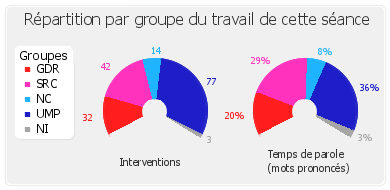Séance en hémicycle du 12 octobre 2011 à 15h00
Sommaire
- Débat préalable au conseil européen (voir le dossier)
- Service citoyen pour les mineurs délinquants (voir le dossier)
- Conditionnements alimentaires contenant du bisphénol a (voir le dossier)
- Épreuve de formation aux premiers secours (voir le dossier)
- Simplification du droit et allègement des démarches administratives (voir le dossier)
- Suite de la discussion après engagement de la procédure accélérée d'une proposition de loi (voir le dossier)
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

L'ordre du jour appelle le débat préalable au Conseil européen du 23 octobre 2011.
La parole est à M. Hervé de Charette, pour le groupe Nouveau Centre.

Monsieur le président, monsieur le ministre chargé des affaires européennes, mes chers collègues, l'euro protège le pouvoir d'achat des citoyens contre les dangers de l'inflation et crée les conditions de la stabilité monétaire à l'intérieur du marché unique. Le premier marché du monde n'aurait pas pu fonctionner avec une quinzaine de monnaies flottant entre elles ; la crise actuelle aurait provoqué une cascade de dévaluations compétitives, disloqué le système et infligé des secousses graves aux entreprises. C'est pourquoi nous savons gré au Gouvernement d'avoir marqué l'attachement indéfectible de la France à l'euro. Mais, à la vérité, l'euro ne court aucun danger. Jamais, dans l'histoire, une grande monnaie n'a disparu sous la pression des marchés ou de la spéculation. La Grèce n'a aucun intérêt à sortir de la zone euro et personne ne peut l'y obliger. Ni la Grèce, ni l'Allemagne, ni aucun autre pays ne le feront.
Les dangers sont ailleurs. Le premier péril, c'est la hausse des taux d'intérêt que subissent les États européens pour prix de leurs dettes. La politique du Gouvernement a permis jusqu'à présent de financer notre dette publique à un taux assez favorable. Malgré cela, le paiement de la dette est, avec 45 milliards d'euros, le premier budget de l'État. Si le taux d'intérêt augmentait de 1 %, il nous en coûterait 10 milliards supplémentaires. C'est pourquoi le groupe du Nouveau Centre a exprimé ici de façon constante son extrême vigilance quant à l'application de la rigueur budgétaire – que nous avons toujours osé appeler par son nom –, quant à une stricte application du pacte européen de stabilité et de croissance et quant aux mesures qui sont en cours d'application pour renforcer la discipline budgétaire des États membres.
Nous demandons avec insistance que la France soit, avec l'Allemagne, lors du Conseil européen, au premier rang des exigences en la matière. Nous croyons nécessaire que la France s'engage à rétablir l'équilibre de son budget à l'échéance 2013, hors paiement de la dette.
Car le second danger qui nous menace est directement issu du laxisme des gouvernements européens, lesquels se sont endettés pour financer la croissance dans des conditions qui, désormais, déstabilisent les banques européennes. Nous jugeons choquant de devoir faire payer par les contribuables européens l'inconséquence des États emprunteurs et la légèreté des banques prêteuses. Même si les circonstances graves ont conduit à agir autrement, nous ne devons pas perdre cela de vue.
Nous entendons dire que la Grèce serait placée en défaut de paiement pour la moitié de sa dette publique auprès des banques européennes et mondiales. Mais, en fait, nous ne savons rien, car le Gouvernement n'a encore donné aucune indication sur ses intentions et sur les négociations en cours avec l'Allemagne. Nous nous réjouirions que les dirigeants européens montrent enfin leur capacité à anticiper, c'est-à-dire, en l'espèce, à mutualiser les dettes publiques et à créer le Fonds monétaire européen dont l'esquisse est déjà sur la table ; nous comptons sur le volontarisme du Président de la République pour y parvenir. Toutefois, tout système ayant pour objet et pour effet de mettre les banques européennes à l'abri de la crise doit avoir pour contrepartie, selon le groupe du Nouveau Centre, la présence de l'État dans les conseils d'administration des banques qu'il serait amené à aider. La responsabilité de chacun doit être remise à sa juste place.
À l'origine de cet enchaînement de crises, il y a le mauvais fonctionnement de l'Europe. Elle n'agit pas, elle réagit. Elle n'anticipe jamais. Les processus décisionnels sont interminables. La règle de l'unanimité intergouvernementale paralyse l'action. Plus encore, après quatre ans de pratique, il est clair que le traité de Lisbonne est inadéquat, dépassé, insuffisant.
Je ferai trois suggestions à ce sujet. En premier lieu, il est urgent que la France et l'Allemagne prennent la pleine mesure de leur immense responsabilité. Je salue donc les efforts accomplis en ce sens par Mme Merkel et M. Sarkozy. On nous annonce, et c'est tant mieux, de nouvelles initiatives : peut-être avez-vous quelque chose à nous dire à ce sujet, monsieur le ministre. En tout état de cause, la France et l'Allemagne doivent aller vite et loin – ce qu'elles n'ont encore jamais fait – pour affirmer leur leadership en Europe.
Deuxièmement, il est indispensable de prendre conscience que le temps où triomphaient les thèses libérales anglo-saxonnes est révolu et que l'Europe a aujourd'hui besoin d'une politique économique fondée sur la régulation publique du système bancaire et sur le volontarisme économique à l'égard des pays tiers.

Il n'est pas nécessaire de parler de protectionnisme européen, mais il faut s'occuper de défendre les intérêts de la France en Europe.
Enfin, puisque le traité de Lisbonne s'avère inadapté, il faut en changer.

Ce qui plombe l'Europe, c'est le refus des nations européennes et de leurs dirigeants de voir que, dans le monde tel qu'il change, il n'y a plus de place pour l'Europe des États et qu'il est nécessaire de concevoir la nouvelle Europe sur une base fédérale…

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Union européenne s'enfonce toujours davantage dans la crise. Comme nous ne cessons de le dénoncer, les choix politiques inscrits dans les traités européens, de celui de Maastricht à celui de Lisbonne, fondés sur une logique de compétition et de mise en concurrence des États membres, expliquent en grande partie la fragilisation financière des États. Je pense notamment au principe de libre circulation des capitaux et aux critères du pacte de stabilité, dont les seuls juges sont désormais les agences de notation, élevées au rang d'arbitres absolus, et les marchés financiers.
Aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face : la politique monétaire de l'Union, conduite par la BCE, devait déboucher, tôt ou tard, sur une crise de grande ampleur. La crise financière de l'été 2007 a fait la démonstration que plusieurs décennies de libéralisation des secteurs financiers et de privatisation des établissements de crédit ont entraîné des problèmes majeurs de fonctionnement. Le système est devenu hors de contrôle. La majorité n'a proposé, au fil des ans, que de le rafistoler à la marge et d'en huiler les rouages, alors que la priorité était de reprendre le contrôle des marchés financiers et des banques.
Malgré les grandes promesses faites par les dirigeants du monde entier en 2008 et 2009, on a pu mesurer, cet été, à quel point la régulation des pratiques spéculatives n'avait pas progressé. Avec le plan de sauvetage des banques de 2008, qui n'avait été assorti d'aucune contrepartie, les établissements bancaires ont d'abord et avant tout pensé à leur redressement financier plutôt qu'au financement de la relance de l'activité économique. Or, ce sont ces mêmes établissements bancaires qui, une fois « renfloués », ont été à la manoeuvre dans la spéculation sur la dette souveraine. Les marchés se sont mis à parier sur le défaut de paiement de certains pays de la zone euro et ont commencé à massivement augmenter les taux d'intérêt des obligations grecques et portugaises. Une fois de plus, la réponse apportée par les dirigeants politiques, notamment Nicolas Sarkozy, n'a pas été à la hauteur. Le plan d'aide à la Grèce n'a été que la répétition du plan d'aide aux banques et a consisté, en réalité, à sauver les banques, au détriment des peuples. La création du Fonds européen de stabilité financière puis l'élargissement de ses missions, convenu le 21 juillet dernier, demeurent des avancées minimes qui n'offrent aucune perspective de désendettement.
L'austérité pénalise l'activité économique, paupérise massivement la population et fait plonger la Grèce dans la récession. Les méfaits de l'austérité ont pourtant été maintes fois dénoncés par d'éminents économistes atterrés, lesquels, depuis la publication de leur manifeste à l'automne 2010, voient leurs hypothèses se vérifier avec l'accélération de la crise. « Nous sommes condamnés au radotage, car l'histoire bafouille », ironise Frédéric Lordon, directeur de recherche au CNRS, qui s'en prend à la « remarquable persévérance dans l'erreur de ceux qui nous dirigent ».
Aucun des prétendus sommets sur la crise n'a en réalité apporté de solution à la crise de la dette ni limité la spéculation effrénée. Ces plans d'austérité ont sur les peuples des conséquences démesurées. Selon les chiffres de la Banque nationale de Grèce, le taux de chômage a doublé en plus de deux ans, atteignant plus de 16 % ; en seulement un an, 65 000 entreprises, dont 7 000 commerces à Athènes, ont déposé leur bilan. Chômage, incapacité de rembourser ses dettes, aggravation de la pauvreté sont autant de conséquences directes des plans d'austérité. En outre, depuis le début de la crise, en 2009, le nombre de personnes qui se sont donné la mort a doublé. Ces suicides sont le signe du profond désespoir qu'engendrent vos décisions.
L'urgence exige que soit mis fin à cette course au désastre et que soient construites des solutions alternatives fortes à l'échelle de l'Union européenne. Ces solutions existent. Nous estimons, pour notre part, nécessaire et urgent d'envisager la refonte des institutions de la zone euro et du système financier international, de prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux fonds spéculatifs, aux fonds de capital investissement, aux paradis fiscaux et à l'évasion fiscale, et de dompter le marché des produits dérivés en le soumettant à des régimes d'autorisation contraignants.
Nous jugeons également indispensable de démanteler les agences de notation privées, de remplacer le pacte de stabilité et de croissance, devenu obsolète, par un pacte de solidarité sociale pour l'emploi et la formation. L'Union doit s'attacher à promouvoir la taxation des mouvements des capitaux spéculatifs et à redéfinir le rôle de la Banque centrale européenne. Cette réforme de la BCE pourrait s'accompagner de la création d'un grand pôle financier public européen constitué en partenariat avec les grandes banques européennes préalablement nationalisées. Ce fonds serait abondé par une taxe sur les transactions financières et une taxe européenne sur les hauts revenus à hauteur de 5 %. L'action prioritaire de ce fonds pourrait être la restructuration et le rachat des dettes souveraines des pays en difficulté.
Il n'est que temps de tirer les leçons des cinglants démentis apportés, semaine après semaine, aux dogmes de l'idéologie néolibérale inscrite au coeur même des traités européens. Contrairement à ce que demande le patronat, il faut, non pas aller vers « une Union politique et économique plus étroite », mais mettre au pas la finance et remettre le social au premier plan.
Nous vous demandons de faire entendre la voix de la France au prochain Conseil européen pour engager une transformation radicale de la construction européenne. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, disons-le avec force : la sortie de la crise passe par un renforcement de l'intégration politique et économique de l'Europe, en particulier de la zone euro. Cette prise de conscience s'est sensiblement accrue sous la pression persistante de la crise. Ainsi, nos partenaires allemands ont confirmé leur engagement européen par le vote massif, regroupant CDU-CSU, sociaux-démocrates et Verts, du 29 septembre dernier au Bundestag sur le Fonds européen de stabilité financière et l'aide à la Grèce.
En Allemagne comme en France, de nombreuses voix s'élèvent à nouveau pour préconiser une intégration politique plus forte de l'Europe, notamment celle de Wolfgang Schäuble et celle d'Alain Juppé, appelant à des transferts de souveraineté supplémentaires.
Nous sommes en effet à la croisée des chemins. Contrairement à ce que prônent les populistes et extrémistes de tout bord, laisser l'euro se défaire serait politiquement, économiquement et socialement catastrophique. Or le statu quo est impossible : il nous faut poursuivre résolument sur le chemin de l'union, avec ambition, courage et lucidité. C'est la voie tracée par l'action du Président de la République, soutenue pleinement par la majorité.
Face aux éternelles Cassandre, il faut rappeler avec force que des étapes considérables ont déjà été franchies depuis deux ans, chaque fois à l'initiative du Président de la République. D'abord, le Fonds de stabilisation financière sera renforcé, après la ratification slovaque que nous espérons aussi prochaine que possible…

…et disposera des instruments adaptés pour agir sur le marché des dettes souveraines et, si besoin, pour soutenir le secteur financier.
Par ailleurs, nous nous sommes dotés, au même moment, des outils d'une gestion budgétaire partagée grâce à l'adoption du « paquet » sur la gouvernance économique. Plus global, plus ambitieux, grâce au semestre européen, et plus crédible grâce aux sanctions « semi-automatiques », le pacte de stabilité et de croissance devient une réalité effective.
Enfin, nous pouvons espérer voir se mettre en place prochainement, grâce à la détermination du Président de la République et de la Chancelière allemande, la taxe sur les transactions financières, ainsi que la convergence fiscale entre la France et l'Allemagne, qui servira de modèle à la zone euro, si nécessaire en coopération renforcée.
À court terme, le règlement de la crise grecque nous met encore devant un choix complexe. Il appartient au Conseil de s'atteler à la recherche de solutions équilibrées, alliant solidarité et responsabilité, notamment en ce qui concerne la participation du secteur privé. Merci, monsieur le ministre, de nous dire où en sont les discussions à ce sujet avec nos partenaires, ainsi que sur la question de la recapitalisation des banques.
Au-delà du règlement de la crise grecque, il nous faut concrétiser les conditions d'une gestion unifiée, commune et durable de l'euro, autour d'une stratégie partagée. Nous avons un vrai problème de gouvernance. Chacun est conscient qu'il faut, notamment, encore étendre le champ de la majorité qualifiée.

Le Président de la République et la Chancelière Merkel ont annoncé, dimanche, qu'ils feraient conjointement des propositions fortes pour une plus grande intégration de la zone euro, comportant éventuellement des modifications aux traités européens. Dans la perspective du Conseil européen du 23 octobre prochain, pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, où nous en sommes sur cette question, notamment où en est la réflexion collective pilotée par le président Van Rompuy ?
L'heure est très grave et les Français sont préoccupés. (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe UMP.) L'enjeu de l'Union européenne est national, européen et même mondial. Le parti socialiste français préfère, lui, la tactique politicienne à l'intérêt général. (Protestations sur les bancs du groupe SRC.)

Le 7 septembre dernier, le groupe socialiste s'est abstenu sur le Fonds européen de stabilité financière et l'aide à la Grèce, contrairement à tous les partis socialistes en Europe qui ont voté pour. Contrairement aux socialistes espagnols, les socialistes français rejettent la règle d'or. (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe UMP.) Et, aujourd'hui, il semble qu'ils soient les otages de la gauche de la gauche de Montebourg sur la démondialisation, le repli sur soi, le protectionnisme,… (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

…autant de recettes archaïques qui consistent à fermer les yeux sur la réalité du monde. Il faut réguler la mondialisation, comme le fait Nicolas Sarkozy au sein de l'Union et du G20, mais non la nier.

Accordez-lui cinq minutes supplémentaires, monsieur le président, ce serait dommage d'interrompre un tel orateur !

Le groupe UMP mesure la responsabilité historique qui est la sienne et il vous soutiendra sans faille, monsieur le ministre, dans les nouvelles initiatives qui seront prises pour sauver l'euro, sur la voie de l'Union politique que nous appelons de nos voeux. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l'a dit Hervé de Charette, il n'est guère facile de débattre du prochain Conseil européen alors que nous n'avons pratiquement eu aucune information à ce sujet.
Un député du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. On ne nous dit pas tout ! (Sourires.)

À part les réponses faites hier par le ministre des affaires étrangères lors des questions au Gouvernement, rien ne nous a été dit sur la préparation du Conseil. C'est donc seulement sur la base des rumeurs ou des informations parues dans la presse que nous devons nous faire une idée.
Le contexte économique et financier, qui s'est beaucoup dégradé ces derniers mois, oblige l'Europe à essayer d'adapter sa réponse et de trouver des solutions à une situation de plus en plus préoccupante…

…à la fois en raison de la crise des dettes souveraines et en raison des perspectives de croissance inquiétantes en Europe, notamment en France et en Allemagne.

Sur ce point, je veux dire à monsieur Lequiller que nous avons bien fait de ne pas voter l'accord du 21 juillet, puisque celui-ci est aujourd'hui caduc, complètement dépassé.
La manière dont les discussions sont en train de se dérouler entre la France et l'Allemagne pour le prochain Conseil européen montre que, à l'évidence, ce qui a été décidé le 21 juillet n'est pas suffisant. Nous l'avons dit ici même, quelques jours avant que la crise financière ne se déchaîne. Cette crise met en évidence l'insuffisance de la réponse européenne, dans son ampleur comme dans sa coordination, et sans doute les autres pays, en particulier les États-Unis et la Chine, auront-ils à coeur de nous le rappeler lors du prochain G20, car la situation préoccupe l'ensemble de la planète.
De ce point de vue, le couple franco-allemand n'a pas bien fonctionné. En dépit de ses prétentions, il ne parvient pas à incarner un leadership dynamique et prospectif pour l'Europe. Entre les deux pays, les relations semblent difficiles, les négociations sont laborieuses et les rencontres de leurs dirigeants sont rarement concluantes, j'en veux pour preuve le résultat du sommet de dimanche dernier. La raison de cette panne est probablement à rechercher dans la situation intérieure des deux États, fragilisés sur les plans politique et économique. En tout état de cause, on ne peut que trouver préoccupants les atermoiements qui marquent les négociations en vue du prochain Conseil européen.
De quoi sera-t-il question lors du prochain Conseil européen ? À l'évidence, nous allons vers une restructuration de la dette grecque beaucoup plus importante que ce qui avait été prévu au départ. La Grèce, prise dans une spirale infernale, ne peut pas s'en sortir sans un allégement très substantiel de sa dette, ce qui aura évidemment un coût très élevé pour les États, mais aussi pour le secteur bancaire. Manifestement, les discussions qui ont lieu actuellement entre la France et l'Allemagne portent sur cet aspect des choses, ainsi que sur la nécessité de recapitaliser les banques.
La recapitalisation est loin d'être évidente car, du fait de leur situation financière, les États européens n'ont plus les moyens d'une intervention massive auprès des banques, et se trouvent confrontés – notamment la France – au risque de voir leur note financière se dégrader. Comme M. de Charette, nous voudrions savoir où nous en sommes sur ce point, quel est l'état des discussions entre la France et l'Allemagne. Le Fonds de stabilité sera-t-il sollicité pour recapitaliser les banques ?
Au-delà, nous posons, pour notre part, deux conditions à la recapitalisation. La première, c'est que des financements publics aient pour contrepartie une capacité de décision relative aux banques accordée aux États concernés. Il ne faut pas, comme cela a été fait il y a quelques mois, donner de l'argent aux banques sans contreparties clairement définies. La seconde condition est celle d'une véritable régulation financière en Europe : des décisions claires et fortes doivent être prises en ce domaine. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Jean Leonetti, ministre chargé des affaires européennes.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mesdames et messieurs les députés, si les Conseils européens sont des rendez-vous importants, celui du 23 octobre prochain est majeur. Ils sont importants pour la France et pour l'Europe, pour l'ensemble des peuples qui attendent avec angoisse une sortie de crise et des solutions aux problèmes auxquels ils font face au quotidien. Ils définissent les grandes orientations de la politique européenne et permettent de prendre au plus haut niveau les décisions nécessaires. Aujourd'hui, ces décisions sont impératives et doivent être courageuses.
Dans les temps bouleversés que nous vivons, le Conseil du 23 octobre prend un sens particulier. Comme l'a dit M. Lequiller, l'Europe se situe à un tournant de son histoire, car nous traversons une crise globale, qui marque la fin d'un monde ancien et annonce la construction nécessaire d'un monde nouveau dont l'Europe doit faire partie. Le statu quo est intenable, nous ne pouvons plus hésiter, encore moins reculer. Nous avons l'impérieux devoir d'aller de l'avant et d'entrer dans cette nouvelle époque avec détermination et confiance.
Pour cela, nous devons examiner avec lucidité les faiblesses de la construction européenne. D'abord, nous avons adopté une monnaie unique sans faire converger nos politiques économiques, extrêmement hétérogènes. Ensuite, face à la concurrence des pays émergents, les pays occidentaux développés se sont réfugiés dans un endettement public devenu insoutenable.
Mesdames et messieurs les députés, nous ne sommes pas devant une crise de l'Europe, encore moins devant une crise de l'euro, qui est une monnaie forte…
…mais devant une crise de la dette souveraine d'un certain nombre de pays de la zone euro. Nous avons donc à résoudre des problèmes nationaux au niveau européen.
J'entends souvent dire que l'Europe met du temps à prendre ses décisions, et j'avoue être surpris de l'entendre dans la bouche de parlementaires. L'Europe est faite d'États démocratiques et les décisions prises par les chefs d'États passent devant les parlements, qu'il s'agisse du Bundestag ou de l'Assemblée nationale. Il est donc logique que ce parcours démocratique, qui passe par l'ensemble des parlements européens, prenne un certain temps.
Par ailleurs, certains se demandent comment il se fait que le Président de la République n'ait pas pris de décision. Je vous rappelle, mesdames et messieurs les députés, que le Président de la République française n'est pas le maître de l'Europe… (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
…et que le couple franco-allemand ne décide pas non plus pour l'ensemble de l'Europe.
Lorsque la Chancelière allemande et le Président de la République française se réunissent et proposent des décisions, j'en entends qui s'étonnent de les voir décider seuls pour les autres. Mais, lorsqu'ils ne se réunissent pas, ou qu'ils se réunissent mais ne prennent pas de décisions fortes, certains s'étonnent encore !
Il faut être lucide, et prendre conscience du fait que le couple franco-allemand est l'indispensable moteur de l'Europe…
…indispensable pour faire des propositions, pour des raisons historiques, mais aussi économiques : la France et l'Allemagne représentant 55 % du produit intérieur brut de la zone euro, il n'est pas anormal que nos deux pays se réunissent pour faire des propositions.
Aujourd'hui, chacun doit savoir faire preuve de modération et considérer que l'initiative du Président de la République est la bienvenue, mais que, au niveau européen, les décisions démocratiques nécessitent un certain temps, celui de l'intervention des parlements.
L'Europe, j'en suis sûr, sortira de cette crise comme des autres ; elle en sortira renforcée et plus intégrée.
Les débats du Conseil seront centrés sur trois thématiques décisives : la gouvernance économique de la zone euro et la croissance de demain ; le G20, au sein duquel la France, qui le préside, et l'Europe doivent marquer leur empreinte sur le monde ; le réchauffement climatique et la conférence de Durban.
En ce qui concerne la zone euro et la gouvernance économique, les avancées sont claires. Qui aurait pensé, il y a encore quelques mois, voire quelques semaines, que l'on puisse parler de gouvernance économique européenne et d'intégration européenne, que l'on puisse avancer sur un fonds monétaire européen, qu'Hervé de Charette avait appelé de ses voeux, que l'on puisse enfin évoquer le fédéralisme économique – ce mot n'est pas un tabou pour moi, car ce qu'il recouvre est devenu une idée neuve et forte pour la construction européenne ?
Oui, le Fonds européen de stabilité financière est un véritable fonds monétaire européen. Il va servir à travailler de manière préventive, à racheter la dette sur les marchés secondaires et à recapitaliser les banques en difficulté.
La Commission européenne va annoncer aujourd'hui des propositions visant à moderniser nos outils de recapitalisation des banques et à aller plus loin que les projets élaborés dans le cadre des accords de Bâle III. Il s'agit de recapitaliser les banques pour qu'elles aient des fonds propres plus importants. Cela dit, je précise que les banques françaises, dans leur ensemble, ne sont pas en difficulté.
La gouvernance économique a progressé. Le Parlement européen a voté ce que l'on appelle le paquet « gouvernance économique », dit « six pack », qui va permettre une meilleure prévention, la surveillance des bouleversements macroéconomiques qui peuvent se dérouler notamment dans notre pays et une surveillance renforcée des politiques budgétaires et des risques de dette.
Pierre Lequiller l'a dit très justement : il est nécessaire de renforcer le pilotage de la zone euro.
Notre objectif est d'instaurer un gouvernement économique commun, car nous partageons une monnaie unique.
Le président du Conseil fera connaître ses propositions dans les jours qui viennent. D'ores et déjà, la France et l'Allemagne, à l'initiative du Président de la République, ont demandé que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent régulièrement, en l'occurrence deux fois par an. La présidence stable du sommet de la zone euro, qui pourrait être confiée à Herman Van Rompuy, confortera cette ébauche de gouvernement économique européen.
La gouvernance économique renforcée n'aura de sens que si elle s'appuie sur la croissance. À cet égard, nous oublions parfois que nous disposons aujourd'hui d'une force considérable au niveau européen, avec 500 millions d'habitants et un PIB cumulé annuel de 12 000 milliards d'euros. Si l'on se souvient que la Grèce représente 2 % de ce PIB et que sa dette compte pour 4 % de celle de la zone euro, on comprend que le problème n'est pas insurmontable.
La France se bat pour une politique industrielle forte, particulièrement dans les domaines de l'innovation, avec Galileo, le Programme européen de surveillance de la Terre, le numérique et les technologies vertes. C'est là que résident l'avenir de l'Europe et celui de la croissance et de l'emploi ; c'est là que se trouve l'avenir de nos concitoyens.
Enfin, je rappelle que la France défend le principe de réciprocité, qui n'est rien d'autre que la loyauté commerciale. J'entends un certain nombre de pays accuser la France de protectionnisme. Est-ce du protectionnisme que d'imposer à l'intérieur de la zone euro des règles sociales et écologiques, sans oublier le développement durable, alors même que nos marchés sont pénétrés par des pays qui n'ont en aucun cas le respect de ces règles ?
Est-il normal que 12 % des pneus qui roulent sur les routes européennes ne soient pas conformes aux normes que nous imposons à nos industriels ?
Est-il normal qu'une société chinoise, aidée par son gouvernement, trouble la concurrence entre les entreprises en décrochant le marché d'une autoroute en Pologne qu'elle n'est même pas capable de finir ? L'Europe doit aussi être un marché qui sache se protéger.
S'agissant du G20, vous savez que la présidence française se veut résolument européenne. Elle doit répondre à la crise économique et financière, qui est une crise des marchés mondiaux. C'est la raison pour laquelle la date butoir, fixée au début du mois de novembre, est importante : nous devons avoir réglé les problèmes de la zone euro avant le sommet du G20, sous peine de voir l'Europe porter la responsabilité de la crise, alors que cette responsabilité ne lui revient en rien.
Retour de la croissance, redressement de nos finances publiques et stabilité du système financier : voilà les objectifs du G20, dans lequel la France a imposé une dimension sociale de la mondialisation, avec une reconnaissance d'un socle de protection sociale.
C'est la marque de la France ; c'est la marque de l'Europe. Dans le domaine agricole, il sera question de la prévention des crises agricoles et, en ce qui concerne le développement, de la taxation des transactions financières. En effet, il nous paraît normal que les transactions financières puissent être taxées : c'est en partie à cause des mouvements financiers que la crise mondiale existe.
Enfin, pour ce qui est du réchauffement climatique et de la conférence de Durban, je sais que certains d'entre vous se sont fortement impliqués dans ce projet – projet français et exigence française. L'Union européenne a toujours assumé une politique volontariste en matière de développement durable. Elle a ainsi fixé des barèmes très hauts en matière d'économie verte et de transferts de technologie pour l'énergie de demain ; l'objectif est de 20 % pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais l'Europe ne représente que 11 % des émissions mondiales. De même, l'ensemble des pays signataires du protocole de Kyoto ne représente que 16 % des émissions.
C'est la raison pour laquelle il est impératif que nous puissions convaincre le monde de l'importance de cet enjeu économique et social, qui met en cause l'avenir de notre planète.
C'est la raison pour laquelle il faut engager une seconde période du protocole de Kyoto, pour permettre une transition vers un accord global, ambitieux et juridiquement contraignant, qui nous permettra de tenir l'engagement de limiter à deux degrés l'élévation de la température mondiale.
J'ai une conviction forte que je voudrais vous faire partager.
Oui, et même à vous, monsieur Myard. (Sourires.)
Nous avons besoin de construire une Europe nouvelle. Nous avons la lucidité de regarder les faiblesses que nous avons accumulées au fil du temps.
La crise, c'est le passage d'un monde qui disparaît à un monde qui se construit.
Nous avons la responsabilité de faire en sorte que l'on puisse créer une Europe nouvelle ; une Europe qui protège par ses frontières l'ensemble d'un territoire, mais qui protège aussi son économie de celles qui la concurrencent de manière déloyale ; une Europe intégrée et innovante ; une Europe aux frontières stables et protégées ;…
…une Europe des valeurs qui soit capable de développer l'idée de liberté et de démocratie ; une Europe prospère, capable d'exhorter le monde à regarder le modèle européen. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et sur de nombreux bancs du groupe NC.)

Nous en arrivons aux questions des groupes.
Pour le groupe Nouveau Centre, la parole est à M. Yvan Lachaud.

Monsieur le ministre, s'il y a en France une catégorie professionnelle qui attend beaucoup de l'Europe, c'est bien celle des agriculteurs. Ils lancent tous les jours un cri d'alarme à propos de la concurrence qui règne au sein même de l'Europe. Les éleveurs, les producteurs de fruits et légumes et les vitiviniculteurs savent aujourd'hui que la plus grande de leurs difficultés réside dans l'écart de compétitivité avec nos voisins européens : c'est vrai pour le Sud de la France avec l'Espagne ; c'est vrai pour l'ensemble de notre territoire avec l'Allemagne, notamment.
J'en prendrai deux exemples. D'abord, le coût de la main-d'oeuvre dans certaines régions européennes – en Allemagne, par exemple – est de 6 à 8 euros de l'heure, contre 13 euros en France.

Ensuite, les produits phytosanitaires sont vendus à moitié prix en Espagne et, alors qu'ils sont interdits chez nous, ils servent là-bas aux exploitants pour traiter les fruits et légumes qui sont ensuite vendus sur notre territoire.
Plusieurs députés du groupe NC. C'est scandaleux ! Inadmissible !

Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus les moyens de se battre. Monsieur le ministre, il est de notre devoir d'affirmer que l'agriculture n'est plus un secteur comme les autres.

Il est de notre devoir d'organiser et d'aider une agriculture de qualité. Il est de notre devoir d'instaurer une réglementation fiscale et sociale européenne.

Il est de notre devoir d'imposer des règles communes à l'Europe. Monsieur le ministre, qu'entend faire la France pour répondre à ce cri d'alarme justifié de nos agriculteurs ? (Applaudissements sur les bancs du groupe NC.)
Monsieur Lachaud, sachez que la politique agricole commune constitue une priorité pour la France. À cet égard, nous avons trois exigences. D'abord, nous nous opposons à la renationalisation de la PAC. Il s'agit bien d'une politique communautaire ; l'Europe en a la responsabilité et doit continuer à l'assumer.
Ensuite, en ce qui concerne la défense de la PAC dans les perspectives financières pour la période 2014-2020, la France a affirmé de manière très claire qu'elle n'accepterait aucun projet financier pour cette période si la stabilité de la PAC n'est pas incluse dans le paquet financier. Nous l'avons répété à plusieurs reprises, si bien que même les pays qui ne sont pas très favorables à la politique agricole commune ont compris que notre intransigeance serait totale.
Enfin, nous refusons tout accord commercial avec un tiers ou une zone géographique qui ne respecterait pas le principe de la réciprocité, que j'ai déjà évoqué. Il n'est pas question d'ouvrir les marchés agricoles de l'Europe de façon à créer des situations de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la Commission européenne a accepté aujourd'hui même un paquet législatif sur l'avenir de la PAC.
Vous avez également évoqué, à juste titre, le coût du travail dans les exploitations agricoles. Le Premier ministre s'est engagé en mars dernier à faire baisser le coût du travail au vu de la crise que connaît le secteur.
Et à celui de Bernard Reynès.
Le Président de la République a annoncé hier, lors de son déplacement dans la Creuse, que certains amendements déposés sur le projet de loi de finances pour 2012 par MM. de Courson, Remiller, Reynès et Dionis du Séjour seraient acceptés par le Gouvernement.

Monsieur le ministre, le système financier n'est pas isolé du système économique en général. Il est lié aux dimensions énergétique, agricole et sociale. C'est pourquoi, à mon avis, vous ne vous en tirerez pas par des instruments de pure régulation financière. Il faut réintroduire de la politique en Europe.

Bien sûr, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut imposer quelques limites aux déficits publics, mais cela doit se faire en tenant compte des politiques sociales et environnementales, des contraintes écologiques, de la justice et de la démocratie.
Un député du groupe UMP. Pour cela, il faut de la croissance !

Bref, il faut une Europe politique – une Europe fédérale des régions et des peuples solidaires, comme nous aimons à le dire.
Êtes-vous favorable, monsieur le ministre, à cette union politique, sociale et écologique reposant sur des euro-obligations, sur une convergence fiscale et sur une augmentation des ressources propres pour le budget européen ?
Monsieur Cochet, votre question comporte deux aspects : vous posez le problème d'un fédéralisme des régions, auquel le Gouvernement n'est pas favorable, mais vous soulevez également celui des euro-obligations.
Qu'est-ce qu'une euro-obligation ? C'est la mutualisation de la dette de l'ensemble des pays de la zone euro, par l'émission de bons du Trésor, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule dette. Cela serait possible, monsieur Cochet, s'il n'y avait aucune hétérogénéité à l'intérieur de la zone euro. Mais il suffit de comparer la dette grecque et la dette allemande, la dette espagnole et la dette française, pour se rendre compte que nos économies sont très disparates. Si nous faisions immédiatement ce que vous suggérez, nous mettrions donc la charrue avant les boeufs. Le projet que vous évoquez n'est pas utopique, mais il passe par une convergence et une discipline.
Il faudra, en effet, une certaine convergence sociale et fiscale, pour que chaque peuple se sente solidaire des autres.
Grâce à cette convergence, grâce à la politique de croissance qu'elle permettra, l'euro-obligation sera possible.
L'euro-obligation que vous évoquez suppose de la solidarité, mais elle implique aussi de la discipline. La solidarité sans la discipline, cela mène la Grèce là où elle est, cela mène à la faillite des États. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) La discipline sans la solidarité, cela mène à la misère pour les peuples. Aujourd'hui, au travers des propositions du Président de la République et de la Chancelière allemande, l'Europe apporte à la fois la discipline et la solidarité. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Monsieur le ministre, permettez-moi de faire deux remarques préliminaires. L'Europe est en crise, personne ne saurait le nier. Mais cette crise n'est-elle pas due à la boulimie de l'Europe, qui a empilé les compétences à Bruxelles et qui, après s'être élargie, doit aujourd'hui s'amaigrir et s'en tenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la gestion d'un continent ?
Deuxièmement, se pose la question de la zone euro. Il est impossible – vous venez de le reconnaître – de mener une politique monétaire unique avec des économies divergentes, et c'est d'autant plus difficile quand on adopte la politique monétaire de l'économie dominante, celle de la Buba – la Bundesbank. Nous ne nous en sortirons pas, je le crains, si nous n'en passons pas par la monétisation de la dette, si nous ne faisons pas baisser l'euro sur les marchés afin de retrouver une compétitivité au plan international.
Ma question concerne plus précisément la concurrence et la politique commerciale de l'Union européenne. Aujourd'hui, le « tout concurrence » de la Commission me paraît complètement décalé par rapport aux économies émergentes qui pratiquent très souvent le dumping social, le dumping économique, le dumping politique et financier, en manipulant leur monnaie sous-évaluée, alors même que la direction de la concurrence de Bruxelles est toujours sur le level playing field. Je suis intimement convaincu que, pour défendre notre industrie, il nous faut aujourd'hui avoir une politique industrielle nationale et communautaire. C'est bien la question fondamentale, car le « tout concurrence » aboutit à la désindustrialisation de la France et de l'Europe.
Aussi, ma question sera-t-elle simple.

Quelles initiatives le Gouvernement prendra-t-il pour aller dans ce sens ?
Monsieur le député, j'ai lu avec intérêt votre rapport relatif à la politique industrielle. Il comporte de nombreux éléments pertinents, que vous avez rappelés.
Une Europe qui se construit, c'est une Europe qui se défend, qui affirme qu'elle a des frontières, qui ne s'étend pas éternellement à l'ensemble des pays du monde. Une Europe qui se construit, c'est une Europe qui approfondit, qui défend la compétitivité. Une Europe qui se construit, c'est une Europe qui défend la croissance.
Compétitivité et croissance : je l'évoquais dans mon propos préliminaire, comment pouvons-nous faire en sorte de vivre dans un monde ouvert sans nous retrouver dans une situation de non-réciprocité ou de concurrence déloyale ? Je préférerais d'ailleurs l'expression de « concurrence déloyale », pour que certains esprits chagrins ne taxent pas la France de protectionnisme. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP.) Nous ne sommes pas là pour protéger nos industriels, mais pour que les règles du jeu soient les mêmes à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur.
Nous sommes là pour faire en sorte que, lorsqu'un produit industriel est fabriqué dans des conditions sociales et écologiques très différentes de celles imposées à l'intérieur de la zone euro ou de l'Europe, une taxe soit imposée aux frontières. Et nous en venons aux deux grandes propositions de la France au niveau européen : il faut imposer la réciprocité et la concurrence loyale, imposer que, grâce au budget européen, l'Europe progresse, se projette, avec les grands projets concernant le numérique, Galileo ou ITER, et imposer, au sein de la zone euro, l'émergence de l'élément social, culturel et démocratique. La réciprocité, la concurrence loyale, la compétitivité : c'est l'objectif de la France, c'est l'objectif de l'Europe. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le ministre, je ferai deux observations. Premièrement, la crise des dettes souveraines a peu à voir avec le pacte de stabilité ; il existait une dette non soutenable du secteur privé. Pourtant, rien n'est dit sur la façon dont l'Union compte suivre et contrôler les mouvements du crédit et lutter contre la spéculation.
Deuxièmement, la crise de l'endettement privé, devenue crise de l'endettement public de plusieurs États, exige une solution à grande échelle. La taille du Fonds de stabilité financière, qui ne s'adresse pas seulement à la Grèce, n'a malheureusement pas été discutée à cette aune. Le niveau d'engagement des banques impliquées, dont la contribution reste fondée sur le volontariat, n'est pas encore connu définitivement.
Par ailleurs, au-delà des restrictions sur les dépenses publiques, c'est l'absence de mesures pour l'avenir qui inquiète. Si l'on n'investit plus, on ne prépare plus l'avenir. Il faut, comme le dit Jacques Delors, aller vers un système interétatique de gestion de la dette des États, plus grand et plus fort que les marchés.
La dette pourrait être gérée de façon mutualisée, pour une part qui ferait l'objet d'émission d'obligations européennes. Cela soustrairait la dette à la spéculation, mais pas au remboursement. Parallèlement, la Banque centrale européenne pourrait financer les investissements d'avenir et les fonds européens structurels pourraient être calibrés pour aider les États en difficulté et assurer un minimum de croissance.
En d'autres termes, ce qui est sauvé pour l'instant, c'est la stabilité de la monnaie, mais ce qui disparaît, c'est l'espoir d'une prospérité liée à la richesse réelle produite.
Monsieur le ministre, sur la prévention de l'endettement privé et la gestion des solutions durables pour lutter contre la spéculation sur la dette des États, votre Gouvernement compte-t-il proposer et défendre des mesures allant dans le sens que je viens d'exposer ?
Madame la députée, votre question pertinente et complexe montre que vous connaissez les problèmes techniques que vous évoquez. Je ne pourrai qu'y répondre incomplètement dans les deux minutes qui me sont imparties, mais je commencerai par rappeler deux points.
Lorsque la banque Lehman Brothers fait faillite, les États-Unis décident de ne pas venir à son secours, parce qu'elle doit assumer ses responsabilités et parce qu'il faut montrer à l'ensemble du système bancaire qu'il est des voies sur lesquelles on ne doit pas s'aventurer. On connaît la suite : une crise financière mondiale qui devient économique, puis sociale. Aujourd'hui, face à la crise d'un pays souverain, la Grèce, les mêmes nous disent de laisser tomber, qu'elle l'a bien cherché et que, de toute façon, elle ne s'en sortira pas.
Nous avons un devoir de solidarité, mais aussi un devoir d'économie générale. Ceux qui ont aimé l'abandon d'une banque aux États-Unis adoreront l'abandon d'un pays dans la zone euro. Cela aboutira aux mêmes phénomènes en chaîne, à la même contamination et, après la Grèce, viendront l'Italie et l'Espagne, puis d'autres. Et l'Europe sera désagrégée et livrée aux spéculateurs mondiaux.
Nous voulons construire les outils que vous avez évoqués : un Fonds européen de stabilité financière, un véritable Fonds monétaire européen. En même temps, il faut, bien sûr, recapitaliser les banques et les obliger à le faire sur leurs fonds propres, sans redistribuer l'ensemble de leurs dividendes à leurs actionnaires. En six mois, les banques françaises ont recapitalisé 10 milliards d'euros. Cela signifie bien que l'exposition des banques françaises à la dette grecque n'était jamais que de 10 milliards d'euros.
Notre objectif est donc raisonnable : nous soutiendrons la Grèce, elle ne sortira pas de la zone euro. La zone euro sera renforcée. Les mécanismes que nous utilisons, tant pour les banques que pour les États, viendront stabiliser l'ensemble des politiques économiques et financières de la zone euro, mais viendront aussi au secours des peuples en difficulté. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Monsieur le ministre, ce n'est pas porter atteinte à la considération et à l'amitié que nombre d'entre nous vous portent que de souligner, en préalable, que, à la veille d'un Conseil européen que tout le monde qualifie de crucial, dans un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'Union européenne et de l'histoire de nombre des pays qui la composent, au moment où tant de questions se posent sur la politique qui va être suivie et où la plupart de nos concitoyens ne savent pas quels sont les grands choix qui sont sur la table, il n'aurait pas été inutile que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères et européennes soient présents dans ce débat. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
Nous sommes nombreux à approuver les déclarations d'intention que vous venez de tenir, mais les bruits qui circulent à propos des décisions qui se préparent en matière de restructuration des dettes et de recapitalisation des banques ne vont pas du tout dans le sens que vous dites. Ce qui se prépare, nous dit-on – et j'espère que c'est une erreur –, c'est l'organisation d'un défaut partiel de la Grèce. Si la voie choisie est celle de la déclaration de l'incapacité de la Grèce à rembourser sa dette à hauteur de 50 ou 60 %, alors il ne fait aucun doute que vous déclencherez un mouvement de contamination du soupçon et de la défiance qui ne s'arrêtera pas à la Grèce et s'étendra à d'autres pays. Vous avez cité l'Espagne et l'Italie : au bout du chemin, il y a la France.
Je voudrais donc, monsieur le ministre, que vous nous rassuriez, si possible, sur les décisions qui seront prises et sur l'exclusion, qui devrait être la nôtre, de toute hypothèse de défaut partiel de la Grèce. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe SRC.)
Monsieur le député, je vous remercie de vos marques d'amitié, de confiance, de convergence. Je suis désolé de n'être que le ministre des affaires européennes, mais, vous le savez, lorsque le ministre des affaires européennes s'exprime, il le fait au nom de la France, sur l'impulsion du Président de la République, du Premier ministre et sous le contrôle du ministre d'État. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) Lorsque je prends la parole ici, ce n'est donc pas seulement ma voix personnelle qui s'exprime : si tel était le cas à un moment ou à un autre, je ne manquerais pas de le signaler.
Vous posez la question de l'inquiétude. Faut-il que je dévoile les hypothèses que la Commission peut envisager ? Faut-il que je relate le petit-déjeuner de lundi matin qui a réuni, à huis clos, les ministres des affaires européennes à la demande de Herman Van Rompuy, et au cours duquel celui-ci a évoqué l'ensemble de ces problèmes. Je note d'ailleurs que M. Van Rompuy ne s'est pas posé la question de savoir s'il aurait en face de lui des ministres d'État ou des ministres des affaires européennes. Il a convoqué les ministres des affaires européennes.
Lorsque la Grèce a été placée dans cette situation où la rigueur a amené la récession et la récession la misère, nous avons eu, ensemble, la volonté d'apporter de la croissance à ce pays.
Lorsque les banques ont renoncé à 21,5 % de leurs dettes, elles ont en partie restructuré la dette grecque. Il est bien normal que les banques renoncent à une partie de leurs dettes devant un État souverain en grande difficulté.
Et il n'est pas anormal que, aujourd'hui, nous demandions la recapitalisation des banques sur leurs fonds propres…
…pour qu'elles puissent assumer le problème bancaire au niveau de responsabilités de la crise dans laquelle nous nous trouvons.
Oui, nous aiderons la Grèce, oui, la Grèce restera dans la zone euro, non, la Grèce ne fera pas faillite : l'Europe ne le permettra pas. Au contraire, elle veillera à ce que, après cet épisode, la Grèce retrouve la croissance nécessaire, grâce d'ailleurs aux 8 milliards d'euros débloqués pour les fonds structurants. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le ministre, les États, conscients que leur isolement serait fatal à leur développement, recherchent de nouvelles coopérations multipolaires pour lutter contre l'instabilité globale. Ces coopérations, pour être efficaces, réunissaient les puissances industrielles traditionnelles du G8. Avec le G20, les grands émergents du Sud sont enfin associés. Pour la première fois dans la courte histoire de cette nouvelle diplomatie, la présidence du G20 échoue pour une année civile complète à un pays, la France, et les deux présidences du G20 et du G8 coïncident. Cette opportunité de pilotage unifié, à un moment où les mentalités sont plus ouvertes que jamais à la régulation économique, a contribué au succès du sommet du G8 à Deauville, en mai dernier, et a conforté la confiance de la communauté internationale vis-à-vis de la présidence française.
Le Président et de la République et le Gouvernement sont d'ailleurs parvenus à inscrire à l'agenda du G20 les thèmes jugés pourtant ambitieux : les déséquilibres macro-économiques mondiaux, la nécessaire réforme du système monétaire international, la régulation des marchés financiers, et la recherche d'une meilleure coordination internationale sur les marchés agricoles en vue de réduire la volatilité des prix des produits de base.
Mais la dynamique politique d'un sommet éclôt en fonction du contexte économique international. La crise de l'euro et les hésitations de la gouvernance européenne seront donc au coeur des discussions des 3 et 4 novembre prochain. Le monde entier, inquiet d'une possible contagion, est en effet préoccupé par l'instabilité qui prévaut en Europe.
J'en viens à ma partie interrogative. Avec la Commission européenne, le Conseil européen, quatre États membres – l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie –, la Banque centrale européenne et l'Espagne, invitée permanente, l'Union européenne est la zone géographique la mieux représentée dans le G20. Monsieur le ministre, l'Europe profitera-t-elle réellement de cette représentation ? L'organisation de l'Union européenne au G20 est certes bien rodée, mais sa gouvernance est-elle optimale ? La gouvernance de l'Europe lui permet-elle de parler d'une voix suffisamment forte et claire pour défendre ses aspirations et ses intérêts ?

Au-delà de cette première série de questions d'avant G20 à Cannes, je voudrais évoquer une piste et, en même temps, une dernière question : ne doit-on pas réfléchir à une fusion des fonctions de Président du Conseil européen et de Président de la Commission européenne, une solution rendue possible par les traités et qui n'exigerait pas une révision longue et aléatoire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Monsieur Lecou, vous avez posé deux questions.
Vous avez d'abord demandé si la présidence française du G20 était une présidence européenne. Vous venez de le démontrer, la France a voulu, présidant le G20, faire en sorte que tous les pays soient associés à l'ensemble des décisions qui sont prises, en particulier au niveau de chaque conseil des ministres concerné. Cette présidence française est une présidence européenne et les décisions qui se prendront au G20 seront des décisions fortes.
Votre seconde question est institutionnelle. Faut-il réviser les traités ? Non. Chacun s'en souvient, chaque pays a adopté, avec quelques difficultés, un certain nombre de règles. Le traité de Lisbonne, dit traité simplifié, a offert diverses possibilités. Mais, que ce soit au niveau du Fonds européen de stabilité financière ou au niveau de la présidence, nous n'avons pas besoin de revoir nos traités pour conforter un pilotage économique européen de la zone euro.
En revanche, à l'initiative du Président de la République et en accord avec la Chancelière, des propositions ont été faites sur l'ensemble de la zone euro pour permettre d'avoir une présidence stable. Grâce au Président Van Rompuy, qui désormais préside le Conseil, une certaine stabilité est donnée aux décisions européennes et donc à la gestion du nouvel instrument qu'est le Fonds européen de stabilité financière.
Je ne pense pas que, dans la situation actuelle, il soit nécessaire de changer nos institutions ou nos traités. Nous avons des outils. Nous avons la volonté politique, qui a été affichée clairement par le Président de la République et qui est partagée par l'ensemble des chefs d'État. Il ne reste plus, à vingt-quatre heures près, qu'un pays pour adopter le Fonds européen de stabilité financière. Le paquet de gouvernance économique a été approuvé par le Parlement européen. Nous pouvons désormais aller de l'avant et aller plus loin, vers une Europe plus efficace et plus intégrée. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le ministre, la zone euro connaît la crise la plus grave depuis sa création, une crise de la dette qui n'est pas sans lien avec les répercussions de la crise financière de 2008. Alors que vous pensiez, une fois de plus, avoir apporté une solution pérenne à cette crise, la situation s'est de nouveau dégradée cet été.
Vous mettez en avant le caractère inédit de cette crise, mais vous ne pouvez vous dédouaner de ses causes structurelles. Certains pays de la zone euro, dont la France depuis 2002, n'ont pas respecté les critères du traité de Maastricht visant à garantir des finances publiques saines et un déficit soutenable. En ce moment, la zone euro en paye les conséquences, auxquelles s'ajoute une défaillance des marchés.
Aujourd'hui, pour améliorer la gouvernance de l'euro, il est urgent de mieux coordonner la politique économique des pays membres de la zone et d'aller vers une intégration plus approfondie. La nomination d'un président de l'Eurogroupe à temps plein a été proposée. En dépit de cette mesure fort intéressante, il manque encore une vision claire du degré et de l'ampleur de l'intégration économique et budgétaire envisagée. C'est une interrogation majeure à laquelle les prochains Conseils européens doivent apporter des réponses. Pouvez-vous indiquer la position que la France défendra auprès de nos partenaires le 23 octobre ?
M. Van Rompuy, Président de l'Union européenne, a récemment évoqué une réforme institutionnelle, ainsi que la perspective de la convocation d'une nouvelle conférence intergouvernementale le 9 décembre prochain. Comment le Gouvernement envisage-t-il ces échéances ? Quelles propositions la France fera-t-elle lors de ces discussions ?
Le Président de la République a souhaité, dimanche dernier, que la crise de l'euro soit résolue d'ici à la réunion du G20 les 3 et 4 novembre prochain. Cet engagement sera-t-il tenu ? Des mesures concrètes et énergiques seront-elles proposées par la France à nos partenaires en vue de sortir définitivement de la crise ou s'agit-il simplement d'un nouvel effet d'annonce ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Vous avez raison, madame la députée, d'évoquer la crise de 2008 et la crise actuelle. Mais la crise de 2008, c'est une crise des banques alors que la crise actuelle, c'est une crise des dettes, une crise des dettes des États souverains.
Non, pas à cause des banques, à cause des déficits qui ont été creusés dans un grand nombre de démocraties.
Je m'étonne que vous posiez la question de cette façon dans la mesure où il semble que vous ne soyez pas favorable à la règle d'or qui imposerait justement que l'on arrête le déficit dans notre pays. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Vous vous souvenez de ce que vous avez fait de la règle d'or de la CADES ? Vous êtes un grand comique ! C'est votre collaborateur qui vous a soufflé cet argument ?
Je voudrais également vous rappeler les engagements qui ont été pris pour les déficits de la France : 5,7 % maintenant, 4,6 % l'année prochaine et 3 % – justement le critère de Maastricht – l'année d'après.
Dans une période de crise, la France tient le cap et fait en sorte d'être un exemple pour l'ensemble des pays européens. Je souligne – bien que je sache que cela n'a pas une grande valeur à vos yeux – qu'elle a une notation triple A. J'ajoute – et je sais que cela a une valeur à vos yeux – que la France emprunte à un taux très bas, pratiquement le même taux que l'Allemagne : l'Allemagne emprunte à 2,2 %, la France emprunte à 2,8 %, quand la Grèce emprunte à 18 %.

C'est honteux : plus tu es pauvre, plus tu payes ! Quel système scandaleux !
Ainsi, lorsqu'on a une économie saine et que l'on se dote d'un plan rigoureux de gestion de la dette publique, on est récompensé par des possibilités d'emprunter, parce que la signature de la France est honorée.
Vous me demandez ensuite si nos propositions resteront des effets d'annonce ou si elles se concrétiseront. Un fonds européen de stabilité financière voté par tous les États, est-ce une annonce ou un fait réel ? C'est un fait réel. Une gouvernance économique mise en place avec une présidence stable de Van Rompuy, est-ce un effet d'annonce ou une réalité ? C'est une réalité. L'obligation pour les banques de se restructurer et de faire en sorte que leurs fonds propres augmentent – réponse de Bâle 3 –, est une annonce ou une réalité ? C'est une réalité.
Contrairement à ce que vous avez l'air de dire, le 21 juillet, des décisions ont été prises, qui sont en train de se mettre en place. Elles nous font une Europe plus forte, plus intégrée et plus efficace, pour l'intérêt de l'ensemble des États, mais également de chaque peuple. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt.)


Dans les explications de vote, la parole est à M. Marc Dolez, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi, soumise à notre vote dans le cadre injustifié de la procédure d'urgence, ne répond en rien au problème de la délinquance des mineurs. Fondé sur le constat inexact d'une croissance exponentielle de celle-ci et d'une prétendue absence de solutions autres que la prison ou la rue, ce texte propose de créer un service citoyen encadré par d'anciens militaires.
Le dispositif, loin d'être novateur, vise simplement à étendre à certains mineurs délinquants ce qui existe déjà avec les EPIDE – les centres de l'Etablissement public d'insertion de la défense – pour de jeunes volontaires déscolarisés et en passe de marginalisation.
Fait exceptionnel, la commission de la défense a rejeté cette proposition de loi élaborée à la hâte et sans concertation avec les professionnels, la considérant comme irrecevable en l'état.
Il s'agit en réalité d'un texte d'affichage politique, à quelques mois de l'élection présidentielle, un texte à la fois inutile et dangereux.
Inutile, car l'article 10 de l'ordonnance de 1945 permet déjà le placement de mineurs dans des établissements ou des institutions d'éducation, de formation professionnelle ou de soins de l'État ou d'une administration publique. De plus, le dispositif se limitant à trois cas – la composition pénale, l'ajournement de la peine et le sursis avec mise à l'épreuve –, seuls des mineurs ayant commis des actes relativement peu graves, environ deux cents, seront concernés et non les mineurs récidivistes, comme annoncé initialement.
La question du financement est, quant à elle, tout simplement ignorée. Alors que la Cour des comptes a souligné en février dernier le coût élevé des EPIDE – 40 000 euros par personne et par an en 2009 –, il y aurait lieu de s'interroger sur les moyens budgétaires qui seraient réellement mobilisés pour mettre en oeuvre le dispositif.
Ce texte est également dangereux. Réunir de jeunes volontaires en grande difficulté sociale et des mineurs délinquants ayant rejoint un EPIDE dans le seul but d'échapper à la prison, c'est, ni plus ni moins, transformer une structure d'insertion en structure alternative à l'enfermement. L'inquiétude est grande chez les spécialistes de la justice des mineurs de voir ainsi les EPIDE déstabilisés, faute de pouvoir assurer les missions supplémentaires qui leur seraient confiées.
Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que la meilleure prévention de la délinquance des mineurs reste l'intervention des services et des magistrats en assistance éducative – ce qui suppose de dégager les moyens nécessaires –, le groupe GDR votera résolument contre cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et plusieurs bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nos concitoyens le constatent malheureusement chaque jour, la délinquance des mineurs connaît une augmentation incontestable : elle devient plus massive, plus violente et plus fréquente. Cette évolution est, à l'évidence, le symptôme d'une perte de repères dans une partie de notre jeunesse, qui ne s'est pas appropriée les modes de vie en société – respect de l'autorité, respect d'autrui et solidarité – ni certaines qualités indispensables pour réussir son insertion professionnelle et sociale.
Nos concitoyens s'inquiètent également de la vague d'impunité dont semblent profiter les mineurs délinquants. En effet, si le taux de réponse pénale est important dans ce domaine, il faut aussi regarder ce que l'on entend par réponse pénale et surtout s'interroger sur le niveau et les délais d'application des peines prononcées par les juridictions compétentes. Cette question était d'ailleurs le thème du rapport de notre collègue Éric Ciotti, qui a précédé le dépôt de cette proposition de loi.
Les parlementaires du Nouveau Centre regardent, en tout premier lieu, ces faits. Ils étudient et constatent les problèmes qui se posent à notre justice en matière de gestion des mineurs délinquants. Ils refusent clairement les postures idéologiques que nous retrouvons trop souvent dans ces débats.
Notre collègue et président de groupe Yvan Lachaud a rendu, il y a quelques mois, un rapport dans lequel il exprimait un constat largement répandu chez les professionnels : la justice des mineurs n'est pas suffisamment rapide, effective et lisible. Il a également retiré de son travail sur le terrain un constat fort : les magistrats chargés des mineurs souhaitent une diversification des solutions, de façon à répondre de la manière la plus ciblée possible aux besoins des jeunes, en privilégiant les mesures éducatives plutôt que les dispositifs répressifs, ainsi que l'impose l'ordonnance du 2 février 1945.
En ce sens, nous accueillons favorablement le principe d'un service citoyen, ainsi que diverses dispositions procédurales contenues dans cette proposition de loi. Et ce d'autant plus que les formations de Jeunes en équipe de travail de l'amiral Brac de la Perrière ont bien fonctionné à l'époque, même si l'on peut regretter que, pour diverses raisons, elles aient été difficiles à généraliser.
Nous avons cependant certaines interrogations qu'il nous semble utile de lever.
En premier lieu, sur l'adhésion des personnels concernés par le dispositif. En tant que centristes, nous attachons une importance particulière à l'implication des acteurs de terrain dans la définition et la mise en oeuvre des décisions politiques. Or, qu'en est-il réellement de la volonté d'implication des militaires dans ce projet ?
En second lieu, nous exprimons les plus vives réserves sur le mélange, au sein des centres « Défense deuxième chance » gérés par l'EPIDE, d'une part de jeunes délinquants non motivés et qui sont là par obligation, d'autre part de jeunes en situation d'échec scolaire, de fragilité et de précarité qui, eux, veulent s'en sortir. En faisant entrer le loup dans la bergerie, ne risque-t-on pas de créer plus de problèmes qu'on n'en résoudra ?
Je rappelle que les propositions d'Yvan Lachaud sont actuellement expérimentées dans le ressort de trois cours d'appel, grâce à la mise en place d'un nouveau type d'établissement visant à garantir un placement rapide des jeunes délinquants, en association complète avec les magistrats et le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse. Sans doute sera-t-il nécessaire d'appliquer la même démarche pour garantir le succès de ce service citoyen.
En troisième lieu, nous voulons profiter de ce débat pour appeler le Gouvernement à donner plus de moyens à la justice des mineurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe NC.)

Il est très bien de créer des établissements publics pénitentiaires pour mineurs, encore faut-il également donner à la justice les moyens de faire appliquer ses décisions concernant ces jeunes. Il faudra donc vérifier dans quelle mesure cette nouvelle disposition aura permis d'améliorer la situation.
Avant de conclure, je voudrais rappeler une vérité trop souvent oubliée : l'insécurité touche d'abord les plus fragiles des Français, jeunes et personnes âgées. Traiter de l'insécurité, c'est donc faire oeuvre sociale. J'ose espérer que l'ensemble des députés pourront trouver, un jour, un terrain d'entente sur les mesures qui s'imposent désormais pour lutter contre la délinquance et l'insécurité.
Le groupe Nouveau Centre et apparentés, bien qu'il reste dubitatif quant à certains aspects de cette proposition de loi, a choisi dans sa grande majorité de la soutenir par un vote favorable. (Applaudissements sur les bancs du groupe NC et plusieurs bancs du groupe UMP.)

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Jacques Alain Bénisti, pour le groupe de l'Union pur un mouvement populaire.

Permettez-moi de vous dire, mes chers collègues, que, s'il y a un texte qui aurait pu faire l'unanimité sur tous les bancs, c'est bien celui-là. D'ailleurs, cette proposition, déjà émise dans le rapport sur la prévention de la délinquance que j'avais remis en février dernier au Premier ministre, avait reçu l'approbation de bon nombre de collègues, siégeant en particulier à la gauche de cet hémicycle.
En effet, comment être contre une proposition parlementaire qui a l'ambition de sauver de la délinquance des centaines de jeunes désoeuvrés primo-délinquants, qui n'attendent qu'une chose : qu'on leur tende la main pour les aider à s'en sortir, à se reconstruire, par l'apprentissage des valeurs de la République qui fondent notre vie en société ?
Comment être contre un texte qui se fonde sur une expérience positive ayant fait la preuve de son succès, avec un taux de réinsertions réussies qui s'établit entre 80 et 100 % ?

Comment être contre un dispositif qui a fait la preuve de son efficacité et qui est d'ailleurs appelé de ses voeux par les dirigeants de l'EPIDE, lesquels ont contribué à la rédaction de ce texte ? (« C'est faux ! » sur les bancs du groupe SRC.)
En fait, personne n'est contre, mais comme c'est une proposition de l'UMP, on ne peut pas être pour ! Et pourtant ce ne sont pas les efforts du rapporteur, Éric Ciotti, ni ceux du ministre, Michel Mercier, qui ont fait défaut. Nous partions de l'accueil de deux cents jeunes ; le ministre a accepté de multiplier par cinq, puis par dix ce nombre au fil des mois, en fonction des résultats de l'expérimentation, soit dans un EPIDE commun aux mineurs et aux jeunes majeurs, soit dans un établissement spécialement consacré aux mineurs.

De même, d'une durée de quatre à six mois, le Gouvernement accepté de passer de six à douze mois, sur notre proposition.
On nous titille aujourd'hui sur un prétendu encadrement militaire… En réalité, il s'agit de retraités de l'armée et d'éducateurs spécialisés. Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre un ancien gradé ayant une forte expérience de l'encadrement des jeunes et un officier en activité ? De même quelle différence y a-t-il entre un jeune mineur de dix-sept ans primo-délinquant et un jeune majeur de dix-huit ans ayant des démêlés avec la justice ?

Tout le monde s'accorde pour dire qu'ils souffrent du même mal-être et ont besoin d'une structure telle que l'EPIDE pour se reconstruire et se structurer.
Le texte a donc évolué pour répondre à tous les malentendus et à toutes les craintes de nos collègues de la commission de la défense, qui sont désormais rassurés, voire, pour beaucoup, convaincus du bien-fondé de ce dispositif.
En tout état de cause, le groupe UMP n'aura aucun état d'âme à voter ce texte, pierre supplémentaire à l'édifice de la prévention de la délinquance que nous construisons depuis 2007 et qui fait aujourd'hui la fierté de notre majorité. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Dominique Raimbourg pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Six raisons nous commandent de voter contre ce texte : deux de forme, quatre de fond.
Commençons par les raisons de forme.
Premièrement, ce texte n'est pas financé malgré la référence, à l'article 5, à une taxe additionnelle, imaginaire et quelque peu illusoire.
Deuxièmement, l'avis de la commission des finances n'a pas été demandé sur cette proposition de loi, comme la procédure de l'article 40 l'imposait, ce qui l'entache, à mon avis, d'inconstitutionnalité. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Troisième raison, de fond, celle-là : ce texte est avant tout une loi d'affichage. Elle est présentée dans les médias, auxquels elle s'adresse principalement, comme une loi d'encadrement militaire des jeunes délinquants. Or il ne s'agit pas de militaires d'active mais de militaires à la retraite. Quant aux délinquants, ils ne se sont rendus coupables que de tout petits méfaits et ils ne seraient que 200 à être concernés chaque année, ce qui est peu en comparaison des 11 000 mineurs ordinairement placés en tant que mineurs délinquants. Il ne s'agit en fait que des établissements de la « deuxième chance » de la défense nationale.
Quatrième raison : cette proposition de loi est inutile car nous aurions pu tout aussi bien mener une expérimentation après avoir donné aux écoles de la deuxième chance l'agrément qui aurait permis aux juges des enfants d'y procéder à des placements, comme cela se pratique au quotidien dans des établissements extérieurs à la justice.
Cinquième raison : cette loi est doublement incohérente. D'abord, elle a été arbitrairement extraite d'un ensemble de cinquante propositions rédigées par M. Ciotti. Ensuite, M. Bénisti avait lui aussi, en son temps, rédigé un rapport contenant soixante propositions pour répondre à la délinquance des mineurs, dont celle, très prudente, d'un encadrement. Là encore, une seule proposition en a été extraite. On peut penser ce que l'on veut de la pertinence de ces propositions, il demeure qu'en agissant ainsi, vous avez altéré la cohérence de l'ensemble.
Sixièmement, enfin, M. Dolez l'a dit, cette loi est dangereuse en ce qu'elle peut mettre en difficulté les établissements de la deuxième chance de la défense nationale, lesquels accueillent environ 2 000 majeurs volontaires chaque année et leur assurent un encadrement assez strict, inspiré des méthodes militaires, tout en faisant preuve de beaucoup de bienveillance et d'attention envers ces jeunes majeurs confrontés à l'échec scolaire, en proie à des difficultés sociales. Nous craignons que l'arrivée de jeunes mineurs qui vivront le placement dans ces établissements comme une sanction ne soit un facteur de déstabilisation et ne mette à mal une expérience qui donne d'assez bons résultats grâce au dévouement du personnel, comme ont pu le constater l'ensemble de nos collègues qui les ont visités.
Nous aurions pu accepter qu'une expérimentation soit menée, d'autant qu'il est toujours souhaitable de diversifier les lieux de placement des mineurs, mais il est impossible au groupe SRC de voter pour cette loi d'affichage, adoptée dans l'urgence et idéologiquement exploitée. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi.
(Il est procédé au scrutin.)

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 382
Nombre de suffrages exprimés 376
Majorité absolue 189
Pour l'adoption 224
Contre 152
(La proposition de loi est adoptée.)

L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote, par scrutin public, sur l'article unique de la proposition de loi de M. Gérard Bapt, M. Jean-Marc Ayrault, Mme Marisol Touraine et plusieurs de leurs collègues, visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (nos 3584, 3773).
Jeudi dernier, le Gouvernement a indiqué qu'en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, il demandait à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur les amendements n° 3584%2C3773/2">2 , 3584%2C3773/3">3 , 3584%2C3773/8">8 et 3584%2C3773/9">9 deuxième rectification et sur l'article unique de la proposition de loi, à l'exclusion de tout autre amendement.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Gérard Bapt, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. (« Il n'est pas là ! » sur les bancs du groupe UMP.)
La parole est à Mme Anny Poursinoff, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

En votant cette proposition de loi, nous avons aujourd'hui l'occasion de faire avancer la santé publique.
Monsieur le ministre de la santé, vous l'avez dit vous-même à propos du bisphénol A, « la précaution est légitime, même nécessaire ». Cette déclaration vous honore car il est temps que le principe de précaution s'applique.
On peut lire dans la déclaration de Rio de 1992 qu' « en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». Il faut par là entendre l'absence d'éléments susceptibles d'influer sur la planète et la santé de ses habitants.
Nous devrions d'ailleurs nous interroger sur les conséquences pour la santé publique de l'ajout de la notion de « coût économiquement acceptable » dans la loi Barnier de 1995.
Comment mesurer, en effet, l'ensemble de ces coûts ? Prenons le cas des débats que nous venons d'avoir sur le sucre.
L'épidémie de diabète coûte 12,5 milliards d'euros par an et augmente chaque année de 1 milliard. Si le nombre de cas se stabilisait, nous pourrions, en cinq ans, économiser 1 milliard mais encore faudrait-il agir sur les trois facteurs principaux de la maladie : la sédentarité, l'alimentation et la pollution chimique.
En refusant de réduire les taux de sucre dans les produits à destination des départements d'outre-mer, le Gouvernement calcule-t-il aussi les coûts de prise en charge sanitaire, les coûts humains ? Ou bien se contente-t-il de craindre des retombées économiques négatives pour les industries de l'agro-alimentaire ?
Alors, oui, nous nous réjouissons que le Gouvernement se déclare prêt à agir en ce qui concerne le bisphénol A. S'il pouvait se réveiller et traiter d'autres sujets avec la même ardeur, ce serait formidable. Faut-il vous rappeler, monsieur le ministre, que cette assemblée a voté une loi pour interdire l'ensemble des perturbateurs endocriniens ?
D'autres situations appellent une action immédiate. Encore faut-il que des experts réellement indépendants puissent s'exprimer et que les agences aient les moyens de travailler. Je prendrai deux exemples.
Le Gouvernement s'apprête à augmenter les taxes sur les boissons sucrées sans rien prévoir pour limiter la consommation des boissons contenant de l'aspartame, alors que des études ont établi le lien entre cet édulcorant et la survenue de certains cancers, ainsi que les risques de prématurité accrus chez les bébés dont la maman en consommait lorsqu'elle était enceinte.
Que dire par ailleurs des ondes électromagnétiques dont les conséquences sur la santé des jeunes enfants aujourd'hui exposés pourraient s'avérer très lourdes demain ? L'OMS a beau s'être exprimée très clairement sur les risques sanitaires d'une exposition continue et forte à la téléphonie mobile, les licences pour l'exploitation de la G4 ne sont pas conditionnées à des études préalables sur les effets éventuels pour la santé.

Dans ces deux situations, comme pour les pesticides, pour les trains de déchets nucléaires qui empruntent aujourd'hui même les voies du RER ou pour d'autres polluants, les intérêts économiques sont importants mais les conséquences sur la santé le sont tout autant.
L'application du principe de précaution, la prévention, la prise en compte des facteurs environnementaux dans les politiques de santé ou encore l'éducation et la promotion de la santé sont autant de priorités sur lesquelles nous ne pouvons transiger.
Bossuet le remarquait déjà, la santé dépend plus des précautions que des médecins.
Prenons plus au sérieux les menaces sanitaires, préservons la santé de nos concitoyens et n'hypothéquons pas la santé des générations futures.
Pour toutes ces raisons, le groupe de la Gauche démocrate et républicaine votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat sur la santé publique est primordial.
Le Nouveau Centre a déjà oeuvré en la matière puisqu'il a milité voici quelques mois pour la suppression des phtalates, des parabènes et des alkylphénols. J'ai par ailleurs personnellement déposé une proposition de loi visant à interdire le bisphénol A, identique à celle de M. Gérard Bapt.
Je suis heureux que ce sujet soit remis à l'ordre du jour car le bisphénol A est présent dans de nombreux emballages alimentaires, qu'il s'agisse des bouteilles en plastique ou des boîtes de conserve. Le dernier rapport de l'ANSES est clair : la nocivité de cette substance est avérée chez l'animal et fortement suspectée chez l'homme, surtout chez les personnes particulièrement vulnérables, à savoir les enfants, les femmes qui allaitent et les personnes âgées.
Nous devons mettre en garde la population contre ces risques.
Nous avons déjà interdit la présence de bisphénol A dans la composition du biberon, ce qui est d'autant plus nécessaire que le fait de réchauffer un biberon favorise la diffusion de la molécule dans la boisson.
Monsieur le président Accoyer, je sais que nous ne sommes pas encore certains du lien entre le bisphénol A et l'obésité, les problèmes endocriniens ou certains cancers. La suspicion est cependant suffisamment forte pour que nous prenions nos précautions.
Bien entendu, il ne faudrait pas le remplacer par une molécule plus toxique encore. La recherche jouera un rôle essentiel et nous devons accorder aux fabricants un délai avant d'interdire complètement la présence du bisphénol dans les conditionnements alimentaires. À cet égard, une durée de trois ans me semble raisonnable.
Dans un esprit de responsabilité, pour toutes ces raisons, le groupe Nouveau Centre votera cette proposition de loi.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Paul Jeanneteau pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Nous sommes aujourd'hui réunis pour voter la proposition de loi visant à suspendre la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A.
L'examen de ce texte en commission des affaires sociales à coïncidé avec la publication, mardi 27 septembre, d'un rapport à ce sujet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. L'agence en conclut que l'on dispose de « suffisamment d'éléments scientifiques pour identifier d'ores et déjà comme objectif prioritaire la prévention aux expositions des populations les plus sensibles que sont les nourrissons, les jeunes enfants, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. Cet objectif passe par la réduction des expositions au bisphénol A, notamment par sa substitution dans les matériaux en contact des denrées alimentaires qui constituent la source principale d'exposition de ces populations. »
La majorité est vigilante quant à la problématique des perturbateurs endocriniens, tout comme le Parlement français, qui est l'un des premiers à avoir suspendu la commercialisation des biberons contenant du bisphénol A. Le Gouvernement a également choisi d'être transparent sur ce dossier. À sa demande, l'ANSES a conduit une expertise sur les dangers et les usages de ce produit relativement courant dans notre environnement quotidien. Les premiers résultats viennent d'être publiés.
L'ANSES confirme un certain nombre de signaux concernant les effets potentiels du bisphénol A sur la santé, en pointant des périodes de plus grande vulnérabilité – période pré et post natale – mais en soulignant également la nécessité de disposer de substances de substitution à la fois efficaces et sans risque, sachant que si des solutions existent pour certains types de plastique, il n'y a pas à ce jour de substitut universel pour cette molécule.
C'est pourquoi l'ANSES, tout en poursuivant son évaluation des risques chez l'homme, soumet à consultation le résultat de ses travaux et lance un appel à contributions afin de recueillir, d'ici à la fin novembre 2011, toute donnée scientifique ou information utile concernant notamment les produits de substitution disponibles et les données relatives à leur innocuité.
Il reste en effet fondamental de s'assurer de l'innocuité des produits de substitution et de ne pas prendre de décision précipitée : il faut agir rapidement, c'est vrai, mais dans le discernement, et le problème de la substitution et des délais dans lesquels elle peut être envisagée sans risque est central. C'est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales a, sous l'impulsion des députés du groupe UMP, adopté un amendement qui repousse l'application de cette proposition de loi au 1er janvier 2014. Ce délai de deux ans nous semble suffisant pour permettre une adaptation de l'industrie.
Notre collègue Edwige Antier avait demandé en commission que l'on puisse faire porter en priorité les efforts de substitution sur les contenants alimentaires à l'usage des nourrissons et des enfants en bas âge. Je me réjouis que M. le ministre de la santé ait pris en compte cette demande et que nous concrétisions par notre vote la suppression de l'usage du bisphénol pour ces contenants dès le 1er janvier 2013.
Nous souhaitons que ce délai différencié soit l'occasion d'étudier d'autres mesures de précaution afin d'éviter au maximum l'exposition des populations les plus sensibles – les enfants de moins de trois ans, mais également les femmes enceintes ou allaitantes. Je pense notamment à un étiquetage spécifique, mesure sur laquelle nous attendons des précisions de la part de M. le ministre de la santé.
Après l'adoption, la semaine dernière, du projet de loi sur le médicament, nos concitoyens savent qu'ils peuvent compter sur la vigilance du ministre et sur celle des députés, où qu'ils siègent dans cet hémicycle, sur les sujets touchant à la sécurité sanitaire. Dans ces conditions, le groupe UMP votera cette proposition de loi pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens.

Je suis finalement heureux, monsieur le président, que vous me donniez la parole en dernier puisque je viens d'entendre que le groupe UMP votera la proposition de loi.

Permettez-moi de vous rappeler que vous n'étiez pas présent lorsque j'ai appelé votre nom pour engager les explications de vote. Veuillez maintenant, je vous prie, vous en tenir à votre intervention.

Je tenais simplement à saluer le vote favorable du groupe UMP, lequel tranche avec la position que, ces dernières années, le Gouvernement, singulièrement Mme Roselyne Bachelot-Narquin,a adoptée sur la question du bisphénol et, plus largement, sur celle des perturbateurs endocriniens.
Plusieurs députés du groupe UMP. Ne nous faites pas regretter notre vote !

Interrogée à plusieurs reprises non seulement depuis les bancs socialistes, mais également depuis ceux du Nouveau Centre, Mme la ministre avait en effet déclaré le 31 mars 2009 : « Les études fiables existent. Elles concluent en l'état actuel des connaissances scientifiques à l'innocuité des biberons au bisphénol A. »
Certes, une initiative parlementaire d'origine sénatoriale avait déjà permis à l'Assemblée d'interdire les biberons au bisphénol A, mais il n'en restait pas moins que 80 % de l'absorption de cette substance par le jeune enfant ou par la mère était due à l'alimentation en général et non au seul biberon. Voilà pourquoi l'extension à tous les conditionnements alimentaires de la suspension de la commercialisation des produits contenant du bisphénol A est une bonne chose.
Je le souligne d'autant plus que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a, eu égard à l'autisme et à l'immobilisme des agences sanitaires tant nationales qu'européennes, opéré une double révolution interne en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens.
La première a été de prendre en considération l'ensemble des études scientifiques et pas seulement celles diligentées par l'industrie qui, on le sait, dispose des moyens de réaliser des études selon les bonnes pratiques des laboratoires... Je pense notamment aux études académiques menées par l'INRA de Toulouse qui, en première mondiale, a montré, d'une part, que le bisphénol migrait au travers de la peau et, d'autre part, qu'il altérait la paroi intestinale. Toutes ces études sont enfin prises en compte et il faut en rendre hommage à l'ANSES, la nouvelle agence qui a résulté de la fusion de l'AFSSA et de l'AFSSET.
La seconde révolution culturelle a été de comprendre que la dose ne faisait plus le poison : les effets sanitaires des perturbateurs endocriniens, même à des doses infinitésimales, sont observés non seulement chez l'animal de façon expérimentale, mais désormais chez l'homme. Je citerai à cet égard une étude publique publiée par l'INSERM Grenoble et Rennes, avec le soutien d'une équipe basée à Atlanta, qui a porté sur le poids à la naissance des enfants en corrélation avec la présence de bisphénol dans le sang de la mère parturiente : ce poids dépend aujourd'hui – sachant qu'un petit poids à la naissance est un facteur de risque d'obésité – de l'ingestion ou non par la mère de bisphénol.
Le groupe Nouveau Centre a d'ailleurs eu raison de citer également le cas des phtalates puisque cette même étude met en évidence ce qui avait été montré expérimentalement chez l'animal, à savoir une augmentation de la prévalence des dysgénésies sexuelles à la naissance lorsque la mère parturiente est imprégnée par les phtalates.
Voilà pourquoi nous nous réjouissons que notre proposition de loi soit adoptée et ne subisse pas le même sort que celle de Victorin Lurel hier. J'ai en effet appris que, si le ministre de la santé était enclin à adopter cette proposition de loi visant l'ajout de sucres dans les boissons outre-mer, c'est Mme Penchard, ministre chargée de l'outre-mer, qui, pour des raisons de politique guadeloupéenne, a fait de son rejet un oukase. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.– Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Il est heureux que l'intérêt général l'emporte aujourd'hui et qu'enfin le bisphénol soit interdit dès le 1er janvier 2014 dans tous les contenants alimentaires. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi.
(Il est procédé au scrutin.)

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 351
Nombre de suffrages exprimés 348
Majorité absolue 175
Pour l'adoption 346
Contre 2
(La proposition de loi est adoptée.)

L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote, par scrutin public, sur l'ensemble de la proposition de loi de MM. Hervé Féron, Pascal Deguilhem, Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues portant instauration d'une épreuve de « formation aux premiers secours » pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges (nos 3691, 3774).
Jeudi dernier, le Gouvernement a indiqué qu'en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, il demandait à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur les articles, à l'exclusion de tout amendement, et sur l'ensemble de la proposition de loi.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Hervé Féron, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le président, Madame la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative, mes chers collègues, la proposition de loi tendant à instaurer une épreuve de formation aux premiers secours pour les candidats au diplôme national du brevet – et non pas du brevet des collèges – a toujours reçu un bon accueil, en particulier auprès de toutes les personnes qualifiées que nous avons auditionnées : qu'il s'agisse du président de conseil général, de l'enseignante, du représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou de ceux de la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, tous ont pu la qualifier de généreuse, de noble, de pleine de bonnes intentions. De la même façon, les députés qui se sont exprimés, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle, ont reconnu a priori l'intérêt de la démarche.
La proposition de loi tend simplement à permettre que les textes qui existent en la matière soient mis en oeuvre et que les objectifs déjà poursuivis par la loi soient ainsi atteints. En effet, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, ont pris acte de cet enjeu de santé publique en instaurant, dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, une obligation de formation aux gestes qui peuvent sauver des vies.
Ainsi, à l'école élémentaire, un dispositif APS, « Apprendre à porter secours », lancé dès 1997, est intégré dans les programmes scolaires. Il comporte un apprentissage de principe simple pour porter secours. Dans le second degré, le législateur a prévu que l'élève bénéficie d'une formation appropriée jusqu'à l'obtention de l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1er », ou PSC 1. Malheureusement, seuls 4,7 % des élèves en école élémentaire et 16,3 % des élèves du second degré ont bénéficié de cette formation en 2009-2010.
L'éducation nationale intensifie pourtant cet effort de formation. Ainsi, des partenariats sont mis en place, en particulier avec la MAIF. Mais les objectifs ne seront pas atteints s'il n'y a pas la volonté politique. C'est bien celle-ci que nous proposons aujourd'hui.
Il s'agit d'utiliser l'épreuve du brevet comme un levier pour inciter à cette formation, sachant que si 80 % des élèves scolarisés parviennent au niveau du brevet, une circulaire du 18 juin 2010 précise que l'attestation de la PSC1 n'est pas nécessaire pour la validation du socle commun, ni par conséquent pour l'obtention du brevet.
La formation aux premiers secours est le prolongement des compétences sociales et civiques qui figurent dans le socle commun des connaissances, et nous faisons à cet égard confiance aux acteurs éducatifs et aux enseignants. Si cette formation est un enjeu de société, elle est aussi un enjeu éducatif et pédagogique. Toutes les personnes qui ont été auditionnées nous l'ont confirmé : à l'âge de passer son brevet, l'élève est particulièrement réceptif car il est sensibilisé à la solidarité et aux nécessaires actions de générosité.
Nous ne proposons surtout pas de remplacer dans sa mission l'éducation nationale. Nous souhaitons que le travail engagé en matière de formation et de partenariat se développe. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons proposé par amendement de reporter à 2014 la date d'entrée en vigueur du dispositif, afin de permettre à l'éducation nationale de continuer à progresser dans de bonnes conditions.
Les moyens nouveaux proposés sont complémentaires de ceux mis en oeuvre par l'éducation nationale, et ne viennent surtout pas les remplacer. Il s'agit d'utiliser de jeunes volontaires du service civique employés par les services départementaux d'incendie et de secours ou par les unions départementales de sapeurs-pompiers et formés spécifiquement à cet effet pour dispenser auprès des élèves des collèges ces dix heures de formation aux premiers secours qui, bien que d'ores et déjà prévues par la loi, ne sont malheureusement pas dispensées systématiquement.
En sollicitant ces jeunes volontaires du service civique, c'est une véritable démarche de formation à la citoyenneté active que nous entreprenons. Le lien qui sera ainsi créé entre les collégiens et les services départementaux d'incendie et de secours ne peut être que bénéfique dans le contexte de grande difficulté que connaissent les SDIS dans leur recrutement.
La somme de 27 millions d'euros avancée pour atteindre les objectifs prévus par la loi correspond au coût de la montée en puissance, dès la première année, du dispositif, lequel serait mis en oeuvre uniquement par l'éducation nationale. Ce que nous proposons est tout autre avec la mutualisation des moyens.
Oui, mes chers collègues, cette proposition a du sens. Oui, elle est noble et généreuse. Certains dans cet hémicycle – je pense à Colette Langlade et Pascal Deguilhem – l'ont souligné : il s'agit d'éduquer à la solidarité et de former à la citoyenneté active, la conscience citoyenne et le service de l'intérêt général étant les deux piliers de notre République.
Les enseignants, les élèves, les parents d'élèves qui nous regardent, ne comprendraient pas que, par un réflexe partisan, notre assemblée ne vote pas massivement cette proposition de loi. Voilà pourquoi le groupe socialiste, républicain et citoyen la votera.

Pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Mme Marie-Hélène Amiable.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, seuls 40 % de nos concitoyens sont formés aux premiers secours, chiffre faible si on le compare notamment à celui des pays du Nord de l'Europe.
Sachant l'importance de ces gestes pour limiter la gravité des blessures et sauver des vies, nous sommes devant une évidente responsabilité que souligne bien la proposition de loi déposée par nos collègues du groupe SRC.
Ses auteurs l'ont rappelé, environ 30 % des décès imputables aux arrêts cardiaques, aux accidents domestiques ou aux accidents de la route pourraient être évités si des soins de premiers secours étaient prodigués dans les minutes suivant l'accident. Or, si l'obligation de formation aux premiers secours dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés est bien inscrite dans la loi, le rapporteur du texte a également démontré son insuffisante application puisque seuls 480 525 écoliers ont été formés depuis 2007.
Il nous est proposé, en conséquence, de conditionner l'obtention du diplôme national du brevet par le suivi d'une formation aux premiers secours de dix heures dispensée dans le cadre scolaire.
Si l'école semble propice à cet apprentissage, les modalités proposées ne sont pas sans faire naître quelques inquiétudes.
Il n'a tout d'abord pas été véritablement répondu à notre préoccupation de garantir la fonction éducative de cette formation. On s'est contenté de nous préciser que cette dimension ne faisait pas de doute puisqu'il s'agissait « d'acquérir des compétences dans le cadre scolaire, en présence d'enseignants ». Connaissant la réalité de la formation de ces derniers depuis la réforme imposée par le Gouvernement et leur difficulté à assurer leur mission dans le contexte de démolition du service public d'éducation dicté par les forces libérales, une telle assertion n'est pas pour nous rassurer.
L'obtention du brevet dépend déjà, depuis 2008, de celles du B2I, le brevet informatique et internet, et du niveau A2 du « cadre européen commun de référence pour les langues » dans une langue vivante. Nous nous interrogeons donc fortement sur le fait de la conditionner par une nouvelle épreuve de formation aux premiers secours.
Sans revenir sur les raisons qui ont fondé notre opposition à la proposition de loi relative au service civique soutenue par le Gouvernement, nous soulignons aujourd'hui les limites qu'il y aurait à confier cette formation à des volontaires du service civique. L'article L. 312-13-1 du code de l'éducation précise d'ailleurs que « cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées ». Or vous n'avez pas fait la preuve que ces volontaires pourront être assimilés à de tels organismes. La question de la responsabilité des formateurs et des élèves amenés à pratiquer ces gestes reste donc entière.
Il est proposé que ces missions soient effectuées dans le cadre de conventions passées entre les services départementaux et les conseils généraux. Mais puisque M. Féron, le rapporteur de la proposition de loi, a lui-même précisé qu'« aucun SDIS ne sera contraint de contribuer au dispositif », il est à craindre une application différenciée sur l'ensemble du territoire.
Pour notre part, nous préconiserions plutôt de renforcer les partenariats entre les organismes habilités et l'éducation nationale. Mais le Gouvernement n'est apparemment pas prêt à en supporter le coût puisque le ministre de l'éducation nationale s'est borné à se féliciter de la tranquille « montée en puissance » de l'existant au lieu de défendre cette « idée généreuse », ainsi qu'il l'a lui-même qualifiée. Nous déplorons la faible ambition au regard des enjeux majeurs qui sont posés tant au plan éducatif qu'en matière de santé publique.
Enfin, ce texte nous semble maladroit dans le contexte du malaise persistant aujourd'hui dans les SDIS, soumis à la révision générale des politiques publiques. En organisant un peu plus les dérogations au droit du travail, la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique n'a visiblement pas contredit la logique de la RGPP.
Parce que les questions soulevées par ce texte méritent de meilleures réponses, et parce que le dispositif proposé nous semble pour l'heure insuffisamment ajusté, les députés communistes, républicains et du parti de gauche s'abstiendront sur cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Olivier Jardé, pour le groupe Nouveau Centre.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la sécurité est un enjeu majeur pour notre société.
Plusieurs députés du groupe SRC. C'est toujours bien !
Plusieurs députés du groupe SRC. C'est encore mieux !

Tous les efforts doivent être déployés pour former aux premiers secours.
Néanmoins, (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC.) je me permets de vous rappeler que la loi de 2004 prévoit une formation aux premiers secours pour les élèves de troisième et que des partenariats pour la formation des instructeurs sont déjà engagés ou en cours de négociation, notamment avec la Croix-Rouge. Tout cela va dans le bon sens.
Faut-il inclure une épreuve relative à la formation aux premiers secours dans le brevet, c'est-à-dire dans un diplôme national qui a vocation à évaluer des acquis scolaires ? On peut légitimement se poser la question.
Plusieurs députés du groupe UMP. Oui !

Est-ce pertinent ? Est-ce utile pour les élèves, pour la population et pour la France ?
Plusieurs députés du groupe UMP. Non !

Nous risquerions d'alourdir considérablement le brevet ? qui comporte déjà des épreuves de mathématiques, de français et d'histoire et géographie, une épreuve dite de maîtrise du socle commun, une épreuve d'histoire de l'art et la note de vie scolaire. Cela fait beaucoup.
J'estime que la loi de 2004 répond déjà aux exigences en matière de formation aux premiers secours, que je considère comme primordiales. Cette proposition de loi n'a donc pas lieu d'être et le groupe Nouveau Centre votera contre.

La parole est à M. Frédéric Reiss, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le président, chers collègues, cette proposition de loi vise à lier l'obtention du brevet des collèges à la validation par les élèves d'une formation obligatoire dite « prévention et secours civiques de niveau 1 ». Elle serait d'une durée totale de dix heures dans tous les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat.
La généralisation de l'apprentissage des gestes de premiers secours est une nécessité car elle permet de sauver des vies : nous ne pouvons que nous accorder sur cette réalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parlement n'a pas attendu ce texte pour s'emparer de la question.
En effet, l'article L.312-13-1 du code de l'éducation, issu de la loi de 2004 portant modernisation de la sécurité civile, prévoit déjà que tout élève bénéficie dans le cadre de sa scolarité obligatoire d'un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours. Nous devons tout mettre en oeuvre pour garantir l'application des textes en vigueur avant d'en adopter de nouveaux.
En conditionnant l'obtention du brevet par le suivi d'une formation aux premiers secours, l'article 1er de la proposition de loi dénature un diplôme national qui a vocation à sanctionner les acquisitions scolaires, notamment celle des enseignements fondamentaux.
Former tous les citoyens à la prévention et aux premiers secours est un objectif essentiel que se doit d'atteindre le ministère de l'éducation nationale. Il sera atteint progressivement dans le cadre des textes déjà votés ; nous ne souhaitons donc pas casser la dynamique actuelle en faisant porter une obligation sur le seul brevet des collèges. En effet, la mesure déjà votée est en cours de déploiement pour tous les élèves, de la maternelle au lycée.

Le suivi est assuré par un comité de pilotage interministériel composé des ministères chargés de l'éducation nationale, de la santé et de l'intérieur. Ainsi, à terme, l'ensemble de la population scolaire sera formé aux gestes qui sauvent.
Depuis 2007, le nombre de collégiens formés au PSC1 n'a cessé de progresser. Pour l'année scolaire 2009-2010, 92 925 élèves de troisième ont été formés. En septembre 2011, on dénombre 173 instructeurs actifs, soit quatre à six par académie, et 5 500 moniteurs interviennent dans les établissements publics et privés ; 730 moniteurs supplémentaires les rejoindront en juin 2012.
Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a engagé un partenariat pour cinq ans avec la MAIF dans une convention signée le 21 juin 2011, qui vise à faire progresser le nombre d'élèves formés. De plus un accord-cadre est un cours de négociation avec la Croix-Rouge.
Dès aujourd'hui, une attestation est délivrée aux élèves de troisième ayant suivi la formation aux premiers secours. Elle est incluse dans le livret personnel de compétences du socle commun, au même titre que les attestations scolaires de sécurité routière de niveau 1 et de niveau 2.
Si l'article 1er de la proposition de loi lie l'obtention du brevet des collèges au suivi d'une formation aux premiers secours, l'article 2 prévoit que cette formation sera dispensée par les volontaires du service civique – et cela pour un coût total évalué à environ 31 millions d'euros, estimation qui ne tient pas compte du coût du matériel nécessaire à la formation.
En commission, j'ai déjà évoqué le problème que pose le statut des formateurs : verra-t-on intervenir des volontaires du service civique ou des engagés ? Ce n'est pas la même chose. En outre, si les jeunes effectuant leur service civique assurent une formation auprès des élèves, ils devront être accompagnés d'un enseignant ou d'un adjoint d'enseignement. Cela a un coût qu'il faut prendre en compte pour l'ajouter à celui des soixante heures de formation du monitorat. Je dirais encore qu'assumer de manière permanente une nouvelle mission de ce type ne me semble pas relever de la vocation du service civique
En conclusion, nous pouvons nous accorder sur le fait qu'il est important que les efforts entrepris depuis quelques années pour déployer la formation aux premiers secours à l'école soient intensifiés ; en revanche, le dispositif proposé, qui grèverait le budget de l'éducation nationale, ne peut pas être adopté en l'état. Nous partageons un objectif vers lequel nous avançons résolument, mais il nous semble que le texte proposé alourdirait considérablement le diplôme national du brevet. C'est la raison pour laquelle les députés du groupe UMP voteront contre cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi.
(Il est procédé au scrutin.)

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 293
Majorité absolue 147
Pour l'adoption 115
Contre 178
(La proposition de loi n'est pas adoptée.)
Vote sur l'ensemble

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze, sous la présidence de M. Marc Le Fur.)

Hier soir, l'Assemblée a commencé l'examen des articles, s'arrêtant à l'article 39.

Je suis saisi d'un amendement n° 102 .
La parole est à M. Alain Vidalies.

Nous proposons de supprimer l'article 39 qui, a priori, ne semble pas avoir de conséquences graves. Il faut bien voir cependant qu'il s'attache à modifier la formulation générique des seuils d'effectifs en droit du travail. Nous sommes d'autant plus surpris par cette initiative que cette formulation est l'aboutissement d'un travail de recodification effectué en 2008, qui a été extrêmement long et précis. Nous avons adopté ces modifications ici même et elles font désormais partie du droit positif. Je ne vois pas pourquoi il faudrait revenir dessus, quand bien même il s'agirait d'une simple question de sémantique.

La parole est à M. Étienne Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

La commission a émis un avis défavorable, considérant que la redéfinition des seuils opérée par cet article 39 rend les textes beaucoup plus lisibles, plus aisément compréhensibles et donc mieux applicables à la fois par les entreprises et par les salariés. Nous considérons qu'il s'agit d'une clarification particulièrement bienvenue.

La parole est à M. Dominique Dord, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

J'irai dans le même sens que le rapporteur. Nous avons eu un débat hier, quelques fois compliqué, sur les conséquences des modifications sémantiques. Nous avons pris le parti de retirer toutes celles qui étaient susceptibles d'entraîner des pertes financières. En revanche, à l'article 39, qui est l'article principal pour l'harmonisation des différents seuils, aucune modification n'entraîne de pénalisation financière. Si nous voulons être cohérents par rapport au principe que nous avons établi hier, il faut bien sûr conserver cet article.
Sur le fond, la formule générique « au moins x salariés » n'est ni plus ni moins critiquable que la formule « x salariés ou plus ». Ce choix ne nous paraît absolument pas constituer une source de confusion, bien au contraire puisqu'il permet une simplification.
Dans ces conditions, avis défavorable.

La parole est à M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation.


Je propose de créer un devoir d'information de l'employeur pour le salarié qui bénéficie d'une protection contre le licenciement au titre d'un mandat, afin de sécuriser les relations contractuelles tout en assurant le respect des droits attachés à l'exercice de ces mandats.
L'employeur peut en effet ignorer que l'un de ses salariés détient un mandat. Les règles de publicité attachées à l'exercice de ces mandats, tel celui de conseiller du salarié, ne permettent pas toujours à un employeur d'en être informé.
Il ne s'agit évidemment pas de supprimer les protections dont bénéficie le salarié détenteur d'un mandat mais tout simplement de permettre à l'employeur d'être informé.

Ces sous-amendements ne remettent absolument pas en cause le fond de l'amendement de Mme Rosso-Debord, qui nous semble de nature à clarifier la situation pour les entreprises.
Il s'agit de simples modifications rédactionnelles visant à préciser les mandats concernés et à sécuriser l'ensemble de la procédure.

Il s'agit de sous-amendements de rédaction visant le même but.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement et les sous-amendements ?

M. le président de la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 9 rectifié comme sur les sous-amendements.
Nous considérons qu'ils abordent un sujet particulièrement sensible susceptible de créer des tensions au sein des entreprises.

Dans ces conditions, nous estimons que de telles dispositions ne peuvent figurer dans une loi de simplification. Elles appellent un véritable approfondissement à l'occasion d'un débat en commission sur un texte ad hoc.
Le gouvernement est favorable à l'amendement n° 9 rectifié , sous réserve de l'adoption des sous-amendements présentés par le Gouvernement, lesquels, je le répète, sont rédactionnels.
Ils précisent les mandats concernés et sécurisent l'ensemble de la procédure. Un employeur peut ignorer de bonne foi que son salarié exerce, hors de son entreprise, un mandat qui lui offre une protection contre le licenciement. S'il engage la procédure de licenciement sans demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, il ne lui est plus possible de régulariser la procédure a posteriori. Sont notamment concernés par cette mesure les représentants du personnel, les salariés membres d'une commission paritaire d'hygiène, les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, les salariés membres du conseil ou administrateurs d'une caisse de sécurité sociale ou ceux membres d'une mutuelle union ou fédération.

Je me demande bien qui est derrière cette batterie de dispositions similaires.

L'amendement de Mme Rosso-Debord vise à compléter un article du code du travail de la manière suivante : « Le salarié bénéficiant d'une protection contre le licenciement doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. » Il est motivé par le fait que, selon elle, l'employeur pourrait ne pas être au courant. Elle cite comme exemple les conseillers du salarié. Le seul problème, c'est que les conseillers du salarié figurent sur une liste arrêtée par la préfecture, liste officielle et facilement consultable. De surcroît, les conseillers du salarié ont tout intérêt à se déclarer auprès de leur employeur puisqu'ils ont droit à un crédit d'heures pour la défense des travailleurs. Cela paraît donc bizarre de prétendre qu'un employeur risque de ne pas être au courant. Cela vaut a fortiori pour les autres représentants du personnel puisqu'ils sont tous élus. Depuis la récente loi sur la représentativité, les délégués syndicaux, qui faisaient exception, sont eux aussi élus et non plus désignés par leur syndicat. Un employeur ne peut donc ignorer quels sont les salariés de son entreprise qui bénéficient d'une protection au titre de la représentation du personnel.
Par ailleurs, parmi les sous-amendements du Gouvernement, qui reprennent des sous-amendements présentés par une députée de l'UMP, il y en a un en particulier qui nous semble bizarre : l'amendement n° 339 , qui vise à insérer les mots « dès réception de la convocation à l'entretien préalable et au plus tard le jour de cet entretien ». Or dans l'amendement de Mme Rosso-Debord, il n'est nullement question de procédure de licenciement mais simplement de la protection contre le licenciement dont bénéficie le salarié mandaté et de l'information de l'employeur. Pourquoi votre sous-amendement prévoit-il qu'un salarié soit un jour menacé de licenciement ?
Je ne sais pas qui est derrière ces sous-amendements : le MEDEF, une de ses branches, ou encore la CGPME ? En tout cas, c'est plus qu'inquiétant, comme d'habitude !

Nous avons raison de nous méfier de tels amendements : il nous faut rester très prudents. Mme Rosso-Debord nous a fait le même coup hier soir avec un beau cavalier arrivé au galop et elle récidive aujourd'hui. Ces dispositions touchent au droit du travail puisqu'elles visent à sécuriser la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié. Expliquez-nous en quoi elles sont de nature à alléger et à simplifier les démarches administratives, but initial de cette proposition de loi ?
Je reprendrai donc l'argument de Martine Billard : si un patron n'est pas au courant des activités de représentation que peut avoir par ailleurs un salarié, cela veut dire, soit qu'ils ne se croisent pas beaucoup – cela peut arriver –, soit plus probablement que le salarié ne fait pas bien son travail ! Si l'on a une délégation, c'est pour l'exercer ; donc le patron est nécessairement au courant.
Encore une fois, on touche au code du travail avec des amendements sibyllins. Le rapporteur a donc raison de rejeter cet amendement.

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Je veux simplement dire que l'avis de la commission est défavorable et que je le maintiens.
Nous avons découvert le sous-amendement du Gouvernement il y a trente minutes, et je ne sens pas du tout cette affaire-là ! (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.) Je ne vois pas où est la simplification.
Si j'ai bien compris l'idée de nos collègues, il s'agit de traiter les situations où un salarié exerce un mandat extérieur – mandat syndical, par exemple : cela le protège en cas de licenciement, car il faut lancer une procédure spéciale ; il devrait donc, dans ce cas, prévenir son employeur. Cela se fait déjà, par lettre recommandée, lorsque quelqu'un est élu conseiller municipal, et il s'agit de transposer ce système dans la sphère sociale.
C'est un problème qui peut exister, et sur lequel nous pourrions travailler, même si ce n'est pas de la simplification.
Mais le sous-amendement du Gouvernement, que je découvre, précise que cette information se fait « dès réception de la convocation à l'entretien préalable et au plus tard le jour de cet entretien ». On touche là à la procédure de licenciement, c'est tout autre chose !
Il s'agit d'une modification très importante, que nous n'avons pas eu le temps d'expertiser. Nous avons été défavorables à cet amendement en commission, et la sagesse, je crois, serait de retirer amendement et sous-amendements, car cela nous entraînerait dans quelque chose dont on a du mal à mesurer les conséquences.
Vous avez bien compris le but de cet amendement…
Chacun a parfaitement compris, et d'ailleurs M. le président de la commission des lois vient de l'expliquer. Le ministère du travail considérait que ces sous-amendements rédactionnels étaient nécessaires au bon fonctionnement du dispositif ; mais je vois qu'il soulève des interrogations, y compris du côté de la commission.
Je propose donc de retirer les sous-amendements du Gouvernement, et que Mme Rosso-Debord retire son amendement, ce qui évitera tout malentendu.

Je tiens à dire que mon amendement ne visait à rien d'autre qu'à permettre à un employeur de ne pas être assujetti à des procédures juridiques lourdes à la suite d'un manque d'information. (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.) C'est aussi cela, la simplification ! Je ne considère donc pas que cet amendement sorte du champ de la proposition de loi.
Je viens également de découvrir le sous-amendement n° 339 , qui nous entraîne effectivement – je suis d'accord avec le président de la commission des lois – vers tout autre chose. (Exclamations sur les bancs du groupe GDR.)
Je ne souhaite pas alimenter plus longtemps le débat, mais je ne souhaite pas non plus qu'il soit dit ici qu'il y avait derrière cet amendement une intention maligne. Il n'y en avait pas.

Néanmoins, je me range à l'avis de M. le secrétaire d'État et de M. le président de la commission, et je retire mon amendement.
(L'amendement n° 9 rectifié est retiré.)

Je suis saisi de deux amendements de suppression, nos 103 et 195.
La parole est à M. Alain Vidalies, pour défendre à l'amendement n° 103 .

L'article 40 est une oeuvre de simplification bien singulière : il s'agit de voter un dispositif législatif destiné à s'opposer aux conséquences d'une jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2010, portant sur l'aménagement des horaires de travail, c'est-à-dire la « modulation » au sens du code du travail, la Cour de cassation a estimé que, même lorsque la modulation résultait d'un accord collectif, le salarié devait donner son accord à sa mise en oeuvre, parce que son contrat de travail s'en trouvait modifié.
Cette jurisprudence forte ne plaît pas, et cet article soi-disant de simplification vise tout simplement à s'opposer à ce principe posé par la Cour de cassation, selon lequel la modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié. Sur le plan juridique, sur le plan humain, c'est très important : le résultat d'une nouvelle organisation du travail doit être compatible avec la vie personnelle de chaque salarié ; parfois, il ne l'est pas.
La Cour de cassation donne à tout salarié la liberté de refuser cette modification de son contrat ; c'est une liberté que vous voulez lui retirer. Ce n'est donc pas une simplification ; c'est une régression.

La parole est à Mme Martine Billard, pour défendre l'amendement n° 195 .

J'irai dans le même sens : ce n'est pas de la simplification du droit.
J'ai assisté à l'audition organisée par M. le rapporteur ; pour sa défense, le ministère du travail mettait en avant sa volonté de privilégier les droits collectifs, et non les droits individuels, qui s'exerceraient à leurs dépens.
Mais aujourd'hui, les modifications législatives que vous avez introduites – qui permettent qu'un accord d'entreprise, et même d'établissement, soit plus défavorable qu'un accord de branche – font qu'un accord signé dans une entreprise ou un établissement peut être assez défavorable aux salariés, parce que le rapport de forces ne joue pas en leur faveur et que l'employeur l'impose ; et un tel accord peut mentionner qu'il pourra dorénavant y avoir une modulation des horaires de travail.
Les salariés –je pense notamment aux femmes seules avec enfants, ou d'ailleurs aux pères seuls avec enfants, il y en a aussi – seront donc contraints d'accepter cette modification de leur contrat de travail, avec des horaires modifiés ; ils rencontreront des problèmes de garde d'enfants – et on viendra ensuite leur donner des leçons de morale sur la façon dont ils éduquent leurs enfants ! S'ils refusent la modification d'horaires, puisqu'elle ne constituera plus une modification substantielle du contrat de travail, cela veut dire que leur licenciement sera autorisé. Ils se retrouveront au chômage.
Cet article n'est donc pas si anodin, et sous prétexte de privilégier les droits collectifs par rapport aux droits individuels, on en vient à mettre bon nombre de salariés, et notamment de femmes, dans des situations où ils devront choisir entre continuer à avoir un emploi mais sans pouvoir s'occuper correctement de leurs enfants, ou bien s'occuper de leurs enfants en étant au chômage, et on sait ce que cela signifie.
Nous proposons donc de supprimer cet article.

Sur le vote de l'article 40, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Quel est l'avis de la commission sur ces amendements de suppression ?

Nous avons considéré que l'arrêt rendu le 28 septembre 2010 par la Cour de cassation va à l'encontre d'un principe juridique posé dans la loi du 20 août 2008. L'article 40 vise donc à rappeler le droit voté par notre assemblée, c'est-à-dire la décision prise par les parlementaires.
Les auteurs des deux amendements justifient la suppression de cet article en indiquant qu'il va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation, puisque, selon cet arrêt de la chambre sociale, « l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ». Ils reprennent l'analyse suivant laquelle le pouvoir de direction de l'employeur ne porte que sur l'aménagement de l'horaire de travail dans la journée de travail ; a contrario, toute autre modification qui entraînerait un bouleversement de l'horaire devrait être analysée comme une modification substantielle du contrat de travail.

Telle n'est pas notre analyse. Nous estimons au contraire qu'il s'agit d'une jurisprudence contra legem : la Cour se livre en effet à une interprétation du code du travail que nous jugeons contestable.
Je note d'abord – c'est un principe de droit – que l'accord du salarié ne s'impose qu'en cas de modification des éléments substantiels du contrat de travail. Cette notion recouvre toute stipulation relative aux éléments de rémunération et à la durée du temps de travail, indépendamment de sa répartition ; celle-ci relève des conditions de travail, qui peuvent évoluer sans que l'accord du salarié soit nécessaire. Leur modification donne lieu à une requalification du contrat si et seulement si cette évolution porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié ou si elle affecte les éléments essentiels du contrat de travail jusqu'à leur porter atteinte ; c'est le cas de ce qui touche à la rémunération.
En second lieu, je souligne que l'article L. 3122-2 du code du travail dispose qu'« un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. » Dès lors, nous considérons que la jurisprudence de la Cour de cassation va à l'encontre de la lettre même du code du travail, comme de la logique de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cette logique, c'est que la détermination de la durée du temps de travail relève d'accords collectifs et qu'elle n'est pas individualisée.
Je rappelle par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation présente un inconvénient majeur : elle ôte toute portée aux accords déjà conclus sur le fondement de l'article L. 3122-2 du code du travail et crée ainsi des motifs de contentieux difficiles à évaluer.
Pour toutes ces raisons, la commission a formulé un avis défavorable à ces amendements de suppression.

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

J'irai dans le même sens.
Nous en avons déjà débattu en commission, et c'est un beau sujet : l'accord collectif doit-il primer sur l'accord et la volonté individuels ?
Je me demande, chers collègues de l'opposition, si vous ne plaidez pas ici à contre-emploi. Vous devriez plutôt, me semble-t-il, défendre comme nous la valeur suprême de l'accord collectif en droit du travail, plutôt que de la relation individuelle.
Pourtant, vous faites l'inverse, avec deux amendements qui ne sont d'ailleurs pas motivés de la même manière. Je souligne d'abord, à l'attention du groupe SRC, que l'article 40 de cette proposition de loi ne vise en aucun cas à permettre à l'employeur de modifier tout seul dans son coin les horaires et la durée du travail ; il faut au contraire qu'un accord collectif lui permette d'effectuer ces modifications. L'article 40 permet justement à l'accord collectif de s'appliquer. Si vous le soumettez à la volonté individuelle de chacun des salariés, vous en ruinez la valeur.
L'article 40 ne modifie pas les dispositions de l'article 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, qui renvoie bien à un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Il me semble donc que le groupe SRC n'est pas fondé à dire que l'article 40 remet en question les principes établis quant aux conséquences du refus par un salarié des modulations de son temps de travail.
Quant au groupe GDR, il estime que c'est parce qu'une jurisprudence de la Cour de cassation ne nous convient pas que l'article 40 est proposé.

C'est même parfaitement vrai ! Car c'est notre rôle de dire le droit si une jurisprudence de la Cour de cassation ne nous semble pas conforme aux principes mêmes du droit, ceux que nous avons réaffirmés dans la loi de 2008. Si nous ne revenons pas sur cette jurisprudence, nous créerons une instabilité juridique.
Par ailleurs, je ne suis pas sûr que la jurisprudence de la Cour de cassation protège mieux les salariés. Au contraire, le refus d'une modification du contrat de travail entraînerait un licenciement. Est-ce cela la meilleure protection des salariés ? Nous nous permettons d'en douter.
Voilà pourquoi nous voterons contre les amendements de suppression de l'article 40, qui réaffirme des principes auxquels nous devrions être tous attachés et qui va dans le sens d'une plus grande sécurité juridique.
Je suis d'accord avec les rapporteurs.
Je veux sensibiliser les auteurs des amendements au fait que cette jurisprudence fragilise le salarié, alors que le dispositif proposé lui est favorable. En réalité, dès lors que l'on demanderait un accord personnel, on prendrait le risque qu'il y ait une forme de pression sur le salarié.
Le dispositif proposé par la commission protège donc plus le salarié que la jurisprudence de la Cour de cassation. Or j'imagine que votre souhait n'est pas de fragiliser la protection du salarié. Peut-être serait-il plus sage de retirer ces amendements.

Ce que nous venons d'entendre n'est pas la vérité. Les organisations syndicales considèrent qu'il s'agit là de modifications majeures du code du travail. Vous avez l'obligation de respecter la loi de janvier 2007 que vous avez vous-mêmes fait adopter et qui dispose qu'en cas de modification du droit du travail il doit y avoir concertation avec les organisations syndicales. Or vous vous asseyez sur cette obligation, ce qui est assez scandaleux.
J'ai reçu tout à l'heure un communiqué de la CGT,…

…qui s'était félicitée, comme les autres organisations syndicales, de l'introduction dans la loi d'une obligation de concertation – même si elles ne se faisaient pas trop d'illusions en la matière – avant des propositions législatives modifiant le code du travail. Aujourd'hui, toutes les organisations syndicales considèrent qu'on est en train de bafouer, une fois de plus, cet engagement gouvernemental et cette loi censée être encore en vigueur, à moins qu'elle n'ait été abrogée par je ne sais quelle disposition.
Dans ce communiqué, la CGT indique que, dans la réalité, en cas de modification de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, prévue par un accord collectif…

Le sujet est important et c'est la première fois que je prends la parole !

..en pareil cas, la protection du salarié apportée par les clauses de son contrat de travail deviendrait caduque. À titre d'exemple, un employeur pourrait exiger de son salarié de travailler une semaine durant quarante-huit heures et dix heures la semaine suivante, sans que celui-ci ne puisse s'y opposer. Cet article va à l'encontre des décisions de la Cour de cassation et des droits fondamentaux des salariés. En outre, il bafoue le droit des grandes centrales syndicales et des syndicats en général à une concertation avec le ministère du travail pour des modifications aussi substantielles.

Pour que l'article puisse jouer, il faut qu'il y ait eu un accord collectif !

Je veux dire à mes collègues socialistes, communistes et verts qu'ils apportent la preuve, comme je le disais dans la discussion générale, qu'on est dans une société de défiance. On part systématiquement du principe que le chef d'entreprise est un arnaqueur, un esclavagiste, qu'il fait n'importe quoi. (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.) Actuellement, si un employeur souhaite modifier les horaires de son salarié, ne serait-ce que pour quelques jours, il risque de se retrouver en tort et le salarié risque de ne plus être assuré. L'article 40 protège donc le salarié et l'employeur, et permet à l'entreprise, en répondant à des pointes de production, de créer de nouvelles richesses, voire de futurs emplois. On ne parviendra jamais à simplifier le droit du travail si vous partez du principe que l'on est dans la défiance.
Le groupe UMP votera cet article.

Les minutes que nous consacrons à ce débat de fond montrent que l'article 40 n'a rien à faire dans un texte sur la simplification du droit.
Quels sont les rapports entre la loi et le contrat s'agissant du code du travail ? Quelles difficultés la jurisprudence de la Cour de cassation entraîne-t-elle ?
Par une argumentation assez contradictoire, dans tous les cas incohérente, le rapporteur et le ministre nous demandent ce que nous sommes en train de faire étant donné que les protections collectives sont là et que nous ne pouvons pas renvoyer à la décision individuelle du salarié. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre.

Votre raisonnement est totalement faux. L'accord collectif est une liberté supplémentaire.
M. le secrétaire d'État, dans un raisonnement complètement incohérent, indique que le salarié serait sans protection. Non, il aura la liberté de dire s'il accepte qu'on lui applique ou non les conséquences de l'accord. On ne lui impose rien.
La Cour de cassation en a décidé ainsi et c'est la conséquence directe d'une décision fondamentale que vous avez prise : l'inversion de la hiérarchie des normes. Lorsqu'il y avait une négociation cohérente respectant les niveaux de négociation où l'accord d'entreprise ne pouvait pas être en recul par rapport à l'accord de branche, cette jurisprudence de la Cour de cassation n'existait pas. Mais le jour où vous avez fait semblant de croire à la négociation collective pour aboutir à son atomisation complète, vous avez mis les salariés en danger. Face à cette confusion, la Cour de cassation a jugé qu'il fallait donner une liberté supplémentaire au salarié. Voilà pourquoi votre décision est grave aujourd'hui.

M. Vidalies a fort bien expliqué le processus. En effet, dès lors qu'un accord collectif est signé, le salarié doit pouvoir refuser cette modulation en fonction de critères de vie sociale et familiale. C'est cette possibilité que vous cassez, c'est-à-dire que vous estimez que le salarié n'aura pas le choix, qu'il sera obligé d'accepter la modulation et de réorganiser sa vie, avec tous les problèmes que cela implique, sinon il sera licencié.
D'un côté, vous essayez régulièrement depuis 2002 de casser toutes les protections collectives en suivant parfaitement les propositions contenues dans les quarante-quatre mesures du MEDEF.

De l'autre, vous inventez des protections collectives qui n'ont comme objectif que de casser la décision qui vient d'être prise par la Cour de cassation. En fait, vous obligez les salariés à être toujours dans la situation la moins favorable.
Contrairement à ce qu'a dit M. Taugourdeau, ce n'est pas un problème de défiance mais de réalité des rapports de force dans les entreprises. Il y a un lien de subordination entre l'employeur et le salarié ; le salarié dépend des décisions de l'employeur. Dès lors, il n'est pas libre. Vous ne pouvez pas arguer de cette liberté puis faire en sorte qu'il ne puisse pas l'utiliser.
Enfin, je souhaite apporter une précision. Ce n'est pas au nom des Verts que j'interviens mais du parti de gauche.

Nous ne sommes pas là dans la simplification, mais dans un changement fondamental du droit.

La jurisprudence a toujours montré que le contrat de travail pouvait être modifié unilatéralement par l'employeur, sauf en cas de modification substantielle comme celles touchant à la situation personnelle et familiale. Cette jurisprudence s'appliquait en cas de modification du lieu de travail, de l'amplitude journalière de travail, voire en cas de travail imposé le samedi. Quand vous proposez de revenir sur ces protections, il ne s'agit pas de simplifier le droit, mais de provoquer une rupture avec une jurisprudence constante qui imposait que l'employeur ne décide pas unilatéralement en imposant au salarié ce qui pouvait avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale, voire en termes de santé. Voilà la réalité du droit positif qui existait jusqu'à présent. Vous ne le simplifiez pas, vous le modifiez de manière fondamentale.
(Les amendements identiques nos 103 et 195 ne sont pas adoptés.)

Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'article 40.
(Il est procédé au scrutin.)

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 59
Nombre de suffrages exprimés 59
Majorité absolue 30
Pour l'adoption 38
Contre 21
(L'article 40 est adopté.)

Je proteste avec vigueur contre l'adoption d'un tel article et contre le fait que nous discutions de la simplification du code du travail et des droits des travailleurs en l'absence du ministre du travail. C'est scandaleux !

Le ministre a pris des engagements quant au respect des méthodes de la concertation avec les organisations syndicales et quant à la loi de 2007 qui impose un délai de six semaines pour discuter avec les organisations syndicales. Or rien de tout cela n'est respecté, vous foulez tout aux pieds. L'absence du ministre concerné est anormale.


Cet amendement reprend un principe déjà adopté par l'Assemblée à l'occasion de la discussion d'une proposition de loi que j'ai défendue en 2009 avec notre ancien collègue Jean-Frédéric Poisson, principe de nouveau voté en juin dernier.
Il s'agit de sécuriser le recours aux avenants temporaires pratiqués dans certaines branches professionnelles ou dans certaines entreprises. Certaines personnes travaillant à temps partiel ne peuvent bénéficier d'un avenant à leur contrat qui leur permettrait de travailler davantage – cela à cause de dispositions légales beaucoup trop difficiles à appliquer –, cependant que leur voisine, par exemple caissière et travaillant elle aussi à temps partiel, serait en congé maternité. (Murmures sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
L'amendement vise à apporter la garantie à une personne en CDD qu'elle pourra, si elle le souhaite, travailler davantage avec la perspective éventuelle de signer un jour un contrat à durée indéterminée à temps complet.

…ensuite, le cadre de la rémunération du complément d'heures choisi est déterminé par les partenaires sociaux par un accord collectif préalable.

Cet accord définit les règles relatives à l'usage de ces avenants, détermine les cas de recours qui ne pourront excéder ce que permet le recours du contrat de travail à durée déterminée, et fixe les garanties apportées au salarié, notamment en ce qui concerne la date et le retour aux conditions initiales de travail.

Le présent amendement me paraît apporter toutes les garanties nécessaires.
Je ne me place pas du côté de l'employeur, mais du salarié. (Protestations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

C'est ça : avec une hache dans la main ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Lorsqu'une occasion s'offre au salarié d'augmenter ses ressources, il doit pouvoir, à terme, bénéficier d'un temps plein.

Il faut par conséquent que nous examinions quelles garanties lui donner.
Je rappelle que nous avons déjà voté le principe de cet amendement à plusieurs reprises.

…je me contenterai de compléter sa démonstration. Un CDI à temps partiel au sein de telle entreprise peut parfaitement être un CDD dans une entreprise voisine. Cet amendement est d'une modernité exceptionnelle…

…puisqu'il permet à une personne en CDI à temps partiel d'effectuer, en plus, un CDD dans la même entreprise plutôt que d'aller faire un CDD dans une entreprise à quarante kilomètres de là.
Plusieurs députés du groupe SRC. Bravo !

Je déciderai du sort de mon amendement en fonction des avis de la commission et du Gouvernement.

La commission a émis un avis défavorable pour chacun de ces amendements. (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC.)

Elle a en effet considéré qu'ils avaient un caractère cavalier. (Sourires.)

Quant au fond, les deux amendements évoquent l'article 13 de la proposition de loi sur le développement de l'alternance et de la sécurisation des parcours professionnels telle que l'Assemblée l'a adoptée le 21 juin 2011 en première lecture.
La disposition en question a été, je le rappelle, supprimée en première lecture au Sénat et n'a pas été rétablie dans le texte définitivement adopté…

…compte tenu de ses aspects problématiques et notamment de la non-comptabilisation en heures complémentaires des heures de travail accomplies dans le cadre de l'avenant conclu par le salarié à temps partiel.

Or ces amendements n'apportent pas de réponse à cette question centrale.

En outre, la notion de complément d'heures choisies ne repose sur aucune définition précise dans le droit du travail.

Le renvoi à la négociation entre partenaires sociaux donne un caractère facultatif à la majoration des heures complémentaires réalisées.

Les implications de tels avenants, pour des catégories d'actifs qui travaillent à temps partiel, en particulier pour les femmes,…

…exigent selon la commission un débat de fond qui ne peut avoir lieu à l'occasion d'amendements à une proposition de loi de simplification du droit.
C'est la raison pour laquelle, nonobstant le caractère fondé, sur le principe, de ces amendements, la commission a préconisé leur rejet.

J'informe l'Assemblée que, sur l'amendement n° 88 , je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements en discussion commune ?
Les propos du rapporteur sont parfaitement cohérents avec l'avis qu'a donné le Gouvernement sur l'amendement précédent.
Le Gouvernement est allé dans le même sens que la commission dans la mesure où elle a pris parti en faveur de la négociation collective ; c'est la position du Gouvernement depuis longtemps, qui s'est traduite par le vote de la loi de 2008.
Il n'est pas question de laisser, comme je l'ai entendu, le salarié tout seul. La négociation collective suppose que des partenaires sociaux négocient pour les salariés. Aussi, conformément à la logique de la loi de 2008, le Gouvernement fait confiance aux partenaires sociaux et à la négociation collective.
J'entends bien les arguments des uns et des autres et je comprends tout à fait que ce sont des situations concrètes qui ont conduit leurs auteurs à déposer ces amendements. Mais, comme le rapporteur, j'estime que ce sujet mérite un ample débat qui n'a pas sa place dans le cadre de l'examen d'un texte de simplification du droit.
Il ne s'agit pas ici d'organiser les relations au sein de l'entreprise ni, par conséquent, d'organiser le temps de travail.
Si votre démarche paraît acceptable dans son principe, elle se heurte néanmoins à une difficulté de fond : vous avez bien prévu la négociation collective, mais elle n'est pas encadrée de façon suffisamment précise, ce qui reviendrait à faire courir des risques aux salariés.
C'est pourquoi notre position est cohérente et était identique à celle de la commission sur les amendements précédents.
Le Gouvernement, j'y insiste, fait confiance à la négociation collective. Si ces amendements étaient présentés à l'occasion de la discussion d'un texte correspondant à leur objet, ils mériteraient d'être débattus et approfondis. Il s'agirait de définir un dispositif renforçant et détaillant la protection du salarié dans le cadre de la négociation collective.
Le Gouvernement souhaite donc que ces deux amendements soient retirés, puisqu'ils sont étrangers à l'objet du présent texte.

L'argument le plus important développé par le rapporteur et par le secrétaire d'État est leur attachement à la négociation collective.
Je souhaitais que le débat puisse avoir lieu a posteriori. Il s'agit en effet d'un sujet important et qui, Bernard Gérard l'a souligné, concerne le salarié. La négociation doit par conséquent être réglementée et je vous accorde volontiers que mon amendement n'a pas forcément sa place dans un texte comme celui que nous sommes en train d'examiner. Mon but consistait à susciter un vrai débat.
Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Je souhaitais moi aussi que ce débat important ait lieu. Contrairement aux remarques polémiques, caricaturales que nous avons pu entendre, j'ai bien placé au coeur de mon amendement les garanties qu'il faut apporter au salarié pour qu'il puisse un jour obtenir un contrat à durée indéterminée à temps complet. (Murmures sur les bancs du groupe SRC.)

Je m'accorde avec M. le secrétaire d'État et je retire mon amendement. Je souhaite néanmoins que nous approfondissions ce sujet car il soulève une vraie question qui touche autant l'entreprise que les salariés.

Cet amendement vise à aligner les droits des salariés du secteur privé ayant contracté un pacte civil de solidarité sur les droits des personnes mariées en matière de congés spéciaux pour événements familiaux.
Cette égalité de traitement étant déjà en vigueur dans la fonction publique, il apparaît normal que les salariés du privé en bénéficient également. Je ne vois pas pourquoi nous n'adopterions pas cette disposition qui relève de la clarification du droit puisque nous procédons à une harmonisation des droits entre mariés et pacsés qui constitue un mouvement de fond depuis la création du PACS.
Dans de nombreux domaines, nous permettons aux pacsés de bénéficier des mêmes droits que les personnes mariées. Or l'on m'a opposé à deux reprises la nécessité d'une étude d'impact, ce qui me paraît un peu ridicule quand on constate que certains amendements qui mériteraient eux aussi une étude d'impact sont parfois adoptés sans la moindre discussion.
La disposition qui vous est proposée peut coûter un peu aux entreprises mais il s'agit d'un choix politique.

M. Tardy vient de donner le motif pour lequel la commission a rejeté son amendement : il nécessite évidemment une étude d'impact.
M. Tardy soulève une vraie question, qu'il a défendue comme il se doit. Il y a lieu toutefois d'approfondir la réflexion sur le dispositif qu'il propose, et qui déborde largement – son auteur ne l'ignore pas – le cadre de la simplification du droit. Là encore, il s'agit d'un sujet méritant un débat, mais qui n'a pas sa place dans la présente discussion.

Il s'agit d'un très bon amendement.
L'article 40, qui n'a rien à voir avec la simplification du droit, a sa place dans ce texte, nous dit-on. Mais la proposition que fait notre collègue Tardy, elle, n'y aurait pas sa place !
Invoquer la nécessité d'une étude d'impact, c'est fantastiquement commode quand on ne veut pas répondre à une question. Sous la IIIe République, l'argument employé était : « Il faut créer une commission ». Sous les gouvernements UMP, c'est : « On attend l'étude d'impact. »
Cela fait maintenant assez longtemps que le PACS existe en France. Je sais que nombre de nos collègues étaient contre, mais il existe, c'est une réalité, à laquelle beaucoup se sont d'ailleurs ralliés, parce qu'ils se sont rendu compte que c'est finalement très pratique dans la vie courante, et que c'est une avancée de civilisation. Toute une série de pays étrangers l'ont d'ailleurs introduit dans leur législation, sous des formes diverses mais similaires. Cela étant, nous n'avons pas été les premiers à le faire. Bref, le PACS existe et concerne des dizaines de milliers de nos concitoyens. Mais il s'arrête à la porte de l'entreprise. Avouez que c'est quand même un peu bizarre.
Normalement, les droits s'appliquent dans l'ensemble de la société, et non pas seulement dans des morceaux de la société. Le groupe GDR votera donc bien évidemment cet amendement.

Le groupe SRC votera également cet amendement, et je remercie M. Tardy de l'avoir déposé.
Cela étant, je voudrais interroger M. le rapporteur, M. le président de la commission des lois et M. le secrétaire d'État. Vous avez une conception de ce texte qui est quand même à géométrie variable. S'agissant de cet amendement relatif au PACS, qui ne propose rien d'autre qu'une simple adaptation du droit, on nous dit qu'il n'a rien à faire dans ce texte. Mais s'agissant de l'article 40 que nous venons d'examiner, on nous dit qu'il entre tout à fait dans le cadre du texte, alors qu'il concerne la durée du travail, qu'il n'a rien à voir avec la simplification du droit, et qu'il atteint profondément notre législation du travail. Cette position est totalement incohérente.
Pour des raisons politiques, vous ne souhaitez pas adopter cet amendement, qui va plus loin que vous ne souhaitez aller. Soit. Mais nous vous disons depuis le début de la discussion de ce texte qu'il recèle un certain nombre de cavaliers législatifs, qu'il constitue une sorte de fourre-tout généralisé. Et nous en avons la preuve ici. D'un côté, vous souhaitez aborder le droit du travail, y compris, je le répète, en modifiant des dispositions fondamentales pour la protection des salariés. De l'autre côté, un amendement comme celui-ci, qui nous semble tout à fait bienvenu, vous le refusez. C'est totalement incompréhensible.
Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je croyais pourtant avoir été clair dans ma réponse à M. Tardy. Je partage tout à fait l'objectif qu'il poursuit.
Et il a raison de dire que cela ne coûte rien à l'État. Il ne s'agit pas d'une question de coût pour l'État. Si la commission demande qu'il soit procédé à une étude d'impact, c'est parce que cet amendement a un coût, qui n'est pas mesuré, pour les acteurs économiques.
Ni la commission ni le Gouvernement n'expriment un désaccord sur le dispositif proposé. Je vous demande d'écouter ce que nous disons. Je reconnais que, sur le fond, je suis favorable à ce dispositif. Je dis simplement, d'une part, que l'objet de ce projet de loi est la simplification du droit, et d'autre part, qu'il n'y a pas d'étude d'impact, comme M. Tardy le reconnait lui-même. On ne sait pas quelle sera la conséquence de ce dispositif. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une étude d'impact, comme le dit le rapporteur.
Mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté : il n'y a là aucune incohérence avec les positions que nous avons prises jusqu'ici, bien au contraire.

Il y a au moins une constante, avec ce gouvernement. Autant, sur un certain nombre de points, il change de pied, autant, sur celui-ci, il ne change pas de pied. Quand on n'ose plus dire qu'on n'est pas d'accord, on utilise des arguments dilatoires : « Vous ne pourrez pas dire que je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas le moment ».
Depuis le début de cette législature, j'en aurai entendu, des « Ce n'est pas le moment » ! M. Lefebvre m'en a encore sorti un la semaine dernière, ou il y a quinze jours, dans l'hémicycle.
Non, dites-nous que vous ne voulez pas faire ce que propose cet amendement, ce sera plus simple. La réalité, c'est qu'il s'agit ici d'étendre aux autres travailleurs un droit qui a déjà été accordé aux fonctionnaires. Cela paraît quand même une évidence. Par ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que l'on attend d'une étude d'impact, si ce n'est qu'elle permette de faire en sorte que quelques mois ou quelques années puissent s'écouler, le temps que certains députés oublient les amendements qu'ils ont déposés.
(L'amendement n° 142 n'est pas adopté.)

Quelques mots de présentation, puisque j'étais l'auteur de l'amendement qui est devenu l'article 40 bis.
Il s'agit d'inscrire dans le code du travail le statut du télétravailleur, et de reconnaître enfin le télétravail. C'est une nouvelle forme de travail, qui a été mise en avant ces derniers temps par un rapport de notre collègue Pierre Morel-A-L'Huissier, et de façon très intéressante. Il a fait des propositions qui auraient pu être reprises. Il était également soutenu par notre ancien collègue Jean-Frédéric Poisson, dont la proposition de loi s'est perdue dans les méandres de la procédure parlementaire, quelque part du côté du Palais du Luxembourg, où je ne suis pas sûr qu'elle prospère dans les temps qui viennent.
L'idée, c'est d'inscrire enfin dans le code du travail la reconnaissance du télétravail. Certes, nous avons déjà un accord européen qui date de 2002, ainsi qu'un accord interprofessionnel qui date de 2005. Mais aujourd'hui, nous avons du retard : 7 % des salariés télétravaillent, alors que la moyenne européenne est de 13 %. Il y a des besoins évidents dans le monde rural. Je peux en attester, d'ailleurs, en tant que vice-président du syndicat départemental Manche Numérique, où l'on essaie de promouvoir le télétravail.
En même temps, je sens bien que cet article a suscité quelques craintes et quelques interrogations. Je voudrais donc, avant qu'un certain nombre d'amendements soient défendus, pouvoir recadrer les choses.
L'article 40 bis reprend la définition du télétravail telle qu'elle est inscrite dans l'accord national interprofessionnel, ni plus ni moins. Il n'y a aucune chausse-trape.
Cet article rappelle que les télétravailleurs sont des salariés qui bénéficient des mêmes droits et garanties que tous les autres salariés. C'était cela, l'intérêt de ma proposition : pouvoir rappeler qu'il y a un statut clair, ferme, que ces salariés appartiennent à la communauté du travail.
Il convient aussi de répondre à l'interpellation qu'a faite hier une grande centrale syndicale, FO, pour ne pas la nommer, qui craignait que le télétravail soit éventuellement dévalorisé. Non, le télétravail est une modalité d'exécution du contrat de travail. Et le télétravail ne se présume pas. Les circonstances exceptionnelles, les épidémies par exemple, sont réellement des circonstances exceptionnelles de l'exécution. Il n'y a pas de présomption.
Enfin, il fallait rappeler que l'ensemble des obligations des employeurs vis-à-vis des télétravailleurs sont les mêmes que dans l'ensemble du code du travail. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point, je tenais à le rappeler.

J'ai été, en 2006, l'auteur d'un rapport sur le télétravail, et je souhaiterais resituer le sujet.
Ce terme est bien connu, notamment à l'étranger. L'Europe s'en est occupée, et un accord cadre européen a été signé en 2002, dans lequel figurent un certain nombre de dispositions qui constituent le fondement même du télétravail : le volontariat ; la réversibilité synallagmatique entre le salarié et l'employeur ; des mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et l'adaptation du lieu de travail.
Cet accord cadre européen a été transposé en droit français dans le cadre d'un ANI, en 2005. Cet ANI a été utilisé par le secteur privé, mais il ne couvre pas toutes les modalités, ni tous les employeurs du secteur privé.
Plusieurs études, plusieurs rapports ont été faits récemment : le mien, en 2006 ; en 2009, celui du Commissariat à l'analyse stratégique, rendu à Nathalie Kosciusko-Morizet ; M. Éric Besson a lancé une étude, ainsi que M. Frédéric Lefebvre. Des groupes de travail ont été constitués. Aujourd'hui, le problème, en France, est d'intégrer un peu plus largement le télétravail. Mais il y a des blocages.
Comme l'a dit Philippe Gosselin, nous constatons à l'étranger des pourcentages élevés de salariés qui exercent dans le cadre du télétravail : 28 % aux États-Unis et au Canada. En France, même si les chiffres sont un peu anciens, nous en serions à 7 %, plutôt à 12 % dans le privé et à 5 % dans le public.
Jamais le terme n'a été intégré dans le code du travail. Ce qui a été accompli par notre collègue Philippe Gosselin était nécessaire. Il fallait intégrer ce concept dans le code du travail.
Concernant le secteur public, nous avons fait faire une analyse par le ministère de la fonction publique. Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies a rendu un rapport. C'était le premier rapport sur le secteur public.
J'ai intégré dans la loi sur le dialogue social la problématique du télétravail. Nous sommes en train de discuter avec les syndicats. Il semble que le moment ne soit pas venu d'intégrer ce terme dans le statut de la fonction publique. Nous attendons les résultats de la discussion avec les syndicats et les employeurs publics. Un accord cadre national doit intervenir en principe en décembre. Ensuite, nous aurons tout loisir de lui donner force de loi, ou de l'inscrire dans un décret pris en Conseil d'État.
Voilà, globalement, la situation du télétravail dans notre pays.


Je suis saisi d'un amendement n° 132 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

On ne peut que se réjouir qu'il soit à nouveau question du télétravail, puisque, avec mes collègues Bernard Gérard et Pierre Morel-A-L'Huissier, nous avions déposé une proposition de loi qui a fait le parcours que l'on sait. Aujourd'hui, nous devons saluer ce nouveau travail.
Cet amendement a pour finalité de protéger le télétravailleur, en instaurant un entretien annuel pour fixer ses conditions d'activité et sa charge de travail. Il importe d'éviter l'isolement du salarié. D'où l'intérêt de cet échange annuel.

Cet amendement a du sens. La commission a peut-être donné un peu précipitamment, je le reconnais, un avis défavorable.
Je vais donner un avis à titre personnel. Cet amendement me semble bienvenu. Il complète la définition du statut du télétravailleur, en prévoyant l'organisation, chaque année, d'un entretien entre l'employeur et le salarié sur les conditions de travail. C'est une chose qui n'existe pas aujourd'hui. A priori, cela ne pose aucun problème. Je ne vois pas pourquoi cet entretien n'aurait pas lieu. Cela ne modifie pas profondément les conditions dans lesquelles s'exerce le « contrat de télétravail ».
C'est une précision bienvenue, je le répète, qui évite l'isolement du salarié. Et nonobstant l'avis peut-être précipité, encore une fois, de la commission, je serais plutôt enclin, à titre personnel, à adopter cet amendement.
Je suis très favorable à cet amendement. Comme l'a dit M. Decool, qui connaît bien ce sujet – tout comme M. Morel-A-L'Huissier, qui travaille sur ces questions depuis longtemps –, il convient de lutter contre l'isolement du salarié. L'entretien annuel est la réponse à ce problème. Il permet à l'employeur de s'assurer que les mesures sont prises pour prévenir cet isolement. Je crois que c'est de bonne politique de prévoir cela dans la loi.
Je veux d'ailleurs en profiter pour souligner l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup de travaux ont été consacrés, dans cet hémicycle, à ce sujet. Beaucoup de salariés et d'entreprises attendent que la loi reconnaisse enfin le télétravail. C'est d'ailleurs, en soi, un dispositif qui va simplifier la vie d'un certain nombre d'acteurs économiques ou de salariés. Il y a aujourd'hui un certain flou, qui nécessite des points de repères et des clarifications.
Nous sommes vraiment en train de mettre en place un dispositif important. M. Morel-A-L'Huissier et M. Decool savent combien j'ai moi-même défendu la question du télétravail. Je voulais les remercier de ces différents amendements, qui, me semble-t-il, sont de nature à enrichir ce texte et à simplifier la vie de beaucoup d'acteurs économiques.

Inscrire le télétravail dans le code du travail, oui, à condition de ne pas dénaturer le texte. Le communiqué qu'a publié hier une organisation syndicale soulève un problème dont nous reparlerons à propos de l'amendement que nous examinerons après celui-ci : s'il y a des circonstances exceptionnelles qui justifient que tout le monde soit assujetti au télétravail, alors on est en dehors du texte, et vous en changez la nature. J'espère que cet amendement sera écarté.
L'amendement n° 132 est-il satisfaisant ? Dans son principe, oui, puisqu'il semble aller dans le sens du salarié. Sauf que sa rédaction introduit une restriction par rapport à l'accord interprofessionnel qui a été signé le 19 juillet 2005.
Les dispositions de l'accord interprofessionnel prévoient, s'agissant de cet objectif : « le télétravailleur doit pouvoir rencontrer régulièrement sa hiérarchie. […] Il bénéficie des mêmes entretiens professionnels que les autres salariés de l'entreprise. » C'est autour de cette rédaction que l'accord a été trouvé entre employeurs et organisations syndicales.
La disposition que vous proposez fixe un droit minimal : un entretien par an, et si les autres salariés ont droit à dix entretiens par an, le télétravailleur n'en aura qu'un seul.
Je ne fais pas de procès d'intention s'agissant de l'objectif visé, mais la rédaction que vous avez choisie aboutit à limiter les droits par rapport au texte de l'accord interprofessionnel.
C'est pourquoi, à ce stade, nous ne voterons pas cet amendement. Puisqu'il existe un accord interprofessionnel, la rédaction du texte doit correspondre à la volonté des partenaires sociaux, sans restreindre les droits du télétravailleur comme c'est le cas ici.

Je partage l'inquiétude exprimée par M. Vidalies. Le télétravail ne doit pas aboutir à créer une catégorie distincte de salariés au sein de l'entreprise.
Je m'étonne, car ce texte est une loi de simplification du droit, et non d'évolution du code du travail. Cet article n'y a donc pas sa place. Visiblement, lorsque cela plaît au Gouvernement, il est possible d'insérer des articles sans rapport avec le sujet, mais pas dans le cas contraire.
S'agissant du contenu, l'alinéa 12 pose problème, car il prévoit de donner au télétravailleur : « […] priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles. » Mais c'est bien la moindre des choses ! S'il n'est pas un travailleur à part dans l'entreprise et si le télétravail n'est qu'une forme, à un moment donné, de son travail au sein de l'entreprise, il devrait à tout moment pouvoir réintégrer un des sites de l'entreprise sans qu'il y ait de questions de priorité à se poser. Cet article suppose donc bien qu'il s'agit d'un salarié à part.
Mais votre amendement va encore plus loin, puisque tout salarié dans l'entreprise a droit à un entretien annuel, et parfois plus fréquemment, afin de fixer ses conditions d'activité et sa charge de travail. Pourquoi introduire un article spécifique pour les télétravailleurs, si ce n'est pour introduire une protection moindre pour cette catégorie de salariés ?
La sagesse serait de retirer cet amendement afin que les télétravailleurs relèvent du droit commun de l'entreprise, et qu'ils ne soient pas une catégorie avec des droits inférieurs.

J'irai dans le sens de Mme Billard : il est vrai qu'à la lecture de cet alinéa, on pourrait penser se trouver face à un extraterrestre en voyant un télétravailleur !
Un télétravailleur, c'est quelqu'un qui travaille chez lui, un point c'est tout. Il est salarié de l'entreprise, il a sûrement des relations permanentes avec sa hiérarchie, mais tel que cet amendement est rédigé, cela donne l'impression que l'on va le faire descendre de sa montagne une fois par an pour le voir en entretien.
Ce type d'amendement est complètement inutile : naturellement, le télétravailleur a les mêmes droits, les mêmes conditions de travail et les mêmes entretiens avec ses supérieurs que tous ses collègues, si ce n'est qu'il ne travaille pas dans l'entreprise. Ce n'est qu'une question physique de distance, qui n'altère en rien le lien qui l'unit à son employeur. Je crois donc que cet amendement ne sert absolument à rien.

Aujourd'hui, nous faisons oeuvre utile en intégrant dans le code du travail la définition du télétravailleur figurant dans l'accord national interprofessionnel. Salariés, employeurs et syndicats demandaient que cela soit intégré dans le code du travail.
Cet amendement assure un entretien obligatoire annuellement, c'est un élément de plus qui figure dans l'accord national interprofessionnel, et comme cela ne figure pas dans le code du travail, il faut l'y insérer.

Il y aurait des salariés qui ne passent pas un entretien annuel dans ce pays ?

Je remercie le rapporteur de son avis favorable à titre personnel, ainsi que le ministre, et je m'associe totalement à l'amendement de M. Decool.

Je tiens à préciser que cet amendement n'exclut pas les dispositifs de droit commun, bien au contraire. Nous prévoyons que le salarié peut avoir un entretien concernant notamment ses conditions de travail et sa charge de travail, afin d'éviter l'isolement. C'est donc un avantage supplémentaire, et pas du tout une restriction.
(L'amendement n° 132 , repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 104 .
La parole est à M. Alain Vidalies.

Nous abordons une question de fond. La rédaction proposée pour l'alinéa 14 s'écarte du texte initialement prévu et dénature le télétravail, qui deviendrait, dans des circonstances exceptionnelles, la forme normale d'exécution du contrat de travail. Un autre amendement propose même d'ouvrir cette possibilité en cas de force majeure, et non de circonstances exceptionnelles.
Par conséquent, il serait possible de demander à des salariés de continuer à travailler depuis leur domicile, parce que les circonstances sont exceptionnelles. Évidemment, personne ne peut définir ces circonstances exceptionnelles : sont-elles météorologiques, économiques, épidémiologiques ? Tout cela est très hasardeux.
À ceux qui ont rédigé le texte ainsi, je tiens à dire que si l'on voulait jeter la suspicion sur le télétravail, on ne s'y prendrait pas autrement. Le télétravail est une forme normale de travail, qui peut correspondre à un moment donné à l'intérêt de l'entreprise et à celui du salarié, puisque ce dernier doit être volontaire. Le fait de l'inscrire dans le code du travail peut correspondre à la volonté des partenaires sociaux.
Je maintiens que l'amendement que nous venons de voter est une erreur, parce qu'en étudiant le cadre général du code du travail, il apparaîtra que nous avons créé une règle spécifique alors que la règle générale suffisait. Nous annonçons que le télétravailleur est un travailleur de droit commun, mais vous faites l'inverse en créant des règles spécifiques.
Les choses sont claires : soit vous croyez dans le télétravail, et alors il faut voter cet amendement pour supprimer cet alinéa qui dénature le télétravail. Soit vous le repoussez, et nous constaterons que la situation est grave, car cette rédaction aboutirait à donner une marge de manoeuvre aux entreprises pour qu'elles imposent le télétravail. Ce serait extravagant, et cela ne correspond en rien aux objectifs des signataires de l'accord national interprofessionnel, ni de ceux qui défendent régulièrement le télétravail dans cette assemblée. Il s'agit vraiment d'une question majeure, et je vous demande donc de voter cet amendement si vous souhaitez inscrire dans le code du travail le télétravail fondé sur le volontariat.

La commission formule un avis défavorable sur cet amendement. Je rappelle que le nouvel article L. 1222-11 du code du travail prévoit : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, la mise en oeuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
Cela signifie que cet article n'a pas pour but de faire travailler à leur domicile les salariés qui sont en situation de congé maladie. Cet article a pour objectif, en cas de circonstances exceptionnelles – rappelons-nous de la menace d'épidémie de H1N1 par exemple – au cours desquelles la liberté de circulation est restreinte, de donner la possibilité de faire travailler les personnes chez elles dans le cadre du télétravail.
Ainsi, la continuité de l'activité de l'entreprise est possible. Cet article 1222-11 paraît donc parfaitement utile, dans des circonstances qui demeurent exceptionnelles, et je pense que nos propos lèvent toute ambiguïté quant au risque de dérapage. Une personne malade ne travaillera pas chez elle en application de cette disposition. C'est la raison pour laquelle nous formulons un avis défavorable à cet amendement.
Le rapporteur vient d'expliquer les choses de manière très précise. Sur la question de savoir dans quelle condition un salarié peut être amené à faire du télétravail, un débat est possible. Mais, en l'occurrence, le dispositif actuel, et notamment l'alinéa n° 14, prévoit clairement que les circonstances exceptionnelles sont des catastrophes collectives, et cela ne peut en aucun cas concerner des salariés en arrêt maladie.
Encore une fois, ce débat existe, le Conseil d'analyse stratégique s'en est d'ailleurs saisi, mais ce n'est pas l'objet de l'alinéa n° 14.

Nous ne pouvons pas nous en tenir aux propos rassurants du secrétaire d'État ou du rapporteur, parce que ce n'est ni l'esprit ni le contenu de l'accord qui a présidé à l'intégration du télétravail dans le code du travail. L'accord interprofessionnel de juillet 2005 ne peut pas subir une interprétation. Il est tel que l'ont décidé les organisations syndicales signataires.
Permettez-moi de citer un communiqué de Force Ouvrière Cadres qui indique qu'il n'y a absolument aucune raison de tolérer une telle modification, parce qu'elle serait assurément source de dérives et d'abus ; il faut donc la rejeter.
Je ne sais pas si M. le secrétaire d'État se souvient d'un débat que nous avions eu ici même lorsqu'il siégeait sur les bancs de l'UMP.
Je viens d'y faire allusion !

Eh bien, je vais compléter votre allusion !
Nous avions eu un vif débat entre opposition et majorité, puisque vous étiez intervenu en apportant des exemples, dont celui de quelqu'un ayant une jambe cassée, et vous vous interrogiez pour savoir pourquoi cette personne ne travaillerait pas puisque, selon vous, une jambe cassée n'a jamais empêché personne de travailler. C'était un de vos arguments lors de nos échanges, je vous renvoie au Journal Officiel.
Il ne s'agit donc pas de circonstances exceptionnelles. Reprenons la rédaction de cet alinéa : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, la mise en oeuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »

Que vous êtes impatient !
M. Warsmann devrait être le gardien du temple s'agissant de la précision de la rédaction de la loi. Chaque fois que l'on introduit le terme « notamment » dans la loi, comme c'est le cas ici, cela permet tout et n'importe quoi, vous le savez bien. Il faut satisfaire tous ceux qui demandent que cet alinéa soit supprimé.

Ce rappel au règlement semblera étrange, mais je demande à M. le rapporteur de m'écouter attentivement.
L'avis que vient de donner le rapporteur est contraire au compte rendu de la commission que j'ai actuellement sous les yeux. Nous avions bien retenu en entrant dans l'hémicycle que vous aviez donné un avis favorable. Le compte rendu de la séance de la commission des lois du mardi 11 octobre à 14 h 30 est ainsi rédigé : « [La commission] accepte l'amendement n° 104 de M. Alain Vidalies tendant à supprimer la disposition précisant qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, la mise en oeuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
La commission a donc bien émis un avis favorable, et il ne me paraît pas correct qu'un débat ait été engagé sans que le rapporteur ne l'ait rappelé. Je pense que cela aurait été susceptible d'éclairer nos collègues : au vu de la composition de la commission, ils auraient compris qu'il s'agissait d'un débat légitime.
Monsieur le président, c'est l'avis de la commission que vous sollicitez, pas l'avis personnel du rapporteur.

Je pensais avoir indiqué, comme pour l'amendement de M. Decool, que c'était à titre personnel que je rendais un avis défavorable.
Nous avons examiné une quantité très importante d'amendements au titre de l'article 88 de notre règlement, et, de fait, sur quelques cas il y a eu des difficultés.
Je confirme que la commission a donné un avis favorable au titre de l'article 88. Personnellement, après avoir réétudié cet amendement, je donne un avis négatif.
Je voudrais sur ce sujet que les choses soient claires.
L'alinéa 14 n'est pas, pour le Gouvernement, le dispositif le plus important introduit dans le texte. J'ai insisté tout à l'heure sur la nécessité de traduire l'accord négocié en 2005.
Il ne faut pas faire d'amalgame ou laisser entendre que cela pourrait concerner un salarié en arrêt maladie. J'ai participé à ce débat de manière très active lorsque j'étais député. J'ai d'ailleurs été confronté à une position négative du Gouvernement. J'avais – vous l'avez rappelé et c'est pour cette raison que j'ai fait allusion à ce débat tout à l'heure – demandé un rapport du Conseil d'analyse stratégique. J'invite chacun de vous à en prendre connaissance. Le rapport souligne combien la proposition que je faisais à l'époque était positive.
Mais, je le répète encore, l'alinéa 14 n'a rien à voir avec ce sujet-là. Il traite de circonstances exceptionnelles, épidémie de grippe, par exemple. Or, lorsque l'accord a été signé en 2005, il n'avait pas été question d'épidémie, puisqu'il en a été question seulement en décembre 2009, reconnaissez-le. Il n'est pas absurde que des parlementaires se posent la question de savoir s'il est utile ou non d'introduire les circonstances exceptionnelles pour inclure une situation d'épidémie. Il me paraît très cohérent que le débat ait lieu.
Il est évoqué, monsieur Vidalies, dans l'exposé des motifs de cet amendement de suppression, l'idée que cela pourrait concerner la situation d'un salarié en arrêt maladie. Ce n'est pas le cas. Il est très important de le rappeler, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté.
Je pense que ce sujet mérite un débat, mais il ne doit pas avoir lieu à l'occasion d'un texte de simplification. Il existe un avantage en termes de simplification. Le fait que ce soit reconnu dans la loi dans les cas où cela peut poser des difficultés simplifiera la vie de beaucoup de gens. Mais il dépendra du Parlement de se saisir de cette question et d'en débattre, s'il le souhaite. Je vous invite, je le répète, à prendre connaissance du rapport du Conseil d'analyse stratégique. Mais de grâce, ne mélangeons pas tout !
Cet alinéa tel qu'il est rédigé est-il pertinent ou pas sur la question de la circonstance exceptionnelle – en l'occurrence des événements qui n'existaient pas au moment de la signature de l'accord en 2005, puisqu'il s'agit d'événements survenus en 2009 ? C'est, me semble-t-il, le seul sujet qui vaille.
J'espère avoir répondu aux interrogations de M. Muzeau et informé correctement les parlementaires.

Je voudrais revenir à l'esprit de l'article 40 bis. Il s'agit d'ancrer dans la loi un statut clair, net et sans ambiguïté du télétravailleur, qui est celui du droit commun. Un certain nombre d'éléments ambigus ont été soulevés. Il s'agit d'un enjeu de croissance : le télétravail peut être bien compris, avec un résultat gagnant-gagnant. Il n'est pas question de créer un statut à part de salarié à part, hors de la communauté de l'entreprise et du monde du travail.
L'amendement que j'ai défendu en commission visait à rappeler le droit commun. J'ai bien entendu l'interrogation de FO – c'est pour cela que j'ai cité FO, avant même que M. Vidalies n'introduise ce débat – et sans doute d'autres. Notre position est sans ambiguïté. Vous savez combien les tribunaux sont sensibles aux débats parlementaires. En ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, l'illustration donnée par la grippe montre bien qu'il ne s'agit pas d'ouvrir à d'autres débats. C'est vraiment le droit commun, ni plus, ni moins. Je pense être très rassurant sur ce thème.

Je voudrais indiquer à M. le secrétaire d'État que l'exposé des motifs de mon amendement ne correspond pas à son esprit. Je vous donne acte qu'il n'était pas opportun de citer le cas de salariés malades que l'on oblige à travailler. Ce débat n'est pas lié à l'amendement.
Vous nous avez indiqué être attaché au télétravail. Nous aussi, mais pourquoi voulez-vous introduire cette rédaction, qui est la seule qui pose actuellement un problème ? Si vous y croyez, pourquoi insistez-vous tant, alors que les salariés sont vent debout contre ce cas-là ?
Pourquoi les gens sont-ils réticents au télétravail ? Ils ne veulent pas que ce soit imposé. Et les chefs d'entreprise sont d'accord. Le seul cas où cela serait imposé, c'est celui-là. Cela peut certes arriver, mais il faudrait trouver une rédaction qui satisfasse tout le monde et qui ne laisse subsister aucun risque. Vous n'avez pas fait cet effort.
Qu'est-ce que les circonstances exceptionnelles ? À quoi tiennent-elles : au temps, aux événements économiques, à la situation personnelle des gens ? Nous n'en savons rien. Aucune précision n'est apportée. Elle n'est même pas renvoyé à un décret. De quelle épidémie s'agit-il ? L'existence de l'épidémie sera-t-elle décidée par une décision du ministère de la santé ? Ce n'est pas du droit. C'est tellement aléatoire que cela justifie les craintes.
Acceptez de voter notre amendement, vous pourrez le réécrire en deuxième lecture. Consultez les partenaires sociaux sur ce sujet. Vous êtes en train de dénaturer un texte pour une raison qui n'en vaut pas la peine. Vous pouvez rédiger un autre amendement, ou en voter un autre, je n'ai pas de fierté d'auteur.
Je crois que vous êtes en train de créer des difficultés – cela apparaît dans les différentes dépêches –, alors que vous êtes probablement de bonne foi.
Supprimons cet alinéa, nous pourrons avancer. Je crois que c'est ce que la commission avait compris et voté.
Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir accordé plus de temps pour réussir à convaincre la majorité qu'il s'agissait d'une bonne cause.

Comme M. Vidalies le reconnaît, je lui ai accordé plus de temps.
La parole est à M. Philippe Gosselin.

Vous avez bien compris l'état d'esprit et la volonté de promouvoir le télétravail que nous partageons sur ces bancs.
Je suis prêt, à titre personnel, à vous rejoindre sur ce point-là – je n'engage pas mes collègues. Si nous pouvions avancer et dépassionner le débat et montrer que c'est réellement le télétravail que nous voulons mettre en avant, si nous pouvions nous débarrasser de ces scories, enlever le petit caillou dans la chaussure, je serais prêt, je le répète, à vous rejoindre.

Je suis saisi d'un amendement n° 144.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

Cet amendement de précision vise, à l'alinéa 14, après le mot : « épidémie, », à insérer les mots : « ou en cas de force majeure, ».
Le droit distingue les deux notions de circonstances exceptionnelles et de force majeure.
En droit français, les circonstances exceptionnelles sont les circonstances rendant légaux des actes normalement illégaux dans le but d'assurer l'ordre public et le bon fonctionnement des services publics.
Un cas dit de force majeure est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face. Traditionnellement, l'événement doit être « imprévisible, irrésistible et extérieur ». Ces deux notions doivent donc se retrouver, sachant que le télétravail est tout à fait adapté à ces deux types de situation.

Cet amendement a été repoussé par la commission. Mais, à titre personnel, j'y suis favorable.

L'adoption de cet amendement serait bienvenue. Elle permet d'éclairer et de rassurer un peu plus nos collègues socialistes.
Cette rédaction précise encore les circonstances exceptionnelles, en montrant qu'il ne s'agit pas de circonstances liées à la maladie d'un salarié, mais de circonstances collectives, comme l'indiquait M. le secrétaire d'État.
La force majeure éloigne, me semble-t-il, la menace, si menace il y avait, de confusion avec la maladie d'un salarié.
J'ai déjà dit que l'alinéa 14 n'était pas pour le Gouvernement le dispositif essentiel. Le fait qu'on veuille le compléter ne me semble pas non plus essentiel.
J'ai entendu les avis des uns et des autres. Il sera utile de profiter de la discussion du texte pour retravailler sur l'alinéa 14, afin que toutes les ambiguïtés qui pourraient exister soient écartées. C'est pour cela que je vais m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée.
Chacun doit être bien conscient – comme l'a dit M. Vidalies tout à l'heure – que nous devons favoriser le dispositif du télétravail. L'objectif est de prendre en compte le fait nouveau, que nous n'avions pu anticiper, d'un phénomène d'épidémie.

Monsieur Dord, ce n'est pas une rédaction qui complète, mais une rédaction qui aggrave : « circonstances exceptionnelles ou force majeure ». L'auteur de l'amendement a lui-même expliqué que c'étaient deux définitions différentes. Vous pouvez soutenir le même texte, à condition de lui donner la même interprétation.
C'est la première illustration du risque que vous prenez. On voit bien que l'on va ajouter à cette rédaction des choses dont personne, y compris vous-même, ne semblait mesurer l'importance. Vous pourrez constater l'effet boomerang. Les commentaires médiatiques, syndicaux ne seront pas : « le télétravail a avancé », mais « ils ont trouvé le moyen d'écrire que le télétravail pourrait être imposé ».
Si, à un moment, il devient possible, contre la volonté des salariés, d'imposer le télétravail, vous aurez pris la responsabilité de ne jamais voir appliquer cet amendement ou de le voir appliquer par de mauvaises mains ; si ce n'est pas votre intention, votre responsabilité de législateur est en jeu.
J'ai entendu les propos de M. le secrétaire d'État, mais je pense que la situation est encore plus grave lorsque l'on ajoute la force majeure. Vous accrocher comme vous le faites à l'alinéa 14 est une erreur majeure.

Je vais donner la parole à Mme Martine Billard, après quoi nous passerons au vote.

Nous n'étions pas favorables au cas de télétravail dans des circonstances exceptionnelles, mais nous pouvions en discuter. Là, on en rajoute une couche avec le cas de force majeure.
Je remarque qu'à chaque fois les députés de la droite populaire parviennent à faire reculer le Gouvernement pour tout ce qui est du code du travail. Ce n'est pas la première fois, ils grignotent. L'alinéa 14 évoque la continuité de l'activité de l'entreprise et la garantie de la protection des salariés.
Qu'entend-on exactement par « événement imprévisible, irrésistible et extérieur » ? Rien ne prouve qu'il s'agit d'un événement mettant en danger la santé des salariés.
Aujourd'hui, on parle de circonstances exceptionnelles, après avoir ajouté les cas de force majeure. Demain, on dira que le télétravail pourra être imposé par l'employeur.
Car dans la gestion des entreprises, entre en ligne de compte le nombre de postes de travail, autrement dit le nombre de mètres carrés nécessaires pour installer l'ensemble des salariés sur un lieu de travail.

Je conclus, monsieur le président.
Pour une entreprise cherchant à diminuer le nombre de mètres carrés de ses bureaux, le télétravail sera une solution et, au final, il sera imposé.

Je souhaiterais que les auteurs de l'amendement, et ils sont nombreux, nous expliquent ce qu'il entendant par « cas de force majeure ». En dehors de la définition juridique donnée par M. Decool – « événement imprévisible, irrésistible et extérieur », est-ce une chute de neige soudaine, une grève SNCF ?
Votre définition est trop succincte ; elle veut tout dire et ne rien dire, ce qui est dangereux. Dites-nous quelles sont vos arrière-pensées.
(L'amendement n° 144 est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 340.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Nous venons d'examiner un dispositif qui devra être retravaillé afin d'aboutir à un bon équilibre.
Sur de tels sujets, il faut des négociations.
L'amendement du Gouvernement vise à développer le télétravail dans la fonction publique, sujet sur lequel M. Morel-A-L'Huissier a beaucoup travaillé. Cela fera bien sûr l'objet de négociations. C'est la raison pour laquelle le texte renvoie à un décret pour laisser se dérouler le temps de la négociation et permettre que les salariés de la fonction publique puissent eux aussi avoir accès au télétravail.
Sur ce sujet majeur, il est indispensable d'arriver à un large consensus, pour dissiper tout malentendu.

La parole est à M. Pierre Morel-A-L'Huissier, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet.

Je partage les propos de M. le secrétaire d'État. Dans le cadre du projet de loi sur le dialogue social, j'avais, à l'article 1er, demandé d'élargir le dialogue social au télétravail. En juin de cette année, une circulaire est parue pour ouvrir les négociations avec les syndicats. Laissons la discussion se dérouler, nous verrons ensuite s'il est nécessaire de compléter par un décret. Laissons faire les syndicats.

Nous ne devons pas adopter de telles dispositions en l'absence d'une concertation avec les organisations syndicales.

Il n'y a pas de discussions avec les organisations syndicales. Nous ne sommes pas dans la simplification du droit, mais dans des modifications substantielles du droit du travail. Je regrette donc vivement l'absence du ministre du travail ce soir.
(L'amendement n° 340 est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 163.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

…sur la promotion du télétravail au sein des administrations publiques.

Cela va dans le sens de la simplification ! (Sourires.)
Quel est l'avis de la commission ?

Avis défavorable. Lors de la dernière loi de simplification, nous avions supprimé 107 rapports. Je vous invite vivement à retirer votre amendement, monsieur Decool.

Oui, je vous en prie, retirez CET amendement !
(L'amendement n° 163 est retiré.)
(L'article 40 bis, amendé, est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 114 , portant article additionnel après l'article 40 bis.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

L'amendement est défendu.
(L'amendement n° 114 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 105 , tendant à supprimer l'article 41.
La parole est à M. Alain Vidalies.

La teneur de nos débats montre que nous ne sommes pas dans la simplification du droit et que nous aurions mieux fait de saisir les partenaires sociaux.
Tel qu'il est rédigé, l'article 41 donne lieu à toutes sortes d'interprétations juridiques.

Il vise le cas de salariés qui sont déclarés inaptes suite à une maladie de droit commun, c'est-à-dire une maladie qui n'a pas d'origine professionnelle. Que se passe-t-il après la décision de la médecine du travail ? L'employeur doit proposer des solutions de reclassement. Il existe des contrôles effectuées par le juge si l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement, en proposant des emplois compatibles avec l'inaptitude ou les prescriptions de la médecine du travail.
Si l'employeur estime qu'il n'y a pas de possibilités de reclassement, il peut procéder au licenciement du salarié. Ce licenciement a une cause réelle et sérieuse aux termes du droit du travail. Dans ce cas, l'employeur doit payer l'indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui n'est pas remis en cause. Mais quid de l'indemnité compensatrice de préavis, car pour les autres licenciements pour cause réelle et sérieuse, les indemnités légales comprennent l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis.
L'interprétation jurisprudentielle dit que, pendant cette période, comme le salarié ne travaille pas, l'employeur n'est pas obligé de le payer. Il est proposé de modifier la règle. Le licenciement prendra donc effet dès sa notification, et cette modification va forcément dans l'intérêt du salarié puisqu'il pourra immédiatement s'inscrire aux Assedic, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui puisqu'il y aurait un délai de carence d'un mois.
J'espère avoir résumé la situation à laquelle nous voulions répondre.

Je m'interroge cependant sur la nature de la réponse et la certitude des rédacteurs de cet article. Le sujet est d'une telle complexité juridique qu'il n'a pas sa place dans le cadre de cette proposition de loi. D'abord, il y a une période de vérification du reclassement, des obligations de l'employeur en la matière. Ensuite, se pose le problème de l'acceptation ou non par le salarié des postes qui lui sont proposés, ce qui fait également l'objet d'un contrôle. Enfin, l'employeur ne doit pas de préavis à condition d'avoir respecté les obligations de reclassement. Voilà pourquoi le droit est tel qu'il est aujourd'hui.
Sur cette question, il aurait mieux valu saisir les partenaires sociaux pour qu'ils arrivent à une rédaction qui aille dans le bon sens. Nous ne sommes pas dans la simplification du droit, loin s'en faut. Et, en dépit des explications très précises de notre rapporteur pour avis, le débat juridique continuera car il a déjà commencé !

Nous avons déjà eu l'occasion de débattre sur ce thème et je vous répète, monsieur Vidalies, que je ne comprends pas votre position.
En tout état de cause, la réponse, de votre point de vue même, ne peut être la suppression de l'article 41. La suppression supposerait le maintien de la situation actuelle…

…qui place le salarié dans une difficulté absolue. Comme vous l'avez dit, la suppression de l'article conduirait à priver le salarié d'indemnités pendant un mois, voire deux ou trois mois.
Votre amendement est fondé sur une erreur d'interprétation. Cet article supprime bien l'exécution du préavis pour les salariés licenciés pour inaptitude suite à une maladie d'origine non professionnelle, mais il ne supprime pas l'indemnité compensatrice de préavis puisque celle-ci n'est pas due, le préavis n'étant pas exécuté du fait du salarié.
L'article 41 permet aux salariés concernés par cette situation, qui ne bénéficient aujourd'hui ni d'une rémunération ni d'une indemnisation pendant toute la durée de leur préavis de pouvoir au moins prétendre plus tôt au versement des allocations de chômage – vous l'avez du reste dit vous-même –, le contrat de travail étant rompu dès la notification du licenciement.
À notre sens, il s'agit d'un dispositif qui est favorable aux salariés. La commission des affaires sociales a proposé d'améliorer les choses car se posait la question du droit à l'ancienneté, le contrat de travail étant rompu plus vite.
Avec l'accord de la commission des lois, nous avons introduit un dispositif qui précise que si le contrat de travail est rompu, le préavis est compris dans l'ancienneté du salarié alors même que ce préavis n'est pas exécuté. L'ancienneté est prise en compte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement. Je rappelle au passage que cela répond à une demande formulée par une organisation syndicale lors des auditions.
La suppression de cet article n'est donc pas la bonne réponse.
Je souhaite convaincre M. Vidalies de retirer son amendement.
Je ne le pense pas, car M. Vidalies est de bonne foi.
Il a parfaitement décrit la complexité juridique de la situation d'un salarié déclaré inapte. Ni lui ni personne dans cet hémicycle ne veut voir perdurer une telle situation juridique.
Je veux rassurer M. Vidalies, le Gouvernement a consulté les partenaires sociaux. Le dispositif a été mis en place parce que le médiateur de la République était intervenu pour tenir compte de la détresse d'un certain nombre de salariés déclarés inaptes.
L'ensemble des partenaires sociaux se sont déclarés favorables au dispositif.
M. Vidalies pourrait retirer son amendement pour ne pas maintenir ces salariés dans des situations délicates.

Il se trouve que vous arrivez à me faire douter, alors que moi je n'y arrive jamais ; sans doute mes arguments ne sont-ils pas assez convaincants ou alors est-ce dû à la différence d'état d'esprit entre la gauche et la droite, bardée dans ses certitudes. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Vous n'étiez pas présent lors du débat sur la protection des consommateurs, sinon vous ne diriez pas cela !

Dès le début, j'ai fait part de mes interrogations. Mais, comme je n'ai pas la certitude que mon amendement réponde au problème, je le retire.
Je voulais lancer le débat. On peut se demander si la rédaction choisie ne modifie pas le code du travail en amont. Je suis prêt à participer ultérieurement à ce débat. En l'état, mes arguments n'étant pas déterminants, j'accepte de retirer mon amendement.
(L'amendement n° 105 est retiré.)
(L'article 41 est adopté.)

Nous en venons à une série d'amendements portant articles additionnels après l'article 41.
Je suis saisi d'un amendement n° 215
La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Défendu.
(L'amendement n° 215 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 162 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

Cet amendement, qui reprend une préconisation du rapport de notre collègue Claude Greff, intitulé Mobilité géographique et professionnelle : Bouger pour l'emploi, se justifie par son texte même. Il vise en effet à insérer, après l'article L. 1121-1 du code du travail, un article L. 1121-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-2. – Une clause de mobilité géographique n'est licite que si elle est conforme à l'intérêt de l'entreprise, si elle définit de façon précise sa zone géographique d'application, si elle comporte un délai de réflexion pour le salarié au moins égal à un mois et si elle comporte les conditions de prise en charge des coûts liés au changement de lieu de travail et notamment les coûts de déménagement entre le domicile et le nouveau lieu de travail. »

Nous sommes en train de réécrire tout le code du travail. C'est invraisemblable !

La commission considère que, si cet amendement présente un intérêt certain, son dispositif mériterait un examen plus approfondi qui ne peut se dérouler à l'occasion de la discussion d'une proposition de loi de simplification.
Même avis que la commission. Nous abordons l'examen de toute une série d'amendements qui, à l'exception de l'un d'entre eux, ne prévoient pas de simplification.

C'est également valable pour l'article 40, monsieur le secrétaire d'État !

Je suis saisi d'un amendement n° 149 .
La parole est à Mme Pascale Gruny.

Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions du code du travail encadrant les conditions de reclassement d'un salarié déclaré inapte. Il prévoit en effet qu'en cas d'inaptitude l'employeur doit envisager un reclassement, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé en fonction des possibilités de l'entreprise ou, le cas échéant, des possibilités des entreprises du groupe auquel elle appartient. Ces modifications permettront une clarification du droit applicable, tant pour les salariés concernés que pour les entreprises soumises à l'obligation de reclassement.
On s'aperçoit en effet que, lorsqu'un salarié est déclaré inapte, la fiche envoyée par le médecin à l'entreprise ne porte bien souvent que les mentions : « Inapte » ou « Inapte à tout poste de travail ». La situation est ubuesque pour l'employeur, qui se trouve dans l'obligation de reclasser le salarié dans l'entreprise sans en savoir davantage sur ce qu'il peut lui proposer. C'est pourquoi je suggère que le médecin du travail, qui connaît l'entreprise, les postes et l'état de santé du salarié, fournisse des indications à l'employeur sur les possibilités de reclassement. Il s'agit d'aider les entreprises et les salariés, qui vivent souvent un drame social lorsqu'ils perdent leur emploi.

La commission a émis un avis défavorable, car elle a estimé qu'en cas d'inaptitude – qu'elle soit liée à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou qu'elle soit d'origine non professionnelle –, le droit existant était suffisant.
Je rappelle en effet que les deux derniers alinéas de l'article L. 1226-2 du code du travail définissent les critères des mesures de reclassement – conclusions écrites du médecin du travail, indications formulées sur l'aptitude du salarié à l'une des tâches existant dans l'entreprise – et prévoient la possibilité d'une mutation, ce qui implique la prise en considération des postes existant dans l'ensemble des établissements d'une entreprise ou d'un groupe.
Sur ce fondement, la chambre sociale de la Cour de cassation apprécie très largement le cadre de l'obligation de reclassement. Elle estime ainsi que la recherche doit se faire non seulement à l'échelle de l'entreprise lorsqu'elle comporte plusieurs établissements – selon un arrêt du 14 février 2007 –, mais aussi, selon un arrêt du 9 janvier 2008, à l'échelle du groupe, lorsque l'entreprise s'inscrit dans un ensemble.
Sagesse.

Je veux une fois de plus dénoncer ce type d'amendements dans un texte de simplification du droit. Nous avions raison de nous méfier. Nous pensions, messieurs les rapporteurs, que votre bonne foi était totale, mais force est de constater que nous allons passer la soirée à examiner des amendements qui sont autant de modifications substantielles déguisées du code du travail et qui n'ont donc rien à voir avec la simplification du droit. Ce type d'amendement décrédibilise la proposition de loi.

Le rapporteur est défavorable à l'amendement : ne faites pas de procès d'intention !

Je m'étonne que le Gouvernement s'en remette à la sagesse de l'Assemblée : l'avis de la commission était tout à fait justifié.
Madame Gruny, vous prétendez que le médecin du travail connaît très bien l'entreprise. Mais je peux vous dire que le médecin d'un service interentreprises regroupant plusieurs dizaines de TPE, par exemple, ne sait rien des postes existant dans l'une d'entre elles et qu'il ne peut donc aider l'employeur à faire des propositions concrètes au travailleur. Il serait donc plus sérieux de retirer cet amendement.

Mon amendement a uniquement pour objet de fournir à l'employeur un écrit précis lui indiquant les possibilités de reclassement du salarié. Madame Billard, les médecins du travail seront ravis d'entendre vos propos.

Pas du tout ! Je puis vous dire que les médecins du travail connaissent bien les entreprises ; ils s'y rendent de plus en plus souvent.
On me dit que cet amendement ne propose pas de simplification, mais il a bien pour objet de simplifier les relations dans l'entreprise.
Madame Gruny, nous allons examiner ultérieurement l'un de vos amendements qui porte sur les jours francs, et j'y serai favorable car il propose une véritable simplification. Madame Billard, si, sur l'amendement n° 149 , je m'en suis remis à la sagesse de l'Assemblée, c'est parce qu'il propose, certes, une simplification, mais qu'il a trait à un sujet qui, ainsi que l'indiquait le rapporteur, mérite de faire l'objet d'une réflexion approfondie.

Je suis saisi d'un amendement n° 219 .
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

Cet amendement a pour objet de mettre fin à une aberration du code du travail. En effet, un salarié accidenté du travail déclaré inapte par le médecin du travail peut prétendre, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double des indemnités légales. Toutefois, ce régime favorable n'est pas applicable aux salariés accidentés du travail déclarés aptes par le médecin du travail et irrégulièrement licenciés.
Dans le cadre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, un salarié inapte irrégulièrement licencié est étrangement mieux traité qu'un salarié apte irrégulièrement licencié. Qui peut comprendre une telle différence de traitement, maintes fois dénoncée par la doctrine ? Le but de cet amendement est de mettre les salariés aptes et inaptes sur un pied d'égalité quant au montant des indemnités qui leur sont dues.
Même avis. Ainsi que je l'ai indiqué, dans cette série d'amendements, seul l'amendement n° 150 a pour objet de proposer une véritable simplification.

Il est défendu.
(L'amendement n° 150 , accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)

L'article 42 ne fait l'objet d'aucun amendement.
(L'article 42 est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 106 , qui tend à supprimer l'article 43.
La parole est à M. Alain Vidalies.

Cet amendement vise en effet à supprimer l'article 43, qui a trait au calcul des congés payés.
En 2008, nous avons modifié le code du travail sur ce point, afin de mettre le droit français en cohérence avec les exigences européennes. Je me demande donc ce qui justifie cette nouvelle modification. Surtout, si nous ne supprimons pas cet article, l'article L. 3141-3 du code du travail disposera, à l'issue du vote de la proposition de loi : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. » Or cette rédaction est identique à celle qui existait avant la modification de 2008. Peut-être ai-je mal compris, mais, si, comme on me le dit, il s'agit d'une avancée, elle ne me paraît guère évidente. Dans l'attente de précisions, nous proposons donc la suppression de l'article 43, car nous ne voyons pas pourquoi les exigences européennes de 2008 auraient disparu en 2011.

Monsieur Vidalies, je regrette amèrement que vous n'ayez pas lu mon rapport.

J'ai en effet écrit, page 22, que, si la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas encore formellement prononcée sur ce point, elle a été très récemment saisie d'une question préjudicielle posée par la Cour de cassation.
Au-delà, il me semble, là encore, que vous vous méprenez sur le sens des dispositions de l'article 43, qui ont pour objet non pas de compliquer le droit aux congés, mais au contraire de supprimer toutes les conditions limitant ce droit. Ainsi que vous l'avez rappelé, nous avons déjà modifié le code du travail afin de ramener la durée minimale de travail ouvrant droit aux congés de trente jours à dix jours. Mais la Cour de justice de l'Union européenne estime que ce n'est pas suffisant : elle souhaite supprimer toute espèce de limitation de l'ouverture du droit aux congés. C'est pourquoi l'article 43 dispose que l'ouverture de ce droit a lieu dès lors qu'un salarié a travaillé un jour chez le même employeur. Bien entendu, dans ce cas, le prorata ne sera pas énorme, mais, encore une fois, il s'agit de se conformer à la volonté de la Cour de justice européenne.
Par ailleurs, il faut bien distinguer l'ouverture du droit aux congés du calcul de ces derniers. Si les conditions d'ouverture sont supprimées, les règles de calcul restent, quant à elles, inchangées. Ainsi l'article L. 3141-3 détermine le nombre de jours de congés gagnés par mois travaillé chez un même employeur, mais il ne dispose pas qu'il faut avoir travaillé un mois pour bénéficier du droit aux congés. Il y aura une proratisation.
Dès lors, il me semble, monsieur Vidalies, que vous devriez retirer cet amendement, comme vous avez retiré le précédent.

Je suis saisi d'un amendement n° 318 du Gouvernement.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
L'objet de l'amendement n° 318 est de compléter la démarche d'harmonisation de l'article 44 en autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances dans le champ de la sécurité sociale, afin d'adopter une définition unique des éléments pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales et de réduire le nombre de données figurant sur le bulletin de paie.
Comme l'a rappelé Jean-Charles Taugourdeau lors de la discussion générale, cette simplification du bulletin de paie est l'une des 80 décisions que j'ai annoncées après les Assises de la simplification. Il s'agit de mettre en oeuvre la déclaration sociale nominative mais aussi – et c'est une mesure extrêmement attendue par les acteurs économiques, notamment les salariés – d'élaborer une définition unique des éléments composant l'assiette des cotisations et des prestations.
L'article 44 prévoit que les travaux se dérouleront de manière concertée entre les pouvoirs publics et les régimes de protection sociale concernés, avant que le fruit de ces travaux ne soit, en ce qui concerne les régimes gestionnaires de régimes de protection sociale, intégré dans les accords qui les régissent. À la suite des travaux relatifs à cet article, il est apparu nécessaire de compléter le dispositif proposé par une habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances afin d'insérer les définitions retenues à l'issue du processus de concertation dans les textes relatifs à la sécurité sociale, ainsi que les autres textes dans lesquels des modifications seraient nécessaires.
Il est proposé de tenir compte des améliorations rédactionnelles successives apportées, suite à l'examen du texte au Conseil d'État – puisque cette initiative a été prise par le président de la commission des lois, ce qui constitue une première –, ainsi que des échanges avec le rapporteur et les principaux régimes et partenaires consultés dans la période récente. Il faut articuler au mieux les deux phases d'harmonisation d'une part et d'intégration dans les accords conventionnels d'autre part, parvenir au meilleur équilibre possible entre le champ qui relève de la responsabilité des pouvoirs publics et celui, auquel vous êtes attachés, qui relève des partenaires sociaux. Les différents volets de la démarche d'harmonisation garantissent que les objectifs poursuivis seront atteints et que les prérogatives des partenaires sociaux seront respectées.


Je me souviens d'un temps où certains réclamaient à cor et à cri que les informations qu'il est aujourd'hui proposé de simplifier figurent au contraire de façon détaillée sur le bulletin de paie. Se voulant exemplaire, l'État lui-même tenait à indiquer tous les éléments constitutifs de la rémunération des fonctionnaires, notamment tous les prélèvements qui, appliqués au salaire brut, ont pour effet d'aboutir au salaire net.
On peut penser que personne ne fait une lecture intégrale de son bulletin de paie tous les mois. Toutefois, la simplification proposée peut se révéler dangereuse…

…car tous les éléments constitutifs du salaire ont leur justification et, moins on en fait figurer sur le bulletin, plus il est difficile de comprendre le processus par lequel on parvient au salaire net. Sans vouloir prêter de mauvaises intentions à quiconque, force est de reconnaître que la simplification est dangereuse.
Une telle simplification n'est d'ailleurs pas vraiment justifiée car, de nos jours, une fois les données fournies à l'ordinateur, c'est le logiciel de traitement de paie qui fait tous les calculs. J'insiste sur le fait qu'en tout état de cause on ne peut faire abstraction de ces calculs, nécessaires pour aboutir au résultat final qu'est le salaire net. L'idée de disposer d'une feuille de paie simplifiée, pour sympathique qu'elle soit – car, je le reconnais, la majorité des salariés regardent surtout la case où est indiqué leur salaire net –, n'est pas sans danger dans la mesure où, diminuant la transparence, elle peut constituer un moyen de rendre certaines choses moins visibles. Le bulletin de paie est peut-être compliqué pour celui qui veut le lire intégralement mais, après tout, il est constitué d'informations utiles, et je ne suis pas sûr que la simplification relative qui est ici proposée fasse gagner beaucoup de temps et d'argent aux entreprises.

La commission est défavorable au sous-amendement n° 332 , considérant que la réduction du nombre de données figurant sur le bulletin de paie est une disposition essentielle de l'article 44. La France a sans doute le bulletin de paie le plus compliqué d'Europe : ce document est devenu illisible, seuls quelques spécialistes ayant encore la capacité de le déchiffrer, et constitue une véritable calamité pour de nombreuses entreprises.

Nous entendons modifier le dispositif d'établissement du bulletin de paie en harmonisant les bases afin de simplifier les choses et faire en sorte que la France ne détienne plus le record de complexité au niveau européen.
Pour ce qui est de l'amendement du Gouvernement, nous y sommes favorables, à une réserve près : la suppression des mots « tel qu'il résulte de la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives », dans la première phrase de l'amendement, après les mots « du code de la sécurité sociale ». Ce n'est qu'une modification rédactionnelle à laquelle le Gouvernement n'est, me semble-t-il, pas opposé.
Je suis effectivement d'accord avec la rectification proposée par M. le rapporteur.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 332 , j'ai écouté attentivement vos explications, monsieur Issindou, mais je veux vous dire que j'ai, avec des parlementaires de tous les bancs, y compris les vôtres, participé aux Assises de la simplification, où nous avons rencontré les acteurs économiques, notamment les salariés.
Alors que plus personne n'est capable de déchiffrer ce document foisonnant qu'est devenu le bulletin de paie,…
…vous n'allez pas nous dire que le conserver tel qu'il est actuellement constitue un avantage pour les salariés ou pour les patrons des petites entreprises. Il y a dans notre pays une demande unanime de simplification.
Admettre que le bulletin de paie est complexe et en arriver à la conclusion qu'il ne faut rien faire ne me paraît pas logique. L'amendement du Gouvernement – rectifié à juste titre par le rapporteur – part des mêmes constatations que vous, mais il en tire toutes les conséquences, en proposant une simplification concertée. Franchement, vous seriez en phase avec les attentes de la population française si vous retiriez votre sous-amendement.

Au sujet de l'article 44, je souhaite relayer ici les inquiétudes de l'ARRCO, qui a adressé un courrier à chacun de nous, soulignant, par la voix de son président et de son vice-président, que « les modifications substantielles apportées par la commission des lois à cet article pourraient conduire à un alignement des assiettes des régimes AGIRC et ARRCO sur celle du régime général ».
Une telle réforme pourrait priver les partenaires sociaux, gestionnaires de ces régimes et responsables de leur équilibre, de la maîtrise de leur financement.

Je suis très étonné de voir notre collègue Issindou développer une telle argumentation, lui qui est attaché à toujours défendre les petits. Vous vous doutez bien que l'article 44 et l'amendement n° 318 ne concernent pas vraiment les entreprises du CAC 40 ! Certes, les ordinateurs effectuent tous les calculs, mais les salariés n'en ont pas moins de mal à comprendre leur bulletin de paie.
Je pense surtout aux toutes petites entreprises, aux artisans, commerçants, agriculteurs, qui passent un temps fou à rédiger les bulletins de paie. D'ailleurs, même si l'on simplifie, rien n'empêche de conserver les rubriques essentielles du bulletin de paie – les retenues pour la santé, pour la retraite, pour la formation professionnelle. Franchement, permettre aux salariés de comprendre le processus par lequel on part du salaire brut pour arriver au salaire net, c'est une mesure attendue par tout le monde.

Je comprends très bien ce qui est demandé, et je comprends même que les salariés puissent le demander. Je le répète, la plupart des salariés s'intéressent essentiellement au chiffre indiquant leur salaire net, et assez peu aux opérations aboutissant à ce résultat. Pour ma part, j'ai établi de nombreux bulletins de paie au cours de ma vie et, que vous le vouliez ou non, on est bien obligé d'effectuer toutes ces opérations, de tenir compte de tous ces paramètres pour arriver au salaire net : c'est la loi !

Par conséquent, le chef d'entreprise, qu'il s'agisse d'un patron du CAC 40 ou d'un petit artisan, sera toujours obligé de faire des calculs en appliquant les taux correspondant aux différentes cotisations : il est impossible d'arriver au salaire net sans faire tout cela de façon très précise. Rassurez-vous, ce n'est pas forcément le chef d'entreprise lui-même qui effectue tous ces calculs le soir, à la lueur d'une chandelle,…

…la plupart confient l'établissement des fiches de paie à des services comptables – certes payants, mais qui les déchargent de cette tâche.
Ne confondez pas l'affichage et le calcul ! Concrètement, la simplification d'affichage que vous proposez ne simplifiera rien, car les calculs pour arriver au salaire net devront de toute façon être effectués. Et s'ils sont effectués, autant les faire figurer sur le bulletin de salaire ! Je me souviens qu'il y a vingt ans l'État avait tenu à rajouter des lignes et des lignes sur les bulletins de paie des fonctionnaires, afin de leur faire comprendre le coût réel d'un emploi dans la fonction publique. Quand on a lu son bulletin de paie une fois, on ne le relit pas tous les mois, mais au moins on sait où trouver toutes les informations utiles à ce sujet.

Notre collègue Issindou, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, nous dit que les bulletins de salaire sont complexes, mais que les entreprises sont bien obligées de tenir compte de tous les paramètres définis par la loi. Mais nous allons précisément changer la loi, mon cher collègue ! Contrairement à ce que vous affirmez, nous ne faisons pas que de l'affichage : nous modifions également le fond.
Il ne s'agit pas de fusionner deux lignes en une sur le bulletin, en obligeant l'entreprise à effectuer les mêmes calculs qu'auparavant. Non, on s'attaque à la complexité à la base, c'est pourquoi le processus va durer plusieurs années. Si les choses sont complexes, c'est parce qu'il existe une multitude de prélèvements d'origines diverses – législative, réglementaire, conventionnelle – et ayant évolué au fil du temps, des lois, des décrets, des négociations. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un système touffu, où il n'y a plus de logique, et où chaque ligne créée a, peu à peu, pris son autonomie, notamment quant à son mode de calcul – ce qui fait que l'on a maintenant pratiquement un mode de calcul par ligne !
Si l'on veut, comme c'est notre cas, simplifier sans se contenter de faire de l'affichage, il faut prendre le problème à la base et, pour cela, prendre son temps. Chaque parlementaire doit prendre ses responsabilités face à l'importance de cette réforme ; c'est pourquoi, monsieur le président, je vous saisis d'une demande de scrutin public sur cet amendement.
Il est important qu'au sujet de tout ce qui est conventionnel le Parlement demande aux partenaires sociaux d'engager des négociations. Je veux vous dire, monsieur Muzeau, que nous avons tenu compte de la lettre de l'ARRCO, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le texte est différent de celui sorti du Conseil d'État : il n'y a pas d'alignement sur le régime général.
Mais nous ne nous adressons pas qu'aux partenaires sociaux. Nous demandons également au Gouvernement de mettre en oeuvre cette évolution et, pour ce qui est des mesures législatives à modifier, il fallait que le Gouvernement lui-même nous demande une habilitation par ordonnance – que je vous demande de voter, mes chers collègues, car cet article va constituer un tout.
Nous engageons un mouvement qui durera plusieurs années, avec un calendrier fixé par lequel nous demandons à chacun des partenaires responsables de la complexité d'entamer des discussions pour faire évoluer de nouveau le texte et permettre la simplification.
Les gains seront énormes. Par exemple, aujourd'hui, en France, lorsqu'un salarié est malade, il faut faire des déclarations concernant ses rémunérations pour parvenir à calculer ses indemnités journalières. C'est la même chose lorsqu'on part en congé de maternité ou de paternité. Ce sont ces déclarations qui pourront être supprimées dès la première étape.
Quand nous serons parvenus à la seconde, l'ensemble des déclarations sociales sera supprimé, soit une trentaine au total. Il n'y aura plus qu'une seule communication. Quand un employeur émettra un bulletin de paie, il fera une déclaration sociale unique et nominative sur les renseignements figurant sur le bulletin, avec les nouvelles normes juridiques et informatiques qui auront été définies. Par cette déclaration, il se sera acquitté de toutes ses obligations.
Je suis très heureux que le Conseil d'État ait approuvé le principe que nous allons inscrire dans la loi. Nous pourrons tous être fiers, quand nous rentrerons dans nos départements, de pouvoir dire que, quand cette réforme entrera en application, aucun service, aucune administration en France ne pourra demander aux entreprises une autre déclaration que la déclaration unique qui aura été construite.
Pourquoi prenons-nous quelques années pour y parvenir ? Ce n'est pas par manque d'ambition. Il faut laisser du temps aux discussions et permettre l'harmonisation des définitions. Il faut également laisser du temps pour rédiger les décrets puis les ordonnances. Après cela, les logiciels devront évoluer, ce qui ne se fera pas en quelques mois. Il faudra donc s'y prendre suffisamment à l'avance.
La réforme que nous initions est attendue depuis de très nombreuses années, si ce n'est des décennies. Comme la loi est en partie à l'origine de la complexité, c'est au Parlement qu'il revient de fixer le cadre. C'est notre responsabilité de le faire ce soir.
Il faut donner de la visibilité à tous les opérateurs, ce que fait ce texte. Je vous propose d'engager cette évolution, qui représentera un grand progrès pour les entreprises comme pour les salariés, car cela mettra un terme à une opacité qui n'a cessé de se développer. Cela réduira également les coûts administratifs. C'est aussi un grand progrès pour l'ensemble de la sphère sociale dans notre pays car cela permettra de remettre à plat et de coordonner tous les systèmes informatiques.
Je voudrais saluer le travail accompli ces dernières années et saluer l'initiative qu'a prise le Gouvernement de former un groupement d'intérêt public qui a travaillé sur ce sujet. Dans ce cadre, nous avons beaucoup écouté. Qu'avons-nous entendu ? Les fonctionnaires qui avaient été mobilisés par le Gouvernement pour faire ce travail nous ont dit : « C'est à vous de prendre vos responsabilités. De notre côté, nous avons fait le travail de défrichage. Le constat et l'analyse juridique ont été faits. Maintenant, il faut que vous donniez l'impulsion, car lorsque nous allons voir tel ou tel organisme social, chacun nous répond qu'il possède son propre système informatique et qu'il correspond aux textes actuels. Si vous voulez changer les choses, prenez vos responsabilités, définissez un calendrier. À partir de là, nous entamerons cette évolution. »
C'est donc une réforme très attendue, qui va dans le bon sens. Elle est fondée sur la discussion, sur le partenariat et la progressivité. Le Gouvernement se donne les moyens de l'accomplir en demandant une habilitation à prendre des ordonnances. Je vous appelle donc, quels que soient les bancs sur lesquels vous siégez, à voter cette réforme. C'est pourquoi, monsieur le président, je vous confirme ma demande de scrutin public.
J'insiste à mon tour sur l'importance de la mesure dont nous discutons. Le président de la commission des lois vient de dire à quel point le dispositif est absolument essentiel pour les acteurs économiques de notre pays.
Avec le texte adopté par la commission et l'ajout proposé par le Gouvernement, nous mettons en oeuvre les décisions qui résultent de la concertation. Je veux d'ailleurs vous dire, monsieur Issindou, comme l'a fait avant moi le président de la commission des lois, que c'est tout sauf de l'affichage. Le Gouvernement a montré clairement sa volonté d'aller vers la déclaration sociale nominative.
Je vous invite, de même que tous les parlementaires présents ici, à interroger les acteurs économiques sur la réforme grâce à laquelle tout passe par les déclarations URSSAF. En effet, nous avons d'ores et déjà supprimé une déclaration ; c'est le début du dispositif vertueux que nous vous demandons de voter aujourd'hui sur la déclaration sociale nominative. Demandez aux acteurs économiques si le fait qu'il y ait non plus deux déclarations, mais une seule, ne constitue pas un progrès.
À ce moment du débat, je vous rappelle ce que je disais en présentant ce texte : quand nous avons lancé les Assises de la simplification – auxquelles je veux de nouveau associer le président de la commission des lois, qui a accepté de les coprésider avec Jean-Michel Aulas, qui siégeait au nom des entreprises –, nous avons annoncé la simplification du bulletin de paie et la déclaration sociale nominative.
Certains y ont vu de l'affichage, sans penser que nous le ferions réellement. Eh bien, aujourd'hui, en l'inscrivant dans la loi, nous nous donnons les moyens de concrétiser cette mesure pour les acteurs économiques de notre pays. Le cabinet Ernst & Young a chiffré le résultat des quatre-vingts décisions prises par les Assises à un milliard d'euros rendu aux acteurs économiques. Pour que chacun mesure l'avancée que représente la présente décision, je vous rappelle qu'il existe aujourd'hui trente déclarations. Chaque déclaration supprimée représente donc un gain de 27 millions pour les acteurs économiques.
Nous sommes engagés dans une démarche qui est essentielle pour la compétitivité et l'attractivité de notre pays, en particulier pour les TPE et les artisans. Aujourd'hui, ils consacrent chaque année cinquante jours ouvrés à la paperasserie administrative. Nous voulons libérer les énergies : il faut que ces personnes puissent avoir plus de temps pour créer, vendre leurs créations, générer de la croissance et des emplois dans notre pays.
Je remercie donc le président de la commission des lois, à ce moment essentiel du débat sur cette proposition de loi, d'avoir demandé un scrutin public. Le Gouvernement souhaite en effet que chacun sur ces bancs prenne ses responsabilités et dise son choix. Cette démarche est favorable aux acteurs économiques, notamment les plus petits qui, partout sur notre territoire, sont en difficulté. Ils pourront à moyen terme, grâce à cette réforme essentielle, créer plus de croissance et d'emplois. Il est vraiment indispensable que chacun mesure à quel point le moment que nous vivons est important pour simplifier la vie des entreprises.

Sur le vote de l'amendement n° 318 , je suis saisi par le président de la commission des lois d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à Mme Martine Billard.

Quel lyrisme de la part du président de la commission des lois et du secrétaire d'État ! Je ne savais pas que le bulletin de paie pouvait donner lieu à un tel déferlement d'éloquence. Le problème est qu'il n'est pas seulement question du bulletin de paie dans l'article et dans l'amendement.

En ce qui concerne le bulletin de paie, tout le monde peut en effet souhaiter sa simplification car, en entreprise, on est souvent amené, en tant que délégué du personnel – là où il y en a – à en faire l'explication à ses collègues.
En tant qu'ancienne salariée, j'ai le souvenir d'une époque où le bulletin de paie était bien plus simple. Il me semble, mais je peux me tromper, que c'est un gouvernement de droite qui a voulu, pour des raisons idéologiques, ajouter toutes les données correspondant aux cotisations patronales, de façon à ce que les salariés comprennent à quel point le travail coûte cher aux entreprises.

À ce moment-là, le bulletin de paie a doublé de volume. Il serait très facile de simplifier en s'en tenant à ce qui concerne la paie du salarié : le salaire brut, les cotisations salariales et le salaire net. Le bulletin de paie serait ainsi bien plus lisible pour les salariés ! Mais je crois que, bizarrement, ce n'est pas ce que vous allez faire.

Dans la seconde partie, qui porte sur les cotisations sociales, il est question de tout autre chose. Il est donc surprenant que cela figure dans le même article et dans le même amendement. Il devrait y avoir deux articles distincts.
Oui, monsieur le secrétaire d'État, il y a débat entre nous sur la déclaration unique. Pour ma part, je m'inquiète de la procédure proposée pour mettre en oeuvre cette évolution. Je vous confirme donc que nous voterons contre votre amendement. Nous aurions pu approuver un article simplifiant la feuille de paie, mais nous voterons contre cet article et cet amendement fourre-tout.

Quitte à être en décalage avec mes collègues, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Luc Warsmann sur cet article. Je pense en effet qu'il y a une nécessité impérative à simplifier les bulletins de salaire, auxquels on ne comprend plus grand-chose.
Bien sûr !

Toutefois, il serait également nécessaire, d'un point de vue pédagogique, de proposer un rappel annuel de ce que paient les uns et les autres, en l'occurrence les salariés et les patrons. La feuille de paie doit aussi avoir un aspect pédagogique.
Les parlementaires n'aiment jamais se voir dépossédés de leur pouvoir d'action. Je suis donc un peu gêné par l'habilitation à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures. Même si l'on peut penser que cette ordonnance serait fonction des résultats de la négociation collective avec les organisations syndicales, il faudrait un contrôle parlementaire pour éviter que le Gouvernement n'aille au-delà. Quoi qu'il en soit, à titre personnel, je voterai pour cet amendement.

Je voulais aborder tout à l'heure un effet collatéral d'une disposition de l'article 44 qui a beaucoup inquiété l'ARRCO. L'organisme a tenu à vous le faire savoir, ainsi qu'à nous : « les modifications substantielles apportées par la commission des lois à cet article pourraient conduire à un alignement des assiettes des régimes AGIRC et ARRCO sur celle du régime général ».

La réponse n'était pas très claire !
Une telle réforme pourrait priver les partenaires sociaux, gestionnaires de ces régimes et responsables de leur équilibre, de la maîtrise de leur financement. La version initiale de l'article 44 invitait les organismes et administrations à adopter une définition commune des données relatives aux assiettes des cotisations figurant dans le bulletin de paie ou utilisés dans les processus déclaratifs.
Cette orientation, aux yeux de l'ARRCO, paraissait souhaitable dès lors qu'elle avait pour seul objet d'unifier l'acception des différentes appellations des données traitées par les organismes en cause, sans modifier le contenu des assiettes respectives des régimes.
Or l'amendement adopté en commission des lois vise à aligner les définitions des éléments de l'assiette des cotisations sur les définitions législatives et réglementaires applicables aux cotisations du régime général et en fait une condition, à partir de 2013, pour l'extension et l'élargissement des conventions ou accords nationaux interprofessionnels régissant les régimes de protection sociale complémentaire.
Citons le courrier adressé par la présidence de l'ARRCO au rapporteur : « Cette modification crée une forte incertitude sur la portée exacte de l'article 44 et pourrait laisser entendre que, derrière l'alignement des définitions, se profile un alignement du contenu de l'assiette. Une telle disposition remettrait alors en cause les conditions de fonctionnement de la protection sociale complémentaire et en particulier des régimes de retraite AGIRC et ARRCO. » J'attends donc une réponse sur ce point.

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

Je salue le travail de simplification engagé par la commission des lois. Je voudrais profiter de la discussion de cet amendement pour souligner l'importance de la pédagogie en ce qui concerne le salaire indirect.
Je prends un seul exemple : il y a trois semaines, dans le journal Le Monde, étaient cités et comparés les salaires des enseignants, mais uniquement les salaires nets. La grande différence entre la France et ses voisins européens, c'est que notre salaire indirect est de 30 % supérieur à celui de la moyenne des pays européens. Or cela n'est pas perçu et nous conduit à avoir un salaire direct plus faible et sans doute une certaine méconnaissance de la nécessité de discipliner le salaire indirect et le montant des cotisations pesant sur le travail.
Un véritable effort de pédagogie sera nécessaire si nous voulons prioriser le salaire direct, qui responsabilise, et les investissements des entreprises, qui se sont affaiblis ces dernières années.
(Le sous-amendement n° 332 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'amendement n° 318 , qui a été très légèrement rectifié sur des éléments de forme.
(Il est procédé au scrutin.)

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 52
Nombre de suffrages exprimés 52
Majorité absolue 27
Pour l'adoption 39
Contre 13
(L'amendement n° 318 , tel qu'il a été rectifié, est adopté.)
(L'article 44, amendé, est adopté.)

Monsieur le président, surtout pour un texte de loi relatif à la simplification du droit, je m'étonne que l'on puisse voter sur un texte d'amendement rectifié dont nous n'avons pas eu la version écrite.

Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Nicolas Véron