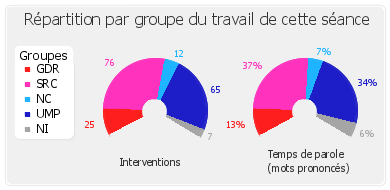Séance en hémicycle du 16 mars 2011 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

L'ordre du jour appelle la déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen et le débat sur cette déclaration.
La parole est à M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'exprime devant vous à l'occasion de ce traditionnel débat préalable au Conseil européen. Naturellement, la réunion des 24 et 25 mars sera marquée par la tragédie que connaît aujourd'hui le Japon et abordera notamment la question de la sûreté nucléaire.
Cette question, la situation nous impose de la traiter sous trois angles : solidarité avec le Japon, sûreté des réacteurs en exploitation en Europe, sûreté des réacteurs qui seront construits dans le monde. Comme l'a dit hier le Premier ministre, aucun débat ne doit être esquivé. Mais nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'urgence, auquel devra succéder le temps du retour d'expérience.
Au sein de l'Union européenne, une directive de juin 2009 a établi un cadre communautaire pour la sûreté des installations nucléaires. Dans ce cadre, nous soutenons un examen par les pairs des mesures prises pour assurer en permanence, en exploitation normale et en situation d'urgence, le plus haut niveau de sûreté des réacteurs en Europe. Le commissaire européen en charge de l'énergie, l'Allemand Günther Oettinger, a réuni hier à Bruxelles les autorités nationales de sûreté nucléaire et de l'industrie. Ces experts ont marqué leur accord pour évaluer l'état de préparation de l'Union à des situations similaires et pour soumettre les quelque 150 réacteurs en Europe à des tests de résistance. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'audit du parc nucléaire français annoncé hier par le Premier ministre.
À Bruxelles, il s'agira de continuer à porter la sûreté nucléaire au plus haut niveau, de tirer les leçons de la tragédie au Japon et d'agir dans la transparence à l'égard des populations.
Nous devons en effet répondre à l'inquiétude très compréhensible de nos concitoyens. Mais nous devons aussi éviter les réactions précipitées. Chaque État membre reste responsable de son mix énergétique. Et nous ne pourrons nous passer de l'énergie nucléaire avant plusieurs décennies, surtout si nous voulons atteindre nos objectifs européens d'une économie décarbonée.
Une séquence de réunions internationales s'ouvre devant nous : conseil énergie exceptionnel le 21 mars à Bruxelles, Conseil européen les 24 et 25 mars, réunion du Nuclear safety and security group du G8 les 24 et 25 mars, sommet de Deauville les 26 et 27 mai. Le G20 pourrait aussi être saisi de la question. Nous mettrons à profit ces échéances pour défendre l'exigence du plus haut niveau de sûreté nucléaire.
Outre la question du Japon et ses conséquences sur la sûreté nucléaire, le Conseil européen des 24 et 25 mars, qui inscrira ses travaux dans la lignée des décisions adoptées lors du Conseil européen extraordinaire sur la Libye et du sommet de la zone euro le 11 mars, sera consacré à deux sujets majeurs : d'une part, le renforcement de la gouvernance économique de l'Union européenne et de la zone euro, et, d'autre part, la construction d'un nouveau partenariat entre l'Union européenne et la rive sud de la Méditerranée.
Pour ce qui est du renforcement de la gouvernance économique de l'Union européenne et de la zone euro, il s'agit à la fois de finaliser la réponse globale à la crise et de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire. Le prochain Conseil européen devrait prendre trois décisions majeures en ce sens.
D'abord, il adoptera formellement la décision de modification limitée du traité permettant la mise en place pérenne, en 2013, du Mécanisme européen de stabilité.
Ensuite, il devrait adopter formellement le pacte pour l'euro, de façon ouverte et inclusive, afin de permettre aux États membres n'appartenant pas à la zone euro de s'y joindre, s'ils le souhaitent et s'ils en acceptent les engagements.
Enfin, le Conseil européen engagera le Conseil et le Parlement européen à aboutir d'ici au mois de juin à un accord sur des propositions législatives présentées par la Commission pour renforcer la gouvernance économique.
Grâce à ces trois décisions, nous parachèverons l'effort engagé lors de la crise de la dette grecque pour défendre l'euro, rétablir de façon coordonnée la maîtrise de nos finances publiques et définir un véritable volet de convergence et de compétitivité au service de la croissance. En un an à peine, grâce à la détermination du couple franco-allemand, nous aurons construit une réponse européenne globale à la crise économique. Permettez-moi aujourd'hui de vous en rappeler cinq éléments essentiels.
Premier élément : le Fonds européen de stabilité financière. Créé juste après la crise de la dette grecque, il a permis d'apporter une réponse immédiate à la crise bancaire irlandaise et d'empêcher un effet de domino qui aurait menacé toute la zone euro. Le sommet du 11 mars a décidé que sa capacité de financement convenue, de 440 milliards d'euros, serait rendue pleinement opérationnelle. Cette capacité globale effective de financement sera portée à 500 milliards d'euros lors du passage du Fonds au Mécanisme européen de stabilité.
Deuxième élément : le « semestre européen ». Son objectif est d'engager une véritable coordination des politiques budgétaires nationales, intégrant les objectifs européens et les engagements souscrits dans le pacte de stabilité et de croissance.
Ce cycle a été lancé en janvier, avec le premier rapport annuel sur la croissance de la Commission. Le Conseil européen donnera son accord sur les priorités en matière de réformes structurelles et d'assainissement des finances publiques. Sur cette base, les États membres présenteront mi-avril leurs programmes de stabilité et de convergence, ainsi que leurs programmes nationaux de réforme. C'est une innovation majeure dans la procédure budgétaire. C'est donc en parfaite cohérence européenne qu'après cette première phase du « semestre européen », chaque État membre engagera la construction de son budget et le vote de sa loi de finances, conformément à ses procédures nationales et dans le respect des prérogatives des parlements nationaux.
Troisième élément : la supervision financière. Avec l'appui décisif du commissaire européen chargé du marché intérieur et des services financiers, Michel Barnier, dont je tiens à saluer le travail, elle a été considérablement renforcée.
J'en veux pour preuve la création du Conseil européen du risque systémique et de trois autorités européennes indépendantes de supervision, couvrant les marchés financiers, les banques et les assurances. Aujourd'hui, le renforcement des ratios prudentiels avec les accords Bâle III, l'adoption de la directive « hedge funds », de nouvelles règles de transparence sur les produits dérivés et le renforcement des « stress tests » pour les banques sont une réalité. On ne peut plus dire que les leçons de la crise financière n'ont pas été tirées.
J'en veux aussi pour preuve l'étape supplémentaire franchie lors du sommet de la zone euro le 11 mars, avec la nécessité affirmée de réfléchir à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières et de faire avancer les travaux au niveau de la zone euro, à celui de l'Union européenne, ainsi que sur le plan international. Cette décision n'était pas facile, et la France, sous l'impulsion du Président de la République, ainsi que l'Allemagne, l'ont fait adopter par l'ensemble de nos partenaires.
Quatrième élément : la gouvernance économique, dont la refonte est engagée. Je pense aux six propositions législatives présentées par la Commission à l'automne dernier, qui devront être adoptées sur la base de l'équilibre dégagé au sein de ce qu'on appelle, dans le langage bruxellois, la « task force Van Rompuy » et endossé par le Conseil européen d'octobre dernier.
Je suis un gardien vigilant de la langue française, mais il y a des moments où il faut utiliser le vocabulaire agréé. En tout état de cause, ce n'est pas l'aspect essentiel de mon discours… (Même mouvement.)
Ces propositions ne se limitent pas à une réforme des volets préventifs et correctifs du pacte de stabilité et à l'introduction de sanctions financières. Au-delà du critère de déficit public, elles intègrent une meilleure prise en compte du critère de dette publique. Elles introduisent également une nouvelle procédure de surveillance des déséquilibres macroéconomiques excessifs.
Ce renforcement des disciplines budgétaires et de la supervision financière ira de pair – et c'est le cinquième élément – avec un véritable volet de convergence et de compétitivité au service de la croissance et de l'emploi. C'est tout le sens du pacte pour l'euro, dont l'idée avait été lancée par le président de la République et la Chancelière au conseil des ministres franco-allemand de Fribourg en décembre dernier, et qui a été approuvé au sommet du 11 mars.
Ce pacte, qui fera l'objet d'un suivi annuel par les chefs d'État et de gouvernement, s'appuiera sur un ensemble d'indicateurs couvrant la compétitivité, l'emploi, la viabilité budgétaire et la stabilité financière. Les États membres seront invités à annoncer, dès le Conseil européen des 24 et 25 mars, de premiers engagements concrets à mettre en oeuvre dans les douze mois suivants.
Nous avons aussi obtenu, et ce n'est pas le moins important, que le pacte pour l'euro porte une attention particulière à la coordination des politiques fiscales et que les États membres s'engagent à entamer des discussions structurées, notamment sur la prévention des pratiques fiscales nuisibles. Le sommet du 11 mars a également posé un jalon vers une assiette commune de l'impôt sur les sociétés à l'intérieur de la zone euro, ce qui est une percée d'une grande importance.
Le second grand enjeu de ce Conseil européen, c'est la construction d'un nouveau partenariat pour la démocratie entre l'Union européenne et ses voisins du sud de la Méditerranée. Cela suppose une refondation de la politique européenne de voisinage, qui doit désormais inclure l'Union pour la Méditerranée.
Cette nécessité a été clairement affirmée par le Conseil européen extraordinaire du 11 mars, qui a adressé un message clair et complet.
Un message pour l'immédiat : sur le départ de Kadhafi et le renforcement des sanctions, sur la reconnaissance comme interlocuteur du Conseil national de transition libyen, sur le maintien de toutes les options sur la table moyennant une nécessité démontrée, une base légale claire et un soutien régional avéré, et, enfin, sur la perspective d'un sommet réunissant l'Union européenne, la Ligue arabe et l'Union africaine.
En ce moment même, à New York, nos diplomates sont à la tâche.
Nous avons déposé, avec nos amis britanniques et libanais, une résolution au Conseil de sécurité qui élargit le champ des sanctions et ouvre la voie à l'utilisation des moyens nécessaires pour stopper l'offensive de Kadhafi. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP. – Exclamations sur plusieurs bancs des groupes SRC et GDR.)
C'est un enjeu majeur. La France, de ce point de vue, a donné l'exemple et tracé la voie. Je peux vous dire que j'ai quelques raisons de penser que nous pourrons atteindre l'objectif qui est le nôtre. Nous n'interviendrons, bien entendu, que sous un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies et avec, non seulement le soutien, mais la participation active des pays arabes. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.)
J'aurais pu imaginer que, sur cette stratégie, nous recueillions un large soutien, y compris de l'opposition, parce que dans ce domaine et par son attitude, la France a dans les pays arabes, je peux l'attester encore après l'entretien que je viens d'avoir avec mon homologue des Émirats arabes unis, une image extrêmement positive qui nous met en position de défendre le processus démocratique. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP. – Exclamations sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
Nous adresserons aussi au Conseil européen un message pour le moyen et le long terme, avec la volonté affirmée de l'Union européenne de mettre en place un « partenariat pour la démocratie et la prospérité partagée au sud de la Méditerranée », en prenant appui notamment sur les propositions de la Haute Représentante Catherine Ashton et de la Commission.
Ce nouveau partenariat, l'Union européenne le veut à la fois global et différencié pour chaque pays de la rive sud, sans paternalisme, sans modèle préconçu, en le fondant sur les besoins exprimés et en privilégiant un appui résolu à la transformation démocratique.
C'est dans cet esprit que le Conseil européen a salué le discours du roi du Maroc annonçant des réformes constitutionnelles. Je voudrais d'ailleurs insister sur ce point : c'est la première fois qu'un monarque du monde arabe propose de transformer son régime en une monarchie constitutionnelle.
C'est un événement d'une grande portée, que nous devons soutenir avec beaucoup de vigueur, je dirais même d'enthousiasme. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.)
C'est aussi dans cet esprit que le Conseil a confirmé le soutien de l'Union européenne à la transition démocratique en Égypte.
C'est enfin la raison pour laquelle il a réaffirmé son appui à la Tunisie, y compris au moyen d'un statut avancé entre l'Union européenne et la Tunisie, en vue de l'élection d'une assemblée constituante le 24 juillet pour relever les immenses défis économiques et sociaux auxquels ce pays est confronté.
Trois jalons de ce nouveau partenariat ont été posés.
Le premier, c'est la décision de reprogrammer rapidement l'aide financière de l'Union européenne, en se fondant sur une approche différenciée par pays et selon une logique incitative reposant sur l'obtention de résultats.
Le deuxième, c'est la décision de relever rapidement les capacités d'intervention de la Banque européenne d'investissement en Méditerranée et de la facilité euroméditerranéenne d'investissement et de partenariat.
Le troisième, c'est la promotion d'une approche globale des migrations, en affirmant la nécessité d'une concertation étroite avec les pays concernés sur l'aide au contrôle des frontières et à la facilitation du retour des immigrants dans leurs pays d'origine.
Cette approche devra aussi favoriser les contacts entre sociétés civiles, par des partenariats ciblés pour la mobilité, avec ceux des partenaires qui seront suffisamment avancés dans leur processus de réforme et qui coopéreront dans la lutte contre l'immigration illégale. Je pense notamment à la mobilité des étudiants : c'est l'intérêt des pays du Sud de pouvoir envoyer leurs meilleurs esprits faire leurs études dans nos pays et c'est le nôtre qu'ils puissent ensuite assumer des responsabilités importantes dans leur pays d'origine. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Au-delà de ces avancées, je souhaite que le Conseil européen des 24 et 25 mars jette les bases d'une véritable refondation de la politique européenne de voisinage méditerranéen.
Nous appelons au maintien d'une politique de voisinage unique de l'Union européenne, avec son « partenariat oriental » pour le voisinage est, avec l'Union pour la Méditerranée pour son voisinage sud.
Nous souhaitons également que l'Union européenne continue d'accorder une véritable priorité financière au voisinage méditerranéen, au moins les deux tiers de l'enveloppe de la politique européenne de voisinage, notamment dans les perspectives financières pour les années 2014 à 2020. L'Union européenne devra aussi accorder un soutien financier plus conséquent aux projets concrets de l'Union pour la Méditerranée, tels que le plan solaire méditerranéen, la protection civile, l'Office méditerranéen de la jeunesse ou les autoroutes de la mer.
Pour l'investissement, l'ampleur des besoins et la nécessité d'appuyer le redémarrage de l'économie en vue d'une véritable redistribution des fruits de la croissance nous appellent à aller au-delà du seul renforcement des moyens de la Banque européenne d'investissement. Nous souhaitons développer les moyens de financement européens destinés à la rive sud de la Méditerranée, en nous appuyant – je l'ai dit – sur la facilité euroméditerranéenne d'investissement et de partenariat.
S'agissant des migrations, notre objectif sera d'avancer dans une coopération étroite avec les pays du Sud, sans laquelle rien ne se fera, et de renforcer les moyens concrets de l'agence européenne FRONTEX contre l'immigration illégale. Ce sera aussi, comme je l'ai déjà évoqué, de promouvoir la création d'un Office méditerranéen de la jeunesse avec le soutien de l'Union pour la Méditerranée, une sorte d'Erasmus euroméditerranéen pour favoriser les contacts entre sociétés civiles et conforter les acteurs de la rive sud qui oeuvrent à la démocratisation.
Enfin, nous devons engager la relance de l'Union pour la Méditerranée en la recentrant sur des projets concrets.
Je note que la Chancelière allemande a clairement pris position en ce sens. Je souhaite donc que nous parvenions à incarner cette dimension concrète en désignant rapidement un nouveau secrétaire général, basé à Barcelone, qui soit originaire de la rive sud et qui incarne la transition démocratique.
D'une manière plus générale, je souhaite qu'un groupe de sages, composé de personnalités des deux rives, soit désigné pour formuler des propositions afin de donner un nouveau souffle à cette initiative prémonitoire lancée par le Président de la République qu'est l'Union pour la Méditerranée. (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
C'est par cette refondation, par la réalisation enfin tangible de ces projets concrets, que l'Union pour la Méditerranée, qui s'impose à l'évidence encore plus après les événements qui viennent de secouer la rive sud, pourra s'affirmer et renforcer le rôle de l'Union européenne, notamment dans le processus de paix au Proche-Orient.
Vous le voyez, mesdames, messieurs les députés, le Conseil européen des 24 et 25 mars, dans la ligne de celui du 11 mars, qui a été du point de vue français un grand succès, s'annonce comme une étape clé pour renforcer l'intégration économique et financière de l'Union et lui permettre de mieux répondre à la crise, mais aussi pour jeter les bases d'un nouveau partenariat que nous appelons de nos voeux entre l'Europe et le sud de la Méditerranée.
Vous pouvez compter sur ma détermination et sur celle de Laurent Wauquiez pour relever ensemble ces deux défis et aboutir à des décisions concrètes. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe UMP et sur plusieurs bancs du groupe NC.)

Pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, la parole est à M. Pierre Moscovici.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre des affaires européennes, mesdames, messieurs les députés, mes chers collègues, l'Europe vit une crise économique et sociale profonde. Le monde arabe voisin entre dans une nécessaire et difficile transition. Le Japon vit un drame qui nous bouleverse tous et sur lequel, monsieur le ministre, vous avez prononcé les paroles qui conviennent, même si nous souhaitons que le débat aille jusqu'au fond, que l'on ne s'en tienne pas à un certain conservatisme et que l'on réfléchisse à l'évolution de la filière nucléaire et de notre mix énergétique.
Mais, dans ce contexte, la France a besoin d'une perspective, d'un cap, d'une volonté, j'allais dire d'une envergure. Or tout nous démontre, au fil des jours, que rien de tout cela n'est garanti aux Français. En vous écoutant, monsieur le ministre d'État, je n'ai pas toujours eu la sensation d'entendre la voix du Président de la République. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Plusieurs députés des groupes SRC et GDR. Tant mieux !

Et je crois, tout en vous souhaitant bon courage, que malgré vos efforts vous ne parvenez pas et ne parviendrez pas à masquer la réalité, qui est celle d'une politique européenne et étrangère dénuée d'une vision cohérente.

Le prochain Conseil européen en est une nouvelle illustration. Il ne lève pas, loin de là, les inquiétudes des Français sur la sortie de la crise économique et sociale européenne. Il donne au contraire, à travers la conclusion d'un pacte qu'on ne sait comment appeler car il est désigné, tantôt comme un pacte de compétitivité, tantôt un pacte de l'euro, le signal d'un nouveau virage, néolibéral cette fois, qui nous inquiète.
Comprenons-nous bien : la création du Fonds européen de stabilité financière, puis celle du mécanisme européen de stabilité sont indispensables. L'alignement de leurs conditions sur celles, d'ailleurs plus favorables, offertes par le FMI constitue un élément positif,…

…tant il était incohérent que l'Europe accable plus que les autres ses membres en difficulté.
Mais ces mesures d'urgence arrivent bien tard. J'ose d'ailleurs penser, monsieur le ministre d'État, que le comportement des majorités de droite dans les instances européennes est largement responsable de ces lenteurs, de ce temps perdu qui éloignent les peuples de l'Europe.

Pis encore : alors qu'on aurait pu naïvement penser que vous aviez utilisé ce temps pour prendre la mesure des défis qui s'offrent à notre continent, vous vous arrêtez une fois de plus à mi-chemin.
Comme d'habitude, vous avez employé votre énergie à rassurer les marchés, sans vous donner les moyens de mettre en oeuvre des politiques de croissance de long terme. (Murmures sur les bancs du groupe UMP.)
Que prévoit en effet ce pacte dont vous êtes si fier ? Entre autres, de réexaminer les dispositifs de fixation des salaires ; de peser sur les accords salariaux dans le secteur public ;…

…d'ouvrir davantage les secteurs protégés, ce qui nous rappelle certaines heures peu joyeuses de l'Union européenne ;…

…d'adapter les systèmes de retraites à la situation démographique nationale, autrement dit d'allonger encore l'âge de départ à la retraite ;…

…d'insérer la rigueur budgétaire dans le marbre du droit des États membres.
Quid, dans ce texte, de la stratégie de croissance, si souvent évoquée et jamais traitée ? Quid de la stratégie de Lisbonne dédiée à l'investissement et à l'innovation ? Quid aussi des eurobonds, les euro-obligations qui auraient pu permettre à l'Europe de mutualiser la dette publique et de réaliser les investissements européens si nécessaires à l'ouverture de nouvelles perspectives de croissance durable ?
Que faire, par exemple, monsieur le ministre d'État, si la Grèce se trouvait, malgré les efforts consentis, dans une situation de défaut avant 2013, alors que vous refusez précisément et avec obstination le principe de la dette européenne ?

Puisque je parle de la dette, je veux dire ici que la réduction des déficits et de la dette correspond à une ardente obligation que la gauche a d'ailleurs toujours su remplir bien mieux que la droite. (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Eh oui ! Les chiffres sont là. Souvenez-vous de la période allant de 1997 à 2002 et comparez ce que nous avons fait et la performance pathétique de la droite au pouvoir, dont vous avez tort de vous enorgueillir aujourd'hui ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

C'est sans doute pour ça que vous n'avez pas fait la réforme des retraites !

Le cadre proposé ici ne propose aucune dynamique vertueuse ; il n'enclenche aucune stratégie de croissance qui permette d'accroître les recettes, mais se borne à prévoir une punition. Ce pacte, dont le Président de la République et votre gouvernement sont les coauteurs – vous le revendiquez – est avant tout un pacte de sanction ou de purge. Il relève de votre volonté d'institutionnaliser l'austérité et d'affaiblir nos modèles sociaux comme nos systèmes de protection sociale.

Il ne fera en réalité, vous le savez, qu'accentuer encore la distance que ressentent nos concitoyens à l'égard de l'Europe. Et ce n'est pas la timide référence à la nécessité de réfléchir à une taxe sur les transactions financières qui pourrait nous rassurer.

Je ne me plains pas que vous repreniez cette idée, qui a émergé des rangs de la gauche, bien au contraire.

Mais il ne suffit pas de l'évoquer ; il faut la mettre en oeuvre avec une ambition suffisante. Ce n'est pas le cas ; nous vous le demandons.
C'est d'autant plus vrai que votre erreur sociale est aussi une erreur économique, car la crise de liquidités couve toujours. Vous avez parlé des stress tests que devraient subir les banques ; c'est un cautère sur la jambe de bois des risques bancaires. En refusant de vous attaquer frontalement au problème bancaire, vous jouez la politique de l'autruche. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

C'est aussi une erreur économique parce que cette politique d'austérité ne peut que briser la faible reprise économique constatée en Europe, et d'ailleurs bien plus en Allemagne qu'en France.
Ce tournant, dangereux pour la France et pour l'Europe, nous entendons le combattre. Une autre voie est possible.

C'est celle qu'ont tracée les propositions du parti socialiste européen à Athènes le 4 mars dernier.
Oui, il faut un pacte européen, mais pas le vôtre. Nous en appelons, avec l'ensemble des socialistes européens, à un pacte pour l'emploi et le progrès social qui passe par une politique industrielle européenne, par l'instauration de normes sociales minimales européennes, par le renforcement de l'efficacité de la dépense publique et par des investissements dans les secteurs d'avenir.

Pourquoi, monsieur le ministre d'État, n'avez-vous pas demandé que l'Europe examine une politique industrielle européenne de nature à répondre aux inquiétudes profondes qui s'expriment dans notre pays sur le déclin industriel ? Pourquoi n'avez-vous pas demandé – je sais que vous êtes sensible à ce sujet – que l'Union européenne avance rapidement vers la conversion écologique de son économie ?
Il existe une « feuille de route pour une Europe compétitive et sobre en carbone d'ici à 2050 », que la Commission européenne vient de proposer et qui dessine le cadre de nos actions à venir. L'accueil que lui a réservé le Gouvernement me semble pour le moins timide.
Pourquoi n'avez-vous pas profité de la remise en cause liée à la nécessaire réponse à la crise pour avancer en matière de réformes structurantes ? C'est d'ailleurs en quelque sorte l'inverse de ce que vous faites dans le domaine fiscal en diminuant la fiscalité sur le travail pour la transférer vers de nouveaux instruments. Je pense notamment, pour ma part, à une fiscalité écologique.
En vérité, ce qui apparaît clairement aujourd'hui, ce sont à la fois vos faiblesses, les faiblesses du Président de la République et du Gouvernement, et votre incapacité à penser sainement notre relation avec l'Allemagne.

Les faiblesses de votre politique d'abord, car comment prêcher l'exemple quand les chiffres du chômage, du déficit public ou du commerce extérieur plombent chacun de nos pas et dessinent sur le plan économique le sombre bilan de votre politique,… (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Vous devriez vous exprimer avec plus de nuance, cela vous rendrait intelligent !

…quand votre gouvernement réussit le tour de force de changer de stratégie économique tous les ans ? C'est en réalité parce que vous avez échoué que vous consentez aujourd'hui à une politique d'austérité qui n'est dans l'intérêt ni de l'Europe, ni de notre pays.

Enfin, je voudrais dire un mot de votre incapacité à penser notre relation avec l'Allemagne.
Il y a exactement un an, Christine Lagarde appelait les Allemands à relancer plus fortement leur économie et à creuser leur déficit pour soutenir la demande en Europe. Un an après, le changement de posture du gouvernement français est complet puisque, de leader ou de donneur de leçons, il devient suiveur. Au-delà de l'inconséquence de vos choix économiques, je me permettrai, monsieur le ministre d'État, de vous rappeler quelques chiffres pour replacer dans son contexte votre pressante envie d'imiter l'Allemagne. En juin 2007, c'est-à-dire immédiatement après l'élection de Nicolas Sarkozy, le taux de chômage était de 7,8 % en France et de 8,1 % en Allemagne. Quatre ans plus tard, il est respectivement de 10 % et de 6,3 %.

Certes, mais la crise est la même pour tout le monde ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) La monnaie est la même pour tout le monde. La notation AAA de la dette est la même pour la France et pour l'Allemagne, l'effort de relance budgétaire est similaire et, pourtant, on constate un échec d'un côté, une réussite de l'autre. Voilà ce qui se produit. Je vous invite à en déduire certaines responsabilités : les vôtres. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Cet échec, c'est enfin celui d'une certaine approche de la gouvernance européenne, une approche unilatérale, qui ignore le Parlement européen comme les institutions européennes, qui affaiblit la Commission européenne.

Et cette approche erratique et unilatérale ne se limite pas aux sujets européens.

Elle est aussi la vôtre dans l'accompagnement des transitions démocratiques en cours dans certains pays arabes, que le Conseil européen devrait également examiner.
Là-dessus, vous avez fait entendre votre voix, vous avez tenté d'introduire de la cohérence dans notre politique arabe.

Vous avez insisté sur l'audience qui est la nôtre, d'après vous, dans ces pays. Moi, je pense, comme le groupe socialiste, qu'en réalité, cette audience est très dégradée.

Parce que le Président de la République, dans un premier temps, face aux révolutions arabes, a fait preuve de complaisance à l'égard des régimes en place : mieux valait, à ses yeux, un dictateur confirmé qu'une démocratie perçue comme une menace. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Le voilà maintenant, et l'on sait que vous n'appréciez guère cela, monsieur le ministre d'État, transformé, sous l'influence d'émissaires qui ne viennent pas de votre ministère, en une sorte de « va-t-en guerre », comme si, après avoir engagé une réconciliation forte avec le colonel Kadhafi, il lui fallait maintenant porter seul l'estoc au coeur de son régime. Cette attitude ne manque pas de générosité, monsieur Juppé, mais elle est inopérante...

…parce qu'elle est une nouvelle négation du fonctionnement multilatéral et d'abord de l'esprit européen.

Tout cela, et j'en termine, monsieur le président, nous conduit à penser et à dire, comme nos amis socialistes européens, que l'Europe n'est pas entre les bonnes mains...

…et, ajouterai-je, que la France n'est pas entre les bonnes mains. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
C'est bien pourquoi, avec la gauche et l'ensemble des hommes et des femmes inquiets du statut et du crédit de notre pays en Europe, nous souhaitons proposer une alternative à la hauteur de ce qu'attendent les Français. (Huées sur plusieurs bancs du groupe UMP.) Elle sera forcément, n'en doutez pas, européenne, car l'Europe, je le répète, a besoin d'un nouveau pacte fondateur, tout différent de celui que vous envisagez. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, monsieur le ministre chargé des affaires européennes, messieurs les présidents de commission, chers collègues, la déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen et le débat que nous tenons aujourd'hui dans l'hémicycle tombent à un moment crucial pour l'Union européenne.
Vendredi dernier, à l'initiative du Président de la République, s'est tenu un Conseil européen extraordinaire sur la Libye, suivi d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement des dix-sept pays ayant l'euro en partage. Le Conseil européen des 24 et 25 mars prochain sera aussi largement consacré à l'euro et à la gouvernance économique européenne.
Ces deux questions, la Libye et l'euro, illustrent parfaitement, pour le groupe UMP, les grands défis auxquels l'Union européenne est confrontée aujourd'hui : d'abord, exister sur la scène internationale et réussir à mettre en oeuvre une politique étrangère commune cohérente ; ensuite, consolider durablement la zone euro et réussir à coordonner nos politiques économiques.
Sur ces deux sujets, l'Union européenne démontre sa capacité à agir et à apporter des réponses. Elle démontre également, comme c'est très souvent le cas, que c'est dans les crises que l'Europe avance.
En matière de politique étrangère, l'Union est confrontée, depuis la fin de l'année 2010 et surtout le début de l'année 2011, aux révolutions qui secouent les pays de la rive sud de la Méditerranée, notre mer commune.
La situation paraît se normaliser, du moins se stabiliser, en Tunisie et en Égypte, avec des annonces concrètes de tenues d'élections et de mise en oeuvre de réformes politiques et démocratiques. L'Union européenne s'en est d'ailleurs félicitée. En revanche, la situation en Libye est particulièrement préoccupante. Monsieur le ministre d'État, il y a urgence en Libye, on ne peut plus attendre.

À l'heure où je parle, les troupes de Kadhafi avancent vers l'est du pays et menacent la sécurité des habitants. Nous devons prendre les décisions nécessaires aujourd'hui car, dans quelques jours, il sera trop tard ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Les conclusions du sommet de vendredi sont claires : « Afin de protéger la population civile, les États membres étudieront toutes les options, à condition que ce soit nécessaire, qu'il y ait une base juridique claire et que le soutien de la communauté arabe soit acquis. »
La dernière condition est aujourd'hui remplie : dès dimanche soir, la Ligue arabe réunie au Caire a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à autoriser l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne pour protéger le peuple libyen. Elle a aussi annoncé sa volonté de « coopérer » avec le Conseil national de transition mis en place à Benghazi, estimant que Kadhafi avait « perdu sa légitimité » en s'en prenant à son peuple.
La position française est particulièrement à l'avant-garde sur cette question, et je tiens à saluer les initiatives audacieuses de Nicolas Sarkozy…

..qui, deux ans après les événements de Géorgie, nous montre, une nouvelle fois, sa capacité à gérer des crises politiques d'ampleur internationale.

Je remercie aussi nos alliés britanniques, qui, sur cette question, sont sur une ligne proche de la nôtre.
La Libye est devenue une question de conscience pour la France. L'Union européenne et le reste du monde doivent suivre la même voie.

La communauté internationale doit prendre ses responsabilités en adoptant au plus vite une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies, qui permettra d'accroître la pression sur le dirigeant libyen. La communauté internationale a le devoir de surmonter ses divergences pour sauver le peuple libyen, pour l'aider à changer de régime et à trouver la voie de la démocratie. L'honneur doit nous conduire à ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée.

Notre conception des droits de l'homme nous interdit de rester les bras croisés, à regarder et à attendre que Kadhafi, je le cite, marche sur son peuple, « nettoie maison après maison » et se livre à des « boucheries » envers les opposants.

Les discours ne suffiront pas à sauver la population. Il faut des actes concrets et forts.
Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre d'État, comment notre pays compte agir dans les jours qui viennent, à la fois auprès de nos partenaires européens, à l'ONU et auprès des grandes puissances comme la Chine ou la Russie ?
Le Conseil extraordinaire de vendredi a également évoqué dans ses conclusions la question des mouvements migratoires suscités par ces différentes crises. Face à cette situation d'urgence, l'heure n'est pas aux polémiques stériles, d'où qu'elles viennent.

L'heure est encore moins à la provocation. Nous savons tous que seule une gestion concertée avec nos partenaires européens pourra résoudre cette question.
Monsieur le ministre d'État, la France a-t-elle, comme le suggèrent les conclusions du Conseil, renforcé les ressources humaines et techniques qu'elle fournit à l'agence européenne FRONTEX ?
En 2008, le Président de la République avait été à l'initiative du pacte pour l'immigration et l'asile. Aujourd'hui, comment la France entend-elle améliorer la gestion des flux migratoires et de réfugiés au niveau européen ?
Ces événements démontrent, a posteriori, comme c'est souvent le cas, hélas ! l'importance de l'Union pour la Méditerranée défendue et prônée par notre Président de la République. Si, au départ, cette idée n'a pas suscité un fort enthousiasme chez certains de nos partenaires européens, la plupart s'accordent aujourd'hui à considérer cette organisation comme un cadre essentiel afin de favoriser le travail entre l'Union européenne et les pays riverains de la Méditerranée.
Monsieur le ministre d'État, vous avez évoqué il y a quelques jours, une refondation de l'Union pour la Méditerranée, suite aux événements survenus en Afrique du Nord. Pourriez-vous nous indiquer les initiatives concrètes que la France compte prendre en ce sens ?
Je souhaite ensuite évoquer la situation de l'euro. Vous le savez, l'Union européenne et la zone euro sont entrées, en 2010, dans une tourmente sans précédent qui a mis à l'épreuve la solidité de ses institutions. Si les marchés ont attaqué la zone euro, c'est parce qu'ils savaient que l'Europe n'est qu'un grand marché, certes doté d'une monnaie unique mais sans direction économique et politique unifiée.
Il devenait donc urgent pour l'Union de se doter enfin d'une gouvernance économique européenne – ce qui, je le rappelle, était une idée impensable il y a encore moins d'un an. À ce titre, le groupe UMP se félicite des avancées majeures contenues dans les conclusions adoptées ce vendredi par les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro.
Ces conclusions seront présentées à l'ensemble des États membres lors du Conseil européen des 24 et 25 mars prochain, afin de permettre aux États non membres de l'euro de préciser s'ils souhaitent ou non participer au pacte pour l'euro.
Parmi les aspects importants de cette gouvernance, je souhaite évoquer trois instruments :
Premièrement, le Fonds européen de stabilité financière. Doté de 500 milliards d'euros, il permettra d'assister financièrement un État membre de la zone euro en difficulté. Cet outil, qui sera permanent à partir de 2013, est une avancée majeure. Il nous donnera la possibilité, si un scénario de type grec ou irlandais devait se reproduire, de sauver de la faillite l'État en difficulté et, surtout, d'éviter les risques de contagion au reste de l'Europe.
Deuxièmement, la taxe sur les transactions financières. Vendredi dernier, les chefs d'État et de gouvernement sont convenus de réfléchir à l'introduction d'une taxe sur le secteur financier, à la fois au niveau de la zone euro, au niveau de l'Union européenne et sur le plan international. Les recettes que cette taxe pourrait dégager sont évaluées à 200 milliards d'euros par an dans l'Union européenne, soit davantage que le budget total de celle-ci, ce qui ne manquera pas, j'en suis sûre, de nourrir le débat sur la question des ressources propres de l'Union.
Troisièmement, le pacte pour l'euro. Il permettra de renforcer la coordination des politiques économiques. Par ce pacte, les États membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour favoriser l'emploi, la compétitivité et surtout pour viabiliser leurs finances publiques. Ce pacte pour l'euro est la réponse des États membres de la zone euro à leur incapacité à faire converger jusque-là leurs économies. On ne peut pas avoir la même monnaie et pratiquer des politiques budgétaires, économiques, fiscales et sociales totalement divergentes.
La gouvernance économique européenne est une ambition portée par la France depuis bien longtemps. Jacques Delors la défendait, Valéry Giscard d'Estaing également. Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, n'a cessé d'insister sur sa nécessité. Il aura fallu cette grave crise pour que l'Europe dans son ensemble en prenne conscience et qu'elle commence à en bâtir les fondations.

Nous le voyons bien, monsieur le ministre d'État, et ces décisions en témoignent, l'Europe avance !

Sur la gouvernance, nous devons montrer aux citoyens européens que nous sommes capables de gérer la crise de l'euro.

En matière de politique étrangère, notre continent pacifié est attendu. Son message, fondé sur la paix et la solidarité, compte et doit compter de plus en plus dans le monde.

Les révolutions arabes donnent à l'Union européenne l'occasion historique de confirmer son rôle d'acteur global et sa vocation à assumer sa part de responsabilité sur la scène internationale. C'est la crédibilité des Européens qui se joue aujourd'hui !
Ensemble, avec le Gouvernement, nous souhaitons poursuivre cette démarche vers une Europe qui compte dans le monde et qui répond aux attentes de ses concitoyens. C'est le sens de notre engagement, messieurs les ministres, à vos côtés. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. François de Rugy, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, chers collègues, lorsque ce débat préparatoire au prochain Conseil des chefs d'État et de gouvernement des vingt-sept pays de l'Union européenne a été organisé, l'actualité était dominée par la question du sauvetage des États les plus endettés, comme la Grèce ou l'Irlande, et par les révolutions en cours dans plusieurs pays arabes.
C'est donc bien légitimement que beaucoup d'entre nous avaient prévu, sans doute, d'intervenir principalement sur ces deux sujets, qui demeurent d'ailleurs importants pour l'Union européenne. On pourrait naturellement y ajouter le pacte de compétitivité, que l'Allemagne tente d'imposer comme nouvelle doctrine européenne.
Sur ces questions, je dois d'ailleurs dire que notre jugement aurait été sévère : sévère pour les représentants de l'Union européenne, sévère pour les gouvernements européens, à commencer par le gouvernement français.
Un soutien tardif et timoré aux peuples arabes qui se sont soulevés et se soulèvent encore ; aucune initiative forte, aucune proposition concrète, aucune coordination réelle des chefs d'État et de gouvernement, qui ont tous voulu faire entendre une voix propre : l'Union européenne a été totalement absente de la scène internationale tandis que se déroulaient les révolutions dans le monde arabe. La France, qui aurait pu, qui aurait dû jouer un rôle primordial du fait de ses liens forts et anciens avec ces peuples, la France a toujours été à contretemps, le comble ayant été atteint avec les pantalonnades de Mme Alliot-Marie, éphémère ministre des affaires étrangères. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)

Mais, au-delà de son comportement personnel condamnable, c'est bien la politique étrangère de la France qui a perdu toute crédibilité. On aurait pu penser que votre nomination, monsieur Juppé, remettrait de l'ordre, de la sérénité et de la détermination au ministère des affaires étrangères. Las, le Président de la République ne vous aura même pas laissé deux semaines de répit avant de rechuter en préconisant, de façon unilatérale et juste avant le dernier Conseil européen, une action militaire contre la Libye.

En voulant faire un coup d'éclat, plus médiatique que diplomatique, il a une fois de plus décrédibilisé la France. Il avait déjà abaissé et, pour tout dire, déshonoré notre pays, en déroulant le tapis rouge au colonel Kadhafi il y a moins de trois ans. Il a achevé d'anéantir l'influence de la France par cette initiative solitaire et vaniteuse. (Nouvelles protestations sur les bancs du groupe UMP.)
En tant qu'écologiste, je n'oublie pas qu'un des objets de cette humiliante visite du colonel Kadhafi à Paris était la fourniture à la Libye d'une centrale nucléaire. Pour notre part, nous avions dénoncé à l'époque cette folie. Nous n'osons imaginer ce que signifieraient aujourd'hui des bombardements sur un pays doté d'installations nucléaires, fussent-elles civiles.

Conseil européen après conseil européen, c'est un triste constat de faillite que nous faisons : faillite de la politique étrangère présidentielle et faillite des institutions européennes. L'une est d'ailleurs étroitement liée à l'autre, puisque M. Sarkozy s'est acharné, avec quelques-uns de ses collègues chefs d'État et de gouvernement, à affaiblir les représentants de l'Union européenne. Où sont M. Barroso, M. Van Rompuy, Mme Ashton dans les crises que nous traversons ? Vous avez osé, monsieur le ministre d'État, associer la notion de task force au nom de M. Van Rompuy : j'ai du mal à comprendre. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Le traité de Lisbonne, qui était déjà fort mal né, est décidément en train de faire la démonstration de son échec programmé. Ce n'est heureusement pas une fatalité. C'est le résultat d'un choix politique : celui d'affaiblir les institutions de l'Union européenne. C'est particulièrement vrai de l'attitude du Président de la République. Pris à son propre piège à force de privilégier systématiquement l'intergouvememental, il se retrouve soumis à l'Allemagne, comme avec ce pacte de compétitivité entièrement tourné vers les intérêts économiques de notre voisin et totalement inadapté aux besoins des peuples européens.
Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, vous comprendrez que la situation dramatique du Japon nous oblige à redéfinir nos priorités politiques. À cet égard, on doit espérer que le Conseil européen ne restera pas non plus sans voix sur cette nouvelle crise, aux répercussions encore inconnues.
Nous tenons tout d'abord à redire ici ce que nous répétons depuis cinq jours dans toutes nos interventions : nos pensées sont d'abord et avant tout des pensées de recueillement et de compassion pour le peuple japonais qui traverse, de l'avis unanime, la pire des tragédies depuis les bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les écologistes s'expriment avec une émotion et une gravité inhabituelles sur cette situation. Après les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl, nous espérions du fond du coeur que le Japon passerait à côté d'une catastrophe nucléaire majeure. Or nous savons aujourd'hui que la situation n'est plus maîtrisée et que le pire est à craindre. Les êtres humains ne peuvent maîtriser l'évolution d'un réacteur nucléaire qui n'est plus sous contrôle.
La première de nos priorités est donc d'exprimer notre solidarité avec les Japonais. En disant cela, nous mesurons la difficulté de rendre concrète et opérationnelle cette solidarité. Même si le Premier ministre a parlé hier, dans son intervention devant notre assemblée, d'une coopération technologique, nous voyons mal quelle forme elle pourrait prendre, tant nous sommes démunis face à une technologie que les hommes, justement, ne peuvent plus maîtriser.
Notre deuxième priorité, en France et plus généralement en Europe, c'est la sécurité. La sécurité est, logiquement, la première préoccupation des Français en pareille circonstance. Cette préoccupation – cette peur, disons-le – est d'autant plus légitime que la France est, avec 59 réacteurs, plus nucléarisée que le Japon. Au sein de l'Union européenne, on compte plus de 150 réacteurs : 153 exactement.
Certes, la France n'est pas située dans une région du monde aussi exposée aux risques sismiques que le Japon (« Ah ! Tout de même ! » sur les bancs du groupe UMP), mais, comme l'a fort bien souligné Mme Kosciusko-Morizet, le Japon, qui était préparé aux risques de séisme, n'avait pas envisagé les conséquences d'un tsunami, lequel est pourtant un effet direct du tremblement de terre. Le propre des accidents nucléaires, c'est de se produire après un enchaînement de dysfonctionnements ou de risques dont la combinaison était imprévue ou n'avait pas été envisagée jusqu'alors.
Le rapport de 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire pointait des dysfonctionnements dans trente-quatre réacteurs français, dont plusieurs touchaient les circuits de refroidissement, c'est-à-dire exactement les éléments à partir desquels s'est déclenchée la tragédie japonaise. Nous savons aussi que la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde, est très vulnérable au risque d'inondation, comme l'a montré la tempête de 1999. Nous nous souvenons enfin du grave incident survenu en 2008, à la centrale du Tricastin, dans le sud de la France.
On comprend donc que les Français ne peuvent se contenter du déni – pour reprendre les termes de l'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin – qu'on leur oppose. Leurs inquiétudes sont légitimes, et ils ne peuvent plus supporter les propos de certains responsables de l'UMP. Puisque le Premier ministre en a appelé à la retenue et à la responsabilité – attitude que nos partageons –, il est grand temps de faire cesser les propos indécents entendus ces derniers jours dans la bouche, par exemple, de M. Guaino, qui s'est réjoui – oui, il s'est réjoui – des perspectives commerciales que cette catastrophe ouvrait au nucléaire français, plus sûr à ses yeux. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Oui, vous avez bien entendu, mes chers collègues : M. Guaino, éminent conseiller du Président de la République, parle de perspectives commerciales en ces heures noires !
M. Daubresse, membre de notre Assemblée et par ailleurs porte-parole national de l'UMP, a également déclaré hier : « Je crois toujours que le progrès technique peut triompher des catastrophes naturelles, même les pires. » Tel est le message que M. Daubresse souhaite envoyer au peuple japonais – c'est tout simplement indécent. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)
J'avoue que nous avons également été choqués par les propos du Premier ministre, repris par la ministre de l'environnement et par vous-même, monsieur Juppé, il y a quelques instants ; vous avez parlé très tranquillement du « retour d'expérience ». Ainsi le drame vécu par le Japon pourrait être ravalé au rang d'expérience dont on pourrait à l'avenir tirer profit.

C'est au mieux de l'irresponsabilité, au pire du cynisme, dont j'espère qu'il ne caractérisera pas le prochain Conseil européen. (Nouvelles protestations sur les bancs du groupe UMP.)
Il y a quelques semaines encore, toutes ces personnes auraient par le avec mépris le risque nucléaire lorsque les écologistes évoquaient la sortie du nucléaire. Ils n'auraient pas hésité à nous traiter d'irresponsables. Mais où est aujourd'hui l'esprit de responsabilité ?
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Pas chez vous !

Les Français jugeront. Plutôt que ces propos pour le moins légers, nous souhaitons des décisions claires et franches. Les meilleures garanties de sécurité sont la transparence et les expertises contradictoires. Il faut mettre fin à la culture du secret – au culte du secret, devrais-je dire – qui a toujours caractérisé la filière nucléaire, en France comme au Japon.
C'est pourquoi nous demandons que notre assemblée décide sans tarder la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'état des centrales nucléaires françaises, dont on sait que plusieurs, âgées de plus de trente ans, sont en fin de vie.
Nous demandons également que l'Union européenne se saisisse de cette terrible question, en décrétant un moratoire immédiat sur toute construction en cours ou programmée de centrales nucléaires en Europe. En effet, en Europe comme ailleurs, la décision comme le risque dépasse les frontières des États.
Nous vous demandons, monsieur le ministre, ainsi qu'aux vingt-sept chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, de faire preuve sur ce tragique sujet d'esprit de responsabilité et de vous montrer à la hauteur de l'enjeu que cette catastrophe nucléaire pose à la France et à l'Europe. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes GDR et SRC. – Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) )

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord faire observer que l'Assemblée a décidément quelque difficulté à trouver la forme idoine pour débattre des questions européennes à la veille des conseils européens, celui-ci n'étant pas le moins important.
Un seul orateur par groupe s'exprime, pour 577 députés, alors que nombreux sont parmi nous ceux qui ont des choses importantes à dire.

L'événement est qualifié de « débat parlementaire », alors qu'en réalité, monsieur le ministre d'État, après avoir écouté votre déclaration, nous faisons modestement les nôtres, puis on plie les gaules et chacun rentre chez soi.

Il n'y a jamais de vote, en aucune circonstance, de sorte que nous nous transformons pendant un bref instant en une sorte d'académie diplomatique internationale, ce qui est sûrement fort intéressant mais en aucun cas conforme à ce que doit être un parlement, lieu de débats et décision. (Applaudissements sur les bancs du groupe NC et du groupe SRC.)

Nous avons une consolation, monsieur le ministre d'État : vous êtes là ; j'ai cru un moment que vous ne le seriez pas.
Je voudrais d'abord faire quelques observations sur l'état financier de l'Europe, car force est bien de reconnaître que l'Europe a failli, au cours des dernières années, à ses devoirs concernant le respect des règles et des normes fixées par le pacte de stabilité et de croissance, qui engageait pourtant tous les pays de la zone euro.
Certains pays ont triché, beaucoup ont fait preuve de laxisme – c'est le cas de la France – et les institutions européennes, qu'il s'agisse de la Commission ou du Conseil européen, n'ont pas pu, pas su ou pas voulu assumer leurs responsabilités. Ce sont ces erreurs accumulées qui se paient aujourd'hui, en pleine crise économique, au prix fort.
Le Nouveau Centre plaide donc pour que les pays de la zone euro soient astreints à plus de rigueur. Vouloir l'Europe, c'est vouloir l'euro ; vouloir l'euro, c'est en accepter la discipline. Je tiens à dire au passage que les critiques si souvent adressées à la Banque centrale européenne, accusée d'excès de rigueur, me paraissent totalement injustifiées. Tant que le gouvernement économique européen restera à l'état de projet, tant qu'il n'y aura donc ni politique économique, ni politique budgétaire, ni politique sociale européenne, la seule clef d'accès à la politique européenne restera la politique monétaire, c'est-à-dire l'euro et la Banque centrale européenne.
Monsieur le ministre d'État, vous nous trouverez à vos côtés pour soutenir les décisions à prendre concernant la crise des dettes souveraines. Cela concerne la décision déjà prise lors du précédent Conseil européen, concernant la capacité effective de prêt du Fonds européen de stabilité financière ; cela concerne le Mécanisme européen de stabilité que vous allez, on peut l'espérer, adopter au prochain conseil et qui est appelé à devenir permanent à partir de 2013, avec un montant de crédits disponibles de 500 milliards d'euros.
Enfin, notre soutien concerne aussi la refonte du pacte de stabilité et de croissance, qui doit obliger les États membres, au prix de sanctions plus ou moins automatiques, à revenir progressivement au niveau d'endettement budgétaire initialement prévu.
En la matière, la volonté de construire un mécanisme stable et permanent de soutien des États confrontés à la crise des dettes souveraine doit inspirer la politique européenne de la France. Toutefois, ce doit être à la stricte condition que l'ensemble des pays de la zone reviennent progressivement dans les clous des règles fixées par le pacte de stabilité et de croissance.
Ce principe de rigueur s'applique évidemment, et en premier lieu, à la France. Monsieur le ministre d'État, nous attendons que le gouvernement auquel vous appartenez rappelle clairement son engagement en ce sens, et qu'il prenne les dispositions pour s'y tenir.
J'en viens enfin à un sujet plus difficile. L'initiative franco-allemande d'un pacte de compétitivité, devenu pacte pour l'euro, est, à mon sens, mal engagée. Je ne vous cache pas que ce projet suscite de notre part un certain nombre de réserves.
Nous sommes partisans de la rigueur financière ; par le passé, nous nous sommes souvent plaints que les gouvernements français, de droite ou de gauche, aient pris d'inutiles et malheureuses libertés avec la règle d'or de la rigueur. Néanmoins, l'Europe n'est pas simplement financière : elle est aussi une Europe des peuples. Si nous voulons exiger des gouvernements qu'ils règlent les questions des retraites ou des salaires au nom de la compétitivité de l'économie européenne, il faut aussi que la compétitivité soit au service des hommes et de l'emploi. Elle ne doit pas seulement se traduire par des règles rigoureuses appliquées par tous ; elle est aussi la mise en valeur de la richesse humaine de nos nations.
Monsieur le ministre d'État, qu'est devenu l'engagement pris à Lisbonne de faire de l'Europe le champion du monde de la connaissance ? Qu'est-ce qu'un pacte de compétitivité dans lequel on ne parlerait ni de l'accès des jeunes à la formation dans une Europe où le taux de chômage de ces derniers est supérieur à 20 %, ni de l'emploi des seniors, ni de l'accroissement des inégalités sociales, ni du désarroi qui prévaut dans certaines de nos grandes cités urbaines. Monsieur le ministre d'État, je vous avoue que, sur ce point, nous comprenons le mécontentement syndical qui nous paraît légitime.

S'il devait rester en l'état, ce pacte serait déséquilibré. Nous souhaitons donc que vous travailliez à le remettre d'aplomb. L'Europe économique et financière, certes ; l'Europe des marchés, pourquoi pas ? mais nous voulons aussi l'Europe de la richesse humaine qui compose les territoires européens.

Le Conseil européen évoquera aussi la situation dans le monde arabe. Le ministre a évoqué la Méditerranée, mais c'est bien du monde arabe qu'il s'agit, à deux exceptions près, que je n'évoquerai pas. Il faut souhaiter que ce Conseil marque une étape décisive dans la volonté de l'Union européenne de porter son regard et ses efforts vers cet espace politique.
Tout d'abord parce que le monde arabe constitue notre voisinage immédiat. De fait, cette zone devrait être la priorité diplomatique de l'Union européenne et de la France.
Ensuite, les peuples arabes attendent beaucoup de l'Union européenne dans tous les domaines, même au-delà de l'économie. Leur regard est naturellement porté vers nous quoi qu'ils en aient.
Enfin, la France exerce en la matière un leadership naturel en Europe. Pourvu qu'elle le veuille, nous attendons qu'elle réaffirme la nécessité d'une politique française à l'égard du Sud et, disons-le franchement, d'une politique arabe de la France, à la fois conforme à ses traditions et moderne dans sa définition.
Monsieur le ministre d'État, devant la commission des affaires étrangères et à la tribune, vous avez parlé du malheureux dossier libyen dans des termes qui nous ont pleinement rassurés. Après un moment d'incompréhension, d'incertitude et même de trouble lorsque nous avons vu ce qui se passait en haut lieu, tout est rentré dans l'ordre. Nous vous faisons confiance pour mener, aussi loin et aussi rapidement que possible, l'action de l'Europe afin qu'elle contribue, au côté du monde arabe, à résoudre le drame libyen.
Vous avez évoqué l'action de l'Europe à l'égard des pays qui marchent chacun à leur rythme vers la démocratie, en mettant en avant les moyens budgétaires, les capacités de prêt et le projet relatif à l'Union pour la Méditerranée. Nous souscrivons pleinement à ces initiatives. En ce qui concerne l'Union pour la Méditerranée, il serait cependant hautement souhaitable qu'elle soit moins doctrinale, moins structurelle, moins administrative, en somme moins politique, et qu'elle se concentre sur quelques projets simples et concrets.
Pour conclure, je veux évoquer à mon tour le drame qui frappe le Japon. Je pense qu'un geste fort de l'Union européenne va s'imposer pour marquer la solidarité des Européens à l'égard des Japonais. Je ne sais pas ce que pourra être ce geste, mais, dès que le pic de la crise sera passé, il sera hautement nécessaire.
J'estime aussi que l'Europe doit promouvoir des règles internationales renforcées pour protéger le monde des risques de l'énergie nucléaire civile.

Je ne crois pas qu'il faille proscrire cette énergie, mais je pense que la communauté internationale doit fixer des règles. Il existe un traité de non-prolifération afin de nous protéger des risques du nucléaire militaire ; il faut un nouveau traité en matière de nucléaire civil afin que cette énergie puisse jouer son rôle en toute sécurité pour l'ensemble des peuples du monde. (Applaudissements sur les bancs du groupe NC et sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Bravo !
(Mme Élisabeth Guigou remplace M. Bernard Accoyer au fauteuil de la présidence.)

La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, mes chers collègues, le gouvernement économique européen, objectif défendu depuis longtemps par la France, entre désormais dans le concret. Vendredi dernier, le sommet de la zone euro a marqué à ce titre une étape décisive fondée sur l'objectif de convergence progressive des politiques économiques nationales.
Que n'avons-nous entendu depuis plus d'un an sur la crise de l'Europe, sur l'éclatement inéluctable de l'euro voire sur l'échec définitif du projet européen ? Pourtant, l'Europe a encore montré dans la crise – et tant pis pour les Cassandre – sa capacité à faire prévaloir le choix concret de la solidarité sur les tentations de repli nationaliste, illustrant ainsi clairement la voie de l'avenir, qui passe par l'Union. Face aux crises, elle a su réagir avec vigueur et rapidité.
Sur le plan de la solidarité financière européenne d'abord, avec le renforcement des modalités d'intervention du Fonds européen de stabilité financière qui, désormais, pourra en outre intervenir directement en achetant des emprunts d'État, ce qui constitue une mutation majeure.
Il y a, ensuite, l'engagement commun de la responsabilité économique et financière grâce au pacte pour l'euro, décidé à partir de la proposition franco-allemande de pacte de compétitivité. Il vise à réduire l'endettement public, à mettre en oeuvre des politiques économiques, fiscales et sociales convergentes, au service de l'emploi et de la croissance, et à réduire ainsi les écarts de compétitivité.
Qui peut nier que nos économies sont confrontées à des défis communs tels que le vieillissement de la population, les divergences fiscales ou l'insuffisance de l'investissement industriel ? Ils ne peuvent être relevés qu'ensemble.
Je veux saluer l'engagement résolu du Président de la République et du Gouvernement, sans lequel rien n'aurait été possible.

Le dialogue franco-allemand a été l'efficace cheville ouvrière des accords successivement élaborés. Je salue aussi le courage politique de la chancelière Angela Merkel : sur cette question, elle doit affronter l'opinion et la presse allemandes, qui ne sont pas toujours tendres avec elle.
Le pacte pour l'euro n'est pas la régression économique et sociale que certains souhaiteraient y voir. Au contraire, vouloir réduire l'endettement public, prendre en compte les évolutions démographiques quand on doit fixer les règles de l'âge de la retraite, établir un lien entre l'évolution des rémunérations et celle de la compétitivité relèvent du bon sens et de l'intérêt général.
La mise en oeuvre de ce pacte devra associer étroitement les partenaires sociaux. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous préciser comment le dialogue social pourra concrètement se développer dans ce domaine ?
Par ailleurs, pour être démocratique, le pacte doit associer au premier chef les parlements nationaux, car cette étape nouvelle de la construction européenne implique directement les décisions des États et celles des parlements qui votent les budgets. C'est le sens du « semestre européen », qui permet de synchroniser les agendas de vingt-sept pays.
Le Conseil européen adoptera les orientations économiques sur la base desquelles les programmes de réformes et de stabilité seront construits. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous donner des précisions sur l'état de préparation des travaux du Conseil en la matière ?
Je me félicite que le Gouvernement ait souhaité la tenue au sein de notre assemblée, au début du moi de mai, d'un débat sur le programme de réforme et de stabilité qui sera transmis à la Commission européenne en avril.
Je voudrais évoquer deux chantiers prioritaires pour lesquels la plus grosse partie du travail reste à faire : l'harmonisation progressive en matière fiscale, la réflexion sur le lancement de programmes d'investissement d'intérêt européen.
En matière fiscale, je regrette que le gouvernement irlandais campe sur ses positions et refuse toute idée de revenir sur le taux d'imposition des sociétés extrêmement bas qui prévaut en Irlande. A contrario, l'initiative de la Commission européenne visant à l'harmonisation des bases de l'impôt des sociétés, qui devrait être présentée aujourd'hui même, va dans le bon sens.
Par ailleurs, dans ce domaine, la coopération franco-allemande apparaît une nouvelle fois comme une sorte d'avant-garde susceptible d'entraîner nos partenaires. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous dire où nous en sommes sur ce sujet ?
En matière de programmes d'investissement d'intérêt européen, s'il existe une conscience assez largement partagée de la nécessité de compléter les efforts de maîtrise des finances publiques par une politique d'investissement dans des secteurs d'avenir comme l'énergie, les transports ou la recherche, la question du financement reste entière. La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement présenteront prochainement des propositions en la matière. Monsieur le ministre d'État, le débat sur cette question peut-il selon vous, à terme, progresser ?
Pour conclure, comment ne pas vous interroger rapidement sur des sujets d'actualité qui seront abordés au prochain Conseil européen ?
En ce qui concerne la situation en Libye, je salue la forte initiative du Président de la République face à la répression meurtrière et monstrueuse de Kadhafi.
Dans la négociation pour obtenir enfin une décision des Nations unies autorisant une action militaire, la France et le Royaume-Uni sont en première ligne mais, monsieur Moscovici, elles ont le soutien de la Ligue arabe. Monsieur le ministre d'État, quelles sont dans ce domaine les perspectives d'évolution des positions de nos partenaires européens ?
Je salue enfin la relance nécessaire de l'Union pour la Méditerranée, autre initiative française qui devra accompagner les évolutions démocratiques, notamment en Tunisie et en Égypte. Fermeté face à une dictature sanguinaire, main tendue aux peuples qui aspirent au progrès : tels sont les deux volets de la politique de la France et de l'Europe, ce dont je me réjouis. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, mes chers collègues, en ce mois de mars 2011, je crois qu'il n'est pas exagéré d'avancer que l'Europe joue en partie sa crédibilité.
Je me réjouis que la France en ait pris la mesure en étant à l'initiative de deux sommets extraordinaires qui se sont tenus, l'un sur l'avenir de l'euro, initiative partagée avec l'Allemagne, l'autre sur la crise libyenne, initiative partagée, cette fois, avec la Grande-Bretagne. La stabilité de la zone euro et le soutien aux transitions démocratiques dans les pays arabes sont en effet deux sujets d'égale importance, qui requièrent de notre part audace et imagination.
Faute de temps, je concentrerai mon intervention sur la politique européenne à l'égard des pays du Maghreb et du Proche-Orient.
Hier, l'Europe a su tendre la main aux pays d'Europe centrale et orientale pour soutenir leurs transitions démocratiques. Aujourd'hui, elle doit faire de même avec les pays du Sud, dans le respect de leurs processus politiques internes.
La France a le devoir moral d'apporter son soutien à toute avancée sur la voie du renforcement des libertés et de la justice, conformément à ses valeurs. Nous devons multiplier les encouragements, être présents et à l'écoute, en particulier à l'égard des pays du Maghreb, qui appartiennent à notre premier cercle d'influence. Je salue, à cet égard, l'annonce par le roi du Maroc, Mohammed VI, d'une réforme constitutionnelle, quelque peu occultée par l'actualité en Libye et au Japon. Le Maroc, qui s'est déjà profondément réformé au cours des dernières années (Exclamations sur les bancs du groupe GDR), prend de nouveau les devants et montre la voie. Je souhaite, pour ma part, que nos amis algériens sachent, eux aussi, définir une voie algérienne de réforme et d'ouverture, même si leur politique actuelle à l'égard des investissements étrangers et de l'ouverture sur l'extérieur n'est pas du meilleur augure.
Permettez-moi d'insister sur l'appui que nous devons apporter à la transition tunisienne, qui a valeur de modèle. Une mission de la commission des affaires étrangères, que je présiderai, se rendra les 20, 21 et 22 mars en Tunisie pour approfondir le dialogue avec les nouvelles forces politiques. Celles-ci se mettent progressivement en place et se préparent à des échéances électorales décisives. Après une période de forte instabilité, les autorités actuelles semblent désormais mieux répondre à la jeunesse tunisienne, qui a joué un rôle majeur dans la chute de l'ancien régime et qui attend maintenant que la démocratie soit synonyme de progrès social et de justice. Les visites bilatérales se multiplient, témoignant que de bonnes relations avec la France demeurent une donnée essentielle pour la Tunisie. Les négociations en vue de la conclusion d'un statut d'association avancé devraient aboutir d'ici à la fin de l'année. Pourtant, rien ne sera définitivement acquis tant que l'économie tunisienne n'aura pas redémarré. Les autorités tunisiennes en ont fait part à notre collègue Rudy Salles, à l'occasion de sa visite à Tunis en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée : la relance de l'économie, en particulier de l'activité touristique, est aujourd'hui une impérieuse nécessité pour assurer à la Tunisie l'installation d'une démocratie stable et, surtout, pérenne.
Notre pays doit également s'attacher à relancer l'Union pour la Méditerranée. Je suis de ceux qui croient en son avenir, surtout depuis que le monde arabe est entré en mouvement. Jusqu'à présent, ce projet a été entravé par les difficultés entre Israël et le monde arabe et par l'insuffisante prise en considération de la Méditerranée par certains de nos partenaires européens. Le renouveau arabe peut permettre de lever ces obstacles politiques, tout comme la poursuite des projets concrets portés par l'UPM, notamment le projet, essentiel, de création d'une agence de l'eau, auxquels il conviendrait de rajouter, selon moi, la maîtrise du prix des denrées alimentaires.
Je souhaiterais, monsieur le ministre, que l'on fasse litière de l'argument, qui nous est souvent opposé, selon lequel l'Union consacrerait déjà les deux tiers de ses crédits de voisinage à la Méditerranée et un tiers à l'Est. Ce ratio n'a aucun sens si l'on considère les niveaux de population. Ainsi, l'aide européenne par habitant en faveur de l'Égypte est aujourd'hui dix fois moindre que celle versée à la Moldavie.
Bien évidemment, je ne peux achever mon intervention sans évoquer la situation en Libye, où le sang coule. Nous sommes peut-être à la veille de massacres à Benghazi. Cet épisode démontre, hélas ! une fois de plus, que le soft power n'est pas toujours suffisant et que les Européens ne peuvent se contenter d'une politique pacifiste d'accompagnement des réformes. Je salue donc les initiatives prises par le Président de la République. La France a été la première à exprimer la volonté que Kadhafi quitte le pouvoir et à reconnaître le Conseil national libyen. Elle a placé et doit continuer à placer ses partenaires, y compris les plus proches et les plus grands, devant leurs responsabilités et les conséquences de leur pacifisme de principe.
Malheureusement, si les Européens se sont mis d'accord sur les conditions de mise en oeuvre d'une option militaire, la nécessité d'agir ne fait consensus, à ce stade, ni en Europe ni au-delà. On l'a bien vu hier, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du G8 ; la position intransigeante de l'Allemagne reste surprenante. Pour ma part, je ne vois pas comment nous pourrions nous dérober, au cas où la Ligue arabe nous demanderait de participer à une opération aérienne qui serait engagée par certains pays arabes. La demande de la Ligue arabe de créer une zone d'exclusion aérienne est un pas important, qui doit nous amener à vaincre les réticences de nos partenaires. Une attitude passive serait alors incompréhensible et constituerait un contre-signal.
Cette position a minima n'est pas particulièrement glorieuse pour la communauté internationale, mais nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, pour que la France, dont c'est l'honneur, se tienne aux côtés des peuples arabes, en particulier des Libyens, en ces journées qui s'annoncent dramatiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mesdames, messieurs les députés, je vais tenter de revenir de la manière la plus synthétique possible sur les différents éléments de notre débat – car il s'agit bien d'un débat, monsieur de Charette – afin d'illustrer notre vision des enjeux du prochain Conseil européen. Ce faisant, je m'efforcerai de répondre aux questions qui m'ont été posées par les différents intervenants qui nous font l'amabilité d'être présents, y compris pour écouter les réponses du Gouvernement.
Ce Conseil européen est l'aboutissement d'une longue marche que l'Europe a commencée il y a deux ans et qui l'a conduite à apporter des réponses à l'une des crises qui étaient le plus susceptibles de déstabiliser l'organisation européenne. Tous, nous avons souligné les risques que comporterait le fait de ne pas parvenir à dégager des positions européennes cohérentes. Le Conseil européen qui se tiendra la semaine prochaine est le point d'aboutissement des efforts déployés pour surmonter les difficultés et les écueils. Ses réalisations, extrêmement concrètes, nous permettent de mesurer l'importance du chemin parcouru.
Premièrement, nous ne disposions pas d'outil permanent de défense de l'euro : nous allons nous doter d'un fonds de stabilité qui permettra de mobiliser d'abord 440 milliards, puis 500 milliards d'euros. Souvenons-nous des débats qu'avait suscités, au moment de la crise grecque, le simple principe d'une intervention conjoncturelle destinée à défendre notre monnaie commune.
À ce propos, vous me permettrez d'insister sur le fait que c'est bien l'euro qui nous a protégés, lors de cette crise.
Souvenons-nous, en effet, des attaques spéculatives dont le franc a fait l'objet en 1993 et 1994, dans une période beaucoup moins tourmentée que celle que nous avons vécue, et de leurs conséquences sur les cours d'achat des matières premières. À l'époque du franc, les taux d'intérêt étaient proches de 9 % ; ils se situent aujourd'hui entre 3 % et 3,5 %. L'euro nous permet ainsi de bénéficier de garanties sur un certain nombre de crédits, notamment en matière de logement.
Ceux qui appellent à une sortie de l'euro et à un retour du franc sont donc irresponsables. Une sortie de l'euro entraînerait, en effet, une diminution de 20 % à 30 % de l'épargne de chacun de nos compatriotes, un renchérissement de 20 % à 30 % du prix des matières premières, alors que celui-ci s'est déjà envolé, et une augmentation de 20 % de notre ratio dette-PIB. Encore une fois, c'est l'euro qui nous a protégés lors de la crise.
Deuxièmement, la décision a été prise collectivement d'abaisser de près de cent points de taux de base le coût du refinancement de l'économie grecque, afin de saluer les décisions courageuses prises par la Grèce et les efforts supplémentaires qu'elle a consentis.
Troisième point, essentiel, qu'ont souligné Hervé de Charette, Pierre Lequiller et Pascale Gruny : le pacte pour l'euro. La notion même de gouvernement économique était un tabou. M. Moscovici – dont je regrette qu'il soit parti sans attendre ma réponse – est bien placé pour savoir que, pendant des années, les socialistes ont plaidé, en vain, pour la création d'un gouvernement économique.

Ils ont voté Maastricht et Lisbonne ! Vous avez raison de le rappeler !
Eh, bien, pour la première fois, l'Europe va se doter d'un tel gouvernement économique.
Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la zone euro, il repose d'abord sur les dix-sept pays qui ont en partage la monnaie commune et trouve sa traduction dans le pacte pour l'euro. Ce dernier est équilibré et concerne à la fois les déficits – M. de Charette a raison d'exprimer cette préoccupation – et ce que j'appelle la compétitivité offensive,…
…laquelle consiste à investir dans les infrastructures et l'innovation, à accentuer nos efforts en faveur de la recherche et à améliorer la situation de l'emploi, notamment en agissant sur la formation des jeunes afin de réduire les passerelles entre formation et accès à l'emploi.
Lorsque les négociations ont débuté, elles ne portaient pas forcément sur un tel contenu. Ce sont nos efforts conjoints, et les vôtres, qui ont permis de faire évoluer le pacte pour l'euro dans un sens beaucoup plus conforme à nos convictions, c'est-à-dire à une économie sociale de marché, à la fois compétitive et attentive au capital humain. J'ajoute, Pierre Lequiller l'a rappelé, qu'un sommet tripartite se tiendra chaque année, qui permettra d'associer pleinement les partenaires sociaux à nos réflexions.
Deux autres points sont révélateurs des acquis de ce Conseil européen. Le premier concerne la mise en place d'une véritable convergence fiscale. Là encore, évoquer ne serait-ce qu'une discussion sur un rapprochement des impôts à l'échelle européenne était un tabou absolu. Eh bien, le Conseil pose le principe d'une réflexion sur une harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. La France le demandait depuis des années ; pour la première fois, la Commission devra mener une étude précise et concrète sur la possibilité d'une meilleure harmonisation fiscale à l'échelle européenne.
Le second point concerne la création d'une taxe sur les transactions financières. Il s'agit, là aussi, d'une avancée décisive, en faveur de laquelle nous avons plaidé pendant des années, parfois des deux côtés de l'hémicycle, du reste.
Vous y compris, en effet, ce qui montre que nous pouvons parfois nous retrouver sur les dossiers européens.
Je souhaiterais maintenant revenir sur l'intervention de Pierre Moscovici. Lui qui connaît bien la scène européenne, qui, objectivement, fut un bon ministre des affaires européennes et qui sut faire avancer un certain nombre de dossiers, ne peut tenir de tels propos. On le savait Cassandre, annonçant que notre économie allait souffrir du sauvetage des banques et que les Français allaient perdre leurs économies ; on le découvre Tartuffe, refusant de reconnaître les avancées que nous obtenons et en faveur desquelles le parti socialiste plaidait depuis des années. Vous vouliez le gouvernement économique ? Nous avons réussi à l'obtenir.
Vous plaidiez pour la convergence fiscale ? Le Conseil européen permettra d'y parvenir. Certes, je comprends que ce soit un peu désagréable, mais, de grâce, ne jouons ni les Cassandre ni les Tartuffe !
Quant à notre prétendue incapacité à penser la relation franco-allemande, arrêtons de dévaloriser la diplomatie française ! Gouvernement économique, taxe financière, fonds de stabilité : l'Europe est de retour et, sur bien des sujets, c'est la France qui est à l'initiative.
Le président Poniatowski a évoqué la Libye. Sur ce sujet, nous espérons obtenir d'un certain nombre d'États membres du Conseil de sécurité des avancées positives. En tout cas, le ministre d'État ne ménage pas ses efforts et met tout en oeuvre pour que nous puissions réagir rapidement, afin que la Libye ne soit pas une tache rouge sur les espoirs qui se sont levés sur la rive sud de la Méditerranée.
S'agissant de la Tunisie, je me retrouve dans les propos de M. Poniatowski : elle offre à l'Europe la possibilité de mener une action exemplaire. Mais, pour cela, il faut des moyens et des réalisations concrètes. La BEI peut étendre ses actions en Tunisie, et la BERD, qui en est aujourd'hui exclue, peut étendre son champ d'action à la Tunisie. Alain Juppé sera amené à se rendre bientôt dans ce pays, afin de marquer notre plein soutien à la transition démocratique…
…et d'investir dans la démocratie.
Pour ce qui est des frontières, chacun connaît mes convictions profondément pro-européennes. Pour répondre à la question que vous avez posée, madame Gruny, je dirai que la défense de nos frontières passe par l'Europe : une défense « nationalisante » n'aurait pas de sens. Nos frontières sont aujourd'hui communes, elles sont européennes et doivent donc être défendues à l'échelle européenne.
De ce point de vue, notre objectif est d'améliorer la capacité opérationnelle de FRONTEX – en coopération avec EUROPOL – et de multiplier les opérations appelées RABIT, qui ont prouvé leur efficacité en Grèce en divisant par deux les flux d'immigration illégale. Le problème n'est d'ailleurs pas tant les effectifs de FRONTEX que leur mise à disposition, c'est-à-dire l'existence de personnels et de matériel pré-identifiés, pouvant être mobilisés rapidement lorsqu'une opération européenne nécessite leur mise en oeuvre, comme c'est le cas en ce moment avec l'opération HERMES, consistant en la présence de navires qui patrouillent en Méditerranée, entre la Tunisie et l'Italie.
En ce qui concerne le programme d'investissement d'intérêt européen, évoqué par le président Lequiller, je crois personnellement aux project bonds. Il faut simplement veiller à ce que le recours à de tels instruments ne conduise pas à multiplier des opérations « hors bilan » qui pourraient être dangereuses. Cela étant, l'idée de mettre en oeuvre des projets communautaires concrets, identifiés, pour lesquels le passage par un project bond peut avoir un effet de levier, me semble intéressante. Je pense que la vocation de la France est de soutenir les idées allant dans le sens d'une plus grande intégration européenne. Nous ne sommes pas dans le camp des eurosceptiques, notre travail est de soutenir ce qui favorise l'intégration européenne.
Enfin, l'Union pour la Méditerranée représente un travail qui doit se faire en étroite coordination avec les pays du Sud. Nous ne devons pas perdre de vue que ce sont eux qui ont fait la révolution, qui ont soulevé les espoirs, et que nous ne pouvons pas arriver maintenant en leur expliquant ce qu'ils doivent faire ou en leur donnant des leçons ! Notre travail consiste avant tout à écouter ce que souhaitent ces pays, et c'est dans ce cadre que la France propose la désignation d'un groupe de sages composé de personnalités des deux rives de la Méditerranée, qui devra prendre le temps de l'écoute.
Par ailleurs, l'Union pour la Méditerranée ne peut pas rester sans attaches : elle doit être reliée à la politique de voisinage de l'Union européenne afin de bénéficier du soutien financier le plus efficace.
Enfin – et, sur ce point, je vous rejoins totalement – l'Union pour la Méditerranée doit être concrète sur un certain nombre de projets identifiables. C'est l'une des leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de la construction européenne : choisir des projets concrets, identifiables par nos compatriotes, est la meilleure façon de faire avancer les choses.
Des projets, nous n'en manquons pas : un plan solaire euroméditerranéen, un projet de dépollution de la Méditerranée, la création d'une chaîne euroméditerranéenne, l'Office méditerranéen de la jeunesse, un programme Erasmus, une coopération entre nos PME, notamment sur des projets environnementaux : autant de thèmes ayant vocation à être déclinés de manière concrète. Ne cherchons pas à tout prix de grands projets lointains, mieux vaut s'en tenir à quelque chose d'identifiable et de tangible !
Ma conviction est que l'année 2011 est celle d'un retour de l'Europe. Un retour qui, certes, se fait à travers des crises et des défis, et passe par des phases d'avancée et de recul, mais un vrai retour. À tous les défis qui nous sont lancés, la réponse est européenne, et la vocation de la France est de prendre l'initiative et de porter résolument l'ambition européenne. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures cinquante.)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (nos 2494, 3116, 3189).
Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.
Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de quatre heures cinquante-huit minutes pour le groupe UMP, six heures treize minutes pour le groupe SRC, trois heures quarante-huit minutes pour le groupe GDR, deux heures cinquante-six minutes pour le groupe Nouveau Centre et quarante minutes pour les députés non inscrits.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Marianne Dubois, pour le groupe UMP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État chargée de la santé, monsieur le rapporteur de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons touche un sujet sensible : la privation de liberté, même pour raisons médicales, est une question que nous devons traiter avec la plus grande prudence et la plus grande équité.
Les avancées contenues dans le texte, en particulier la nouvelle terminologie autour de la notion de soins, sont intéressantes. Plus qu'une nouvelle définition des soins psychiatriques, ce texte impulse une nouvelle culture de la prise en charge des patients en hôpital psychiatrique.
En substance, c'est un projet de loi équilibré : il répond aux inquiétudes de nos concitoyens qui réclament à juste titre des garanties contre les risques que la liberté de certains malades psychiques fait peser sur l'ordre public et il répond aux intérêts du malade.
Il se conforme au nécessaire respect du droit des patients et le renforce même en instaurant un contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention en cas de maintien d'une personne en hospitalisation complète sans son consentement au-delà de quinze jours. La procédure d'admission en soins sans consentement sera globalement simplifiée, ce qui constitue une mesure de bon sens, car les familles rencontrent aujourd'hui des difficultés pour faire hospitaliser un proche quand celui-ci ne représente pas une menace directe pour l'ordre public. C'est souvent au moment d'une crise ou d'un événement grave qu'elles se tournent, désespérées, vers l'hospitalisation d'office.
C'est avant tout en tant qu'élue de terrain que j'ai souhaité m'exprimer. Élue d'un territoire rural, maire d'une commune du Loiret de 4 000 habitants, de 2001 à 2008, je tiens à souligner la complexité du dispositif actuel de l'hospitalisation d'office en milieu rural. Heureusement peu fréquente, l'hospitalisation sous contrainte constitue une charge très lourde à gérer pour les élus de ces territoires. Et si le projet de loi va dans le bon sens pour ce qui est des patients, on peut se demander s'il sera applicable dans de bonnes conditions sur tout le territoire.
Quel maire de petite commune ne se heurte pas à des difficultés pour appliquer les mesures d'hospitalisation sous contrainte ? Cette procédure lourde et chronophage nécessite en effet la mobilisation pendant plusieurs heures des élus, des médecins, des forces de gendarmerie – deux gendarmes au minimum, qui doivent parfois suivre l'ambulance jusqu'à l'hôpital psychiatrique pour éviter tout incident. Ajoutons que toutes ces difficultés sont accentuées la nuit lorsque les effectifs sont réduits. Un cas particulièrement douloureux a ainsi nécessité de mobiliser durant cinq heures quatre gendarmes, soit le tiers des effectifs d'une communauté de brigade, et un médecin. Or, en milieu rural, du fait de leur emploi du temps surchargé, les médecins ne sont pas toujours disponibles immédiatement et leur raréfaction va alourdir le processus.
Toutes les personnes impliquées dans la procédure de l'hospitalisation sans consentement sont aux prises avec la complexité de la marche à suivre. Élus ruraux, médecins, gendarmes sont confrontés à une évolution permanente des textes qui réclame d'être certain de disposer de la dernière version pour ne pas risquer de rendre la procédure caduque.
De surcroît, en milieu rural le placement d'office requiert de tels efforts matériels et humains qu'on a souvent l'impression qu'ils sont inutiles. Ce sentiment fait place au découragement lorsque le patient concerné sort rapidement du centre hospitalier.
Désormais, les préfets devront donner une autorisation explicite pour la sortie du patient. Le projet renforce également les conditions de sortie en obligeant dans certains cas les patients à prolonger les soins à leur domicile, ce qui, je l'espère, soulagera les familles souvent démunies face à leurs proches malades et réduira le temps et l'énergie qu'il faut leur consacrer.
Le dispositif mis en place pose toutefois la question du contrôle des soins ambulatoires. Les déplacements de professionnels et l'accès au domicile de la personne suivie sont deux éléments incontournables à prendre en compte dans l'application de cette mesure.
Pourrons-nous répondre à ces attentes avec des moyens efficaces, tant humains que financiers ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le présent projet de loi, qui concerne près de 70 000 patients par an, instaure une meilleure prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques sans remettre en question les fondements du dispositif actuel. Il vise également à garantir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux tout en assurant leur sécurité et celle des tiers.
Toutefois, même s'il a été élaboré en concertation avec les associations de patients et leurs familles ainsi qu'avec des représentants de psychiatres, un groupe de personnes a semble-t-il été oublié : les victimes et les familles de victimes.
Je voudrais illustrer mon propos par une histoire vécue.
Maire d'une commune de 12 000 habitants, j'ai été amené à rencontrer une famille de trois enfants dont l'aîné souffrait de troubles mentaux. Dès son adolescence, il suscitait l'inquiétude et la frayeur des autres membres de la famille. Chacun fermait sa chambre à clef.
La mère, seule à élever ses trois enfants, vivait dans l'angoisse constante de découvrir en revenant chez elle qu'une porte avait été fracturée, que des objets avaient disparu ou que son aîné avait commis l'irréparable. Ses frère et soeur demandaient chacun à leur tour : « Maman, quand est-ce qu'il partira ? ».
Quand cette pauvre dame est venue me voir à la mairie pour me demander de l'aide alors que son fils s'était enfui de l'hôpital, je n'ai pu que lui répondre qu'on ne pouvait garder quelqu'un contre la décision des psychiatres et l'obliger à se soigner contre son gré.
Vous l'avez compris, il s'agit d'un sujet ô combien difficile. Dans certains cas, qu'on le veuille ou non, l'enfermement est peut-être la première des mesures à prendre. C'est une nécessité pour le patient comme pour le reste de la société.
Lorsque le maire ou le préfet décide d'un internement, ce n'est pas de gaieté de coeur. Ce choix ne relève pas de la volonté de tel ou tel, c'est avant tout une décision de bon sens : la société a le droit et le devoir de se protéger et bien souvent de protéger l'individu de lui-même.
C'est le devoir de la puissance publique que de prendre la responsabilité de l'irresponsabilité, madame la secrétaire d'État. C'est pourquoi je voterai en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La France doit-elle avoir peur de la maladie mentale ? Telle est la question.
En 2005, le rapport « Violence et santé mentale », commandé par le Gouvernement après le meurtre d'une aide-soignante survenu à Pau en 2004, avait clairement répondu : 2,7 % des actes violents étant commis par des personnes souffrant de troubles psychiatriques, violence et psychiatrie ne devaient pas être amalgamées. Le texte qui nous est soumis contredit ce constat : n'obéissant qu'à la loi des sondages et de la posture politique, il aborde la psychiatrie d'un point de vue essentiellement sécuritaire.
Cette position est du reste assumée de longue date par le Président de la République. En décembre 2006, alors ministre de l'intérieur, et déjà atteint d'un trouble obsessionnel compulsif (Sourires sur quelques bancs), il avait tenté d'associer maladie mentale et dangerosité dans la loi sur la prévention de la délinquance. Il a également profité d'un fait divers tragique impliquant un malade en fugue pour réclamer la réforme aujourd'hui en discussion.
Ce texte est donc inopportun. En outre, il comporte des contradictions extrêmement embarrassantes.
Je prendrai un exemple très concret : celui des soins sous contrainte. Le projet permet d'obliger une personne à se soigner à son domicile.

Cette éventualité entraîne plusieurs questions, auxquelles il faudra répondre : comment le respect de la vie privée du patient sera-t-il garanti ? Quels seront le rôle et les responsabilités des autres personnes vivant à son domicile ? Quel sera le degré d'intervention à domicile des soignants ?
Au-delà de ces interrogations, c'est le fait que des dispositions contraires soient adoptées dans les régions qui nous étonne le plus. Je pense aux infirmiers libéraux qui soignent plus spécifiquement des patients atteints de pathologies psychiatriques, et je prendrai l'exemple de ma ville, Toulouse.
Dans la région toulousaine, six cabinets qui travaillent en relation avec l'hôpital psychiatrique permettent de maintenir à domicile près de trois cents patients atteints de graves pathologies – schizophrénie, psychose, névrose.
Outre l'administration des traitements, ils assurent le suivi des patients grâce à l'outil le plus efficace qui soit : le dialogue, un dialogue expert, assorti de tous les actes – aide à l'hygiène, à l'alimentation, gestes quotidiens – qui permettent aux patients, malgré le déni fréquent de la maladie, de vivre dans la cité et de suivre leur traitement.
Au bout de quatre ans, on vient de refuser à ces six cabinets une partie des remboursements de ces prestations, du fait d'une nouvelle interprétation par la CNAM de l'article de la nomenclature générale des actes professionnels intitulé « Soins à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ». En fait, la CPAM ne souhaite plus prendre en charge ces patients à cause d'un problème de conventionnement de la structure.
Or ces professionnels ne font que leur métier en respectant à la lettre le code de la santé publique, en particulier ses articles R. 4311-1, R. 4311-2 et R. 4311-3, lesquels disposent notamment que « relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes ».
« Dans ce cadre », ajoute le code, « l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il ou elle juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il ou elle identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il ou elle peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il ou elle est chargé(e) de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers ».
On est loin, monsieur le rapporteur, de ce dont vous sembliez vous soucier : bien dissocier l'obligation de soins et la modalité des soins, afin d'assurer la pluralité de l'offre pour l'adapter aux situations individuelles.

Ce n'est pas lié au projet de loi, mais à l'interprétation de l'assurance maladie !

Au lieu d'entamer un dialogue avec les professionnels concernés, puisqu'un problème d'interprétation se posait, la CPAM a préféré interrompre une partie des remboursements, ce qui fragilise tous les patients. Certains – j'ai leurs lettres – ont même tenté de mettre fin à leurs jours, en réaction à la brutalité de l'annonce qui leur a été faite par courrier.
Comment peut-on considérer que l'économie réalisée sur des soins à domicile, soit environ trente euros par jour, pourra compenser l'hospitalisation de ces patients, laquelle coûte en moyenne cinq cents euros par jour, selon un praticien de l'hôpital psychiatrique de Toulouse, l'hôpital Marchant ? Monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'État, cette situation est proprement kafkaïenne.
Le cas des infirmiers toulousains n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des incohérences dont le Gouvernement fait preuve en général, notamment en matière de psychiatrie.
Je le disais en commençant, mes chers collègues : on ne peut pas traiter de psychiatrie du seul point de vue sécuritaire, qu'il s'agisse du casier psychiatrique, de la garde à vue psychiatrique ou – bientôt peut-être – du dossier médical personnel psychiatrique. Madame la secrétaire d'État, il serait temps que votre Gouvernement parvienne à un équilibre entre les lois de circonstance, comme celle que nous examinons, et les lois-fleuves comme la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », qui, avant même d'être entièrement appliquée, fait l'objet de propositions de révision, telle la proposition de loi du sénateur Fourcade.
La psychiatrie mérite une véritable réforme, une réforme globale, une réforme profonde.

Cette réforme aurait dû porter le nom de loi de santé mentale. C'est une Arlésienne de plus, comme la loi de santé publique, qui nous arrive en tranches.
La psychiatrie attend du législateur non qu'il stigmatise les malades, mais qu'il lui apporte des moyens et une reconnaissance sociale qui la mettent à l'abri des craintes injustifiées et des instrumentalisations populistes. N'oublions jamais que, depuis sa création, cette discipline n'a fait l'objet que de deux réformes, en 1838 et 1990.
Mes chers collègues, les professionnels, les familles des patients, les patients eux-mêmes nous regardent. Ayons le courage d'aborder cette question dans toute sa complexité, et non de manière simpliste comme vous le faites aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la réforme qui nous est proposée est tout à fait nécessaire – tous les professionnels de santé du secteur psychiatrique le reconnaissent – et attendue depuis longtemps.
En effet, tous ceux qui ont pris part à l'évaluation de la loi du 27 juin 1990 ont demandé que l'on remédie à plusieurs de ses dysfonctionnements, identifiés dans l'étude d'impact. Il s'agit des difficultés à appliquer le dispositif de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ; des lacunes du dispositif de l'hospitalisation d'office, qui ne suffit pas à assurer un suivi efficace ; de l'inadaptation de la loi à l'évolution des modalités de prise en charge des patients ; enfin, de l'efficacité relative des garanties des libertés individuelles.
Le projet de loi qui nous est proposé vise à surmonter ces difficultés. En outre, il tient compte des recommandations formulées par la cour de justice européenne et par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais aussi de la position du Conseil constitutionnel, qui a conclu à une méconnaissance des exigences de la Constitution dans sa décision du 25 novembre 2010.
Plusieurs mesures constituent des avancées significatives.
Certaines sont proposées depuis de nombreuses années, en particulier la possibilité d'administrer des soins ambulatoires sans consentement ou l'entrée dans le dispositif de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète initiale de soixante-douze heures au plus, débouchant soit sur la levée de la mesure, soit sur différentes modalités de soins sans consentement. Il en va de même de la procédure permettant d'administrer les soins même en l'absence de tiers ; de la constitution d'un collège destiné à éclairer la prise de décision dans les cas difficiles, qui sont nombreux ; enfin, du renforcement des droits des patients.
Ce futur dispositif devra représenter un compromis délicat entre continuité et changement, entre les finalités thérapeutique et sécuritaire.
Le projet est bâti sur le socle des deux lois fondamentales de 1990 et, surtout de 1838. Le préfet reste la pièce maîtresse du système médico-administratif,…

…le maire et le juge venant lui apporter leur concours pour appliquer un dispositif de contrôle sanitaire et social.
Par suite de la décision du Conseil constitutionnel, le projet de loi instaure un dispositif législatif demandé par les professionnels de santé : la décision fait intervenir l'autorité administrative et le contrôle du juge a posteriori. Cette évolution accroît le rôle du juge tout en maintenant celui du préfet. Quant au juge des libertés et de la détention, treize articles s'y réfèrent, qui lui font jouer un rôle prépondérant dans le contrôle a posteriori des mesures d'hospitalisation sans consentement. Ce dispositif relatif à l'intervention du juge est tout à fait cohérent et conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.
Le projet rappelle que les établissements de santé mentale ont d'abord vocation à soigner, que leur finalité est avant tout thérapeutique. Les soins sans consentement devront toujours être justifiés par une pathologie chez les personnes incapables de consentir à des soins. Ils sont conçus comme un nouveau moyen de faciliter le traitement, plutôt que comme un outil de contrôle social supplémentaire.
Enfin, le texte permettra de prendre en charge les détenus souffrant de troubles mentaux dans un cadre adapté, qui fait défaut aujourd'hui.

Mais cette réforme nécessitera naturellement une organisation structurée. En effet, elle entraînera des conséquences importantes en termes d'organisation pour les établissements chargés de l'appliquer. En outre, le calendrier de son application sera quelque peu tendu.
D'autre part, le projet de loi n'assouplit pas l'exigence de produire des certificats médicaux préalablement à l'admission. Ainsi, la procédure d'admission en soins sans consentement sur demande de tiers est notablement alourdie par le nombre de certificats demandés : il faut réunir cinq à six certificats médicaux et avis, émanant d'au moins trois ou quatre médecins différents, entre le premier et le douzième jour suivant l'admission. Les psychiatres publics disponibles seront donc très sollicités, d'autant qu'ils sont peu nombreux.
I1 en ira de même du juge des libertés, car les procédures sont lourdes : le texte l'oblige à examiner systématiquement toutes les mesures d'hospitalisation sans consentement, à des périodes fixées impérativement par la loi, sans compter les recours possibles – mais peut-être le débat nous permettra-t-il de progresser sur ce point. I1 faudra éviter les oublis et erreurs qui pourraient conduire, à cause d'un simple retard, à la main levée d'une mesure d'hospitalisation en soins contraints, ce qui serait évidemment contraire aux objectifs du projet de loi.
J'évoquerai aussi le problème du transport des personnes en crise depuis leur domicile. Le maire que je suis sait d'expérience que le SDIS n'aime guère l'assurer, que la police estime que ce n'est pas son travail, et que les ambulanciers des hôpitaux psychiatriques ont quelque difficulté à le faire.

En effet.
En conclusion, la réussite de cette réforme dépendra des moyens qui lui seront consacrés par les ministres de la santé et de la justice.

Au demeurant, ces moyens sont parfaitement identifiés par l'étude d'impact, dont tous ont reconnu en commission qu'elle était remarquable.
Enfin, tous l'ont dit également, seul un grand plan de la santé mentale permettra d'aborder tous les problèmes en jeu. Mais je sais qu'une réflexion est déjà engagée et aboutira sans aucun doute rapidement.
Dans l'intervalle, il faut voter cette réforme de la loi de 1990, attendue depuis 1995, c'est-à-dire depuis trop longtemps.
Je remercie M. le rapporteur du travail qu'il a accompli en faisant un tour d'horizon complet de la question. Les amendements qu'il a déposés nous permettront de préciser ou d'améliorer encore le projet sur certains points. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'un sujet majeur de santé publique : la santé mentale.
Certes, nombreux sont ceux qui reconnaissent que la loi de 1990 doit être revisitée ; mais ce ne sera certainement pas le résultat du projet de loi que vous nous proposez.
Votre texte porte pourtant un titre rassurant : « Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et modalités de leur prise en charge ». On pourrait donc croire, à première vue, qu'il se préoccupe principalement de la santé du malade. Il n'en est rien.
Le rapporteur a pourtant fait preuve de la bonne foi et du courage qu'on lui connaît, et je veux louer à mon tour sa capacité d'écoute,…

…certes sélective.
Vous n'avez pas pour autant réussi, monsieur le rapporteur, à nous montrer que ce projet était un vrai texte de santé publique.
Il serait, dites-vous, le résultat d'un équilibre subtil entre trois objectifs : liberté, santé, sécurité. En réalité, l'aspect sécuritaire ressort très fortement. Et on comprend, quand on sait l'origine de ce projet, pourquoi il ne saurait en être autrement.
Les événements dramatiques de Pau et de Grenoble ont été l'occasion d'un discours du candidat Sarkozy en 2006, puis du président du même nom en 2008 à Antony. Il avait dit alors : « les malades mentaux sont potentiellement dangereux, voire criminels ». Comment, dès lors, s'étonner qu'on nous propose aujourd'hui un texte essentiellement sécuritaire ?
La maladie mentale mérite un meilleur traitement ! Chaque année, plus d'un million de personnes consultent ; nous pouvons tous être un jour ou l'autre concernés. Le sujet mérite donc mieux que ce texte partiel, complexe et beaucoup trop technique.
Ce que les professionnels attendent, c'est le développement du volet sanitaire : ils savent que cette maladie ne peut se contenter de soins médicamenteux ; or, comme dans la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », vous ne traitez pas du volet prévention.
Les malades ont besoin d'un accompagnement humain de qualité : pour cela, il faut, tout simplement, des moyens humains. Aujourd'hui, ces moyens ne sont pas à la hauteur des besoins potentiels.
Ce que les professionnels demandent, c'est une véritable politique de santé publique ; ils vous l'ont dit avec force, hier encore devant l'Assemblée. Pourtant, vous ne leur proposez qu'un projet de loi incomplet, et bien trop sécuritaire.
Vous affirmez vouloir préserver la liberté individuelle, mais la présence du juge dans le dispositif ne suffit pas à nous rassurer. D'abord, la justice, déjà encombrée, ne pourra pas absorber dans des conditions correctes ce surcroît de travail – même si le ministre nous a dit hier soir que, sur les moyens humains, on allait voir ce qu'on allait voir.
Ensuite, et cela a déjà été dit, le poids de la décision du préfet est beaucoup trop important : c'est toujours lui qui a le dernier mot.
L'atteinte aux libertés individuelles se manifeste aussi par l'instauration de soins à domicile sous contrainte et obligatoires. Les professionnels le disent : l'administration de médicaments peut régler le problème immédiat de l'atteinte à l'ordre public, mais elle ne peut régler le problème de santé sur le fond. C'est là que l'accompagnement humain prend au contraire tout son sens.
Vous restez obnubilés par une logique de contrôle social et de sûreté publique. Cela transparaît dans la création d'un fichier du patient, véritable casier judiciaire psychiatrique – vous semblez certesreculer sur ce point, en précisant par amendement que ce casier pourra être effacé ; mais on ne sait pas encore au bout de combien de temps.
Le dispositif complexe de votre texte laisse voir le rôle prééminent du préfet sur le juge : ce dernier n'intervient qu'au bout de quinze jours ; quelles garanties seront données au patient pendant les soixante-douze heures d'hospitalisation initiale – délai dont on a rappelé hier soir qu'il était bien long ?

Vous mettez en place, ce sont les professionnels qui le disent à juste titre, une véritable garde à vue psychiatrique.
Une saisie automatique du juge pour les soins sans consentement en ambulatoire serait sans aucun doute préférable. Mais le gros défaut de votre texte réside dans ce jeu à trois entre le juge, le préfet et le psychiatre ; cela promet de bons moments ; mais dans ce jeu complexe, c'est toujours le même – le préfet, qui peut invoquer l'atteinte potentielle à l'ordre public – qui gagne. C'est inquiétant.
On peut redouter que le préfet, mettant en avant le principe de précaution, refuse de prendre le moindre risque ; et comment prendra-t-il sa décision, alors qu'il ne dispose d'aucune capacité d'expertise ?
Ce projet souffre de lourdes carences. Il n'évoque pas le renforcement de la politique de sectorisation, pourtant perçue comme un modèle dans le monde entier, mais aujourd'hui menacée par une couverture territoriale problématique, comme par la possibilité ouverte par la loi HPST de la confier au secteur privé.
Votre volonté sécuritaire a été partiellement freinée par le Conseil constitutionnel, qui vous a contraints à faire contrôler par le juge judiciaire le maintien de l'hospitalisation au-delà de quinze jours, puis tous les six mois. Là aussi, on pourra vraisemblablement raccourcir les délais ; mais cela ne suffit pas, puisque le texte prévoit que le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pourront déposer un recours contre la décision du juge. À la fin, c'est toujours le même qui gagne !
Ce texte, qui donne l'illusion de prendre en compte la santé des malades, stigmatise en réalité les personnes atteintes de maladie mentale. Il s'appuie sur la peur du fou dangereux pour priver de liberté un grand nombre de malades qui ne sont pas dangereux et qui n'ont besoin que de soins adaptés, sous forme de contacts réguliers avec les professionnels de santé.
Le Gouvernement choisit au contraire le contrôle permanent, l'enfermement à domicile, le fichier, la mise en oeuvre excessive du principe de précaution. Certes, les rares faits divers, d'ailleurs trop fortement médiatisés, sont regrettables ; mais ce n'est pas ce texte sécuritaire – un de plus – qui réglera le problème de la santé mentale.
Les professionnels de santé sont très remontés contre votre projet ; ils vous le disent tous.

Écoutez-les, monsieur le rapporteur. Vous les avez reçus, je crois : ils vous ont dit que la prévention reste le meilleur moyen d'éviter le pire. Mais pour cela, il faut des moyens, et ces moyens sont aujourd'hui insuffisants et mal répartis sur le territoire.
Ce projet de loi – comme beaucoup d'autres depuis 2007 – répond de manière démagogique à quelques drames médiatisés. Il ne répond en rien à l'attente des acteurs, alors qu'une vraie politique de la santé mentale serait nécessaire : il sera très rapidement indispensable de revenir sur ce sujet. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Ce projet de loi doit nous amener à nous interroger en profondeur sur les origines de la forte augmentation des troubles psychiatriques dans notre pays au cours des vingt dernières années.
On observe en effet un quasi-doublement du nombre d'hospitalisations sous contrainte. La France se situe parmi les pays européens où le taux d'hospitalisation des malades sans leur consentement est le plus élevé.
J'en viens à me demander pourquoi notre société engendre plus de malades mentaux que par le passé, alors que nous vivons globalement mieux, grâce au progrès médical. Quelles sont les causes structurelles qui expliquent une telle tendance ?
Pour endiguer cette progression, il faut mener une réflexion globale, qui dépasse le cadre des trajectoires personnelles, et qui doit prendre en compte les grandes évolutions sociales de ces vingt dernières années.
Je pense qu'une des explications principales de ce phénomène réside dans la complexité croissante de notre société, engagée dans un processus de changement culturel, social et économique effréné, qui a favorisé l'émergence de pathologies nouvelles nécessitant une appréhension, et donc une prise en charge, nouvelles.
Je pense en particulier aux activités chronophages générées par les nouvelles technologies de l'information – internet, jeux vidéo – comportant un risque d'addiction évident, ou encore à la consommation croissante de produits psychotropes qui prolifèrent sous plusieurs formes.
À ces nouvelles pathologies doivent être associées des offres de soin diversifiées, autres que l'hospitalisation à temps plein, en prenant soin de distinguer les malades difficiles des malades dangereux.
Cette réforme vise à une meilleure différenciation de la prise en charge de la psychiatrie, et je m'en félicite, tout en ayant bien conscience de la nécessité d'encadrer l'hospitalisation des patients souffrant des pathologies les plus graves pour les protéger et protéger leurs proches.
Mais j'insiste sur le fait que l'approche spécifiquement médicale doit aujourd'hui être accompagnée d'une approche sociale. Ce décloisonnement doit se concrétiser par la mise en place de structures extra-hospitalières d'aide à la réinsertion sociale du patient. Ces structures alternatives au tout-médicament contribuent à changer la vision de la société sur la maladie mentale.
Si notre regard sur le handicap physique et moteur a pu changer, pourquoi n'en irait-il pas de même pour le handicap psychique ?

La loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées avait, je le rappelle, reconnu pour la première fois la spécificité du handicap psychique.
Je voudrais revenir sur le phénomène croissant des addictions à l'origine de la désocialisation des personnes, et plus particulièrement sur les addictions aux drogues. De nombreuses études ont fait état du lien avéré entre consommation de produits stupéfiants et persistance des troubles psychotiques.
La dernière en date, publiée dans le British Médical Journal et réalisée par des chercheurs européens, démontre que les patients exposés au cannabis ont plus de risques de développer des troubles psychiatriques que ceux qui n'en ont jamais consommé. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

De nombreuses études ont également prouvé que la consommation de drogue augmente fortement les risques de devenir schizophrène.
Je ne cherche pas à tirer de conclusions hâtives en reliant consommation de produits psychotropes depuis vingt ans et augmentation des hospitalisations.

Mais je suis intimement convaincue que la consommation de drogues qui s'est fortement accrue depuis les années 1990 est l'une des nouvelles causes des maladies psychiatriques qui affectent de plus en plus de nos concitoyens.

Or, pour soigner des troubles psychiques en partie liés à la consommation de stupéfiants, il faut des structures adaptées ; il faut éviter l'hospitalisation sous contrainte et les séjours en prison – qui ne font qu'aggraver les troubles pour ces personnes – et au contraire développer le dispositif de l'injonction thérapeutique, mis en place par la loi de 1970.
Cette procédure, renforcée par la loi de mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, substitue à la remise de peine une obligation de soins du consommateur de produits – licites ou illicites – dans une structure adaptée, en fonction du niveau de dépendance.
Si je mentionne ce sujet, qui s'éloigne du champ de ce projet de loi, c'est pour bien souligner que la politique de la psychiatrie doit être envisagée de manière globale sans enfermer les gens dans des perspectives trop restrictives.
Nous devons accentuer nos recherches sur les origines des troubles psychiatriques afin de trouver des réponses adaptées aux différents symptômes.

C'est pourquoi je souhaite vivement que le rapport d'évaluation prévu à l'article 8 bis intègre une analyse des causes des différentes pathologies psychiatriques observées chez les patients ; c'est selon moi la seule manière de réduire de façon significative les maladies mentales dans notre pays.
La consommation de drogue constitue par exemple un problème de santé publique à part entière. Or son interdépendance avec la maladie psychiatrique est avérée. Si cette consommation continue d'augmenter, combien d'hôpitaux psychiatriques devrons-nous encore ouvrir ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La question de la prise en charge des malades atteints de troubles psychiques est un sujet complexe ; cette appellation regroupe en fait de nombreuses pathologies différentes. Ce sujet touche, directement ou indirectement, nombre de nos concitoyens : plus d'un tiers des Français souffriront, au cours de leur vie, d'au moins un trouble mental.
Le projet de loi qui nous est présenté par le Gouvernement n'est pas satisfaisant et il a d'ailleurs suscité l'opposition aussi bien des psychiatres que des magistrats ou des familles de patients.
Il n'est pas satisfaisant d'abord parce qu'il s'agit d'un texte rédigé dans l'urgence, sans réelle concertation avec les professionnels.
En effet, lorsqu'il a été déposé sur le bureau de notre assemblée au mois de mai 2010, ce texte avait été élaboré à la suite d'une série de faits divers tragiques. Il traduisait surtout les grandes lignes de la vision de la psychiatrie exprimée par le Président de la République à l'hôpital d'Antony en 2008 : une psychiatrie essentiellement tournée vers l'enfermement.
La lettre rectificative qui modifie ce texte répond quant à elle à l'obligation faite par le Conseil constitutionnel de modifier la loi du 27 juin 1990 avant le 1er août 2011.
Il ne s'agit donc en aucun cas d'un texte dicté par une réflexion de fond sur le traitement des personnes atteintes de troubles psychiques.
Ensuite, ce texte n'est pas satisfaisant parce qu'il s'agit d'un texte essentiellement sécuritaire fondé sur l'idée que les troubles psychiques sont une maladie incurable et que la seule solution repose sur l'enfermement des malades, qu'il soit physique ou chimique.
La censure opérée par le Conseil constitutionnel le 26 novembre dernier a obligé le Gouvernement à confier au juge des libertés et de la détention le contrôle de ces mesures privatives de liberté. Même si les nouvelles dispositions prévues par la lettre rectificative garantissent ce contrôle, ce texte n'en demeure pas moins répressif : même la sortie du malade est prévue avec des « soins sous contraintes », au lieu de la mise en place d'un véritable accompagnement social, d'un suivi et de la définition d'un projet de vie.

Enfin et surtout, ce texte n'est pas satisfaisant parce qu'il n'accorde pas plus aux psychiatres qu'aux juges les moyens de l'application de la loi.
L'obligation d'obtenir deux certificats est compréhensible au vu de la décision du Conseil constitutionnel. Néanmoins, la réduction proposée dans le projet de loi initial tirait toutes les conséquences d'une situation délicate : dans les petits départements ruraux, il est très difficile de trouver deux psychiatres en mesure de signer de tels certificats.
De même, le recours au juge des libertés et de la détention est un pas en avant dans la garantie des droits des patients, mais il se traduira inévitablement par une augmentation de la charge de travail que le texte élude.
Enfin, le projet de loi limite la psychiatrie aux soins sous contrainte et à l'enfermement. La réalité est pourtant bien différente puisque ces mesures concernent moins du quart des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation. L'ensemble des spécialistes s'accordent d'ailleurs à dire que les soins sous contrainte ne sont qu'une solution temporaire, les soins les plus efficaces étant ceux consentis par les patients. Mais ces soins nécessitent une offre de proximité, une réelle logique de secteur et davantage de moyens au service de nos concitoyens en souffrance : autant de dimensions qui sont totalement absentes du projet de loi.
Le texte ne répond donc en rien aux besoins des malades, pas plus qu'aux demandes des professionnels pour assurer une meilleure prise en charge des patients. Par sa complexité, il sera source d'insécurité, aussi bien pour les malades que pour les professionnels. Pire encore, il fait glisser la psychiatrie vers une police du comportement. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Merci, madame la présidente. Madame la secrétaire d'État, votre prédécesseure, Mme Bachelot, nous avait promis deux grandes lois de santé publique : l'une devant réévaluer la loi de santé publique de 2004, l'autre réformant la politique de santé mentale et la loi de juin 1990. Que reste-t-il aujourd'hui de ces deux engagements ?

Uniquement le texte que vous nous proposez aujourd'hui, qui ne peut absolument pas prétendre engager une nouvelle politique de santé mentale dans notre pays. Du reste, je me demande s'il en a même l'ambition.
Vous nous proposez d'examiner un rattrapage de mesures sécuritaires concernant les malades psychiatriques, que le Gouvernement avait échoué à introduire en décembre 2006 dans le projet de loi sur la lutte contre la délinquance. L'amalgame qui avait été ainsi fait entre maladie mentale et délinquance avait choqué les professionnels et les associations de familles de malades, et le Gouvernement avait dû reculer.
Mais le 2 décembre 2008, le Président de la République, récemment élu, avait prononcé, en visitant un hôpital psychiatrique à Antony, peu de temps après un fait dramatique survenu en Isère, un discours sécuritaire. Annonçant des mesures de renforcement de la sécurité dans les établissements, il avait dévoilé deux éléments de réforme de la loi du 27 juin 1990 : l'instauration de soins sans consentement en ambulatoire, d'une part, la prééminence de la décision préfectorale sur l'avis médical pour l'autorisation de sortie des patients, d'autre part.
Ainsi, la pression serait-elle mise sur le préfet, sur lequel il y a autorité et possibilité de sanction.

L'expérience de bien des déplacements sanction, décidés le plus souvent par le Président de la République, peut laisser prévoir que les autorisations de sortie ne seront données qu'avec de grandes réticences, luxe de prudence et de précaution, et assurance de sécurité, pour les carrières aussi.
La situation qui en résulterait est prévisible : l'encombrement accru des services d'hospitalisation, qui est déjà une réalité. Interrogé, le chef du secteur psychiatrique de Noisy-le-Grand répond : « Sur mes vingt-cinq lits d'hospitalisation, six patients sont en hospitalisation d'office à la demande du préfet ou du maire, neuf patients sont hospitalisés à la demande d'un tiers et seulement cinq sont en hospitalisation libre. Parmi les six patients en hospitalisation d'office, certains sont là depuis des années. L'un a purgé sa peine de prison mais le préfet l'a fait hospitaliser d'office. Depuis, tout est bloqué : on demande sa sortie, mais le préfet fait le dos rond ; on attend une expertise, mais le préfet dit qu'il n'a pas d'argent. On maintient quelqu'un qui pourrait être suivi en ambulatoire ».

Avec quels moyens, madame la secrétaire d'État, pourra-t-on assurer le contrôle de l'internement par le juge ? Plus de mille patients seront concernés chaque année, la justice est encombrée, les personnels peu nombreux, alors qu'il faudra assurer les transferts consommant beaucoup de temps de travail,…

…de même que la mise en place des certificats nécessaires à tous les stades du processus des soins sans consentement que vous prévoyez.
Ce texte, malgré les quelques améliorations ponctuelles apportées par le rapporteur,…

…est inacceptable. D'ailleurs, il est rejeté par l'ensemble des professionnels. Il serait nécessaire d'engager un débat public pour une nouvelle politique de santé mentale dépassant très largement celle des soins à apporter aux personnes souffrant de troubles mentaux, car, aux changements de notre société correspondent des évolutions dans le mode d'expression des conflits de relations sociales qui s'expriment de plus en plus par l'expression d'une souffrance psychique. L'épidémie de suicides dans certaines grandes entreprises n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Cette évolution s'objective à travers l'explosion des demandes de consultation en psychiatrie générale comme en pédopsychiatrie. La dichotomie entre maladie et normalité s'estompe au profit d'un continuum qui va des troubles psychiatriques les plus sévères à la souffrance psychique qui peut concerner chacun et chacune d'entre nous.
En termes de santé publique, les maladies mentales occupent une place majeure. Je reprendrai les propos d'Édouard Couty, auteur d'un remarquable rapport, malheureusement resté sans suite : « D'après l'OMS, les maladies mentales se classent au troisième rang des maladies en termes de prévalence et elles sont responsables du quart des invalidités. En médecine générale, elles se situent au deuxième rang, derrière les maladies cardiovasculaires. Elles affectent une personne sur cinq chaque année, et même une sur trois si l'on se réfère à la prévalence sur la vie entière. […] En France, les troubles psychiatriques sont responsables chaque année de 12 000 morts par suicide, auxquels s'ajoute la surmortalité non suicidaire – accidentelle, consommation d'alcool, de tabac, de drogue. Les études épidémiologiques comparées menées dans plusieurs pays européens montrent par ailleurs que la prévalence des différentes pathologies psychiatriques est relativement élevée en France. »
Nous devrions, madame la secrétaire d'État, être capables de proposer, face à l'importance des besoins et aux nouvelles demandes, une gamme de services différenciés et adaptés sur l'ensemble du territoire pour traiter l'ensemble des situations comme il convient, et le plus précocement possible, ce qui est gage d'efficacité et de réduction du temps de prise en charge. La façon de prendre en charge les souffrances, des plus intenses aux moins sévères, doit refléter nos valeurs humanistes, respecter les libertés individuelles, lutter contre les inégalités, associer les usagers et leurs familles aux décisions qui les concernent.
Notre réflexion devrait donc aujourd'hui se fonder sur une conception humaniste et contemporaine de l'individu souffrant, qu'il soit adulte ou enfant, de ses besoins et de ses aspirations, ainsi que sur une bonne connaissance du système actuel de prise en charge et des expériences actuellement menées. Mme Lemorton évoquait tout à l'heure le recul, à Toulouse, des cabinets d'infirmiers libéraux que la modification du remboursement de leurs actes contraindra soit à changer d'exercice soit à plier boutique, laissant leurs malades désemparés.
La psychiatrie a la particularité de porter sur la seule pathologie en raison de laquelle on peut contraindre une personne à être enfermée à l'hôpital. Cela implique de porter une attention particulière au respect de la personne et à la préservation des libertés publiques. C'est en ce sens que des amendements seront proposés pour améliorer le texte.
De manière générale, nous sommes très inquiets de la politique menée actuellement, qui s'appuie sur la peur et dresse les individus les uns contre les autres. Cette politique est dangereuse et stigmatisante ; elle ne permet pas de mettre en oeuvre dans la cité l'approche intégrative et apaisée dont les personnes souffrantes ont besoin. Elle provoque même des reculs, comme celui que je viens de citer s'agissant de la prise en charge en ville des malades psychiatriques. Voilà pourquoi nous la refusons. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, dans vos différentes interventions, vous vous êtes référés à de nombreuses reprises à des rapports, dont ceux de Mme Strohl et de l'IGAS. Cela me réjouit, précisément parce que ce projet de loi repose sur un certain nombre de leurs préconisations.
Je l'ai dit lors de la discussion générale, il fallait trouver de nouveaux modes plus contemporains de prise en charge, notamment extrahospitaliers. Il fallait également résoudre le problème de personnes qui doivent être hospitalisées mais qui n'ont pas, malheureusement, un proche qui puisse en faire la demande. Il fallait encore élargir la période d'observation au cours de laquelle l'état du patient peut évoluer et les professionnels réviser leur point de vue et le mode de prise en charge.
Le projet de loi est un exercice délicat d'équilibre entre la nécessité d'offrir aux malades les soins les plus adaptés et le respect des libertés individuelles. D'ailleurs, dès 1997, avec le rapport Strohl, certaines mesures auraient pu être mises en oeuvre lorsque votre majorité était au Gouvernement. La période d'observation de soixante-douze heures et l'alternative à l'hospitalisation sans consentement étaient déjà préconisées.
Monsieur Blisko, s'agissant de la baisse du nombre de lits, vous avez parlé d'une réduction de l'effort de la société. Permettez-moi de ne pas être d'accord : nous avons changé d'approche dans la prise en charge des malades présentant des troubles psychiatriques en cherchant de nouvelles alternatives à l'hospitalisation, car nous ne sommes pas nostalgiques des asiles.
Nous préférons que le soin apporté soit le plus adapté au rythme de vie des personnes. Pour nous, les centres médico-psychologiques doivent rester le pivot de la prise en charge et des soins.
La sectorisation a précisément vocation à sortir la psychiatrie des murs et à soigner les gens au plus près de leur lieu de vie.
Je ne suis évidemment pas d'accord avec l'idée d'ouvrir de façon inconditionnelle, en tout cas abusive, le nombre de lits. Notre nouvelle démarche va précisément à l'inverse de l'enfermement à tout prix et à outrance. En outre, il faut aussi tenir compte des progrès formidables de la médecine et des traitements qui permettent aux malades d'être mieux pris en charge en continuant à vivre près de leurs proches.
Mais l'élément fondamental à mes yeux est celui de la liberté et de la socialisation des malades. L'hospitalisation à outrance n'est pas la meilleure réponse à l'adaptation des malades à leur milieu de vie. La désinsertion de la société qu'elle implique ne contribue pas à faire évoluer leur état vers une amélioration.
Vous avez aussi fustigé les soins ambulatoires. Vous préconisez des expérimentations pour déterminer leur pertinence, mais les sorties d'essai ont déjà prouvé que ces nouveaux modes de prise en charge étaient tout à fait pertinents.
Vous êtes nombreux à revendiquer une grande loi de santé mentale (Exclamations sur les bancs du groupe SRC),…
…et à en dénoncer l'absence. Toute la réflexion sur les mesures d'organisation de soins, les pratiques médicales, la recherche, l'accompagnement, la prévention, le diagnostic demande-t-elle vraiment un texte législatif ?
De mon point de vue de secrétaire d'État à la santé, tout cela relève davantage d'un plan de santé mentale, de psychiatrie, que nous sommes en train de préparer.
La loi de santé mentale dont vous avez la nostalgie entre dans le cadre des plans de santé publique. Je vous le répète, vous aurez connaissance de ce plan de santé mentale dès l'automne prochain.
D'habitude, vous êtes les premiers à dire qu'il y a pléthore de textes législatifs.
Or, ici, vous revendiquez une énième loi…
…alors que les dispositions dont vous parlez relèvent, non du cadre législatif, mais d'une organisation de soins dans le cadre d'un plan psychiatrique.
M. Mallot, qui n'est pas là, a évoqué l'accueil familial thérapeutique. C'est vrai, ce type de prise en charge est encore peu développé puisqu'en 2010, il représentait 1,5 % de l'ensemble des prises en charge à temps complet, environ 4 % des journées.
Ces éléments montrent la nécessité de mener des travaux sur la spécificité de l'accueil familial thérapeutique dans une perspective de complémentarité avec les autres activités sanitaires et les services proposés par les acteurs médico-sociaux. Je prends acte de cette intéressante modalité de prise en charge qui mérite d'être développée. Une contribution sera mise en place dans le cadre du plan psychiatrique que je viens d'évoquer.
En conclusion, je souhaite répondre à Mme Lebranchu, qui n'est pas là, que la Chancellerie est déterminée à tout mettre en oeuvre pour que cette réforme soit accompagnée, dans les délais les plus brefs possibles, des moyens humains et matériels nécessaires.
Le travail d'évaluation est en cours.
À Mme Lebranchu, qui connaît parfaitement les contraintes qui sont les nôtres dans le temps imparti par le Conseil constitutionnel, je veux dire que toutes les pistes de réflexion sont actuellement explorées et donneront lieu rapidement à des mesures concrètes.
Par ailleurs, pour répondre à l'évolution prévisible de la législation, l'École nationale de la magistrature a créé, dès 2010, une session de formation continue spécifique intitulée « Les atteintes à la liberté d'aller et venir et au consentement aux soins pour raisons médicales ». Cette session a été renouvelée cette année et élargie à 200 participants. Des formations pratiques ou à l'occasion de changement de fonction des magistrats sont aussi organisées. Enfin, des formations managériales permettant de prendre en compte l'impact de la réforme sur l'organisation des juridictions ont également été envisagées.
Évidemment, la possibilité et le droit de faire appel sont ouverts à toutes les parties, donc aux patients.

J'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi.

Je suis saisie d'un amendement n° 15 , portant article additionnel avant l'article 1er.
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour le soutenir.

Cet amendement vise à élargir le champ des personnes de confiance pouvant être choisies par le patient.
La notion de « personne de confiance » a été introduite dans la législation française par la loi de 2002 relative aux droits des malades, suite à un avis de 1998 du Comité national d'éthique qui partait du constat que les personnes, dont la capacité de compréhension est faible ou tronquée en raison de leur état de santé ou de leur âge, se trouvaient en difficulté pour consentir aux soins.
Face à cette situation, la personne de confiance est donc un intermédiaire privilégié pour représenter l'avis du patient. Elle peut être consultée par le corps médical, sans toutefois aller jusqu'à se substituer à la personne si celle-ci peut exprimer elle-même son consentement.
De façon surprenante, ce projet de loi ne fait jamais référence à la personne de confiance. Il se contente de prévoir l'information du patient – ou de ses proches parfois – dans la mesure où son état le permet.
Nous avons déposé un certain nombre d'amendements qui visent à introduire la personne de confiance dans le face-à-face entre le médecin et son patient. L'article L. 1111-6 du code de la santé publique prévoit que la personne peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Nous avons souhaité ajouter deux possibilités : les membres d'associations, parce que les malades psychiatriques reçoivent leur aide, et les travailleurs sociaux qui, souvent, constituent un lien important avec le patient. Ces derniers sont perçus par les patients comme des personnes qui ne leur imposeront pas forcément quelque chose et auxquelles on peut faire davantage confiance, en tout cas dans la première étape.

La parole est à M. Guy Lefrand, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Avis défavorable.
Les dispositions qui créent et définissent la personne de confiance ont été introduites dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé.
Si elles s'appliquent aux patients qui font l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement, elles dépassent largement le cadre de l'hospitalisation sous contrainte. Il apparaît donc particulièrement malvenu, dans un texte sur l'hospitalisation sous contrainte, de modifier des dispositions qui sont beaucoup plus larges que le texte lui-même.
Par ailleurs, je vous rappelle que la formulation actuelle de l'article L. 1111-6 est déjà très large puisqu'elle précise que : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant ». Cette liste n'est donc pas limitative.
Je considère donc que votre amendement est satisfait. Aussi, je vous demande de le retirer. À défaut, j'émets un avis défavorable.
Même avis que le rapporteur.

Je ne comprends pas le refus du rapporteur et de la secrétaire d'État.
À la page 28 de l'étude d'impact, il est indiqué que : « Or, deux situations problématiques peuvent alors se rencontrer : l'impossibilité d'identifier un proche en raison de l'isolement social du patient ou le refus de l'entourage du patient d'assumer la responsabilité d'une demande d'enfermement… »
L'amendement de nos collègues du groupe GDR est totalement en phase avec ces problématiques et il me semblait avoir compris, en commission, que nous étions d'accord. Aussi, je ne comprends pas la raison de ce refus aujourd'hui.
Vous faites référence à la loi de 2002 que notre majorité avait fait adopter. En neuf ans, la société peut avoir changé. Des gens se retrouvent dans des situations de très grande solitude, notamment les personnes qui vivent dans la rue et qui n'ont parfois comme seul contact que des associations comme le SAMU social.

Effectivement, en commission le rapporteur avait donné une appréciation favorable et m'avait répondu que mon souhait était exaucé grâce à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Si, derrière le terme « proche », on considère qu'il peut s'agir d'associations ou de travailleurs sociaux, alors mon souhait est peut être exaucé.

Effectivement, je crois que votre amendement est satisfait. En effet, l'article L. 1111-6 précise que : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant ». La liste n'est donc pas limitative. Toute personne physique peut être désignée. Mais il ne peut pas s'agir d'une association, c'est-à-dire d'une personne morale.
(L'amendement n° 15 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 14 , tendant à supprimer l'article 1er.
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour le soutenir.

D'abord, je tiens à donner acte des avancées que constitue l'article 1er. Le cadre de la loi de 1990 ne permet, à l'heure actuelle, de prendre en charge une personne sans son consentement, que sous la forme d'une hospitalisation complète. Le rapport de l'IGAS de 2005 faisait le même constat et soulignait que l'hospitalisation ne pouvait être la seule façon d'obliger un malade à recevoir des soins. Tout au plus, cette modalité de prise en charge devait être un cadre symbolique. Les inspecteurs recommandaient donc d'explorer les prises en charge sous contraintes dans divers lieux du secteur psychiatrique, voire en dehors des établissements relevant de ce secteur.
Vous reconnaissez implicitement la pertinence de la coexistence d'une pluralité de modes de prise en charge des patients, et c'est bien. Vous avez également été contraints – c'est plus dommage – d'intégrer les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010. De fait, votre projet de loi clarifie le cadre légal existant.
En dépit de ces avancées, nous ne pouvons souscrire à l'approche qui a été privilégiée par le Gouvernement, suite au discours pour le moins martial du Président de la République, et ce pour plusieurs raisons.
La première d'entre elle tient à la contradiction entre les objectifs affichés – l'accès aux soins, la continuité des soins, la protection des personnes et de leur liberté – et la réalité des dispositions qui aménagent plutôt le recours à la contrainte, une continuité de la contrainte, la protection de l'ordre public et finalement la limitation de la liberté des patients. Vous n'envisagez, en effet, la pluralité des modes de prise en charge que sous l'angle des soins sans consentement. Vous méconnaissez ainsi le rôle du libre arbitre du patient dans l'acceptation de prises en charge alternatives – sanctions en cas de manquement, retour à l'hospitalisation d'office, approche sécuritaire. C'est un moyen de contourner le manque de moyens alloués aux établissements et c'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles la loi promise en 2009 n'a pas été présentée devant le Parlement alors que chacun reconnaît son impérieuse nécessité.
Aujourd'hui, nous sommes face à un manque de lits, à des sorties précipitées, à un manque de personnel, à une augmentation inquiétante des placements en chambre d'isolement. Par conséquent votre texte risque de borner le service public à la prise en charge des traitements contraints. On en voit déjà à l'heure actuelle les effets pervers puisque, hélas ! nombre d'hôpitaux refusent, faute de moyens, les hospitalisations libres pour se concentrer sur les hospitalisations d'office et les hospitalisations à la demande d'un tiers.
Par ailleurs vous instaurez un régime de garde à vue psychiatrique de soixante-douze heures sans intervention d'un juge de l'autorité judiciaire. Certes, vous pouvez vous enorgueillir d'un renforcement du droit des patients en raison de la faculté qui leur sera offerte de saisir le juge des libertés à tout moment, mais vous ne faites intervenir ce même juge qu'à l'issue des soixante-douze heures. Il y a là comme une incohérence.
De plus, le texte prévoit des délais confortables pour statuer qui, s'ils satisfont la CEDH, ne peuvent recevoir notre aval s'agissant d'une privation de liberté pour des patients souffrant de troubles mentaux : pour eux, une hospitalisation est un réel traumatisme qui ne contribue pas toujours à leur mieux-être.
Le contrôle du juge ne portera que sur les mesures d'hospitalisation complètes et pas sur les autres formes de prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement.
Vous prévoyez enfin que la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le juge ne fera pas obstacle à une décision d'admission en soins sans consentement sous une forme alternative, ce qui, à nos yeux, constitue toujours une mesure privative de liberté.
Tout est prévu, finalement, pour étendre le champ de la prise en charge sans consentement, rendre plus difficile la sortie des patients d'une telle modalité de soins et s'assurer par la contrainte qu'ils se conforment à ces obligations.
Votre projet s'articule donc principalement autour de préoccupations sécuritaires qui vont jusqu'à étendre la contrainte aux soins ambulatoires. La notion de surveillance heurte de plein fouet la conception très particulière des soins dans le domaine de la psychiatrie.
En revanche, rien n'est concrètement prévu pour améliorer, sur les plans social, humain et sanitaire, la qualité et la continuité des soins indispensables. Nous ne partageons pas ce parti pris, cette vision de la psychiatrie.
Pour ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.

La commission a rejeté cet amendement en application de l'article 86 du règlement. Je rends néanmoins hommage à Mme Fraysse, qui est dans son rôle en demandant la suppression de l'article tout en reconnaissant les énormes avancées qu'il comporte. Si j'osais, je parlerais de schizophrénie…

Vous tâchez de résoudre en tout cas cette apparente contradiction avec beaucoup d'élégance. Vous admettez vous-même, j'y insiste, que cet article représente une avancée importante pour les droits des malades, notamment en ce qui concerne l'accès au juge et la garantie d'un droit au recours effectif.
Je vous rappelle que l'hospitalisation ne se réduit pas à l'hospitalisation sous contrainte, pour reprendre l'un de vos arguments, puisque cette dernière représente aujourd'hui 21 ou 22 % de l'ensemble des hospitalisations. Près de 80 % des patients vont par conséquent librement à l'hôpital psychiatrique.

Je soutiens, pour ma part, cet amendement. Mme Fraysse a dit l'essentiel en deux mots : elle s'oppose à cette réforme partielle et sécuritaire. Vous évoquez, madame la ministre, un prochain plan de santé psychique ou mentale. Il faudrait commencer par nous expliquer ce que vous entendez par « plan ».

Notre rôle, ici, consiste à voter des lois et non des plans appelés à être adoptés en d'autres lieux.
S'il s'agit, en revanche, d'une vraie loi, nous nous en réjouissons par avance. Reste que le plan général que vous annoncez nous conduira à remodeler le présent texte. J'ai l'impression que nous sommes en train de faire du bricolage d'attente, si vous me permettez l'expression.
Cela n'a rien à voir !

Des faits divers certes dramatiques, médiatisés à souhait comme ceux survenus en 2004 à Pau et en 2008 à Grenoble ne sont tout de même pas si fréquents. Les personnes affectées de problèmes psychiques ne sont pas a priori dangereuses, comme vous semblez le penser, ainsi que le Président de la République, dès que vous commentez un fait divers majeur.
L'une des personnes auditionnées par la commission citait l'exemple de ces gens atteints de maladies cardiaques auxquelles on ne retire pas le permis de conduire et qui sont pourtant susceptibles, à la suite d'un malaise, de faucher des piétons sur un trottoir. On ne semble pas s'en émouvoir outre mesure alors que dès qu'il s'agit de problèmes psychologiques, cela devient une affaire d'État.
Nous devons de surcroît tenir compte de l'opposition de tous les professionnels – peut-être ne rencontrons-nous pas les mêmes – qui se montrent très motivés. Il serait donc utile et urgent d'attendre le véritable plan dont vous nous parlez.
(L'amendement n° 14 n'est pas adopté.)

Cet amendement vise à modifier la rédaction du titre du chapitre premier. Il semble en effet regrettable que figure dans le titre comme dans le contenu du texte un nombre considérable de locutions comme « fait l'objet » pour des personnes souffrant de troubles mentaux mais qui n'en demeurent pas moins des personnes. Il me semble qu'il s'agit d'une maladresse péjorative qui mérite d'être corrigée.
Il serait préférable d'écrire que ces personnes recevront des soins plutôt que d'écrire qu'elles en feront l'objet. M. le rapporteur, qui est un humaniste, devrait se montrer sensible à cette requête. (Sourires.)
Il s'agit d'une proposition certes symbolique mais importante de mon point de vue.

J'ai moi aussi défendu, hier, madame la secrétaire d'État, l'idée d'un plan de santé que nous attendons vivement. Nous pourrions imaginer qu'il s'agirait d'une loi importante avec le financement correspondant.
Pour répondre à notre collègue du groupe socialiste : un plan cancer a été décidé, qui n'est pas une loi et dont on reconnaît aujourd'hui qu'il a permis de véritables avancées dans la lutte contre cette maladie.

L'Institut national du cancer a bien été créé par une loi, monsieur Préel !

Un plan bien préparé peut se révéler intéressant.
Je souhaiterais, madame la secrétaire d'État, obtenir de votre part des réponses aux questions que j'ai posées hier.
Le présent texte correspond à un juste équilibre entre la liberté de la personne et sa protection, celle de ses proches et de la société. Il reste notamment des points important à examiner comme la composition du collège, qui me paraît assez – j'allais dire : « absurde » mais le mot est un peu fort –, étonnante :…

…on demande en effet à deux psychiatres de trancher un cas ; également comme la disponibilité des juges des libertés auxquels seront confiées de nombreuses responsabilités. J'espère que vos réponses permettront d'améliorer le texte.

Je suis toujours très sensible aux volontés de perfectionnement sémantique de notre collègue Préel…

Bien sûr que c'est important ! Ma thèse de médecine portait sur la sémantique…

Je suis heureux que vous ayez abandonné le terme « requérir » que vous aviez proposé en commission, monsieur Préel.
J'ai moi aussi recherché, dans ma grande humanité, à comprendre votre demande et j'ai trouvé que l'expression « faire l'objet de soins » était courante. J'en veux pour preuve le premier exemple donné par le Grand Robert – qui est tout de même une référence sérieuse – pour illustrer la locution « faire ou être l'objet de » : « Ce malade est l'objet d'une surveillance constante de la part de son entourage. »
L'amendement me semble par conséquent insuffisant, d'autant qu'il se contente de vouloir modifier le seul intitulé du chapitre Ier sans se soucier des autres occurrences au sein du texte.
Avis défavorable, donc, à cause du Grand Robert.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
Pour revenir au plan de santé mentale, il ne fera pas l'objet d'une loi. Vous êtes suffisamment avertis pour savoir qu'il existe de nombreux plans de santé publique – les plans cancer, Alzheimer, maladies rares, lancé récemment pour ce dernier… Ces plans sont financés et visent à mieux prévenir, mieux diagnostiquer, mieux prendre en charge les malades, à soutenir les familles, à aider à l'investissement dans les structures d'accueil. Bref, ils répondent à une approche globale.
Je rappelle que pour le plan de santé mentale 2005-2008, 287 millions d'euros de crédits de fonctionnement ont été déployés et 188 millions d'euros de subventions ont été accordés par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publique et privée.
Un plan ne se réduit pas à l'incantation mais prévoit des dispositions à appliquer dans l'intérêt des malades et de leurs familles.
De quels jeunes parlez-vous, de ceux qui ont des troubles psychiatriques ?

J'entends souligner à quel point j'ai été intéressé par l'exposé de M. Préel. Au-delà de la seule question sémantique, c'est presque de philosophie qu'il est question. Nous souhaitons tous que les personnes atteintes de troubles psychiques – qui peuvent durer des années voire toute une vie, depuis l'adolescence jusqu'à un âge très avancé – puissent devenir de plus en plus autonomes, libres, même si cela est compliqué.
Je suis d'accord avec Mme la ministre : nous savons bien que 85 % des soins en psychiatrie sont réalisés en dehors des structures hospitalières. Arrêtons un faux débat : nous ne sommes pas favorables à l'idée d'hospitaliser tout le monde mais à l'idée qu'il faut donner à l'hôpital et aux centres médico-psychologiques des moyens supplémentaires, ô combien nécessaires.
Il faut en effet trois mois, en moyenne, pour obtenir un rendez-vous avec un psychiatre dans un CMP et six mois quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents qui ne vont pas bien. Songez aux adolescents qui menacent de se suicider – du fait d'une crise d'adolescence ou de raisons profondes : ce ne sont pas les parents, ce ne sont même pas les généralistes qui peuvent le détecter mais le pédopsychiatre auprès duquel, j'y insiste, on ne peut obtenir de rendez-vous que dans un délai de six mois en moyenne.

Qu'il s'agisse d'un plan ou d'une loi, nous devons tout de même donner une réponse à une société qui va mal et à des personnels épuisés.
Je reviens sur l'intervention de M. Préel. L'expression : « faisant l'objet » implique l'idée d'un patient passif, contraire au principe d'autonomie, alors que « recevant des » implique l'idée un malade qui participe plus activement à son traitement voire à sa guérison.
Aussi, entre le Grand et le Petit Robert, je choisis le Jean-Luc. (Sourires.)

Il s'agit d'un amendement d'harmonisation rédactionnelle.
(L'amendement n° 108 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l'amendement n° 19 .

L'alinéa 14 traite de la possibilité de soins ambulatoires sans consentement et en particulier à domicile. Nous réitérons nos réserves sur la pratique des soins sans consentement notamment dans le domaine de la psychiatrie et rappelons à quel point ils doivent rester exceptionnels.
Si ces soins sans consentement sont appliqués en ambulatoire et a fortiori à domicile, nous nous interrogeons sur leur application et sur leurs chances de succès. Nous pensons que l'intérêt du patient commande que les soins en question soient dispensés dans des structures spécialisées avec des personnels compétents, qu'il s'agisse de centres médico-psychologiques ou d'hôpitaux de jour, qui sont des lieux de soins au sens large, où l'on parle, des lieux où l'on mesure l'état du patient, des lieux de rencontre, d'activités de socialisation indispensables au succès thérapeutique.
C'est pourquoi nous vous demandons, d'une part, de développer ces lieux sur tout le territoire, car nous en manquons cruellement…

…– ce doit être en effet l'une des dispositions prévues par le plan promis par Mme Berra –, et, d'autre part, de renforcer les moyens, qui font dramatiquement défaut, des quelques centres existant.
C'est aussi pour cette raison que cet amendement vise à compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante : « La prise en charge dans les centres médico-psychologiques et les hôpitaux de jour est privilégiée lorsque l'état du patient le permet. »

Pour le coup, très défavorable. J'examine toujours les amendements de Mme Fraysse avec la plus grande attention car si nous ne sommes pas toujours d'accord sur les moyens, nous nous rejoignons quant aux objectifs de la prise en charge du patient.
Je suis quelque peu surpris, car vous avez beaucoup insisté en commission et au cours de la discussion générale sur le fait qu'à vos yeux nous ne laissions pas suffisamment de place aux psychiatres. Or vous voulez, ici, imposer d'emblée des choix thérapeutiques aux psychiatres.

Je suis personnellement défavorable à cet amendement n'a pas été examiné par la commission.
Dans le cadre du protocole de soins, c'est au psychiatre de décider, en fonction du patient, de la pathologie et du lieu où il sera, si le CMP est préférable ou s'il convient plutôt d'accueillir le patient dans d'autres structures.

Que le législateur impose d'emblée au psychiatre l'endroit où le patient devra être accueilli, cela me semble aller à l'encontre de ce que vous proposez, et de ce que nous voulons tous, à savoir le libre choix des décisions thérapeutiques par le psychiatre.
Je rejoins l'avis du rapporteur. Les modalités de prise en charge, madame Fraysse, relèvent bien d'une décision médicale, en fonction de l'état clinique du patient. C'est bien au médecin de choisir l'outil thérapeutique le plus approprié.
Au niveau des territoires, les agences régionales de santé élaborent le schéma régional d'organisation des soins, et elles mettent donc à la disposition des patients différentes modalités possibles de prise en charge. C'est bien parmi celles-ci que le médecin choisit la meilleure alternative possible, la plus adaptée à l'état clinique du malade.

On ne peut être d'accord avec l'argumentation développée par le rapporteur. Mme Fraysse, au contraire, reconnaît la compétence spécifique du psychiatre quand il est fondamental pour ses patients d'avoir une prise en charge spécialisée. Il est donc tout à fait important de prendre en compte cet amendement.
Cela est d'autant plus important qu'il faut répondre à la nécessité de mettre en place les moyens suffisants pour la prise en charge de ces patients. Nous savons, par exemple, que le nombre de psychiatres en hôpital public est malheureusement lamentable. Vous nous annoncez un plan, madame la secrétaire d'État. Pourriez-vous nous dévoiler quelque peu ses contours, en particulier s'agissant des moyens qui seront mis en oeuvre par le Gouvernement pour traiter du sujet de la santé mentale, sachant, par ailleurs, que votre prédécesseur nous avait clairement annoncé un projet de loi ?

Je voudrais à mon tour dire combien la réponse du rapporteur me surprend. L'alinéa 14 évoque des soins ambulatoires « pouvant » comporter des soins à domicile. Ce n'est qu'une possibilité. Je propose d'ajouter que la prise en charge dans les centres médico-psychologiques et les hôpitaux de jour doit être privilégiée aussi souvent que possible. Cela ne remet nullement en cause le fait que c'est bien sûr au psychiatre qu'il appartient de décider du traitement. La compétence des psychiatres n'est pas du tout remise en cause, au contraire, puisque ceux-ci, dans ces structures, exercent dans des équipes pluridisciplinaires, et dans des conditions qui me paraissent très favorables aux patients.
C'est donc une alternative aux soins à domicile. J'entends bien que vous ne souhaitez pas retenir cette proposition. Je comprends bien que les soins à domicile, cela coûte moins cher que l'accueil dans les CMP ou dans les hôpitaux de jour. C'est clair. Et je regrette que Mme la secrétaire d'État n'ait pas développé davantage sa réponse pour nous dire comment elle compte faire pour développer les CMP et hôpitaux de jour sur l'ensemble du territoire – car il y a une grande inégalité territoriale, s'agissant des réponses de ce type – et comment elle peut donner des moyens supplémentaires pour ceux qui souffrent beaucoup.
Des CMP te hôpitaux de jour, j'en ai visité deux, il n'y a pas très longtemps, dans le département de Seine-Saint-Denis, où ils manquent de psychologues, notamment. J'aurais préféré une réponse sur cette question à celle que j'ai reçue, qui ne me paraît pas très convaincante.
Il ne me paraît pas pertinent de faire figurer dans la loi une disposition prévoyant qu'il faut privilégier un mode de prise en charge par rapport à un autre. C'est vraiment remettre en question le professionnalisme des médecins.
Eux seuls savent quelle est la meilleure prise en charge pour leur malade, en fonction de son état clinique. Ce n'est pas du registre législatif, malheureusement. Il s'agit ici de bonnes pratiques. Faisons confiance aux médecins, qui sauront apporter la meilleure réponse possible.
Quant au plan, vous me demandez des précisions. Mais depuis quand avons-nous l'habitude de vous présenter un plan élaboré au niveau gouvernemental et mis en oeuvre à l'échelle des territoires ? Nous respecterons la démarche qui a prévalu jusqu'à présent : la concertation, l'échange avec les professionnels, les usagers, les associations de patients, pour aboutir à des solutions concrètes, les plus adaptées, les plus appropriées, qui devront être mises en oeuvre au profit des patients. Il ne s'agit pas ici de « pondre » quelque plan que ce soit, élaboré au niveau gouvernemental. Le plan doit être le fruit d'un travail concerté avec les différents acteurs de la santé mentale et avec les patients.

Ce que vous nous dites là, c'est le contraire du texte que vous nous proposez !

Sur ce qu'a dit Mme Fraysse, deux remarques. Je suis d'accord – nous avons d'ailleurs adopté en commission des amendements que vous avez déposés et qui vont dans ce sens – pour privilégier les soins libres par rapport aux soins sous contrainte. Sur ce point, je vous suis parfaitement, parce qu'il s'agit de la forme de la prise en charge. Par contre, quand on entre dans le détail, les choix qui doivent être faits ne me semblent pas être du ressort du législateur, mais du psychiatre, ou, éventuellement, des recommandations de bonne pratique. Cela ne relève pas du législateur.
Par ailleurs, certains ont parfois tendance à faire un amalgame entre soins ambulatoires et soins à domicile. Je vous rappelle que les soins ambulatoires, c'est l'ensemble des soins qui ne se pratiquent pas à l'hôpital. Le domicile n'est qu'une possibilité parmi d'autres, mais rien n'est gravé dans le marbre. Encore une fois, c'est le psychiatre, avec son équipe soignante, dans le cadre du protocole de soins, qui examinera avec le patient la question de savoir s'il est possible ou pas de lui donner des soins à domicile. Évitons cet amalgame que l'on entend parfois – je ne dis pas que vous l'avez fait, madame Fraysse, mais je profite de l'occasion que vous me donnez pour revenir sur ce point – entre soins à domicile et soins ambulatoires.

Je trouve ces réponses inquiétantes. Dans le nouveau règlement de l'Assemblée nationale, on prévoit que des études d'impact doivent être réalisées sur les projets de loi dont nous sommes saisis. En l'espèce, l'étude d'impact accompagnant ce texte précise – je n'invente rien, monsieur le rapporteur, je ne fais que lire ce qui est écrit à la page 7 – que « l'offre ambulatoire comprend essentiellement les prises en charge en centres médico-psychologiques » et que le CMP reste « le dispositif pivot du secteur ». Par conséquent, je ne vois pas en quoi l'amendement de Mme Fraysse est irrecevable. Il y a des choses que je ne comprends pas. Ou alors, modifions le règlement de l'Assemblée et mettons fin aux études d'impact !
(L'amendement n° 19 n'est pas adopté.)

Je voudrais repartir de ce qu'a dit excellemment Mme la secrétaire d'État : « Faisons confiance aux médecins ». Cet amendement nous donne une bonne occasion de traduire cette parole dans les actes.
Il s'agit du fameux protocole de soins qui est prévu par cet article 1er dans son alinéa 15. C'est une nouveauté. Ce protocole est établi lorsque les soins prennent la forme de soins ambulatoires. En commission, nous avons fait quelques observations sur ce protocole de soins. Nous demandons surtout qu'il puisse être révisable. Je crois que c'est un oubli, tout simplement. La médecine évolue, de même que les médicaments et les modes de traitement. L'âge du malade peut faire que ce qui était possible – ou impossible – à un moment donné ne le soit plus, ce qui appelle une révision du protocole. Celle-ci peut être nécessaire tout simplement parce que le patient va mieux, et que, par exemple, on l'avait astreint à prendre des neuroleptiques retard qui peuvent être maintenant abandonnés. Il se peut, autre exemple, que ses troubles bipolaires aient fait place à une situation d'équilibre.
Vous allez me dire qu'il est évident que le médecin doit adapter le protocole en fonction des évolutions. Mais si, demain, les médecins estiment que le patient peut ne plus venir au CMP qu'une fois par mois au lieu de tous les quinze jours, parce qu'il va nettement mieux, parce qu'il est réinséré, ils peuvent se heurter à l'impossibilité de réviser le protocole de soins. Si nous n'inscrivons pas cette possibilité dans la loi, il risque d'y avoir des difficultés.
Il me paraît donc de bon sens de prévoir que le protocole de soins pourra, pour des raisons médicales, être révisé.

Avis défavorable. Nous avons déjà largement débattu de ce sujet lors de nos travaux en commission. Je vais reprendre, monsieur Blisko, les arguments que je vous avais opposés alors.
Tout d'abord, vous proposez de préciser que « ce protocole de soins est établi dès le choix de la forme de la prise en charge durant le délai de soixante-douze heures », c'est-à-dire à l'issue de la période d'observation. Sur ce point, votre amendement est satisfait, je pense que vous en serez d'accord, par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2.
Le second aspect de cet amendement est la faculté de réviser ce protocole. Comme Mme la secrétaire d'État l'a excellemment dit tout à l'heure, l'élaboration du protocole relève de la responsabilité du psychiatre. De cette élaboration découle la forme de la prise en charge, et même si cette forme n'évolue pas, rien dans le texte ne dit que le psychiatre n'a pas le droit de réviser le protocole. Il peut le faire quand bon lui semble. Sans aucune mauvaise foi, votre amendement est satisfait par ce texte, monsieur Blisko. C'est pourquoi j'y suis défavorable. Je vous proposerai même, dans votre grande sagesse, de le retirer.
Même avis que le rapporteur.

Il sera donc noté dans le compte rendu de nos débats que le protocole est révisable.
(L'amendement n° 77 n'est pas adopté.)

Le but de cet amendement est de limiter le nombre des certificats médicaux qui sont prévus tout au long de ce texte. L'important est le protocole de soins établi à l'issue de la période de soixante-douze heures. Cet amendement maintient bien sûr le certificat établi dans ce cadre. Mais il supprime le certificat du huitième jour, et prévoit un certificat établi au plus tard le huitième jour précédant la fin de chaque période d'hospitalisation complète de six mois à compter de la décision judiciaire, cette durée de six mois étant par ailleurs prévue dans le texte.
Le but est de limiter le nombre de certificats à ce qui est vraiment nécessaire.

Défavorable, même si la question que pose Jean-Luc Préel est effectivement importante. Je l'ai dit en commission, je me suis longtemps interrogé sur ce nombre de certificats médicaux désormais requis dans le cadre des missions de soins sans consentement. J'ai moi aussi réfléchi à la possibilité d'en supprimer un. Mais lequel ? Va-t-on supprimer le certificat des vingt-quatre heures ? Dans ce cas, on pourrait dire que nous sommes liberticides. Il me semble fondamental qu'un patient qui a été hospitalisé sans son consentement, et parfois avec des moyens de contention importants, bénéficie dans les vingt-quatre heures de l'examen par le psychiatre.
S'agissant du certificat des soixante-douze heures, je rappelle que ce délai est un élément fondamental de l'architecture du projet de loi. Il paraît difficile, aujourd'hui, de supprimer ce certificat. C'est celui qui matérialise la fin de la période d'observation.
Vous proposez donc, monsieur Préel, la suppression du certificat établi au huitième jour. On sait que la moitié des patients hospitalisés sans leur consentement sortent, justement, au terme de cette période de huit jours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission a adopté un amendement prévoyant l'information du juge sur ce certificat.
Je sais que l'élaboration de ces nombreux certificats médicaux va représenter une charge administrative importante pour les psychiatres. Mais n'oublions pas l'objet de ce projet de loi, qui figure d'ailleurs dans son titre : il s'agit d'améliorer les droits des patients. Le fait de prévoir davantage de certificats médicaux constitue peut-être aussi, pour le patient, la garantie qu'il sera examiné régulièrement et que la poursuite des soins est parfaitement justifiée.
En outre, le certificat établi au plus tard au huitième jour n'est pas vraiment un nouveau certificat. Autrefois, le certificat était établi à J + 15. Aujourd'hui, par concomitance avec l'intervention du juge des libertés et de la détention, sa production a été avancée à J + 8. Nous sommes donc, finalement, dans la même architecture.
Mais ce qui m'inquiète le plus, et je suis persuadé que ce dernier argument vous amènera à retirer votre amendement, c'est qu'en supprimant ce certificat, on supprimerait tout certificat entre la fin de la période d'observation de soixante-douze heures et la fin du premier mois d'hospitalisation. Pour le coup, ce serait une régression certaine du droit des patients. Le dispositif que vous proposez, que vous complétez deux amendements de coordination aux articles 2 et 3, ne me paraît pas acceptable sur le fond.
Sur la forme enfin, deux des dispositions proposées par votre amendement sont satisfaites dans le projet de loi : je veux parler de la transmission au directeur de l'établissement de santé et au préfet du certificat médical produit à l'issue de la période d'observation, et de la transmission au juge d'un avis médical avant la saisine automatique tous les six mois.
Je vous propose donc, compte tenu de ces arguments, de retirer votre amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable.

Je le maintiens, madame la présidente.
(L'amendement n° 56 n'est pas adopté.)

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour défendre l'amendement n° 20 .


Il s'agit de renforcer dans le texte, et dans la vie, le caractère exceptionnel, nous en sommes tous d'accord, du recours aux soins sans consentement.
L'amendement n° 20 propose de supprimer les mots « et de soins » dans l'alinéa 17 de l'article 1er du projet de loi. L'amendement n° 94 ajoute quant à lui après le même alinéa : « Pendant cette période, aucun soin ne peut être administré sans le consentement du patient, sauf en cas d'existence avérée d'une nécessité impérieuse de soins. »
Ces amendements, sans modifier le fond du texte, précisent clairement que l'on recherche par tous les moyens le consentement du patient, et qu'on ne lui administrera des soins sans son consentement qu'après avoir constaté une existence avérée de la nécessité impérieuse de ces soins, en raison notamment du danger que son état pourrait constituer pour lui-même.

Avis défavorable : nous avons sur ce point un vrai désaccord de fond. Si nous nous contentions, comme vous le proposez, d'observer le patient sans lui apporter aucun soin, nous serions dans le cas d'une garde à vue psychiatrique : on l'enferme et on attend de voir ce qui se passe, en espérant qu'il va se calmer. Aucun soin, cela signifie aucun médicament, mais aussi aucune prise en charge sur le plan psychothérapique ; autrement dit, le patient ne verra pas de psychiatre. J'avoue être un peu surpris… Je sais que certaines associations un peu marginales défendent ce point de vue ; pour ce qui me concerne, en tant que médecin et en tant que député, je ne peux qu'être totalement défavorable à cette garde à vue psychiatrique que vous créeriez.

Je veux corriger les propos excessifs de notre rapporteur : je suis clairement contre la garde à vue psychiatrique.

Mes amendements ne proposent pas ce que vous suggérez. L'amendement n° 20 supprime la mention aux soins, mais l'amendement n° 94 ajoute que des soins sans consentement peuvent être appliqués en cas d'existence avérée d'une nécessité impérieuse de soins.
Il n'est donc pas question de supprimer les soins, mais de renforcer l'idée que, quel que soit l'état du patient, tout aura été fait pour obtenir son accord. Et si celui-ci n'est pas obtenu, c'est seulement s'il y a danger pour lui-même qu'on lui infligera des soins contre son gré. Il ne s'agit évidemment pas d'enfermer un patient sans soins pour le contempler ou le punir. Tout au contraire, nous sommes dans une démarche de respect maximum de la personne.

Cela devient encore plus complexe : on n'administre des soins que s'ils sont nécessaires… Je veux croire qu'aucun psychiatre ne proposera des soins inutiles !
Par ailleurs, comment va-t-on justifier de cette « nécessité impérieuse » de soins ? Faudra-t-il un autre certificat pour montrer qu'ils sont absolument justifiés et indispensables ? Tout cela paraît embrouillé, et pour tout dire très compliqué, sans apporter grand-chose à l'intérêt du patient.
Moi non plus, je ne comprends vraiment pas l'objectif de cet amendement et je suis assez surprise en tant que médecin. Voilà un patient hospitalisé avec des troubles mentaux avérés, constatés par des psychiatres, et en demande de soins,…
Il faudrait ne lui proposer aucune alternative au nom du respect de la décision du patient ? Pour ma part, je considère, c'est une question d'éthique, que l'accès aux soins est un droit fondamental. Le malade a le droit d'être soigné quand son état le nécessite. Donc, je suis profondément défavorable à ces deux amendements.

Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais il est grand temps de sortir de ces jeux de mots. Il est bien évident que Mme Fraysse ne souhaite pas que les gens soient laissés sans soins ! Ce serait contraire à toute éthique, non seulement des médecins, mais aussi de tous ceux qui voient les autres souffrir. Bien évidemment, nous souhaitons tous que les meilleurs soins possibles soient accordés, et personne n'a envie ici de regarder les patients sans leur prodiguer aucun soin, tel un entomologiste observant un insecte. Cela n'a pas de sens.
Ce que nous souhaitons, et c'est l'esprit de ces deux amendements qui se complètent, c'est que l'on essaie par tous les moyens d'éviter la coercition. C'est ce que Mme Fraysse a expliqué dans son exposé des motifs.

Le manque de personnel, le manque de moyens, l'absence ou l'insuffisance de formation, l'insuffisance du temps consacré à un certain nombre de patients, dans des conditions malheureusement très tendues en hospitalisation, et en particulier en hospitalisation d'urgence où l'on est souvent très pressé par ce qui se passe à la porte de l'hôpital ou du service d'accueil des urgences, tout cela milite pour écarter l'idée d'une une démarche coercitive…

…sauf si l'on y est vraiment obligé avec un patient très agité qu'il faut désarmer. Cela arrive, cela nous est tous arrivé ; nous savons que ce peut être un moment long, voire difficile, et ce ne peut être l'affaire que d'une équipe soignante bien entraînée, pas simplement d'une personne ou d'une infirmière débordée.
M. le rapporteur nous l'avait dit lors des débats en commission : quand il y a un infirmier psychiatrique formé dans un service d'accueil des urgences, 80 % des querelles entre des gens qui jurent ne pas être malade et l'équipe médicale se règlent en quelques heures, parce que ces équipes ont été formées au dialogue. Elles peuvent leur qu'ils ne vont pas trop bien, qu'ils ont un problème dont il faut parler.
L'esprit des amendements de Mme Fraysse est de privilégier ce dialogue, qui est finalement la meilleure chose que l'on puisse connaître dans l'éthique médicale de notre pays. Rappelons qu'il y a des pays où l'on enferme les gens, et qu'on ne les soigne pas s'ils ne sont pas d'accord. Et je parle de pays voisins, non de dictatures.
Il y a là quelque chose de fondamental : il faut toujours privilégier la recherche du consentement. C'est l'esprit de la loi de 2002 sur le droit des malades. Nous savons que c'est dans ce domaine de la psychiatrie que se concentrent toutes les difficultés de la recherche du consentement, face à des patients parfois très oppositionnels, ou dans le déni de la maladie.
Le président de l'UNAFAM le dit souvent : la maladie mentale, c'est une pathologie de la liberté. Essayons donc de travailler à partir de ces notions simples, et de dire qu'on ne force pas le malade, nous y sommes malheureusement obligés mais essayons de faire que ces cas soient les plus rares possibles.

Je suis prête à entendre M. le rapporteur considérer mes amendements superflus même si je ne partage pas ce point de vue : je persiste à les croire utiles. En revanche, je ne peux admettre que l'on nous accuse de vouloir priver les patients de soins. Et je ne dis rien de la réponse de Mme la secrétaire d'État, que je préfère ne pas qualifier.

Nous voulons seulement renforcer la protection du choix de la personne, en donnant acte que dans certains cas, hélas, et malgré tous les efforts d'équipes compétentes, on n'y parvient pas, et alors on lui inflige des mesures de coercition. Ce n'est en fait qu'une précision rédactionnelle, pour insister davantage sur les droits de la personne, en parfaite cohérence avec le titre du texte, tel qu'il est rédigé ; reste que nous avons une divergence d'appréciation sur ce point.

Je veux bien donner acte à Mme Fraysse qu'elle n'a certainement pas voulu créer une garde à vue psychiatrique. Je vais donc dire les choses autrement : nous ne sommes pas ici pour réécrire le code de déontologie médicale ; or ce que vous dites entre dans le cadre de la déontologie médicale.


L'amendement n° 76 porte sur le point fondamental que constituent ces soixante-douze heures d'observation. Il ne s'agit pas d'une observation « neutre », je ne soupçonnerai jamais M. Lefrand de vouloir instaurer une période d'observation de soixante-douze heures sans aucun abord thérapeutique. Reste que ce délai est très long. L'établissement du deuxième certificat médical devrait intervenir dans les quarante-huit heures. L'expérience montre qu'avec l'expérience dont nous disposons, et des équipes bien entraînées, quarante-huit heures suffisent, même si je vous accorde qu'on ne trouve plus beaucoup d'équipes bien entraînées ! Mais nous espérons tous que le plan nous permettra de remonter la pente… Et une fois que nous serons sur la bonne pente, quarante-huit heures devraient suffire.
Je vous ai donné hier l'exemple de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Je n'ai pas l'habitude de citer cet endroit, considéré comme très sécuritaire à Paris, mais il leur suffit de quarante-huit heures. Dieu sait que les malades amenés là-bas, souvent des hospitalisations d'office sur la voie publique, ne sont pas des plus faciles : on voit des gens qui profèrent des menaces, qui parfois même sont passés à l'acte. C'est là qu'avait été immédiatement amené l'individu qui avait tiré sur le Président de la République Jacques Chirac le 14 juillet 2002. C'un établissement à la fois policier et médical, avec une garde périmétrique et une équipe de psychiatres, un établissement unique, très original, et sur lequel nous nous interrogeons beaucoup…

En effet, et nous souhaiterions qu'il n'en existe plus aucun de la sorte. Reste que, aux dire du préfet de police, au terme de quarante-huit heures, ils savent à quoi s'en tenir, et ils peuvent remettre la personne dans la rue ou à sa famille, ou la faire passer en hospitalisation libre, parce qu'elle s'est calmée et reconnaît qu'il y a eu un problème, ou la garder en hospitalisation d'office et la transférer dans un hôpital psychiatrique. Il est même possible de décider d'une hospitalisation à la demande d'un tiers si l'on a retrouvé la famille.
Je pense donc que les quarante-huit heures sont largement suffisantes, si l'on en croit l'expérience des psychiatres, pour savoir à qui l'on a à faire. Qui plus est, les traitements actuels permettent, après ces deux jours, de disposer de premières indications.

Je ne suis pas persuadé que l'IPPP soit le modèle à défendre pour la prise en charge de personnes souffrant de troubles mentaux et nécessitant une prise en charge sanitaire… Votre comparaison ne me paraît pas la meilleure !
Tout le monde ne s'accorde pas, nous l'avons vu tout à l'heure, sur le contenu de la période d'observation, sur le fait de savoir si elle se situe ou non en amont des soins sans consentement. Reste qu'un consensus se dégage pour dire que cette période initiale d'observation, sous la forme d'une hospitalisation complète, est nécessaire.
Je rappelle que, durant ce délai de soixante-douze heures, il faut tout à la fois organiser l'observation du patient, sa prise en charge médicale, psychothérapeutique, etc., et surtout élaborer le protocole de soins. Je crains que votre amendement, qui part effectivement d'une bonne intention, ne soit quelque peu contre-productif : le psychiatre peut ne pas avoir forcément eu le temps d'élaborer en quarante-huit heures le protocole de soins. Si vingt-quatre heures sont nécessaires pour que le patient se calme, il ne lui restera plus que vingt-quatre heures pour discuter avec lui. Quand pourra-t-il élaborer le protocole de soins ? J'estime que les soixante-douze heures sont indispensables pour rédiger le protocole de soins. Au demeurant, nous avons recueilli assez peu de critiques sur ce délai lors des auditions auxquelles nous avons procédé.
J'ai peur que, à la marge, votre amendement n'ait – involontairement – un effet pervers : si le psychiatre n'a pas le temps d'établir le protocole de soins en quarante-huit heures, il ne laissera pas le patient ressortir. À la limite, il le gardera en hospitalisation, car il n'aura pas eu les soixante-douze heures qui lui auraient permis d'observer convenablement le patient et d'organiser la prise en charge. La période de soixante-douze heures est déjà assez courte pour élaborer le protocole et trouver le centre médico-psychiatrique capable de l'accueillir et d'organiser le suivi ; autant dire que le délai de quarante-huit heures que propose l'amendement n° 76 est bien trop bref..
Pour toutes ces raisons, l'avis de la commission est défavorable.
Même avis que le rapporteur.

Monsieur le rapporteur, j'ai bien entendu vos remarques frappées au coin du bon sens, mais elles ne font que traduire les difficultés d'application de la loi : vous sophistiquez et compliquez une problématique dont vous savez, quelque part, qu'elle ne sera pas appliquée.
Les contraintes que vous imputez assez justement aux quarante-huit heures, nous les retrouverons en fait avec les soixante-douze heures. Vous étiez défavorable tout à l'heure à l'amendement permettant d'impliquer les CMP dans le projet de soins, soutenant que cela ne dépendait que du psychiatre. Ce faisant, vous avez commis une assez belle erreur : cet amendement ne forçait pas la main au psychiatre, mais aux CMP, afin qu'il soit inscrit dans la loi que ces structures ont vocation à recevoir ce type de malades. En effet, nous le savons, c'est vrai en psychiatrie comme dans tout le système du parcours de soin hospitalier, les services refusent les malades et se les repassent des uns aux autres.
S'il n'est pas inscrit dans la loi qu'il est de leur responsabilité de recevoir ce type de malade, on retrouvera la tendance naturelle des services, déjà très largement débordés, à refuser à ce type de malades de venir en CMP. C'est tout le problème des parcours de soins qui est posé.
En reprenant, de façon pragmatique, les arguments de Serge Blisko, vous faites bien de dire que ce qui est vrai en quarante-huit heures ne le sera pas en soixante-douze. En revanche, les quarante-huit heures montrent bien qu'il y aurait une cohérence avec la problématique des droits individuels.
(L'amendement n° 76 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 40 .
La parole est à M. le rapporteur.

Amendement rédactionnel.
(L'amendement n° 40 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)


L'amendement n° 21 tend à rédiger l'alinéa 26 qui définit le droit des malades et prévoit l'information du patient faisant l'objet d'une mesure sans consentement, dans la mesure où son état le permet, pour tout projet de décision concernant la levée ou la poursuite de la mesure de soins ou la forme de cette prise en charge en hospitalisation ou en ambulatoire.
Il nous paraît juste d'informer le patient. Mais nous proposons également que cette obligation d'information s'étende à la famille ou à la personne de confiance, désignée préalablement par le patient, si celle-ci existe bien évidemment, de manière à impliquer son entourage dans les décisions prises. Cette implication pourrait aider le patient à accepter son état et son traitement. C'est pourquoi il nous semble nécessaire que la famille et la personne de confiance fassent partie de celles et ceux qui reçoivent l'information.

La parole est à M. Philippe Armand Martin, pour défendre l'amendement n° 95 .

L'amendement n° 95 va dans le même sens que celui défendu par Mme Fraysse. Son objectif est d'étendre le droit à l'information à destination de la famille, des personnes de confiance ou encore des proches de la personne faisant l'objet de soins psychiatrique sans son consentement.

La commission a repoussé ces amendements, irréalistes dans leur principe. Une information préalable systématique de la famille, le recueil de ces informations avant d'envisager l'hospitalisation et la prise en charge du patient ne seraient pas toujours possibles ni même souhaitables.
Nous savons qu'en cas d'hospitalisation sous contrainte de patients souffrant de troubles mentaux, le rôle de la famille nécessite une grande attention. Cette obligation aurait surtout pour conséquence de retarder la prise en charge et les soins.
Je rappelle que la famille est tenue informée de la mission de soins dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision. Ce n'est pas très long et cela permet une prise en charge. Ensuite, le rythme de décision du maintien est fixé dans la loi. Pour une modification de prise en charge dans le cadre d'une admission à la demande d'un tiers, le tiers en question est informé par le directeur de l'établissement. Dans le cas d'une admission en soins sur décision du représentant de l'État, le préfet doit en informer la famille dans les vingt-quatre heures.
Aujourd'hui, les choses me paraissent bien encadrées. Je vais me permettre de reprendre votre argument et vous indiquer que votre amendement est un peu superfétatoire en ce qui concerne le recueil systématique de l'avis de la famille préalablement à la prise de la décision. Cela me paraît un peu excessif.
Ce qui me gêne le plus – nous en avions parlé en commission, madame Fraysse –, c'est la suppression de la mention « dans la mesure où son état le permet ». Je ne vous suivrai pas sur ce point. Vous avez quelque peu modifié cette disposition. J'avoue qu'il me paraît excessif de donner systématiquement l'information au patient ou à la famille, quel que soit l'état du patient.
Je comprends bien les principes d'humanité qui ont guidé M. Decool et ses collègues, mais nous restons fidèles à notre argumentaire. Je suis obligé de demander le retrait de l'amendement n° 95 . Sinon, avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
L'information de la personne de confiance est déjà satisfaite. L'article L. 1111-6 du code de la santé publique prévoit que, si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux. Dans ces conditions, si le patient le désire, la personne de confiance peut disposer en même temps que le patient de toutes les informations concernant sa prise en charge, qui lui sont délivrées au cours des entretiens prévus à l'article L.3211-3, tel qu'il résulte du présent projet de loi.
Pour ce qui a trait à l'information de la famille, le projet de loi n'entend pas la systématiser. La communication à la famille de toute décision concernant le patient ne serait pas forcément justifiée, car la notion même de famille est particulièrement complexe à aborder. Les modèles familiaux sont devenus très divers du fait de l'évolution de la société. De plus, les liens du patient avec ses proches peuvent être distendus et il convient de respecter le choix du patient qui ne souhaiterait pas que sa famille ait connaissance des décisions qui le concernent. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a été prévue la notion de « personne de confiance », qui prend tout son sens en psychiatrie.
Dans le cas des personnes maintenues en soins sans consentement sur demande d'un tiers, le projet de loi a néanmoins retenu la nécessité d'informer, au-delà de la personne de confiance, la personne qui a fait la demande de soins, de tout passage à une prise en charge extra- hospitalière et de toute levée de la mesure de soins.
Puis pour les personnes en soins sans consentement sur décision préfectorale, la famille est avisée de toute admission et de toute décision de maintien de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète et de toute levée.
Les modalités particulières d'information des proches apparaissent donc équilibrées entre le droit du patient au respect de son intimité, de son libre choix et la nécessité d'informer certains proches lorsque des décisions particulièrement importantes et susceptibles de les concerner directement sont prises.

Je pensais, en déposant cet amendement, que l'information de la personne de confiance avant la décision ne pouvait qu'être utile à l'équipe soignante pour faire le bon choix. Avant de prendre une décision définitive, l'équipe soignante peut informer la famille de ses intentions et recueillir un avis qui peut justement aider à la prise de cette décision.
Vous m'avez fait observer, à juste titre, en ce qui concerne l'information du patient, que mon amendement supprimait le membre de phrase : « si l'état du patient le permet ». Il y a lieu de bien peser cette formule : si l'état du patient est tel qu'il ne comprend pas ou qu'il ne peut pas recevoir raisonnablement, au sens de la raison, la décision thérapeutique, ce n'est pas grave : rien n'interdit d'expliquer à un patient, quel que soit son état, ce que l'on envisage le concernant. Si son état est très sévère, mais qu'il peut comprendre quelque chose, l'informer est préférable au silence.
Si le patient est en état de crise grave, peut-on pour autant se passer de lui expliquer ce que l'on envisage à son égard ? Je crois qu'on peut le lui dire. Cela n'aura peut-être pas d'effet et il ne comprendra peut-être pas, mais ce n'est pas grave. S'il comprend, c'est bien. Il me semble en tout cas qu'il faut y réfléchir.


Avant de retirer l'amendement n° 95 , notre collègue aurait pu essayer non seulement d'entendre un certain nombre d'arguments du rapporteur, qui ne sont pas inexacts, et intégrer dans le même temps leur démarche première qui avait une raison d'être.
Les arguments sont justes concernant la famille. Le secret médical implique plutôt la protection de la personne par rapport à sa famille.
Du reste, et l'argument doit être entendu par les auteurs de l'amendement, on pourrait même se demander s'il faut prévenir la famille ; mais dans le cas présent, la situation est différente dans la mesure où une personne va recevoir des soins sans consentement. Dès lors, dans la mesure où l'on peut supposer que cette personne est dans le déni de sa propre maladie, et sachant que la loi relative aux droits des malades renforce l'idée que ce n'est pas le médecin et encore moins l'État qui choisissent la stratégie médicale, il n'est pas inconcevable de rechercher le consentement si cela est possible et si cela est considéré comme souhaitable par l'équipe médicale, ne serait-ce que pour asseoir sa propre légitimité. Dès lors, le médecin doit avoir, non pas l'obligation, mais la liberté, s'il pense que c'est utile, d'informer la famille.

On inverse, en quelque sorte, la problématique. Cette idée est d'autant plus légitime qu'il pourrait, au moins en théorie, compte tenu de l'état du malade, ne pas informer la famille de ses décisions. Il suffirait de réécrire l'amendement en indiquant que, dans le cadre de la responsabilité médicale, la famille « peut » – et non plus « doit » – être informée.

On devine tout le bénéfice d'une telle rédaction et combien elle pourrait apaiser l'angoisse et le traumatisme de la famille. Seriez-vous alors disposé à reconsidérer votre avis, monsieur le rapporteur ?

Une fois de plus, nous sommes dans le domaine de la rédaction du code de déontologie médicale… D'ores et déjà, les médecins ont la possibilité d'informer autant que faire se peut la famille.
Votre remarque, madame Fraysse, est juste et pose une vraie question sur la formulation « lorsque l'état de la personne le permet ». Ce qui me gêne dans vos propos, c'est lorsque vous dites : « Peu importe si la personne comprend ou non, on va l'informer ».

Ce peut être pour le médecin un moyen commode de se dédouaner : il suffirait d'appliquer strictement le code, un peu comme dans les films américains où on lit ses droits à l'intéressé sans se préoccuper de savoir s'il est en mesure de les comprendre.

C'est exactement ce que vous avez dit, madame : même si la personne est en crise, on lui lit ses droits. Et sur ce point, nous sommes en désaccord. Pour expliquer à quelqu'un ce qu'on a décidé pour lui et ce qui va se passer, il faut que cette personne soit consciente.
Cela étant, je suis d'accord avec vous pour considérer que le sujet mérite d'être débattu.

Dans ma pratique, je n'ai jamais vu un médecin – et c'est bien la preuve que le code de déontologie s'applique – envoyer un patient à tel ou tel endroit sans le lui dire.

Même si le patient est en crise, nous nous adressons à lui, nous le prévenons que nous allons faire ceci, que nous allons lui demander cela etc. Peut-être ne nous écoute-t-il même pas, mais c'est ce que nous faisons toujours. Il est donc normal de préciser dans la loi que ces patients, quel que soit leur état, doivent être informés des décisions que l'on prend pour elles et, de surcroît, de ce que l'on envisage de leur imposer.

Je partage le point de vue de Mme Fraysse. Ces patients si violents et si agités soient-ils ne sont pas, dans la plupart des cas, inconscients.

Ils sont parfaitement conscients.
Quelqu'un est intervenu tout à l'heure pour souligner l'importance du personnel spécialisé : le psychiatre, l'infirmière de psychiatrie, même si la spécialité n'existe plus, en tout cas celle qui maîtrise de cet exercice, le ou la psychologue. Eux seuls sont capables, dans un temps relativement court, de ramener le patient au calme alors que la contention physique peut être source d'angoisse et peut contribuer à accroître l'agressivité du patient.
La proposition de Mme Fraysse est tout à fait appropriée. L'obligation d'informer le patient, sa famille ou les proches relève du respect de la personne humaine et du code de déontologie.
(L'amendement n° 21 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 22 .
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Cet amendement s'inscrit dans la même démarche que le précédent : il s'agit d'informer la famille du patient ou la personne de confiance.

Même avis défavorable que précédemment : cet amendement est déjà en grande partie satisfait. Il est prévu d'informer la famille dans les vingt-quatre heures suivant la décision.
Avis défavorable.
(L'amendement n° 22 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 23 .
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Sans revenir sur tout ce qui a été dit sur le sujet, je veux insister sur les conséquences concrètes d'un tel amendement, madame Fraysse, notamment sur le recueil de la preuve que l'information a bien été donnée à un patient qui n'était pas en mesure de la recevoir et de la comprendre. Le risque de contentieux est grand. Comment protéger le personnel médical ou paramédical lorsque le patient exigera la preuve qu'il a été prévenu ? Avis défavorable.
Même avis que la commission.

Cette preuve peut figurer dans le compte rendu médical. En tant que médecin, nous avons l'habitude de faire des comptes rendus médicaux. De la même façon que nous indiquons, au bas du document, qu'aucune transfusion n'a été faite, pourquoi ne pourrions-nous pas écrire que le patient a été informé ?

Nous n'allons tout de même pas créer un nouveau fichier, un casier des preuves !
(L'amendement n° 23 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 24 .
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

L'alinéa 29 de l'article 1er relatif aux droits des patients prévoit l'information du patient sur sa situation juridique, ses droits, les voies de recours qui lui sont ouvertes et les garanties qui lui sont offertes, dès son admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande et après chacune des décisions concernant sa prise en charge. Cela sous-entend qu'un patient qui ne demanderait pas à être informé sur ses droits ne le serait pas.
Cette situation ne nous paraît pas acceptable. C'est pourquoi nous proposons que l'information du patient sur ses droits à chaque étape de sa prise en charge soit systématique – ce qui renforcera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la légitimité de la prise en charge dès lors que l'intéressé en aura été informé. C'est pour remédier à cette lacune que nous avons déposé cet amendement.

Il semble que nous n'ayons pas la même interprétation du texte, madame Fraysse. L'information du patient doit être systématique, je suis d'accord avec vous, mais le texte ne dit pas autre chose. Je rappelle qu'aux termes de l'alinéa 29, il est prévu une information dès l'admission ou dès que l'état du patient le permet ; une information après chacune des décisions de maintien en soins ou de modification de la forme de prise en charge. Et si le patient le désire, il est prévu une information à sa demande.
Le projet de loi n'impose aucune alternative ; il prévoit seulement une complémentarité entre l'information initiale systématique, l'information ultérieure qui a lieu, quoi qu'il arrive après chaque décision. Non seulement votre amendement est satisfait, mais il pourrait aboutir à une régression en ne permettant plus au patient d'avoir une information à sa demande. Il existe aujourd'hui une information systématique et une information à la demande du patient. Vous, vous proposez de supprimer l'information à la demande du patient. Je vous invite à y réfléchir, madame Fraysse, et peut-être à retirer votre amendement.

Je comprends, et je retire mon amendement.
(L'amendement n° 24 est retiré.)

Je suis saisie d'un amendement n° 25 .
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

L'alinéa 30 précise que l'avis du patient doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. Nous proposons que l'avis de la famille ou de la personne de confiance soit également recherché et pris en considération. Nous partons en effet du principe que cet avis devrait aider l'équipe. C'est au médecin d'apprécier s'il s'entoure de ces avis.

Avis défavorable. Nous avons évoqué à plusieurs reprises la place de la famille dans le dispositif de soins. Tout le monde s'accorde à reconnaître son importance grandissante et cette évolution doit être prise en compte. Faut-il pour autant aller jusqu'à accepter l'immixtion des familles dans la définition des modalités de soins ? C'est précisément ce que je crains avec cet amendement. Nous avons tous auditionné des associations de familles de malades. Tout le monde voudrait voir son rôle mieux pris en compte. Votre amendement, madame Fraysse, implique davantage encore la famille, qui sera systématiquement consultée avant une prise de décision. À mon avis, ce n'est pas son rôle et ne relève pas de sa compétence. Je crains un effet secondaire négatif. Nous risquons d'aller à l'encontre des objectifs que nous poursuivons.
Même avis que le rapporteur.

Je rejoins le rapporteur sur le danger d'une consultation systématique. En effet, le débat de tout à l'heure a bien montré que cela devait rester une simple possibilité offerte..
(L'amendement n° 25 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 78 .
La parole est à Mme Catherine Génisson.

Il est important de prévoir un psychiatre supplémentaire dans le collège des soignants. >Nous avons conscience que notre amendement peut compliquer le plan de santé mentale prévu par Mme la secrétaire d'État, car il existe déjà un problème de psychiatres. Cela étant, pour la prise en charge qualitative du patient est une précaution tout à fait nécessaire.

Avis défavorable. Pour commencer, cet amendement pose un problème de cohérence. Il est présenté comme complémentaire à l'amendement n° 79 alors qu'il fait passer le nombre de membres du collège de trois à quatre !

Sur le fond maintenant, je ne suis pas persuadé qu'il soit justifié d'augmenter le nombre de psychiatres dans le collège. Nous avons déjà eu le débat sur le cadre de santé, nous y reviendrons. Pour une meilleure cohérence, je vous proposerai un amendement qui proposera non un cadre de santé, mais un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

Je retire l'amendement, mais nous reviendrons tout à l'heure sur la proposition du psychiatre supplémentaire.
(L'amendement n° 78 est retiré.)

Je suis saisie d'un amendement n° 79 .
La parole est à Mme Catherine Génisson.

Nous avons eu en commission une longue et intéressante discussion sur la présence d'un cadre infirmier au sein du collège de soignants. Rappelons au passage que ces cadres s'apparentent davantage à des personnels administratifs qu'à des soignants ; or ils pourraient se retrouver à représenter l'ensemble de ces personnels soignants qui ont une relation particulièrement forte avec le patient : si le psychiatre ne passe qu'une fois ou deux dans la journée, les infirmiers, eux, ont une relation permanente et constante avec les patients. Pour faire court, il pourrait donc y avoir un conflit d'intérêts si le soignant, qui est auprès du malade, est aussi juge de la situation de celui-ci.

Je considère moi aussi que la présence d'un cadre de santé stricto sensu au sein du collège pose un problème. Dans l'amendement n° 41 rectifié , dont nous allons discuter dans un instant, je propose de le remplacer par un représentant de l'équipe pluridisciplinaire. Cette proposition a reçu un avis plutôt favorable de la part des professionnels concernés. Chaque structure sera libre de son choix : il pourra s'agir d'un assistant social, d'un psychologue…

Cela veut dire que je vous demande de retirer votre amendement au profit de celui du rapporteur.
Défavorable à l'amendement n° 79 et favorable à l'amendement du rapporteur que nous allons examiner dans un instant.

J'ai bien entendu vos arguments, monsieur le rapporteur. Je vous remercie d'ailleurs de toujours nous répondre sur le fond. Par précaution, néanmoins, et tout en étant sensible à votre proposition – je pense même que nous voterons votre amendement –, nous maintenons notre amendement car nous tenons vraiment à ce que le cadre de santé ne fasse pas partie du collège prévu à l'alinéa 43.
(L'amendement n° 79 n'est pas adopté.)

Je suis saisie de deux amendements, nos 26 et 41 rectifié , pouvant être soumis à une discussion commune.
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l'amendement n° 26 .

Nous avons longuement discuté de ce point en commission. Nous avons finalement considéré qu'il ne fallait pas retenir la notion de cadre de santé. Notre amendement n° 26 tend donc à remplacer le cadre de santé par un infirmier en charge du patient. Nous souhaitons vivement que la décision ne soit pas prise seulement par deux médecins psychiatres. Certes, l'un des deux ne participe pas à la prise en charge du patient, ce qui lui donne un peu plus de recul. Mais il s'agit néanmoins de deux médecins de l'établissement. Or nous estimons qu'il faut élargir le cercle.
La proposition de M. Lefrand, qui n'exclut pas d'ailleurs la mienne,…

… nous semble tout à fait pertinente car elle ouvre précisément le champ.
Je répondrai d'un mot à des objections que j'ai pu entendre et selon lesquelles un infirmier n'est pas censé remettre en cause la décision de psychiatres. Il va de soi que l'infirmier n'ira pas la contester : il donnera son avis au sein du collège où chacun pourra s'exprimer sur l'état du patient. C'est évidemment le médecin qui tranchera.

La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 , l'amendement n° 41 rectifié ayant déjà été présenté.

J'ai cru comprendre que le consensus pourrait se faire sur l'amendement n° 41 rectifié et j'en remercie mes collègues.
J'ai bien entendu les critiques formulées en commission à l'encontre du premier amendement que j'avais déposé et qui prévoyait simplement de prendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. L'amendement n° 41 rectifié vise donc à intégrer un représentant de l'équipe au sein du collège et satisfait celui de Mme Fraysse. Je l'invite en conséquence à retirer l'amendement n° 26 au profit du mien.

Une fois n'est pas coutume, nous sommes d'avis de suivre le rapporteur. C'est un grand moment ! (Sourires.)

D'autant que, lui ne nous suit pas souvent. Mais cette fois-ci, il a su entendre nos demandes et nous lui en savons gré. Nous voterons donc l'amendement n° 41 rectifié .

Non, madame la présidente. Je le retire au profit de l'amendement du rapporteur.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de M. le rapporteur.
(L'amendement n° 26 est retiré.)
(L'amendement n° 41 rectifié est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 27 .
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Je considère que cet amendement est défendu.
(L'amendement n° 27 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 28 rectifié , qui fait l'objet d'un sous-amendement n° 109 .
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Le texte prévoit que les patients ne peuvent bénéficier d'une permission de sortie que s'ils sont accompagnés d'un membre de l'établissement. Notre amendement n° 28 rectifié permet à la personne de confiance de le remplacer. Il nous semble important, dès lors que les soignants en sont d'accord, qu'un patient puisse par exemple aller déjeuner au restaurant sans être forcément accompagné d'un membre du personnel de l'établissement d'accueil.

La parole est à M. le rapporteur pour présenter le sous-amendement n° 109 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 28 rectifié .

Madame Fraysse, un bienfait n'est jamais perdu : vous avez voté mon amendement n° 41 rectifié et moi, je serai favorable à votre amendement n° 28 rectifié sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement.
La formule des sorties de courte durée est en effet de moins en moins utilisée. Cela est dû probablement à une certaine pusillanimité de la part de l'autorité administrative, mais aussi à la désorganisation des services qu'elle entraîne dans la mesure où le patient en sortie doit être accompagné d'un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement psychiatrique. Il en résulte que les patients sont maintenus en permanence à l'intérieur de l'hôpital. À moins de recourir à des solutions bancales, avec une moindre surveillance de la part des personnels.
L'amendement de Mme Fraysse vise précisément à prendre en compte cette situation et à favoriser ces sorties, qui apportent une bouffée d'oxygène indispensable aux patients. Je remercie Mme Fraysse d'y avoir pensé et je suis désolé de ne pas l'avoir fait moi-même.
Vous proposez donc, madame, d'élargir les possibilités d'accompagnement de la personne en soins psychiatriques lors de sorties de courte durée en prévoyant que la personne de confiance désignée par le patient pourra se substituer au personnel de l'établissement. Mon sous-amendement n° 109 complète le champ des personnes susceptibles d'accompagner ces sorties en l'étendant aux membres de la famille du patient.
À ceux qui pourraient s'inquiéter des conséquences en termes de sécurité et de responsabilité, je rappelle que ces sorties sont placées sous la responsabilité de l'autorité décisionnaire, le directeur de l'établissement ou le préfet. Peu importe qui accompagnera le patient – membre du personnel, de la famille ou personne de confiance –, c'est toujours le même qui restera responsable. Nous ne prenons donc aucun risque à cet égard.
Avis favorable à l'amendement ainsi sous-amendé.
(Le sous-amendement n° 109 est adopté.)
(L'amendement n° 28 rectifié , sous-amendé, est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 29 .
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Notre amendement n° 29 vise à supprimer les alinéas 57 et 58 de l'article 1er. Ces dispositions concernent en effet les sorties de courte durée et organisent plusieurs niveaux d'autorisation de sortie temporaire pour les patients hospitalisés sans leur consentement. Les sorties qu'ils peuvent se voir autoriser ne doivent pas excéder douze heures. Elles sont accordées par le directeur de l'établissement de santé ; un avis favorable du psychiatre de l'établissement est nécessaire et elles doivent être accompagnées. Toutes ces conditions nous semblent suffisantes et de nature à prévenir les incidents.
Concernant les personnes hospitalisées d'office, la loi prévoit la transmission de la demande de sortie au préfet qui a demandé l'hospitalisation. Or cela nous semble excessif.
Avec les alinéas 57 et 58, l'accord du représentant de l'État pour les personnes déclarées pénalement irresponsables ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles doit être explicite. C'est cette dernière disposition que nous jugeons à la fois superfétatoire et stigmatisante. D'abord, un patient qui a présenté une crise l'ayant conduit en unité pour malades difficiles était dans un état précis que le traitement a géré ; il n'est donc pas justifié qu'un régime spécial lui soit appliqué. Nous ne voyons pas l'intérêt d'une telle disposition, d'autant que le préfet n'aura pas besoin d'y recourir pour s'opposer à une sortie.
Voilà les raisons pour lesquelles nous souhaitons supprimer les alinéas 57 et 58.

La commission a rejeté cet amendement. Le texte prévoit effectivement des mesures de précaution supplémentaires pour deux catégories spécifiques de malades, caractérisées par leur dangerosité potentielle : d'une part, les personnes ayant déjà été hospitalisées à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale et, d'autre part, celles qui ont séjourné en unité pour malades difficiles. J'ai déjà entendu hier soir dans les débats cette extrapolation selon laquelle quelqu'un qui a pris une cuite et s'est un peu énervé est forcément hospitalisé en UMD. Ce n'est évidemment pas vrai,…

…ou alors cela voudrait dire qu'il faudrait créer des UMD partout et, pour le coup, nous aurions besoin de beaucoup de moyens rien que pour ces unités ! (Sourires.) Or je ne crois pas que ce soit là qu'il y ait le plus de besoins aujourd'hui.
Je persiste donc à penser que les mesures de précaution consistant notamment à exiger plusieurs certificats médicaux pour permettre l'évolution de la prise en charge ou la levée de la mesure de soins ne sont pas aberrantes. La mesure visée ici, c'est-à-dire la nécessité de recueillir l'autorisation expresse du préfet pour des sorties de courte durée, ne me choque pas non plus.
Je sais que, cette fois-ci, nous ne pourrons pas trouver d'accord, mais je m'en tiens pour ma part au texte projet de loi.

C'est là que le contexte dans lequel est né ce projet de loi joue pleinement. Nous pourrions vous suivre dans votre argumentation s'il suffisait de prendre le texte au pied de la lettre et si l'on vivait dans un monde idéal. Mais tel n'est pas le cas : nous sommes dans un monde où les préfets – entre autres – sont, comme chacun le sait, tancés, notés, radiés…

…et payés, en effet, en fonction des prétendus résultats sécuritaires qu'ils devraient obtenir.
Quel est aujourd'hui le préfet qui va assumer la responsabilité de prendre un risque, alors même que sa connaissance en la matière est très relative, ce que, très sincèrement, on ne peut pas lui reprocher ?
Tout le projet de loi, compte tenu du contexte dans lequel il a été élaboré, repose sur l'idée qu'il faut enfermer les gens dangereux, c'est-à-dire les schizophrènes et autres malades mentaux. Ce qui explique que nous allons nous retrouver face à des problèmes d'organisation du système de soins terribles, sans parler des atteintes aux libertés individuelles, même si l'on n'aura pas à rendre de comptes avant trois ou quatre ans.
Hier, on m'a dit que mes propos étaient outranciers, mais nous arrivons là au coeur du problème. Pensez-vous sincèrement qu'il n'y a pas de risque que des autorités administratives soient amenées à prendre des décisions « de précaution », dit-on, qui feront que des individus parfaitement aptes à être intégrés dans la société se trouveront enfermés ? On en voit sans arrêt des exemples dans la presse – mais je sais que vous allez me dire qu'il ne faut pas forcément s'y fier.

C'est vrai, les maires ont des responsabilités très importantes en la matière.

Ça se voit que vous ne l'êtes pas ! (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

N'insultez pas l'avenir ! Vous ne savez pas ce qui se passera en 2014. (Rires.)

Je suis adjoint au maire chargé de la santé dans une ville de 2 millions d'habitants ! Mais vous savez sans doute, malgré cela, mieux que moi ce qui se passe !
Dans ce domaine, la particularité de la ville de Paris, dont je suis l'élu, c'est que la décision dépend du préfet de police. Cette dernière remarque s'adressait à Jean Mallot.

Mes chers collègues, seul M. Le Guen a la parole. Vous pourrez vous exprimer ensuite si vous le souhaitez.

Vous « hébergez » des malades, monsieur Malherbe ! Le terme est en dit long sur vos idées. En ce qui concerne le cas que vous évoquez, nous voulons plutôt, quant à nous, faire revenir ces hôpitaux dans la capitale.
Je conclus en disant tout simplement que ce projet de loi va entraîner des dysfonctionnements en raison même de son objet principal, en l'occurrence de la question dont nous parlons aujourd'hui : nous craignons que le système se bloque, parce qu'il a pour but de maintenir dans les asiles des gens qui pourraient – peut-être – se révéler dangereux à l'extérieur. Au lieu de faire reposer le système sur une régulation d'ordre essentiellement médical, vous y introduisez une dimension administrative, placée sous une responsabilité politique très directe, avec pour cadre un discours construit autour de l'idée selon laquelle il faut protéger la société de malades mentaux potentiellement dangereux. C'est le coeur même de notre désaccord fondamental avec ce texte. Au-delà de la lettre de ce texte, la conception de celui-ci est faussée car, à plusieurs reprises, le message politique qui a été produit a tourné autour de cette problématique extrêmement dangereuse et, me semble-t-il, attentatoire aux libertés individuelles. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

M. Le Guen vient de s'essayer à une démonstration qui n'en est pas une, en commençant par faire un procès d'intention.

Ce procès d'intention vise les préfets de la République. À vous entendre, les préfets, qui sont des hauts fonctionnaires assumant une responsabilité de grande importance, veulent en quelque sorte faire du chiffre et enfermer tous les gens a priori dangereux.

C'est la logique qu'on leur impose. Hortefeux est préfet après tout ! (Sourires sur les bancs du groupe SRC.)

Je m'inscris bien entendu en faux contre le début de cette démonstration.
Ensuite, je souhaite indiquer que les personnes qui passent dans des unités pour malades difficiles ou qui ont été déclarées pénalement irresponsables ne sont pas dépourvues de dangerosité. Tous ceux qui ont visité des unités pour malades difficiles savent pertinemment que dans ces établissements, qui sont d'ailleurs peu nombreux, il y a effectivement des personnes qui ont été déclarées irresponsables pénalement, mais qui n'en ont pas moins commis des faits très graves.
Et quand on est victime, qu'on le soit de personnes déclarées responsables pénalement ou de personnes déclarées irresponsables, on est toujours victime !

Il n'est pas question pour moi de faire à mon tour un procès d'intention à toutes les personnes présentant des troubles psychiatriques, pas plus qu'il n'est question d'enfermer toutes ces personnes. Il s'agit simplement de regarder la réalité en face. Je suis donc opposé aux amendements qui ont été déposés par l'opposition, parce que nous sommes ici dans la pure constatation de faits.

Je voudrais rebondir sur ce que disait M. Le Guen. Je regrette, mais moi je suis maire d'une commune qui accueille depuis 1860 l'établissement de Perray-Vaucluse, qui est un hôpital parisien spécialisé. C'est moi qui supporte les conséquences du fait que, quand le maire de Paris veut faire hospitaliser des personnes, il les envoie chez nous !

N'importe quoi ! C'est le rôle du préfet de police. Vous ne savez même pas comment fonctionne votre établissement !

Mais si ! Je siège au conseil de surveillance de l'établissement, donc je le sais mieux que vous. Renseignez-vous auprès de votre collègue maire adjoint qui y siège avec moi.
C'est nous, les maires, qui avons les problèmes, monsieur Le Guen. Quand le maire de Paris, ou bien le préfet de police, veut se débarrasser des personnes qui sont sur le quai de Valmy, par exemple, eh bien on les amène à l'hôpital de Perray-Vaucluse. Je connais donc bien le problème !

Mais non ! Je dis simplement que ces personnes sont hospitalisées chez nous.

Je suis saisie d'un amendement n° 42 .
La parole est à M. le rapporteur.

Amendement rédactionnel.
(L'amendement n° 42 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 43 .
La parole est à M. le rapporteur.

Amendement de précision.
(L'amendement n° 43 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente :
Suite du projet de loi relatif à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma