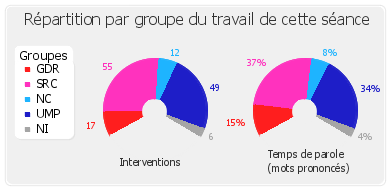Séance en hémicycle du 18 novembre 2009 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

La parole est à Mme Marie-George Buffet, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, près de 5 000 salariés de 1 800 entreprises sont aujourd'hui en grève.
Ces hommes et ces femmes sont, pour beaucoup, salariés depuis cinq, voire dix ans, de grandes entreprises telles qu'Adecco, Sodexho, KFC, etc. Cela fait des semaines qu'ils luttent – qu'ils luttent tout simplement pour être reconnus.
Par leur travail, ils contribuent au développement de notre pays. Ils sont solidaires et cotisent pour les retraites et la sécurité sociale ; ils payent leurs impôts. Ils participent à notre vie démocratique par leurs engagements associatifs ou syndicaux.
Mais il y a un problème : ces salariés sont placés hors la loi, car ils ne détiennent pas de titre de séjour. Notre pays ne les reconnaît pas pour ce qu'ils sont, des hommes et des femmes, artisans de notre nation, acteurs de notre République.
Monsieur le ministre, un nouveau projet de circulaire de régularisation circule. Il comporte certaines avancées, mais ne saurait être considéré en l'état comme satisfaisant. Pour que ces hommes et ces femmes puissent travailler et vivre dans la dignité, allez-vous, comme le demandent aujourd'hui les syndicats, permettre que votre ministère prenne le relais des négociations ?
Il est urgent de sortir du traitement au cas par cas. Ni les ressortissants de pays avec lesquels des accords bilatéraux prétendument plus avantageux existent, ni les salariés dont le travail est dissimulé, notamment les femmes, ne doivent être écartés de la circulaire. Il est en outre inacceptable d'opposer à ces salariés la situation de l'emploi dans un secteur où ils travaillent déjà.
Monsieur le ministre, ces salariés travaillent. Ils doivent pouvoir vivre ici dans la dignité. Reconnaître leurs droits est une question de justice. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

La parole est à M. Éric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Dans les faits, ce que vous nous demandez, c'est la régularisation de tous les étrangers en situation irrégulière.
De tous ceux qui travaillent, j'entends bien.
Mais, madame la députée, vous savez pertinemment que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'abord, au regard de nos engagements européens. Sous la présidence française, mon prédécesseur Brice Hortefeux a négocié un pacte européen qui lie tous les États membres en interdisant les régularisations massives. Ce n'est pas non plus possible au regard de la loi de 2007, dont l'article 40 a cependant permis un certain nombre de régularisations « sur critères ».
Ces critères doivent être précisés par une circulaire : j'ai récemment soumis aux syndicats un projet de texte. Vous avez bien voulu souligner que cette circulaire comporte un certain nombre d'avancées, d'ailleurs reconnues par les syndicats, même s'ils les estiment insuffisantes.
Nous pensons, je dois vous le dire très sincèrement, que la maîtrise des flux migratoires et l'intégration des étrangers en situation régulière sont les deux facettes d'une même médaille. Il existe entre les deux un lien mécanique.
Permettez-moi de vous dire, en outre, que le taux de chômage des étrangers en situation régulière est aussi de 25 % : il est donc trois fois plus élevé que celui du reste de la communauté nationale. En période de crise et de chômage – même si les choses vont un peu mieux –, permettez-nous de nous soucier de l'emploi des Français et de l'emploi des étrangers en situation régulière.
N'ayez pas de réflexes pavloviens : écoutez-moi jusqu'au bout.
Permettez-nous de nous soucier de l'emploi des Français et de l'emploi des étrangers en situation régulière avant d'ouvrir nos frontières, ce que nous ne pouvons pas faire actuellement. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et sur plusieurs bancs du groupe NC.)

Monsieur le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi, avec la crise, le chômage en Alsace a connu le plus fort taux de progression de France.
Cependant, une des chances et des richesses économiques de la région, ce sont les 70 000 personnes qui se rendent chaque jour dans les pays voisins, la Suisse et l'Allemagne, pour y travailler.
Toutefois, ces pays n'échappent pas à la crise et, de la même façon, les travailleurs frontaliers subissent des licenciements économiques. Or les personnes licenciées dans le cadre d'une rupture de contrat de travail, y compris dans le cas d'une rupture conventionnelle, ne bénéficient pas des mêmes droits que les salariés travaillant sur le territoire national, alors même que la cotisation chômage dont ils s'acquittent en Suisse est reversée, par accord, à la France.
Ainsi, Pôle Emploi ne verse pas l'équivalent des prestations, contrevenant en cela aux accords européens, qui stipulent que « tout travailleur frontalier qui est au chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État de sa résidence. »
Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, la loi française s'applique à tous ses ressortissants, y compris ses frontaliers. Ces derniers doivent donc bénéficier des mêmes avantages que les salariés travaillant sur le territoire national et ce, je le rappelle, en vertu du strict principe constitutionnel d'égalité de traitement entre les citoyens.
Les frontaliers ne souhaitent que l'application de la loi. Quelles mesures entendez-vous prendre afin que ce principe devienne rapidement une réalité ?
Monsieur le député, vous soulevez le problème des travailleurs résidant en France et travaillant à l'étranger, notamment ceux issus de la région Alsace, mais aussi des Ardennes ou de Lorraine.
Au niveau national, je veux rappeler que nous estimons à environ 272 000 le nombre de travailleurs résidant en France et travaillant à l'étranger, et qui peuvent être confrontés au type de situation que vous avez dépeinte.
S'agissant de leur indemnisation chômage, les travailleurs frontaliers en chômage complet bénéficient, vous l'avez rappelé, des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge, donc par Pôle Emploi.
Le salaire pris en compte correspond bien au dernier salaire. En pratique, cela signifie qu'un salarié qui a perdu un emploi dans un pays européen doit se procurer auprès de l'institution compétente de l'État dans lequel le travail a été accompli le fameux formulaire édité par l'Union européenne et la Suisse. Ensuite, il s'inscrit comme demandeur d'emploi.
Vous faites part des difficultés dans la mise en oeuvre de ce principe au niveau du versement de l'indemnisation chômage par Pôle Emploi. Elles sont réelles, c'est vrai. M. Laurent Wauquiez va saisir Pôle Emploi et les consulats concernés à l'étranger afin de régler cette situation : monsieur le député, vous avez raison, il n'est pas acceptable que ceux qui sont déjà victimes de la perte de leur emploi soient en même temps victimes de complexités administratives hors de propos. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe NC.)

La parole est à M. Laurent Fabius, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le Premier ministre, je voudrais, si vous le voulez bien, revenir sur le sujet ô combien compliqué de la taxe professionnelle. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC. – Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
Vous avez décidé de supprimer la taxe professionnelle au 1er janvier de l'année prochaine, ce qui signifie que les entreprises auront, selon les chiffres officiels, à peu près 22 milliards d'euros en moins à payer. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
Mais comment seront compensés ces 22 milliards ? Toute la question est là.

Vous proposez qu'une partie de ces milliards soit compensée par les entreprises elles-mêmes. Mais il reste, pour l'année prochaine, près de 12 milliards à trouver, et, pour les autres années, près de 6 milliards. Du coup, la question se pose, et c'est le mystère de la taxe professionnelle : qui va payer tous ces milliards ? (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
La réponse est simple, mes chers collègues. Vous nous dites que ce seront des dotations budgétaires, mais les dotations budgétaires, il faut qu'elles soient financées, c'est l'impôt sur les ménages. Vous nous dites que ce sera le déficit budgétaire, mais le déficit budgétaire, il faut le rembourser, c'est l'impôt sur les ménages. (Exclamations sur les mêmes bancs.) Vous nous dites que ce sera l'imposition des collectivités locales, mais les collectivités locales, c'est l'impôt sur les ménages. (Mêmes mouvements.)

Monsieur Fabius, une petite seconde.
Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir écouter la question. Le chronomètre est arrêté, je le ferai repartir quand vous serez calmés. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
Monsieur Fabius, je vous en prie, poursuivez.

Ce que je voulais dire, en une minute trente, c'est que l'usine à gaz de la taxe professionnelle, cela consiste simplement à taxer moins les entreprises et à créer un nouvel impôt sur les ménages. C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, nous n'acceptons pas vos propositions. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR. – Huées sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. François Fillon, Premier ministre. (Mmes et MM. les députés des groupes UMP et NC se lèvent et applaudissent vivement.)
Monsieur Laurent Fabius, la vérité, c'est qu'hier vous avez tenté d'instrumentaliser l'Association des maires de France et que vous avez échoué. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.) Pourquoi ? Parce que vous avez menti. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Vous avez menti aux maires en leur faisant croire que la taxe professionnelle ne serait pas compensée ou qu'elle le serait par des dotations budgétaires.
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. C'est vrai !
J'ai démontré hier que la taxe professionnelle serait remplacée intégralement par des transferts de fiscalité…
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. C'est faux !
…et par la création de deux nouvelles taxes sur les entreprises, une taxe basée sur le foncier des entreprises et une taxe sur la valeur ajoutée, qui nous permettra d'ailleurs de mettre en application une péréquation dont vous parlez depuis très longtemps mais que vous n'avez jamais réussi à mettre en oeuvre. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
Vous avez menti en faisant croire aux maires qu'il n'y aurait plus de lien entre les entreprises et les territoires, alors même que, grâce à l'Assemblée nationale et aux travaux du Sénat aujourd'hui, le lien entre les entreprises et la fiscalité des territoires a été préservé et sera même, s'agissant du bloc communal, plus important qu'il ne l'est actuellement. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)
Vous avez menti…
…en faisant croire aux Français que la suppression de la taxe professionnelle se ferait au détriment des ménages. (« C'est vrai ! » sur plusieurs bancs des groupes SRC et GDR.)
J'ai démontré hier qu'il n'en était rien, sauf dans les collectivités qui n'arrivent pas à contenir leurs dépenses (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC) et je n'ai pas noté qu'il fallait que nous supprimions la taxe professionnelle pour que, dans beaucoup de collectivités que vous gérez, les impôts augmentent d'une manière tout à fait inconsidérée dans les périodes que nous rencontrons. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
Enfin, vous avez menti aux maires en leur faisant croire que, demain, du fait de la loi sur l'organisation du territoire, les régions et les départements ne pourraient plus financer leurs projets.
Ce n'est pas parce que nous allons clarifier les compétences, que nous allons rendre plus lisibles les financements de ces collectivités, que les communes ne seront plus aidées.
Mais on ne peut pas, monsieur Fabius, brandir en permanence le principe de l'autonomie des collectivités locales et en même temps accepter que les maires soient, comme aujourd'hui, souvent contraints de passer sous les fourches caudines de contrats contraires à la liberté des collectivités locales. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC. – Protestations sur les bancs du groupe SRC.)
Monsieur Fabius, Pierre Mendès France disait : « Il faut affronter la réalité, il faut dire la vérité et il faut agir en sincérité. » J'aimerais que le parti socialiste s'inspire des propositions de Pierre Mendès France. (Mmes et MM. les députés des groupes UMP et NC se lèvent et applaudissent longuement.)
Taxe professionnelle

La parole est à M. Michel Piron, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Godillots !

Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Hier, devant l'assemblée des maires de France, le Premier ministre a exposé les éléments d'une vraie réforme, posant de vraies questions, qui appellent de vraies réponses.

Il a rappelé l'urgence économique de la réforme de la taxe professionnelle, attendue depuis si longtemps.
Il a réaffirmé l'importance du lien fiscal entre entreprises et territoires d'accueil, qui devrait reposer sur le foncier et la valeur ajoutée.
Il a annoncé qu'un rendez-vous avec les collectivités aurait lieu en 2010, au vu de simulations complémentaires pouvant justifier des ajustements.
Il a chiffré à 17,1 milliards les ressources fiscales appelées à se substituer aux 17,3 milliards actuellement perçus par nos collectivités, soit un taux de remplacement de 98,80 %, que l'État complétera par 1,2 milliard de dotations pour les 1,2 % manquants.
Parce qu'un certain nombre de précisions sont encore attendues aujourd'hui, le Gouvernement pourrait-il nous assurer :
Que, dans le cadre du débat ouvert, la valeur ajoutée dégagée sur chaque commune et communauté servira bien de base à l'impôt économique qui reviendra à chacun de ces territoires d'implantation ?
Que cet impôt évoluera bien en fonction de la dynamique des entreprises, assurant le lien entre ressources locales et croissance nationale ?
Qu'une meilleure péréquation sera permise par l'établissement d'un taux moyen national et qu'une garantie de ressources individuée sera assurée au-delà de 2011 par un fonds national instauré à cet effet ? (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Des impôts ! Des impôts !

Je vous en prie.
La parole est à M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie.
Monsieur Piron, le Premier ministre a parfaitement répondu tant devant l'assemblée des maires de France hier que devant la représentation nationale il y a quelques instants.
Je veux simplement vous confirmer qu'après que votre assemblée a largement amélioré le dispositif du Gouvernement en proposant que l'impôt payé par les entreprises soit pour partie directement affecté aux collectivités sur le territoire desquelles elles sont établies, le Sénat réfléchit actuellement à des modalités de répartition encore plus justes.
Enfin, comme le Premier ministre vient de le rappeler et comme il l'a dit hier aux maires de France, communes et intercommunalités ont la garantie qu'à bases et taux constants, leurs ressources seront maintenues en 2010 et 2011 (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.) et que, bien évidemment, un fonds de garantie individuelle de ressources viendra corriger les éventuelles variations induites par la réforme pour les années à venir.
Monsieur Piron, le fait que le lien entre collectivités et entreprises, entre territoires et entreprises, soit préservé est fondé sur cette valeur à laquelle les maires de France sont si attachés, et nous savons de quoi nous parlons.
En même temps, en tant que ministre de l'industrie, je veux vous dire combien je suis fier…
… qu'à partir du 1er janvier prochain nous puissions dire aux Français, aux maires et à tous les ouvriers de France que la seule suppression de la taxe professionnelle sur les investissements productifs nous permet de nous engager sur des milliers d'emplois pour notre pays.
C'est un engagement à lutter contre les délocalisations qui ont tué l'emploi dans notre pays ces dernières années. C'est notre capacité à donner des marges de manoeuvre à nos entreprises pour qu'elles investissent dans l'innovation et les enjeux stratégiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Élisabeth Guigou, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le Premier ministre, hier, au congrès des maires de France, vous avez entendu la révolte des élus, notamment de ceux de votre majorité (Exclamations sur les bancs du groupe UMP) et du président de l'association des maires de France – qui n'est pourtant pas socialiste (« Lamentable ! » sur les bancs du groupe UMP) –face à vos projets de réforme de la fiscalité locale et de réforme territoriale.
Vous avez tenté de la désamorcer en annonçant quelques concessions marginales et en renouvelant des promesses auxquelles personne ne croit. Les communes rurales ne verront pas leur situation améliorée par de nouvelles assises territoriales. Le fonds destiné à atténuer l'impact de la taxe carbone n'est pas financé. La taxe professionnelle ne sera pas intégralement remplacée par un impôt local décidé de façon autonome non par l'État mais par les collectivités. Les inégalités entre les territoires vont encore s'aggraver.
Nous ne voulons pas de votre projet qui, en diminuant l'impôt sur les entreprises, fera payer la facture par les ménages. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) Nous voulons une réforme, mais une bonne réforme, qui maintienne les ressources indispensables aux collectivités locales pour financer les services publics, les aides aux personnes âgées et handicapées, le logement, les transports publics, les investissements qui créent des emplois, les activités sportives et culturelles, et enfin les associations. Nous voulons une vraie réforme qui corrige l'injustice des impôts locaux et réduise les écarts entre les territoires riches et pauvres, une réforme qui représente un progrès et non une régression démocratique.
Monsieur le Premier ministre, les élus ne sont ni des gaspilleurs ni des profiteurs. Ils vous demandent non pour eux-mêmes mais pour nos concitoyens de renoncer à imposer votre projet, et de tout remettre à plat pour ouvrir une vraie concertation et entreprendre une réforme cohérente, efficace et juste. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire.
Madame la députée, je vous remercie de votre question. Nous étions ensemble hier au congrès des maires, et je n'ai pas porté sur eux le même regard que vous. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Je les ai vus écouter avec intérêt l'exposé du Premier ministre et comprendre enfin la réforme qui leur était proposée. La réforme des finances locales représente en effet une chance pour les collectivités rurales…
…puisqu'elle instaure enfin et pour la première fois une véritable péréquation entre les communes les plus riches et les communes les plus pauvres, grâce au fonds national de garantie.
Pour avoir écouté et vu les maires, je sais qu'aujourd'hui ils ont envie de mieux comprendre et de mieux connaître la réforme, parce qu'on les a trop souvent égarés et qu'ils sont heureux d'avoir entendu un exposé clair et serein à son sujet.
Oui, les communes rurales seront gagnantes dans ce système, puisqu'elles disposeront d'une imposition dont le montant sera garanti pour 2010 et 2011.
En outre, l'écrêtement des communes les plus riches pour aider les plus pauvres représente un progrès. Comprenant que cette réforme rendrait la décentralisation plus claire, plus simple et plus efficace, l'auditoire a changé : tandis qu'il écoutait attentivement le discours du Premier ministre, il a soudain repris espoir. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Jean-Michel Ferrand, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Madame la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, lors de la conférence nationale du handicap du 10 juin 2008, le Président de la République a présenté le pacte national pour l'emploi des personnes handicapées, qui vise à atteindre un taux d'emploi de 6 % de personnes handicapées tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.
Ce pacte repose sur des engagements réciproques de l'État et des employeurs. Le premier s'engage à mieux accompagner les personnes handicapées dans leur parcours d'accès à l'emploi et à faciliter leur recrutement, tandis que les seconds s'engagent sur des plans pluriannuels ambitieux d'embauche et de maintien dans l'emploi de ces personnes.
Les engagements pris par l'État ont été tenus, puisque désormais un bilan professionnel est systématiquement effectué pour les demandeurs de l'allocation adulte handicapé, que des efforts de formation accrus ont été réalisés et que la limite d'âge pour l'accès à l'apprentissage a été supprimée, tout comme la condition d'un an d'inactivité pour obtenir l'allocation adulte handicapé.
Un député du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Tout va bien !

Au moins, tout va mieux qu'à l'époque où vous étiez aux affaires ! (« Très juste ! » sur les bancs du groupe UMP.)

Quant aux employeurs, quels progrès ont-ils réalisés en matière d'emploi des personnes handicapées, non seulement dans le secteur privé mais aussi dans la fonction publique, qui se doit d'être exemplaire dans ce domaine ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité.
Reconnaissons-le, monsieur le député, le taux de chômage des personnes handicapées est encore beaucoup trop élevé, puisqu'il s'élève à 19,3 %. Cependant, 40 % des entreprises ont passé le seuil de 6 %. Quant à la fonction publique, elle a fait un effort considérable en atteignant le taux de 4,4 %. Cela dit, nous devons intensifier nos efforts. C'est pourquoi M. Darcos et moi-même avons présenté au Conseil des ministres la création du comité interministériel du handicap. Placé sous l'autorité du Premier ministre, il nous donnera plus de force pour agir et mieux coordonner nos politiques, qui doivent être interministérielles et transversales.
Pour répondre à cette attente, nous devons relever deux défis.
Le premier est celui de la formation des personnes handicapées, dont 83 % ont un niveau inférieur ou équivalent au BEP. Il faut par conséquent aider, par l'intermédiaire des familles, les jeunes en situation de handicap à mieux se former et à ne pas s'autocensurer. Avec M. Chatel et Mme Pécresse, nous allons travailler au service des jeunes et de leurs familles, d'abord à l'école, puis pour mieux les orienter notamment vers l'université.
Le second défi à relever vise à maintenir dans l'emploi les personnes devenues handicapées à la suite d'un accident de la vie. Les moyens alloués à l'AGEFIPH nous permettront de relever le défi essentiel que représente le seuil de 6 %. Mais il faut aller plus loin. Certaines grandes entreprises ont montré l'exemple : chez Michelin, par exemple, le taux de personnes handicapées atteint 7 %. Nous avons réuni les entreprises du CAC 40, qui sont de véritables vitrines. Elles nous permettront de mettre en oeuvre des politiques efficaces. En outre, parce qu'elles sont les fleurons de notre économie, elles seront des locomotives pour les personnes handicapées qui doivent trouver un emploi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Huguette Bello, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer.
Bien qu'elles ne suscitent pas toutes les mêmes déferlements médiatiques, les marées noires provoquent toujours des catastrophes écologiques. La dernière en date a eu lieu, en août dernier, dans une zone jusqu'ici préservée, au sud de l'océan Indien, à proximité des côtes malgaches. Reliant le Togo à l'Inde, un vraquier battant pavillon turc a fait naufrage à la pointe sud de Madagascar. Dans ses soutes, il transportait du phosphate brut, du fuel lourd, des hydrocarbures.
Les tristes conséquences de cet échouement se sont vite fait sentir : des dizaines de kilomètres de plages souillées ; la faune et la flore menacées, et notamment une surmortalité des baleines ; l'interdiction de la pêche, qui est la principale source de revenu de la population. En un mot, l'impact écologique et environnemental, désormais établi, est accablant aussi bien pour les populations que pour ce lieu qui passait pour un sanctuaire marin.
Pour compléter le tableau, il faut préciser qu'il s'agissait d'un navire qui figurait depuis 2002 sur la liste des navires poubelles interdits dans les ports de l'Union européenne. Le Gulser Ana, c'est le nom de ce vraquier, fait partie des soixante-six navires répertoriés « à risques très élevés ».
À la veille du sommet de Copenhague, la France, puissance maritime grâce à ses outre-mers, ne pourrait-elle pas prendre une nouvelle initiative pour que les océans du Nord et du Sud, déjà menacés par le dérèglement climatique, n'aient plus à souffrir de blessures nullement inévitables ? (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et certains bancs du groupe SRC.)
Madame Bello, effectivement, le 31 août dernier, le vraquier Gulser Ana s'échouait sur un haut-fond au sud de Madagascar. C'est un des navires poubelles interdits de navigation dans les eaux européennes. Nous avons proposé d'envoyer le Beautemps-Beaupré cartographier cette zone au sud de Madagascar, qui est mal connue – c'est une raison, mais non la seule, de cet échouement. Nous avons réitéré la proposition et j'espère que nous allons pouvoir accomplir ce travail.
Sur un plan plus général, la France est la deuxième puissance maritime du monde. Sous la présidence française de l'Union européenne, Dominique Bussereau s'est battu pour faire adopter le paquet « Erika-III », qui traite notamment de la sécurité des pavillons et de la responsabilité des armateurs.
Mais il faut aller plus loin. Nous défendons l'idée, en Méditerranée, d'interdire les Bouches de Bonifacio aux transports maritimes, pas seulement italiens et français.
Nous saisissons l'Organisation maritime internationale et, par ailleurs, nous sommes convaincus que les mers et les océans ne peuvent rester, au-delà des 12 à 15 milles, une zone de non-droit international. Il faudra donc réformer l'OMI, et probablement créer une ONU de la mer. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Notre assemblée examine actuellement le projet de loi de Mme la garde des sceaux sur le suivi des criminels à la sortie de prison.

C'est une première réponse très positive à ce problème, mais encore insuffisante. On oublie en effet l'essentiel. Les délinquants sont de plus en plus violents, l'impunité règne dans nos quartiers, la récidive progresse parce que, tout simplement, dans notre pays, les peines de prison ne sont pas intégralement appliquées.
Comment accepter qu'on libère les criminels ou les délinquants les plus violents bien avant la fin de leur peine ? Les Français doivent savoir que, depuis 2004, chaque condamné obtient une remise de peine automatique d'un trimestre pour la première année d'incarcération et de deux mois pour les années suivantes. S'y ajoutent des remises de peine sous condition, pouvant aller jusqu'à trois mois par année de prison, puis des libérations conditionnelles décidées par le juge d'application des peines.
Ainsi, un criminel condamné à onze ans de prison peut sortir au bout de la septième année. C'était le cas de celui qui, il y a peu, a assassiné une femme à Milly-la-Forêt.
Il n'y a pas de pays démocratique aussi laxiste que le nôtre.

C'est pourquoi j'ai proposé, par voie d'amendement au projet en discussion, de supprimer la réduction de peine automatique instaurée en 2004. Je sais que beaucoup de députés de la majorité y sont favorables. Aussi je m'étonne que le Gouvernement, qui communique tant sur la sécurité, refuse cette suppression. Pourquoi un tel décalage entre vos belles intentions et vos actes ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Monsieur Dupont-Aignan, contre la récidive, la première chose à faire est d'appliquer les sanctions. L'une de mes priorités est qu'il n'y ait plus 32 000 peines prononcées et non exécutées.
Quand les sanctions sont exécutées, se pose effectivement le problème de la réduction automatique des peines.
Nous partageons, sur tous les bancs je crois, l'objectif de mieux prendre en compte la personnalité des personnes détenues. Pour autant, les réductions de peine, automatiques sur le papier, ne sont pas systématiquement accordées. Ensuite, pour les récidivistes, les réductions sont de toute façon diminuées de moitié. Enfin, la réduction de peine permet aussi de tenir compte de la volonté de la personne incarcérée de se soigner, ce qui nécessite son accord, et de se réinsérer. Lorsque le détenu refuse le soin ou ne fait pas ce qu'il faut pour se réinsérer, il ne bénéficie pas de cette réduction. Il y a là une incitation importante.
Enfin, pour revenir au texte qui est examiné aujourd'hui même, la libération conditionnelle n'est pas automatique mais décidée par le juge au vu du dossier et du comportement du détenu. Si ce dernier ne suit pas les injonctions de soins, la libération conditionnelle peut être supprimée. C'est un gage d'efficacité. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Yves Albarello, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale, dans quelques jours, le projet de loi relatif au Grand Paris vient en discussion devant notre assemblée. Ce projet, comme son nom l'indique, concerne au premier chef la région capitale, c'est-à-dire la région d'Île-de-France dont la ville de Paris est le coeur, sinon le moteur et, pour le monde entier, l'emblématique capitale de notre beau pays.

Votre texte propose, à partir d'un super-métro automatique structurant, dont l'épine dorsale sera la traversée de Paris par la ligne 14 prolongée, la réalisation d'un projet global de développement à plusieurs pôles économiques, moteurs de croissance. Ces pôles, qui permettront de stimuler l'innovation, seront donc reliés par un réseau de transport qui assurera la cohérence de l'ensemble de cette opération de développement et d'aménagement. Une application concrète immédiate est prévue sur le plateau de Saclay.
Dans ces conditions, pouvez-vous préciser quelles retombées, notamment économiques, le Gouvernement attend de cette opération d'intérêt national, tant au bénéfice de la province que des territoires franciliens éloignés du tracé de ce super-métro ?

La parole est à M. Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.
Monsieur Albarello, vous m'interrogez sur les retombées, notamment économiques, du Grand Paris pour les territoires national et francilien.
Je vous remercie de souligner avec force, en tant que rapporteur du projet de loi (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC), qu'il relève d'un intérêt stratégique international, national et local. En effet, grâce à ses trois aéroports internationaux et au port du Havre, le Grand Paris est la principale porte d'entrée mondiale de la France.
Dans un monde largement globalisé où les accélérations sont souvent fulgurantes – je rappelle qu'en 1990 le PIB de l'Île-de-France était équivalent à celui de la Chine alors qu'en 2008 il n'en représente plus que 20 % –, il importe de libérer le plus rapidement possible les potentiels de la région capitale.
Le nouveau système de métro automatique, en reliant plus vite et plus confortablement les centres urbains et les pôles stratégiques de la création, de l'innovation et de la recherche, sera un facteur de productivité et de compétitivité.
Par ailleurs, le Grand Paris sera interconnecté et conçu en synergie avec les métropoles régionales. Notre pays a la grande chance d'avoir sur son territoire une ville-monde : grâce à l'articulation en réseau avec les grandes métropoles, en particulier avec Lyon-Grenoble, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et Strasbourg, c'est mécaniquement tout le territoire français qui bénéficiera du gain de croissance d'une région représentant déjà 30 % du PIB national.
Je terminerai en évoquant la deuxième couronne du Grand Paris. Comme vous le savez, le projet de loi prévoit que les gares du réseau automatique de métro seront conçues pour être connectées aux transports de desserte de la grande couronne… (« Deux minutes ! Stop ! » sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Bruno Le Roux, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le Premier ministre, adossé à votre réforme des collectivités territoriales ; réforme au sujet de laquelle je veux d'ailleurs vous dire que vous mentez aux Français (Vives protestations sur les bancs des groupes UMP et NC – Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)…

Les Français doivent savoir que les communiqués de victoire du MEDEF pèsent pour 6 milliards d'euros supplémentaires sur les factures des ménages de notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Adossé à la réforme des collectivités territoriales, disais-je, vous voulez malheureusement une nouvelle fois – mais il s'agit chez vous d'une habitude – tripatouiller les modes de scrutin. (Protestations sur les bancs des groupes UMP et NC.)
Que voulez-vous faire ? Un scrutin majoritaire uninominal à un seul tour. Cela nécessite quelques explications car les Français aiment que les modes de scrutin soient clairs. Or, en l'espèce, il s'agit d'un scrutin étrange et injuste : pour la première fois dans notre histoire, celui qui sera élu n'aura pas la majorité des voix, il ne disposera donc pas de cette majorité qui lui permet aujourd'hui d'asseoir sa légitimité.
Pire encore, avec ce mode de scrutin, la plupart des futurs conseillers territoriaux seront élus alors même qu'une majorité d'électeurs ne leur aura pas accordé sa confiance.

Ajoutez à cela une fausse proportionnelle, complexe car dépendant seulement d'une partie des voix des électeurs, et vous obtenez un mode de scrutin incompréhensible et antidémocratique, entraînant un recul majeur de la parité, et jugé anticonstitutionnel, notamment par le Conseil d'État.
Ce mode de scrutin est en effet jugé comme portant atteinte à l'égalité comme à la sincérité du suffrage, rien de moins ! Il avait même été condamné à une autre époque, par Nicolas Sarkozy, pour qui il était « brutal, sauvage et peu démocratique ». Pourtant, monsieur le Premier ministre, vous ne renoncez pas !
Aujourd'hui, deux modes de scrutin sont bien compris par les Français : celui qui leur permet d'élire leur maire et celui qui leur permet d'élire le Président de la République. Allez-vous persévérer à vouloir instaurer un mode de scrutin tripatouillage ou respecterez-vous la démocratie, en vous inspirant de ces scrutins ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)

La parole est à M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. (« Magouilleur ! Charcuteur ! » sur les bancs du groupe SRC, dont de nombreux députés miment un découpage aux ciseaux.)
Mes chers collègues, je vous prie d'écouter la réponse du secrétaire d'État. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur Bruno Le Roux, le mode de scrutin que nous avons retenu est un scrutin mixte qui se déroulera dans le cadre traditionnel du canton. Il s'agira d'un scrutin majoritaire pour 80 % des sièges, et d'un scrutin proportionnel pour les 20 % restants. (Bruit sur les bancs du groupe SRC.) « La répartition de cette dernière partie des sièges se fera au plus fort reste, elle bénéficiera ipso facto aux plus petites formations politiques, qui n'étaient pas représentées jusqu'à maintenant. (Brouhaha )
Des modalités similaires ont déjà été mises en oeuvre, notamment par la gauche, dans de nombreux pays. Ce fut le cas en Italie, à l'époque du gouvernement socialiste de M. Ciampi, puis alternativement par des gouvernements de gauche et de droite. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Ces modalités ne peuvent évidemment s'appliquer qu'avec un scrutin à un tour : nous ne sommes pas dans le schéma allemand.
Pour notre part, nous avons voulu rester dans le cadre du département en conservant des cantons à taille humaine. Il y aura ainsi un minimum de quinze cantons par département, et donc quinze élus au moins pour les plus petits départements.
Certes, dans notre pays, les élections utilisant un mode de scrutin majoritaire ont toujours été à deux tours. Mais ne pas respecter cette règle n'est pas injuste. Il ne s'agit pas d'une règle constitutionnelle, et il n'est pas interdit de la changer. Vous ne vous êtes d'ailleurs pas privés de le faire durant des années, à l'époque où M. Mauroy ou M. Fabius était Premier ministre.
En outre, il faut relativiser les conséquences d'un tel changement. J'ai examiné les résultats des dernières élections cantonales de mars 2008 : plus de 90 % des candidats élus étaient soit des élus du premier tour, soit des élus qui se situaient en tête au premier tour. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Olivier Dassault, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, l'agriculture est l'un des piliers historiques, actuels et futurs du développement de nos territoires. La ruralité occupe une place majeure au plan économique et social.

Or notre tissu agricole, socle du monde rural, traverse une crise profonde. La baisse généralisée des prix des matières premières touche de plein fouet une profession qui a pourtant consenti, depuis des décennies, d'énormes efforts d'adaptation aux contraintes technologiques, écologiques et européennes.
Vous avez su, monsieur le ministre, répondre à l'urgence de la situation, en débloquant notamment une aide de 1,6 milliard d'euros, versée aux agriculteurs dans le cadre d'un vaste plan de soutien et de prêts bancaires à taux réduit. Toutefois, les distorsions qui existent entre notre législation fiscale, sociale et environnementale et celle de nos concurrents sont une menace pour l'avenir de nos paysans.
Prenons un exemple. Comment, après un périple de 17 000 kilomètres, un porc né au Canada, élevé en Australie, abattu en Belgique et vendu dans un hypermarché français peut-il être moins cher qu'un cochon français, l'un des délicieux emblèmes de notre gastronomie et de nos terroirs ?

Voilà qui démontre bien la nécessité d'harmoniser nos réglementations ou, du moins, de protéger nos producteurs et l'ensemble des filières d'éleveurs !
L'agriculture a besoin d'être rassurée et éclairée. Si les biocarburants, les bioplastiques, les agro-ressources ouvrent de nouvelles perspectives à cette activité millénaire, encore faut-il qu'elle soit soutenue et encouragée. Monsieur le ministre, quels sont vos priorités et vos objectifs pour les prochaines discussions avec nos partenaires européens ? Comptez-vous notamment plaider en faveur du rétablissement du principe de préférence communautaire et des prix plancher, indispensables filets de sécurité pour les producteurs ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, la priorité absolue pour tous les exploitants agricoles, c'est le déblocage immédiat des fonds prévus dans le cadre du plan de 1,650 milliard d'euros décidé par le Président de la République et le Premier ministre.
Après avoir reçu, aujourd'hui, les représentants de la filière viticole, je me rendrai, demain matin, dans le Nord, pour rencontrer ceux de la filière du porc, puis, demain soir, dans le Vaucluse, pour participer à la conférence organisée par la filière des fruits et légumes. Je souhaite en effet rencontrer les représentants de chaque filière, afin de m'assurer que, dans chacune d'entre elles, l'argent va bien aux exploitants qui en ont le plus besoin.
Ce que demandent ensuite tous les exploitants agricoles de France, c'est une lisibilité au niveau européen : ils veulent savoir quelle sera la politique européenne qui sera conduite en matière agricole. À ce propos, je veux dire très clairement que, dans la lignée de ce qui a été fait depuis plusieurs mois, je refuse la stricte concurrence par les prix, qui aboutirait à un moins-disant social, ainsi qu'à la remise en cause de la sécurité sanitaire de notre pays et de nos choix en matière de développement durable.
Par ailleurs, je souhaite que nous soyons capables de mettre en oeuvre une régulation européenne beaucoup plus forte, qui permette de réagir aux crises, en apportant des solutions immédiates, lorsque les agriculteurs en ont besoin, et non trois ou six mois après la crise. J'ai ainsi demandé à l'ensemble des membres européens du G20 agricole de participer à une réunion en décembre, à Paris, afin de commencer à discuter de l'avenir de la PAC.
Enfin, la régulation agricole doit aussi se faire à l'échelle mondiale. La sécurité alimentaire est en effet un enjeu mondial majeur. Lors du sommet de la FAO, à Rome, où je me trouvais lundi, une initiative franco-brésilienne a été prise afin de mettre en place cette régulation mondiale des marchés agricoles. Elle passe par une meilleure stabilisation des prix, par une meilleure gestion des terres agricoles et par un meilleur accord sur le développement durable. Nous nous battrons également sur le front de la régulation mondiale. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Alain Néri, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le Premier ministre, le chômage augmente, la précarité de l'emploi s'aggrave et la pauvreté se développe. Nombreux sont nos concitoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, fixé par l'Europe à 817 euros et par l'INSEE à 880 euros. La pauvreté frappe plus particulièrement les personnes âgées, les femmes et les familles monoparentales, ainsi que les jeunes. C'est insupportable !
Savez-vous que, dans notre pays, nombreux sont les retraités, qu'ils aient travaillé dans l'agriculture, le commerce, l'artisanat ou qu'ils aient été ouvriers, payés au SMIC durant toute leur carrière, dont les ressources sont inférieures à l'allocation spécifique aux personnes âgées, soit 677 euros ? Quand allez-vous enfin augmenter les retraites pour que nos anciens puissent vivre dans la dignité ?
Les rapports du Secours catholique et du Secours populaire dénoncent l'aggravation de la précarité chez les femmes et les jeunes en particulier, qui n'ont même pas 700 euros pour vivre parce qu'ils n'ont qu'un travail temporaire ou un temps partiel subi. Peut-on vivre ou seulement survivre avec un tel salaire ?

Alimentation énergie, logement : les dépenses quotidiennes explosent. Or vous annoncez de nouveaux déremboursements de médicaments et une hausse du forfait hospitalier. Ce ne sont plus seulement les chômeurs, mais aussi les salariés précaires qui ont recours au Secours catholique et au Secours populaire pour boucler les fins de mois.
Comment appeler à la cohésion nationale quand il n'y a plus de cohésion sociale parce que les plus aisés se gavent d'avantages indécents, comme le bouclier fiscal (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP)…

…et autres retraites chapeau que vous refusez de supprimer, pendant que d'autres, les plus modestes, sombrent dans la précarité ?
Comment ne pas se révolter quand on offre à des jeunes un salaire de 700 euros par mois qui leur interdit de s'installer et de fonder une famille ? Comment donner confiance en l'avenir à notre jeunesse lorsque le seul horizon que vous leur proposez est de devenir travailleur pauvre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse.
Monsieur Néri, vous avez raison de vous référer à ce remarquable rapport du Secours catholique ; nous aussi, nous travaillons avec le Secours catholique et le Secours populaire. Nous lisons leurs rapports, nous les rencontrons régulièrement, nous écoutons leurs propositions et nous les suivons.
Selon le Secours catholique, les femmes isolées sont de plus en plus souvent en situation de vulnérabilité. Pour la première fois, cette année, la prime de Noël – qui, sans cela, ne mériterait pas son nom –, ce complément des minima sociaux, sera versée aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, aux femmes seules avec des enfants. Cela fait dix ans que ce complément existe ; c'est la première fois qu'il est versé à ces personnes, et ce n'est que justice. Nous mettons ainsi un terme à une injustice extravagante.
Par ailleurs, 80 % des travailleurs pauvres sont des travailleuses.
Jusqu'à présent, à cause de la prime pour l'emploi, les travailleurs les plus pauvres étaient privés de tout soutien à leurs revenus, ainsi que l'INSEE vient de le rappeler. Avec le revenu de solidarité active, les salariés les plus modestes, donc les travailleuses pauvres, vont bénéficier d'un tel soutien. Et nous travaillons avec le Secours catholique pour que la possibilité de recourir au RSA soit bien connue de toutes les familles vulnérables.
Ensuite, pour les femmes, qui ont plus de difficultés à reprendre le travail, notamment à cause du premier mois de garde d'enfant et de certaines dépenses, l'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être débloquée de manière immédiate, sur simple facture, par les conseils généraux et les CCAS. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Cette aide est financée à 100 % par l'État et nous espérons que vous pourrez dépenser l'ensemble de l'enveloppe qui lui est allouée.
Quant aux personnes âgées, le minimum vieillesse, qui a été augmenté de 6,8 % l'année dernière, fera l'objet d'une revalorisation de 25 %.
Reste le problème du surendettement. J'espère que la prochaine loi sera à même de lutter efficacement contre ce phénomène. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Valérie Rosso-Debord, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Ma question, à laquelle j'associe Mme Claude Greff, s'adresse à M. le haut commissaire à la jeunesse, et ne manquera pas de faire plaisir à M. Néri.
Lors de la campagne présidentielle, le Président de la République avait affirmé son souhait de proposer aux jeunes un service civique volontaire ambitieux, qui puisse répondre à leur soif d'engagement pour les autres et pour la nation. Lors de son discours de Saint-Lô, où il vous a chargé, monsieur le haut commissaire, de mener une grande concertation en faveur de la jeunesse, il a insisté sur ce point en vous demandant de mettre en place les conditions d'un grand service civique à destination de tous les jeunes. Les travaux de la commission de concertation, que vous avez menés durant le premier semestre 2009, ont inscrit cette priorité pour la jeunesse. Le 29 septembre dernier, le Président a réaffirmé son souhait de voir ce grand service civique voir le jour.
Le Sénat a pris l'initiative d'une proposition de loi en ce sens, visant à uniformiser les statuts existants et à promouvoir la création d'un grand service civique attractif et capable de toucher rapidement une bonne partie de notre jeunesse. Cette proposition de loi a été adoptée à une très large majorité par les sénateurs, indépendamment des clivages politiques.
Lors de votre audition par la commission élargie sur la mission jeunesse, vous avez confirmé votre volonté de donner une vraie ampleur à ce service civique : 10 000 jeunes volontaires en 2010, ce chiffre ayant vocation à augmenter par la suite. Il s'agit d'un très beau projet, sur lequel le groupe UMP a décidé de s'investir : Jean-François Copé a créé un groupe de travail réunissant déjà une trentaine de députés, avec l'objectif d'aboutir dans les semaines qui viennent, si possible au mois de janvier.
Monsieur le haut commissaire, je vous remercie de bien vouloir indiquer à la représentation nationale votre ambition au sujet du service civique volontaire, les moyens que vous comptez lui consacrer pour lui donner une véritable ampleur et quelle est la mobilisation des acteurs et des jeunes sur ce projet, (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse.
Madame Rosso-Debord, je vous ai vue récemment, ainsi que Mme Greff et quelques-uns de vos collègues (« Ah ! » sur les bancs du groupe GDR), notamment M. Lesterlin, afin de travailler sur le service civique. Il y a sur ce point une attente formidable de la part des jeunes et des associations. C'est un projet mobilisateur, un projet de citoyenneté, un projet d'engagement, d'avenir, de générosité. S'il vous plaît, aidez-nous à le faire aboutir rapidement !
Nous avons inscrit les crédits – 40 millions d'euros pour l'année prochaine – et vous les avez votés. Nous avons constaté que les statuts du volontariat constituaient un véritable maquis. Le Sénat propose de les simplifier. Vous pouvez aller encore plus loin en inscrivant ce texte à l'ordre du jour. Les volontaires ont connu des déceptions au cours de ces dernières années, mais sont encore prêts à s'engager.
Nous travaillons sur des causes d'intérêt général : avec Benoît Apparu, pour que les jeunes s'impliquent aux côtés des associations travaillant avec les personnes en difficulté d'hébergement ; avec Chantal Jouanno, pour qu'ils puissent participer à l'établissement d'un répertoire de la biodiversité ; avec les associations, pour que des dizaines de milliers de jeunes puissent s'engager aux côtés des autres générations dans le domaine environnemental, social ou culturel, afin d'aider leur pays.
Il faut que nous soyons fiers d'avoir fait ce service civique. S'il vous plaît, inscrivons-le vite, travaillons vite, lançons-le vite ! Le Gouvernement est prêt à le faire, nous sommes à votre écoute pour l'améliorer, et les jeunes nous attendent, ils veulent rendre service à leur nation par un engagement civique en France, mais également dans les autres pays. Faisons en sorte que l'année prochaine, année européenne du volontariat, nous puissions effectivement, avec nos partenaires, être à la hauteur de cet engagement. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Sandrine Hurel, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Ma question, à laquelle j'associe ma collègue Monique Boulestin, s'adresse à Mme la ministre de la justice.
Comme vous le savez, partout dans le monde, en France, dans nos territoires, les enfants sont particulièrement vulnérables aux violations des droits de l'homme – maltraitance, exploitation sexuelle – et leurs opinions sont rarement prises en compte. La difficulté est grande pour eux de recourir à la justice afin de protéger leurs droits. C'est parce que, sur ces bancs, vous êtes tous conscients de la nécessité de protéger les enfants, que vous avez voté unanimement la loi du 6 mars 2000 instituant le Défenseur des enfants, comme le préconise la Convention internationale des droits de l'enfant.
Or, le 9 septembre dernier, le Président de la République a décidé de supprimer le Défenseur des enfants. (« C'est un scandale ! » sur les sur les bancs du groupe SRC.)
Quelles seront les conséquences d'une telle décision ? Ce sera, par exemple, la disparition de la mission de promotion et de protection des droits de l'enfant au sein de notre société, mais aussi la disparition de la mission de proposition législative pour garantir les droits de l'enfant, notamment son statut lors de séparations parentales conflictuelles ? Les droits des enfants vont, au mieux, se trouver dilués dans les droits des administrés, au pire, ne plus être défendus.
Cette décision entraînera également la disparition des correspondants territoriaux. Dans mon département, la Seine-Maritime, la déléguée a permis de signaler, entre autres, l'insuffisance de lits de pédo-psychiatrie, l'absence de structures adaptées pour les adolescents en souffrance psychologique. Le Conseil de l'Europe comme le Comité des droits de l'enfant de l'ONU non seulement recommandent le maintien de cette autorité indépendante, mais sollicitent un renforcement de ses missions.
Pour le vingtième anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant, que nous allons célébrer vendredi, le Président de la République décide que la France sera l'un des seuls pays européens à ne plus être doté d'un défenseur des droits des enfants. Madame la ministre, êtes-vous favorable à cette décision ? Surtout, que comptez-vous faire pour garantir le respect des droits fondamentaux des enfants dans notre pays ? (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Madame la députée, je vous rappelle que la réforme constitutionnelle de juillet 2008, créant un défenseur des droits et libertés, a été saluée quasi unanimement (« Non ! » sur les bancs du groupe SRC) comme une grande avancée en matière de défense des droits et des libertés.
La création d'une autorité indépendante ayant une grande visibilité, plus d'efficacité grâce à des moyens d'action et des moyens d'injonction importants, a, pour pouvoir prendre toute sa dimension, vocation à regrouper d'autres institutions, diverses et disposant de pouvoirs extrêmement différents, inférieurs à celui du défenseur et, surtout, d'une visibilité bien inférieure. C'est dans ce cadre qu'un regroupement est prévu.
Bien sûr, la spécificité de la défense des droits des enfants doit être pleinement préservée. La nouvelle institution préservera d'ailleurs les modalités d'action spécifiques qu'exige, c'est vrai, la défense des droits des enfants.
Ainsi, le Défenseur des droits sera assisté de personnalités qualifiées, dont une ou plusieurs dédiées aux missions particulières de protection de l'enfant.
De même, toutes les personnes de la mission actuelle participeront à cette nouvelle structure et à cette nouvelle mission.
Je veux vous dire, madame la députée, qu'il y a aura une discussion parlementaire, que je mènerai, comme je le fais toujours, dans un esprit de dialogue, parce qu'au-delà de nos différences, nous partageons tous, j'en suis sûr, le même objectif : protéger les enfants et les citoyens. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Philippe Morenvillier, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Madame la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, comme nous le savons tous, notre pays est à un tournant de son histoire audiovisuelle. Comme nous le souhaitons tous, l'avènement de la TNT ne doit laisser sur le bord de la route aucun de nos concitoyens. Vos annonces du 21 octobre m'ont, à ce titre, particulièrement réjoui. Mettre un terme aux menaces d'écran noir répandues de façon complètement contre-productive par certains était une action nécessaire, et même indispensable.
Pour aller plus au fond des choses, vos annonces ont enfin fait ressortir l'intérêt d'une solution bien trop méconnue ou ignorée : le satellite. Ce n'est pas faute de l'avoir inscrit dans la loi du 5 mars 2007 relative à la télévision du futur – que nous avons votée – mais je le redis : le satellite est la réponse pour couvrir les 5 % de la population qui ne le seront pas, en tout cas pas de façon aussi économique et directement opérationnelle, par voie hertzienne terrestre. J'en vaux pour preuve l'expérience de quelque 1,5 million de foyers de notre territoire. Situés depuis longtemps déjà hors des zones bien couvertes par le hertzien analogique, ces foyers ont été les premiers à se poser les questions que nous abordons aujourd'hui. Or ils reçoivent parfaitement par satellite, et depuis des années, les six chaînes de la télévision classique.
Madame la secrétaire d'État, pourriez-vous nous dire tout d'abord comment les mesures que vous avez annoncées le 21 octobre dernier seront concrètement mises en place ? Par ailleurs, pouvez-vous préciser comment les foyers qui utilisent actuellement les services de télévision analogique par le satellite seront accompagnés vers le tout numérique ? Il me semble indispensable de rassurer officiellement, et dès maintenant, ces foyers. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique.
Monsieur le député, les engagements du Gouvernement ont été réaffirmés, hier, par le Premier ministre lui-même devant le congrès des maires. Oui, 100 % des foyers recevront la TNT en France et le Gouvernement met tout en oeuvre pour qu'il n'y ait pas d'écran noir.
Le passage à la TNT permettra de libérer des fréquences et de développer de nouveaux services, comme l'internet à très haut débit mobile notamment dans les zones les moins denses du territoire. Quelque 277 millions d'euros sont consacrés à l'information du public et à l'accompagnement financier et technique des personnes les plus fragiles.
Par ailleurs, et vous l'avez signalé, le Premier ministre a souhaité, le 21 octobre, renforcer ce dispositif en particulier pour assurer l'équité des territoires.
Ces mesures ont été adoptées à l'unanimité des députés présents en commission des affaires économiques, le 4 novembre dernier. D'abord, la couverture hertzienne, c'est-à-dire par antenne râteau, sera étendue grâce à une augmentation de la puissance des émetteurs. Tous les foyers qui recevaient la télévision par antenne râteau et se trouveraient en zone d'ombre du numérique bénéficieront d'une aide pour recevoir la TNT par satellite. Cela représente 96 millions d'euros en tout. Nous avons donc ajouté aux 40 millions initialement prévus une enveloppe supplémentaire de 56 millions à l'occasion des décisions du 21 octobre. Conformément aux demandes des élus, nous solliciterons les chaînes pour qu'elles puissent participer à cet effort.
Certaines collectivités souhaitent maintenir la diffusion hertzienne même pour un nombre limité de foyers : c'est un choix qui leur appartient ; l'État les accompagnera financièrement.
S'agissant des foyers qui reçoivent actuellement la télévision analogique par satellite, sachez que, pour eux, les délais sont différents. Les chaînes diffusées par ce moyen ne s'arrêteront pas au 30 novembre 2011. Bien entendu, ces foyers seront eux aussi accompagnés vers la TNT en temps utile. C'est un engagement du Gouvernement. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Christophe Caresche, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le ministre de l'intérieur, je voudrais revenir à l'excellente question de notre collègue Martine Aurillac, à laquelle vous n'avez pas, hier, totalement répondu. Elle portait sur ce projet, abject, visant à distribuer de l'argent dans le cadre d'une opération promotionnelle, près du Champ de Mars.
Mme Aurillac vous a demandé si cette manifestation avait été autorisée. Or vous n'avez pas répondu à cette question, pourtant simple et précise. Je vous la pose donc à nouveau : la préfecture a-t-elle autorisé cette manifestation ?

L'avocat des organisateurs l'affirme puisqu'il a déclaré que la préfecture de police avait donné son accord le 10 novembre. (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC.) Si tel est bien le cas, je voudrais vous poser deux questions subsidiaires.
D'abord, comment expliquer que l'État ait autorisé une telle manifestation alors que la distribution d'argent est un délit et que le risque de trouble à l'ordre public était manifeste ? Ensuite, sur quel fondement l'État envisage-t-il de poursuivre, comme vous l'avez indiqué hier, les organisateurs d'une manifestation qu'il a lui-même autorisée ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Monsieur le député, vous posez une question précise : quelles sont les raisons qui ont conduit le préfet de police à ne pas interdire cette manifestation ? (Rires et exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Ma réponse se fonde sur deux points de droit.
Tout d'abord, la distribution d'argent sur la voie publique est, certes, illégale mais, en l'état actuel du droit, et contrairement à ce que vous avez indiqué, elle n'est punissable que si elle est constatée. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Cela signifie qu'elle constitue une contravention, laquelle s'élève à 150 euros : un tel montant a assez peu ému l'organisateur.
Par ailleurs, vous avez raison : il n'est pas possible d'interdire un événement public sauf s'il est établi que celui-ci présente un risque de trouble manifeste. Or, dans ce domaine, il n'y avait pas de précédent. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Et la jurisprudence, à juste titre du reste, est très restrictive sur les conditions d'interdiction des manifestations.
L'important est de réagir et de tirer un certain nombre d'enseignements.
Premièrement, je vous le confirme, j'ai porté plainte au pénal, devant le procureur de Paris, contre la société qui a commis cette infraction, pour mise en danger de la vie d'autrui car, en incitant des milliers de personnes à venir pour son opération, elle les a bel et bien mises en danger. Voilà une réponse précise à votre question, même si cela vous gêne !
Deuxièmement, je suis déterminé à faire en sorte que le contribuable ne soit pas la victime de ces opérations de marketing privé. Je présenterai donc la facture. Celle-ci est estimée à plus de 100 000 euros. Les organisateurs sont d'ores et déjà mis en demeure de rembourser.
Troisièmement, afin que de tels errements ne se reproduisent plus à l'avenir, je souhaite que la LOPSI comporte des dispositions transformant cette contravention en délit et qu'on envisage une amende égale à dix fois la somme qui aurait été ainsi distribuée.
Ces mesures sont utiles et se révèleront totalement dissuasives à l'avenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Projet de distribution de billets sur le Champ de Mars

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Marc Laffineur.)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (nos 1237, 2007).
Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de cinq heures cinquante-quatre minutes pour le groupe UMP, huit heures vingt-quatre pour le groupe SRC, trois heures quarante-deux pour le groupe GDR, trois heures huit pour le groupe NC et dix-neuf minutes pour les députés non inscrits.

La parole est à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Si vous voulez, monsieur le député ! (Sourires.)
Je vais tout de même prendre un peu de temps pour répondre aux différents orateurs qui se sont exprimés.
C'est sans doute parce qu'on estime que je n'en ai pas besoin et que je me peux me défendre toute seule ! (Sourires.)

Vous n'avez pas la parole, mes chers collègues ! Laissez Mme la ministre s'exprimer.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je voudrais d'abord exprimer quelques remerciements.
Je remercie en tout premier lieu M. le rapporteur. Je remercie également les orateurs qui ont soutenu à la fois la philosophie et le dispositif général du présent texte.
Ceux qui ont soutenu le texte ont exprimé des idées très diverses. Des amendements ont été déposés. Ils seront étudiés dans un esprit qui, de ma part, visera toujours à être constructif. J'estime, comme je l'ai dit au début de la discussion de ce texte, que c'est par une bonne entente entre le Gouvernement et le Parlement qu'il est possible d'améliorer un texte et d'avancer vers des solutions sur un certain nombre de problèmes.
L'opposition a joué son rôle d'opposition et c'est normal dans notre démocratie. Je passe, bien entendu, sur certains propos caricaturaux, qui n'apportent strictement rien. En revanche, je veux souligner que d'autres positions, avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, méritent le respect et suscitent l'intérêt. Elles ont permis d'exposer des visions différentes, voire de faire émerger des propositions.
Je ne puis évidemment partager les analyses du projet de loi développées par MM. Raimbourg et Urvoas. En particulier, il est un peu caricatural – je n'oserai dire de mauvaise foi – de comparer la rétention et la surveillance de sûreté avec la relégation qui existait au siècle dernier. On voit bien qu'avec de tels propos, on entre dans l'outrance. Or vous êtes, les uns et les autres, de trop fins juristes pour ne pas savoir que la rétention et la surveillance de sûreté sont des mesures exceptionnelles, ne pouvant être ordonnées que par l'autorité judiciaire et dans des conditions particulièrement restrictives, alors que la relégation était un enfermement automatique et perpétuel des récidivistes.
La rétention et la surveillance peuvent être prononcées lorsque le risque que font courir certaines personnes est suffisant, qu'il est établi par des évaluations pluridisciplinaires. De plus, je le rappelle, la rétention et la surveillance ne sont prononcées que pour des périodes limitées, qui ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions où elles ont été prononcées.
Ainsi, les mesures – ne l'oublions jamais, car c'est, je crois, notre préoccupation commune – créées par la loi de 2008, que le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer, ont bien pour finalité la resocialisation de la personne. Elles visent à diminuer la dangerosité des récidivistes. Cela n'a donc rigoureusement rien à voir avec la relégation ou la tutelle pénale.
MM. Goujon, Hunault, Aeschlimann ont parfaitement indiqué les enjeux du texte : mieux protéger les victimes, pas uniquement contre la récidive ou la réitération, mais également contre les premiers faits d'agression ou de violence. Mme Barèges, MM. Morel-A-L'Huissier et Ciotti ont aussi rappelé l'importance du partage de l'information entre tous les intervenants de la chaîne de la sécurité pour assurer et la sécurité de nos concitoyens et les capacités de réinsertion de celui qui a été condamné. Je veux les remercier de leur soutien.
Plusieurs orateurs, dont M. Vaxès, se sont étonnés que le projet de loi ne reprenne pas l'ensemble des propositions du rapport Lamanda. Le projet reprend, c'est évident, les dispositions de nature législative de ce rapport. Nous sommes en présence du partage du domaine de la loi des articles 34 et 37.
Dans le rapport Lamanda, il y a, bien entendu, de nombreuses autres propositions intéressantes qui ne sont pas de nature législative. Je pense à la promotion de la recherche et de l'enseignement en criminologie. Je crois savoir que M. le rapporteur a d'ailleurs des idées très particulières sur l'enseignement de la criminologie, dont probablement la création de nouvelles disciplines qui pourraient répondre à certaines de nos préoccupations en rapprochant les problématiques de la psychiatrie et de la criminologie.
Le rapport Lamanda suggère de numériser les dossiers des condamnés ou de créer un référentiel des normes de suivi des condamnés. Je suis extrêmement favorable à ces propositions, mais la loi ne peut ordonner leur mise en oeuvre.
Vous avez dit, messieurs, à juste titre, qu'il fallait éviter les lois d'affichage. C'est justement ce que je m'efforce de faire, en faisant respecter le domaine de la loi.
J'ai également relevé quelques points sur les principaux axes du projet. La question de la réduction des peines a été soulevée par plusieurs orateurs, dont M. Nicolin, Mme Besse ou M. Dupont-Aignan. Je sais parfaitement – nous en avons parlé tout à l'heure encore lors des questions au Gouvernement – que ces réductions de peine peuvent paraître surprenantes à nos concitoyens et qu'elles leur donnent le sentiment que la peine n'est pas totalement exécutée. Mais il faut rappeler un certain nombre de choses. D'abord, les réductions de peine ne sont pas de plein droit, même quand elles sont automatiques. Le juge de l'application des peines peut tout à fait décider de les refuser en fonction du comportement du détenu. D'ores et déjà, la loi prend en compte certaines situations en prévoyant, pour les récidivistes, une limitation de moitié du crédit de réduction de peine par rapport à celui des autres détenus.
N'oublions pas, mesdames, messieurs, que l'objectif du crédit de réduction de peines dont bénéficie tout détenu n'est pas simplement de diminuer la durée de sa détention. C'est un outil qui se veut efficace pour permettre de sanctionner un mauvais comportement en détention, par le retrait total ou partiel du crédit de réduction de peine. C'est donc un élément important d'incitation pour le détenu à bien se comporter en prison. Il ne s'agit pas simplement pour lui d'avoir un comportement normal ; il faut aussi qu'il soit prêt à accepter certaines mesures visant à lutter contre la récidive, notamment à accepter des soins en détention. C'est, en quelque sorte, une épée de Damoclès. Nous avons commencé à parler, hier, des mesures de suivi médical et social. De la même façon, si le détenu ne respecte pas la surveillance qui pèsera sur lui à sa libération, il sera possible encore de la lui retirer, ce qui entraînera son retour en prison.
Je sais bien que la présentation est parfois difficile, mais je crois que le dispositif prend bien en compte les différents cas de figure.
Certains parlementaires, notamment MM. Raimbourg et Vallini, ont insisté tout particulièrement sur le problème des médecins coordonnateurs au titre des moyens mis en oeuvre pour l'injonction de soins. Il est évident que notre objectif est d'augmenter le nombre des médecins coordonnateurs. Nous prenons progressivement des mesures concrètes pour faire en sorte qu'il y en ait davantage. Ainsi, l'arrêté du 24 janvier 2008 a revalorisé l'indemnité des médecins coordonnateurs. Il a également porté à vingt le nombre de personnes qui peuvent être suivies par un médecin coordonnateur, ce qui est aussi une façon de rendre cette fonction plus attractive en mutualisant davantage les efforts. L'arrêté du 24 mars 2009 a permis à des médecins non psychiatres d'exercer la fonction de médecin coordonnateur, après le suivi d'une formation spécifique.
Compte tenu de tout cela, vous ne pouvez pas dire que des mesures n'ont pas été prises pour avancer dans ce domaine. Nous avançons lentement. Il est vrai qu'il y a, aujourd'hui, quatre médecins coordonnateurs de plus qu'il n'y en avait au début de l'année 2009. Il faut continuer.
Toutefois, nous nous heurtons à un problème plus général. Dans quinze départements qui ne sont pas dotés de médecins coordonnateurs, le véritable problème est la désertification médicale. Celle-ci s'étend aussi au cas particulier des médecins coordonnateurs. Je suis particulièrement attentive aux résultats des efforts menés au plan local par les autorités judiciaires, qui effectuent des démarches, notamment auprès des ordres départementaux de médecins, pour mieux faire connaître la fonction de médecin coordonnateur, qui n'est pas forcément bien connue, et susciter des candidatures.
Parmi les thèmes retenus et développés hier, la question du traitement inhibiteur de la libido a été évoquée par de très nombreux orateurs, pratiquement sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée.
Je ne peux, bien entendu, pas souscrire aux propos tenus par Mme Pau-Langevin, qui a fait part de son scepticisme sur l'efficacité de ces traitements. Elle est d'ailleurs très isolée dans sa position, puisque nous avons entendu des personnes, qui ont la compétence et l'expérience nécessaires pour en parler dans cet hémicycle, confirmer que si le traitement n'a pas d'effets dans tous les cas, lorsqu'il en a, ils sont significatifs. C'est également ce qui a été rappelé par le docteur Cordier, dans une interview publiée dans Le Monde hier. L'efficacité de ces traitements n'est pas apparue à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Déjà, lors de l'adoption de la loi de juin 1998, qui a créé le suivi sociojudiciaire, elle était invoquée et présentée comme un facteur positif. En la matière, je crois que nous devons reconnaître, tout en disant que ce n'est pas la seule solution, que ces traitements doivent également s'accompagner de traitements psychiatriques, qu'il y a là une voie à ne pas négliger.
Je ne saurai suivre certains parlementaires qui suggèrent de ne rien faire sous prétexte que ces traitements n'auraient pas une efficacité prouvée dans 100 % des cas. Doit-on, au motif qu'il peut y avoir des cas qui échappent, ne rien faire ? Cela me paraît être une attitude peu responsable.
Je crois – ce sont les arguments que j'ai développés hier et que je continuerai à développer au cours de cette présentation – que la loi doit donner au praticien une palette de réponses à mettre en oeuvre au cas par cas. Dans cette perspective, il faut effectivement améliorer le dispositif d'injonction de soins, comme l'ont souhaité, hier soir, M. Debré ou Mme Besse, notamment en ce qui concerne les auteurs de viols contre mineurs.
Mesdames, messieurs les députés, je n'ai sans doute pas répondu dans le détail à chacune des questions que vous avez soulevées. J'ai essayé de répondre aux grandes lignes de vos interrogations, que ce soit dans la majorité, que je remercie encore une fois de son soutien, ou dans l'opposition, que je remercie de sa contribution à la réflexion. Nous aurons l'occasion d'examiner plus en détail toutes ces questions au cours de la discussion des amendements. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Nous en arrivons à la discussion des articles.
J'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi.

Madame la garde des sceaux, permettez-moi, au préalable, de formuler, une remarque sur la réponse que vous venez de nous fournir concernant la discussion générale.
J'ai noté moi-même – sans doute l'avez-vous observé – qu'une série des propositions du rapport Lamanda étaient de nature réglementaire et non législative. J'ai évoqué le problème parce que je souhaite que le Gouvernement nous indique les suites qu'il entend donner à la vingtaine de propositions non retenues. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté un certain nombre d'amendements sous forme de demandes de rapports : l'article 40 ne nous permettant pas de prendre des engagements financiers, ils vous permettront de nous faire part des intentions du Gouvernement quant aux propositions qui me semblent de nature à combattre efficacement la récidive.
L'article 1er A a été ajouté par la commission. Selon le rapporteur, il a pour objet de réparer une omission de la loi du 25 février 1998 sur la rétention de sûreté. Il étend le champ des infractions susceptibles de se voir appliquer la rétention de sûreté. Nous sommes résolument opposés à cette loi et à la philosophie qu'elle sous-tend.
Je rappelle que, lors de la présentation du projet de loi, Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, nous avait promis, la main sur le coeur, que l'application de la rétention de sûreté devrait être restreinte aux cas extrêmes n'offrant aucune autre solution. Elle tenait ainsi à rassurer l'opposition, soucieuse du respect des exigences constitutionnelles et des libertés individuelles, en affirmant que cette détention après la détention ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre d'une catégorie bien spécifique de condamnés : ceux qui se seraient rendus coupables de crimes sur mineurs. Quelques heures plus tard – vous vous en souvenez, monsieur le rapporteur –, la rétention de sûreté s'appliquait aux crimes commis sur les majeurs !
Démonstration était faite, si besoin était, que ce qui est présenté dans un premier temps comme exceptionnel devient très vite ordinaire. Aujourd'hui, moins de deux ans après le vote de cette loi, on étend encore l'utilisation de la rétention de sûreté. Qu'en sera-t-il dans un an, deux ans, trois ans, lorsque quelques faits divers relanceront le débat qui nous réunit aujourd'hui ? C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la suppression de cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas, pour présenter l'amendement n° 56 .

Notre amendement tend également à supprimer l'article 1er A.
De notre point de vue, la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 sur la rétention de sûreté aurait dû combler le Président de la République. Il était, en effet, quasi inespéré que le Conseil constitutionnel acceptât l'instauration d'une possibilité d'enfermement à vie, et qu'après avoir purgé sa peine sans avoir commis le moindre acte nouveau répréhensible, une personne puisse être enfermée uniquement en raison d'un comportement réputé dangereux pour elle-même ou pour autrui. Le Conseil constitutionnel a validé l'interprétation selon laquelle l'enfermement n'est pas une peine, ni même une sanction, mais une mesure de sûreté. Cela fut une grande surprise pour beaucoup de juristes, qui se demandent d'ailleurs toujours ce qu'est la rétention de sûreté si elle n'est ni une peine ni une sanction punitive.
Si nous respectons la décision du Conseil constitutionnel, il n'empêche que nous la regrettons. Selon nous, le chef de l'État aurait dû se réjouir d'un tel sophisme. Manifestement, cela n'a pas suffi. C'est pourquoi il faut un nouveau texte. Faute de pouvoir l'approuver, nous contribuerons à la réflexion.
Déduire le droit d'un fait divers est, selon nous, une impasse. Nous avons largement démontré – et les exemples, hélas ! parlent d'eux-mêmes – que votre rhétorique politique s'épuisait dans une vaine réactivité à l'événement. Plutôt que de prévoir ou de promettre une improbable société irénique, vous devriez consacrer l'énergie gouvernementale à appliquer les lois existantes, au premier chef la loi de 1998 qui avait une ambition autrement plus importante que le texte que vous proposez. Cette loi de 1998 visait à s'attaquer aux infractions sexuelles, à leur répression, mais également à leur prévention, sans attendre le premier passage à l'acte. Or, alors que nous parlons de récidive, que constatons-nous ? Que les prisons sont remplies non de récidivistes, mais de personnes coupables d'avoir commis leur premier acte d'agression sexuelle. Dominique Raimbourg a, à cet égard, rappelé en commission des lois que 8 000 personnes étaient condamnées pour agression sexuelle. La loi de 1998 a prévu les outils pour prévenir les passages à l'acte.
Ce dont nous avons besoin, c'est de moyens – et vous venez de dire, madame la garde des sceaux que vous vous y atteliez, c'est une bonne chose –, pas d'une nouvelle loi qui suscite l'inquiétude du monde médical. Permettez-moi de vous rappeler les propos du docteur Cochez, qui dirige un service spécialisé dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles dans un centre hospitalier de Bordeaux. Selon lui, « on ne sait pas dire qui est dangereux ou qui ne l'est pas ». Les traitements dont on parle, on ne les propose dans son centre qu'à peu de personnes au total ; lui-même ne l'a fait qu'à 20 % des malades qu'il suit. « J'angoisse – dit-il – de devenir un juge en blouse blanche. La pression mise sur les médecins n'a jamais été aussi forte. Alors que le soin doit être adapté à chaque patient, on se heurte à une loi qui systématise la prise en charge autour d'un enjeu : l'incarcération. C'est inquiétant. »
Voilà une loi que les médecins n'attendent pas. Nous disposons de tous les outils pour suivre et contrôler les délinquants sexuels. Ce qui compte, c'est de dégager des moyens, humains ou financiers, en aucune manière, de voter un nouveau texte.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 1er A.

La parole est M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Non, monsieur Urvoas, nous ne disposons pas de tous les outils nécessaires, et le projet de loi qui vous est proposé permet de compléter le dispositif des mesures de sûreté. Vous entretenez à dessein la confusion entre les peines et les mesures de sûreté qui sont, sur le plan juridique, différentes. Du reste, le Conseil constitutionnel a validé cette différence de définition. Quant à la loi de 1998 sur le suivi sociojudiciaire – très important, j'en conviens –, là encore, vous entretenez la confusion : le suivi sociojudiciaire est une peine et non une mesure de sûreté. Vous ne pouvez donc faire le parallèle entre les deux.
Les deux amendements identiques visent purement et simplement à supprimer l'article 1er A parce que vous êtes, en réalité, opposés aux mesures de rétention de sûreté. Vous avez une opposition de principe sur cette question. Je suis évidemment en total désaccord sur ce point avec vous ; c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à ces deux amendements.
La jurisprudence nous ayant donné quelques signaux, l'article 1er A remédie à une omission dans la loi du 25 février 2008 pour que la mesure puisse s'appliquer aux récidivistes.
Avis également défavorable.
Lorsque nous parlons des moyens de mise en oeuvre des textes, il faut distinguer entre les moyens juridiques et les moyens matériels. Concernant les premiers, je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire excellemment le rapporteur. S'agissant des seconds, permettez-moi simplement de dire que si la loi de 1998 était aussi formidable que vous le prétendez, je ne comprends pas pourquoi vos gouvernements, entre 1998 et 2002, ne les ont pas mis en oeuvre !

Nous sommes au coeur du débat et, contrairement à ce que vous affirmez, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, nous n'entretenons aucune confusion. Nous sommes contre l'application d'une mesure supplémentaire après qu'une personne ait purgé sa peine pour répondre à une éventuelle dangerosité de cette personne. Le débat n'est pas nouveau.

Permettez-moi de vous lire quelques lignes extraites d'un débat sur les prisons qui a eu lieu dans notre assemblée. L'orateur, qui n'est autre que Victor Hugo, parle de nouvelles peines prévues dans un projet de loi :
« N'en faites pas le prolongement inutile d'un châtiment afflictif subi et complet, ne l'ajoutez pas, le jour de la délivrance, à la destinée d'un malheureux amendé et repentant, comme supplément, comme luxe, comme si la loi disait : Ah ! j'ai oublié quelque chose !
« C'est ébranler, par cette infliction superflue, la solidité de ce repentir et par conséquent la paix de la société, créer un danger en s'imaginant qu'on prend une précaution, couronner la justice par l'injustice. Oh ! messieurs ; j'y insiste, ce serait un triste leurre et un étrange travail que celui-ci : Votre loi pénitentiaire s'efforçant de rendre aux condamnés un avenir que votre loi pénale leur aurait retiré à jamais ! »

Ce débat, mes chers collègues, a eu lieu en 1847, pourtant, il fait penser à aujourd'hui !

Sauf que nous sommes à fronts renversés sur les rôles respectifs de la loi pénale et de la loi pénitentiaire. Nous avons, d'une part, la loi pénitentiaire dont le propos est de préparer la sortie de prison et, d'autre part, la loi pénale qui tourne résolument le dos à cette évolution, sur la base – et c'est le fond de l'affaire – de la notion de dangerosité.
La définition, ou plutôt l'absence de définition et de certitude, de l'appréciation psychiatrique part d'une erreur. Nous sommes devant une difficulté à laquelle le Gouvernement doit répondre. Peut-on traiter la récidive uniquement en prenant en compte la population concernée dans son aspect psychiatrique ? La difficulté réside là depuis la question posée par le Président de la République à M. Lamanda à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Comment répondre globalement aux cas de ces criminels en ne visant que ceux qui présentent des troubles de nature psychiatrique ? Qu'en est-il des autres par rapport à cette délinquance spécifique ? Une partie seulement est traitée. C'est une des limites de votre loi qui justifie les initiatives prises par le rapporteur. Or la réponse – qui n'est pas facile – ne se trouve certainement pas dans l'aggravation de la situation pénale. Après chaque fait divers, vous serez amenés à aggraver ou à étendre le champ d'application de votre nouveau dispositif.

Et parce que les causes sont ailleurs, vous serez obligés de légiférer. Vous nous proposez une fuite en avant permanente en tournant délibérément le dos aux principes du droit pénal qui faisaient consensus.
Le débat n'est pas nouveau.
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Il s'en est fallu de peu !

Je suis saisi d'un amendement rédactionnel, n° 12, de M. Jean-Paul Garraud.
(L'amendement n° 12 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L'article 1er A, amendé, est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 25 portant article additionnel avant l'article 1er.
La parole est à M. Michel Vaxès.

Notre amendement vise à abroger la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Se protéger du risque de récidive ne doit pas signifier un enfermement ad vitam aeternam sur simple présomption de dangerosité. Même si vous ne souhaitez pas qu'on parle de peine, il s'agit tout de même d'un enfermement. Que vous le vouliez ou non, le texte prévoit la possibilité de renouveler la décision de rétention de sûreté aussi longtemps qu'on considérera qu'il y a une dangerosité potentielle.
Pour protéger notre société de ce risque, il faut le traiter. Mme la garde des sceaux ainsi que M. le rapporteur ont reconnu que les moyens de traitement existent ; ils ont notamment été mis en place par la loi de 1998, laquelle a posé le principe des soins en prison pour les délinquants sexuels et instauré le suivi sociojudiciaire. Cette loi propose une prise en charge psychiatrique et thérapeutique qui débute en prison et peut se poursuivre après la sortie par la mise en place du suivi sociojudiciaire avec injonction de soins.
Aujourd'hui – et le problème est là –, l'institution ne dispose pas des moyens de l'appliquer. C'est donc sur cet aspect qu'il incombe au Gouvernement de porter ses efforts et non sur la mise en place d'une peine perpétuelle – car il s'agit bien de cela – pour masquer la responsabilité de l'État dans l'absence de prise en charge des détenus jugés particulièrement dangereux.
Pourquoi ne donnez-vous pas les moyens de la mise en place d'un suivi médicosocial effectif dès le début de l'incarcération ? Pourquoi attendre la fin de la peine pour mettre en oeuvre un suivi sérieux ? Pourquoi ne pas proposer de placer la personne condamnée dans un centre socio-médico-judiciaire dès le début de la peine ? On gagnerait du temps !
Vous ne tentez de remédier aux insuffisances de notre système carcéral que par une logique d'enfermement. Or cette logique, au-delà de la philosophie douteuse qui la sous-tend, est dangereuse : elle vous a conduit à opérer dans ce texte des choix qui nous paraissent entièrement irrationnels.
Tout d'abord, vous remettez la décision entre les mains d'experts psychiatres qui devront se prononcer sur la dangerosité du condamné. Rappelons pourtant avec M. Senon, professeur de psychiatrie, la prudence des recommandations de la Haute autorité de santé, laquelle distingue dangerosité psychiatrique et criminologique et réserve aux psychiatres et psychologues dotés d'une formation complémentaire en psycho-criminologie l'évaluation de la dangerosité criminologique, selon une approche multidisciplinaire associant le champ socio-éducatif. La psychiatrie doit contribuer à la prise en charge socio-médico-psychologique et non se substituer au juge pour décider le placement en rétention d'un détenu ayant déjà effectué sa peine.
En outre, je l'ai dit, ce texte bafoue les principes fondamentaux de notre droit pénal. Ainsi, la rétention sera décidée non parce que le crime aura été commis, mais parce que l'on craindra qu'il le soit. Vous hochez la tête, monsieur le rapporteur ; permettez-moi néanmoins de citer l'appel du 20 mars 2008 demandant l'abolition de la rétention de sûreté, appel que je reprends à mon compte.
« Parce que la rétention de sûreté, comparable dans sa philosophie à la peine de mort, est une peine d'élimination préventive susceptible de graves dérives ; parce que la rétention de sûreté ajoute de l'enfermement à la peine de prison, déjà anormalement longue en France au regard des standards européens, et constitue en conséquence un traitement inhumain et dégradant ; parce que la rétention de sûreté implique un pronostic arbitraire de la “dangerosité”, dont les contours ne peuvent être clairement définis ni par les psychiatres, ni par les juristes ; parce que la rétention de sûreté crée l'illusion du “risque zéro” de récidive par l'exploitation démagogique de la douleur des victimes ; parce que la rétention de sûreté témoigne du renoncement des pouvoirs publics à faire de la prison un temps utile à la prévention de la récidive et à la réinsertion ; parce que la rétention de sûreté, malgré l'accomplissement de la peine, n'autorise plus l'oubli du crime, réduisant ainsi la personne à son acte criminel passé avec le risque de l'y enfermer à jamais ; parce que la rétention de sûreté est une violence institutionnelle inacceptable qui prive les détenus de tout espoir de liberté ; pour toutes ces raisons, la rétention de sûreté n'est en aucun cas un instrument de prévention de la récidive et de protection des citoyens. » Nous nous associons à tous les signataires de cet appel pour vous demander l'abrogation de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Avis défavorable.
Il n'est évidemment pas question d'abroger la loi du 25 février 2008,…

…dont le principe a été validé par la juridiction suprême, le Conseil constitutionnel – à moins que vous n'alliez jusqu'à contester ce dernier !
Je rappelle, en outre, que le principe d'une mesure de sûreté existe dans de nombreux autres pays, dont les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Belgique.
Je ne vois donc pas du tout pourquoi vous demandez l'abrogation de cette loi tout à fait indispensable ; je suis, je le répète, radicalement opposé à cette abrogation.
Même avis.
Certes, nous pouvons être en désaccord sur certains sujets pour des raisons idéologiques ; mais je me demande, monsieur Vaxès, si vous avez bien conscience du fait que les personnes dont vous parlez sont des récidivistes, coupables qui plus est de crimes particulièrement graves et odieux.

Il me semble au contraire que M. Vaxès a parfaitement exprimé le problème que nous pose la rétention de sûreté.
Inutile de reprendre son excellente démonstration : la rétention de sûreté est totalement contraire aux principes de notre droit, attentatoire aux libertés, et elle contresigne en quelque sorte l'échec du temps de l'emprisonnement lorsqu'elle est conçue, comme dans la loi du 25 février 2008, comme devant s'ajouter à la première peine d'emprisonnement.
Sur ce dernier point, le propos de M. Vaxès était très intéressant. Monsieur Garraud, vous venez de dire que la peine de rétention de sûreté existe dans des pays démocratiques, ce qu'ils sont effectivement même si leur tradition pénale diffère de la nôtre ; et vous avez cité l'Allemagne. Or je crois avoir lu dans votre rapport – à moins que ce ne soit dans celui de MM. Goujon et Gautier, qui constitue comme le vôtre une très intéressante source d'information – que, dans plusieurs pays, la peine équivalente à la rétention de sûreté se substitue à la prison.
Il s'agit là d'une innovation intelligente : on considère qu'en raison de la gravité, voire de la barbarie des actes qu'elle a commis, ainsi que de sa personnalité, de ses troubles et de ses antécédents psychiatriques, la personne concernée n'est pas justiciable d'un emprisonnement classique, fût-il assorti de soins, mais doit être placée dans une structure ad hoc qui se substitue à la prison.
Telle est la voie sur laquelle nous aurions pu progresser. Difficile, jalonnée de chausse-trappes et fondée sur des présupposés complexes, elle avait du moins l'avantage de ne pas ajouter la peine infinie à l'enfermement perpétuel – puisque, nous l'avons démontré, la lourde responsabilité que vous confiez au collège des experts destine le plus souvent la rétention de sûreté à durer indéfiniment et à devenir une nouvelle perpétuité.
Enfin, Mme la ministre a fait allusion à un article du Monde d'hier soir, qui fournit un bon compte rendu de nos travaux et propose des éclairages utiles. J'ai été particulièrement intéressé par la description de la seule personne aujourd'hui placée en surveillance, ou en rétention, de sûreté – de ce point de vue, l'article n'était pas très clair. Il se prénomme Jean-Pascal ; il n'y a naturellement aucune raison de citer son nom de famille. Condamné pour viol, récidiviste, me semble-t-il, et extrêmement perturbé, à l'issue d'un emprisonnement ponctué d'hospitalisations d'office, il a été de nouveau hospitalisé d'office sous le régime de la rétention de sûreté, faute de solution et parce qu'aucun hôpital psychiatrique ne voulait de lui, y compris dans le département d'outre-mer dont il est originaire.
Ce cas, si je l'ai bien compris, témoigne de l'impasse où nous mène la rétention de sûreté. Nous sommes en train de bâtir ce système faute d'approfondir ce que pourrait être une hospitalisation psychiatrique pour les cas les plus lourds, rénovée mais soignante, et parce que l'on veut faire croire que l'on peut successivement punir et soigner. Or c'est exactement l'inverse qu'il faut faire.

Je ne peux laisser passer toutes ces caricatures, ni la manière dont on tente de reprendre le débat sur la loi du 25 février 2008 instaurant le régime de la rétention de sûreté.
Celle-ci n'est pas une peine, puisque la question du placement en rétention de sûreté se pose justement à l'expiration de la peine. Il s'agit d'un placement non en prison, mais en centre de suivi socio-médico-judiciaire. Elle n'est ni attentatoire aux libertés ni contraire aux droits des personnes, bien au contraire, puisqu'elle requiert que des juridictions en aient accepté le principe et que la cour d'assises, lorsqu'elle a statué sur la peine, ait auguré de ce placement à l'issue de la peine.
En outre, elle n'est pas décidée n'importe comment. Quand, à l'issue de la peine, on constate que, malgré l'obligation de soins et les traitements administrés, la remise en liberté ferait courir de graves dangers aux citoyens et à la société et risquerait de faire de nouvelles victimes, et dans ce cas seulement, un an avant la libération – et non au dernier moment –, un collège d'experts composé de psychiatres et de psychologues, doit examiner la personne concernée, étudier sa pathologie et vérifier si elle présente un degré de dangerosité tel que sa remise en liberté entraînerait de graves risques de récidive.
Dans cette hypothèse, les magistrats d'une juridiction régionale composée de présidents de cours d'appel – il ne s'agit donc pas de n'importe qui – statuent sur le placement en rétention, c'est-à-dire, je le répète, non en prison, mais dans un centre de suivi socio-médico-judiciaire.
Ce débat est derrière nous ; il a été clos par la loi du 25 février 2008. Aujourd'hui, il s'agit d'appliquer cette mesure à toutes les personnes qui, du fait de la non-rétroactivité de cette loi, pourraient y être soustraites alors qu'elles doivent lui être soumises pour le bien de la société et afin d'éviter de futures victimes.
Pour ces raisons, je souscris moi aussi au rejet de cet amendement.

Je suis atterré par ce que j'entends. Nos collègues de l'opposition n'ont aucun argument : ils nous repassent en boucle le même discours.

Mais je vous écoute : au nom des bonnes consciences, vous êtes prêts à excuser toutes les horreurs ! (Protestations sur les bancs du groupe SRC.)

Je vous en prie ! M. Roubaud a seul la parole ; si vous voulez la reprendre, vous le pourrez.

Je le répète : au nom des bonnes consciences, vous êtes prêts à excuser toutes les horreurs de la terre. (Vives protestations sur les bancs du groupe SRC.)

La réalité est là ; le rapporteur et Mme la ministre l'ont excellemment dit tout à l'heure. En voici la meilleure preuve : M. Vaxès a déclaré tout à l'heure qu'il ne voulait pas entrer dans la prise en considération démagogique de la douleur des victimes. Voilà où en est la gauche ! (Même mouvement.)

Vous sortez mes propos de leur contexte et vous dites n'importe quoi. Vous les interprétez mal !

Vous affirmez, chers collègues, que la décision de placement en rétention de sûreté sera très encadrée et que le collège d'experts apportera des garanties.
Deux remarques : tout d'abord, lorsque nous avons examiné la loi sur la récidive, nous avons entendu ici même la garde des sceaux de l'époque, Rachida Dati, soutenir que cette loi concernerait les mineurs et eux seuls.

Or, je l'ai rappelé tout à l'heure, il a été décidé quelques heures plus tard de l'étendre aux personnes majeures, malgré l'engagement pris ici même. Puis, deux ans après, on étend à nouveau les critères d'application de cette loi.

Il faut être conséquent et s'en tenir à ce que l'on a dit. Or, bien que l'on nous ait dit à plusieurs reprises la même chose, on a étendu à plusieurs reprises les conditions d'application de la loi.
Vous dites que le collège d'experts apporte des garanties. Certes, il vaut mieux que la décision soit prise par un collège plutôt que par des juristes ou des psychiatres seuls. Mais, récemment encore, lorsque des personnes dont plusieurs juridictions avaient décidé la remise en liberté en toute légalité ont récidivé, les juges ont été mis au ban par les politiques. Cela signifie qu'une pression considérable s'exercera sur ces experts.
Enfin, il s'agit aussi d'un problème de philosophie. Là où nous pensons qu'un traitement est possible si l'on s'en donne les moyens, vous répondez, comme je l'ai entendu hier soir, que le traitement n'est pas possible et que l'enfermement est nécessaire. Mais, tant que l'on n'engagera pas les moyens indispensables au traitement, l'enfermement sera la seule réponse. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Or vous n'engagerez pas ces moyens ; du moins, vous ne souhaitez pas le faire aujourd'hui.
Le risque d'un enfermement ad vitam aeternam est une réalité.

Ne dites pas cela aujourd'hui : dans deux semaines, trois mois ou trois ans, je pourrais vous reprendre. Il y a quatre ans, j'affirmais que les dispositions de prévention de la délinquance que vous présentiez ne règleraient pas le problème. Aujourd'hui, la délinquance a augmenté : vous ne pouvez le nier, vos propres statistiques le montrent. Depuis 2002, vous avez proposé de multiples dispositions et le problème n'est toujours pas résolu.
Il faut peut-être chercher les explications ailleurs. Nous avons fait des propositions et nous continuerons d'en faire. Nous estimons que le rapport Lamanda donne de bonnes pistes pour lutter efficacement contre la récidive et j'espère que Mme la garde des sceaux voudra bien donner suite à ses recommandations pour avancer dans la résolution du problème qui nous préoccupe.
Mais, de grâce, pas de caricatures et surtout pas de leçons d'humanité.

Pour éviter les caricatures, j'aimerais préciser notre position, qui ne se résume pas à dire que la droite préconise un enfermement généralisé.
Tout d'abord, nous rappelons qu'à ce jour, l'efficacité de la loi sur le suivi sociojudiciaire, dont nous sommes à l'origine, n'a pas été évaluée. Nous ne nous sommes d'ailleurs pas donné les moyens de l'appliquer alors qu'elle constitue bel et bien une réponse.

Ensuite, nous affirmons que la rétention de sûreté comporte un risque d'enfermement de longue durée pour ceux qui en feraient l'objet. Nous ne parlons pas d'enfermement généralisé, nous disons qu'il sera très difficile de faire sortir les personnes placées en centre médico-socio-judiciaire. M. Blisko évoquait tout à l'heure le cas de Jean-Pascal, cité dans Le Monde, aujourd'hui en attente d'un placement d'office dans un hôpital d'un département d'outre-mer qui refuse de le prendre en charge au motif qu'il n'est plus domicilié dans ce département. C'est à ce genre de ping-pong entre institutions psychiatriques et institutions judiciaires que nous risquons d'assister demain.
En outre, nous estimons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de connaissances scientifiques et d'experts pour rendre effectif le concept de dangerosité et mener toutes les expertises judiciaires que vous jugez, à juste titre, nécessaires.
Enfin, nous soulignons que vous ne parvenez pas à respecter le seuil de quinze ans que vous avez fixé. La meilleure preuve en est qu'il y a des débordements en permanence, ce qui est bien normal. Parmi les personnes potentiellement dangereuses, il n'y a en effet pas que celles condamnées à plus de quinze ans pour les crimes que vous avez indiqués. La dangerosité peut se manifester par d'autres formes de psychopathie ailleurs. Autrement dit, le problème n'est pas pris dans le bon sens.
C'est tout ce que nous disons. Cela ne mérite ni excès d'indignité ni excès d'honneur. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
(L'amendement n° 25 n'est pas adopté.)

Il faut se demander tout d'abord, pour répondre à Mme Barèges, si le débat sur la rétention est réellement derrière nous. Nous considérons que non.
D'abord, la première partie du projet de loi que nous examinons est bien la suite de la loi sur la rétention. Je veux quand même rappeler, ce qui nous a surpris dans le principe, que le Conseil constitutionnel a été amené à inventer un nouveau concept entre peine et mesure de sûreté et à préciser les conditions d'application de cette loi.
La première des réponses est de considérer que ce texte ne s'applique que pour des faits commis postérieurement à son adoption, ce qui, d'après M. Lamanda, signifiait que l'on connaîtrait les premiers cas d'application de premier degré dans onze ou douze ans. Or, entre-temps, il a été prévu que les personnes qui n'auraient pas respecté les mesures de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté puissent se voir appliquer immédiatement ces dispositions.
Je passe sur la caricature qui consiste à faire croire que nous ne sommes pas sensibles à ces crimes affreux. Nous sommes, bien sûr, aussi préoccupés que vous. Simplement, nous nous demandons si la réponse pénale peut constituer la réponse principale. Le problème se pose bel et bien puisqu'une personne a déjà été condamnée. Les arguments de Dominique Raimbourg devraient tous nous amener à prendre conscience que les décisions pénales sont là pour palier la carence de l'institution psychiatrique. Je vous renvoie à ses propos sur l'évolution de la psychiatrie où le milieu ouvert est devenue la seule règle à partir des années soixante-dix. Il faut bien constater l'absence d'institutions qui auraient pu répondre à ce problème.
Pour des pathologies de cette gravité, nous estimons que la réponse ne passe pas uniquement par la réponse pénale. Pour autant, nous ne considérons pas qu'il faille définitivement abolir les procédures d'internement d'office. Il y a d'autres garanties à apporter. À tout le moins, nous nous gardons d'entretenir la confusion des genres.
Depuis des années, certains essaient de vendre le concept de dangerosité. Une grande majorité de la droite y résistait, il y a quelques mois encore. Depuis sept ans, jamais le Gouvernement n'avait accepté d'entrer sur ce terrain, même si M. Garraud et d'autres n'ont eu de cesse de vouloir l'y entraîner. Mais la pression des événements est telle aujourd'hui que cela apparaît désormais à vos yeux comme la seule solution. C'est une erreur. C'est ce que nous tentons de vous faire comprendre à travers ce débat.
Tout milite en faveur d'une position d'extrême prudence à l'égard du concept de dangerosité. M. Urvoas en a donné plusieurs définitions et la lecture du rapport ne permet pas d'être plus avancé même s'il fait bien le point sur la situation. Un magistrat qui aurait à trancher sur le fondement des concepts contenus dans ce projet de loi et dans la loi de février 2008 aurait besoin de bien du courage, car il s'agit de tout sauf de droit. Le rapport de M. Garraud ne lui donnerait aucune indication si ce n'est peut-être une intuition.

Interrogé sur la façon dont les psychiatres seraient amenés à rédiger un rapport en vue d'aider les magistrats à prendre une décision, Evry Archer, expert psychiatre près les cours d'appel, explique : « La dangerosité, ce n'est rien d'autre que la probabilité plus ou moins grande, jamais nulle, jamais égale à l'unité, estimée avec plus ou moins de rigueur pour un sujet plus ou moins malade mental, d'accomplir dans une unité de temps plus ou moins longue, dans des contextes plus ou moins propices, une agression plus ou moins grave. » (Rires sur plusieurs bancs du groupe SRC.) Bien sûr, il a forcé le trait.

Prétendre qu'à partir du moment où l'on sait repérer les individus dangereux, il faut les éliminer de la société est basique. Mais si c'était si facile, il y bien longtemps que vous l'auriez fait ! En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées, M. Vaxès et M. Urvoas vous l'ont déjà démontré.
Au fur et à mesure, vous serez amenés à étendre les éléments n'appartenant pas au champ du droit pénal parce que, tout simplement, le concept de dangerosité sera évolutif. Je ne vous en fais pas le reproche à vous qui êtes des républicains de droite. Ce genre de concept n'appartient pas à votre histoire politique, chers collègues. Mais dès lors que cette frontière est franchie, l'incertitude règne. Nous le voyons bien aujourd'hui à travers certaines explications et aussi certains exemples. Je vous renvoie à l'article du Monde que j'évoquais à l'instant. Devant le cas de la première personne concernée, ne vous dites-vous pas qu'il s'agit d'un problème médical et psychiatrique profond et non d'une question pénale ? C'est tout le problème de la confusion entretenue par votre loi.

L'article 1er expose, en forçant le trait, la philosophie du nouveau texte proposé par la majorité, quatrième loi sur la récidive en moins de quatre ans. La cinquième est-elle prévue pour 2010, la sixième pour 2011 et la septième pour le début de l'année 2012 ?

Ensuite, je l'espère, une nouvelle majorité sera aux commandes de la France.
J'en parle avec un peu d'humour mais ce n'est jamais que le constat que les Français peuvent eux-mêmes faire. Dans le domaine de la sécurité, vous avez voulu nous faire croire que vous étiez les champions du maintien de l'ordre au nom de la sécurité pour tous. En réalité, vous êtes surtout les champions des débats législatifs tous plus inutiles les uns que les autres.
Cette loi est une loi de plus, une loi de trop, mais c'est surtout une loi de fuite en avant, comme l'a très bien expliqué Alain Vidalies, qui a démontré, avec mes collègues, l'inutilité des dispositions proposées.
On ne peut légiférer dans l'urgence, sous le coup de l'émotion et sous la pression des médias. Or c'est ce que fait le Gouvernement. Dès que se produit un événement tragique, le Parlement est amené dans l'instant à délibérer sur des textes…

… le plus souvent inappliqués, faute de moyens. Le constat est terrible.
Madame la ministre, je dois dire que le titre du projet de loi a de quoi interpeller. Vous souhaitez lutter contre la récidive. Dont acte : tous les citoyens souhaitent qu'il y ait le moins de récidive possible. Je vous trouve bien rapide…

…pour réagir à ces drames si médiatisés, mais beaucoup moins pour réagir à d'autres formes de récidive, pourtant bien plus graves. Je profite de ce micro, car il me faut saisir toutes les occasions de dénoncer votre laxisme, votre absence de réactivité à ce qui a constitué le plus grand crime dans le domaine de la santé publique, je veux bien évidemment parler des crimes liés à l'amiante.

Je dis bien crimes, car les responsables savaient très bien ce qu'ils faisaient en envoyant pendant six décennies des travailleurs dans des lieux amiantés.

Il y a eu des promesses et des engagements. (Exclamations sur quelques bancs du groupe UMP.)
Si j'ai tort, dites-le moi. Je ne demande qu'à vous croire. Et dites-moi aussi quand aura lieu le procès pénal – je rappelle que cela fait treize ans que les plaintes ont été déposées.

Non, car on continue de laisser faire les criminels.
En résumé, madame la ministre, vous ne pouvez pas tenir deux discours sur la récidive : l'un qui répond aux pressions et réactions médiatiques, l'autre qui consiste à faire de grandes déclarations et des promesses, afin de gagner du temps, sans que rien de concret n'arrive.
Je ferai tout ce qui est possible pour dénoncer ce grand laxisme, pour employer un terme gentil. À l'avenir, je pourrais l'être moins.

Nous vous proposons un amendement de cohérence avec notre demande d'abrogation de la loi sur la rétention de sûreté.
Nous reconnaissons toutefois que l'article 1er en améliore le contenu. Il reprend d'ailleurs l'une des propositions du rapport Lamanda, qui prenait en compte la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008, laquelle considérait « que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté n'a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l'exécution de la peine ; qu'il appartiendra, dès lors, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ».
Le président Lamanda demandait que soit mise en place, sans tarder, une prise en charge médicosociale, psychologique et éducative – j'insiste sur le mot « et » – des condamnés dangereux, si possible dès le début de leur détention. Il ajoutait : « Celle-ci s'impose, non plus seulement pour des considérations médicales, tous les spécialistes s'accordant à dire qu'il ne faut pas attendre la sortie de prison pour engager un traitement, mais aussi pour des raisons juridiques : priver l'intéressé de soins en prison lui permettrait, en fin de peine, de contester le bien-fondé d'une rétention de sûreté. »
Forcés de prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel, le Gouvernement et le rapporteur nous proposent cet article 1er.
Nous ne nous y opposerons pas, car, s'il était respecté, je pense que nous lutterions efficacement contre la récidive, et que, très certainement, très peu de condamnés seraient susceptibles de se voir placés en rétention de sûreté. Ou bien, encore, faute de dégager des moyens pour permettre à la personne condamnée de bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique, la juridiction régionale ne sera jamais en mesure de prononcer la rétention de sûreté, ce qui serait une serait une excellente chose.
Afin de vous empêcher tout commentaire désagréable à mon endroit, je retire l'amendement n° 26 ,...
C'est ce que j'allais vous demander !

..ce qui me permettra de soutenir les amendements du groupe SRC, qui visent à améliorer la rédaction de l'article 1er.
(L'amendement n° 26 est retiré.)

La décision du Conseil constitutionnel, qu'il faut respecter, est très claire : la prise en charge doit être médicale, sociale et psychologique et non médicale, sociale ou psychologique, comme le prévoit l'article 1er, sinon on risque d'aboutir à des contentieux infinis. Dans certains cas, la prise en charge sera sociale, dans d'autres il y aura eu soins sans prise en charge médicale, dans d'autres encore il y aura eu traitement sans travail psychologique. N'oublions pas que nous sommes face aux cas les plus lourds et les plus difficiles et que le premier réflexe d'un psychiatre moyen à qui l'on demande de s'en occuper est de répondre qu'il n'a pas de place.
La prise en charge doit être complète tout au long de la peine et, comme certains l'ont dit au cours de la discussion générale, il est indispensable que le centre d'études préconisé par le rapport Lamanda et un certain nombre de praticiens de l'ARTAS voie le jour. Du reste, M. Garraud en était d'accord. Ce centre d'études, de recherche et d'expérimentations nous permettrait d'avancer sur des traitements qui ne peuvent pas être de simples décalques des traitements anglo-saxons. En effet, notre abord psychothérapique et médical est différent et la France bénéficie d'une grande expérience psychiatrique. Nous pouvons donc commencer à traiter, à condition de mettre en place un centre.
Voilà pourquoi je propose d'introduire à l'article 1er ce qu'a voulu dire le Conseil constitutionnel dans son considérant de février 2008.

M. Vaxès a eu la sagesse de retirer un amendement qu'il qualifiait de cohérence mais qui ne l'était pas vraiment, l'article 1er prévoyant qu'un certain nombre de garanties entourent le placement en rétention de sûreté.
On voit, dans ses propos, que M. Blisko, reconnaît comme positives certaines des considérations de l'article 1er.
Le texte adopté par la commission est précis. Ce qui compte, c'est une prise en charge adaptée, et la rédaction reprend les préoccupations du Conseil constitutionnel dans le considérant que vous avez évoqué.
La commission est défavorable à votre amendement, tout en y reconnaissant un élément intéressant. À cet égard, une modification va peut-être vous être proposée par Mme la garde des sceaux.
L'amendement de M. Blisko comprend deux parties. La première prévoit que la rétention de sûreté ne serait possible que si la personne a pu bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique et non médicale, sociale ou psychologique, comme le prévoit la rédaction de l'article 1er. Je suis favorable à cette modification.
En revanche, je suis défavorable à la seconde partie de l'amendement, qui me semble redondante dans la mesure où ce sont les conditions générales posées par la loi pour le prononcé de la rétention de sûreté.
Monsieur Blisko, je suis prête à accepter votre amendement sous réserve de la suppression des mots « destinés à atténuer le danger de récidive mais que ceux-ci n'ont pu produire des effets suffisants en raison, soit de l'état de l'intéressé ou de sa personnalité, soit de son refus de se soigner ».


Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
(L'article 1er, amendé, est adopté.)


Il ne nous paraît pas raisonnable d'aggraver le texte avant même qu'il ait pu être mis en oeuvre.
L'article 1er bis vise à allonger la durée de la surveillance de sûreté en la portant à deux ans. En commission, le rapporteur a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un recul des garanties qui encadraient le prononcé de la mesure mais d'une adaptation de sa durée. Je rappelle que cette mesure s'applique à l'issue de la peine et qu'elle vient s'y ajouter, non en fonction de faits nouveaux, mais en raison de la dangerosité, ce qui implique des contraintes non négligeables et des risques indéniables de placement en rétention de sûreté.
Il ne nous semble pas que l'article 1er bis réponde aux exigences du Conseil constitutionnel, notamment s'agissant de la proportionnalité de la mesure.

Avis défavorable.
En réalité, il s'agit d'une mesure d'adaptation visant à allonger la durée de la surveillance de sûreté en la portant de un à deux ans. Toutefois, je précise que l'intéressé peut demander, à tout moment, la mainlevée de la surveillance de sûreté, laquelle est évidemment moins contraignante que la rétention de sûreté, dont les règles de révision sont différentes – la rétention de sûreté est révisable tous les ans. Bien entendu, il peut être mis fin à tout moment à la mesure dès lors que ses conditions légales ne sont plus réunies.

Je suis saisi d'un amendement n° 29 tendant à supprimer l'article 2.
La parole est à M. Michel Vaxès.

Il s'agit d'un deuxième amendement de cohérence (Sourires).
La nouvelle rédaction de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale est moins pire que la précédente puisqu'elle affirme solennellement le caractère subsidiaire de la rétention de sûreté.
Elle pose le principe selon lequel la rétention ne doit être décidée qu'en ultime recours. Le dispositif s'en trouve amélioré en ce qu'il assure un meilleur respect des libertés publiques. Là encore est reprise l'une des recommandations du rapport Lamanda, qui nous apporte une nouvelle fois la preuve de son excellence.
À l'appui de cette préconisation, il rappelle qu'aujourd'hui, lorsque l'une des obligations de la surveillance de sûreté n'est pas respectée, la rétention de sûreté est ordonnée, avec toutes ses lourdes conséquences. Aussi est-il demandé qu'en ce cas la juridiction régionale de la rétention de sûreté puisse soumettre la personne à des obligations nouvelles qu'elle jugerait suffisantes pour assurer son contrôle et mieux adaptées à son profil sans être contrainte d'ordonner une rétention de sûreté.
Pour ces raisons, bien que nous restions farouchement opposés à la rétention de sûreté, nous ne nous opposerons pas à l'adoption de cet article, ce qui me conduit à retirer une nouvelle fois mon amendement pour soutenir celui de mes collègues du groupe SRC.

Je suis saisi d'un amendement n° 67 .
La parole est à M. Alain Vidalies.

Je dirai simplement quelques mots de cet amendement de précision, d'interrogation devrais-je dire.
Tel que l'article est rédigé, l'on peut s'interroger sur l'instance chargée de décider d'un placement en rétention de sûreté. Nous souhaitons ainsi préciser qu'il s'agit bien de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cela peut aller de soi à la lecture du texte, mais la précision n'est sans doute pas inutile, même si la rédaction de l'amendement pourrait être affinée.

La rédaction de l'article ne laisse place à aucune ambiguïté : c'est bel et bien la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui prend cette décision. Avis défavorable.
Il n'y a en effet pas la moindre ambiguïté. L'auteur de l'amendement l'a du reste lui-même reconnu. S'il avait besoin d'une quelconque confirmation, la voici. Peut-être pourrait-il à présent retirer son amendement ?

Il s'agit d'un amendement de coordination.
(L'amendement n° 13 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L'article 2, amendé, est adopté.)

Cette fois, je ne retirerai pas mon amendement, qui tend à supprimer ce nouvel article, introduit pas la commission des lois, qui s'inscrit pleinement dans la logique de la loi sur la rétention de sûreté. Le refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté peut ainsi constituer un motif de placement en rétention de sûreté.
Voilà un nouveau motif, qui vient s'ajouter à tous les autres, de recourir à la rétention de sûreté ! Nous nous y opposons, car bien d'autres mesures pourraient être ordonnées dans le cadre de la surveillance de sûreté. Il est du devoir du législateur d'encourager leur mise en oeuvre, sans privilégier le recours à la surveillance électronique mobile par la contrainte.
Peut-on en effet considérer que le consentement sera recueilli sans contrainte dès lors que le refus de la personne entraînerait son placement en rétention de sûreté ? Nous vous demandons d'adopter cet amendement de suppression, car il existe bien d'autres moyens d'obtenir que la personne condamnée accepte les soins susceptibles de lui être proposés.

Vous aviez fait preuve d'une certaine cohérence, monsieur Vaxès, en retirant vos précédents amendements. Vous ne poursuivez malheureusement pas sur cette lancée alors qu'il est logique que le refus de mise en oeuvre d'une surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté puisse constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Cette mesure n'est pas du tout automatique, mais il est normal que le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté informe la personne concernée des conséquences de son refus de se soumettre au contrôle nécessaire.
Je rends par conséquent un avis défavorable à cet amendement. L'article, contrairement à ce que vous prétendez, est tout à fait légitime, car il faut informer la personne soumise à la surveillance de sûreté des obligations qui pèsent sur elle, et des conséquences du manquement à ces obligations.
Compte tenu des précisions que vient de fournir le rapporteur, il serait logique que M. Vaxès retire son amendement. Je pense d'ailleurs qu'il en a l'intention.

Je vais le maintenir, madame la garde des sceaux, au risque de vous décevoir, mais ce ne sera pas la première fois.
Monsieur le rapporteur, ces dispositions opèrent un premier glissement. Le refus de porter un bracelet électronique entraîne une sanction, de sorte que nous sortons de la logique que vous avez posée, dont l'objectif, tel que vous le rappeliez, est de prendre des mesures de soin pour aider la personne concernée à s'extraire des difficultés dans lesquelles elle se trouve.
J'ose imaginer que s'il a été proposé à la personne le port d'un bracelet électronique plutôt que de lui imposer le placement en rétention de sûreté, c'est qu'il a été considéré que cette personne ne relevait pas de la rétention de sûreté. Or, au seul motif qu'elle va refuser cette mesure, vous allez la placer en rétention de sûreté, sans chercher d'autres mesures alternatives. Vous envisagez en vérité la rétention de sûreté comme une peine. On en revient au débat précédent.

Nous en revenons éternellement aux mêmes problèmes philosophiques. La meilleure des préventions reste le risque de sanction. Nous sommes dans un État de droit. La liberté a ses limites. Si le détenu veut profiter d'une mesure de libération, il doit accepter de porter un bracelet électronique. S'il viole cette obligation, il est logique qu'il risque d'être sanctionné par la mesure de rétention de sûreté. Ce serait trop facile, sinon.
(L'amendement n° 30 n'est pas adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 68 .
La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Lamanda préconisait dans son rapport – recommandations 22 et 23 – d'une part, que, dans les cas où la surveillance électronique mobile ne serait pas applicable, il soit possible d'ordonner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle, et d'autre part, qu'il soit permis à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d'ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d'une surveillance électronique. Alors que ces préconisations présentaient le mérite de proposer une solution graduée, vous prévoyez simplement, à l'article 2 bis, d'aviser la personne qu'en cas de manquement aux obligations inhérentes à la surveillance de sûreté, elle risque d'être placée en rétention de sûreté. Vous portez ainsi, ce qui est plus grave, une nouvelle fois atteinte aux libertés puisque la personne, si elle est libre de refuser le port du bracelet électronique, risque alors d'être placée en rétention de sûreté.
Nous vous proposons de replacer l'avertissement concernant l'éventuel placement sous surveillance électronique mobile à sa juste place étant entendu que d'autres dispositifs plus légers, tels que celui que je viens d'évoquer, doivent rester possibles et méritent également une explication lors de la mise en place du dispositif.

Cet amendement n'offre aucune garantie supplémentaire préalablement à un placement en rétention de sûreté. Le fait de préciser que l'avertissement sur les conséquences du refus de porter le bracelet électronique mobile est donné au moment de la décision va de soi. Il est par conséquent inutile de le répéter.
Par ailleurs, les obligations prescrites à l'encontre de l'intéressé sont bien réelles. Si la personne ne les respecte pas, elle s'expose à une réincarcération si elle était en surveillance judiciaire, à la rétention de sûreté si elle était en surveillance de sûreté. Avis défavorable sur cet amendement.
Avis défavorable pour les mêmes raisons. Cet amendement est inutile.
(L'amendement n° 68 n'est pas adopté.)
(L'article 2 bis est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement de suppression, n° 31.
La parole est à M. Michel Vaxès.

Il est défendu.
(L'amendement n° 31 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 3 est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement de suppression, n° 32.
La parole est à M. Michel Vaxès.

Il est défendu.
(L'amendement n° 32 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 69 .
La parole est à M. Dominique Raimbourg.

Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 2 de l'article 4, par lequel il est permis de mettre en place une surveillance de sûreté à l'issue d'une surveillance judiciaire lorsque la personne a été condamnée pour un des crimes visés par la rétention de sûreté à une peine, non plus de quinze ans, mais de dix ans.
Vous revenez ainsi sur la décision du Conseil constitutionnel. Pire, nous voici entraînés dans un engrenage auquel nous ne pourrons résister puisque nous commençons à descendre en dessous du quantum de peine initialement prévu. Peu à peu, la loi s'est élargie : des crimes commis à l'encontre des mineurs de quinze ans, elle est passée à ceux commis contre les mineurs de dix-huit ans, puis aux crimes aggravés à l'encontre des majeurs, et nous en arrivons aujourd'hui, du fait de cette surveillance de sûreté qui peut suivre une surveillance judiciaire, à une extension inacceptable, sans préjudice, de surcroît, du suivi sociojudiciaire qui peut être mis en place par ailleurs.

Il est nécessaire de préciser quelques points.
L'application éventuelle de la rétention de sûreté dépend de la durée de la peine prononcée par la cour d'assises, à savoir quinze ans de réclusion criminelle.
Il n'est pas logique que des mesures moins contraignantes que la rétention de sûreté – la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire – correspondent à des peines identiques. La surveillance de sûreté, à la différence de la rétention de sûreté, s'applique en milieu ouvert : la personne concernée est libre tout en étant soumise à certains contrôles et obligations. Quant à la surveillance judiciaire, elle peut s'appliquer dans le cas d'un reliquat de peine : un individu condamné à dix ans de réclusion et qui est libéré au bout de six ans peut être placé sous surveillance judiciaire. Les obligations de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles de la surveillance judiciaire.
L'idée qui sous-tend l'article est la mise en place d'une gradation des conditions d'application de la surveillance, plus ou moins contraignantes en fonction de la peine prononcée. Une peine de quinze ans de réclusion criminelle ouvre une possibilité de rétention de sûreté, il s'agit de la mesure la plus coercitive puisque privative de liberté. Une peine de dix ans de réclusion criminelle donne la possibilité d'une surveillance de sûreté, en milieu ouvert, je le répète. Enfin, une peine de sept ans d'emprisonnement offre la possibilité d'une surveillance judiciaire.
Il est vrai que le texte implique une extension du champ d'application de ces mesures ; je ne le conteste en aucune façon. Il est vrai également qu'il est difficile de soutenir qu'une personne est plus ou moins dangereuse en fonction de la peine prononcée contre elle. Il est possible que des individus se révèlent plus dangereux que d'autres condamnés à des peines plus fortes qu'eux. Seulement, il est indispensable de fixer des références. Ainsi, la gradation prévue par l'article 4 – quinze ans, dix ans et sept ans – ne fait qu'ouvrir des possibilités ; le dispositif ne recèle aucune automaticité. Il revient à l'autorité judiciaire d'apprécier chaque situation. Cette gradation, par sa proportionnalité et sa prise en compte de la réalité, me paraît tout à fait légitime.
La commission s'oppose par conséquent à cet amendement qui revient de fait à porter de dix à quinze ans le quantum de la peine susceptible d'être suivie d'une surveillance de sûreté à l'issue d'une surveillance judiciaire. Ce ne serait pas logique car il faut tenir compte de la pénalité prononcée par la juridiction pour, en fonction de sa gravité, ouvrir le droit soit à la mesure la plus coercitive, la rétention de sûreté, soit aux mesures les moins coercitives, la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté.
J'ai bien entendu les arguments développés par le rapporteur en faveur d'un abaissement du seuil à partir duquel on peut appliquer la surveillance de sûreté.
Cette proposition me pose problème : au moment où la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté ont été votées par l'Assemblée, il était bien prévu qu'il s'agissait de dispositions exceptionnelles, de sanctions correspondant à des faits d'une grande gravité. Si l'on a voulu établir une meilleure protection, c'était aussi pour la réserver à des situations particulières.
On peut du reste se demander comment le Conseil constitutionnel va réagir – lui qui considère également que ces mesures ne peuvent être qu'exceptionnelles – à votre proposition qui tend, je ne dirai pas à « banaliser » les dispositions en question, puisqu'elles correspondent à des faits très graves, mais en tout cas à abaisser le seuil que je viens d'évoquer.
Quant au fond, je me demande si cette modification du texte gouvernemental est bien nécessaire. Une personne condamnée à une peine de dix à quinze ans de réclusion peut d'ores et déjà faire l'objet d'une surveillance judiciaire et si cette personne, nous y reviendrons, ne se comporte pas comme elle le doit dans la perspective de la surveillance judiciaire, y compris dans le cadre de mesures d'accompagnement, elle pourra toujours être placée en rétention de sûreté. C'est la raison pour laquelle j'estime que les dispositions qui s'imposent en pareil cas existent déjà.
Cette question a été très discutée, certes. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée tout en appelant son attention sur les implications de cette disposition.

Cette question est en effet l'objet d'un vrai débat. Je me souviens d'une discussion analogue au cours de l'examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté, en février 2008. Le texte initialement proposé prévoyait des conditions : non seulement une peine minimale de quinze ans de réclusion criminelle devait être prononcée, mais l'application éventuelle de la rétention de sûreté était liée à l'âge de la victime. Il était indiqué que celle-ci ne pouvait être que mineure, en l'occurrence âgée de quinze ans au moins. La question s'était alors aussi posée de l'éventuelle inconstitutionnalité du texte.
Déjà, au cours de la discussion qui a suivi, j'étais de ceux qui considéraient que la rétention de sûreté ne saurait être limitée à l'application des cas où la victime est mineure. La dangerosité de l'auteur d'actes entraînant une condamnation d'au moins quinze ans de réclusion criminelle est indépendante de l'âge de la victime. L'Assemblée avait d'ailleurs retenu que l'on ne pouvait fonder le dispositif en question sur l'âge de la victime et l'avait donc étendu aux cas où lesdites victimes étaient majeures. Le présent débat offre des similitudes.
Ainsi, la commission propose de porter à quinze ans de réclusion le seuil au-delà duquel on peut appliquer la rétention de sûreté, à dix ans pour la surveillance de sûreté et à sept ans pour la surveillance judiciaire. Il est vrai que la commission propose une extension du dispositif ; nous considérons néanmoins qu'il appartient à l'autorité judiciaire de disposer de cette possibilité à son gré ; à elle, par conséquent, de se saisir de cette possibilité ou non.
J'ai en mémoire des cas très récents comme celui de Mme Hodeau : l'auteur présumé du crime a été condamné non à quinze ans de réclusion criminelle mais à onze ans. Ce cas précis ne serait pas concerné par les dispositifs proposés – rétention de sûreté, surveillance de sûreté et surveillance judiciaire – s'ils ne s'appliquaient tous qu'à partir d'une peine d'au moins quinze ans. Dans cette hypothèse, il ne serait même pas possible de décider l'application d'une surveillance de sûreté ou d'une surveillance judiciaire.
Le Conseil constitutionnel aura certainement à vérifier la constitutionnalité de ce projet, comme ce fut le cas pour le texte qui a abouti à la loi du 25 février 2008. Cependant, la gradation proposée, qui fait correspondre une mesure de sûreté plus ou moins contraignante à la durée de la peine prononcée, me paraît totalement logique et, de plus, permet de couvrir, au rebours du texte initial, le cas de gens dangereux.
Ce texte est l'aboutissement d'une évolution législative qui a commencé il y a plusieurs années et qui a suscité de nombreux travaux – ce pourquoi je m'élève contre ceux qui prétendent que nous légiférons sous le coup de l'émotion. Il nous appartient d'aller au bout de notre logique, faute de quoi, demain, de nouveaux cas risquent de se présenter et l'on nous demandera quelles dispositions nous avions prévues pour y parer. Imaginons un individu condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et qui présente toujours une véritable dangerosité à l'issue de sa peine : nous ne pourrons pas le placer en rétention de sûreté ni même en surveillance de sûreté si nous n'étendons pas le champ d'application du texte.
J'ai cité hier quelques exemples d'individus dont nous savons qu'ils recommenceront, de détenus, heureusement rares, qui l'annoncent même. Imaginons donc l'hypothèse d'un individu condamné à quatorze ans de réclusion, auquel on n'aura accordé aucune réduction de peine, qui n'aura bénéficié d'aucun aménagement de peine parce que tout le monde sait qu'il est dangereux ; eh bien, au bout du bout, nous ne pourrons même pas le placer, j'y insiste, en surveillance de sûreté.
C'est pourquoi je considère que nous devons aller au bout de notre logique maintenant.

Nous nous trouvons au coeur même, sans doute, du débat sur ce texte. Nous avons compris que l'opposition n'y était pas favorable. Elle a combattu le texte qui est devenu la loi du 25 février 2008 et l'a déféré au Conseil constitutionnel dont la décision nous oblige de nouveau à l'examiner.
Mme la garde des sceaux vient d'exprimer des réserves, précisant que le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse des députés.
J'ai écouté avec attention l'exposé des motifs de notre excellent rapporteur. Que propose-t-il ? De donner la faculté, et non d'imposer, à l'autorité judiciaire de prendre une mesure d'une exceptionnelle gravité comme la rétention de sûreté pour des condamnations à quinze ans de réclusion, la surveillance de sûreté pour les condamnations à dix ans et la surveillance judiciaire pour les condamnations à sept ans.
Que s'est-il passé depuis le mois de février 2008 ? Les pages de faits divers sont remplies de drames horribles.

Or, si l'autorité judiciaire avait eu la faculté d'exercer une surveillance, des vies auraient pu être sauvées.

Madame la garde des sceaux, je vous ai écoutée avec beaucoup d'attention hier et cet après-midi, quand vous avez répondu aux différents orateurs. Vous avez rappelé la finalité de ce texte en soulignant l'importance de la surveillance. Mais enfin, si l'on n'a pas de crime à commettre, on ne doit pas être très gêné d'être surveillé.
Or il est ici question d'individus condamnés pour des crimes graves. Il s'agit de donner la faculté à l'autorité judiciaire de décider une surveillance. L'opinion publique en a assez que nous légiférions chaque année pour éviter des crimes commis par des récidivistes ; il convient dès lors de lui donner des signaux.
Puisque le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, à chacun des députés de prendre ses responsabilités. Pour ma part, j'apporte mon entier soutien à la proposition du rapporteur qui donne à l'autorité judiciaire la faculté, j'y insiste, de décider l'application de certaines mesures de surveillance.
Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de faire de l'angélisme, pour mettre en place des mécanismes de surveillance, dont vous avez rappelé, madame la garde des sceaux, qu'ils constituent un élément important pour éviter la récidive.

Première observation, les deux faits divers dramatiques qui soulèvent l'émotion, à savoir le viol du jeune garçon par Francis Evrard et le meurtre aggravé de Milly-la-Forêt, ne sont pas concernés par notre débat. Francis Evrard aurait pu être surveillé, il ne l'a pas été. Quant au meurtre de Milly-la-Forêt, son auteur avait été condamné à une peine inférieure à quinze ans. Il n'était donc, en tout état de cause, pas concerné par le texte dont nous parlons. Éloignons donc un instant ces cas dramatiques de nos esprits, pour essayer de réfléchir avec sagesse.
Deuxièmement, à l'intérieur même de la logique de la surveillance de sûreté, l'alinéa 2 de l'article 4 prévoit qu'à l'issue d'une surveillance judiciaire, la juridiction de sûreté peut prévoir une surveillance de sûreté dès lors que la personne a été condamnée à « dix » ans, au lieu de « quinze » ans. Mais l'alinéa 4 prévoit que la juridiction régionale de sûreté peut ordonner une surveillance de sûreté à l'encontre d'une personne qui verrait la totalité de sa surveillance judiciaire révoquée. Nous avons donc là une gradation dans les motifs qui nous permet déjà de répondre à l'objectif légitimement poursuivi par M. le rapporteur, à savoir la surveillance de gens qui peuvent être dangereux.
Je ne me situe pas ici à l'extérieur de la logique de la rétention de sûreté. Je ne vous dis pas : « Ce n'est pas bien en soi. » Je vous dis que, compte tenu des objectifs que vous visez, et même dans ce qui resterait du texte si l'on faisait droit à l'amendement que je défends, c'est-à-dire la suppression de l'alinéa 2, vous avez la possibilité de prononcer, à l'encontre de quelqu'un qui n'aura pas respecté les obligations de la surveillance judiciaire, une surveillance de sûreté qui pourra ensuite déboucher sur une rétention de sûreté.
La gradation est là. Ne descendons pas trop vite. Nous serons certainement amenés à en reparler. Ce texte sort, et de loin, du droit commun. Il faut le réserver à des cas tout à fait particuliers. N'invoquons pas à l'appui de cela des faits divers qui, de toute façon, n'auraient pas été concernés par ce texte.

Je voudrais à mon tour demander à mes collègues de bien réfléchir à ce que nous a dit Mme la garde des sceaux tout à l'heure. Nous sommes tous évidemment horrifiés par le caractère dramatique et insupportable des crimes commis. Nous réagissons tous de la même façon, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains. Ce qui nous occupe ici, c'est de chercher les meilleurs moyens d'éviter la récidive. Personne ne peut imaginer que nous puissions avoir la moindre indulgence pour le genre de crime dont nous parlons.
Mais, une fois que cela est dit, et sans revenir sur les principes de la rétention de sûreté – j'ai dit ce que j'avais à dire au moment de la loi de février 2008 –, je crois que nous devons tout de même garder une certaine mesure dans les dispositions que nous votons. Non seulement, comme Mme la garde des sceaux l'a rappelé, et comme vient de le dire Dominique Raimbourg, il y a déjà dans le texte des dispositions qui entrent dans cette logique – qui n'est pas la nôtre – et permettent d'exercer la surveillance de sûreté, mais, de surcroît, il faut quand même être attentif à la décision du Conseil constitutionnel qui justifie le texte de loi que nous examinons aujourd'hui.
Le Conseil constitutionnel a précisé que « la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté doivent respecter le principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire », et que les atteintes portées à la liberté d'aller et de venir et au respect de la liberté individuelle « doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi ».
Mme la garde des sceaux a fait allusion à ces considérants tout à l'heure. Je crois, mes chers collègues, que vous devriez y porter une attention toute particulière.
Mais je voudrais moi aussi revenir sur la logique qui anime notre rapporteur et qu'il a très bien exposée tout à l'heure. Faisons attention aux risques de dérive et de surenchère. Non seulement, comme vient de le rappeler Dominique Raimbourg, les cas de Francis Evrard et de l'auteur du meurtre de Milly-la-Forêt ne sont pas concernés par ce texte, mais vous trouverez toujours un cas qui justifiera une surenchère particulière. Et là, le risque de dérive est terrible. Que se passera-t-il, monsieur Garraud, quand une personne aura été condamnée à huit ans de réclusion et que vous estimerez nécessaire de lui appliquer la surveillance de sûreté ? Cette escalade est indéfinie. Il y aura des pressions continuelles sur les juges. Rappelons-nous quand même ce qui s'est passé au moment de l'affaire d'Outreau. Si nous avons eu quatorze innocents mis en détention provisoire, pour une durée de trois ans en moyenne, et dont l'un est mort en prison, c'est parce que l'ensemble des magistrats et l'ensemble de la société étaient soumis à des pressions terribles, phénoménales. Si les juges avaient pris la décision de ne pas mettre ces personnes en détention provisoire, ils auraient encouru un opprobre et même une vindicte considérables. Faisons attention, donc, à ce que nous votons. Je dois dire d'ailleurs qu'à voir ces amendements on se demande : « Jusqu'où cette escalade peut-elle nous mener ? »
Nous devons nous rappeler en permanence que le droit pénal est quelque chose de très important, mais que s'agissant des cas auxquels nous nous intéressons – et à juste titre –, nous voyons bien qu'il nous faut aller vers une combinaison de mesures, à la fois pénales, psychiatriques et sociales. Je m'étonne d'ailleurs une fois de plus, madame la garde des sceaux, que vous soyez seule à ce banc. Car, après tout, la présence de Mme Bachelot, ministre de la santé, serait aussi nécessaire.

En effet, ce qui est aussi en cause, et ce qui l'est principalement, ce n'est pas une poignée, ni peut-être deux poignées d'individus, mais la misère de la psychiatrie en France, et le fait que nous n'arrivions pas à traiter suffisamment tôt et suffisamment bien ces personnes, avant même qu'elles commettent des actes punissables et répréhensibles par la justice, et, à plus forte raison, pendant leur incarcération.
Faisons très attention à la surenchère. Je pense que Mme la garde des sceaux a tenu tout à l'heure des propos très sages, en se situant dans le cadre de cette loi – un cadre que nous n'approuvons pas –, pour vous appeler à plus de mesure.

Je voudrais rappeler que l'opposition a voté, à l'unanimité moins une voix, celle de Mme Guigou, l'article 1er. C'est donc qu'elle reconnaissait qu'il y a des détenus extrêmement dangereux, du fait de leur pathologie ou parce qu'ils n'ont pas reçu les soins qui auraient dû leur être apportés pendant toute la durée de leur détention.
Même M. Vaxès a reconnu que l'article 2, que vous avez également voté,…

…était respectueux des libertés publiques. Donc, de grâce, pas d'anathème sur le thème de l'escalade et de la surenchère !
De quoi s'agit-il, en toute humilité ? Il est bien évident que le rapport Lamanda nous pousse vers d'autres pistes, comme l'a rappelé Mme la garde des sceaux. Il est bien évident que des mesures de suivi socio-judiciaire sont nécessaires. Il est bien évident que la loi ne règlera pas tous les problèmes. Mais de quoi s'agit-il ici ? Il s'agit d'exclure tout risque de récidive, ou tout au moins de réduire ce risque. Vous voyez à quel point le titre même de ce projet de loi est révélateur de l'humilité avec laquelle nous abordons ce texte.
Que nous dit le rapporteur ? Qu'il faut éviter qu'à l'issue de leur détention des individus extrêmement dangereux ne puissent pas être suivis par l'autorité judiciaire. Avec la gradation que nous proposons – quinze ans, dix ans, sept ans –, nous sommes dans un système totalement cohérent, qui permet au magistrat, car c'est bien d'une possibilité qu'il s'agit, à l'issue de la détention, de suivre ces délinquants particulièrement dangereux. C'est une faculté, ce n'est pas une obligation.
Vous avez cité deux faits divers. Je vous citerai simplement le cas d'un pédophile qui a été condamné seulement – même si c'est déjà beaucoup – à treize ans de prison. Cette personne, si l'on vous suivait, passerait à travers les mailles du suivi judiciaire.
J'appuie donc totalement la position de M. le rapporteur.

Je voudrais ajouter une précision supplémentaire. Ce n'est pas parce que la commission souhaite abaisser les seuils que l'on peut aussitôt parler de « dérapage », comme cela a été suggéré, notamment par Mme Guigou. Pas du tout ! Je rappelle que la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire – comme la rétention de sûreté, bien sûr – obéissent à des conditions très strictes. Il n'y a pas que la peine prononcée qui ouvre la possibilité, la simple possibilité, d'une rétention de sûreté, d'une surveillance de sûreté ou d'une surveillance judiciaire. Quelles sont les autres conditions ?
Il faut d'abord qu'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, un an avant la fin de la peine, statue en quelque sorte sur la dangerosité. Elle est composée de magistrats, de personnels de l'administration pénitentiaire, de médecins, d'avocats. En outre, ce n'est pas cette commission qui prononce la mesure de sûreté. C'est la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui va la prononcer, ou pas. Cette juridiction régionale est composée de magistrats de cour d'appel. Il y a ensuite un recours possible devant une juridiction nationale composée de magistrats de la Cour de cassation.
À chaque fois, bien sûr, l'individu concerné a droit à un avocat et à un débat contradictoire.
Au-delà de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, un recours devant la Cour de cassation elle-même est possible, même si le cas ne s'est pas encore présenté.
À ceux qui veulent faire croire à un dérapage total, à une complète surenchère, je dis que ce n'est pas vrai. Nous ouvrons simplement une possibilité, avec une extension possible – je dis bien : possible – selon la peine prononcée. Il y a une gradation : rétention de sûreté, surveillance de sûreté, surveillance judiciaire.
Toutes les garanties existent pour éviter tout dérapage. Je m'élève donc contre ce qui a été dit par l'opposition. Au contraire, ce qui est proposé par la commission est nécessaire. J'ai la certitude que, demain, si un crime affreux est commis par un récidiviste et que nous ne pouvons même pas placer son auteur, une fois sa peine purgée, ne serait-ce qu'en surveillance de sûreté ou en surveillance judiciaire, on nous demandera des comptes !
(L'amendement n° 69 n'est pas adopté.)

Défendu, de même que le suivant.
(L'amendement n° 70 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'amendement n° 71 rectifié , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 72 .
La parole est à Mme George Pau-Langevin.

Je voudrais revenir sur le débat que nous venons d'avoir. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe UMP.) C'est une affaire importante : vous y tenez ; nous aussi !
Il me semble qu'en l'espèce plusieurs arguments doivent être répétés.
D'une part, vous risquez, à l'évidence, de vous mettre en contradiction avec les limites posées très clairement par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a validé la rétention de sûreté en tant que mesure exceptionnelle. Dès lors que l'on ne cesse d'élargir son champ d'application, il est clair que le risque existe que les conditions posées pour que ces mesures soient constitutionnelles – proportionnalité, adéquation entre les besoins de la défense de l'ordre public et les exigences des libertés individuelles – ne soient plus remplies. Vous vous écartez manifestement des conditions posées par le Conseil.
D'autre part, je voudrais appeler à nouveau votre attention sur le fait qu'en élargissant sans fin ces mesures vous prenez vous-mêmes le risque de les rendre inefficaces. Nous en avons d'ores et déjà la certitude, nous l'avons démontré hier et cela résulte du rapport Lamanda : vous n'avez en réalité pas les moyens de mettre réellement à exécution les dispositions que vous avez déjà adoptées.
Aujourd'hui, vous prenez encore de nouvelles dispositions. M. le rapporteur nous a expliqué que des juridictions nouvelles allaient statuer.

C'est magnifique mais la justice est déjà dans la misère ; les juges d'application des peines travaillent dans la misère : il suffit de voir comment ils sont épaulés par des agents ! Le budget de la justice, nous l'avons vu, ne vous donne pas les moyens d'appliquer ces mesures, et vous essayez de nous faire croire que des obligations supplémentaires vous permettront de faire face !
Même dans votre propre logique, celle de mesures applicables à des détenus particulièrement dangereux, vous affaiblissez la portée de votre texte.
Cet amendement vise donc à limiter à trois ans la durée d'une mesure de rétention de sûreté. Il me paraît préférable, même dans votre logique, de prévoir une durée limitée plutôt que les durées très longues mises en place par le texte.

Avis totalement défavorable. En effet, l'amendement qui nous est proposé consiste à limiter à trois ans la mesure de rétention de sûreté : cela ne correspond en aucune façon aux considérations juridiques menant à la mesure de sûreté. Celle-ci, encore une fois, n'est pas une peine ; elle est renouvelable tant que dure la dangerosité de l'individu, selon des modalités et sous des garanties prévues à la fois par le texte de la loi du 25 février 2008 et par le présent projet de loi : elle est renouvelable par un débat contradictoire, selon ces mêmes modalités.
On ne peut pas limiter dans le temps une mesure qui, par définition, dépend de la dangerosité. Il est absolument impossible de dire, trois ans à l'avance, que l'individu ne sera plus dangereux trois ans plus tard !
C'est cela qui vous gêne mais, au fond, je ne comprends pas pourquoi : tout est balisé, et d'une façon pluridisciplinaire. J'insiste sur ce dernier aspect : les magistrats, les avocats, le personnel pénitentiaire, les médecins se retrouveront pour évaluer cette dangerosité ; c'est comme cela qu'on procède au Canada, en Belgique et ailleurs. Dès lors que l'on évalue la dangerosité, dès lors que la personne peut à tout moment demander la main-levée de cette mesure de sûreté, la mesure ne peut pas s'arrêter trois ans après. Elle est par définition renouvelable.
Nous venons de voter la possibilité de renouveler tous les deux ans la surveillance de sûreté ; en ce qui concerne la rétention de sûreté, nous n'avons pas touché à la loi du 25 février 2008, qui prévoit un renouvellement annuel.
Il est impossible de dire à un moment donné dans quel état se trouvera l'individu deux, trois ou quatre ans plus tard. Il faut au contraire réévaluer régulièrement son cas : c'est le principe de l'individualisation – la loi pénitentiaire, que nous avons votée il y a peu, consacre cette individualisation du parcours d'exécution de la peine par le détenu du début à la fin. Si, en fin de peine, il est toujours dangereux, la possibilité est ouverte – sous des conditions bien précises que j'ai énoncées – de prendre des mesures de sûreté. Celles-ci peuvent effectivement être renouvelées.
Si l'individu est très dangereux, s'il continue de l'être, elles peuvent être renouvelées de façon perpétuelle : est-ce ce terme qui vous gêne ? Moi, il ne me gêne pas. Dès lors qu'un individu a commis des faits très graves, dès lors que le renouvellement de la mesure de sûreté est entouré de toutes les garanties nécessaires, dès lors que cet individu est réputé très dangereux par un collège d'experts pluridisciplinaires, le fait que la mesure, prononcée par une juridiction régionale et susceptible de toutes sortes de recours, soit renouvelable ne me gêne en rien.

Je préfère, et de beaucoup, des gens très dangereux qui font l'objet de mesures de sûreté à des gens très dangereux en liberté sans aucun contrôle !
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Très bien !
Avis défavorable.

Je suis pour ma part opposé à cet amendement.
Je voudrais dire à notre collègue Pau-Langevin que je n'ai pas beaucoup apprécié les propos qu'elle a tenus lorsqu'elle a déclaré vouloir revenir sur la discussion et le vote de l'amendement précédent. J'ai préféré l'intervention de Mme Guigou…

…qui s'est montrée beaucoup plus mesurée : elle s'est dite opposée au texte en considérant qu'on ne donnait pas assez de moyens aux médecins, au suivi socio-judiciaire, à la psychiatrie.
Nous sommes d'accord : ce texte n'a de sens que si on s'accorde à donner plus de moyens pour la prévention.

Mais qui, depuis quelques années, essaye de soutenir le Gouvernement pour améliorer la situation des lieux de privation de liberté, le suivi des prisonniers, les moyens matériels et humains ? C'est bien cette majorité !
Ce texte, nous l'assumons politiquement.

Nous assumons le vote d'un texte qui vise à remettre en cause des dispositifs qui sont aujourd'hui insuffisants face à la dangerosité de certains détenus. On ne peut pas nier ce fait.
Vous nous dites qu'il ne faut pas légiférer sous le coup de l'émotion ; mais c'est bien parce que notre droit présente des lacunes que nous sommes aujourd'hui obligés de légiférer. (Protestations sur les bancs du groupe SRC.)
Si vous voulez vous faire les gardiens des libertés, eh bien je vous rappellerai que le Conseil constitutionnel est là pour censurer, si nous allons au-delà de ce qui doit être voté. Mais, de grâce, sur un sujet si difficile, comprenez que vous ne parviendrez pas à nous donner mauvaise conscience. Nous prenons nos responsabilités et, rassurez-vous, nous sommes prêts à aller devant l'opinion et à prendre toutes nos responsabilités pour soutenir le Gouvernement. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Ne préjugeons pas l'avis du Conseil !
(L'amendement n° 72 n'est pas adopté.)
(L'article 4 est adopté.)

Je suis saisi de deux amendements de suppression, nos 33 et 58.
La parole est à M. Michel Vaxès, pour soutenir l'amendement n° 33 .

L'article 5 bis a été introduit en commission par le Gouvernement. Il crée un énième fichier – je sais bien que les auteurs de l'amendement préfèrent parler d'un « répertoire », le répertoire de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires. Toutefois, il s'agit bien, on s'en doute, d'un fichier, qui réunira les « expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires » réalisées « au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement ou de l'exécution de la peine ».
Il me semble que l'avis de la Commission nationale informatique et libertés était indispensable avant qu'un tel dispositif ne soit soumis à notre vote. Il s'agit là en effet de données sensibles, concernant notamment la santé. En outre, ce fichage concernera les personnes condamnées, mais aussi les personnes poursuivies, c'est-à-dire non condamnées, donc présumées innocentes.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer l'article.

Cette disposition a été introduite par un amendement du Gouvernement – qui, à ma connaissance, n'a pris sur ce dispositif ni l'avis de la CNIL ni celui du Conseil d'État.
Il y avait déjà eu un long débat en commission puisque le dispositif initialement proposé portait atteinte à la présomption d'innocence. Cela a été rectifié par un sous-amendement ; il n'en reste pas moins que ce nouveau fichier pose de graves problèmes.
Tout d'abord, il prévoit la collecte de données sensibles, au sens de l'article 8 de la loi Informatique et libertés – notamment de données concernant la santé.
Si on comprend bien la préoccupation concrète – mettre à la disposition des magistrats, en particulier, l'ensemble des informations, expertises, informations judiciaires, déjà réalisées –, cela ne peut se faire dans n'importe quelles conditions, par la création d'un fichier. Cela ne peut se faire sans garantie de conditions optimales de sécurité et de protection des données informatiques, notamment pour ce qui concerne le secret médical. De plus, je souligne que le texte, en l'état, déroge au droit commun des fichiers informatiques : le droit commun prévoit l'obligation de publier l'avis de la CNIL pour les décrets en Conseil d'État.
Je voudrais aussi souligner qu'en matière de délinquance sexuelle un fichier existe : le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Toutes les dispositions concernant le FIJAIS sont inscrites dans le code de procédure pénale ; elles ont été débattues démocratiquement et inscrites dans la loi par le Parlement.
Ici, l'amendement du Gouvernement propose que la durée d'inscription comme la liste des destinataires des données soient définies par le seul pouvoir réglementaire – alors que le législateur, je le redis, a débattu du FIJAIS.
Je ferai une dernière remarque, plus prosaïque : compte tenu de la difficulté que rencontrent aujourd'hui les juridictions pour déployer l'application Cassiopée, on peut très sérieusement douter de la possibilité pratique de mettre en place ce type de dispositif. Dans les conditions actuelles définies par le Gouvernement, ce dispositif ne nous paraît en tout cas pas bien sécurisé et il ne nous semble pas prévoir les garanties nécessaires pour des données aussi sensibles.

Ces amendements tendent à supprimer ce répertoire, ou ce fichier – comme vous voudrez, puisque le terme de « fichier » ne me fait pas peur.
En réalité, ce fichier ne va servir qu'à renseigner l'autorité judiciaire, qui devra prendre des décisions très importantes, notamment sur la liberté des personnes qui lui sont présentées. Je prends des cas pratiques, réels : lorsqu'un individu commet une infraction et qu'il est présenté à l'autorité judiciaire, il faut recueillir dans un temps souvent très bref des éléments concernant sa personnalité et son passé.
On consulte certes le casier judiciaire, mais celui-ci ne contient pas forcément toutes les informations, ou bien celles-ci peuvent y être insuffisantes ou pas tout à fait à jour.
Le fichier que nous vous proposons de créer consiste simplement à donner à l'autorité judiciaire des éléments supplémentaires pour mieux apprécier et donc mieux juger l'individu qui est en face d'elle. Ce répertoire contiendra ce qui a été diligenté précédemment par la même autorité judiciaire.
Nous parlons de récidivistes, de personnes qui sont déjà passées devant les tribunaux, de personnes pour lesquelles des expertises, psychiatriques, médico-psychologiques, des bilans de personnalité, ont déjà été pratiqués. Quelle déperdition de connaissances et d'énergie, lorsque cette personne est présentée à une autorité judiciaire d'un autre lieu géographique, si cette autorité judiciaire n'a pas ces éléments, ou les obtient trop tard ! L'appréciation de l'autorité judiciaire peut en être faussée.
Je ne comprends pas le raisonnement qui consiste à demander qu'on ne donne pas à l'autorité judiciaire des éléments qui permettront à la justice de mieux faire son travail. Quand le procureur de la République, ou le juge d'instruction, ou le juge des libertés et de la détention, ou les magistrats de la comparution immédiate – il y a plusieurs cas de figure – devront décider la mesure à prendre, il est préférable qu'ils aient entre leurs mains les précédentes expertises pratiquées sur l'individu qui se trouve en face d'eux plutôt que de devoir se contenter des simples expertises qui auront été pratiquées pendant le délai de garde à vue, délai par définition assez court, malgré la qualité des psychiatres. En effet, ceux-ci ne disposent alors que de quelques dizaines de minutes pour apprécier une personnalité. Il est intéressant de disposer de ces éléments d'information.
D'ailleurs, cela jouera dans les deux sens. Ces informations pourront conforter l'avis qui aura été donné par l'expert sur le moment, mais elles pourront aussi apporter un éclairage nouveau, qui pourra être positif pour la personne présentée.
Voilà la finalité du répertoire. Je tiens particulièrement à cet outil, puisque je l'avais déjà préconisé en 2006, lorsque j'avais rendu un rapport au Premier ministre sur cette question.
Plus précisément, il s'agit de centraliser l'ensemble des informations concernant la santé et la personnalité de l'individu concerné, avec de nombreuses garanties.
Ainsi, je réponds notamment à Mme Batho, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés…

…définira les modalités de fonctionnement. Donc la CNIL sera bien entendue saisie avant que le décret en Conseil d'État ne soit pris.
Autre garantie, seuls les magistrats qui sont amenés à juger et les experts qui doivent donner leur avis aux magistrats qui jugeront pourront consulter ce fichier.
La trace des interrogations et consultations sera conservée dans des conditions définies par ce même décret en Conseil d'État.
Le décret fixera la durée de conservation des informations inscrites dans le répertoire et les modalités de leur effacement. Dans certains cas, comme pour le FIJAIS, il arrive que cette durée de conservation soit prévue par la loi, mais cela n'a rien d'obligatoire.
Enfin, parce que, lors de la discussion en commission des lois, certaines voix se sont élevées pour que cette mise en place s'accompagne de plus de garanties, l'article prévoit qu'« en cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier aliéna de l'article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées ».
Vous le voyez, toutes les garanties sont prises.
Certains d'entre vous se disent choqués qu'on puisse donner à l'autorité judiciaire des éléments d'information sur des personnes poursuivies. Mais il est évident qu'il faut donner à l'autorité judiciaire des éléments sur les personnes poursuivies parce que cela permet de mieux les juger.

Quelle serait l'utilité de donner des éléments une fois la décision prise ? Cela ne servirait à rien. C'est précisément quand la personne est poursuivie et avant qu'elle soit traduite devant la juridiction de jugement qu'il faut donner tous les éléments.
Je souhaite apaiser les craintes de certains. Ce nouveau fichier est accompagné de garanties, de conditions d'application qui respectent les droits des personnes qui y figureront et qui donneront tous les éléments d'appréciation à la juridiction de jugement. Quoi de plus normal que de donner des éléments supplémentaires indispensables pour mieux apprécier la personnalité de l'auteur d'une infraction qui peut être très grave et pour laquelle il faut quelquefois prendre des décisions rapides ?
À un autre moment du débat, je crois que, sur la quasi-totalité de vos bancs, on a dit qu'il était important que l'information puisse circuler entre les personnes qui sont amenées à s'occuper de quelqu'un qui a commis une infraction pour pouvoir mieux juger sa personnalité et mieux adapter les actions à mener pour sanctionner mais aussi pour permettre la réinsertion sociale. Eh bien, nous sommes là au coeur de ce débat.
Il ne faut pas que, dès qu'on entend le mot « fichier », on se dise qu'il s'agit de quelque chose de terrible alors qu'il s'agit tout simplement de prendre des mesures très concrètes et de bon sens pour permettre la circulation de cette information.
Pour lever tout malentendu, je crois nécessaire de rappeler que ce fichier ne constitue ni un fichier de police judiciaire, ni un fichier d'antécédents, ce n'est pas cela que l'on cherche à faire. Il s'agit uniquement de créer un outil réservé à l'autorité judiciaire, outil qui lui permettra d'avoir, au moment où l'autorité doit prendre une décision, tous les éléments résultant notamment d'expertises qui ont été faites dans différents endroits et à différents moments. Nous connaissons des exemples où des expertises ont été oubliées. Cela a pu entraîner des décisions qui ne prenaient pas en compte la totalité de la personnalité, comme on aurait pu le faire si elles avaient été connues, notamment du juge de l'application des peines.
Ce répertoire, le rapporteur l'a souligné, demeure sous le contrôle du juge. Si un expert a besoin d'une expertise antérieure, il doit passer par le juge pour en obtenir communication. Nous apportons ainsi les garanties nécessaires, tout en essayant de répondre au besoin, exprimé par tout le monde, de la nécessaire coopération entre les uns et les autres.
Mme Batho a regretté que la CNIL n'ait pas été consultée préalablement sur ce texte. Mais c'est normal, puisque cet article est le résultat d'un amendement. La CNIL comme le Conseil d'État seront consultés, je le confirme, dans le cadre du décret d'application prévu par le texte. C'est tout à fait normal et ce sera fait.

Le Parlement a conduit un travail relativement sérieux et consensuel sur les fichiers de police et certains fichiers judiciaires, considérant qu'il fallait dans ce domaine ne pas prendre des décisions à la va-vite et bien apprécier à la fois l'impact de ce qui était décidé et la sécurité juridique de ce type de dispositif.
Monsieur le rapporteur, vous nous répondez sur la finalité du dispositif que vous proposez, mais cette finalité, on la comprend.

Elle relève du bon sens : il faut que les magistrats puissent avoir accès à toutes les informations.
Je me souviens d'un dossier particulièrement épineux, celui du dossier médical personnalisé. Vous parlez par exemple de mettre dans ce fichier des examens médico-psychologiques, des examens psychiatriques, etc. Que faites-vous du problème du secret médical ?
De toute façon, le juge aura ces documents.

En matière de données sensibles, notamment celles relatives à la santé, le dispositif que vous proposez est en dessous du droit en vigueur dans la loi Informatique et libertés. En effet, celle-ci prévoit que, lorsqu'on introduit des données sensibles dans un fichier, le décret en Conseil d'État doit être pris non seulement après avis de la CNIL mais après un avis motivé et publié de la CNIL, c'est-à-dire un avis qui est rendu public. Le texte tel qu'il est rédigé est, je le répète, en dessous du droit actuellement en vigueur, du droit commun de la loi Informatique et libertés.
Concernant toutes les questions que j'ai posées sur les garanties quant à la durée de conservation des données ou au droit d'accès des personnes inscrites dans ce fichier, vous renvoyez au décret, mais je pense que toutes ces questions sont du domaine de la loi, qu'elles relèvent de la compétence du législateur. C'est ce qu'a prévu la proposition de loi sur les fichiers de police adoptée par la commission des lois et ce sur quoi nous étions tous d'accord. C'est d'ailleurs ce qui a été fait par le législateur en ce qui concerne le FIJAIS.
J'ai pris bonne note par ailleurs qu'il n'y avait ni avis de la CNIL ni avis du Conseil d'État sur ce dispositif.
Pour conclure, je dirai que vous apportez à ce qui peut apparaître comme une question de bon sens une mauvaise réponse. Il aurait été plus intelligent d'étudier le dispositif Cassiopée, qui est en train de se mettre en place, et de voir, le cas échéant, comment on pouvait adapter le dispositif pour le problème particulier des délinquants sexuels. Le dispositif que vous proposez non seulement ne nous paraît pas du tout entouré de garanties suffisantes mais, en plus, il ne pourra pas entrer en vigueur car il se heurtera à d'énormes problèmes juridiques.

Je ne vais pas reprendre les excellents arguments développés par Mme Batho, je voudrais simplement faire deux observations, notamment pour ceux qui ne siègent pas à la commission des lois, parce que ce que nous propose M. le rapporteur pose beaucoup de problèmes et sera très difficile à mettre en oeuvre.
Certes, le texte initial a été modifié à la suite des réactions qu'il avait suscitées mais, quand même, monsieur le rapporteur, vous qui prétendez vouloir protéger les gens et respecter les droits de l'homme, vous qui prétendez qu'il n'y a rien d'inacceptable dans le dispositif, vous aviez déposé un amendement qui ne prévoyait pas les exclusions du fichier en cas de non-lieu ou de décision de ce genre. Nous avons dû batailler, avec l'aide d'un certain nombre de députés de la majorité, dont M. Perben, pour que les choses évoluent.
Vous étiez arrivé, monsieur le rapporteur, avec des propositions si sévères qu'on se demandait comment on avait pu en arriver là. Probablement, comme l'évoquait Mme Batho, c'est la conséquence du manque de concertation. Cela vous amène, madame la garde des sceaux, à nous donner des explications avec lesquelles je suis d'accord mais qui ne correspondent pas au texte.
Spontanément, vous nous dites que, naturellement, l'accès au fichier va se faire sous le contrôle d'un magistrat, mais le texte ne dit pas cela. Le texte que l'Assemblée s'apprête à voter est le suivant : « Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ». Si la loi correspondait à ce que vous dites, madame la ministre, il aurait fallu écrire que le décret précisera les conditions dans lesquelles, sous le contrôle d'un magistrat, on aura accès à ce fichier. La rédaction qui nous est proposée ne correspond pas à l'interprétation qu'en donne le Gouvernement.
Nous partageons le souci d'efficacité mais, de mon point de vue, ce qui est proposé n'est ni fait ni à faire. Il serait souhaitable que nous adoptions, dans la procédure parlementaire, une attitude plus rigoureuse.

Je voudrais juste préciser que ne s'agit pas d'un fichier de police. C'est un répertoire qui est mis à la disposition de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire des experts et des juges. Il fait appel à la notion de secret, de secret partagé.

Je souligne que certaines analyses contenues dans ce répertoire sont pour ainsi dire tombées dans le domaine public. Elles ont déjà été dévoilées lors des audiences qui, dès lors que le huis clos n'a pas été ordonné, sont publiques. Chaque fois que, dans une audience de cour d'assises, on procède à un examen de personnalité, on cite les conclusions des experts. Ceux-ci comparaissent devant la cour. Le public a donc connaissance de leurs travaux. Puisque ceux-ci ne sont pas couverts par une procédure de secret, il n'y a rien de gênant à ce qu'ils soient ensuite consignés dans un répertoire accessible à la seule autorité judiciaire.

Au cours de l'audience, les expertises ne sont pas transmises au jury !

Je trouve surprenant qu'aux termes de l'article 5 bis les pièces de ce répertoire – ou de ce fichier – soient de plein droit transmises aux experts. Non seulement cette disposition pose un problème déontologique – car un expert qui s'appuie sur d'autres expertises sera sans doute moins objectif –, mais elle est contraire à l'usage actuel, selon lequel le magistrat choisit les pièces qu'il transmet. Il me semblerait préférable de s'en tenir à cette pratique, si l'on veut que la consultation du fichier reste limitée.

La consultation du répertoire est réservée aux magistrats et aux experts. Ces derniers devront formuler un nouvel avis sur la base non seulement d'un entretien avec l'individu concerné, mais aussi des précédentes expertises auxquelles il a été procédé. Tous les éléments d'information doivent donc être en leur possession.
Si on limite la consultation du répertoire aux seuls magistrats, on retombera dans le travers que j'ai dénoncé tout à l'heure : un expert ignorant tout du passé d'un individu ne disposera que d'un temps très bref pour émettre un avis qui risque d'être incomplet. Une telle déperdition d'information serait très dommageable.
En refusant de transmettre certains documents à l'expert, on court le double risque qu'il ne connaisse pas toute l'histoire d'un individu et qu'il effectue point par point des analyses auxquelles il a déjà été procédé.
Quand on va consulter un médecin spécialiste, lui aussi se renseigne sur les analyses antérieures.
Le décret précisera en outre que c'est sous le contrôle du juge que l'expert aura accès aux analyses antérieures. Toutes les garanties souhaitables semblent donc réunies.
(L'amendement n° 74 n'est pas adopté.)

Il est défendu.
(L'amendement n° 106 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 5 bis est adopté.)

Je m'interroge sur la faisabilité de cet article 5 ter, qui prévoit que l'injonction de soins pourra concerner des médicaments entraînant une diminution de la libido. Les conditions d'utilisation du traitement, telles que vous les prévoyez, posent plusieurs problèmes, et je souhaiterais que nous obtenions quelques informations avant d'entamer l'examen de l'article.
Quels sont les effets secondaires de ces traitements ? Il semble qu'ils soient réels et méritent la plus grande attention médicale. Certaines molécules utilisées peuvent provoquer en un ou deux ans une déminéralisation osseuse. L'une d'elles est contre-indiquée pour les personnes atteintes d'une psychose ou souffrant d'épilepsie. Enfin, elles peuvent entraîner des effets secondaires non négligeables, ce qui signifie que leur prescription doit être accompagnée d'un suivi médical rigoureux. L'utilisation de ces médicaments ne peut donc être envisagée dans tous les cas et sur le long terme.
Je m'inquiète en outre des amendements proposant que le traitement puisse être ordonné sans l'accord de l'intéressé. Si l'injonction de soins vise à entraîner une diminution de la libido, la question du consentement doit être posée. Je citerai à ce sujet les propos du président de la Cour de cassation : « Pour une majorité de thérapeutes, la reconnaissance par le sujet des faits qui lui sont reprochés, même si elle n'est que partielle ou implicite, est une condition préalable à leur intervention. Celle-ci ne peut, en outre, être envisagée que si le délinquant manifeste son accord pour en bénéficier. On peut toutefois douter de la sincérité d'un consentement manifesté en échange d'une libération ou d'un maintien en liberté, et donc de l'efficacité ultérieure du traitement. » En l'espèce, comment ne pas douter de la sincérité du consentement ?
Quant à M. Garraud, qui s'est plaint hier que je ne citais que M. Lamanda, il observe : « Les modifications effectuées permettent d'indiquer dans le code de procédure pénale, de façon explicite et sans la moindre ambiguïté, les mesures auxquelles s'expose la personne qui refuse soit de commencer, soit de poursuivre le traitement proposé :
- si elle est détenue, la personne s'expose au retrait de son crédit de réduction de peine, ou à l'interdiction de bénéficier de réduction supplémentaire de peine ;
- si elle exécute sa peine en milieu ouvert [...], la personne encourra la révocation ou le retrait de la mesure, et donc une incarcération ;
- si elle est sous surveillance judiciaire, la personne pourra être réincarcérée pour exécution de son reliquat de peine ;
- si elle est sous surveillance de sûreté, la personne pourra faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté, conformément aux dispositions et selon la procédure de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale. »
Pensez-vous que la personne acceptera de suivre ce traitement parce qu'elle est convaincue de son utilité et qu'elle souhaite sincèrement en bénéficier, ou simplement parce qu'elle voudra échapper à la prison ?
D'autre part, n'y a-t-il pas une contradiction entre les risques médicaux du traitement – puisqu'il existe des effets secondaires et des contre-indications – et la nécessité du consentement, faute duquel le traitement risque d'être inefficace ? Dès lors que le refus expose à des sanctions, le traitement médical me semble une solution très insuffisante.
Une fois encore, j'emprunterai ma conclusion au rapport Lamanda : « Il semblerait, en toute hypothèse, qu'un consensus se dégage sur la quasi-impossibilité d'appliquer un traitement médical efficace à un criminel pervers au sens psychiatrique du terme. Sans prendre parti sur ces controverses, il apparaît, en l'état des données actuelles de la science, qu'il serait hasardeux de faire reposer les programmes de prévention de la récidive uniquement sur ce type de prise en charge médicale. »
« Uniquement » : le mot est important !

« La dimension thérapeutique, en l'espèce, ne se limite pas aux remèdes de la médecine. Elle s'élargit à un ensemble de soins délivrés par une équipe pluridisciplinaire, dont la composition doit pouvoir varier selon les cas, en faisant appel aux compétences d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un criminologue clinicien, d'un éducateur, d'un assistant social et d'un infirmier psychiatrique. »
La réflexion des professionnels – et non des moindres – montre à quel point il serait difficile d'appliquer le texte de manière systématique. Quant aux amendements visant à imposer ce type de traitement, ils me paraissent totalement inadaptés.
Je remercie par avance Mme la garde des sceaux de sa réponse.

Pour ma part, je me contenterai de regretter la confusion vestimentaire qu'introduit l'article. Il y a un mois, la loi pénitentiaire prétendait revêtir les médecins du bleu de l'administration pénitentiaire ; aujourd'hui, le Gouvernement rêve d'enfiler une blouse blanche aux magistrats. J'aimerais que l'on remette un peu d'ordre dans leur garde-robe.

Je suis saisi d'un amendement n°59 , tendant à supprimer l'article 5 ter.
La parole est à M. Dominique Raimbourg.

Cet amendement nous donne l'occasion de préciser notre position sur ces questions. Tout d'abord, le traitement sur lequel porte l'injonction de soins s'appelle « traitement anti-libido ». Il ne s'agit pas d'une « castration ».
Ensuite, l'injonction de soins existe déjà.
D'autre part, elle ne peut intervenir que sur prescription médicale, laquelle doit prendre en compte toutes les contre-indications, telles que les risques d'ostéoporose ou l'existence d'une psychose.
En outre, ce type d'injonction nécessite le consentement de l'intéressé.
Enfin, pour que le traitement soit efficace, l'intéressé doit non seulement y consentir, mais y adhérer. Celui-ci peut le faire de manière rationnelle, en prenant en considération les effets bénéfiques qu'il aura sur la durée de sa détention, mais il faut aussi que, lorsqu'il est en proie à des pulsions qu'il ne parvient pas à maîtriser, il se soumette aux soins en les considérant comme un soulagement.

L'article 5 ter est l'une des dispositions les plus importantes du projet, même si le terme de castration chimique est impropre. En effet, il clarifie les règles relatives à l'injonction de soins applicable aux auteurs d'infraction sexuelle.
Il n'y a ici aucune confusion des rôles, aucun empiètement sur l'autorité médicale. C'est le pouvoir souverain de l'autorité judiciaire d'ordonner l'injonction de soins, en fonction de la personnalité de l'individu qu'elle a à juger et c'est elle qui, dans le cadre d'une surveillance de sûreté ou d'une surveillance judiciaire, lui fixe un certain nombre d'obligations. Ce peut être, de façon classique, d'aller pointer au commissariat ou d'être contrôlé par la brigade de gendarmerie, de ne pouvoir se rendre dans certains lieux, d'être placé sous surveillance électronique mobile. Ce peut être aussi de se soumettre à une injonction de soins, qui n'a rien de nouveau puisqu'elle fait partie du suivi sociojudiciaire.
Dans le cadre de cette injonction peut être prescrit un traitement pour diminuer la libido. Mais si l'autorité judiciaire ordonne l'injonction de soins, c'est bien entendu l'autorité médicale qui en définit les modalités. Il n'y a donc aucune confusion des rôles. Mais il y a, j'y insiste, un travail en commun, une interdisciplinarité indispensable. Si l'on continue à agir en fonction de clivages dans le traitement d'individus dangereux, nous n'aboutirons pas au résultat que nous recherchons tous, qui est de diminuer la dangerosité et de favoriser la réinsertion ultérieure du condamné dans la société.
L'article comprend certes une disposition nouvelle : le médecin traitant en charge du traitement anti-libido devra informer le médecin coordonnateur, ou l'autorité judiciaire directement, d'une suspension du traitement à laquelle il n'aurait pas donné son accord. C'est bien normal car le traitement anti-libido peut être très important pour éviter les récidives en matière d'infraction sexuelle.
Cela me ramène au secret partagé. Il est très important de dépasser les clivages qui existent parfois entre justice et médecine. Elles doivent travailler ensemble, car le sort de victimes potentielles en dépend et, de surcroît, la personne soumise au traitement doit pouvoir en tirer les bénéfices. Bien entendu, il n'est pas question de se passer de son consentement. Des amendements proposent de s'en dispenser pour appliquer certains traitements médicaux. Mais en l'absence de consentement, en général, le traitement est moins efficace. De toute façon, c'est un principe éthique de base que de disposer du consentement d'un individu pour pouvoir porter atteinte à son intégrité physique.
En revanche, il peut y avoir une incitation forte à respecter le traitement : la personne sous surveillance judiciaire qui refuserait le traitement anti-libido prescrit, montrant ainsi sa dangerosité potentielle et le risque élevé de récidive qu'elle présente, sera avertie qu'elle peut être de nouveau incarcérée. Si cette personne est en surveillance de sûreté, elle sera avertie de même qu'elle pourra être placée en rétention de sûreté.
Tout cela est parfaitement logique et nécessaire. Donc, avis défavorable à l'amendement.
(M. Marc Le Fur remplace M. Marc Laffineur au fauteuil de la présidence.)
Monsieur Vaxès, le traitement médical n'est pas, à nos yeux, l'alpha et l'oméga, mais une mesure dans un ensemble. Nous savons que le traitement n'est pas efficace dans tous les cas, mais il l'est pour certains. Nous savons qu'il l'est s'il est accompagné de soins psychiatriques et s'il y a un suivi pour favoriser la réinsertion. C'est bien dans ce cadre global que nous nous plaçons.
Quant aux effets du traitement, je ne suis pas médecin. Mais j'entends des médecins, dans cette assemblée et à l'extérieur, parler d'effets bénéfiques, comme j'entends des personnes qui suivent ce traitement dire qu'elles revivent grâce à lui.
Monsieur Raimbourg, nous appliquons ces dispositions dans le respect des principes : celui du consentement, qui est aussi de toute façon une nécessité médicale ; celui de la séparation du médical et du judiciaire ; celui du secret médical.
Ces principes s'imposent. Il y a ensuite des aménagements, que le rapporteur a très bien expliqués.
Je suis donc défavorable à cet amendement.

Je comprends les réserves et les interrogations de nos collègues de l'opposition. Ils ont bien fait de déposer cet amendement, car il a permis à Mme la garde des sceaux et à M. le rapporteur d'apporter des précisions indispensables à ce stade. Mme la garde des sceaux a ainsi rappelé que ces dispositions respectaient des principes et avant tout celui du consentement des détenus.
Moi non plus, je ne suis pas médecin, et je crois qu'il faut se garder d'aller trop loin en créant des contraintes qui ne sont pas de la compétence du législateur. Nous devons affirmer un principe, celui de l'obligation de soins. Il y faut bien sûr le consentement des détenus. Mais ceux-ci lancent souvent un appel au secours, pour qu'on les aide à se soigner et à éviter la récidive.
Les choses sont donc claires : il y a injonction de soins, mais le consentement du détenu est nécessaire. D'autre part, il ne faut pas, comme le demandent certains amendements, créer une situation monstrueuse. Ce qui compte avant tout, c'est de conserver la dignité de la personne humaine, même de celle dont le crime est contraire à cette dignité. C'est pourquoi il était indispensable d'encadrer les dispositions de cet article.
(L'amendement n° 59 n'est pas adopté.)

Il est défendu.
(L'amendement n° 75 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Nous en venons à l'amendement n° 11 , sur lequel je suis saisi par le groupe Nouveau Centre d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le palais.
La parole est à M. Michel Hunault pour défendre cet amendement.

Cette demande de scrutin public illustre l'importance que mon groupe attache à la limitation des remises de peine, que nous avons évoquée à plusieurs reprises. J'ai eu l'honneur de le faire hier lors des questions au Gouvernement et un de nos collègues a fait de même cet après-midi.
Vous nous avez répondu que les remises de peine dont le caractère est automatique sont diminuées de moitié pour les récidivistes, mais que, pour le reste, elles constituent un élément souvent pris en compte par le juge d'application des peines comme pouvant contribuer à la réinsertion.
L'intention est louable. Mais en pratique, que constate-t-on ? Un problème d'application effective des peines. Sur 110 000 peines environ prononcées chaque année, 33 000 ne sont jamais exécutées. Nous avons bien pris acte, madame la garde des sceaux, de votre volonté d'améliorer cette situation.
D'autre part, l'individu condamné à une peine criminelle par une cour d'assises peut, en l'état actuel des textes, et grâce aux remises de peine, bénéficier d'une sortie de prison en n'ayant effectué que la moitié de sa peine. Ce qui choque l'opinion, madame la garde des sceaux, c'est que des gens condamnés à dix ou vingt ans d'emprisonnement sortent aussi rapidement et commettent de nouveaux crimes.
Membre de la représentation nationale depuis 1993, j'ai fait devant chacun de vos prédécesseurs, comme Mme Lebranchu ou Mme Guigou, cette même réflexion. J'ai donné des exemples, comme celui des frères Jourdain qui, après avoir purgé neuf années d'une condamnation à vingt ans de prison, avaient violé, étranglé puis enterré trois jeunes filles dans le Nord-Pas-de-Calais. Et, depuis quinze ans, ces cas horribles se sont multipliés.
Je ne demande qu'une chose : que les remises de peines ne soient plus automatiques pour les personnes en état de récidive. Quelqu'un qui a déjà tué deux fois ne doit pas pouvoir le faire une troisième fois sans avoir effectué la totalité de sa peine d'emprisonnement.
Il faut que nous soyons cohérents : il faut que nous protégions la société contre certains individus extrêmement dangereux. Le projet de loi pour lequel nous vous apportons notre soutien va dans ce sens, mais cet amendement vise à restreindre les remises de peine qui, sans cela, resteront automatiques, malgré les réductions que vous avez prévues pour certaines d'entre elles.
J'ai constaté que certains députés du groupe UMP avaient repris cette suggestion dans des déclarations de presse, des amendements ou des propositions de loi ; je m'en réjouis. Il ne s'agit pas de courir après l'opinion publique, mais seulement de donner les moyens aux juges de ne pas remettre en liberté des détenus particulièrement dangereux – même si je reconnais qu'en la matière, le projet de loi constitue déjà un progrès.
Madame la garde des sceaux, je n'attends pas nécessairement le soutien du Gouvernement mais, comme tout à l'heure, vous pourriez vous en remettre à la sagesse de l'Assemblée. Cela permettrait à chacun de prendre ses responsabilités à propos de cet amendement que je défends au nom de mon groupe.

Bien entendu, je comprends la légitime préoccupation de Michel Hunault. Cependant, il n'est pas tout à fait exact de parler de réductions de peine automatiques. En effet, le juge de l'application des peines a la possibilité de ne pas accorder ces réductions de peine, notamment en cas de mauvaise conduite ou, depuis la loi du 25 février 2008, si un détenu ne suit pas un traitement médical prescrit en détention. Il existe ainsi toute une série de raisons qui peuvent justifier qu'une réduction de peine ne soit pas accordée.
Par ailleurs, nous sommes tous d'accord pour que les détenus suivent un parcours individualisé d'exécution de la peine. Si la peine n'est qu'une mise à l'écart et qu'à l'issue de celle-ci le détenu est remis en liberté sans qu'il soit possible d'utiliser certains aménagements de peine pour préparer sa réinsertion, nous allons manquer notre but. Car nous cherchons bien à sanctionner – nous sommes tous d'accord sur l'exemplarité de la peine et sa valeur pédagogique –, mais nous pensons aussi que la peine doit être utile tant au détenu qu'à la société. En effet, si l'individu sort de détention en étant aussi dangereux que lors de son incarcération, l'échec est assuré.
Il faut donc faire en sorte qu'en cours de détention l'individualisation de la peine puisse aller jusqu'à permettre un aménagement de peine – c'est ce que nous avons prévu en adoptant la loi pénitentiaire. Ces aménagements ne peuvent bénéficier au détenu que si l'on constate sa réelle volonté de se réinsérer, et si les conditions de sa libération permettent sa réinsertion.
Les réductions de peine présentent donc un double intérêt. Elles permettent d'abord à certains détenus de garder une sorte d'espoir, lors de leur arrivée en détention. Elles permettent ensuite de mettre en place des dispositifs de surveillance pendant la durée des réductions de peine.
L'auteur de cet amendement et les collègues qui le soutiennent souhaitent eux aussi que les détenus ne soient pas relâchés dans la nature sans aucune surveillance, parce qu'alors ils récidiveraient. Or c'est précisément durant la période des réductions de peine que pourra être mise en place la surveillance judiciaire.
Une personne condamnée à dix ans de prison peut ainsi bénéficier de réductions de peine qui lui permettront de sortir après six ou sept ans de détention. Pendant les trois ou quatre ans qui courent jusqu'à la fin de la peine initialement prononcée, il sera alors possible de la placer sous surveillance judiciaire et de lui imposer toute une série d'obligations.
Finalement, si nous devions supprimer les remises de peine, cela nous amènerait à rendre inapplicables la surveillance judiciaire et les mesures de contrôle de l'individu, que ces périodes permettent de mettre en place.

Le parcours individualisé d'exécution de la peine et les mesures de sûreté, qui prennent le relais pour les individus déclarés dangereux, répondent à la préoccupation exprimée par cet amendement.
Vouloir qu'il n'y ait aucun aménagement de peine,…

…c'est aller à l'encontre de tout ce que nous avons voté ces dernières années pour permettre une véritable réinsertion des individus dans la société.
Ce sont les réductions de peine qui permettent de mettre en place la surveillance judiciaire. Sans elles, il n'y aurait que des sorties sèches : vous auriez sans doute la satisfaction de constater que la peine a été intégralement purgée mais, à la sortie des détenus, aucun dispositif de surveillance judiciaire ne pourrait être mis en place.
Adopter cet amendement remettrait en cause l'intérêt des mesures que nous sommes, par ailleurs, en train de voter. Tout en comprenant les motivations qui animent ses auteurs, je souhaite que nous puissions poursuivre dans la voie de l'individualisation de la peine.
Je précise que celle-ci n'est pas synonyme de clémence, mais qu'elle joue aussi dans le sens de la fermeté. En tant que rapporteur de la loi pénitentiaire, j'ai encouragé les aménagements de peine pour ceux qui voulaient se réinsérer ; en tant que rapporteur de ce projet de loi, j'appelle à la fermeté envers ceux qui restent très dangereux.
Pour ne pas remettre en cause une logique, fondée sur les réductions de peine, à laquelle nous tenons, j'émets un avis défavorable.
Monsieur Hunault, je ne dirai certainement jamais que vous courez derrière l'opinion publique. Je vous connais, je connais vos motivations. Comme vos collègues, vous cherchez à renforcer certaines dispositions parce que vous cherchez les meilleures solutions possibles pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Je suis d'accord avec vous quand vous relevez l'incompréhension fréquente de l'opinion publique. Moi-même, il m'est arrivé d'avoir la même réaction. C'est d'ailleurs en prenant cet élément en considération que j'ai, à plusieurs reprises, recommandé au parquet de faire appel de certaines décisions : le risque existait que des personnes soient libérées dans un délai tel que l'opinion n'aurait pas compris.
Pour autant, je ne suis pas favorable à votre amendement.
Les réductions de peine sont un outil pour obtenir le respect de certaines règles ou attitudes de la part de la personne condamnée. La remise de peine dite « automatique » ne l'est pas en réalité. Elle sert plutôt à donner au détenu une référence : il sait ce qu'il peut obtenir s'il se conduit bien. Il s'agit donc d'une incitation à la bonne conduite. Vous connaissez la situation difficile des institutions pénitentiaires ; que va-t-il se passer si nous ne disposons plus de la menace qui consiste à pouvoir mettre fin au petit avantage que constitue la réduction de peine ? Nous risquons d'être confrontés à des situations ingérables. C'est lorsque les gens n'ont rien à perdre qu'il y a des problèmes, la prise d'otage qui a eu lieu hier illustre partiellement cette situation. Pour gérer les personnes détenues, nous avons besoin d'une sorte de « carotte » qui les pousse à la bonne conduite.
Mais l'incitation concerne aussi le suivi médical et les actions de réinsertion par la formation ou l'apprentissage d'un métier. Nous devons conserver une possibilité de sanction contre ceux qui, par exemple, ne respectent pas l'engagement pris de suivre un traitement médical. Si nous renonçons à la possibilité de la sanction que constitue la suppression d'une réduction de peine, pourquoi voulez-vous que certains détenus s'engagent à se faire soigner ?
Les réductions de peine permettent de gérer des situations individuelles complexes. Il est important de ne pas enlever aux juges les moyens dont ils disposent. Elles permettent évidemment une meilleure préparation de la sortie et une meilleure réinsertion.
Je sais, comme vous, qu'il est difficile de faire comprendre tout cela à l'opinion publique. Il faut que nous réussissions à mieux nous expliquer. Nous devons pouvoir dire, tous les ans, dans quels cas et combien de fois il a été mis fin à des réductions de peine – nous pourrions le faire devant la commission des lois. Cela permettrait à l'opinion publique de comprendre ce que nous faisons.
Je suis très sensible à l'incompréhension que manifeste l'opinion publique. Pour ma part, je pense que nous avons besoin d'elle si nous voulons réussir la lutte contre la récidive, c'est-à-dire la réinsertion des personnes. Tant qu'elle sera réticente à l'égard de ceux qui ont purgé leur peine ou de ceux qui sont en cours de réinsertion, nous ne réussirons pas réellement cette réinsertion et, par voie de conséquence, nous ne parviendrons pas à lutter contre la récidive.

Plusieurs orateurs souhaitent prendre la parole sur l'amendement n° 11 .
La parole est à M. Dominique Raimbourg.

Le crédit de réduction de peine mis en place en mars 2004, sous l'égide de M. Perben, est un assez bon système. Par son caractère incitatif, il constitue un mode de gestion et de réinsertion des détenus. Vouloir y mettre fin, c'est, en quelque sorte, scier la branche sur laquelle nous sommes en train de nous asseoir en examinant ce projet de loi. En effet, les crédits de réduction de peine ont été instaurés pour mettre en place la surveillance judiciaire qui permet ensuite la surveillance de sûreté. Ceux qui sont favorables à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté ne peuvent pas vouloir supprimer les crédits de réduction de peine : cela n'aurait pas de sens.
Voter cet amendement, ce serait, à la fois, risquer une explosion dans les prisons, et empêcher de suivre les détenus à l'issue de leur peine. Le risque serait non seulement de créer un grand désordre, mais aussi de favoriser la récidive.

Monsieur Hunault, nous ne sommes pas d'accord avec votre amendement.
Il y a peu, l'examen du projet de loi pénitentiaire a donné lieu à un débat approfondi. À cette occasion, nous nous sommes rendu compte que si notre pays ne parvient pas à faire exécuter les peines prononcées, c'est parce que ses prisons sont trop pleines.
Nous avons ainsi débattu durant de longues heures des moyens que nous pouvions mettre en oeuvre pour réduire le nombre des personnes détenues, notamment du développement du placement sous surveillance électronique mobile. Or, si l'on supprime les réductions de peine pour les personnes condamnées à plus de cinq d'emprisonnement, il est évident que la surpopulation carcérale que nous dénoncions s'accroîtra davantage encore. En outre, je souhaiterais que l'on m'explique comment nous parviendrons à recruter des gardiens de prison si l'on ôte à certains détenus la perspective de bénéficier d'une remise de peine pour bonne conduite.
Cet amendement est le type même de la fausse bonne idée et nous devons nous y opposer. Il nous appartient, en tant que responsables politiques, de faire admettre un certain nombre de vérités à l'opinion publique et de lui faire comprendre qu'en conservant la possibilité de prononcer des réductions de peine, nous assurons sa tranquillité. En effet, ce dispositif incite les personnes condamnées à suivre la voie de la réinsertion et à prendre des traitements pour pallier les problèmes qu'ils rencontrent. Nous ne devons pas craindre d'affronter l'opinion et de lui expliquer pourquoi les remises de peine sont un élément important d'une bonne politique pénale, d'une bonne politique de réinsertion et d'une bonne politique de sécurité.

Monsieur Hunault, j'avais moi-même déposé des amendements visant à limiter les remises de peine automatiques, mais j'ai été sensible aux arguments développés par le rapporteur lors des débats au sein de la commission des lois.
Le projet de loi forme un ensemble cohérent. Autant je suis pour la fermeté – et j'ai proposé que l'on abaisse les seuils permettant le suivi des délinquants dangereux –, autant je crois que nous ne pouvons pas bâtir un système qui désespère de l'homme et du juge et qui, de surcroît, compliquerait la tâche de l'administration pénitentiaire. Ce texte va très loin ; je rappelle que nous avons voté un dispositif prévoyant la castration chimique, ce qui est une grande nouveauté. La France n'est pas en avance en la matière. Pourtant – et c'est ce que je souhaitais expliquer tout à l'heure, mais on ne m'en a pas donné la possibilité –, ce dispositif fonctionne bien dans d'autres pays, qui ne sont absolument pas liberticides.
Dans l'architecture parfaitement cohérente de ce texte, votre amendement n'a plus sa place. Il nous faut en effet conserver le système actuel, car il est incitatif pour le détenu, il facilite la tâche de l'administration pénitentiaire et il respecte le rôle du juge d'application des peines, lequel n'aurait plus de raison d'être si votre amendement était voté. On ne peut pas me suspecter d'être laxiste, mais il me semble que nous devons faire confiance au rapporteur. C'est pourquoi je demande, au nom du groupe UMP, le rejet de cet amendement.

Je soutiens la proposition de notre collègue Michel Hunault. En effet, comment fait-on dans les autres pays ? Que je sache, il n'existe pas, en Allemagne, autant de réductions de peine qu'en France. Pourquoi devrions-nous accepter que les criminels n'exécutent que la moitié de leur peine ? On semble considérer dans cet hémicycle que l'opinion publique est un peu demeurée et qu'elle devrait être éduquée, tandis que nous, nous détiendrions le savoir. Mais nous sommes les représentants du peuple et la justice est rendue au nom du peuple français.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à cause d'un certain laxisme, d'une démagogie permanente et de la crainte de voir exploser les prisons – parce qu'on n'y a pas consacré les moyens financiers nécessaires –, on relâche dans la nature, à la moitié de leur peine, des personnes condamnées pour des faits extrêmement graves. On peut justifier tout et n'importe quoi, mais il n'est pas acceptable que, dans notre pays, des criminels sortent de prison en n'ayant effectué que la moitié de leur peine. J'entends l'argument du rapporteur, qui est juste, bien évidemment. Il s'agit de parvenir à un équilibre. Mais là, on est véritablement passé d'un extrême à l'autre, et je suis très étonné que le Gouvernement n'entende pas la colère de nos concitoyens.

Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'amendement n° 11 .
(Il est procédé au scrutin.)

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 42
Nombre de suffrages exprimés 42
Majorité absolue 22
Pour l'adoption 5
Contre 37
(L'amendement n° 11 n'est pas adopté.)


Il me semblait que cet amendement aurait pu être soumis à une discussion commune avec l'amendement n° 11 , car ils ont tous les deux le même objet. Je vais donc en profiter pour demander des éléments de réponse supplémentaires.
L'amendement n° 99 vise à supprimer le caractère automatique des réductions de peine. Mes connaissances en droit pénal sont certainement insuffisantes mais, si je comprends l'argument de Mme la garde des sceaux, selon lequel il ne faut pas désespérer les personnes condamnées, en revanche, je comprends mal que l'on en soit pratiquement arrivé à instaurer une automaticité des remises de peine si le juge d'application des peines a la faculté de prononcer ou non ces dernières.

Mon cher collègue, l'amendement n° 99 ne pouvait pas faire l'objet d'une discussion commune avec l'article 11, car ils ne visent pas le même alinéa de l'article 5 ter, même s'ils traitent de sujets très proches.
La parole est à M. Nicolas Dupont-Aignan.

Je serai bref, car la question a déjà été abordée. Mme la garde des sceaux a évoqué la nécessité de disposer d'informations sur les cas où la réduction de peine quasi automatique – pour ne pas dire automatique – de l'article 721 est prononcée par le juge d'application des peines. Il serait en effet intéressant de disposer de statistiques dans ce domaine – mais j'ignore si le ministère peut les fournir –, afin que nous sachions exactement où nous en sommes.
Cela dit – pardonnez-moi d'insister, mais vous me connaissez –, je maintiens que nous sommes allés trop loin. Nous, élus de la nation, nous ne pouvons pas nous indigner que des innocents meurent sous les coups d'assassins libérés au bout de six ans – je ne pense pas à vous, madame la garde des sceaux, mais aux plus hautes autorités de l'État, notamment au Président de la République – et ne pas tirer les conséquences de nos indignations au moment où nous faisons la loi. De deux choses l'une : ou bien l'on se tait et l'on assume la loi telle qu'elle existe, ou bien l'on partage, à juste titre, la peine et l'indignation du peuple français et l'on en tire les conséquences au moment de voter la loi. En tout cas, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, car c'est à cause de ce type de discours que la parole politique est profondément discréditée dans notre pays.

Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements en discussion commune ?

Le débat est identique à celui que nous avons eu sur l'amendement précédent. Sans tomber dans des arguties juridiques, il ne faut pas confondre automatique et systématique : il n'y a pas de réduction de peine systématique.
Surtout, grâce au texte que nous allons voter, nous allons « positiver », si je puis dire, la réduction de peine, puisque, lorsqu'elle sera prononcée – ce qui, je le répète, n'est pas obligatoire –, elle sera désormais assortie, si jamais il existe un risque particulier, d'une surveillance judiciaire. Nous apportons donc une réponse au problème posé.
Il est vrai que la loi de 2008 et ce projet de loi auraient pu être votés plus tôt, peut-être même sous d'autres majorités. Mais, encore une fois, nous allons « positiver » ces réductions de peine, en contrôlant l'individu. Je suis donc défavorable à ces amendements, même si je comprends tout à fait ce qui a été dit par leurs auteurs ; j'entends, moi aussi, mes concitoyens. J'ajoute que les précisions que Mme la garde des sceaux vient d'apporter sont très importantes.

Il ne faut pas mélanger les sujets. Premier point : nous votons des lois ; celles-ci doivent être appliquées. Pour chaque acte de délinquance, il doit donc y avoir une réponse pénale.
Deuxième point : lorsqu'un tribunal prononce un jugement au nom du peuple français, celui-ci doit être exécuté. Nous devons être d'une rigueur totale dans ce domaine. Quand une peine de prison ferme est prononcée, elle doit donc être exécutée rapidement. Toutefois, en l'espèce, il ne s'agit pas de l'exécution de la peine de prison, mais de ses modalités.
Il n'existe pas de réduction de peine automatique : c'est une contrevérité. Il existe en réalité deux types de remise de peine.
Le premier a pour but d'inciter les personnes emprisonnées à bien se comporter en détention. Que ceux qui balaient cet argument d'un revers de main aillent passer un ou deux jours avec les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, à qui l'on demande d'assurer le bon ordre de l'établissement : ils s'apercevront de l'importance de ce type de dispositif. La nature humaine est ce qu'elle est, et il est utile que les détenus soient incités à bien se comporter.
La disposition qui a été introduite par amendement dans la loi « Perben II » sous la précédente législature, et dont j'ai pris l'initiative – je vous remercie d'avoir refusé à la quasi unanimité de la supprimer – prévoit que la date de sortie est calculée au moment de l'entrée en prison de la personne condamnée. En effet, si l'on décide d'un aménagement de peine en fin de peine, mieux vaut savoir quand celle-ci se termine. Cette disposition prévoit également que, si le détenu se comporte mal, s'il cause des troubles à l'ordre public, par exemple en agressant quelqu'un, il sera sanctionné : sa date de sortie sera repoussée. Si, lorsqu'il est entré, sa fin de peine a été fixée au 15 mai 2010, elle sera repoussée, par exemple, au 15 septembre. On a considéré que ce dispositif était extrêmement pédagogique, et je l'assume entièrement. Au reste, je n'ai jamais eu de difficultés à l'expliquer ni devant nos concitoyens, ni dans des réunions publiques, face à des militants de ma formation politique.
L'autre type de réduction de peine, prononcée au cas par cas, correspond à une récompense accordée aux détenus qui se comportent bien. Une personne qui suit une formation, obtient un diplôme, montre la volonté de s'en sortir ou de travailler doit être récompensée : dans la société, c'est donnant-donnant.
Troisième point : comme l'a excellemment dit le rapporteur, quand une réduction de peine est prononcée, elle est assortie d'une sorte d'élastique. En effet, de plus en plus souvent, une fois sortis, les détenus sont accompagnés et doivent respecter des règles. S'ils ne les respectent pas, ils retournent en détention. C'est un moyen d'être efficace. Je rappelle qu'en 2002, lorsque nous avons commencé à modifier l'orientation de la politique en matière d'exécution des peines, la quasi totalité des sorties de prison étaient sèches : les détenus quittaient la prison du jour au lendemain et étaient renvoyés, sans aucune obligation à respecter ni suivi, dans le milieu où ils avaient commis leurs actes de délinquance. Tous nos concitoyens comprennent parfaitement que, dans ces conditions, ils ont toutes les chances de récidiver et que l'enjeu n'est pas qu'ils restent quinze jours de plus en détention – car, de toute façon, ils sortiront –, mais que, pour faire diminuer le taux de récidive, leur sortie doit être accompagnée dans le cadre de dispositifs tels que ceux qui figurent dans ce texte.
C'est une illusion de vouloir faire croire à nos concitoyens qu'en gardant un détenu un mois de plus, on leur procurera plus de sécurité. Le véritable enjeu consiste à faire baisser la récidive après la sortie de prison.
Enfin, mes chers collègues, si vous voulez remettre en cause le dispositif des réductions de peine, ce n'est pas dans le cadre de ce texte que vous devez le faire. C'est lors du vote des crédits du ministère de la justice que vous auriez dû vous manifester ! Ce n'est pas vraiment le moment, alors que nous venons de lancer le plus grand plan de construction d'établissements et d'embauche de surveillants, de procéder à un changement de politique pénale. Ceux qui souhaitent ce changement sont invités à venir mettre en place, lors de l'examen du budget, les crédits destinés à permettre la construction des établissements nécessaires. Lorsque, et seulement lorsque cette construction sera terminée, ils pourront proposer l'application d'une autre politique. Il faut être logique : on ne peut pas venir faire ici des déclarations dans le but de flatter telle ou telle partie de l'électorat, sans avoir en contrepartie à assumer financièrement les conséquences de ce que l'on propose.
Je me félicite du vote qui a été demandé par scrutin public, où chacun a pris ses responsabilités en son âme et conscience : 37 voix contre 5. J'étais parmi les 37 et j'en suis fier, comme je suis fier de défendre la position qu'ont adoptée la commission et le Gouvernement.
Je veux rappeler une chose que j'ai déjà dite à plusieurs reprises dans cet hémicycle : pour être respectée, la justice doit être à la fois ferme, sereine et équitable, ces caractéristiques n'étant pas incompatibles. C'est, et ce sera toujours ma position.
Je suis en mesure de répondre à M. Dupont-Aignan sur les chiffres, que l'on vient de me communiquer. Pour l'année 2008, les greffes des établissements pénitentiaires ont enregistré 18 550 retraits de crédits de réduction de peine pour 86 317 personnes condamnées et écrouées. Nous ne sommes pas loin de 20 % des personnes incarcérées, ce qui n'est pas négligeable, et vous avez sans doute raison de considérer que ces chiffres devraient être davantage connus de l'opinion publique.

C'est un débat important et honorable que nous avons actuellement. Une fois n'est pas coutume, nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par le président de la commission et par Mme la ministre. La seule réserve que j'émettrai vis-à-vis de M. le président de la commission est sa façon de considérer, comme à son habitude, que l'histoire commence en 2002 – à l'exception de la loi de 1998, qui comportait déjà le sursis avec mise à l'épreuve.
Sur le fond, il n'est pas admissible qu'un responsable politique surfe sur des contrevérités. Notre travail pédagogique est d'expliquer la réalité à nos concitoyens. Les personnes ne connaissant pas la procédure et ne sachant pas tout ce qui a été dit ce soir peuvent être amenées à considérer qu'il n'est pas normal de réduire ainsi les peines, et il se trouvera toujours quelqu'un pour tenter de surfer sur ce sentiment. Il faut n'avoir jamais rencontré des responsables de la pénitentiaire, qui font partie de nos concitoyens exerçant l'un des métiers les plus difficiles, pour penser que l'on peut voter ce type d'amendement sans que cela ait des conséquences. L'ambiance dans ces établissements est très difficile, et tout le monde vous dira que le crédit, alimenté par la bonne conduite au sein de l'établissement, est extrêmement important : à défaut, on se retrouverait confronté à des incidents majeurs et à des actes désespérés de la part de détenus n'ayant plus aucune perspective. Il faut se rendre dans les centres pénitentiaires et parler avec les fonctionnaires qui font ce métier : ils sont unanimes à dire que là est la première préoccupation.
Il ne faut pas non plus alimenter l'idée selon laquelle il y aurait des remises de peine automatiques. Ce n'est pas vrai ! Ce qui est automatique, c'est ce qui ne peut pas être remis en cause. D'ailleurs, au moment où le juge ou le jury prend sa décision, l'existence même de ces remises fait partie du débat. Lors d'un procès d'assises, c'est quasiment un exercice obligé sinon pour le parquet, du moins pour l'avocat de la partie civile d'appeler à prononcer une peine plus élevée en disant : « si vous voulez qu'il fasse dix ans, mettez-lui en quatorze, sinon il n'en fera que six ! » Certains ne veulent pas dire comment ça se passe, mais il est évident que cet aspect des choses est pris en considération, comme le savent tous les magistrats et toutes les personnes s'intéressant un tant soit peu aux procès d'assises.
Je remercie Mme la garde des sceaux d'avoir indiqué ce chiffre très important de retraits, qui montre bien quelle arme les crédits de réduction de peine constituent pour l'administration pénitentiaire. Supprimer les remises automatiques, comme il est proposé, n'a de plus aucun sens : cela revient à vider la surveillance judiciaire de son contenu. Que resterait-il, à part les sorties sèches ? Or, il faut bien un cadre juridique permettant d'appliquer la surveillance judiciaire.
Ces amendements constituent donc une véritable régression et, pour notre part, nous nous rangeons à l'avis exprimé par Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur.

J'ai souhaité reprendre la parole car, alors que j'avais cru comprendre que M. le président de la commission, M. le rapporteur et Mme la ministre répondaient aux auteurs des amendements en discussion, ils ont fait référence au scrutin public sur l'amendement que j'avais déposé au nom de mes collègues du groupe Nouveau Centre.
Monsieur le président de la commission des lois, vous avez exprimé un point de vue, et j'en ai un autre. Fort heureusement, nous sommes en démocratie, ce qui nous permet d'échanger dans cet hémicycle. Il s'agissait de remettre en cause les remises de peine en cas de récidive. Je vous rappelle que le Président de la République, à la suite d'un fait tragique, a reçu lui-même l'entourage familial d'une victime, ce qui lui a donné l'occasion d'affirmer que des mesures seraient proposées, dans le cadre de la loi sur la récidive, pour remettre en cause les remises de peine et mieux tenir compte de la dangerosité.

Il ne m'a pas semblé que l'amendement proposé au nom du groupe Nouveau Centre était en contradiction avec la volonté présidentielle. Je prends acte qu'une partie de sa majorité a décidé de s'opposer à cet amendement, et je respecte cette position.
Pour ma part, je suis très serein sur ces questions difficiles, et vous ne pouvez m'accuser, madame la garde des sceaux, de courir après l'opinion publique. J'ai visité des prisons dans le monde entier pour le Conseil de l'Europe et modestement contribué à essayer d'élaborer un cadre visant à assurer la meilleure dignité des personnes privées de liberté. Si je ne croyais pas en l'individu, quand bien même il aurait commis des crimes, je n'aurais pas accompli tout ce travail, et je suis heureux que la récente loi pénitentiaire – avec le même rapporteur que pour ce texte – se soit inspirée des recommandations du Conseil de l'Europe.
Nous devons aborder ces questions avec beaucoup de modestie mais, pour ma part, madame la garde des sceaux, je me réfère à la réalité. Monsieur le président de la commission des lois, je vous rappelle que le dernier crime dont l'opinion publique a été le témoin a été commis – comme cela avait été le cas il y a un an avec Melle Schmitt, qui n'est jamais arrivée à Versailles – par des gens qui, après avoir été condamnés pour d'autres crimes, avaient été libérés à mi-peine. Mon amendement portait sur la récidive légale pour crime. Que vous ne soyez pas d'accord, je le respecte, mais je note que la volonté présidentielle n'est pas suivie dans cet hémicycle, et chacun devra prendre ses responsabilités.
Je prends les miennes et je crois, madame la garde des sceaux, que nous partageons des valeurs communes. Vous avez donné des chiffres, et il me paraît effectivement important de faire preuve de transparence. Il me semble que nous nous opposons sur des objectifs qui ne sont pas si éloignés que cela, car si nous ne partagions pas le même idéal, la même croyance en l'individu, nous ne serions pas en train de débattre dans cet hémicycle. Au-delà de la discussion de ce soir, nous aurions intérêt à poursuivre, dans la transparence, l'évaluation des textes que nous votons, en l'occurrence l'évaluation des remises de peine.
Si nous sommes là ce soir, c'est bien parce qu'il y a des lacunes. Je veux rappeler avec fermeté à M. le président de la commission des lois que les magistrats ne sont là que pour faire respecter et appliquer la loi.

Si la loi comporte des imperfections et des lacunes, c'est à nous de les corriger en vue de son amélioration. Dans un débat extrêmement difficile, nous n'avons pas intérêt, les uns et les autres, à en rajouter ou à s'approprier un idéal qui dépasse tous les clivages politiques.

Je veux dire à M. le président de la commission des lois que j'accepte difficilement que le fait d'avoir une opinion différente de la sienne nous vaille d'être accusés de flatter certains électorats. Je trouve que ces propos ne sont pas très corrects de la part d'un président de la commission des lois. Les sujets graves que sont la perte de crédibilité de la justice et l'impunité qui règne dans certains quartiers méritent qu'on les traite sérieusement.
Par ailleurs, j'ai souvent reçu des syndicats de la pénitentiaire, j'ai visité des établissements et, comme nombre d'entre nous, je sais très bien ce qui s'y passe. Pourquoi caricaturer notre position ? Il n'a jamais été question de supprimer toute remise de peine, mais seulement de supprimer l'article 721 – les trois autres mois permettant, vous le savez très bien, de gagner en souplesse.
Vous n'avez pas, je le répète, répondu sur ce qui se passe à l'étranger. La France serait-elle le seul pays démocratique au monde à ne pas pouvoir faire fonctionner ses prisons correctement ? Sur ce point, je rejoins M. le président de la commission des lois : il faut bien en assumer le coût. Il y a plus de prisonniers par habitant en Angleterre et en Allemagne, mais on se refuse toujours à considérer, dans notre pays, que la prison est une solution, et on paye très cher cette démagogie.
Enfin, M. le président de la commission des lois parle de pédagogie pour les prisonniers. J'ai entendu, dans les quartiers, de vrais voyous dire qu'en France, on peut tuer quelqu'un sans que cela coûte plus de cinq à sept ans. Voilà la réalité ! Aujourd'hui, des trafiquants de drogue n'hésitent plus à tuer, car il est entré dans l'esprit de nombre de délinquants que la vie d'un homme ne vaut pas cher aux yeux de la justice, et qu'ils seront ressortis de prison au bout de six ans. Croyez-moi, la première des pédagogies, dans une société, est sans doute l'exemplarité de la peine : faire comprendre aux délinquants que lorsqu'on tue un citoyen, on reste plus de cinq ou six ans en prison. Ce n'est pas, à l'heure actuelle, ce que pensent la plupart des délinquants, avec des conséquences tragiques pour la vie sociale de notre pays.

Monsieur le président de la commission des lois, j'ai été profondément choqué par vos propos. J'ai voté en mon âme et conscience l'amendement de mon collègue Michel Hunault, et je ne l'ai pas fait pour flatter l'opinion publique, loin s'en faut. Je veux vous préciser, monsieur Warsmann, que j'ai personnellement connu Marie-Christine Houdeau, Milly-la-Forêt faisant partie de ma circonscription.
Je n'ai pas l'impression de me montrer populiste en prenant fait et cause pour ce qui a été dit par MM. Hunault et Dupont-Aignan. Lorsqu'il a reçu la famille de Marie-Christine, le Président de la République a pris ce dossier à bras-le-corps et annoncé très clairement qu'il fallait lutter contre la récidive. Pardon si je montre trop de passion et si je sors un peu du propos, mais je veux tout de même dire qu'il y en a assez de voir certaines personnes commettre des crimes à répétition. L'individu qui a séquestré, violé et tué Marie-Christine Houdeau avait déjà violé une mineure précédemment.
Je veux simplement dire que le débat est ouvert : il n'y a pas de sujet tabou. Alors, comment expliquer à la famille et à l'opinion publique qu'un homme, condamné à dix ans de prison, est sorti au bout de sept ans, s'est installé à quelques centaines de mètres de la maison de l'adolescente qu'il avait violée, et a séquestré, violé et tué une femme qu'il avait suivie tel un prédateur après l'avoir repérée alors qu'elle faisait son jogging ?
Monsieur le président Warsmann, nous réagissons devant des faits inexcusables. Il n'est pas question ici de voleurs de poules : il s'agit d'individus qui ont tué, violé. Nous ne nous adressons pas à l'opinion publique : nous voulons régler des problèmes concrets. Cela semble vous faire sourire. Moi, je n'ai vraiment pas envie de sourire.
Les propos que vous avez tenus vont sûrement choquer l'opinion publique. Ils ont en tout cas profondément choqué des élus qui, comme vous, sont des élus de terrain, connaissent le monde de la pénitentiaire, ont dans les quartiers difficiles de leur commune, des personnes qui font leur travail, à Fleury-Mérogis ou ailleurs, pour ne parler que de l'Essonne.
Alors, de grâce, ne jugez pas ceux qui prennent leurs responsabilités, qui font partie de la majorité, comme moi, et qui, simplement, expriment ce que le Président de la République a rappelé. Il n'y a pas de sujet tabou, n'en déplaise à ceux qui font de l'angélisme sur les bancs opposés. Pardonnez-moi de tirer peut-être un peu contre mon camp, mais je n'ai pas de leçons à recevoir en tant que député et porteur de message. Ce n'est pas flatter l'opinion publique, c'est s'assumer pleinement.

Je n'ai souhaité blesser personne. J'ai cru comprendre, à entendre certaines interventions, qu'on voulait faire passer le système français pour un des plus ridicules au monde et les députés qui avaient voté les dispositifs existants, dont la loi Perben 2, comme des personnes inconséquentes ou laxistes. J'ai donc répondu à cette critique-là. J'assume tout ce que j'ai dit à cet égard.
Si je n'ai pas voulu vous blesser, sachez que, moi, je l'ai été par la manière dont vous avez attaqué le droit actuel, comme si ce dernier était mû par je ne sais quel laxisme. Non, ce ne sont pas des soixante-huitards échevelés qui ont voté la loi Perben 2 ! Nous avons beaucoup réfléchi et travaillé sur ce sujet.
Monsieur Marlin, vous posez de vraies questions. Mais ainsi que j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, vous apportez de fausses réponses. S'agissant des faits divers que vous avez évoqués, ce n'est pas en supprimant les réductions de peine qu'on va résoudre le problème. Une telle mesure coûterait énormément d'argent public, ne pourrait être appliquée que dans un certain nombre d'années et soulèverait de multiples difficultés.
Les vraies réponses, ce sont les dispositions que nous vous proposons. Vous avez cité le cas d'un sortant de prison qui narguait sa victime. Nous souhaitons précisément que, désormais, le juge prononce une interdiction de paraître à proximité de sa victime pour la personne condamnée. Tout en laissant sa liberté au magistrat, on va même lui demander de motiver sa décision s'il ne prononce pas cette interdiction. Voilà une vraie réponse !
S'agissant des personnes en fin de peine, on ne cesse de développer des dispositifs visant à imposer des conditions, à assurer un suivi, à rendre obligatoire des traitements. Bref, nous mettons en place tous les moyens de coercition, là où ils seront utiles.
Enfin, ne mélangeons pas tout ! Je l'ai dit tout à l'heure : s'agissant du petit délinquant, toute infraction doit être sanctionnée et, lorsqu'un jugement est prononcé, il doit être exécuté. Mais ne faisons pas d'amalgame entre la majorité des délinquants et ces quelques dizaines de personnes, qui sont à la fois des criminels et des malades, et dont on doit à nos concitoyens de ne pas les laisser en liberté tant qu'on pense qu'elles sont dangereuses. C'est l'objet du dispositif de la rétention de sûreté – le rapporteur a même employé, en la matière, le terme « perpétuel ».
Nous sommes conscients que certains individus sont à la fois des délinquants et des malades que la médecine ne permet pas aujourd'hui de soigner et dont les spécialistes disent qu'ils sont dangereux. La majorité souhaite donc donner à notre pays les moyens de ne plus remettre ces personnes en liberté. Oserai-je dire que ces questions auraient dû être traitées lorsque la peine de mort a été supprimée ?

Je le pense sincèrement. Nous le faisons aujourd'hui, avec quelques dizaines d'années de retard, hélas ! Nous le faisons, en tout cas. Je l'assume, et le rapporteur avec moi.
S'agissant du reste de la délinquance, le problème est totalement différent. Pour celui qui doit passer trois ou six mois en prison, il faut faire en sorte que cette peine soit exécutée et qu'à la sortie, les risques de récidive soient le plus faibles possible.
Il y a deux logiques. La première concerne des cas très limités et vise à ne pas remettre librement dans la société les individus très dangereux en question. La seconde concerne 99 % des cas et tend à prévoir des obligations pour éviter la récidive – c'est la lutte contre les sorties sèches.
Voilà ce que je voulais dire. Le débat aura permis à chacun de s'exprimer. Pour ma part, je suis content d'avoir dit ce que je pensais en expliquant qu'on gérait les conséquences de la suppression de la peine de mort et qu'on voulait doter notre pays d'un système à la fois respectueux de la dignité des personnes et de la sécurité. En l'absence d'autres solutions, le premier moyen de parvenir à cet objectif, c'est d'éviter la récidive et donc que de vrais dangers publics se retrouvent en liberté. Tel est l'équilibre du présent texte.

Monsieur Marlin, nous avons tous été émus par vos propos. Ce texte répond précisément à votre demande. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu : ce projet n'est pas laxiste, bien au contraire. Dans ma carrière judiciaire, j'ai connu moi aussi des victimes. Du sang, j'en ai vu. Je sais de quoi le criminel est capable. J'ai été juge d'instruction de terrain pendant longtemps. Le législateur que je suis devenu essaie de supprimer les carences que comportait la législation que j'étais chargé d'appliquer.
Je l'affirme, ce que nous avons mis en place en février 2008, ce que nous présentons aujourd'hui répond à toutes vos préoccupations. Nous mesurons tous l'importance du dispositif que nous mettons en oeuvre : il vise, alors que la peine est terminée, à instaurer un système de contrôle à durée indéterminée – éventuellement perpétuel, dans le cadre d'obligations garantissant, bien entendu, le respect d'un certain nombre de droits. La mesure de sûreté va prendre le relais, ce qui répond à votre souci. Nous pouvons aussi, dans le temps de la réduction de peine, mettre en place des dispositifs de surveillance, adaptés à la dangerosité de la personne concernée.
En revanche, si nous votions les mesures que vous proposez sur les réductions de peine, nous ferions s'effondrer le système, nous irions à l'échec. Mme la garde des sceaux l'a très bien dit : pour être crédible, pour faire en sorte que cela marche, il faut aller, lorsque c'est nécessaire, dans le sens de l'aménagement de peine, de l'individualisation, de la réinsertion. Mais lorsque l'individu est très dangereux, nous prévoyons un système permettant de le contrôler de façon éventuellement durable.
Le président de la commission des lois a soulevé une vraie question en évoquant la suppression de la peine de mort. C'était une élimination radicale. Le bannissement était également une mesure d'élimination radicale. La tutelle pénale a été, elle aussi, supprimée en 1981. Il n'est pas question, bien sûr, de revenir sur ces suppressions. Mais cette façon de traiter les individus – inadmissible – constituait une réponse, même si elle n'était pas adaptée. Rien n'est venu remplacer ces dispositions. Or les individus dangereux existent toujours.
Ce texte – de même que celui de 2008 –, sous réserve bien sûr de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, constitue une réponse adaptée, juridique et conforme à nos principes constitutionnels ainsi qu'à la convention européenne des droits de l'homme. Il permet de traiter de façon démocratique et efficace tous ces individus. Monsieur Marlin, monsieur Dupont-Aignan, nous répondons à vos préoccupations. Croyez-moi, je me bats depuis des années en ce sens.
(L'amendement n° 99 n'est pas adopté.)
(L'amendement n° 4 n'est pas adopté.)

Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures quarante-cinq :
Suite de la discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma