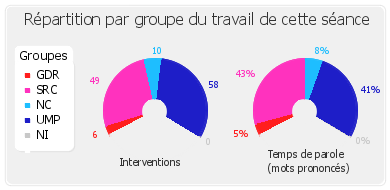Séance en hémicycle du 22 juin 2011 à 21h45
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures quarante-cinq.)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi adopté par le Sénat sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (nos 3452 et 3532).
Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de six heures cinquante minutes pour le groupe UMP ; neuf heures sept minutes pour le groupe SRC ; quatre heures treize minutes pour le groupe GDR ; trois heures cinquante-sept minutes pour le groupe Nouveau Centre. Les députés non inscrits disposent de trente-quatre minutes.
Cet après-midi, l'Assemblée nationale a fini d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.
La parole est à M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, je veux apporter quelques mots de réponse à tous les orateurs. Ils ont été nombreux – plus de trente, me semble-t-il – à pendre la parole, ce qui est un signe de l'intérêt que soulève ce texte, quoi que certains aient pu en dire dans leurs interventions !
La plupart des orateurs ont suivi le plan du texte, se prononçant successivement sur le tribunal correctionnel avec citoyens, sur la correctionnalisation et sur la justice des mineurs. Les critiques ont été à peu près les mêmes ; je veux essayer de répondre aux arguments avancés.
En ce qui concerne tout d'abord des citoyens assesseurs, il s'agit de faire participer des citoyens à un tribunal. Je ne vois pas pourquoi certains ont peur qu'il y ait des citoyens dans une juridiction. C'est là quelque chose de tout à fait naturel, qui existe déjà pour la juridiction criminelle. Vouloir faire en sorte que le tribunal correctionnel puisse accueillir lui aussi des citoyens, qui seront des assesseurs et non des jurés, constitue un progrès pour l'appropriation de la justice par les Français.
À un moment où l'on demande, d'une façon générale, de plus en plus de justice et où l'on attend beaucoup de la justice – peut-être plus d'ailleurs qu'elle ne peut donner –, il me semble sain d'associer les citoyens à son travail pour que chacun puisse se rendre compte de la difficulté qu'il y a à juger. C'est donc un acte civique qui est proposé aux Français. À partir de là, on peut se livrer à des calculs et se demander s'il y aura plus ou moins de citoyens appelés à cette tâche par rapport à la situation actuelle. Chaque année, des citoyens seront amenés à se prononcer dans environ 40 000 dossiers, pour à peu près 2 700 aujourd'hui en cour d'assises. C'est donc forcément un progrès.
Ce dispositif va d'abord être expérimenté : nous commencerons dans deux cours d'appel avant de l'étendre. S'il y a lieu de procéder à des améliorations, nous le ferons. À cet égard, je ne dis pas du tout que l'histoire s'arrête aujourd'hui ; je crois au contraire qu'elle commence. Il peut être intéressant d'associer les citoyens à la justice.
Contrairement à ce que certains – M. Dolez, notamment –ont dit, il n'y aura pas de justice à deux vitesses. Simplement, une formation supplémentaire sera mise en place pour la correctionnelle. Il existe déjà dans notre droit des juridictions spécialisées. Comme on vient de le voir avec un procès qui s'est tenu à Paris, il y a une cour d'assises spéciale pour certains crimes. Des procédures particulières sont prévues pour le terrorisme ou encore la criminalité en bande organisée.
S'agissant de la protection des jurés – puisque M. Urvoas a soulevé la question –, les jurés de cour d'assises sont déjà protégés et il n'y a pas, de ce point de vue, de changement fondamental.
Je veux dire maintenant quelques mots sur la question de la correctionnalisation. On peut considérer que ce phénomène est dû à une définition inadéquate des incriminations, avec pour conséquence le fait qu'on ne parvient pas à faire appliquer la décision du Parlement. D'une certaine façon, cela est parfaitement scandaleux. Il faut donc que l'on y mette un terme.
Pour ce faire, deux méthodes peuvent être envisagées. D'une part, on peut dire que les crimes n'en sont plus. Pour cela, il faut un vote du Parlement. Que les choses soient claires : ce n'est pas ce que je vous propose. D'autre part, on peut continuer à considérer qu'un crime est un crime. Dans ce cas, il faut tout mettre en oeuvre pour le juger comme tel, et non comme un délit. Sinon, nos concitoyens ne pourront pas croire en la justice. C'est la raison pour laquelle nous voulons trouver la bonne solution. Y sommes-nous parvenus ? Peut-être pas ; peut-être avons-nous simplement progressé et nous faudra-t-il encore travailler. Le Gouvernement avait fait une proposition. Le Sénat a choisi une autre voie, tandis que votre rapporteur propose sur ce point une solution sur la constitutionnalité de laquelle le Gouvernement s'interroge – mais nous y reviendrons au court du débat. Comme dirait M. Garraud, il faut du contradictoire dans le débat. (Sourires.)
Or, si je poursuivais, le rapporteur ne pourrait pas me répondre, ce qui priverait M. Garraud d'un moment de débat contradictoire.
Très naturellement, la correctionnalisation pose la question de la victime. En effet, la première des injustices vis-à-vis de la victime réside dans le fait que les mêmes actes ne sont pas jugés de la même façon sur l'ensemble du territoire.
Tout à fait. C'est bien pour cela qu'il faut lutter contre la correctionnalisation.
En ce qui concerne la question de l'appel, nous aurons également un débat. Je n'y insiste pas car l'article 1er va venir assez vite. Il est normal que ce débat ait lieu et que chacun défende sa thèse. Comme, par ailleurs, ce n'est pas vraiment le sujet du texte, il vaudrait mieux traiter la question de la victime dans sa globalité à un autre moment.
Enfin, s'agissant de la justice pour mineurs, honnêtement, j'ai entendu à peu près tout et son contraire et je m'interroge un peu. M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin et M. Dray nous ont dit que nous mettions cette justice par terre, que nous ne respections rien. Au contraire, Mme Batho nous a dit que nous étions beaucoup trop mous, que nous n'étions pas capables de mener une politique de fermeté…
…et qu'il était grand temps de s'y mettre. Elle nous a réclamé de la fermeté, encore de la fermeté, toujours de la fermeté. Si nous n'y arrivons pas, certaines solutions existent à l'en croire, notamment l'utilisation de l'armée.
Là aussi, nous aurons un débat, mais il faut choisir sa thèse et son camp : ou bien on veut garder les principes de la justice pour mineurs, ou bien on souhaite une justice pour les mineurs qui soit encore plus ferme que la justice pour les adultes – voilà ce qui nous a été dit.
Ce débat sera forcément intéressant. Pour le Gouvernement, ce qui a compté, c'est d'abord et avant tout de réaffirmer les principes constitutionnels de la justice pour mineurs, que je rappellerai succinctement.
D'abord, quand on est mineur, on n'a pas la même responsabilité que quand on est majeur. La minorité est une excuse légale en matière de responsabilité. Le Gouvernement n'a pas souhaité changer l'âge de la majorité ; il n'a pas voulu non plus revenir sur l'excuse légale de minorité.
Ensuite, il faut aider le mineur à se construire ou à se reconstruire après l'acte délictueux qu'il a commis et lui permettre d'aborder la vie dans de meilleures conditions. Cela nécessite forcément des mesures éducatives, la peine n'étant pas la solution unique. Il peut y en avoir une, mais il doit aussi y avoir, dans tous les cas, des mesures éducatives. Il faut pour cela des tribunaux spécialement composés et des procédures particulières, sans oublier des établissements spécialisés, car si tous les mineurs se retrouvent dans le système pénitentiaire normal, nous n'y arriverons pas. Nous avons fait beaucoup d'efforts ces dernières années, avec notamment la mise en place des établissements pour mineurs, qui allient l'éducation à la sanction.
Le choix est simple : soit on veut mettre les mineurs en prison, soit on ne le souhaite pas. Le Gouvernement a clairement choisi de mettre les mineurs, non pas dans la prison classique, mais dans ces établissements. Certes, ils n'y sont pas libres, mais on y dispense avant tout une formation. Dans un établissement pour mineurs, il y a en effet soixante mineurs pour cent vingt agents, composés pour moitié d'agents de l'administration pénitentiaire et pour l'autre d'agents de la protection judiciaire de la jeunesse.
C'est en effet énorme. Le Gouvernement consent un effort considérable pour ces mineurs. La raison en est simple : il s'agit de préparer leur avenir. Cela coûte très cher et nulle part ailleurs n'existe un tel effort.
Mais bien sûr que si !
Madame Batho, je vous ferai d'abord remarquer que je vous ai laissée parler. Vous avez dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, je ne l'ai pas fait remarquer pour autant ! Ensuite, comme nous sommes en France, nous allons nous occuper de nous. Le Canada, ce sera pour un autre jour !
Je disais donc que nous avions fait un énorme effort. Nous continuerons à le faire, parce que nous ne souhaitons pas que les mineurs aillent en prison.
Je souhaite qu'ils aillent dans des établissements où, tout en n'étant pas libres, ils bénéficient d'une formation. Tel est notre choix politique et philosophique fondamental.
Vous avez le droit d'en faire un autre. Il n'y a aucun problème à cela ! Ce n'est pas le nôtre, parce que c'est l'avenir des jeunes qui en cause.
Nous aurons l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces questions, mais je veux tout de même dire encore un mot sur le principe de spécialité des tribunaux. Sur ce sujet aussi j'ai entendu beaucoup de choses.
On nous a dit que notre tribunal correctionnel pour mineurs n'était pas un tribunal pour enfants. Chacun peut affirmer ce qu'il veut mais aucun de ceux qui ont soutenu cette thèse n'a fait la comparaison avec la cour d'assises des mineurs. Cette cour, qui existe, qui fonctionne et qui prononce chaque année des condamnations, comment est-elle composée ? Elle est présidée par le président de la cour d'assises, qui est nommé par le premier président de la cour d'appel. Ce président est accompagné de deux assesseurs qui sont, dans la mesure du possible comme dit le code, des juges des enfants – sinon ce sont des magistrats ordinaires – et des jurés de la cour d'assises normale. Le fait que les jurés de la cour d'assises normale soient jurés de la cour d'assises pour mineurs n'a posé aucun problème, personne n'en a parlé, alors que le tribunal correctionnel que nous vous proposons est un tribunal spécialement composé pour les mineurs. Nous sommes donc complètement dans l'esprit de l'ordonnance de 1945.
Voilà les quelques précisions que je voulais apporter avant que nous n'abordions la discussion des amendements. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

J'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi.

Je suis saisie d'un amendement n° 80 portant article additionnel après l'article 1er A.
La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l'amendement.

Préalablement au débat concernant la réforme de la justice pénale visant à élargir la participation des citoyens aux tribunaux correctionnels, il nous semble important de revenir sur une procédure en principe exceptionnelle mais qui tend à devenir la norme, je veux parler des audiences correctionnelles à juge unique. Cette pratique va à l'encontre de ce que chacun, ici, souhaite, j'imagine.
La collégialité est une garantie du bon fonctionnement de la justice pour nos concitoyens. Alors que le projet de loi entend faire participer deux citoyens assesseurs aux côtés de trois magistrats aux audiences portant sur les délits d'atteinte à la personne, on ne peut que s'étonner du maintien du juge unique en matière correctionnelle.
La rupture d'égalité face à la justice devient dans ces conditions abusive puisque les prévenus amenés à comparaître pourront être traduits, selon les cas, soit devant un juge unique, soit devant un tribunal collégial composé de trois magistrats, soit devant un tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne composé de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs, sans compter bien entendu les tribunaux correctionnels pour mineurs.
Il nous semble quelque peu incohérent de multiplier, d'un côté, les possibilités de recours devant un juge unique, au nom d'une prétendue efficacité mais pour réaliser surtout des économies budgétaires, et de créer, d'un autre côté, une procédure complexe, coûteuse et lourde, en prévoyant des citoyens assesseurs pour juger certains délits.

La parole est à M. Sébastien Huygue, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission.

Je rappelle que la formation en juge unique au tribunal correctionnel existe depuis la loi du 29 décembre 1972. Cette procédure a fait, depuis le temps, la preuve de son efficacité puisque plus de 50 % des affaires correctionnelles sont jugées ainsi. Cela permet de faire face à l'explosion du contentieux, de contenir les délais d'audiencement et de jugement dans des limites raisonnables, et cela favorise la spécialisation des magistrats, ce qui constitue une garantie de la qualité de la justice qui est rendue.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 80 .

La parole est à M. le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement.
Comme l'a rappelé le rapporteur, le juge unique est établi dans notre système pénal depuis quarante ans et, pendant toutes ces années, personne n'a voulu le supprimer. Chaque année, quelque 300 000 décisions sont rendues par le juge unique et 100 000 par la formation collégiale. Nous n'avons pas les moyens de faire autrement et je rappelle que le juge unique peut toujours renvoyer l'affaire devant la formation collégiale s'il rencontre des difficultés. Avis défavorable, donc, sur l'amendement n° 80 .

Je trouve que cet amendement traduit une profonde méconnaissance du problème de la justice en France. Au prétexte que la collégialité permettrait d'éviter les erreurs judiciaires, parce qu'on échange sur le fond d'un dossier, on met en place, pour juger des affaires qui sont d'une simplicité extrême, des procédures trop lourdes.
Lorsque, à l'initiative de notre collègue Garraud, nous avons mis en place la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, notre objectif était d'appliquer des procédures simples à des affaires particulièrement simples. L'amendement qui nous est proposé revient sur ce principe.

Résultat, on réintroduirait de la complexité dans des affaires d'une simplicité extrême. Ce serait totalement contreproductif. Alors même qu'elle n'est formulée ni par les justiciables, ni par les parties civiles, cette proposition alourdirait les procédures, prolongerait les délais et serait, à mon avis, totalement inadaptée à la situation actuelle de la justice. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous voterons contre cet amendement.


Avec cet amendement de suppression de l'article 1er, je souhaite revenir brièvement, m'étant longuement exprimé hier dans la discussion générale, sur les raisons principales qui fondent notre opposition au dispositif de participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales.
Je voudrais d'abord dire à M. le ministre que la participation des citoyens à la justice ne nous fait pas peur.
Ça va, alors.

L'objectif pourrait paraître louable. Ce que nous contestons, ce sont les modalités de la participation de ces citoyens assesseurs.
De nombreux collègues qui sont intervenus dans la discussion l'ont relevé, cette réforme repose sur un faux postulat, à savoir un laxisme supposé des juges professionnels et une plus grande sévérité des citoyens assesseurs. On tente ainsi de nous faire croire que la justice sera rendue dans de meilleures conditions.
Pourtant, une première conséquence de ce dispositif sera de créer deux catégories de tribunaux correctionnels : d'un côté, ceux composés de citoyens assesseurs, qui traiteraient des délits portant atteinte quotidiennement à la sécurité et à la tranquillité de la population, et, de l'autre, les tribunaux composés uniquement de magistrats professionnels, qui, eux, traiteraient des affaires de corruption, des infractions économiques, des scandales financiers ou du monde des affaires. Il s'agit selon nous d'un nouvel acte de défiance à l'égard des magistrats.
Ce dispositif, beaucoup l'ont déjà dit, ralentira considérablement le déroulement même de la justice. Le mode de désignation des citoyens assesseurs, combinant tirage au sort et vérification des aptitudes par le biais d'un recueil d'informations, sur lequel d'ailleurs on ne sait pas grand-chose, créera des lourdeurs administratives.
La formation des citoyens assesseurs soulève également bien des questions. Un décret en Conseil d'État devra préciser les modalités de la formation que ces citoyens assesseurs devront recevoir avant d'exercer leur fonction, sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle et la mission des citoyens assesseurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agira d'une charge particulièrement lourde à gérer pour les juridictions compte tenu de l'ampleur de la matière et du nombre de citoyens assesseurs concernés.
L'affectation des citoyens assesseurs dans chacune des audiences constituera, elle aussi, une charge très importante en termes d'organisation pour les juridictions.
Enfin, l'introduction de ces citoyens contribuera hélas ! à détériorer un peu plus les conditions de jugement. Les citoyens assesseurs, qui seront des néophytes en droit, devront comprendre la réalité des faits, des problèmes juridiques posés, devront se faire expliquer les points techniques pour prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Tout cela nécessitera du temps. Les délais de jugement seront encore prolongés et, au final, l'oralité nécessaire des débats ne pourra que ralentir le cours de la justice. Le président de l'Union syndicale des magistrats a même dit que cela risquait de faire exploser notre système judiciaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons présenté cet amendement de suppression.

La parole est à M. Jean-Pierre Dufau, pour soutenir l'amendement n° 143 .

Je voudrais profiter de cet amendement de suppression pour lever certaines équivoques.
Monsieur le ministre, notre propos n'est pas de nous opposer au fait d'associer les citoyens à l'action de la justice, cela se pratique déjà dans les cours d'assises, dans les chambres d'application des peines, dans les tribunaux pour enfants, et nous pensons que ce système d'échevinage, en particulier dans les tribunaux pour enfants, est une bonne chose qu'il faut maintenir. Mais entre ce dispositif qui existe déjà et les propositions que vous faites, il y a un pas qu'on ne peut pas franchir.
La justice actuelle manque déjà de moyens. Je ne vois pas comment elle pourra faire face à tout ce qui va lui être demandé par ce projet de loi, en termes de personnels, de locaux, ou tout simplement parce que ces nouveaux assesseurs ne seront pas compétents immédiatement. Un ralentissement est inévitable.
Même si l'intention de départ est tout à fait louable, les effets boomerang que cette réforme va induire vont complètement la contrarier. Au bout du compte, cela risque d'éloigner les Français de la justice parce que ce qu'ils attendent avant tout – les enquêtes d'opinion le montrent –, c'est une justice rapide, réactive, qui émette des jugements dans des délais raisonnables. Et ceci est encore plus vrai lorsqu'il s'agit des mineurs, vous le savez. Tout ce qui ralentit la justice va donc dans le mauvais sens.
Enfin, monsieur le ministre, vous avez, avec pertinence, évoqué au Sénat la notion de pédagogie. Je ne suis pas convaincu que le seul fait d'associer des citoyens assesseurs à un certain nombre d'actions soit une manière de répondre à ce souci, même si cela peut être intéressant. Il me semble que la pédagogie a un lieu privilégié d'exercice, c'est l'école. On pourrait réfléchir à des programmes scolaires, avec des niveaux d'expérimentation et des sujets adaptés à l'âge des élèves. On pourrait faire tout un travail sur la justice qui concernerait l'ensemble d'une génération, avec des élèves de tous les milieus.
Si la France a un problème avec sa justice, c'est qu'elle semble un monde si extravagant et si étranger que les citoyens ne s'y retrouvent pas. Il faut donc d'abord, dès l'école, puis au collège et au lycée, expliquer ce qu'est la justice, pour développer ensuite l'éducation populaire, à travers les médias, par exemple, en s'appuyant de façon didactique sur des procès ou des enquêtes exemplaires. À ce moment là seulement, les citoyens, familiarisés avec cet univers, seront aptes à être associés à la justice.
La pédagogie est une chose sérieuse ; elle doit se pratiquer en amont pour préparer les esprits. Il ne s'agit pas de former des têtes bien pleines mais des têtes bien faites.

La commission a naturellement rejeté ces amendements qui s'attaquent au principe même du texte que nous examinons, à savoir la création des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels.
Je me bornerai ici à rappeler que notre ambition est de réconcilier les Français avec la justice, en introduisant dans les tribunaux correctionnels des citoyens tirés au sort pour participer à la justice, puisque celle-ci est rendue en leur nom. Ils y apporteront un regard extérieur, un peu de fraîcheur, voire de la candeur.
Lorsque la mesure sera appliquée sur l'ensemble du territoire, ce sont près de neuf mille citoyens assesseurs qui oeuvreront chaque année à rendre la justice. Ils pourront ensuite diffuser autour d'eux l'information sur la manière dont fonctionne notre justice et dont travaillent les magistrats. Ils témoigneront que la victime et la personne mise en cause ont été entendues, que les dossiers sont à charge et à décharge, et que la justice a donc été rendue avec équilibre et sérieux. Leurs témoignages contribueront à une meilleure compréhension et à une meilleure acceptation de la justice.
C'est la raison pour laquelle non seulement cet article mais l'ensemble du texte doit être adopté par notre assemblée.
J'ai bien compris que ni M. Dolez ni M. Dufau n'étaient opposés à la présence d'assesseurs citoyens dans les tribunaux, mais que la façon dont on présente l'affaire ne leur convient pas tout à fait…
Vous avez déclaré être d'accord sur le principe, mais que les modalités ne vous convenaient pas !

Ce n'est pas parce ce que c'est vous qui le proposez que nous sommes contre ce projet !
Je n'ai pas dit ça, monsieur Dolez ! Ce sont vos mauvaises habitudes qui vous font imaginer que j'aie jamais pu penser une chose pareille !
Quoi qu'il en soit, je retiens l'idée de M. Dufau concernant des actions menées dans les écoles. Le ministère de la justice s'est déjà engagé dans cette voie, notamment en ouvrant certaines audiences aux scolaires.
Je suis ouvert à toutes les bonnes idées, et le ministère est très partisan d'expliquer la justice aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens. En revanche, nous sommes naturellement hostiles à la suppression de cet article.

Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de moyens supplémentaires, en évoquant la création de postes de magistrats et de greffiers. Vous avez opté par ailleurs pour une réforme expérimentale dans un premier temps, ce qui me semble être la bonne méthode, compte tenu des innovations qu'elle introduit dans notre justice et qui soulèvent quelques questions.
Je voudrais pour ma part m'arrêter sur les conséquences de la réforme en matière de délais. En effet, il ne s'agit pas ici d'allonger les délais de procédure, et nous devons, dans ce domaine, nous fixer des objectifs. De trop nombreuses victimes souffrent de la lenteur de notre justice, et nous pourrions nous inspirer de ce qui se pratique dans d'autres pays européens pour limiter, sans être trop rigides, la durée des procédures.
Je ne sais si le ministre possède les réponses à ces questions, mais il me semble que nous pourrions nous accorder avec le rapporteur pour faire en sorte que les procédures se tiennent dans des délais raisonnables. La Convention européenne des droits de l'homme parle de procès équitable, notion qui, d'après moi, englobe les délais de procédure, car le jugement d'un délit ou d'un crime avec plusieurs années de retard constitue pour la victime un motif de souffrance supplémentaire.
Sans préjuger le fait de savoir si cela doit être inscrit dans la loi, je me permets donc d'ajouter cette question à celles de nos collègues de l'opposition, bien que je m'oppose aux amendements de suppression qu'ils ont défendus.

Tous ici, comme M. Hunault, nous souhaitons raccourcir les délais, ce que permet d'ores et déjà la jurisprudence, puisque la responsabilité de l'État peut être engagée lorsque les jugements interviennent dans des délais considérés comme non raisonnables, ce qui s'estime en fonction de l'affaire et de la procédure. Cela ne peut être inscrit dans la loi, mais je ne doute pas par ailleurs que M. le ministre oeuvre chaque jour à ce que la justice soit rendue dans des délais raisonnables.
La question de M. Hunault est pertinente, puisque l'un des principaux griefs faits à la justice concerne la longueur des procédures. Il y a plusieurs façons d'aborder ce problème, le premier d'entre eux, que je réprouve, étant la prescription. Lors de l'élaboration de ce texte de loi, j'ai donc indiqué au Premier ministre que cette réforme exigeait des moyens supplémentaires : 263 postes de magistrats et de greffiers ont ainsi été créés pour éviter l'allongement des procédures.
(Les amendements identiques nos 25 et 143 ne sont pas adoptés.)

Je suis saisie d'un amendement n° 144 .
La parole est à M. Dominique Raimbourg.

Eu égard à notre opposition à la mise en place de ce système, nous proposons, dans cet amendement de repli, de le limiter à la chambre des appels correctionnels, ce qui représente environ cinquante mille dossiers par an. Cela permettrait une expérimentation au-delà de celle prévue dans deux cours d'appel.

La commission a rejeté cet amendement. Après la suppression de l'article 1er, on nous propose une suppression par appartements du dispositif.

Cet amendement vise à empêcher les citoyens assesseurs de participer à la phase du jugement, mais on peut légitimement se demander pourquoi ils seraient plus compétents pour statuer sur l'application de la peine plutôt que sur le prononcé de cette peine.
Ce texte repose sur un principe cohérent : permettre aux citoyens de participer tout à la fois à l'élaboration du jugement et à la détermination des conditions de son application. Je vous invite donc à repousser cet amendement.
Avis défavorable.
(L'amendement n° 144 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 145 .
La parole est à M. Dominique Raimbourg.

Je ferai trois observations. En matière d'application des peines premièrement, il existe déjà des assesseurs spécialisés devant la chambre d'application des peines, l'un représentant les associations de victimes, l'autre les associations de réinsertion des détenus ; ces assesseurs donnent toute satisfaction.
Ma seconde observation est une remarque de vocabulaire. Il faut bien distinguer entre, d'une part, les peines en attente d'exécution – on évoque le nombre de 80 000 – et, d'autre part, les peines non exécutées. Or une peine non exécutée, c'est une peine touchée par le délai de prescription, ce qui constitue un problème beaucoup plus sérieux.
Il est certes regrettable, en termes de gestion, que certaines peines soient en attente d'exécution – et je partage sur ce point les observations faites par Michel Hunault ou par Étienne Blanc dans son rapport sur la non-exécution des peines –, mais il est bien plus dommageable que certaines peines ne soient jamais exécutées.
Enfin, la circonstance que quelqu'un sorte de détention avant la fin du délai indiqué par le juge n'est pas un problème d'exécution ou de non-exécution de la peine ; c'est un problème d'aménagement et de gestion de la peine. Je ne donne pas ces précisions de vocabulaire par cuistrerie, mais parce qu'elles sont importantes pour ma troisième observation.
Je propose avec cet amendement de ne pas autoriser la présence de jurés citoyens à l'intérieur des juridictions d'application des peines. En effet, si la peine est prononcée au nom du peuple français et s'il est, dès lors, logique d'y associer des citoyens – même si nous sommes en désaccord sur la manière dont cela se fera –, les modalités d'exécution de la peine ressortissent en revanche de problèmes de gestion. Or, avec votre système, la seule modalité d'exécution deviendra à terme la détention. C'est une dérive perverse, dont nous paieront cher les conséquences, si le système aboutit à ce qu'il n'y ait plus jamais d'aménagement de peine mais uniquement de l'enfermement et des sorties sèches.
J'attire l'attention de notre assemblée sur ces précisions de vocabulaire, et par cet amendement nous proposons de ne pas faire entrer les jurés au sein des juridictions d'application des peines.

Après nous avoir proposé de supprimer l'appartement du premier étage, qui est la modalité de jugement, vous nous proposez de supprimer le second étage, celui de l'application de la peine.
Cette proposition est incohérente car elle revient à demander à nos concitoyens de participer à la détermination de la peine infligée à la personne reconnue coupable tout en fermant les yeux sur les modalités d'application de cette peine alors même que les juridictions d'application des peines sont susceptibles d'en modifier substantiellement l'exécution. Le citoyen qui aurait reçu la possibilité de se prononcer sur le quantum de la peine doit pouvoir poursuivre son oeuvre et déterminer la manière dont la peine sera appliquée.
Vous partez du postulat, monsieur Raimbourg, que nos concitoyens sont forcément plus sévères que nos magistrats. Or l'expérience montre qu'il n'en est rien, au contraire. Les jurés d'assises sont ainsi, le plus souvent, moins sévères que les magistrats professionnels. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 1941 on a introduit dans les cours d'assises des magistrats professionnels, car on estimait que les citoyens n'étaient pas suffisamment sévères. Il n'y a pas de raison pour que nos concitoyens, appelés à se prononcer sur l'application des peines, soient plus sévères que pour déterminer le quantum de la peine.
Faisons confiance à l'association du citoyen avec le magistrat professionnel pour aboutir à la juste mesure.
Avis défavorable.
Même avis.

Je suis désolé de contredire M. Raimbourg, qui a tenu des propos plutôt aimables, mais nous sommes là au coeur du clivage entre les partisans de ce texte et ses opposants. Je comprends pourquoi vous défendez cet amendement, monsieur Raimbourg, même si j'y suis farouchement opposé.
L'un des objectifs de ce texte est de réconcilier nos concitoyens avec la justice.

Or nous nous sommes opposés durant toute cette législature sur les questions de remise de peine, et ces désaccords ont dépassé les clivages politiques. Je rappellerai à mes collègues UMP qu'il leur est arrivé de combattre des mesures de sévérité que j'ai eu l'honneur de défendre au nom de mon groupe, même si je me réjouis que le rapport de M. Ciotti ait pu démontrer en toute objectivité le problème de la réalité de la peine et de l'exécution de la peine. Nos concitoyens ne comprennent pas, et le mot est faible. Là réside tout l'intérêt de leur participation aux juridictions d'application des peines. En effet, la victime d'un crime ou d'un délit sexuel, qui a souffert des lenteurs procédurales – deux, voire trois ans –, qui voit l'auteur de l'infraction condamné à sept ou huit ans de prison, avec la possibilité de se voir proposer à mi-peine soit une remise de peine, soit une exécution en dehors de la prison, ne comprend pas. Or sur qui pèse la responsabilité de cette situation aux yeux de nos concitoyens ? Sur le magistrat, qui ne fait qu'appliquer la loi que nous votons. C'est en cela que votre amendement va à l'encontre de l'esprit du texte. Grâce à la présence d'un jury citoyen au sein des juridictions d'application des peines, la complexité des modalités d'exécution sera mieux comprise. Nos concitoyens réaliseront que les magistrats ne font qu'appliquer la loi et que si celle-ci est mal faite, c'est aux députés de la modifier. Nous sommes un certain nombre à vouloir remettre en cause des remises de peine devenues automatiques pour mieux prendre en compte la dangerosité de l'individu. Ces mesures ne seraient pas sans conséquence puisqu'il faudrait prévoir plus de places dans les prisons et par conséquent voter les budgets et les crédits nécessaires à la construction de nouvelles places. Une réflexion globale sur ces problèmes serait nécessaire.
Pour le moment, je m'oppose à votre amendement, monsieur Raimbourg, car la présence d'un jury citoyen dans une juridiction d'application des peines sera l'occasion de réconcilier les citoyens avec la justice et surtout de protéger les magistrats, sur qui l'on fait souvent peser une responsabilité qui n'est pas la leur.

M. Raimbourg fait une erreur de raisonnement car il ne prend pas en compte l'évolution qui s'est produite en matière d'application des peines et qui s'est traduite par une juridictionnalisation de cette procédure. On peut en effet se demander à quel moment de l'application des peines l'on peut remettre en cause une décision prononcée par une juridiction souveraine. C'est une question de principe que je comprendrais, à la limite, que l'on se pose.
En revanche, il me semble anormal que, dans le secret des cabinets d'application des peines, les magistrats, entre eux, remettent en cause des décisions qui ont été notamment prises par des jurys souverains.
Exactement.

Dès lors que le peuple est intervenu aux assises pour juger un individu, il est naturel, vu l'ampleur de la juridictionnalisation de l'application des peines, que le peuple intervienne également à ce niveau puisque nous savons que tout, ou presque, peut être remis en cause.
À partir du moment où vous ne remettez pas en cause le principe de l'aménagement des peines, il faut respecter une certaine concordance entre ce qui est décidé par des juridictions souveraines, la cour d'assises, et ce qui ensuite peut être remis en cause dans l'application de la peine suite au parcours individualisé en détention d'un individu. Un système exclut l'autre. Dès lors qu'un juré citoyen intervient en cour d'assises, le peuple doit également intervenir au niveau de l'application des peines. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Je reprendrai les arguments brillamment défendus par MM. Hunault et Garraud.

La démonstration de M. Raimbourg, en effet, manque de cohérence. Le Gouvernement a eu raison de faire entrer des jurés assesseurs au sein des juridictions d'application des peines pour assurer une certaine cohérence au dispositif. 95 % des décisions examinées par ces juridictions sont en effet prononcées par des cours d'assises, avec intervention d'un jury populaire. Si l'on associe le peuple aux décisions de justice, il est logique de l'associer aux décisions relatives à l'application et à l'aménagement de la peine.
Pour ce qui est de la question, plus générale, de l'aménagement des peines, vous avez raison de dire, monsieur Raimbourg, que l'aménagement de la peine est une modalité de l'exécution des peines. Ce n'est pas parce qu'une peine est aménagée qu'elle n'est pas exécutée. Mais ne nous voilons pas la face : nous sommes confrontés à une difficulté majeure, souvent source d'incompréhension entre nos concitoyens et la justice, et qui se traduit par de la défiance de la part de nos concitoyens à l'encontre de la justice.
Ce n'est pas le principe de l'aménagement que je conteste – même si l'on a caricaturé mon rapport sur cette question –, mais son caractère parfois systématique, notamment pour les peines de prison ferme inférieures à deux ans, pour lesquelles la loi pénitentiaire a introduit une forme d'aménagement quasi systématique. Les modalités d'exécution avec les crédits de réduction de peine revêtent eux aussi un caractère quasi systématique même si cela est contesté : 98 % des personnes qui entrent en détention bénéficient d'un crédit de réduction de peine.
Sans remettre en cause le principe de l'aménagement, il est utile que le peuple y soit associé et je crois que nous sommes une majorité sur ces bancs hostiles au caractère systématique de ces aménagements. Nous devrons revenir sur ces textes qui nous ont conduits sur ce chemin, et que je n'ai personnellement pas votés.

Nous avons bien du mal à saisir la pensée de la majorité sur ce sujet. On nous renvoie au remarquable rapport de M. Ciotti pour comprendre vos motivations mais nous n'avons pas eu la joie de l'avoir à notre disposition puisque ce n'est pas un rapport parlementaire.

Il n'y a pas si longtemps, dans ce même hémicycle, cette même majorité a fait voter une loi pénitentiaire et nous a proposé des aménagements de peine en nous expliquant de manière très convaincante qu'il fallait trouver une solution à la surpopulation carcérale et que les aménagements de peines ainsi que le refus des sorties sèches allaient dans le sens de la sécurité des Français.
Et voici que, quelques mois après, vous revenez nous dire que l'automaticité des aménagements de peine est inadmissible et incompréhensible !

On se doutait qu'en la matière la colonne vertébrale de la pensée de la majorité n'était pas très stricte, mais tout de même, reconnaissez que nous pouvons avoir du mal à vous suivre.
(L'amendement n° 145 n'est pas adopté.)

La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas pour défendre l'amendement n° 147 .

Cet amendement vise à supprimer le mode de désignation des citoyens assesseurs qui est peu compréhensible même s'il a évolué dans le bon sens au cours des débats au Sénat puis au sein de notre commission des lois. Le dispositif le plus simple a en tout cas été écarté, à savoir un mode de désignation calqué sur celui des jurés d'assises par un simple tirage au sort sur les listes électorales. L'on comprend d'autant moins ce choix qu'il s'agissait là de la seule véritable option si l'on avait vraiment souhaité ouvrir la sélection des juges citoyens le plus simplement possible et en assurant une représentation complète de la société. Mais il aurait alors été indispensable, pour assurer l'impartialité des jurés, de prévoir une possibilité de récusation identique à celle qui existe aux assises.
J'ai lu l'étude d'impact que le Gouvernement nous a fournie. Cette option a été écarté parce qu'elle aurait impliqué de convoquer, pour chaque affaire, un nombre suffisamment important de personnes tirées au sort.
Ne seront convaincus par ces arguments que ceux qui veulent bien user de toute la bonne foi nécessaire pour comprendre la philosophie qui anime le Gouvernement ; les autres resteront sceptiques.
Vous écartez la simplicité au profit d'une solution parfaitement ambiguë : les citoyens assesseurs n'étant ni des jurés ni des magistrats, vous organisez un système complexe avec tirage au sort, sélection par une commission et intervention du maire. C'est tout sauf simple.
Nous souhaitons la suppression de ces dispositions.
Afin de nourrir notre recours devant le Conseil constitutionnel, j'insiste sur le fait que l'exposé des motifs du projet de loi rappelle opportunément – mais sans en tirer les conséquences pourtant nécessaires – que le Conseil a déjà eu l'occasion de préciser que si des non-professionnels peuvent siéger dans des juridictions répressives, c'est à la condition que des garanties appropriées soient apportées « permettant de satisfaire au principe d'indépendance ainsi qu'aux exigences de capacité qui découlent […] de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». Et si le Conseil a pu juger que « les dispositions organiques fixant le statut des juges de proximité apportaient les garanties d'indépendance et de capacité requises par la Constitution », celles que le projet de loi tente maladroitement de mettre en place pour les citoyens assesseurs apparaissent, par comparaison, tout à fait insuffisantes.
J'insiste, pour souligner le caractère un peu baroque du mode de désignation proposé, sur un élément lié au fait que vous ne définissez pas vraiment le statut de ces citoyens assesseurs : le serment.
Curieusement, il n'a rien à voir avec celui des magistrats professionnels tel qu'il est prévu dans l'article 6 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ni avec celui qui figure à l'article 304 du code de procédure pénal, qui rappelle pourtant avec force la nécessité, pour des personnes qui ne sont pas rompues au fonctionnement de l'institution judiciaire, de prendre en compte les intérêts des parties et de la société. Sans doute, là encore, le souci de rapidité a-t-il prévalu, tendant à faire des citoyens assesseurs des « sous-jurés » d'assises.
Pour l'ensemble de ces raisons, la solution la plus simple consiste à supprimer le mode de désignation prévu pour les citoyens assesseurs.

Défavorable. Il est nécessaire de différencier le mode de désignation des citoyens assesseurs de celui des jurés car ces derniers sont au nombre de neuf en première instance et de douze en appel, alors que les citoyens assesseurs sont deux. Une éventuelle inaptitude de l'un d'entre eux ne pourrait donc pas être corrigée par l'effet du nombre. Il est en conséquence indispensable de vérifier qu'elle n'existe pas avant leur nomination.
En commission des lois, nous avons adopté trois critères que l'on retrouve dans un certain nombre de fonctions : la probité, l'honorabilité et l'impartialité – j'imagine que vous comprendrez aisément pourquoi.
La Constitution nous impose de fixer les modalités de désignation de citoyens assesseurs. Elles doivent être entourées des garanties appropriées permettant de satisfaire aux exigences de capacité découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
Il est donc constitutionnellement indispensable que le tirage au sort soit, en quelque sorte, compensé par une désignation effectuée par la commission départementale qui intervient aujourd'hui pour fixer annuellement la liste des jurés d'assises. Elle sera désormais chargée d'écarter les personnes qui ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur parce qu'elles ne remplissent pas les qualités qu'a rappelées le rapporteur.
Le Gouvernement partage la position de la commission des lois : il est défavorable à l'amendement.

M. Urvoas a parfaitement « démonté », si je puis dire, l'usine à gaz que constitue le mode de désignation des citoyens assesseurs, malgré tous les correctifs que vous essayez de mettre en place.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Je constate que la devise des Shadocks a encore de beaux jours devant elle dans notre pays.
Je m'arrête sur un point : le tirage au sort des citoyens assesseurs ne suffit pas, nous dit le rapporteur, il faut encore les sélectionner. La commission établissant la liste annuelle du jury d'assises exclura les personnes « ne paraissant manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ». La litote est belle mais on ne peut guère être plus subjectif.
Quant aux critères énoncés, je m'interroge. Un citoyen tiré au sort devra passer devant une commission chargée de déterminer s'il est partial ou impartial : j'avoue que je ne comprends pas bien. Peut-être pourriez-vous me fournir le mode d'emploi ? Monsieur le rapporteur, voulez-vous dire que d'anciennes victimes manqueraient d'impartialité pour devenir citoyens assesseurs ? Comme vous ne cessez de répéter qu'il faut toujours penser aux victimes, votre raisonnement devient difficile à suivre.
Même lorsque vous tentez de clarifier les choses, elles restent obscures. L'article 10-10 du code de procédure pénale devait prévoir que chaque citoyen assesseur ne pouvait être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de huit jours d'audience dans l'année. La commission a porté cette durée à dix jours. Cependant à l'alinéa suivant, tout se complique : « Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la limite prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré. » Est-ce dix jours ? Est-ce jusqu'à l'issue du délibéré ? Les deux durées sont-elles compatibles ? Quelle est la règle, quelle est l'exception ? Nous aimerions comprendre.

Je suis saisie d'un amendement n° 148 .
La parole est à Mme George Pau-Langevin.

Les citoyens assesseurs, qui seront à la fois tirés au sort et sélectionnés, rempliront un recueil d'informations. Que contiendra ce document ? Quelles informations sont susceptibles d'être demandées pour la sélection des citoyens assesseurs ?
Notre amendement vise à préciser que ces informations doivent être « objectives ». En effet, nous ne souhaitons pas qu'elles puissent permettre d'éliminer ceux dont on estimerait qu'ils ne sont pas conformes à l'idéologie dominante ou dont l'opinion exprimée par le passé ne serait pas majoritaire.
Le flou de la rédaction que vous avez retenue permet d'effectuer des choix subjectifs. Pour que nous soyons certains de l'objectivité des critères utilisés pour désigner les citoyens assesseurs, il faut que les informations qui leur seront demandées ne concernent ni leur personnalité ni leurs opinions.

Le recueil d'informations prévu par le projet de loi comportera deux parties afin de garantir le respect de la vie privée.
Une première partie obligatoire posera des questions objectives afin de s'assurer que la personne tirée au sort n'est concernée par aucune des incompatibilités avec la fonction de citoyen assesseur. Ces questions sont, par exemple, relatives à la profession, à l'exercice de mandats électifs ou à un éventuel placement sous tutelle.
Une seconde partie facultative permettra de faciliter l'exercice des fonctions de citoyen assesseur. On pourra ainsi demander durant quelles périodes de l'année, du mois ou de la semaine la participation à des audiences pénales poserait le moins de problèmes.
Le détail des questions posées dans le recueil d'informations sera fixé par un décret en Conseil d'État. Ce dernier vérifiera évidemment qu'elles sont conformes à la loi.
La commission est défavorable à l'amendement.
Je comprends que Mme Pau-Langevin s'interroge : je lui donne l'assurance que le recueil concernera des informations objectives.
Comme l'a indiqué le rapporteur, la partie obligatoire comprendra les informations nécessaires pour vérifier que la personne tirée au sort n'est pas dans une situation d'incompatibilité pour devenir citoyen assesseur, en raison de sa profession, de l'exercice d'un mandat électif ou encore d'un placement sous tutelle.
La partie facultative permettra de vérifier que les exigences conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition d'une juridiction impartiale sont satisfaites.
Il s'agit de conditions objectives : il sera demandé à la personne si elle est membre d'une association d'aide aux détenus, d'une association d'aide aux victimes ou si elle a été récemment partie civile dans une procédure pénale. Si c'est le cas, les exigences conventionnelles et constitutionnelles que j'évoquais justifieront qu'elle ne soit pas désignée comme citoyen assesseur.
Ces informations étant totalement objectives, je vous demande en conséquence de bien vouloir retirer votre amendement. Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de demander son rejet.

Les réponses du rapporteur et du ministre nous montrent combien nos préoccupations sont légitimes.
Le rapporteur évoque la question de la profession du citoyen assesseur : je crois qu'il continue à raisonner comme s'il s'agissait de récuser un juré en cour d'assises. Si une procédure en cour d'assises concerne un expert-comptable victime d'un vol avec violence, il est clair que les jurés experts-comptables ne seront pas retenus. Au cours des audiences correctionnelles, la situation est différente : les citoyens assesseurs auront à connaître d'une dizaine d'affaires. Il faudrait alors que, selon les affaires appelées – un expert-comptable, une mamie agressée… –, le président décide d'éliminer tel ou tel.
Si nous ne nous contentons pas de quelques informations objectives, nous construisons à nouveau une usine à gaz. Il sera impossible à partir des questions posées de s'assurer que le citoyen assesseur sera impartial lors de l'examen de dix ou quinze affaires différentes traitées le même jour.
Par principe, vous vous opposez à notre amendement, mais nous posons un problème sérieux que les présidents de tribunaux rencontreront dès qu'ils devront choisir leurs assesseurs.

Je souhaiterais soulever une question pratique. Si je suis tiré au sort pour être citoyen assesseur et que je suis exclu, j'aurai le droit de contester cette décision ? En effet, à aucun moment le projet de loi ne prévoit les motivations du refus. La formulation employée dans le texte est tellement générale que les contentieux seront permanents, puisqu'une personne pourra estimer, dès lors qu'elle aura été exclue, que l'on porte ainsi atteinte à son honneur, à sa probité et à son impartialité. Soit le refus est motivé, et il existe une base juridique qui permet d'affronter un contentieux. Soit il ne l'est pas, et il sera assimilé à un délit de faciès. Ce dispositif ne peut donc pas fonctionner, et il donnera lieu à de nombreux contentieux. Ou alors on prendra tout le monde pour ne pas avoir de problèmes.

Je serai bref, car mon argumentation est dans la même veine que les interventions de mes collègues. L'impartialité d'un citoyen assesseur n'est pas déterminée in abstracto, mais au regard des particularités de l'affaire dans laquelle il est appelé à intervenir. Or vous nous avez expliqué que les critères seront généraux, c'est-à-dire déconnectés des réalités. Dès lors, au mieux, les garanties que vous nous donnez quant à l'impartialité des citoyens assesseurs sont factices et illusoires ; au pire, votre système est impraticable.

Puisque M. le rapporteur est obligé de nous donner une réponse, j'en profite pour revenir un instant sur la question qu'a posée notre collègue Dufau sur la compatibilité entre l'alinéa 41 et l'alinéa 45 de l'article 1er. En effet, en cas de prolongation des débats, comment pourra-t-on respecter l'interdiction pour les citoyens assesseurs de siéger plus de dix jours ?

Monsieur Raimbourg, relisez le texte : une dérogation permet d'aller jusqu'au terme du délibéré de l'affaire en cours, y compris, si besoin est, en excédant la durée de dix jours.

Toutefois, je précise que les délits qui seront jugés par un tribunal correctionnel en formation citoyenne seront des délits relativement simples. Ainsi la commission des lois a exclu les atteintes au code de l'environnement, qui donnent lieu à des affaires complexes. Je vous rappelle que, dans l'affaire de l'Erika, par exemple, les débats ont duré six mois.
Par ailleurs, la commission départementale choisit les citoyens assesseurs en fonction des éléments objectifs qui figureront dans le recueil d'informations. Je vous rappelle que les jurés d'assises peuvent être récusés sans aucune explication.

Pour le choix des citoyens assesseurs, le Gouvernement a fixé des critères objectifs, précisés par la commission, qui permettent de garantir l'objectivité de ce choix. Les garanties existent,…

…et sont, je le répète, beaucoup plus strictes que pour les jurés d'assises, puisque ces derniers peuvent être récusés sans aucune explication. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
(L'amendement n° 148 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 149 .
La parole est à Mme Delphine Batho.

Je souhaite souligner un paradoxe. En effet, nous assistons ces jours-ci à une gigantesque campagne d'intoxication et de contre-publicité sur les primaires du parti socialiste de la part de l'UMP, qui dénonce un risque de fichage, d'ailleurs démenti par la CNIL.
Plusieurs députés du groupe UMP. Pas du tout !

Si les risques de fichage inquiètent M. Copé, il serait bon qu'il rejoigne l'hémicycle, car je vais évoquer un problème de fichage bien réel celui-là.
En effet, parmi les critères sur lesquels seront sélectionnés les citoyens assesseurs, on découvre, en lisant l'alinéa 28 de l'article 1er, que seront exclues « les personnes qui, au vu des éléments résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6 » – c'est-à-dire Cassiopée, le STIC et Judex – « ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur. » Ce sont donc les éléments contenus dans ces fichiers qui permettront d'apprécier l'honorabilité, l'impartialité et la probité des citoyens assesseurs. Or cela pose trois problèmes sérieux.
Premièrement, on crée une distorsion entre les conditions dans lesquelles on sélectionne les jurés d'assises et la manière dont seront choisis les citoyens assesseurs. Je rappelle en effet que, pour les premiers, on se fonde uniquement sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Deuxièmement, on va, de fait, donner accès aux fichiers de la police et de la justice, notamment le fichier des antécédents judiciaires, aux membres de la commission de sélection, qui est composée d'avocats et de conseillers généraux, lesquels ne sont pas habilités à consulter ces fichiers. Au détour de l'alinéa 28, on s'assoit donc sur la loi Informatique et libertés et sur les conditions restrictives pour l'accès aux fichiers de police et de justice.
Troisièmement, on va soumettre les citoyens assesseurs aux mêmes difficultés que celles que connaissent les citoyens qui sont soumis à des enquêtes administratives en vue de l'accès à un certain nombre de professions. En effet, non seulement le STIC et Judex recensent 6 millions de personnes mises en cause et 28 millions de victimes – et, à cet égard, la question posée par Jean-Pierre Dufau est très pertinente, car un citoyen assesseur peut figurer dans un de ces fichiers au motif qu'il a porté plainte, ce qui peut faire naître un doute sur son impartialité – mais, selon la CNIL, 83 % des informations enregistrées dans le fichier STIC sont erronées.
Nous demandons donc la suppression pure et simple des alinéas 28 et 29. J'aimerais connaître la position du rapporteur à ce sujet car je le sais attaché à la défense de la loi Informatique et libertés.

L'accès aux données contenues dans les fichiers visés dans le texte sera réservé aux seuls membres de la commission dûment habilités à les consulter, aux termes de l'article 230-10 du code de procédure pénale, c'est-à-dire, depuis la loi LOPPSI 2, les magistrats du parquet. Or ces derniers sont représentés au sein de la commission. Ce sont donc eux qui indiqueront à la commission si la personne tirée au sort peut siéger aux cotés des juges en qualité de citoyen assesseur. Toutes les règles prescrites par la loi Informatique et libertés et le code de procédure pénale seront donc respectées.
J'ajoute que, si le texte autorise la consultation de ces fichiers, c'est parce que le retard de l'inscription des condamnations au casier judiciaire est de l'ordre de quatre à cinq mois et que le choix des citoyens assesseurs nécessite de disposer d'informations immédiates et à jour.
Le Gouvernement confirme les propos du rapporteur et partage naturellement son avis.

Monsieur le rapporteur, je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de disposer d'une information immédiate sur les antécédents judiciaires des citoyens assesseurs et pas sur ceux des jurés d'assises. Votre raisonnement ne tient pas.
Par ailleurs, l'argument selon lequel seuls les membres du parquet sont habilités à consulter les fichiers de police est fallacieux. En effet, nous savons très bien comment cela se passera. Au sein de la commission, on dira : « On a consulté les fichiers et, celui-là, on pense qu'il ne faut pas le prendre. » De fait, on va se fonder sur le contenu de ces fichiers pour sélectionner les citoyens assesseurs.
Enfin, je le répète, le fichier STIC contient 83 % d'informations erronées. Il peut ainsi indiquer qu'une personne a porté plainte, alors que cette personne a retiré sa plainte ou que la police a démontré que les faits n'étaient pas avérés.
À ce stade, vous n'avez donc absolument pas répondu au problème que nous soulevons.

Une nouvelle fois, je ne comprends pas l'angle d'attaque de l'opposition. Le rapporteur vient d'apporter toutes les garanties concernant la consultation des fichiers.
Je dois reconnaître, chers collègues, une certaine constance dans vos critiques. Madame Batho, tout au long de la législature, vous avez été très vigilante sur les questions liées à la consultation des fichiers de police, et vous avez certainement eu raison. Mais enfin, de quoi parlons-nous ? Le projet de loi prévoit que des citoyens siégeront aux côtés des magistrats pour juger certains délits. Vous nous avez dit que cette disposition était dangereuse. Nous prévoyons donc que, grâce à la consultation des fichiers, on puisse s'assurer que leur casier judiciaire est vierge de toute condamnation. Cela me semble être la moindre des choses s'agissant de personnes qui vont assister des juges ! Quant à la consultation des fichiers, le rapporteur, je le répète, vient de vous apporter toutes les garanties nécessaires.
Par ailleurs, permettez-moi de rappeler que, dans le passé, un certain nombre d'entre vous se sont opposés à un amendement qui exigeait que, pour être élu de la nation, on présente un casier judiciaire vierge de toute condamnation. L'auteur de cet amendement s'est fait renvoyer dans les cordes au motif que ce serait aux électeurs de juger. Là, il s'agit de rendre la justice, et il est normal que les personnes qui seront appelées à assumer cette tâche aient un casier judiciaire vierge de toute condamnation…
Plusieurs députés du groupe UMP. Exactement !

…et que l'on puisse s'en assurer en consultant les informations que la police possède.
Enfin, monsieur Raimbourg, on s'est aperçu, lors de la session de la cour d'assises de Loire-Atlantique de septembre 2010, qu'un témoin de moralité cité par la défense avait tué deux policiers et fait vingt ans de réclusion criminelle. Ce type de situation éloigne davantage encore les citoyens de la justice. Je demande donc au rapporteur et au Gouvernement de tenir bon, car votre amendement n'est pas justifié. Il faut que les jurés qui siégeront demain aux côtés des magistrats présentent toutes les garanties d'honorabilité.

Ma question est très simple : la suppression des alinéas 28 et 29, qui est l'objet de nos amendements, ferait-elle s'effondrer l'ensemble du projet de loi ? Non.
En revanche, cela supprimerait un grand nombre de difficultés que viennent d'évoquer nos collègues du groupe SRC. Comme l'a dit Delphine Batho, les personnes figurant dans les fichiers du fait qu'elles ont été victimes, ou qu'elles ont porté plainte pour une raison ou pour une autre, représentent un volume considérable. De ce fait, près de la moitié du gisement potentiel de citoyens assesseurs est récusable. Or, pour au moins l'un des fichiers concernés, on peut considérer que 80 % des informations y figurant sont erronées.
On se souvient que, récemment, la consultation de fichiers a conduit certaines personnalités de la majorité, et non des moindres, à mettre en cause un candidat socialiste aux élections régionales en Île-de-France, le traitant de « délinquant multirécidiviste ». Or les faits qui lui étaient reprochés concernaient en réalité un homonyme. Bien évidemment, on n'a jamais su qui avait consulté illégalement ces fichiers, les enquêtes diligentées par le ministère de l'intérieur et le directeur général de la police nationale n'ayant rien donné : dans ce type d'affaire, le taux d'élucidation est nul. Comme on le voit, la consultation de fichiers peut conduire à l'erreur.
La moitié du gisement potentiel de citoyens assesseurs est donc récusable, tandis que l'autre moitié peut voir sa probité mise en cause pour des raisons encore non précisées. Sera-t-on récusé parce qu'on aura osé participer aux primaires socialistes ?

Ce n'est pas moi qui dérape ! Ce matin encore, lors de la délibération de la commission des lois dans le cadre de la mission d'information sur le droit de la nationalité, certains ont mis en cause la probité et le patriotisme de nos concitoyens disposant d'une double nationalité. Faut-il en déduire que les binationaux ne seront pas dignes d'êtres citoyens assesseurs ?

Enfin, quels sont les éléments qui, selon vous, devraient permettre de récuser telle ou telle personne ayant vocation à devenir citoyen assesseur ? Toutes ces questions méritent des réponses précises…

…ou, à défaut, il convient de supprimer les alinéas 28 et 29. Outre que l'article 1er peut fort bien se passer de ces deux alinéas, leur suppression vous permettra d'être beaucoup moins exposés au risque de contentieux qu'a évoqué Julien Dray tout à l'heure.

Mes chers collègues, il ne sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple.

Plutôt que d'essayer de mettre au point une usine à gaz, pourquoi ne pas se référer au système de tirage au sort mis en oeuvre pour les jurés d'assises, un système qui n'a jamais posé aucun problème, ni à la justice, ni aux Français ? La proposition la plus simple est que les citoyens assesseurs que vous souhaitez instaurer soient désignés comme le sont les jurés de cour d'assises ; mais peut-être est-ce un peu trop simple à votre goût.
En choisissant une autre solution, vous risquez d'ouvrir la boîte de Pandore. Delphine Batho a remarquablement expliqué les risques liés à l'utilisation de fichiers. Pour ma part, j'aimerais poser une question au rapporteur et au ministre : la personne récusée sur la base de son inscription dans tel ou tel fichier va-t-elle recevoir, oralement ou par écrit, un avis motivé de sa récusation ? Bref, y aura-t-il obligation de motiver la récusation, ou celle-ci pourra-t-elle intervenir sans explication, comme c'est le cas pour les jurés d'assises ?
Une personne récusée et se sentant atteinte dans sa probité et son honneur pourra ressentir le besoin d'obtenir des explications et sera donc susceptible d'introduire un recours. En tout état de cause, vous allez au-devant des ennuis : soit le fait de récuser est motivé, ce qui ne sera pas simple, soit il ne l'est pas, et ce sera source de contentieux. Je vous le répète, le plus simple est de s'en tenir à ce qui se fait actuellement pour la désignation des jurés.

Peut-être ne suis-je pas suffisamment concentré, toujours est-il que les explications du rapporteur m'ont paru très compliquées, à tel point que je n'y ai rien compris !

Pour clarifier les choses, il me semble qu'il n'est pas inutile de faire appel au bon sens. Figurent actuellement dans le fichier STIC de très nombreuses personnes qui ignorent s'y trouver. Il suffit, pour que votre nom se trouve inscrit dans ce fichier, que vous ayez été placé en garde à vue durant cinq heures, ce qui n'est pas rare en matière de contrôle des permis de conduire. Or, qu'elle soit justifiée ou non, la garde à vue dont quelqu'un a fait l'objet est systématiquement inscrite dans le fichier STIC, et ne peut en être retirée que sur demande de la personne concernée, avec le concours d'un avocat. Il y a actuellement des milliers de Français qui, ignorant les modalités de cette procédure, restent inscrits dans le fichier alors qu'ils n'ont pas à s'y trouver.
Ces personnes risquent d'apprendre, à l'occasion de leur récusation, qu'elles figurent dans le fichier STIC, ce qui peut être tout à fait injustifié si la garde à vue n'a donné lieu à aucune procédure par la suite. Mais quand on vous dit que les fichiers contiennent des informations erronées, vous ne répondez pas ! Le seul critère objectif, c'est le casier judiciaire : soit il contient des condamnations, soit il n'en contient pas. Dès lors, nous ne comprenons pas que vous préfériez vous référer à des fichiers dont l'objectivité est sérieusement sujette à caution, et que vous refusiez de vous expliquer sur ce point.

La fonction de citoyen assesseur n'est pas un droit, mais un devoir. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

La personne récusée n'aura pas lieu de s'en inquiéter, puisque seules seront contactées les personnes retenues pour assumer effectivement la mission de citoyen assesseur.
Par ailleurs, si les fichiers ayant vocation à être consultés contiennent actuellement des erreurs, il ne vous a pas échappé que le ministre de l'intérieur avait annoncé le remplacement prochain des fichiers STIC et JUDEX, qui ont vocation à être fondus en un nouveau fichier dont toutes les informations vont être vérifiées.
Enfin, une personne figurant dans le fichier en sera informée préalablement et disposera d'un droit à faire retirer son nom, dès lors qu'elle aura été mise hors de cause dans l'affaire la concernant.
Pour résumer, les fichiers peuvent effectivement poser un certain nombre de problèmes à l'heure actuelle, mais ces problèmes seront bientôt résolus avec la création prochaine du nouveau fichier TPJ, dont toutes les données vont être réactualisées.

Il me paraît extraordinaire d'entendre dire que le choix des citoyens assesseurs va se faire au moyen de la consultation de fichiers de police qui, quoi que vous en disiez, monsieur le rapporteur, ne sont pas portés à notre connaissance : c'est seulement si vous avez l'occasion d'apprendre que votre nom figure dans un fichier que vous pouvez éventuellement demander qu'il soit procédé à une rectification. Mais dans 90 % des cas les personnes figurant dans les fichiers de police ne le savent même pas.
C'est d'autant plus étonnant qu'à l'origine le Gouvernement proposait que puissent devenir citoyens assesseurs des personnes ayant été condamnées à une peine pouvant atteindre six mois d'emprisonnement avec sursis. Il a fallu une protestation de l'USM, faisant valoir que les magistrats pouvaient trouver choquant de siéger aux côtés de personnes qu'ils avaient précédemment condamnées, pour que le Gouvernement retire cette disposition. Maintenant, c'est le contraire : il suffit d'un élément non objectif, au contraire d'une condamnation – en l'occurrence, le simple fait de figurer sur un fichier – pour être récusé. Sur ce point, le cynisme de l'argumentation du Gouvernement ne laisse pas de nous étonner.
Par ailleurs, on ne nous a pas dit précisément de quel recours disposera la personne écartée de la fonction de citoyen assesseur sur le fondement d'un renseignement de police qui se révélerait faux. Si, pour certains, se voir confier la mission d'assesseur relève de la corvée, d'autres pourront trouver vexant d'être récusé. Cela pourra se savoir dans leur village, où la rumeur dira que, s'ils ont été récusés, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher,…

…ce qui constituera dès lors une atteinte à leur honneur. Dans ce cas, de quel recours disposeront les personnes concernées ?

La commission des lois rédige actuellement un deuxième rapport sur les fichiers de police. Certes, les fichiers STIC et JUDEX vont fusionner en un nouveau fichier appelé TPJ, mais cela ne supprimera pas pour autant les erreurs que contiennent ces fichiers.

Si, en ce qui concerne les données relevant de la gendarmerie nationale, un travail considérable de nettoyage et de rectification des erreurs a été effectué, il n'en est pas de même des données du STIC, erronées à 83 % et qui vont être transférées telles quelles dans le TPJ. Ce qu'a dit le rapporteur à ce sujet est donc faux, et je ne pense pas que le ministère de l'intérieur soit en mesure de nous prouver le contraire : alors que, dans le premier rapport d'information sur les fichiers de police que M. Bénisti et moi-même avons rédigé, nous demandions précisément la mise en place d'une sorte de comité, placé sous l'égide de l'inspection générale de la police nationale et chargé de procéder au nettoyage du STIC, cela n'a jamais été fait.
Par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 28 me paraissent contraires à la loi Informatique et libertés. J'aimerais donc que le ministre et le rapporteur nous fassent connaître l'avis de la CNIL au sujet de cet alinéa. La loi Informatique et libertés prévoit que l'on ne peut pas sélectionner des citoyens sur la base de fichiers d'antécédents judiciaires autres que le casier judiciaire et que, lorsque c'est le cas, les citoyens concernés en sont informés et disposent d'un droit d'accès indirect, c'est-à-dire d'un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant. Or, je ne vois rien dans le texte disant que les citoyens assesseurs inscrits sur les listes préparatoires et devant, à ce titre, être passés au crible des fichiers CASSIOPEE, STIC, JUDEX et maintenant TPJ, vont recevoir un courrier les informant de la consultation de ces fichiers et du droit d'accès et de rectification dont ils disposent en cas de récusation pour un motif tiré de l'un de ces fichiers, si ce motif est injustifié. Les principes fondamentaux de la loi Informatique et libertés ne me paraissent donc pas respectés.

Et les fichiers des primaires socialistes, ils ne posent pas de problèmes ?
Je souhaite apporter quelques précisions pratiques. Comme d'autres ici, sans doute, j'ai siégé de nombreuses années dans la commission qui désigne les jurés, tant sous l'ancien système, avant le tirage au sort, que sous le nouveau.
Non, j'ai été élu pour cela. Les citoyens du Rhône ont bien voulu m'élire et me réélire chaque fois que je le leur ai demandé. Je reconnais que c'est une grande chance d'être élu et, tous les jours, je les remercie de m'avoir désigné.
Monsieur Dray, je comprends que ce que je vais dire vous gêne et que vous ne souhaitez pas me laisser parler. Je vais néanmoins tenter de franchir la barrière que vous tentez de m'opposer.
Les choses se passent de façon très simple. Personne n'a un droit à être juré ou citoyen assesseur. Un tirage au sort a lieu et, à partir de la masse des personnes tirées au sort, la liste du jury est établie, de même que sera établie la liste des citoyens assesseurs. Personne ne sait qui est inscrit sur cette liste.
Il y a belle lurette que vous êtes député, monsieur Dufau ; si vous ne vous ne vous en êtes pas encore aperçu, c'est tout de même grave ! Je suis sûr qu'il vous arrive, tous les ans au mois de juillet, comme dans toutes les mairies de France, de tirer au sort les gens qui seront jurés. Cela a lieu à Capbreton comme ailleurs.
Beaucoup mieux qu'ailleurs : on met beaucoup plus de temps et l'on ne s'en rend pas compte ! (Sourires.)
Dans la commission siègent des magistrats, dont un représentant du parquet. Au moment de la constitution des jurys, si le représentant du parquet affirme que la nomination de telle personne n'est pas possible, il ne nous fournit pas d'explication. Et il a consulté les fichiers parce qu'il en a le droit. Les choses se passent de cette façon depuis des années. Je pense qu'il faut rejeter cet amendement et passer à la suite.

Les choses ne sont claires que pour M. Mercier ! Il n'a parlé que pour lui-même !

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les réponses de M. le rapporteur et de M. le ministre. Le premier a dit très justement que la fonction des assesseurs était un devoir. C'est le sens de l'alinéa 55 : « L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique. » Nous en sommes tous d'accord, il n'y a aucune ambiguïté.
L'alinéa 19 dispose, quant à lui, que le maire établit la liste préparatoire à partir d'un tirage au sort sur les listes électorales : ce sont donc les citoyens jouissant de leurs droits civiques qui sont concernés.

Au nom de quoi une commission peut-elle récuser des personnes jouissant de leurs droits civiques ? Comment voulez-vous que ces personnes ne se sentent pas agressées ? Elles jouissent de leurs droits civiques, du droit de vote, mais n'auraient pas le droit de siéger ? C'est absolument incompréhensible. Alors que vous demandez par ailleurs un rapprochement des citoyens de la justice, vous êtes en train de les en éloigner !
(L'amendement n° 149 n'est pas adopté.)

La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l'amendement n° 192 .

Nous apprécierions que le ministre ou le rapporteur réponde. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Chers collègues, vous avez fait adopter la réforme du temps programmé ; ne vous plaignez donc pas lorsqu'un débat sur une disposition, un amendement, un sous-amendement, dure le temps que nous le souhaitons !
L'amendement de repli n° 192 tend à supprimer les termes : « ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6 », ce qui revient à retirer la possibilité de consulter les fichiers STIC, Judex et Cassiopée pour établir la liste annuelle des citoyens assesseurs.
Le rapporteur et le Gouvernement seraient bien inspirés d'accepter cet amendement, car son adoption permettrait que le texte soit conforme aux principes de la loi Informatique et libertés.

Défavorable. Nous avons déjà répondu, même si la réponse ne convient pas à l'opposition. Le raisonnement est exactement le même sur cet amendement de repli.
Même avis.

C'est un peu léger. Un certain nombre de textes, lois et décrets, déterminent les personnes qui ont le droit de consulter les fichiers STIC et Judex. Or, dans la commission qui établira la liste, et qui aura donc, de fait, connaissance de ces fichiers, siégeront des avocats ou des conseillers généraux. Allez-vous modifier la loi sur le STIC et le Judex pour autoriser que des avocats et des conseillers généraux puissent avoir connaissance de leur contenu ? Comment cela va-t-il se passer ? Est-ce que vous voulez bien nous le dire ?

J'ai déjà répondu à cette question. Ce sera l'application stricte de l'article 230-10 du code de procédure pénale, validé par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la LOPSSI 2. Je vous renvoie à sa lecture.

Nous touchons à une des limites du système. Pour la nomination des jurés, on tire au sort et on écarte les personnes ayant un casier. Pour les citoyens assesseurs, on est obligé de consulter un fichier, dans des conditions irrégulières, comme l'a souligné Mme Batho.
Par ailleurs, sauf erreur de ma part, aucune protection particulière n'est prévue pour les citoyens assesseurs, qui ne bénéficient pas des protections accordées aux jurés pour les coups et blessures lorsqu'ils sont victimes d'agressions en raison de leurs fonctions.
Les citoyens assesseurs ne font pas non plus l'objet d'une protection particulière en matière de droit du travail. Aucune disposition ne prévoit l'interdiction d'une mesure disciplinaire professionnelle à leur encontre.

Monsieur Raimbourg, la commission a donné un avis favorable à un amendement visant à protéger les salariés.

Tout à fait ! C'est moi qui l'ai déposé !
(L'amendement n° 192 n'est pas adopté.)

La parole est à M. Patrice Verchère, pour soutenir l'amendement n° 224 .

Pour la prestation de serment des citoyens assesseurs à l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, cet amendement vise à compléter la formule proposée à l'alinéa 48 par les mots suivants : « de me souvenir que je suis au service de la vérité et de la justice ». Cette formule est inspirée du droit allemand et vise à rappeler aux citoyens assesseurs que leur premier devoir est de dépasser leurs émotions pour rendre un jugement de valeur.

Nous avons aligné le serment des citoyens assesseurs sur celui des jurés car les premiers doivent être dans le même état d'esprit que les seconds pour rendre la justice. Ils prêteront donc le même serment. L'ajout proposé paraît redondant avec le reste du serment, qu'il risque d'alourdir inutilement. Je demande donc le retrait de l'amendement.

La parole est à Mme George Pau-Langevin, pour soutenir l'amendement n° 146 .

Nous sommes tous sensibles à la beauté du serment prêté par les jurés devant la cour d'assises. Vous avez souhaité que les citoyens assesseurs prêtent également serment. Ces derniers, tout en bénéficiant d'une protection qui est celle d'un juge, prêteront le serment des jurés. On retrouve ce caractère hybride que nous avons déjà souligné.
Le citoyen assesseur prêtera serment en prononçant notamment les mots suivants : « de me décider suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ». Cette formule me paraît aujourd'hui dépassée. Parmi les jurés ou les citoyens assesseurs, il n'y a pas que des hommes, mais aussi des femmes. Je trouve donc déplacé de demander au citoyen assesseur de jurer qu'il se comportera comme un « homme ».

C'est un terme générique ! Nous avons bien la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen !

Nous pouvons tout à fait remplacer le terme générique « homme » par un autre terme générique, celui de « personne »,…

… de façon que le serment se dise ainsi : « avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre ». Une personne, cela signifie un homme ou une femme. Ce serait beaucoup plus conforme à la société dans laquelle nous vivons.
D'ailleurs, même l'adjectif « probe », bien que beau en soi et figurant dans le serment des jurés, a pris une connotation quelque peu vieillotte, et je crains qu'une partie des personnes qui seront amenées à prêter serment ne soient pas tout à fait à l'aise avec ce mot.
En tout cas, l'expression « un homme » est totalement périmée dans un texte voté en 2011.

Nous ne ferons pas un mauvais procès à nos concitoyens sur l'étendue de leur vocabulaire et nous garderons donc le mot « probe », qui existe dans d'autres textes et pour d'autres fonctions.
Quant au terme « homme », il est employé dans son acception générique, qui se retrouve dans l'intitulé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne crois qu'il faille débaptiser celle-ci. La commission a repoussé cet amendement.
(L'amendement n° 146 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Aux termes de l'alinéa 58, le fait, pour une personne désignée aux fonctions de citoyen assesseur, de ne pas se présenter sans motif légitime à l'audience à laquelle elle doit participer l'expose au paiement d'une amende de 3 750 euros.
Par cet amendement, nous souhaitons faire un peu de pédagogie, en précisant : « Avant la mise en oeuvre de toute sanction, la personne concernée est invitée à fournir des explications sur ses manquements. Le courrier rappelle également que l'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir de citoyen et une participation à la justice de son pays. »

La commission a repoussé cet amendement. Je rappelle que si nous avons fixé l'amende à 3 750 euros, c'est pour la calquer sur celle qu'encourent les personnes qui refusent de remplir la fonction de juré en cour d'assises, car il n'y a pas de distinction à faire entre les citoyens assesseurs et les jurés, une fonction n'est pas plus noble que l'autre. Je précise que les personnes qui refuseront la fonction de citoyen assesseur ne seront pas systématiquement condamnées à une telle peine. Le procureur de la République pourra toujours recourir à une alternative aux poursuites,…

…en vertu de l'article 41-1 du code de procédure pénale. Je crains que le vote de cet amendement n'introduise une certaine rigidité dans la procédure de désignation et de participation des citoyens assesseurs, procédure qui, il ne faut pas l'oublier, concernera chaque année 9 000 de nos concitoyens quand elle sera généralisée. Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.

Après avoir entendu les explications du rapporteur, y compris ses précisions sur le parallélisme des formes, je retire l'amendement. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC et sur quelques bancs du groupe UMP.)

Monsieur le rapporteur, la cour d'assises prononce elle-même la sanction pour absence injustifiée d'un juré, avec la possibilité d'y revenir par la suite, alors qu'il est prévu ici que l'amende soit prononcée comme devant le tribunal de police, sans que l'intéressé soit forcément à même de fournir ses explications.
(L'amendement n° 225 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 1er est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement rédactionnel, n° 89, présenté par M. Huyghe.
(L'amendement n° 89 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L'article 1erter, amendé, est adopté.)

Cet amendement important vise à régler un problème que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises. La commission des lois a adopté cet article complétant le code de procédure pénale afin de permettre à la victime de former appel sur l'action publique contre les arrêts d'acquittement rendus par les cours d'assises en l'absence d'appel du ministère public. Une telle modification soulève un certain nombre de problèmes de principe de nature juridique et pratique : sur le plan juridique, elle bouleverserait assez profondément notre système d'action publique et, sur le plan pratique, elle soulève plusieurs questions.
Sur le plan des principes, je sais que nous avons tous de la considération pour les victimes et que nous souhaitons qu'elles puissent vivre le procès pénal dans des conditions qui les satisfassent dans leur désir de réparation et qui leur permettent d'anticiper au mieux ce qui est pour elles la procédure de la vraie réparation, c'est-à-dire le débat sur les intérêts civils.
Permettre à la partie civile d'enclencher l'action publique, c'est déjà chose faite, M. Blanc l'a excellemment rappelé dans son intervention. Si le ministère public ne déclenche pas l'action publique, la victime peut le faire au moyen de plusieurs procédures – la citation directe, la plainte avec constitution de partie civile, l'appel sur l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Mais il y a bien évidemment une différence fondamentale entre déclencher et exercer l'action publique. Dans notre droit, c'est l'État qui exerce l'action publique, dans l'intérêt de la loi et pour réparer un accroc fait au pacte social. La victime a bien sûr le droit d'obtenir réparation pour ce qu'elle a subi, mais la peine pénale n'est pas la réparation pour la victime : c'est la réparation pour la société. Il faut en avoir pleinement conscience. Changer cela, ce serait changer très profondément notre droit…
…car la victime pourrait alors être en position accusatoire devant le juge, et le parquet n'aurait plus grand-chose à faire. On ne peut pas, au gré d'un amendement voté en commission, si intéressant soit-il, bouleverser aussi profondément notre conception de l'action publique. Qu'il y ait des réflexions sur le sujet, qu'il y ait débat, me semble tout à fait normal, mais je ne pense pas que l'on puisse, dans de telles conditions, modifier à ce point la conception de l'exercice de l'action publique dans notre pays.
Je précise que la mesure proposée visant uniquement les arrêts des cours d'assises, l'amendement de suppression du Gouvernement ne porte que sur ce sujet. Je veux rappeler à l'auteur et aux cosignataires de l'amendement qui a conduit au nouvel article 1er quater qu'ils ont quelque peu négligé un point : le texte du Gouvernement prévoit une obligation de motivation des décisions rendues par les cours d'assises. Bien évidemment, le parquet ne décidera de faire ou non appel qu'au vu de la motivation de la cour. On ne sera plus du tout dans le système où il s'agissait d'un arrêt sec et où on ne savait pas pourquoi les jurés avaient pris telle ou telle position. Maintenant on saura pourquoi, et si le parquet décide de ne pas faire appel dans ces conditions, on ne peut pas accepter un conflit entre la victime et le ministère public.
J'ajoute que ce serait un faux espoir pour la victime. En effet, si le parquet décide de ne pas faire appel, c'est qu'il est convaincu qu'il n'y a pas lieu de le faire, et transformer l'appel en une des modalités d'enclenchement de l'action publique ne le convaincrait pas plus : il pourrait dès lors, bien entendu, requérir l'acquittement.
Il y a encore un autre argument sur le plan pratique : l'appel en matière criminelle a le même nom qu'en matière correctionnelle, mais pas tout à fait le sens. En matière correctionnelle, il y a une hiérarchie, avec un tribunal de première instance, puis la deuxième instance, à savoir le tribunal correctionnel et, au-dessus, la chambre correctionnelle de la cour d'appel. La hiérarchie est claire : il suffit de regarder comment le CSM procède aux nominations. S'agissant des cours d'assises, il n'y a pas de hiérarchie : la cour d'assises de la première instance est exactement au même niveau que la cour d'assises de l'appel. L'appel a certes été institué, mais ce n'est pas un appel au sens correctionnel du terme. L'appel en matière criminelle, devant une cour d'assises, c'est une deuxième chance donnée à celui qui a été injustement condamné. On changerait profondément le système si l'on modifiait le dispositif actuel, parce que c'est un jury populaire qui, à la majorité, prononce la condamnation. C'est la raison pour laquelle il ne peut y avoir un jury plus fort qu'un autre jury : dans tous les cas, c'est le peuple qui s'est prononcé. Cette deuxième chance, c'est l'application de ce qu'écrivait La Bruyère : « Un innocent condamné est l'affaire de tous les honnêtes gens. » Il s'agit simplement de donner une deuxième chance et rien d'autre.
Et puis j'en viens aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles. Je suis très attaché aux dispositions constitutionnelles. Je sais que c'est un peu moins à la mode aujourd'hui…
…et que l'on invoque plus largement les dispositions conventionnelles, mais je reste très attaché à notre bloc de constitutionnalité.
J'y tiens beaucoup. À cet égard, je rappelle à M. Blanc que l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la base de notre vie en commun, dispose que l'accusé a droit à un procès impartial. Comment la victime pourrait être la partie accusatrice sans que l'impartialité du procès ne soit remise en cause ? Ce serait évidemment impossible.
Je connais M. Blanc depuis longtemps, je sais que c'est un grand européen, et il a invoqué l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en disant que la victime, elle aussi, a droit à un procès équitable. Il a raison, mais j'ai relu l'article parce que je ne pouvais pas être complètement convaincu aussi facilement : l'article 6 définit le procès équitable comme étant un procès impartial. Permettre à la victime de faire appel serait la transformer en partie poursuivante, et ce ne serait donc plus un procès impartial.
Pour toutes ces raisons, je demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir accepter l'amendement de suppression du Gouvernement. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP et du groupe SRC.)

Nous avons déposé cet amendement pour supprimer l'article introduit par la commission des lois parce qu'il remet en cause un principe fondamental de notre procédure pénale.

Je veux dire à M. le ministre que, sur ce point-là, il peut compter sur le soutien de notre groupe face aux arguments qui vont lui être opposés par certains collègues siégeant à droite de l'hémicycle.

Avis favorable parce que la disposition prévue à l'article 1er quater bouleverserait profondément les principes essentiels de notre procédure pénale. Je rappelle que celle-ci prévoit que les poursuites devant la cour d'assises sont effectuées par le procureur de la République au nom de la société et que la victime, elle, demande la réparation de son préjudice. Si nous maintenions cet article, nous risquerions de tomber dans une justice privée, certains ont même parlé de « justice de vengeance », avec le risque que la partie civile devienne un second accusateur, situé sur le même plan que le ministère public. Je vous renvoie, mes chers collègues, à la démonstration très complète que vient de faire le garde des sceaux à propos des problèmes que l'appel à l'initiative des victimes susciterait au regard des exigences du procès équitable.
Sur le plan pratique, si cette disposition était maintenue, toutes les décisions d'acquittement feraient automatiquement l'objet d'un appel, ce qui, dans les conditions d'encombrement actuelles des tribunaux, serait source de grandes difficultés.
En outre, la possibilité d'interjeter appel d'un arrêt d'acquittement de cour d'assises ne serait pas offerte seulement à la victime mais aussi à toutes les associations qui se seraient constituées partie civile. C'est là un autre écueil.
Enfin, une telle disposition ne trouve pas sa place dans un texte dont la vocation est de faire siéger des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels.
Je vous demanderai, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet amendement de suppression, quitte à repenser ultérieurement l'intégralité de notre législation sur les droits des victimes. Depuis 2002, nous avons introduit dans notre droit vingt et une dispositions en leur faveur. Les victimes n'ont donc jamais été oubliées par la majorité…

…qui a présenté un certain nombre de propositions de loi pour améliorer leur sort, comme le fait habilement remarquer le président de la commission des lois.
Le Gouvernement prépare une refonte totale du code de procédure pénale ; l'avant-projet, qui comporte 700 articles, a été abondamment commenté. À un an d'échéances électorales majeures, ce n'est pas le moment de lancer cette réforme de fond qui, le temps venu, nous permettra de revoir les principes fondamentaux de la procédure pénale.

Trois arguments plaident en faveur de l'amendement de suppression du Gouvernement.
Le premier a déjà été développé : le procès n'est pas un face-à-face entre l'accusé et la victime, mais un rituel au cours duquel la société essaie de réparer la blessure au corps social que représente le crime. Le principal acteur du procès est le procureur ; la victime est une partie associée au procureur. Je ne crois pas qu'il faille toucher à cet équilibre, quand bien même il faut réserver sa place à la victime, sachant que cette dernière ne peut pas devenir l'accusateur principal.
Deuxième argument : nous sommes en train de parler de choses très ténues statistiquement parlant. Les cours d'assises rendent quelque 2 500 arrêts par an, et le nombre d'acquittements oscille entre 100 et 150. La plupart de ces acquittements font l'objet d'un appel de la part du parquet, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'une catégorie statistique tout à fait minime. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous y intéresser, mais ce sont des cas rarissimes.
Troisième argument : nous sommes dans une situation très particulière. Si le parquet a décidé de poursuivre devant la cour d'assises, avec toute la lourdeur et le coût que cela représente, cela veut dire qu'il croit à son dossier. S'il décide de ne pas faire appel à l'issue des débats, c'est qu'un événement s'est produit à l'audience, indiquant que l'accusation ne pourrait aboutir à une condamnation. À tort ou à raison.
Dans certains cas, la croyance en la culpabilité de l'accusé ne peut être objectivée par aucun élément matériel. Quand bien même tout le monde pense que la cour a affaire à quelqu'un qui doit être impliqué dans le dossier, aucun élément ne permet d'asseoir sa culpabilité.
Dans ce cas-là, il faut protéger la victime et ne pas la laisser nourrir l'espoir que, toute seule, elle arrivera à obtenir une condamnation en appel. C'est d'autant plus important qu'elle peut être conseillée de façon un peu maladroite par un avocat peu habitué aux cours d'assises, car ces procédures sont rares : 2 500 arrêts par an. Si le conseil n'est pas un habitué des cours d'assises, avec la charge émotionnelle que représente le fait d'être confronté au crime, à la douleur de la victime, à la stupeur de l'accusé, il peut y avoir un emballement émotionnel conduisant à un acharnement procédurier qui va coûter beaucoup à la victime en frais et en espoirs déçus. Il est sage de protéger aussi la victime de son propre emballement.
En conséquence, j'estime qu'il faut voter cet amendement.

Nous sommes au coeur du débat. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais je m'inscris en faux contre cet amendement de suppression.
Premièrement, quel est l'intitulé du projet de loi dont nous débattons ? « Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs ». Nous sommes bien dans le sujet. Le citoyen n'est pas simplement un être éthéré qui vient apporter sa contribution au débat sur la justice, c'est aussi éventuellement une victime. À ce titre, il a droit à tout notre intérêt, à toute notre attention.
Dans vos arguments, vous voulez transformer ce que nous considérons comme une évolution en une espèce de révolution.

Non, c'est une évolution. Et vous le confirmez dans votre propos, monsieur le ministre : de multiples décisions élaborées depuis 2002 et votées dans cette enceinte ont permis de faire progresser les droits de la victime. Nous allons vers une étape supplémentaire, c'est vrai, mais pas davantage : lui donner la possibilité de faire appel en cas d'acquittement.
Deuxièmement, que les choses soient bien claires, le droit d'appel qui serait conféré à la victime n'est pas du tout comparable à celui du procureur.

Non ! Il ne s'agit pas de donner à la victime le pouvoir de contester le quantum de la peine. Aux termes du texte que nous avons fait adopter en commission, la victime ne pourra pas dire : il a pris cinq ans, il devrait en prendre dix. Dans cette hypothèse, elle n'aura pas la possibilité d'appel. L'appel se confine aux cas où la victime considère qu'il y a déni de justice, c'est-à-dire où il y a acquittement.

Évidemment, la logique nous commande d'avoir une réflexion analogue pour les relaxes en correctionnelle.
Mais chacun aura compris que, contrairement à ce qui est parfois instillé dans les réponses qui nous sont faites, on ne saurait comparer le droit d'appel du procureur et celui que nous proposons pour la partie civile.

Non, mon cher collègue, ayez la courtoisie de suivre mon raisonnement. La victime ne peut pas contester le quantum de la peine en cas de condamnation ; elle ne peut faire appel qu'en cas de déni, d'acquittement.
Troisième étape du raisonnement : notre collègue Dominique Raimbourg cite des chiffres, mais je préférerais avoir ceux de la chancellerie. Combien y a-t-il eu d'acquittements et d'appels sur acquittement au cours des dernières années, monsieur le ministre ? Je tiens à des réponses chiffrées pour que notre débat soit le plus objectif possible. Même si les cas sont rares, cela ne signifie pas qu'ils ne méritent pas notre attention, comme le dit très justement M. Raimbourg. Quoi qu'il en soit, je voudrais que vous nous donniez vos chiffres précis et datés.
Quatrième élément : nous n'avons pas la même conception des droits de la victime, monsieur le ministre. Finalement, vous restreignez les droits de la victime à l'indemnisation. Or combien de crimes – ou de délits, auxquels notre raisonnement s'applique aussi – n'ont pas vocation à se traduire en indemnisations ? Dans les cas de traumatismes qui résultent d'agressions sexuelles, le sujet n'est pas l'indemnisation mais la réparation devant la société par une sanction. Nous ne pouvons pas confiner la victime comme elle l'est encore actuellement – et les mots sont déjà dépassés – à des droits de nature pécuniaire. Il faut aller au-delà.
Dernier élément mais pas le plus modeste : l'acquittement fait de la victime une menteuse potentielle, une possible affabulatrice puisque, après avoir été suivi un temps par le parquet, son raisonnement n'a pas été retenu. C'est donc elle qui, de fait, se trouve mise en accusation devant la société, ce qui représente une source de traumatisme supplémentaire.
Pour toutes ces raisons, nous considérons que le débat doit avoir lieu, que vous devez nous fournir des chiffres précis, monsieur le garde des sceaux, et qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une révolution mais d'une évolution souhaitée par nos concitoyens. Nous devons introduire davantage la victime dans le procès pénal. Nous ferions ainsi oeuvre utile.

Je défends bien sûr l'amendement du Gouvernement. Les intentions sont toujours bonnes.

En général. Mais a-t-on réellement mesuré ce qu'un tel bouleversement entraînerait dans le fonctionnement quotidien de la justice ? Pour ma part, j'ai du mal à comprendre que l'on puisse s'y résoudre en une semaine.
On ne change les lois, dit-on, que d'une main tremblante. De grâce, si vous ne voulez pas, au-delà des problèmes multiples qui se poseraient, rendre la justice ingérable dans ce pays, vous devez adopter l'amendement du Gouvernement.

Avant de faire référence à ce qui nous sépare, au moins en apparence, je rappellerai ce qui nous réunit : la volonté que notre droit et nos pratiques nous rapprochent de plus en plus de la considération due aux victimes. Ceci ne peut être dénié par personne. Nos concitoyens expriment le vrai désir – que nous ressentons aussi – que notre droit pénal ne soit pas désincarné, et qu'il se rapproche le plus possible de la douleur et de la souffrance des victimes et de leurs proches.
Une fois que nous avons dit cela, comment atteindre l'objectif ? L'amendement adopté en commission que le Gouvernement propose d'annuler est probablement la plus mauvaise réponse que l'on puisse apporter.
J'invite notre collègue Marc Le Fur à être prudent avec les formules. Dire qu'un acquittement serait un déni de justice me semble excessif et pour le moins dangereux.

L'acquittement exprime l'incertitude du jury souverain quant à la culpabilité de la personne mise en cause, ou sa certitude que cet accusé n'est pas coupable. Prendre le parti de la victime pour dire que l'acquittement de l'accusé est un déni de justice me semble grave et dangereux. C'est un mauvais point de départ.
Il faut tout se dire. D'où vient le sujet ? D'une pression exercée sur un grand nombre d'entre nous par une association très respectable qui s'est donnée comme objectif de réfléchir à un meilleur équilibre de notre justice pénale et à une meilleure considération de la victime.
Comme un certain nombre d'entre nous, j'ai beaucoup travaillé et réfléchi avec cette association et je pensais lui avoir fait comprendre qu'il n'était pas possible d'accepter le formidable retour en arrière que constituerait le passage de la justice à la vengeance auquel sa demande conduirait et auquel revient l'amendement adopté en commission et qu'il nous est proposé maintenant de supprimer.
On veut faire un parallèle entre l'avant-procès et le procès lui-même.
Avant le procès, il est tout à fait légitime que la victime fasse savoir qu'elle est victime et demande l'ouverture d'un procès. Personne ne le conteste et beaucoup de voies de droit lui sont ouvertes. Elle peut porter plainte. Si le parquet ne donne pas suite, elle peut porter plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction aux fins d'ouverture d'une instruction – ce qui n'oblige nullement le juge d'instruction à poursuivre au point de traîner devant la cour d'assises la personne mise en cause. Donc, avant le procès, la victime peut faire valoir son droit à ce qu'une action publique soit engagée.
À partir du moment où le procès a lieu, nous entrons dans le cadre du droit pénal : la société prend la place, au nom de l'action publique, de la victime et fait valoir les droits de celle-ci dans un ordre social qu'il faut assumer et assurer en permanence.
Faire croire, par une empathie qui peut être coupable, à la victime qui jugerait l'action publique défaillante qu'elle peut se substituer à elle est probablement dangereux. En tout cas, ce serait non pas « évolutionnaire », mais révolutionnaire, au point que cette question mérite qu'on y consacre plus de temps qu'une simple discussion au détour d'un amendement, d'ailleurs détourné de l'objet même du projet de loi.
Je précise qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit à ce sujet.

N'oublions pas que les « promoteurs » de l'idée qui a donné lieu à l'amendement adopté par la commission des lois partaient de la conception, apparemment simple et objectivement acceptable, selon laquelle, quand un procureur a requis et n'est pas suivi par la cour d'assises, il doit faire appel. Les auteurs de l'amendement sont allés au-delà du souhait des personnes qui nous ont tous sollicités, en en faisant une mesure générale s'appliquant à toutes les parties civiles. Ces dernières n'étant pas toujours des représentantes objectives des victimes, elles prendront un malin plaisir à faire systématiquement appel de toutes les décisions d'acquittement. C'est le risque que nous courons si nous n'adoptons pas l'amendement du Gouvernement, d'autant qu'un autre amendement a été déposé afin d'étendre la mesure aux tribunaux correctionnels pour toutes les décisions de relaxe.
Cela étant, il est de la responsabilité du Gouvernement de faire des propositions. Puisqu'il va être demandé aux cours d'assises de motiver leurs décisions, ne peut-on obtenir des procureurs qu'ils donnent les raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas faire appel d'une décision d'acquittement de la cour d'assises. La voie à suivre me semble être celle-là. Il faut que la victime soit éclairée sur la manière dont l'action publique a été enclenchée et sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas été poursuivie.
Pour revenir aux propos, que je respecte totalement, de Marc Le Fur, je précise que faire appel, c'est demander et, par voie de conséquence, obtenir qu'un nouveau procès ait lieu, c'est-à-dire que l'ensemble de l'affaire soit reprise. En d'autres termes, la victime se substituerait au parquet.
Lors de l'examen de cette question en commission, M. le ministre a soulevé un problème important. Si la victime fait appel et que le procureur, qui n'a pas fait appel, ne requiert pas, qui va requérir ? La victime ? Au nom de quoi ? Au nom du ministère public auquel elle va se substituer ? Ce serait une véritable révolution, qui bouleverserait l'équilibre de notre droit pénal.
Le droit civil, ce sont deux personnes qui s'affrontent à propos d'un différend. Le droit pénal, c'est une personne mise en cause par la société, parce que celle-ci a décidé qu'entre citoyens organisés, modernes et civilisés, il n'y a pas de vengeance.
C'est la raison pour laquelle, malgré tout le respect que je porte à nos collègues qui ont fait voter cette disposition en commission des lois, je demande que l'amendement du Gouvernement soit adopté. Il y va, je le crois profondément, de l'intérêt des victimes. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs des groupes SRC et GDR.)

Cela n'a échappé à personne : nous débattons d'un sujet essentiel, et je crois que les positions peuvent évoluer dans cet hémicycle, y compris en matière de droit.
L'amendement adopté par la commission des lois a été déposé par plus de soixante-dix députés, qui n'étaient pas tous de l'UMP puisqu'un député du Nouveau Centre, Jean-Christophe Lagarde, nous a apporté son soutien au moment du vote.

Nous sommes dans une situation un peu inédite où le Gouvernement s'oppose à un amendement de la majorité présenté, disais-je, par plus de soixante-dix députés et adopté par la commission des lois, tandis que l'opposition fait cause commune avec le Gouvernement pour bloquer une évolution du droit des victimes.

Personne n'a le monopole du droit des victimes, mais nous avons observé, ces dernières années, une très nette évolution en leur faveur. Ayant moi-même évolué sur la question, je considère qu'il nous faut maintenant aller au bout de notre logique.
J'ai entendu exposer avec talent les positions des uns et des autres. J'estime nécessaire, avant d'aller plus loin, de recadrer le débat, en rappelant de quoi il s'agit exactement.
La victime de faits criminels – donc passibles d'une action devant la cour d'assises – se trouve aujourd'hui dans une situation très particulière, puisqu'elle est partie civile. Elle a, bien entendu, droit à l'assistance d'un avocat, qui la conseille tout au long de la procédure, et au soutien du procureur de la République, qui mène l'accusation et requiert, à la fin des débats en cours d'assises, une peine à l'encontre de l'accusé. Il arrive qu'au cours de l'audience, l'évolution des débats modifie l'idée que le procureur avait de l'affaire et qu'il ne requière pas mais, la plupart du temps, ayant mené l'accusation, il requiert une peine.
Si la cour d'assises de première instance prononce cependant une décision d'acquittement, il peut alors se passer quelque chose de très surprenant : alors que le procureur a mené l'accusation, qu'il parle au nom de la société et qu'il a requis parfois une peine très sévère, il ne fait pas appel. J'ai été confronté à de tels cas. Comment cela se fait-il ?
Monsieur le ministre, la motivation n'est pas encore un sujet d'actualité.
Elle figure dans la présente loi !

Dans les arguments que vous avez invoqués pour défendre votre amendement de suppression, vous faites appel à une évolution du droit. Celle-ci est tout à fait loisible mais, pour l'instant, elle n'existe pas.
Les victimes qui se trouvent confrontées à un acquittement – et j'en connais – souhaitent faire appel, pour que l'affaire soit rejugée par la cour d'appel. Or elles n'en ont pas le droit. Il y a là une incohérence…

…qu'il faut absolument corriger, non pas parce que la victime n'est pas contente, si je puis employer ce terme, de la peine prononcée – l'importance de la peine n'est pas en cause – mais parce qu'il y a eu acquittement.
L'amendement qui a été adopté par la commission des lois et que vous souhaitez supprimer, donne simplement à la partie civile la possibilité l'occasion de faire rejuger son affaire.
Il ne s'agit en aucune façon d'une vengeance privée, ni d'une privatisation. Contrairement à ce que vous avez écrit dans l'exposé sommaire de votre amendement, monsieur le ministre, l'amendement adopté en commission ne donne pas plus de pouvoir à la victime qu'au procureur de la République, puisqu'il a, lui, la possibilité de demander une échelle de peine.
Si la victime demande à statuer en appel, c'est simplement parce qu'elle veut porter son affaire devant la cour d'assises d'appel.
Je rappelle que la victime a, heureusement, de nombreux droits : elle peut enclencher l'action publique, contourner un classement d'opportunité du procureur de la République, porter plainte avec constitution de partie civile et saisir un juge d'instruction. Elle peut également, et c'est heureux, faire appel de l'ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction et faire appel encore dans d'autres domaines.
Elle peut encore – c'est un élément important que personne n'a évoqué jusqu'à présent – citer directement une personne devant un tribunal correctionnel.
Nous l'avons dit !

Sans qu'il y ait la moindre enquête de gendarmerie ou de police, n'importe qui peut être cité directement par une partie civile devant un tribunal correctionnel. Qu'on ne dise donc pas que la partie civile n'a pas de pouvoirs particuliers. Elle en a heureusement beaucoup.
Elle peut enfin contribuer à l'oeuvre de justice puisqu'il est également dit dans les textes qu'elle concourt à la culpabilité.
Il serait donc naturel de lui donner la possibilité de demander que son affaire soit rejugée.
Je rappelle également que les droits des suspects ont été accrus dans la dernière loi sur la garde à vue. La Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel nous ont demandé de donner davantage de droits aux suspects, en prévoyant, dès le début de la garde à vue, l'assistance effective d'un avocat – et non une simple présence.
Dans le même texte, nous avons également fait progresser les droits des victimes puisqu'elles peuvent se faire, elles aussi, assister d'un conseil, notamment lors des confrontations avec le suspect. Tout cela résulte du débat parlementaire, ce qui prouve son efficacité.
Comment peut-on accroître les droits des suspects, alors qu'on ne sait pas s'ils sont coupables ou innocents, sans accroître ceux des victimes, alors qu'on sait qu'elles sont réellement des victimes ? Il y a là aussi, me semble-t-il, une certaine incohérence.
Par ailleurs, parler de vengeance privée ou d'acharnement de la part des victimes – je ne vous accuse pas d'avoir prononcé ces mots, monsieur le ministre –, c'est mal les connaître. La victime n'est pas un être sanguinaire qui réclame la vengeance à tous crins. Au contraire, elle fait confiance à la justice de son pays. Ni vous ni moi ne savons comment nous réagirions face à l'horreur qu'elles ont parfois connue, et je trouve remarquable ces victimes et ces associations de victimes qui ne cherchent pas à se faire justice elles-mêmes mais confient cette oeuvre aux tribunaux. Du reste, je vous mets en garde : si nous n'allons pas au bout de notre raisonnement sur les droits des victimes – qui en l'occurrence seraient très limités, puisqu'il n'est question que de faire rejuger une affaire, qu'il ne s'agit pas d'une privatisation de la justice, des juges étant appelés à trancher –, nous risquons, comme l'a excellemment dit Étienne Blanc, d'encourager la vengeance privée dès lors que la justice n'aura pas fait son travail.
Enfin, argument suprême, tous, nous sommes soucieux d'accroître les droits des victimes, et le Président de la République plus que tout autre. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Combien de fois a-t-il marqué, avec force et détermination, sa volonté dans ce domaine ?

Il ne dépend que de nous d'accorder à la victime la possibilité de faire appel et de se pourvoir devant des juges et des jurés souverains, et je ne comprends pas que vous lui refusiez, alors qu'elle est de plus en plus partie prenante au procès – article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme –, le contradictoire, le procès équitable, sans mettre aucunement en cause les droits de la partie que représente le procureur de la République. Dans l'exposé sommaire de son amendement, M. le garde des sceaux précise d'ailleurs que seul le procureur général peut faire appel : rien de plus normal, puisqu'on est au niveau de la cour d'assises.
Enfin, l'UMP a récemment réuni une convention sur l'exécution des peines (Exclamations sur les bancs du groupe SRC), organisée par Éric Ciotti et moi-même. L'une des propositions de cette convention était de faire de la partie civile une partie à part entière au stade de l'application des peines, avec possibilité de faire appel d'une décision de libération conditionnelle.

Cela rejoint le débat que nous avons eu tout à l'heure sur la juridictionnalisation de l'application des peines. Cette possibilité que l'UMP demande, de faire de la partie civile, au niveau de l'application des peines, une partie à part entière, donnons-la au niveau de la cour d'assises : ce ne serait que justice. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

Je laisse à M. Garraud le soin d'organiser comme il l'entend les débats au sein du groupe UMP, mais je lui rappelle que je suis l'orateur du groupe Nouveau Centre : j'ai pris à la tribune, au nom de mes collègues, l'engagement d'apporter le soutien du groupe à un texte qui nous paraissait équilibré. Je voterai donc votre amendement, monsieur le garde des sceaux, et je désavoue celui que mes collègues ont fait adopter en commission.
J'ai la plus grande estime pour Marc Le Fur et Jean-Paul Garraud, mais je dois leur dire avec la plus grande délicatesse qu'ils n'ont pas le monopole des victimes. Tous ceux qui sont aujourd'hui présents dans cet hémicycle sont autant attachés aux droits des victimes.

Ce n'est pas parce que nous voterons l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement que nous sommes moins attachés que vous au sort des victimes.

C'est d'autant plus vrai que, le ministre et le rapporteur l'ont rappelé, nous avons été très attentifs, depuis quelques années, à améliorer ce sort. Il y a sept ans, dans ce même hémicycle, un prédécesseur de M. le garde des sceaux avait pourtant tenté de remettre en cause certains droits des victimes. Nous avions été plusieurs à faire en sorte qu'en cas de classement sans suite, la constitution de partie civile puisse déclencher l'action publique.
L'argument de nos collègues Garraud et Le Fur n'est donc pas juridique. M. Le Fur dit que nous sommes ici au coeur du projet : nous sommes, au contraire, en dehors du projet, qui vise à améliorer le fonctionnement de la justice par la présence des jurés populaires, mais nous ne sommes pas là pour remettre en cause une énième fois le code de procédure pénale. J'ai entendu le rapporteur évoquer un avant-projet de 700 articles. Je lui conseille, comme au Gouvernement, de s'abstenir d'ouvrir un tel chantier avant les élections de 2012. (Rires.) Nous aurons tout lieu d'en reparler dans le cadre d'une prochaine législature. Nous avons entrepris un grand nombre de réformes : il faut aujourd'hui les évaluer et, surtout, dégager les moyens financiers et les moyens en personnel pour leur réussite.
Je suis donc favorable à l'amendement du Gouvernement.

Je rappellerai enfin à M. Le Fur que nous avons un double degré d'appel pour les décisions d'assises, mais qu'il s'agit d'une nouveauté qui nous a été imposée par la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention de Strasbourg. Lorsqu'il y a un arrêt d'acquittement ou une condamnation pénale, il y a un deuxième procès sur intérêts civils. Dominique Raimbourg pourrait en parler aussi bien que moi.

Lorsqu'il y a un arrêt de cour d'assises, la réparation du préjudice de la victime est prévue sur intérêts civils. Il y a là un deuxième degré de juridiction.
Voilà pourquoi je suis pour l'amendement de suppression. S'il n'était pas adopté, c'est tout l'équilibre du texte qui serait compromis.

Je souhaiterais faire trois remarques.
D'abord, le débat qui nous occupe ce soir est particulièrement intéressant : c'est un débat de droit mais aussi un véritable débat de société. Les avocats, notamment ceux qui ont plaidé devant des juridictions pénales, savent tous que la place de la partie civile dans le procès pénal est bien singulière. Dans les cours de déontologie prodigués par les barreaux, on apprend aux étudiants avocats que, lorsqu'ils défendront une partie civile, ils ne prendront pas part au procès pénal pour requérir une peine, mais qu'ils seront simplement aux côtés d'une victime qui est souvent plaignante, pour renforcer l'accusation lorsqu'elle vise à faire reconnaître une culpabilité. D'ailleurs, les mots ont un sens. Les plaidoiries des parties civiles se terminent toujours par des formules qui ne visent pas à réclamer une condamnation, mais qui demandent au tribunal d'entrer en voie de condamnation ou de déclarer coupable l'accusé ou le prévenu. Cette situation est très ambiguë car, si la partie civile demande une condamnation, on entre de plain-pied dans la justice privée : celui qui a subi un préjudice demande au juge de condamner ; peu importe son indemnité, ce qu'il veut, c'est une condamnation. Voilà la justice dont nous ne voulons pas : celle qui consiste à indemniser un intérêt privé par une sanction pénale.
Deuxième observation : je n'ai pas signé cet amendement à la demande d'une association mais parce que, depuis une vingtaine d'années, il s'agit d'un sujet de premier plan ; il suffit de lire les revues de droit pénal pour s'en convaincre. Les cours d'assises de France rendent, bon an mal an, 2 500 arrêts. J'aurais aimé citer les chiffres précis, mais nous ne les avons pas.
Si cela suffisait pour les obtenir… (Sourires.)
Plutôt 190 !

Environ 80 ou 90 % font l'objet d'un appel de la part de l'avocat général. Rien de plus normal : il a soutenu une accusation, n'a pas obtenu satisfaction et interjette donc appel devant une autre cour d'assises qui va reprendre le dossier depuis le début.
Le problème concerne ces 15 ou 20 % d'arrêts d'acquittement qui ne font pas l'objet d'un appel – et ce sera là ma troisième observation. Avec sagesse, le législateur a cherché à apporter une réponse à cette question à travers les dispositions de l'article 372 du code de procédure pénale : « La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation. »

En clair, cela signifie qu'après avoir prononcé un acquittement ou une exemption de peine, la cour d'assises va se réunir pour statuer sur intérêts civils et que, à cette occasion, elle va examiner les demandes de la partie civile. C'est là que nous avons un véritable problème. En effet, la jurisprudence exige que la partie civile apporte la preuve d'une faute civile distincte de la faute pénale.

Si la demande d'indemnisation ne s'appuie que sur la faute pénale, elle sera purement et simplement écartée, puisqu'il y a eu acquittement, lequel efface la faute. Il faut donc que la partie civile trouve la voie étroite d'une faute distincte de celle qui était reprochée à l'accusé, qui sera qualifiée de faute civile et permettra d'obtenir une indemnisation.
Je citerai un exemple simple. La victime d'un viol se constitue partie civile devant une cour d'assises. La cour acquitte : il n'y a donc pas eu de viol. Quelle est alors la place de celle qui se déclare victime ? Quelle indemnité peut-elle obtenir ?

Tel est le problème de fond. On ferme à la victime la voie de l'appel, c'est-à-dire celle du double degré de juridiction, qui lui permettrait de faire réexaminer son argumentation par une cour d'assises. En fait et en droit, cette porte lui est fermée et, à ma connaissance, c'est un des seuls cas où une partie est privée du double degré de juridiction.
Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, je me suis associé à cet amendement. Je comprends la difficulté que rencontre le Gouvernement. Le problème ne date pas d'hier. Il remonte à Cambacérès et à la rédaction du code de procédure pénale, lorsque s'est posée la question de la place des victimes : on sortait de la Révolution et d'un droit bien différent.
Monsieur le garde des sceaux, on ne peut pas laisser la procédure pénale dans cette situation d'ambiguïté. Évoquer cette question à la faveur d'un amendement un peu à la marge, c'est comme y accéder par la bande, mais vous êtes un grand joueur de billard.
Je n'y ai jamais joué de ma vie !

Je parlais de politique, monsieur le garde des sceaux. (Sourires.)
Je pense qu'on ne peut laisser le code de procédure pénale en l'état, dans cette incertitude. Une réponse doit être apportée. Laquelle ? Faut-il que vous constituiez une commission qui prenne à bras-le-corps ce dossier ?

En tout cas, je n'imagine pas que l'on puisse laisser la victime face à une telle ambiguïté, en ne lui ouvrant qu'une voie extrêmement étroite pour obtenir au civil une indemnité, et en sachant qu'une somme d'argent, aussi élevée soit-elle, ne règle pas le problème de fond qui est le sien dans le procès pénal.

Il est vrai, monsieur Blanc, que pour l'avocat de la partie civile l'acquittement est quelque chose de très cruel, et je comprends que vous vouliez faire rejuger les faits.
Il ne s'agit pas pour autant de renverser les principes de notre système juridique. Il est clair que la partie civile n'a pas pour fonction de faire appliquer le droit pénal. Vous avez d'ailleurs rappelé que, si ses avocats peuvent conclure leur plaidoirie en réclamant que la culpabilité de l'accusé soit reconnue, ils se mettraient en dehors des clous s'ils réclamaient une peine, car ce n'est pas leur rôle.
On est donc assez surpris de la volonté qui s'exprime de voir la partie civile remplacer, en définitive, l'avocat général. On est encore plus étonné de constater que cette attaque émane de la partie droite de l'hémicycle. Aujourd'hui, les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme mettent le parquet suffisamment en difficulté.
C'est vrai !

Selon elle, il ne serait pas suffisamment indépendant pour être considéré comme une autorité judiciaire. Or voilà que des députés qui, en principe, le soutiennent, viennent, en défendant cet article au nom des victimes, contester le rôle du parquet, reconnu de manière indiscutable dans notre système juridique, à savoir représenter les intérêts de la société et faire appliquer le droit pénal. Ce coup bas de cette partie de l'hémicycle nous surprend. On ne s'y serait pas attendu.
De surcroît, la victime ne pourra remporter qu'une victoire à la Pyrrhus. Dans neuf cas sur dix, si un avocat général qui a soutenu une accusation en première instance pense, après un acquittement, pouvoir l'emporter en appel, il interjettera appel ; s'il ne le fait pas, c'est manifestement que les débats lui ont montré une faille dans son accusation. Il serait donc étrange que la victime contraigne le parquet à la suivre et à soutenir en appel une accusation à laquelle il ne croit pas. Ce serait d'autant plus étrange que le parquet ne dirait rien devant la juridiction d'appel et que la victime ne pourrait requérir à sa place.
Par conséquent, si la victime n'est pas satisfaite d'un verdict d'acquittement, elle peut soumettre les faits à une nouvelle juridiction, oui, mais uniquement à une juridiction civile, la question des intérêts civils étant la seule qu'elle puisse encore poser.
On comprend qu'il y puisse y avoir une difficulté en l'occurrence, et la situation est sans doute très difficile à vivre pour la victime, mais le dispositif que vous proposez ferait jouer les utilités au parquet. Il ne voudrait pas requérir en appel et tout le monde s'en ficherait ! Ce n'est pas un service à rendre à l'autorité de la justice de décider que tout le monde passera outre à l'avis de l'avocat général.
Je ne veux pas relancer le débat ; il fut de grande qualité et honore l'Assemblée nationale. Les arguments qui ont été avancés par les uns et les autres ne sont pas médiocres et méritent d'être pris en considération.
Simplement, je le redis, je ne pense pas que l'on puisse, au détour d'un amendement, changer aussi profondément notre procédure pénale. J'ajoute que les travaux sur le nouveau code de procédure pénale ne sont pas achevés et, très naturellement, je suis prêt à consacrer à ce sujet une séance de travail à la chancellerie dans le cadre de la préparation du projet de code qui vous sera soumis lors de la prochaine législature.

Monsieur Le Fur, ce n'est tout de même pas à vous que je vais expliquer que l'on demande la parole ! (Sourires.)
Il y a eu 190 acquittements, et M. Blanc, qui en annonçait 180, était très proche de la réalité. Quant au nombre d'acquittements n'ayant pas fait l'objet d'un appel du parquet, je ne vais pas vous raconter d'histoires : pour l'instant, je n'ai pas le chiffre, mais je vous le donnerai d'ici à la fin de la discussion.
Je crois avoir exprimé clairement une position claire. Je comprends que certains aient une autre position, et je suis prêt à en discuter. Cependant, très honnêtement, je ne crois pas que nous puissions accepter cet article maintenant, et je demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir voter l'amendement de suppression du Gouvernement.

J'avancerai deux nouveaux arguments en faveur de ces amendements de suppression.
Le premier tient à la loi du 5 mars 2007, qui a modifié l'article 85 du code de procédure pénale. La majorité, parmi lesquelles figurent des défenseurs des droits des victimes, a voté une disposition qui soumet la constitution de partie civile, d'une part, au dépôt préalable d'une plainte simple auprès du parquet et, d'autre part, au refus du procureur de la République d'engager les poursuite ou à l'expiration d'un délai de trois mois depuis le dépôt de la plainte. Il existe donc déjà un dispositif qui prévient l'emballement, si j'ose dire, de certaines victimes.
Deuxième argument : si, par extraordinaire, dans la quinzaine, la vingtaine ou la trentaine de cas dont il est question aujourd'hui, il y a un conflit entre le procureur et la victime, le procureur général, lui, a la possibilité de faire appel en application de l'article 380-2 du code de procédure pénale.
Il serait donc sage d'examiner toutes ces questions tranquillement pour voir si un problème se pose vraiment et, le cas échéant, envisager des solutions qui ne dénaturent pas l'organisation de notre procédure pénale.

Je suis saisie d'un amendement n° 21 rectifié .
La parole est à M. Marc Le Fur.

Il s'agit d'étendre le droit d'appel des parties civiles aux relaxes prononcées par les tribunaux correctionnels. Mais cet amendement, lui, n'a pas été adopté en commission. Le débat a eu lieu, il a été purgé, je crois qu'il était nécessaire, et je remercie les uns et les autres de leurs réponses. J'en attends les suites puisque vous avez, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, ouvert des pistes, et je retire cet amendement.
(L'amendement n°21 rectifié est retiré.)

Je suis saisie d'un amendement n° 151 .
La parole est à Mme George Pau-Langevin.

Nous sommes nous aussi sensibles au sort de la victime, et nous souhaitons qu'elle soit informée de la date d'audience devant la cour d'appel, même lorsqu'elle n'a pas elle-même interjeté appel.
(L'amendement n° 151 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 1er quinquies est adopté.)

Je suis saisie de deux amendements de suppression de l'article 2, nos 26 et 152.
La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l'amendement n° 26 .

Pour présenter cet amendement, je reviens au débat sur le champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa forme citoyenne.
Comme le remarque le Syndicat de la magistrature, la liste des infractions retenues comme relevant de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est éminemment politique. Je vous lis ses observations : « Le ministère de la justice a décidé qu'il devait s'agir de délits dits “sensibles” et “qui portent une atteinte particulièrement grave à la cohésion sociale du pays, notamment les violences, les vols avec violences, les violences conjugales habituelles et les agressions sexuelles.” En sont donc exclues, malgré les lourdes peines qu'elles font encourir à leurs auteurs, les infractions en matière de stupéfiants et relevant du domaine économique et financier. »
Si vous n'étiez pas, mes chers collègues, convaincus par l'argumentation du Syndicat de la magistrature, je vous renverrais volontiers à celle développée par le rapporteur du Sénat, Jean-René Lecerf, sénateur du Nord. Il estime que « la spécialisation sur les violences aux personnes conduit à “cibler” une catégorie de délinquants qui, le plus souvent, se recrutent au sein d'une frange particulièrement démunie de la population ». Il regrette que « d'autres formes de délinquance moins sociologiquement “marquées” [continuent] de relever des seuls magistrats professionnels ». Et il conclut ainsi son propos : « Il n'est pas sûr que ce traitement différencié contribue à rapprocher les citoyens de l'oeuvre de justice. »

La parole est à M. Dominique Raimbourg, pour soutenir l'amendement n° 152 .

Mon premier argument à l'appui de cet amendement de suppression est que l'exclusion d'un certain nombre d'infractions – je souscris entièrement aux propos de M. Dolez – est tout à fait dommageable. En quoi la délinquance astucieuse, en quoi l'escroquerie, en quoi la fraude fiscale, en quoi le travail dissimulé ne porteraient-ils pas atteinte à l'ordre social ? On se concentre à juste titre sur les violences contre les personnes, car ce sont des faits graves, mais elles sont souvent commises, effectivement, par des gens qui sont assez peu insérés ou, du moins, ne le sont pas suffisamment pour se permettre une délinquance plus astucieuse. Cette délinquance astucieuse n'en porte pas moins atteinte à l'ordre social, comme les violences.
Deuxième argument : nous avions déposé un amendement visant à étendre le champ d'application de l'article mais il a été rejeté sur le fondement de l'article 40 de la Constitution, au motif qu'il constituait une charge pour les finances publiques. Cela m'étonne, mais, quand bien même l'amendement n'a pu prospérer, l'idée demeure.
Par ailleurs, l'article 2 prévoit la participation des citoyens assesseurs aux audiences de comparution immédiate. Je crois que nous allons, ici, nous heurter à des difficultés pratiques très importantes. Prenons le tribunal correctionnel de Paris. Selon les informations qui nous ont été données au cours des auditions, une chambre spécialisée, autrefois appelée la chambre des flagrants délits, siège pendant des heures et des heures. Je ne vois pas comment les citoyens assesseurs vont réussir à s'intégrer à de telles audiences.
Enfin, selon l'article 399-13 du code de procédure pénale que tend à instaurer l'alinéa 26 de l'article 2, les assesseurs citoyens statueront sur les circonstances aggravantes. Cela veut dire qu'on va leur demander de qualifier les faits et, en fonction de cette qualification, ils participeront ou ne participeront pas au jugement de l'affaire.
Pour que les choses soient claires, imaginons un instant que, mû par une impulsion néfaste, je porte des coups à quelqu'un que je n'aime pas alors que j'ai un couteau dans ma poche. Je suis poursuivi pour violences avec arme, mais je fais valoir que le couteau est resté dans ma poche. Cette question de qualification juridique des faits est tranchée par les citoyens assesseurs qui, s'ils retiennent la circonstance aggravante, vont s'exclure du jugement. C'est leur demander bien des efforts que de les faire venir pour leur dire qu'ils ne vont finalement pas juger.
Il y a là toute une série de difficultés pratiques qui me semblent difficilement surmontables.

Défavorable.
Ces amendements tendent à supprimer la définition de la compétence du tribunal correctionnel en formation citoyenne. Nous avons abondamment débattu de ce point dans la discussion générale. Nous avons pour notre part expliqué que nous avions choisi les atteintes aux personnes et qu'un certain nombre d'autres délits avaient été envisagés. Le Sénat avait ajouté les atteintes à l'environnement, mais la commission des lois les a exclues, car nombre de ces délits sont complexes et les instances durent alors très longtemps. J'ai pris l'exemple du fameux procès de l'Erika, qui avait duré six mois. Or, dans le texte initial, on demandait aux citoyens assesseurs un service de huit jours, que la commission des lois a porté à dix jours.
Pour ces raisons, la commission a considéré que l'arbitrage que nous avions fait en limitant le champ de compétence aux atteintes aux personnes, qu'elles soient volontaires, comme le prévoit le texte initial, ou involontaires, comme l'a ajouté le Sénat, était le bon étiage pour les tribunaux correctionnels en formation citoyenne.
Défavorable.
Quelques mots pour répondre aux orateurs qui proposent de supprimer la définition ratione materiae de la compétence de ce nouveau tribunal correctionnel.
J'avoue avoir eu quelque peine à suivre le raisonnement de M. Raimbourg. D'habitude, j'y parviens assez bien, sans être forcément d'accord ; en l'occurrence, je n'y suis pas parvenu. M. Raimbourg nous a expliqué qu'il était tout à fait contre ce nouveau tribunal correctionnel. Maintenant, il nous dit qu'il est tout à fait contre le fait qu'on limite sa compétence…
… et qu'il faudrait, au contraire, lui donner une compétence générale et absolue. (Interruptions sur les bancs du groupe SRC.)
Attendez ! J'ai tout de même le droit d'expliquer la difficulté que j'ai à comprendre M. Raimbourg !
Je vais lui expliquer la position du Gouvernement, qui est très simple : ce n'est pas une position dogmatique.
Cela vous change peut-être, monsieur Dray, mais c'est ainsi, et il faudra vous y faire !
Nous allons d'abord expérimenter, pour voir si tout marche bien. Il ne s'agit pas de casser le système judiciaire, mais de l'améliorer et d'installer durablement le citoyen dans le jugement des délits.
C'est un premier pas. Deux cours d'appel seront choisies. Une compétence ratione materiae est définie. Peut-être, dans cinq ou dix ans, étendrons-nous cette compétence et peut-être, un jour, n'y aura-t-il plus qu'un seul tribunal correctionnel. Alors, même si nous ne sommes plus ici, nous serons contents – je parle pour moi, pas pour vous, bien sûr – d'avoir lancé cette nouvelle conception de la juridiction pénale.
Quoi qu'il en soit, monsieur Raimbourg, je n'ai pas bien compris votre argumentation. C'est pourquoi je suis hostile à votre amendement.

Monsieur le garde des sceaux, mes collègues ont été gentils avec vous, et même sympathiques. Car, franchement – Marc Dolez comprendra ce que je vais dire –, nous sommes au coeur de ce que l'on appelle une justice de classe. C'est le terme exact : une justice de classe !
Vous nous faites un véritable cours pour démontrer qu'il faut aujourd'hui associer les citoyens à la justice pénale. Puis, nous avons droit à un cours d'une heure et quart sur les droits des victimes. Pour finir, vous dites brusquement que le peuple peut juger certaines affaires, mais pas toutes. Et comme par hasard, les affaires qu'il ne peut pas juger, ce sont les délits financiers. Le peuple, en l'occurrence, n'est pas apte à les juger ! Voilà ce que vous êtes en train de faire, avec toutes vos formules alambiquées !

Monsieur le rapporteur, vous pouvez toujours vous exclamer, mais la vérité, c'est que vous ne voulez pas que la justice citoyenne puisse juger les délits financiers.

Cela veut dire qu'en matière de délits, vous considérez qu'il y a les atteintes à la personne, les violences, sur lesquelles il faut chauffer à mort parce que c'est votre marque de fabrique depuis neuf ans.

Mais tout ce qui est de l'ordre de la plus grande injustice aujourd'hui, comme la fraude fiscale des plus puissants, le peuple n'aura pas le droit d'en juger. Il vaut mieux selon vous que cela s'arrange dans le cadre d'autres procédures. Voilà la réalité de ce que vous proposez !
Dans les semaines et les mois à venir, nous rappellerons ce qu'est la vraie nature de ce gouvernement : un gouvernement au service des puissants qui, lorsqu'il fait appel au peuple, ne lui laisse qu'une marge de manoeuvre très étroite et ne veut surtout pas que l'on puisse s'attaquer aux puissants qui fraudent en matière financière !
Monsieur Dray, ce n'est guère le moment !
Je vous ai écouté gentiment. Cela étant, je rappelle à l'Assemblée nationale que, cette année, le Gouvernement a mené la lutte contre la fraude fiscale, laquelle a rapporté 16 milliards d'euros, soit deux fois le budget de la justice. Personnellement, j'en suis très heureux et j'espère que la justice en bénéficiera un peu. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Je signale au Gouvernement que les interrogations sur le périmètre retenu pour les jugements en formation citoyenne ne sont pas le seul fait de l'opposition. Le Sénat a largement modifié le texte en préconisant, si l'on visait un certain type de délit, d'aller plus loin et de couvrir tous les délits susceptibles d'avoir la même gravité. Le Sénat, qui n'est pas, me semble-t-il, un repaire de gauchistes, a lui aussi estimé qu'il n'y avait pas de raison que les délits portant une atteinte grave à l'ordre public, comme les délits concernant l'environnement, ne fassent partie de ceux devant être soumis au tribunal que vous êtes en train de créer.
Quand nous nous étonnons de ne pas voir figurer dans cette liste certains délits graves comme le travail dissimulé, la fraude fiscale, les escroqueries ou le blanchiment, nous ne faisons que poser des questions raisonnables. Et ce n'est pas en nous renvoyant dans les cordes que vous réglerez le problème.
Le rapporteur explique que votre choix s'est porté sur des délits qui seraient jugés rapidement, parce que les assesseurs citoyens ne pourront pas être présents plus de dix jours. Or, en matière d'homicide involontaire par exemple, il peut y avoir une cascade de responsabilités et la procédure, de ce fait, dure plusieurs mois. Dans ce cas, vous ne nous avez pas expliqué comment ce fameux tribunal, avec des assesseurs citoyens siégeant dix jours, pourra délibérer pendant des mois…
En réalité, vous avez voulu viser les délits reprochés aux enfants des classes populaires plutôt que ceux reprochés aux cols blancs. Cela crève les yeux ! Et le peuple, que vous entendez associer à ces tribunaux, se rendra bien compte que vous lui interdisez de juger certaines personnes.

Nous sommes en effet au coeur d'un débat important. Les choses sont simples, monsieur le garde des sceaux : soit M. Dray se trompe…

…et l'intention du Gouvernement n'est pas d'avoir une justice de classe ; soit M. Dray a raison…

…et, pour dissiper tout malentendu, puisque votre intention n'est pas celle qu'il vous prête, il suffit d'étendre le périmètre du dispositif pour lui donner satisfaction et montrer votre bonne foi.
C'est ce que je demandais dans mon intervention liminaire. Pourquoi prétendre vouloir rapprocher les citoyens de leur justice si vous ne le faites que partiellement ? Il faut les en rapprocher davantage, les associer à l'ensemble du périmètre. C'est facile à faire : il suffit que vous le vouliez. Si vous ne le voulez pas, ce sera un aveu !
(Les amendements identiques nos 26 et 152 ne sont pas adoptés.)

Prochaine séance, jeudi 23 juin à neuf heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 23 juin 2011, à une heure dix.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma