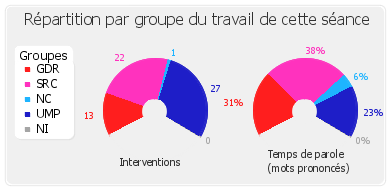Séance en hémicycle du 6 mai 2008 à 21h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heure trente.)

Monsieur le président, monsieur le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, mesdames et messieurs les députés, le texte qui vous est soumis aujourd'hui aborde une question importante pour notre droit : celle de la prescription civile. Cette proposition de loi, déposée au Sénat par le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, est une excellente initiative que le Gouvernement soutient pleinement.
Le droit de la prescription doit en effet être réformé : vous l'avez fort bien mis en évidence, monsieur le député Émile Blessig, dans votre rapport. J'ai senti parler toute l'expérience de l'avocat et du juriste de qualité que vous êtes.
La prescription est fondée sur un motif d'ordre public et de paix sociale. Elle répond à un impératif de sécurité juridique : le titulaire d'un droit, resté trop longtemps inactif, est censé y avoir renoncé.
Fixé il y a plus de deux siècles par le code civil, en 1804, le délai de prescription est en principe de trente ans. Dans certains cas, le législateur l'a ramené à dix ans : ainsi pour les actions en responsabilité civile non contractuelles comme les accidents de circulation. Qui plus est, de nombreux délais particuliers ont été instaurés au fil des ans. Au total, on dénombre aujourd'hui plus de 250 délais légaux dont la durée varie d'un mois à trente ans.
À ce foisonnement s'ajoutent des règles d'interruption ou de suspension des délais de prescription extrêmement complexes. Cette multiplicité des délais a abouti à un système qui a perdu sa cohérence. Nous sommes désormais face à un paradoxe : la prescription doit répondre à un souci de sécurité juridique, mais les dispositions actuelles, parce que trop nombreuses, sont source d'insécurité juridique.
Chacun le reconnaît, le droit commun de la prescription est aujourd'hui inadapté. Non seulement l'absence de lisibilité est pour nos concitoyens facteur de confusion, mais surtout, cette complexité nuit à l'attractivité de notre droit et particulièrement à notre attractivité économique. Notre régime de prescription est isolé en Europe : en Allemagne, le délai est de trois ans, en Angleterre et au Pays de Galles, de six ans.
Il est donc nécessaire de procéder à une remise à plat d'ensemble du droit commun de la prescription. Il faut le simplifier et le moderniser.
Cette réforme aussi ambitieuse que profonde procède d'une volonté commune, tant des professionnels du droit que des opérateurs économiques. Elle résulte d'un rapport rédigé par la Cour de cassation en 2004, qui suggérait de faire passer le droit commun de la prescription de trente à dix ans. Elle fait également suite aux travaux du groupe de travail animé par le professeur Pierre Catala en 2005, qui proposait de le ramener à trois ans. Elle est construite autour de deux axes : d'une part, la réduction et l'unification des délais ; d'autre part, la clarification du régime de la prescription.
La proposition de loi fixe le délai de droit commun de la prescription à cinq ans ; l'actuel délai de trente ans est à l'évidence devenu beaucoup trop long. Comment agir en justice trente ans après les faits ? Quelles preuves apporter ? Quelles chances a-t-on de voir ses demandes aboutir ? C'est une très grande insécurité pour le défendeur. Quelles pièces faut-t-il garder pendant tout ce temps ? On ne peut pas exiger qu'une personne conserve durant trente ans des justificatifs de paiement. Cela dépasse le raisonnable.
Le délai de prescription fixé en 1804 correspondait aux contraintes de l'époque. L'accès au droit et à l'information juridique était moins aisé. Aujourd'hui, l'accès à l'information juridique est très largement facilité. Une personne qui recherche des informations sur les possibilités d'action en justice peut y accéder grâce à Internet, à l'organisation de consultations juridiques dans de nombreux lieux, et à l'action des associations. Tout un chacun peut désormais obtenir rapidement et gratuitement des informations sur ses droits. Il ne faut pas non plus oublier l'action des professions juridiques et judiciaires, avocats, notaires ou huissiers.
La proposition de loi tire les conséquences de ces évolutions en instaurant un délai de prescription de cinq ans. Ce délai est respectueux des droits de chacun : il est suffisant pour permettre à un créancier d'exercer une action ; il garantit également une meilleure stabilité du patrimoine car il écarte toute action tardive. Il est également compatible avec les délais de conservation des archives par les sociétés, comme pour les avocats. Elles n'auront plus à conserver leurs pièces pendant trente ans, ce qui présente un intérêt financier non négligeable. Le texte s'inscrit à cet égard dans le mouvement choisi par nos voisins européens ; il nous replace au coeur du dynamisme juridique, il facilitera la vie économique de nos entreprises, qui gagneront en compétitivité.
La proposition de loi répond aussi à une volonté d'unification et de simplification du droit. La situation actuelle est en effet profondément injuste. Entre autres exemples d'incohérence, la victime d'un accident liée par contrat à son responsable a trente ans pour agir contre lui ; mais en l'absence de contrat, elle ne dispose plus que d'un délai de dix ans pour demander réparation… Ainsi, dans le cas d'un accident résultant de l'imprudence d'un chauffeur de car, les passagers ont trente ans pour agir, alors que le conducteur de la voiture percutée, lui, n'a droit qu'à dix ans ! Autrement dit, deux personnes ayant subi le même dommage ne bénéficient pas des mêmes droits. Après l'adoption de la proposition de loi, un seul et même délai leur sera applicable. De surcroît, sur proposition de votre rapporteur, l'aggravation de l'état de la victime pourra ouvrir un nouveau délai pour agir.
Le délai commun de cinq ans connaîtra cependant quelques dérogations correspondant à des situations particulières. C'est le cas pour les actions concernant l'état des personnes, notamment en matière de filiation.
Une autre exception est, à mes yeux, particulièrement importante : celle qui s'applique aux victimes mineures d'actes de torture ou de barbarie ainsi que de violences ou d'agression sexuelles. La règle fixant un délai de vingt ans pour leurs actions en responsabilité civile est maintenue. Certains se sont interrogés sur l'opportunité de le porter à trente ans ; je crois raisonnable de nous en tenir à un délai de vingt ans en cette matière.
Cette dérogation au principe d'unité des délais de prescription me paraît tout à fait justifiée. Elle tient compte de l'extrême gravité des faits subis et de la vulnérabilité des victimes.
Votre rapporteur vous proposera également, à juste titre, une dérogation en matière de droit de la construction, qui consolide les acquis de la jurisprudence.
Je tiens enfin à revenir sur les incidences de la présente réforme en matière de lutte contre les discriminations salariales. Après l'adoption de la proposition de loi par le Sénat, certains syndicats, mais également la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, ont fait part de leurs inquiétudes. Ils craignent que la suppression du délai trentenaire ne restreigne l'indemnisation des victimes. Ils redoutent que les victimes de discrimination ne soient plus indemnisées que pour le préjudice subi pendant les cinq dernières années.
J'ai fait, vous le savez, de la lutte contre les discriminations une de mes priorités. Il n'a jamais été dans l'intention du Gouvernement de restreindre le droit à indemnisation. Ce n'est pas non plus la volonté des rédacteurs de la proposition de loi. C'est précisément pour dissiper tout malentendu qu'un amendement proposé par MM. les sénateurs Hyest et Béteille a été adopté, le 9 avril dernier, par le Sénat lors de l'examen du projet de loi portant sur les luttes contre les discriminations. Il précise que les dommages et intérêts alloués à la victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice subi, pendant toute sa durée. Aujourd'hui, votre rapporteur vous suggère de reprendre ce dispositif. Le texte actuel me paraît en effet plus approprié.
Le deuxième axe de la réforme concerne la simplification du régime applicable à la prescription. Comme l'a rappelé votre rapporteur, Émile Blessing, les règles qui régissent la prescription sont particulièrement complexes. Une simplification et une adaptation sont donc nécessaires.
La simplification passe par la refonte du titre XX du livre troisième du code civil. Il faut favoriser la lisibilité du texte et faciliter l'usage de cet outil afin de le rendre accessible à tout un chacun.
La simplification impose également d'énoncer clairement les causes d'interruption ou de suspension de la prescription. C'est le cas dans le texte qui vous est soumis. Il énonce de nouvelles règles qui prennent en compte les modes alternatifs de règlement des conflits et les évolutions communautaires. Le recours à la conciliation ou à la médiation suspendra le cours de la prescription. Il sera donc possible de prendre le temps de dégager une solution amiable sans perdre ses droits à agir en justice. Les créanciers ne seront plus contraints d'assigner : ils pourront d'abord engager des pourparlers, avec la garantie apportée par la présence d'un tiers, ce qui favorisera le règlement amiable des litiges.
Enfin, les règles obsolètes et sources d'insécurité juridique seront supprimées. C'est le cas notamment de certaines règles en matière de prescription immobilière. Aujourd'hui, si le propriétaire d'un immeuble est de bonne foi, la prescription peut varier de dix ans à vingt ans selon son lieu de domiciliation. Si la distance pouvait être un obstacle à l'information au début du XXe siècle, elle ne l'est plus aujourd'hui : cette distinction n'a plus lieu d'être. La proposition de loi fixe désormais un délai unique de dix ans.
Comme vous le voyez, cette proposition de loi simplifie et modernise considérablement le droit de la prescription. J'y suis donc très favorable.
Elle répond aux attentes des Français qui souhaitent un droit plus accessible. Elle répond aussi aux attentes exprimées par nos entreprises. Elle constitue la première étape de la modernisation de notre droit des obligations. C'est pour cela qu'elle recueille le soutien du Gouvernement.
La modernisation de notre droit se poursuivra par la réforme du droit des contrats, puis par une refonte du droit de la responsabilité délictuelle. Je sais que votre assemblée partage cette volonté de moderniser notre droit et de le simplifier.
Grâce au travail de la commission des lois et de son président Jean-Luc Warsmann, elle a été à l'origine d'importantes réformes. L'occasion vous est donnée aujourd'hui de poursuivre cette action bénéfique. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

La parole est à M. Émile Blessig, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise a été adoptée par le Sénat en première lecture le 21 novembre dernier. Elle trouve son origine dans la réflexion conduite dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, rédigé sous la direction de M. Pierre Catala, et dans les travaux de la mission d'information de commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, présidée par M. Jean-Jacques Hyest.
Cette réforme attendue – Mme la garde des sceaux nous l'a rappelé – repose sur trois axes principaux : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive ; la simplification de leur décompte ; enfin, l'autorisation encadrée de leur aménagement contractuel. Ses mesures les plus importantes à mes yeux sont le raccourcissement du délai de droit commun de trente ans à cinq ans et l'institution d'un délai butoir de vingt ans, corollaire de la définition d'un point de départ glissant pour la prescription.
Rappelons enfin que la proposition de loi a été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat, seul le groupe CRC s'étant abstenu. En tant que rapporteur je concentrerai mon propos sur les quelques points qui ont donné lieu à des discussions plus approfondies en commission.
Les principales inquiétudes ont porté sur la question de la prescription de l'action en réparation de la discrimination en droit du travail. La discrimination au sein d'une entreprise se traduit le plus souvent par une perte de salaire. Or, en la matière, il y a concurrence entre deux règles de prescription : pour ce concerne le paiement des salaires, la prescription est quinquennale, comme le précisent les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; pour ce qui concerne la discrimination au travail, définie dans le code du travail, la prescription est soumise à un délai de trente ans. La Cour de cassation, saisie sur cette question, a renoncé à isoler la question de la réparation de la perte de salaire : « l'action en réparation du préjudice résultant [de la] discrimination se prescrit par trente ans ».
Or le texte prévoyait initialement de ramener à cinq ans le délai de droit commun de la prescription. Confronté à de multiples interrogations, le Sénat a proposé un amendement particulièrement intéressant. Il prévoit, d'une part, que les dommages et intérêts « réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » – point extrêmement important –, et, d'autre part, que l'action en réparation du préjudice né de la discrimination court à compter de la révélation de la discrimination.
Le terme de « révélation » appelle toutefois des précisions car il n'a pas fait taire toutes les inquiétudes. La doctrine définit la révélation comme la « connaissance du manquement et du préjudice en résultant ». Il faut savoir que la discrimination est très difficile à établir car elle est rarement imputable à un élément unique. Elle est, au contraire, le résultat d'une série de décisions qui s'étalent dans le temps. En outre, l'action en réparation est le plus souvent engagée lorsque le salarié a quitté l'entreprise. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2007, a fait de la révélation de la discrimination le point de départ de ce délai. La révélation n'est donc pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié : elle correspond au moment où il dispose de tous les éléments de comparaison lui permettant de mettre en évidence la discrimination. En l'absence de ces éléments, la discrimination n'est pas considérée comme étant révélée ; par conséquent, la prescription ne court pas.
Cet amendement est donc particulièrement favorable aux salariés et contribue à la lutte contre la discrimination au travail en général. Il garantit la réparation intégrale du dommage né de la discrimination, quelle qu'en soit la durée – à la limite, la durée peut être supérieure à trente ans. D'autre part, il permet au salarié, grâce à la définition du point de départ que je viens d'évoquer, d'agir seulement quand il dispose des éléments probants à l'appui de sa demande. Compte tenu de cet encadrement, la réduction de trente ans à cinq ans du délai de prescription ne nuira pas aux capacités d'action des salariés.
D'autres points ont fait débat en commission. Un amendement socialiste prévoyant de fixer le délai de prescription de droit commun à dix ans au lieu de cinq ans a été rejeté. Il en est allé de même pour un autre amendement du même groupe tendant à supprimer le délai butoir. Nous avons également repoussé un amendement visant à rétablir un point de départ en cas de vice de consentement dans un mariage – nous en reparlerons lors de la discussion des articles. Autre point de discussion – qui ne doit pas nous entraîner trop loin : la suppression du second alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, qui dispose que la remise d'un bulletin de paye ne vaut pas arrêté de comptes. L'amendement adopté cet après-midi en commission sera, je l'espère, de nature à apaiser les inquiétudes des uns et des autres et à dissiper toute ambiguïté.
Pour finir, j'insisterai sur le fait que ce texte, d'apparence très technique, concerne beaucoup de nos concitoyens dans leur vie quotidienne, nous le verrons lors de l'examen des amendements et des divers problèmes qu'ils soulèvent. La prescription permet par ailleurs de sécuriser et de simplifier notre système juridique. Nous ne pouvons plus, au XXIe siècle, nous fonder sur des délais établis il y a deux siècles, d'autant que, comme l'a rappelé Mme la garde des sceaux, il en existe plus de 250, variant de un mois à trente ans. C'est la raison pour laquelle la commission a adopté ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

J'ai reçu de M. Jean-Claude Sandrier et des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine une question préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.
La parole est à M. Michel Vaxès.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, sous le couvert de rendre plus cohérentes les règles de prescription civile, la proposition de loi dont nous entamons aujourd'hui l'examen soulève, malgré les explications apportées par Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur, de graves interrogations quant à ses incidences prévisibles sur les délais pour agir et le droit à réparation des victimes des discriminations visées par l'article L. 122-45 du code du travail, telles que les discriminations entre hommes et femmes ou les discriminations liées à l'origine ethnique, à l'âge, au handicap ou à l'appartenance syndicale.
Je tenterai, dans la suite de mon propos, de préciser les dangers que présente une réforme susceptible à nos yeux de réduire à néant tout l'édifice jurisprudentiel relatif à la discrimination. J'essaierai également d'expliquer les raisons pour lesquelles nous jugeons nécessaire de surseoir à l'examen de ce texte, à moins que vous ne vous engagiez clairement à apporter des modifications substantielles à la rédaction du nouvel article 2224 du code civil. Et je dois vous dire, monsieur le rapporteur, que ce ne sont pas celles proposées dans l'amendement adopté par la commission qui sont de nature à nous rassurer.
Il y a un peu plus d'un mois, lors de l'examen du texte relatif au droit communautaire et à la lutte contre les discriminations, nous avions déjà demandé, pour les mêmes raisons, que ce texte d'initiative sénatoriale ne soit pas inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée. Nous n'avons pas été entendus, de sorte que nous nous trouvons aujourd'hui devant un texte qui fixe la durée de prescription de droit commun à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières contre trente ans actuellement, nouveau délai qui s'appliquera également aux relations entre les salariés et les employeurs régies par le code du travail.
Permettez-moi de revenir plus précisément sur les différentes incidences qu'aura cette nouvelle rédaction sur le contentieux du droit du travail. Le contentieux social présente, nous le savons, des spécificités : le salarié, placé sous l'autorité de son employeur, attend le plus souvent, sans doute par crainte, d'avoir quitté l'entreprise pour agir en justice, d'où l'intérêt d'une longue prescription.
Dans un certain nombre de cas, comme la discrimination ou le harcèlement moral, il s'agit pour la victime de faire reconnaître des actes qui s'inscrivent dans un processus qui, par définition, se déroule dans le temps.
Dans les rapports de travail, il est fréquent que la discrimination, quelle qu'en soit la cause, se manifeste, par exemple, par une moindre évolution de carrière. Ses effets se mesureront nécessairement sur une longue période. Un certain recul est donc nécessaire pour examiner et caractériser l'inégalité de traitement.
Elle se répare aussi en prenant en compte les conséquences que cette discrimination a eu dans le temps. Cette réparation peut être obtenue soit devant les tribunaux, soit dans des négociations avec l'employeur.
Il arrive aussi que l'illicéité se révèle longtemps après la commission de l'acte ou l'apparition de la situation illicite. Je pense, par exemple, à la non-cotisation par l'employeur à l'organisme de retraite révélée au moment de la liquidation des droits, ou encore à toutes les créances soldées au moment de la rupture et dont les éventuelles irrégularités ne se révèlent qu'à ce moment-là.
À l'évidence, ce nouveau délai de cinq ans ne sera pas suffisant pour caractériser la discrimination et pour réparer la situation de discrimination. Cinq années sont bien trop courtes pour mesurer, par exemple, le ralentissement de carrière d'un salarié. Elles ne suffisent pas non plus à rendre compte de l'ampleur des préjudices.
La prescription trentenaire permet, en revanche, d'avoir connaissance effective de tous les éléments permettant d'établir qu'il a été victime d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement et de déterminer, au plus juste, la complète réparation du préjudice subi, grâce notamment à la méthode de François Clerc, validée par quinze années d'expérience, utilisée par les juridictions et les négociateurs dans les entreprises et préconisée par les directions des ressources humaines.
La prescription quinquennale prévue par le texte, causera donc un préjudice considérable aux victimes de discrimination, qu'elle soit syndicale, sexuelle, religieuse ou raciale, qu'elle soit due à un handicap, à un état de santé ou à une orientation sexuelle. Les plus faibles, ceux qui ont besoin du droit pour se protéger, seront injustement traités par ce nouveau délai de prescription.
Pourtant, la lutte contre les discriminations a été présentée par le Président de la République comme l'une de ses priorités. Avec l'adoption de ce nouveau délai de prescription, toutes les déclarations politiques volontaristes contre les discriminations seraient réduites à un affichage sans effet, ce qui est un comble un mois à peine après l'adoption d'un texte qui entendait parachever la transposition de la directive 200078 et alors que le Gouvernement continue de prétendre faire de la lutte contre les discriminations l'un de ses principaux chevaux de bataille.
Au-delà d'une remise en cause en profondeur de la politique de lutte contre les discriminations, ce nouvel article du code civil sera également incompatible avec la norme européenne.
La directive européenne du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, énonce deux principes essentiels qui se trouveraient remis en cause si la prescription quinquennale devait être adoptée. Le premier pose que la réparation accordée en cas de violation du principe de l'égalité doit être suffisante au regard du préjudice subi. Le second dispose que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Avec une prescription de cinq ans, la réparation ne sera pas suffisante au regard du préjudice et les sanctions ne seront ni proportionnées, ni dissuasives : plus la prescription est brève, moins la dissuasion est grande.
Du reste, ce nouvel article 2224 pose problème quant à la durée du délai, mais aussi quant au point de départ de la prescription : il prévoit en effet que le délai court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits ». La référence à la révélation ne me paraît pas plus précise que ces éléments-là. Il conviendra alors de rechercher la date à laquelle le fait a été connu du salarié ou révélé au salarié ou la date à laquelle il aurait dû le connaître.
Concrètement que faut-il entendre par « aurait dû connaître » ? Nul doute qu'il posera des problèmes d'interprétation juridique considérables aux magistrats. Devront-ils s'en remettre à une appréciation objective en se mettant dans la peau d'un salarié moyen ou à une appréciation subjective qui se référera au salarié en cause ?
Qui plus est, ce point de départ de la prescription nie l'inégalité des parties face à la preuve. Comparé à un employeur, un salarié n'a pas les mêmes moyens de collecte et d'analyse des éléments de faits qui révèlent une illégalité.
Enfin, la discrimination dans la carrière, la non-déclaration d'un salarié ou encore, par exemple, un processus progressif de harcèlement, sont des faits qui, par nature, sont opaques. Comment pourra-t-on fixer la date connue des faits par le salarié ou encore celle qu'il aurait dû connaître ?
Ces seules incertitudes juridiques devraient suffire à nous dissuader d'adopter cet article en l'état, au-delà même d'un souci de défense des salariés qui, malheureusement, ne semble pas être une priorité pour tous ici.
Naïvement, lorsque j'ai pris connaissance de ce texte, j'ai pensé que c'était bien involontairement que le droit du travail n'avait pas été abordé lors des débats au Sénat. Alerté par des syndicalistes et des avocats spécialisés sur les questions de discriminations, j'avoue que, sans eux, je n'aurais sûrement pas fait le lien entre ce nouvel article du code civil et le droit du travail. Je reste d'ailleurs persuadé que bon nombre de sénateurs auraient voté contre ce texte s'ils avaient établi ce lien. Je le sais en tout cas avec certitude pour ma famille politique.
Cette bonne foi n'est pas forcément partagée. Depuis la fin des années 1990, les syndicats ont trouvé les moyens de faire reconnaître et de faire indemniser efficacement les discriminations subies dans les entreprises. La charge de la preuve a été aménagée, de sorte que ce n'est plus au salarié de prouver qu'il est discriminé, mais à l'employeur de prouver que le salarié a eu une médiocre évolution de carrière pour une raison qui n'a rien à voir avec son engagement syndical, son origine, son sexe ou son orientation sexuelle.
Les organisations patronales se sont émues de cette nouvelle donne. Elles ont réclamé et soutiennent la réforme qui nous est soumise aujourd'hui, en tout cas sur ce point.
La volonté de réduire la prescription applicable aux discriminations n'est d'ailleurs pas nouvelle ; en témoigne la proposition de loi déposée par notre ancien collègue Jacques Godfrain, député de la majorité UMP sous la précédente législature.
Celui-ci écrivait alors, sans se cacher derrière d'autres arguments juridiques, que « la durée de cette prescription est excessive pour des raisons d'ordre public et de sécurité juridique. Il est nécessaire d'empêcher des procès difficiles à juger ou inopportuns par suite du temps écoulé, alors que, par ailleurs, l'inaction prolongée du salarié constitue une négligence grave. Ainsi, il est anormal que des salariés puissent attendre vingt ans avant de réclamer réparation en justice, sans jamais s'être plaints d'une quelconque discrimination illicite au cours de cette période, et demandent, du fait du long temps écoulé, le paiement de lourdes indemnités qui, cumulées, mettent en danger la situation financière de l'entreprise ».
Je me suis permis de reprendre cette longue citation car elle éclaire, sans aucun doute possible, la volonté de son auteur et, par ricochet, de celles et ceux qui voteraient l'article 2224 en l'état.
S'il met en doute la bonne foi des salariés, permettez qu'à mon tour je puisse mettre en doute celle du Gouvernement, qui a préféré garder le silence sur l'impact de cette nouvelle prescription quinquennale sur le droit du travail et sur la lutte contre les discriminations.
D'ailleurs, le rapport Virville, remis en 2004 au Gouvernement, qui plaidait pour « un droit du travail plus efficace », était lui aussi très clair sur la question des prescriptions : il déplorait « la longueur du délai dans lequel il est possible d'engager une action » pour obtenir des dommages et intérêts, et préconisait de réduire le délai de prescription au nom de la sécurité juridique…
Dans ces conditions, je ne peux pas penser que, lorsque le texte est venu en discussion au Sénat, le Gouvernement ait ignoré les problèmes qu'il posait et que vous avez soulignés en matière de droit du travail.
Nous sommes donc bien là face à une revendication du monde patronal qui n'est pas nouvelle et qui ne pouvait, en aucun cas, être ignorée du Gouvernement. Pourquoi avoir fait silence sur ce point lors de l'examen du texte au Sénat, sinon dans l'objectif implicite d'en soutenir l'opportunité ?
Pour ce qui nous concerne, et en pleine connaissance des enjeux du débat, nous refuserons de voter cette proposition de loi en l'état.
Nous estimons, en effet, que limiter ou fragiliser le droit d'agir en justice du salarié, comme c'est également le cas dans le texte de modernisation du marché du travail s'agissant de la contestation des sommes dues par l'employeur après un licenciement, c'est effacer la responsabilité des employeurs quant à leurs actes illicites et c'est à l'évidence vouloir normaliser le droit du plus fort.
Faisant référence à l'opposition doctrinale entre « substantialistes » et « processualistes » de la prescription, vous soulignez, monsieur le rapporteur, que l'opposition entre prescription du droit et prescription de l'action demeure dans certaines espèces. C'est notamment le cas pour l'action en réparation du préjudice lié à la discrimination en droit du travail.
Dans le cas, poursuivez-vous, d'une discrimination dans le cadre du contrat de travail, la perte de salaire est aujourd'hui prise en compte sur une durée pouvant aller jusqu'à la durée de prescription de droit commun, soit trente ans.
En ramenant cette durée à cinq ans, la proposition de loi risque de conduire à ce que la perte de salaire des salariés victimes de discriminations ne soit plus prise en compte que pendant cinq ans.
Monsieur le rapporteur, pour minimiser ce risque...

..vous soulignez l'importance que revêt le point de départ de l'action du salarié et l'interprétation qu'en fait la Chancellerie, tout en reconnaissant qu'il existe un risque quant à l'interprétation qu'en font les juridictions et que la question de l'ampleur de la réparation du préjudice paraît encore plus incertaine. Et renvoyer au débat doctrinal, revient à laisser à telle ou telle instance le soin de décider, le soin de décider, en fonction de sa propre doctrine, du sort qui sera fait à la demande du salarié. Avouez que cela fait beaucoup d'incertitudes !
L'amendement du président de la commission des lois du Sénat sur les dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des discriminations vient, fort à propos, tenter de les lever. Malheureusement, et vous le dites vous-même, monsieur le rapporteur, il ne fait pas taire celles liées à la prescription de l'action pour la bonne raison qu'en de nombreux cas il est très difficile de déterminer le fait générateur, détermination qui demeurera, selon nous, d'une terrible complexité. Du coup, elle fragilise la notion de révélation. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mars 2007 ne suffit pas à nous rassurer.
C'est pourquoi pour reconsidérer notre appréciation de ce texte, il faudrait aujourd'hui que le Gouvernement et la majorité nous fassent des propositions suffisantes. C'est le seul point qui pose problème parce que nous sommes d'accord sur la nécessité d'harmoniser ces prescriptions.
La première solution, réponse de bon sens, serait d'exclure explicitement du dispositif les relations contractuelles régies par le droit du travail. Chacun s'accorde à reconnaître que cela ne changerait rien par rapport à l'ancienne règle. Si cela ne change rien, ne changeons pas le texte ! À tout le moins, il faudrait inscrire dans la loi que l'action en réparation, si elle doit être prescrite au bout de cinq ans, le soit à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments et, par ailleurs, que la totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation.
À défaut de réponses positives aux inquiétudes que nous exprimons, avec d'autres, nous jugerions dès à présent inutile de passer à l'examen des articles.

J'ai déjà abordé en partie cet aspect des choses lors de mon intervention et nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la discussion des amendements. Je puis déjà dire qu'il y a dans le texte, tel que modifié par la commission, matière à rassurer les inquiétudes de M. Vaxès. C'est pourquoi je propose de repousser la question préalable.

Dans les explications de vote sur la question préalable, la parole est à M. Alain Vidalies.

La question préalable déposée par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine et défendue par M. Vaxès soulève un point qui nous préoccupe particulièrement : les conséquences de ce texte en matière de lutte contre les discriminations. Depuis plusieurs semaines, le groupe socialiste multiplie les initiatives à ce sujet et se bat en commission afin d'y remédier. Les arguments qui viennent d'être développés rejoignant nos propres préoccupations, nous voterons la question préalable.

La parole est à M. Charles de La Verpillière, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe de l'Union pour un mouvement populaire appelle l'Assemblée à repousser l'agression,… (Rires.)

…pardon, la question préalable qui vient d'être défendue par M. Vaxès. En effet, il nous semble, comme M. le rapporteur l'a expliqué, que la présente proposition de loi ne porte aucunement atteinte à l'action et au droit à réparation des salariés victimes de discriminations au travail, compte tenu des dispositions ajoutées à l'article 8 par l'amendement n° 13 de notre rapporteur. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

La parole est à Mme Martine Billard, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Je souhaite attirer l'attention de mes collègues sur les conséquences de ce texte en matière de droit du travail, puisqu'il s'agit de ce qui pose le plus problème. Je vous rappelle que le Gouvernement s'était engagé – et c'est d'ailleurs prescrit par la loi de modernisation du dialogue social que nous avons votée – à ce que les partenaires sociaux fussent consultés avant toute modification du droit du travail. Or ce texte provoque une modification de fait et, que je sache, les partenaires sociaux n'ont pas été consultés ; la preuve, c'est qu'il a fallu qu'ils montent au créneau pour obtenir une clarification. J'ai bien entendu notre rapporteur expliquer qu'il s'agissait d'un texte de portée générale sur les questions de droit civil, sans idée préconçue ni visée particulière s'agissant du droit du travail ; malheureusement, comme Michel Vaxès l'a rappelé, certains précédents sont de nature à nous rendre quelque peu méfiants… Le fait qu'en dépit des engagements du Gouvernement, les partenaires sociaux n'aient pas été consultés nous interpelle. Il suffit à lui seul à justifier le vote de la question préalable.

Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n'est pas adoptée.)

Dans la discussion générale, la parole est à M. Charles de La Verpillière.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe de l'Union pour un mouvement populaire accueille très favorablement la proposition de loi adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile.
Son contenu ayant été excellemment présenté par le rapporteur, M. Émile Blessig, je me contenterai d'en rappeler brièvement les principales dispositions : la réduction du délai de droit commun et de certains délais spéciaux pour la prescription extinctive ; la clarification et l'harmonisation des règles applicables au point de départ des délais et au cours de la prescription ; l'élargissement des possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription extinctive ; le regroupement et la modification des règles relatives à la prescription acquisitive ; une série enfin de dispositions diverses et de coordination.
Les députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire estiment que ce texte, sous des abords très techniques, s'inscrit parfaitement dans l'action d'ensemble engagée par la majorité depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République ; et ce, d'un triple point de vue.
En premier lieu, il s'agit d'une réforme de modernisation et de compétitivité. La réduction du délai de droit commun de la prescription extinctive de trente à cinq ans va dans ce sens, compte tenu du nombre et de la rapidité des transactions juridiques aujourd'hui ; notre droit se rapprochera ainsi des règles en vigueur en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne, et nous échapperons à la concurrence entre les systèmes juridiques. L'élargissement des possibilités d'aménagement contractuel est une autre illustration de cette volonté de modernisation.
En deuxième lieu, cette réforme contribue à la simplification de notre droit et à la sécurité juridique. Les députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, et particulièrement ceux qui siègent à la commission des lois, y sont très sensibles ; il n'est besoin que de rappeler le chantier ouvert par le président Warsmann dans ce domaine.
En troisième lieu, la proposition de loi prend soin de protéger les intérêts des personnes en situation d'infériorité ou de vulnérabilité, en interdisant par exemple, grâce à l'amendement n° 5 de la commission des lois, tout aménagement contractuel dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ou en matière de salaires, arrérages de rentes, loyers, fermages, charges locatives et intérêts des sommes prêtées ; citons aussi le maintien à trente ans de la prescription de l'action en annulation du mariage pour cause de nullité absolue. En outre, compte tenu des dispositions insérées à l'article 8 par l'amendement n° 13 de notre rapporteur, la proposition de loi ne porte aucunement atteinte à l'action et au droit à réparation des victimes de discriminations au travail.
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union pour un mouvement populaire votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, la présente réforme de la prescription en matière civile était attendue d'abord en raison de la multiplication des délais : M. Weber, président de la troisième chambre de la Cour de cassation, en a recensé plus de 250, dont la durée varie d'un mois à trente ans. Cette situation est source à la fois d'ignorance, de désordres et d'insécurité juridique permanente.
Cette réforme va aussi dans le sens de la simplification du droit, à laquelle notre commission des lois s'attachera tout au long de cette législature.
La prescription, « la plus importante de toutes les institutions de notre code civil » selon Savigny, serait-elle à ce point médiocre pour devoir être ainsi réformée ? Le doyen Carbonnier ne nous disait-il pas – avec raison – qu'une réforme doit être adaptée à l'esprit et qu'il faut se méfier du droit venu d'ailleurs ?
Nombreux sont les rapports et avis exprimés par la doctrine sur le sujet, et nombreux sont ceux qui convergent vers une durée réduite à dix ans, que le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche considère comme le point d'équilibre des relations contractuelles.
Je rappellerai les différentes études menées jusqu'à ce jour, afin de montrer le sérieux du travail accompli et mesurer à son aune la présente proposition de loi.
Le rapport annuel de la Cour de cassation de 2001 suggérait déjà la modification des articles 2261 et 2270-1 du code civil afin de ramener la prescription extinctive trentenaire à une prescription décennale : « Depuis longtemps, une doctrine unanime préconise l'harmonisation et la réduction des délais de prescription des actions et obligations. L'oeurs : prescription de dix ans pour les actes de commerce et les actes mixtes, prescription ramenée ou fixée à cinq ans, en 1968, pour les actions en nullité des conventions, à dix ans, en 1978, pour les actions en responsabilité et garantie en matière de construction d'ouvrage.
« La disparité actuelle aboutit à des incohérences dans le schéma bien connu de la combinaison des articles 1147, 1165 et 1382 du code civil lorsqu'un tiers se prévaut de la violation d'une obligation contractuelle qui lui cause préjudice. En ce cas, en effet, les victimes d'un même acte seront soumises à des prescriptions différentes selon qu'elles ont un lien contractuel avec le responsable de leurs dommages – auquel cas la prescription est de trente ans – ou qu'elles n'en ont pas – auquel cas la prescription est de dix ans. Il conviendrait donc de généraliser à dix ans le délai maximal de prescription des actions en toute matière. Bien entendu, cette suggestion ne concerne pas la prescription acquisitive ou usucapion. »
En 2004, le groupe de travail présidé par M. Weber préconisait de fixer un délai de droit commun de dix ans pour la prescription extinctive applicable aux actions mobilières et personnelles, et de maintenir le délai trentenaire pour les actions réelles immobilières. Il notait avec raison : « L'acquisition de la propriété immobilière par possession trentenaire ou l'extinction des servitudes par non-usage pendant trente ans correspondent à de véritables règles culturelles de la “constitution civile des Français”, qu'il serait paradoxal de raccourcir alors que la durée de la vie ne cesse de s'allonger et qu'une telle prescription acquisitive ne correspond plus aujourd'hui, statistiquement, qu'à une petite partie de la vie d'un seul individu. »
Le groupe de travail proposait en outre de fixer une durée de prescription acquisitive immobilière abrégée unique de dix ans, quel que soit le lieu de résidence du vrai propriétaire. Ces propositions avaient même inspiré le projet de réforme établi par la direction des affaires civiles et la direction du sceau du ministère de la justice, qui devait être appliqué par voie d'ordonnance.
Le projet de loi de simplification du droit présenté en juillet 2006 au Sénat par Thierry Breton et Jean-François Copé, visant à habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, autorisait dans son article 1er le Gouvernement à modifier les règles relatives à la prescription civile, notamment en limitant à dix ans le délai de prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou mobilières, à l'exception de celles relatives à l'état des personnes. La prescription trentenaire était maintenue pour les actions réelles immobilières. Cette réforme aurait permis, nous disait-on, de renforcer la sécurité juridique des particuliers et des entreprises, et constituait une réelle simplification en mettant fin à l'obligation de conserver pendant trente ans des justificatifs de paiement.
Le présent texte fait suite au rapport de la mission d'information sénatoriale sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite par les sénateurs Hyest, Portelli et Yung, qui comportait dix-sept recommandations pour moderniser les régimes de prescriptions et leur rendre leur cohérence. Celles-ci s'inspiraient dans une large mesure de la partie de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription abrégée rédigée par les professeurs Malaurie et Catala, dont les idées progressistes n'ont d'équivalent que la constance qu'ils mettent à les combattre. (Sourires sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) Ces derniers proposaient même de réduire à trois ans la prescription de droit commun, à l'exception de quelques hypothèses comme l'usucapion. La direction des affaires civiles du ministère de la justice et le MEDEF s'y étaient montrés hostiles, tous deux préférant réduire à dix ans la durée de la prescription extinctive de droit commun. Les travaux de la mission d'information de la commission des lois du Sénat reçoivent aujourd'hui l'éloge du professeur Malaurie, qui parle, à propos de la réduction du délai de droit commun de la prescription extinctive, de « coup de maître et d'acte de courage », échappant « à la timidité des propositions » faites par le ministère de la justice. Mieux encore, il souligne que la mission d'information est sortie de la « facilité consensuelle ».
On peut cependant s'étonner qu'aucune analyse sociologique n'ait été menée préalablement afin d'interroger les masses silencieuses – et pas seulement les groupes de pression – sur l'adaptation du délai de cinq ans à notre époque. La réforme des régimes matrimoniaux de 1965, par exemple, avait été préparée par une très utile enquête sociologique préalable ; et elle a porté les fruits que l'on sait.
On aurait également souhaité qu'une étude d'impact économique pose les bonnes questions : à qui profite une prescription aussi courte ? Au professionnel ? Au consommateur ? Au responsable ? Ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile, voire impossible, de se prononcer a priori sur les effets économiques de la réforme.
Cette réforme favorisera les comportements opportunistes des débiteurs qui joueront la montre en adoptant une attitude passive. Elle augmentera finalement le nombre de créances impayées éteintes grâce à la prescription. Une courte prescription incite naturellement le créancier à recourir au juge pour obtenir son dû. Plus la probabilité d'existence d'une créance est grande, plus le délai de la prescription est long et réciproquement. Le législateur n'a pas tenu compte de ce fait. Consacrer un court délai de prescription a un effet spoliateur : le créancier est privé du bien.
Sur le fond, nous sommes opposés à la réduction drastique du délai de prescription trentenaire à cinq ans. Contraire à notre tradition juridique et à la construction de notre droit, il profitera toujours à celui auquel le rapport de force contractuel sera favorable. Ce délai, nous l'avons dit, n'est pas consensuel. On attend d'une réforme législative d'ampleur qu'elle reflète l'état de la société tout en étant équilibrée. Il n'est pas certain que ce soit le cas de cette proposition de loi, d'autant que des critiques peuvent être formulées dans plusieurs autres domaines.
Une des principales critiques que nous relèveront concerne la codification des règles de prescriptions extinctive et acquisitive. L'actuel article 2259 résultant de la proposition de loi déclare « applicables à la prescription extinctive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre », à savoir le livre IV du code civil intitulé : « De la prescription acquisitive ». Ces dispositions forment donc un ensemble de règles communes aux prescriptions extinctive et acquisitive, qu'il aurait été judicieux de rassembler dans une division unique pour une meilleure compréhension et rédaction des textes. Ne devons-nous pas travailler avec constance à la simplification du droit ? Celle-ci concerne aussi la codification des textes que nous votons. Je crains que la présente proposition de loi ne nous permette pas d'y parvenir.
Une autre critique concerne le délai butoir inscrit à l'article 2232 du nouveau code civil. L'instauration d'un délai butoir a pour effet que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne pourront conduire à ce que le délai de la prescription extinctive s'étende au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai butoir alimente les critiques, notamment de la Cour de cassation – il n'est qu'à se reporter aux conclusions du groupe de travail de la Cour de cassation de juin 2007 sur l'avant-projet Catala de réforme du droit des obligations. Le groupe de travail s'est déclaré hostile au délai butoir, soulevant le risque d'inconstitutionnalité de cette mesure au motif qu'elle méconnaît le principe suivant lequel la prescription ne peut être opposée à celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
La mission d'information sénatoriale a également fait part de ses réserves quant à la généralisation d'un délai butoir. Ainsi, Alain Bénabent, professeur à l'université de Paris-X et avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a mis en évidence devant la mission d'information le fait qu'en cas d'instauration d'un délai butoir général, même trentenaire, le salarié qui s'apercevrait au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, par exemple en 2007, que son employeur avait omis, entre 1970 et 1975, de verser au régime général les cotisations nécessaires à la constitution de ces droits, ne pourrait plus intenter aucune action.
Par ailleurs, le point de départ choisi pour le délai butoir n'est pas satisfaisant, se révélant trop peu protecteur du droit des justiciables.
En ce qui concerne l'aménagement conventionnel – ce sera ma troisième remarque –, la possibilité pour les parties de modifier la durée de la prescription, en l'allongeant, en l'abrégeant, ou en ajoutant des causes prévues d'interruption ou de suspension de la prescription, présente des risques pour les contractants en situation de dépendance économique. En effet, si l'exclusion des actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d'habitation, et fermages, ou si l'exclusion des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou celle des contrats d'assurance et des opérations soumises au code de la mutualité offre des garanties dans ces domaines, elle laisse échapper toutes les autres conventions, notamment entre professionnels où la partie en position de force risque d'imposer à l'autre un allongement du délai d'action à son profit et un raccourcissement du délai d'action contre elle. En outre, la prescription n'intéresse pas que les intérêts privés des parties : elle intéresse également l'institution judiciaire, à travers la possibilité, offerte ou non, de saisir le juge d'une prétention.
En juin 2007, le groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme déjà cité s'est déclaré « à l'unanimité hostile » aux aménagements conventionnels de la durée de la prescription autorisés par l'avant-projet « eu égard au risque que de tels aménagements soient imposés à la partie la plus faible, comme ce fut le cas en matière d'assurance avant la loi du 13 juillet 1930 qui a interdit ce procédé. »
Par ailleurs, permettre la multiplication des délais dérogatoires de la prescription par une simple volonté des parties est en contradiction manifeste avec ce qui devrait être l'objectif du législateur : l'intelligibilité du droit.
La matière ne doit donc pas être abandonnée à la volonté privée et doit être déclarée d'ordre public.

En ce qui concerne la rédaction de l'article 2219 du code civil, il n'est pas fait de choix entre des thèses bien connues en doctrine. Il est fait de la prescription un mode d'extinction d'un droit – article 2218 –, mais les articles 2224 et suivants appliquent la prescription à l'action en justice, réintroduisant des conflits de délais notamment pour les actions mixtes en matière immobilière.
Le point de savoir si la prescription éteint le droit lui-même ou simplement l'action est une question sujette à débat. Du reste le rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat par M. Laurent Béteille reconnaît que l'article 2219 ainsi rédigé « ne précise pas clairement ce qui est éteint par la prescription : le droit en sus de l'action (conception “substantialiste”) ou seulement l'action en justice (conception “processualiste”). »
La définition retenue paraît trop restrictive, compte tenu du fait, notamment, que de multiples dispositions visent textuellement la prescription de l'action. La référence au droit semble mieux correspondre à la prescription acquisitive. Par ailleurs, la définition retenue suscite l'interrogation en ce qui concerne l'application des dispositions nouvelles à des matières où il est plus difficile de discerner un droit, particulièrement lorsqu'il s'agit des actions en nullité. Il serait donc plus précis d'ajouter que la prescription extinctive peut également être un mode d'extinction d'une action.
La rédaction de l'article 181 du code civil supprime quant à elle la référence au moment où l'époux victime d'un vice du consentement a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue, comme point de départ éventuel de l'action en nullité du mariage : or une telle suppression risque d'avoir pour conséquence, dans certains cas, que l'action soit prescrite avant que la victime n'ait pu agir. Il en va ainsi notamment de l'époux victime d'une violence qui ne cesserait que plus de cinq ans après le mariage. Il n'est en effet pas certain que la règle générale de l'article 2224 du code civil modifié par la présente proposition de loi, qui fixe le point de départ de principe au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », permette de fixer le point de départ de l'action en nullité du mariage au jour de la cessation de la violence.
La modification de l'article 181 est d'autant plus regrettable que la règle générale énoncée en matière de conventions, selon laquelle la prescription « ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts », n'est pas modifiée.
En ce qui concerne, enfin, la question de la prescription en cas de discrimination, l'application en matière de discrimination du délai de prescription de droit commun et la proposition de texte présentée par M. le rapporteur, à partir de l'amendement Hyest adopté par le Sénat, ne résolvent pas toutes les questions posées par cette importante question des discriminations. Mon collègue Vidalies y reviendra au cours de son intervention.
En conclusion, ce texte important pour l'organisation de notre droit reste, après un examen attentif encore imparfait. Il constitue à nos yeux une réforme excessive du délai de droit commun de la prescription extinctive. Il faut se garder des comparaisons simplistes avec les droits voisins, notamment allemand ou anglais, qui comportent eux-mêmes de nombreuses exceptions à leur délai de droit commun. Sans oublier que de nombreux autres pays ont un délai de droit commun supérieur à cinq ans pour la prescription extinctive.
Cette réforme n'est pas adaptée à l'esprit français. Ne serait-elle pas liée à l'obsession de désengorgement des tribunaux ? La qualité de notre justice ne saurait être sacrifiée à des critères économiques. Ce texte est fait, en vérité, pour servir le droit des affaires : les individus et le droit des personnes en sont les grands oubliés.

Le groupe socialiste ne votera donc pas cette réforme. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je consacrerai mon propos à la question des discriminations au travail.
Les dispositions du nouvel article 2224 du code civil, remplaçant celles de l'article 2262 du même code, prévoient une réduction considérable du délai de prescription de trente ans à cinq ans en matière civile, pour des actions personnelles et mobilières. L'évaluation des dommages et intérêts, si le dommage porte sur plus de cinq ans, serait quant à elle réduite de trente ans à vingt ans par le nouvel article 2232 du code civil. À qui profite une telle réduction du délai d'action en justice dans le cas des discriminations au travail ? Certainement pas aux victimes ! Il s'agit en fait de répondre à une demande du patronat, puisque cette proposition de loi est le reprise d'une injonction du MEDEF dont on trouve une trace dans le fameux document de 2004 intitulé « Les 44 propositions du MEDEF » et toujours en ligne sur le site de celui-ci. Il convient, selon ce document, de « généraliser la prescription quinquennale des demandes découlant du contrat de travail afin d'assurer le respect du principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et de tenir compte de ce que les entreprises ne peuvent conserver sur de très longues périodes les pièces justificatives de l'évolution de carrière de tous les salariés, et sont même obligées d'en supprimer certaines, en application de lois d'amnistie. »
Un tel rappel des injonctions du MEDEF donne sa juste valeur à la notion de « juste milieu » dont le rapporteur prétend qu'elle aurait présidé à la fixation du délai de cinq ans, du moins en matière de discriminations au travail. Où est le juste équilibre, lorsque l'adoption d'un délai trop court être une source d'injustice pour les titulaires de droits ? Depuis 1990 et de façon régulière depuis, la Cour de cassation envisageait une réduction à dix ans et ce n'est que parce que quelques juristes auraient avancé un abaissement à trois ans que la prescription quinquennale peut aujourd'hui être présentée comme « un juste milieu ».
Quant à l'harmonisation européenne, invoquée pour justifier cet abaissement, le rapport donne lui-même des exemples de pays – Finlande, Italie, Suède ou Suisse – où le délai de prescription de droit commun est de dix ans.
L'adoption en l'état des dispositions de cette proposition de loi modifierait sur le fond le régime juridique de lutte contre les discriminations et affaiblirait les transpositions des textes européens qui régissent la matière, dans la mesure où leur mise en application se trouverait bouleversée sur le fond par la réduction du délai de prescription.
Du reste, le rapport l'admet puisqu'il précise, page 18, qu'« en ramenant cette durée de droit commun à cinq ans, la proposition de loi risque de conduire à ce que la perte de salaire des salariés victimes de discriminations – qu'ils soient ou non représentants syndicaux – ne soit plus prise en compte que pendant cinq ans et non trente ans aujourd'hui. »
Pendant très longtemps les représentants syndicaux dans de trop nombreuses entreprises étaient victimes de discriminations – retard dans l'avancement, primes supprimées, mise au placard – sans pouvoir obtenir de réparation. Au cours des années 1990, la jurisprudence de la Cour de cassation a permis une évolution de la situation et aujourd'hui les discriminations sont plus justement réparées par les juridictions, à la suite de l'arrêt Clerc, dit aussi « méthode Clerc », du nom de cet ancien mécano de chez Peugeot, qui a voué une grande partie de sa vie syndicale à la lutte contre la discrimination.
Toutefois, pour obtenir réparation, encore faut-il pouvoir démontrer l'existence d'une discrimination, ce qui implique d'examiner le déroulement de la carrière des personnes, de le comparer avec celui d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable et de démontrer qu'il existe une répétition ou une accumulation de faits discriminatoires. La discrimination est un délit continu qui provoque des inégalités de traitement. Elle s'apprécie donc dans le temps.
Tant bien que mal, depuis la fin des années 1990, des syndicalistes discriminés de grandes entreprises ont réussi à négocier des rattrapages financiers pour cause de réparation de discriminations et des réintégrations à leur juste niveau dans la grille de classification. Dans les petites et moyennes entreprises, faute de représentation syndicale, les salariés sont souvent conduits à attendre d'avoir quitté l'entreprise pour engager une action en réparation : c'est donc particulièrement pour eux que la réduction du délai de prescription risque d'être dommageable.
Selon les auteurs de cette proposition de loi, une telle réduction serait rendue possible « dans la mesure où les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations indispensables pour exercer leurs droits ».
Il convient tout d'abord de rappeler que la société n'est pas uniquement composée « d'acteurs juridiques », pour reprendre l'expression, ni même de personnes continuellement assistées de leurs avocats… Et quand bien même une personne victime d'une ou de plusieurs discriminations franchirait le pas de s'inscrire dans une démarche de droit, souvent au prix de la rupture de la loi du silence, encore faut-il que les acteurs, associations ou syndicats, qui maîtrisent les outils juridiques et peuvent aider les salariés, aient le temps d'établir la preuve ou l'intention discriminatoire.
Avec un délai de prescription quinquennal, toutes les actions devant les conseils de prud'hommes de salariés victimes de discriminations, qui pouvaient aboutir grâce au délai de prescription trentenaire, deviendront plus difficiles. Le nombre des actions de salariés en dommages et intérêts contre l'ensemble des discriminations retenues par le code du travail, qu'elles soient liées au sexe ou au pays d'origine, à la couleur de la peau, au handicap, à l'orientation sexuelle ou à l'appartenance syndicale, ne pourra que diminuer.
La réduction du délai de prescription dans tous ces cas de figures, jointe à la minimisation conséquente du risque financier, est un mauvais signal que vous adressez aux employeurs qui usent de telles pratiques. Vous leur donnez pratiquement un blanc-seing qui les incitera à ne pas prévenir les diverses formes de harcèlement qui existent sur les lieux du travail.
Mais la réduction du délai de prescription n'est pas le seul élément préoccupant de la proposition de loi, il faut aussi considérer le moment à partir duquel court le délai. Les justifications de la rédaction d'origine invoquée à la page 15 du rapport indiquent que la rédaction s'inspire de la réforme du droit allemand des obligations et d'autres dispositifs relatifs aux contrats de commerce internationaux, en calquant la formule de délai imputable à un créancier. Nous ne pouvons tout de même pas reprendre tel quel, pour toutes les relations sociales de droit commun du code civil, ce qui est conçu initialement pour le droit du commerce !
Pourquoi cette insistance à réduire les délais de recours en droit du travail ? Aujourd'hui, pratiquement tous les dossiers présentés en justice et utilisant la méthode Clerc aboutissent aux mêmes décisions de reconnaissance du préjudice subi et donc des réparations nécessaires. Derrière les premiers syndicalistes qui ont obtenu gain de cause, ils sont maintenant des dizaines à engager le même type d'actions. Une telle situation commence à coûter cher aux entreprises. Mais après tout, si la représentation nationale a décidé de voter des lois pour lutter contre les discriminations, elle ne peut que se féliciter qu'elles soient efficaces.
Seulement voilà : après le dossier des réparations des discriminations syndicales, arrive celui de la discrimination salariale généralisée subie par les femmes entrées en nombre sur le marché du travail dans les années soixante-dix et, à travail égal, sous-rémunérées. Le nombre de salariés concernés étant cette fois bien supérieur, il y avait urgence pour le MEDEF à arrêter cette spirale de réparations.
Mais il ne sert à rien de se lamenter sur les inégalités subies par les femmes, si les maigres outils fournis par la législation pour lutter contre ces abus sont démantelés. Face à cette situation, notre collègue, le sénateur Jean-Jacques Hyest, à l'origine de la proposition de loi, a reconnu le risque d'ambiguïté. Interpellé par un collectif regroupant des syndicats comme la CGT et la CFDT, qui représentent la grande majorité des salariés du pays, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature ainsi que des associations de lutte contre les discriminations, il a cherché une autre formulation plus acceptable en ce qui concerne le délai de prescription dans les relations du travail, c'est-à-dire régies par le code du travail et le régime des fonctionnaires.
Cette formulation est reprise dans l'amendement déposé à l'article 8, qui a été voté en commission. Elle précise que l'action en réparation du préjudice se prescrit à compter de cinq ans « à compter de la révélation de la discrimination », et que la réparation couvre « l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». Cette formulation de compromis, qui clarifie la question de la réparation dans sa durée, réduit tout de même le délai de prescription de trente à vingt ans, du fait du nouvel article du code civil.

Non. Je pense qu'il fallait conserver le délai de trente ans, compte tenu du fait que le Gouvernement allonge par ailleurs la durée de la vie salariale à quarante et un ans. Dès lors, il paraît normal qu'un salarié obtienne réparation, s'il n'a pas pu se défendre pendant toute cette période. En outre, il faut éviter tout ce qui inciterait à ne pas lutter contre les discriminations dans les entreprises.
En dehors de la diminution des délais, la question de la date de départ de la prescription reste entière. La formule proposée – qui retient la révélation de la discrimination – risque tout de même d'introduire beaucoup de contentieux. Il est surprenant que ne soit pas proposée une formule plus précise, au moment où le Gouvernement explique qu'il faut absolument alléger la charge des tribunaux et réduire tous les contentieux possibles. Le moins qu'on puisse dire est que, vu la formule proposée, le résultat risque de ne pas être au rendez-vous.
Le rapporteur a indiqué en présentant le texte que la majorité des discriminations portait sur les salaires. C'est exact, mais une telle vision reste limitée, car si elles se traduisent dans le salaire, elles concernent aussi l'évolution du salarié dans la grille de classification. Si l'on ne prévoit pas, outre une réparation financière, sa réintégration au niveau de la grille où il aurait dû se situer, la réparation portera seulement sur les années de discrimination. Autrement dit, tout au long des années de travail qu'il lui reste à effectuer, le salarié continuera à accumuler un retard par rapport à ses collègues. La réparation doit par conséquent prendre en compte non seulement les salaires qu'il aurait dû percevoir, mais également sa réintégration dans la grille.

Le dépôt de l'amendement n° 13 à l'article 8, qui régit la prescription en matière salariale, risque d'introduire, en cas de contentieux, une réparation qui ne se traduirait qu'en termes financiers, sans aller jusqu'à la réintégration. L'amendement est donc un moindre mal. Il n'empêche que cette évolution réduit doublement les droits à réparation des salariés, tant par le délai de cinq ans fixé pour intenter une action en réparation, surtout pour les salariés des PME – il est grave que nos lois introduisent ainsi des différences de plus en plus importantes entre les salariés des grandes entreprises et ceux des PME –, que par la réduction de la prescription de trente à vingt ans. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)

Monsieur le Président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir opère un véritable dépoussiérage de notre droit de la prescription en matière civile.
Le texte adopté au Sénat le 21 novembre dernier reprend à son compte un grand nombre de propositions formulées dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations rédigé par Philippe Malaurie sous l'égide de Pierre Catala, tous deux professeurs émérites de l'université Paris II.
La proposition de loi que nous examinons a abouti à un texte de qualité. Une pierre supplémentaire est ainsi apportée à l'édifice de la réforme des obligations. Elle est de taille, puisqu'elle touche à une des garanties fondamentales de la sécurité juridique : la prescription. « Le temps des juristes n'échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité », disait le doyen Carbonnier. Cette relativité, qui correspond à la consolidation d'une situation juridique par l'écoulement du temps, doit être précisée par le législateur.
Tout l'enjeu d'une réforme de la prescription est de concilier l'exigence de justice, qui doit permettre à un justiciable qui a subi un préjudice de faire valoir ses droits pendant un délai raisonnable, et l'exigence de protection, comme l'a indiqué Mme la garde des sceaux, contre des actions en justice qui surviennent trop tardivement.
En France, les règles de la prescription sont devenues trop nombreuses et trop complexes. Il était donc grand temps de repenser dans sa globalité le régime de la prescription civile. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, madame la garde des sceaux : la situation actuelle est injuste. Il convient donc de soutenir une réforme qui vise à la simplification.
Parlons d'abord des délais. Il en existe actuellement plus de deux cent cinquante. Cette situation, illisible pour le justiciable, provoque de nombreuses incohérences. La proposition de loi simplifie le droit en diminuant sensiblement le nombre et la diversité des différents délais de prescription, notamment en réduisant le nombre des prescriptions extinctives particulières et en les alignant sur le délai de droit commun.
L'apport essentiel du texte porte en effet sur la durée de ces délais. Alors que l'état actuel du droit prévoit un délai de droit commun de trente ans, la proposition de loi le ramène à cinq ans en matière civile et commerciale.
Cette réduction drastique peut sembler exagérée au premier abord. On notera pourtant que l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription de Pierre Catala recommandait d'adopter un délai de trois ans. De plus, le système juridique français fait encore figure d'exception par rapport à ses voisins européens qui ont retenu des délais beaucoup moins élevés. Notre excellent rapporteur rappelle que ceux-ci sont de dix ans en Italie, en Suisse et en Suède, de six au Royaume Uni et de trois en Allemagne.
La prescription trentenaire s'est révélée un délai bien trop long pour un grand nombre d'actions, en particulier pour certaines actions personnelles, et inadapté face à l'exigence de rapidité – que vous avez évoquée, madame la garde des sceaux – et de réactivité de notre appareil judiciaire.
Cette réforme présente donc le double avantage de l'unification et de la simplification des délais de la prescription en matière civile et commerciale. Qui plus est, un garde-fou est créé, puisque ce nouveau délai de droit commun ne s'applique pas à de nombreuses actions qui nécessitent un délai supérieur. C'est le cas par exemple pour les actions réelles immobilières, les dommages corporels ou encore les préjudices – vous avez eu raison de le souligner, madame la garde des sceaux – résultant de torture ou de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur. Celles-ci resteront de vingt ans.
Précisons également que le délai retenu pour les auteurs d'un dommage environnemental est porté à trente ans, ce dont se félicitent les députés du groupe Nouveau Centre, fermement engagés pour une attitude responsable dans ce domaine.
Le deuxième apport essentiel du texte est de fixer le point de départ du délai pour agir en justice. Désormais, le délai de prescription est fixé au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La précision n'est pas anodine, car elle légitime l'abaissement de la durée du délai de droit commun. Elle permet ainsi d'éviter des situations où la victime s'apercevrait trop tard de son préjudice, au regard des délais imposés par la loi. En revanche, une fois celui-ci constaté, le délai de cinq ans paraît amplement suffisant pour intenter une action en réparation. On ne voit pas pourquoi, en effet, une personne lésée dans son bon droit mettrait plus de temps à réagir.
Pour la première fois, est également instauré un délai butoir de vingt ans en matière de prescription extinctive à compter de la naissance d'un droit, même si le point de départ du délai est reporté, ou que la prescription est suspendue ou interrompue, ce qui limite dans le temps les situations d'insécurité juridique.
Le texte profite également de la refonte du droit de la prescription pour corriger certaines situations juridiques ambiguës. C'est le cas du régime des causes de suspension et d'interruption des délais de prescription, qu'il réorganise.
La proposition de loi met fin à des anomalies juridiques qu'il était nécessaire de réformer, notamment les délais préfix. La jurisprudence a admis l'existence de ces délais qui provoquent l'incompréhension de l'ensemble des acteurs du monde juridique. Il était temps de les exclure du régime de la prescription extinctive. Grâce à cette proposition de loi, c'est chose faite.
Le groupe Nouveau Centre se félicite enfin de la plus grande part laissée à la prescription conventionnelle. Dans de nombreux cas, la durée de la prescription pourra être abrégée ou allongée par accord des parties, dans la limite de un à dix ans pour éviter les abus dans un sens ou dans l'autre.
Les parties pourront également ajouter conventionnellement aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Cette mesure, qui introduit davantage de liberté et de souplesse, est une bonne chose. Bien qu'elle soit contraire à l'objectif d'uniformisation des délais, nous saluons la volonté de faire primer le consensus sur la règle rigide et impersonnelle. Vous avez d'ailleurs signalé, madame la garde des sceaux, que cette proposition de loi encourage la conciliation ou la médiation, qui ont pour effet de suspendre les délais de prescription.
Ainsi, globalement, le régime de la prescription en matière civile ressort nettement amélioré de la proposition de loi. Le code civil est réorganisé. Les règles de la prescription sont modernisées et rendues cohérentes. Les incertitudes juridiques résultant des règles jurisprudentielles sont sensiblement réduites. Le texte laisse enfin plus de liberté aux justiciables dans la fixation des règles de la prescription. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe du Nouveau Centre apporteront leur soutien à la proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe Nouveau Centre et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, réformer le droit de la prescription pouvait être un objectif partagé, dès lors que notre pays se caractérisait, jusqu'à aujourd'hui, par un délai de droit commun particulièrement long, à savoir trente ans, et par une multitude de textes dérogatoires ou spécifiques instituant deux cent cinquante régimes de prescription particuliers.
Les principales initiatives préalables à la présente proposition de loi furent, tout d'abord, une proposition de réforme du droit des obligations, élaborée par un groupe d'universitaires qui, dans un chapitre relatif à la prescription, retenait le principe d'un délai de droit commun ramené de trente ans à trois ans ; vinrent ensuite les travaux issus des différents rapports de la Cour de cassation qui préconisaient un délai de droit commun de dix ans.
Cette dernière proposition semblait faire consensus et avait abouti, le 13 juillet 2006, au dépôt, par les ministres Thierry Breton et Jean-François Copé, d'un projet de loi dont l'article 1er visait à habiliter le gouvernement à modifier par ordonnances les règles relatives à la prescription civile, notamment en limitant à dix ans le délai de droit commun. Cette réforme avait l'assentiment de tous et nous ne pouvons que regretter le choix fait par le Sénat puis, semble-t-il, par la majorité et le Gouvernement, d'abandonner cette proposition commune au profit d'une prescription générale de cinq ans.
Selon les arguments avancés par les promoteurs de cette nouvelle réforme, elle a principalement pour objet d'harmoniser le droit français avec celui des autres pays européens, et de répondre aux exigences du droit des affaires dans une économie mondialisée.
En ce qui concerne le premier argument, la démonstration qui s'appuie sur des comparaisons européennes n'est pas totalement probante. Certes, l'Allemagne pratique un délai de prescription de droit commun de trois ans, mais assorti de nombreuses exceptions. Ce délai est de six ans au Royaume-Uni mais, là encore, les exceptions existent : la plus notable concerne les créances nées d'un acte formel pour lesquelles le délai de prescription est porté à douze ans. L'Italie et la Suisse ont un délai de prescription de droit commun de dix ans ; il est de quinze ans en Espagne et, au Luxembourg, comparable à celui en vigueur dans notre droit positif.
Si le délai de droit commun de trente ans pouvait apparaître comme une singularité française, le choix d'un délai de dix ans semblait manifestement être celui qui correspondait le mieux à l'objectif partagé d'une harmonisation.

Comme second argument, les partisans de cette réforme évoquent la nécessaire adaptation de notre droit aux exigences de la mondialisation. Ainsi, en conclusion d'un article publié dans les Petites affiches, en avril 2008, deux avocats d'affaires écrivent : « Gageons que les députés valideront les principaux apports de cette opportune proposition de loi du Sénat qui permettra à la France de s'adapter à la rapidité de la vie des affaires afin d'attirer de nouveaux investisseurs ; là réside la clé d'un moteur de l'économie trop longtemps négligé… »
M. Philippe Malaurie, professeur à l'Université Paris II et rédacteur de la partie relative à la prescription dans le travail remis par les universitaires, écrit très clairement : « Notre système actuel de la prescription trentenaire contribue à l'asthénie qui souvent frappe notre économie handicapée dans la concurrence internationale ; partout dans les grands pays industriels, le droit civil devient une incitation à l'action, sauf en France. » Rien que ça !
Le plus frappant dans tous les travaux préparatoires, qu'ils soient universitaires ou parlementaires, c'est l'absence de référence au droit des gens, ou tout simplement d'intérêt pour cette question. En effet, le Code civil vise les relations juridiques entre les particuliers, y compris dans la partie relative au droit des obligations. Le droit civil ne se résume pas au droit des affaires, et c'est probablement cette différence d'approche qui explique nos divergences d'aujourd'hui sur des questions majeures comme l'établissement d'un délai butoir ou l'extension des possibilités d'aménagement conventionnelles. Chacun peut comprendre que les appréciations sur les conséquences de tels choix, comme sur celui du délai de droit commun, sont différentes si la réflexion est restreinte au droit des affaires ou si, comme nous le proposons, elle englobe tout le champ du droit civil, et notamment le droit des gens au quotidien.
Sans doute une vision très partielle de la problématique de la prescription et de ses conséquences aura-t-elle conduit le Sénat à adopter un texte qui, de fait, remettait en cause tous les acquis de la législation et la jurisprudence dans la lutte contre les discriminations dans l'emploi.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par trente ans, conformément aux dispositions de l'actuel article 2262 du Code civil. Or le texte adopté par le Sénat aboutit non seulement à enfermer l'action en réparation dans un délai de cinq ans, mais aussi à limiter le champ de la réparation à ce même délai ! Il rejoint ainsi, assez curieusement, les objectifs explicites d'une proposition de loi, déposée le 15 octobre 2003, par M. Jacques Godfrain, député UMP, qui proposait une prescription de cinq ans pour toute action fondée sur l'article L. 412-2 du Code du travail, aux fins « d'éviter de mettre en péril la situation des entreprises » ! Le Sénat a-t-il oublié les conséquences de son texte sur la lutte contre les discriminations, a-t-il voulu faire plaisir à M. Godfrain ou répondre aux objectifs de sa proposition de loi ? Le débat reste ouvert.
Des juristes spécialisés dans le droit du travail, des organisations syndicales, et même la HALDE ont vivement réagi dès qu'ils ont pris connaissance du texte adopté par le Sénat. Pour répondre à ces démarches, le président de la commission des lois du Sénat et le rapporteur de la proposition de loi ont publié un communiqué, le 19 mars 2008, affirmant que leurs objectifs n'étaient pas de limiter l'action ou la réparation du dommage et précisant : « Le texte adopté par le Sénat en première lecture est certainement perfectible – c'est vrai par définition mais, fait exceptionnel, des sénateurs le reconnaissent ! – et la navette parlementaire pourra utilement lever les interrogations suscitées par sa rédaction si elles s'avèrent fondées.»
Ce communiqué appelait naturellement l'adoption d'un amendement par notre assemblée pour mettre fin aux dégâts avérés de la rédaction adoptée par le Sénat. J'observe d'ailleurs que le Sénat a tenté de réparer son erreur en adoptant, sur proposition du président de sa commission des lois, un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Cet amendement, voté le 9 avril 2008, précise que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, d'autre part, que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Vous nous proposez, monsieur le rapporteur, de reprendre tout simplement cet amendement dans l'actuelle proposition de loi. Sur la question de l'étendue de la réparation, votre proposition répond presque entièrement à nos objections, mais il n'en va pas de même en ce qui concerne le point de départ et la durée de la prescription.
Sur l'étendue de la réparation, compte tenu des propos tenus par les orateurs depuis le début de la discussion générale, je souhaiterais, madame la ministre, ou monsieur le rapporteur, que vous leviez une ambiguïté. Elle résulte de la mise en cohérence du texte sur la réparation et du délai butoir. En matière de discrimination, et nonobstant la nouvelle rédaction, le délai de vingt ans pourrait empêcher la réparation sur une période de préjudice supérieure à cette durée... Il me semble au contraire que le délai butoir ne concerne que l'ouverture de l'action, et non la réparation du préjudice. Avec le texte que nous examinons aujourd'hui, il y aura bien une réparation sur l'ensemble de la période du préjudice même si elle est supérieure à vingt ans. Manifestement, le délai butoir n'a rien à voir avec la question de la durée du préjudice mais puisque la question a été soulevée par quelques orateurs et qu'il n'y a pas eu d'expression publique officielle sur ce sujet, il vous appartient, monsieur le rapporteur, madame la garde des sceaux, de lever cette ambiguïté.
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrira désormais par cinq ans, à compter de la révélation de celle-ci. Cette notion de révélation, empruntée à la jurisprudence ou plus exactement à une décision de la Cour de cassation, n'évitera en rien d'interminables débats devant les tribunaux sur le moment où cette révélation, concept nouveau dans notre droit civil, sera établie. À l'évidence, une brèche est ouverte pour ceux qui tenteront systématiquement d'établir que les salariés n'ont pas tenu compte, en temps utile, de la « révélation » qui s'offrait à eux... La lisibilité et la clarté du droit ne sont pas au rendez-vous de cette rédaction singulière.
Si, comme vous prétendez, les objectifs sont partagés, il serait alors plus simple et plus clair d'écrire que l'action se prescrit « à compter du moment où la personne a pu en connaître l'ensemble des éléments », soit, mot pour mot, la définition qui figure dans les décisions de la Cour de cassation. Cette rédaction aurait le mérite de maintenir explicitement le droit positif sans polluer le débat par la référence à un concept de « révélation » aux contours aléatoires pour les victimes.
Le délai de cinq ans maintenu dans votre amendement, monsieur le rapporteur, constitue manifestement un dégât collatéral majeur pour le droit des victimes de discriminations et ne peut plus, aujourd'hui, être le résultat d'une erreur ou d'un malentendu. Vous ne pouvez, à la fois, prétendre que vous ne souhaitez pas porter atteinte aux droits des victimes de discriminations, et, maintenir cet amendement qui enferme leur action dans un délai de droit commun de cinq ans.

J'en termine, monsieur le président.
Cette démarche est contradictoire : alors que la majorité se prétend d'ordinaire être attentive au sort des victimes, force est de constater que cette attention trouve aujourd'hui ses limites puisque, du fait de l'adoption de ce texte, des victimes de discriminations vont connaître une réduction de leur capacité d'action ! Dans ces conditions, nous voterons résolument contre cette proposition de loi.

La discussion générale est close.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Monsieur le rapporteur, vous avez souligné que cette réforme était attendue, vous avez rappelé ses principaux apports et vous avez également mentionné que cette proposition de loi permettrait, de façon encadrée, de moduler la durée de la prescription. Il s'agit, en effet, de la reconnaissance du principe de liberté contractuelle auquel le Gouvernement est extrêmement attaché.
Monsieur Charles de La Verpillière, vous avez expliqué que ce texte constitue une réforme de modernisation et de compétitivité : je me réjouis de votre plein accord avec cette proposition de loi.
Monsieur Michel Vaxès, madame Martine Billard, vous avez relayé les inquiétudes de certains syndicats après l'adoption de la proposition de loi par le Sénat. Mon cabinet a reçu, à ce sujet, les représentant du syndicat CGT et les a rassurés sur les intentions du Gouvernement. Il s'est en fait produit une confusion entre le délai de prescription, après lequel il n'est plus possible d'introduire une action, et la durée du préjudice à réparer. Le délai de prescription est de cinq ans, mais si la discrimination a duré pendant trente ans, la réparation portera bien sur les trente ans. L'intérêt à agir sera désormais de cinq ans, mais la réparation du préjudice concerne la totalité de la durée durant laquelle le préjudice est avéré.
Il était hors de question pour nous de restreindre le droit à réparation. M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois du Sénat, et M. Laurent Béteille, rapporteur de la proposition de loi au Sénat, ont levé toute ambiguïté en faisant adopter par la Haute assemblée un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des luttes contre les discriminations. Il sera ainsi clairement inscrit dans la loi que si l'action est prescrite cinq ans après la découverte de la discrimination, la victime pourra obtenir une indemnisation sur la totalité du préjudice révélé. Votre rapporteur propose d'ailleurs de reprendre cet amendement dans cette proposition de loi, ce qui, à mon sens, constitue une excellente réponse aux légitimes inquiétudes des syndicats.
Messieurs Jean-Michel Clément et Alain Vidalies, vous critiquez le délai de prescription de cinq ans qui fait pourtant consensus aujourd'hui. Il reprend une recommandation du rapport élaboré, après un travail approfondi, par la mission d'information du Sénat présidé par M. Jean-Jacques Hyest. La Cour de cassation s'est ralliée à ce délai qui permettra à la France de se situer dans la moyenne européenne et internationale. Vous avez évoqué la question du délai butoir, je viens de m'en expliquer : il n'a rien à voir avec le droit à réparation.
Monsieur Michel Hunault, vous avez souligné que ce texte constitue un élément important de la réforme du droit des obligations. Il s'agit effectivement la première étape d'une réforme d'ensemble du droit des obligations que nous mènerons à bien. Vous avez également montré l'intérêt de ce texte en termes de simplification et de clarification de notre droit ; je partage entièrement votre analyse.

J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

Réformer la prescription, c'est utile ; réformer pour simplifier n'est pas idiot ; réformer pour harmoniser, c'est plutôt bien.

Mais, comme M. Vidalies l'a dit avec beaucoup de talent – même s'il n'est pas parvenu à convaincre la ministre –, si un délai de prescription de trente ans ne se justifie plus aujourd'hui, la mesure drastique qui consiste à le ramener de trente à cinq ans n'est ni raisonnable ni justifiée. Au reste, contrairement à ce que vous indiquez, madame la ministre, je ne suis pas sûr qu'une telle mesure fasse consensus, car beaucoup de voix se sont élevées récemment pour s'y opposer.
En fait, je crains que ce délai ne pénalise surtout les citoyens les plus fragiles, car il me paraît bien trop court pour qui connaît mal le droit. Or, nous vous le répétons à longueur de séance, les Français les plus fragiles – et ils sont des millions – subissent déjà de plein fouet votre politique en matière de logement, de pouvoir d'achat, de précarité de l'emploi – aujourd'hui, dans ma ville, ceux qui touchent un SMIC à 35 heures font figure de privilégiés – ou de santé, avec l'application scandaleuse des franchises médicales.

Il n'est donc pas raisonnable d'y ajouter cet élément, qui aggravera encore la situation des Français les plus fragiles.
Par ailleurs, comme l'a très bien démontré M. Vidalies, vous prétendez harmoniser et adapter notre droit à la concurrence des systèmes juridiques internationaux, mais le délai de la prescription est de six ans en Allemagne et en Angleterre – où il supporte beaucoup d'exceptions –, de dix ans en Italie, en Suisse, en Finlande et en Suède, et de quinze ans en Espagne.
Aussi, j'espère que vous écouterez mes collègues socialistes avec attention et que vous accepterez leurs amendements.

Nous en venons à l'examen des amendements sur l'article 1er.
Je suis saisi d'un amendement n° 21 .
La parole est à Mme Martine Billard, pour le soutenir.

L'amendement n° 21 est retiré.
Je suis saisi d'un amendement n° 2 rectifié .
La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

Cet amendement vise à consolider la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, qui considère que les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique, qu'elles relèvent ou non du droit commun.
Il est donc proposé que les actions en responsabilité contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans pour les ouvrages et deux ans pour les éléments d'équipement. Le point de départ de ces délais – la réception de l'ouvrage – est unique.
J'ajoute qu'il va de soi que les actions en responsabilité en matière de dommages corporels, auxquelles l'article 2226 du code civil est spécifiquement consacré, ne sont pas concernées par le dispositif que je vous invite à adopter.

Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié .
(L'amendement est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 1 .
La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

Il s'agit d'un amendement de clarification portant sur la numérotation des articles.

Je suis saisi d'un amendement n° 22 .
La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour le soutenir.

Cet amendement a trait à un problème que j'ai évoqué dans mon intervention et qui a fait l'objet de discussions lors des travaux de la commission. Le rapporteur du Sénat, M. Béteille, a reconnu lui-même que la rédaction qui nous est proposée de l'article 2219 du code civil est imprécise, dans la mesure où elle ne nous éclaire pas sur ce qui est éteint par la prescription.
Au-delà du débat technique qui oppose les juristes sur la conception de celle-ci, il serait donc précieux d'ajouter les mots « ou d'une action », sans quoi la définition de la prescription demeurerait trop restrictive, alors même que de multiples dispositions visent textuellement la prescription de l'action. Une telle précision présenterait l'avantage d'éclairer ceux qui, demain, auront à appliquer cette nouvelle définition de la prescription.

L'article 2219 du code civil définit en effet la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. L'ajout des mots « ou d'une action » serait donc de nature à rendre encore plus opaque le débat théorique qui occupe surtout les universitaires. La discussion qui porte sur le point de savoir si la prescription a pour effet d'éteindre un droit – selon la thèse substantialiste – ou seulement une action – selon la thèse « processualiste » – doit demeurer universitaire et ne présente aucun intérêt direct dans la vie quotidienne pour la mise en oeuvre de la prescription.
La définition adoptée par la nouvelle rédaction l'article 2219 penche plutôt pour la première solution. L'adoption de cet amendement compliquerait le texte et susciterait des débats théoriques artificiels qui, à mon sens, seraient contre-productifs par rapport à l'objectif de la proposition de loi.
Je partage les arguments du rapporteur. La question de savoir si la prescription est l'extinction d'un droit ou d'une action est un débat doctrinal. L'option retenue dans ce texte est celle de la prescription comme extinction d'un droit. Si l'on y ajoute l'action, on crée une confusion. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.

Je suis saisi d'un amendement n° 23 .
La parole est à M. Dominique Raimbourg, pour le soutenir.

Comme cela a déjà été dit lors de la discussion générale, la décision de ramener le délai de prescription à cinq ans nous paraît trop brutale. Par ailleurs, la réforme Badinter avait prévu que les actions en responsabilité civile issues de faits pénaux se prescrivaient par dix ans. En conséquence, si le délai est fixé à cinq ans, en matière criminelle par exemple, la prescription pénale sera supérieure à la prescription civile. Je vous concède qu'il s'agit d'une hypothèse d'école, mais c'est une des raisons qui nous incitent à juger plus raisonnable de fixer le délai de prescription à dix ans.

En effet, puisqu'elle n'est pas d'accord avec vous. (Sourires.) Plus sérieusement, le délai de cinq ans est consensuel…

Monsieur Roy, ne mélangeons pas les questions au Gouvernement et l'examen d'un projet de loi. Essayons, je vous prie, de travailler sérieusement sur ce sujet qui requiert un peu d'attention. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Non. Vous aurez la parole quand le président vous la donnera.
Le délai de cinq ans, disais-je, représente un point d'équilibre entre le risque d'un délai de prescription trop long, qui créerait de l'insécurité juridique, et celui d'un délai trop court, qui serait source d'injustice. Certains ont proposé dix ans, d'autres trois ans. Mais je ferai observer que, dans plusieurs réformes récentes, c'est le délai de cinq ans qui a été choisi. Je pense notamment à l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, qui a fixé à cinq ans la prescription des actions en contestation d'une filiation établie par un titre corroboré par la possession d'état ; à la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, qui a fixé à cinq ans la prescription des actions en nullité relative du mariage fondées sur un vice de consentement ; et, enfin, à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a fixé à cinq ans la prescription des actions en réduction des libéralités excessives.
Le délai de cinq ans ne résulte donc pas d'un marchandage. Il est l'aboutissement d'une réflexion cohérente, qui visait à définir un délai de droit commun qui représente un équilibre et permette une simplification du droit.
Le rapport de Jean-Jacques Hyest préconisait cinq ans, celui de M. Catala trois ans. La solution retenue correspond à la moyenne européenne et internationale. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Je suis saisi d'un amendement n° 19 .
La parole est à M. Michel Vaxès, pour le soutenir.

Je l'ai déjà présenté lorsque j'ai défendu la question préalable, mais je souhaite ajouter deux éléments aux arguments que j'ai développés lors de cette défense.
Tout d'abord, je souscris à l'appréciation qu'a faite Mme Billard de l'engagement du Gouvernement à ne pas toucher au droit du travail sans qu'une négociation ait eu lieu préalablement. Madame la garde des sceaux, vous avez indiqué avoir reçu des syndicats. C'est bien, mais cela s'appelle un échange de vues : une négociation, c'est autre chose. L'adoption de cet amendement, qui tend à exclure explicitement du dispositif de la réforme les relations entre salariés et employeurs régies par le code du travail, vous permettrait d'honorer l'engagement qui a été pris, quitte à revenir sur la rédaction du texte à l'occasion de l'examen d'un autre texte portant sur le même thème.
Par ailleurs, j'entends les explications que nous donnent M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux et un certain nombre de nos collègues de la majorité, qui veulent nous convaincre que nos inquiétudes n'ont pas lieu d'être, puisque rien ne changera. Par exemple, la réparation courra sur trente ans si le préjudice porte sur une telle période. En tout cas, nous dit-on, les dispositions de ce texte n'entraîneront aucune altération par rapport à la situation antérieure. Mais alors, pourquoi ne pas accepter l'amendement n° 19 ? Il faut me l'expliquer. Si, réellement, la nouvelle prescription ne change rien, mieux vaut conserver le dispositif existant.

La commission a repoussé cet amendement pour une raison très simple : situé à cet endroit du texte, il aurait pour effet de rendre imprescriptible toute action liée au code du travail. Si nous sommes ouverts à la discussion, nous ne sommes pas disposés à accepter l'anéantissement du texte !
En plus de l'argument exposé par le M. le rapporteur, j'insiste sur le fait que nous voulons rendre le droit plus simple et plus lisible en matière de prescription. Si l'on exclut, comme il est proposé de le faire dans cet amendement, les salariés du champ de la prescription, il devient impossible de déterminer quel délai de prescription leur est applicable. Si l'on souhaite protéger les salariés, il vaut mieux leur appliquer les dispositions prévues par le texte, ce qui ne nuit pas à leur droit à réparation. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Je suis saisi d'un amendement n° 3 .
La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

Cet amendement n'est pas sans importance, car il vise à préciser que la consolidation du dommage, à partir de laquelle débute le délai de prescription, doit s'entendre comme la consolidation du dommage initial, mais aussi du dommage aggravé, dans le cas d'un préjudice corporel.

Je suis saisi d'un amendement n° 24 .
La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour le soutenir.

L'article 6 ter de ce texte prévoit que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage », et je me félicite que la protection de l'environnement se traduise par l'application d'un délai de prescription de trente ans dans ce domaine.
Ce qui me gêne, en revanche, c'est de constater qu'à l'alinéa 22 de l'article 1er, l'action en responsabilité civile relative aux violences et agressions commises envers des mineurs ne soit prescrite que par vingt ans. Ainsi, les dommages subis par l'environnement bénéficient d'un délai de prescription plus long que les dommages subis par des personnes. Cette différence ne nous paraissant pas justifiée, nous proposons de continuer à appliquer le plus long délai de prescription figurant dans le code civil, à savoir trente ans, aux actions en responsabilité civile relatives aux actes particulièrement graves commis à l'encontre des personnes. C'est une question de bon sens, mais aussi de considération pour les personnes – ce à quoi vous êtes, me semble-t-il, particulièrement attachés.

La proposition de loi ne fait que reprendre les dispositions de l'actuel deuxième alinéa de l'article 2270-1 du code civil. Le maintien du délai de vingt ans vise précisément à prendre en compte la spécificité de ces situations. Par ailleurs, porter ce délai de vingt à trente ans créerait une asymétrie entre la prescription civile et la prescription pénale. En effet, l'article 7 du code de procédure pénale prévoit que « le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
Compte tenu de la gravité des actes en cause, il me paraît préférable que ce soit la durée de la prescription pénale qui serve de référence à la durée de la prescription civile. On introduirait une aberration juridique en permettant qu'une action puisse exister sur le plan civil alors qu'elle est prescrite sur le plan pénal. C'est pourquoi la commission a rejeté cet amendement.
M. Clément a évoqué la prescription applicable en cas de dommages causés à l'environnement. Or, en la matière, c'est une directive européenne, à laquelle nous ne pouvons déroger, qui nous impose un délai de trente ans. Par ailleurs, les dommages causés à l'environnement sont susceptibles d'être beaucoup long à se révéler, d'autant que le droit de l'environnement est un droit nouveau, dont la mise en oeuvre est d'une certaine complexité.
Quant aux dispositions relatives aux mineurs, elles ont déjà été modifiées en 2006 : au pénal, le délai de prescription est alors passé de dix ans après la majorité à vingt ans. Il n'y aurait pas de logique à passer de vingt ans à trente ans au civil dans la mesure où la victime d'un préjudice intente, la plupart du temps, d'abord une action pénale. Au contraire, le texte aboutit à une harmonisation des délais de prescription au pénal et au civil. Un délai de vingt ans après la majorité permet aux victimes d'intenter une action pénale, assortie d'une demande de réparation au civil, jusqu'à l'âge de trente-huit ans.


Je reconnais, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, que mon premier amendement présentait le risque que vous avez souligné. Fort heureusement, j'ai un amendement de repli, l'amendement n° 20 , qui ne présente pas les mêmes inconvénients.
Cet amendement a pour objet de lever les imprécisions de l'amendement que vous proposez à l'article 8 et, situé à l'article 1er, il marquera la volonté de notre assemblée de protéger le droit du travail.
Les dispositions adoptées par le Sénat le 9 avril dernier sur la proposition du président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, reprises par notre rapporteur à l'article 8, ne sont pas de nature à nous rassurer. La référence à la notion de révélation de la discrimination ne nous paraît pas suffisante, dès lors qu'on entend garantir non seulement la réparation de l'intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination exercée à son égard, mais aussi et surtout caractériser le préjudice et fixer le point de départ de celui-ci.
Ainsi, lorsque la discrimination porte sur un ralentissement de carrière du salarié pour des motifs prohibés, ce qui suppose des actes de discrimination répétés dans le temps – pas d'augmentation, pas de promotion, pas de formation professionnelle pendant plusieurs années –, un délai de cinq ans est manifestement insuffisant pour caractériser semblable discrimination. En effet, en cinq ans, l'entreprise peut n'avoir procédé qu'à un nombre restreint d'augmentations ou de promotions. La différence de traitement entre salariés aura, dans ce cas, peu de chances de pouvoir être démontrée de manière suffisamment probante pour que soit attribuée à l'entreprise la commission d'un acte discriminatoire.
Il n'est qu'à se rapporter aux décisions de la Cour de cassation pour mesurer l'importance de ces considérations. Je tiens à votre disposition un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2008 qui rappelle, comme elle l'avait déjà fait en d'autres occasions, que les dommages et intérêts octroyés relèvent de la prescription trentenaire et que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se trouverait si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. On ne saurait mieux affirmer l'étroitesse du lien qui noue la caractérisation du préjudice dans le temps à sa réparation intégrale. C'est la raison pour laquelle nous proposons de retenir comme point de départ de la prescription, non pas le moment où la personne discriminée aurait dû connaître sa situation ni la date de sa révélation – à supposer d'ailleurs qu'il soit possible de fixer une telle date –, mais le moment où le salarié a pu avoir connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant de s'estimer victime d'actes de discrimination.
Cette formulation rigoureuse permettrait de répondre à de très nombreux cas de discrimination progressive ou durable dont les juges ont à connaître, sans porter préjudice au droit des salariés et en évitant toute une série de contentieux que l'on peut imaginer si l'on conserve la formulation de l'amendement du rapporteur à l'article 8. Dans la mesure où il n'y a pas, dans les arguments exposés jusqu'à présent, de différence dans l'esprit de la loi entre l'amendement que vous proposez, monsieur le rapporteur, et le mien, rien ne s'oppose à l'adoption de l'amendement n° 20 à l'article 1er.

Nous abordons une question essentielle de notre débat. Je ne rappellerai pas l'historique de ce qui s'est passé au Sénat, toujours est-il qu'il y a aujourd'hui une tentative de réparation de ce qui peut être considéré, au choix, comme un oubli ou comme le résultat d'une volonté délibérée. Tout le monde s'accorde sur l'idée que la réparation doit porter sur l'ensemble de la période du préjudice. Restent deux questions.
La première, qui peut s'exprimer très simplement – encore faut-il que le Gouvernement et la commission le fassent –, est de savoir si la nouvelle législation modifie la nature de la réparation, puisqu'il n'est question dans le texte que de dommages et intérêts alors qu'actuellement, la réparation de la discrimination va plus loin et peut comprendre, par exemple, un repositionnement ou une reclassification. Afin que personne ne soit tenté de tirer profit de cette incertitude, il serait bon que le Gouvernement nous précise que cela ne change pas – je ne pense pas que cela puisse poser de difficultés.
La deuxième question, plus complexe, concerne le point de départ du délai de prescription. Le problème n'est pas que le délai soit de cinq ans ou de dix, mais que vous introduisiez dans le code civil le concept de « révélation ». Même en cherchant, je n'ai pas trouvé dans le code civil d'autre exemple de ce terme, qui a plus sa place dans des ouvrages théologiques ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) En tant que législateurs, nous devons éviter de recourir à des termes qui n'ont rien de juridique. Vous nous expliquez que la Cour de cassation a employé ce terme : certes, mais une fois seulement, et en donnant une explication. Le législateur est-il tenu de le reprendre, malgré les exigences de clarté qui pèsent sur lui ? Que vont comprendre nos concitoyens à la lecture d'un code civil où il serait question d'une « révélation » ?
Le débat n'est pas que sémantique. En page 19 de votre rapport, monsieur Blessig, vous écrivez que « dans l'hypothèse d'une action exercée par un salarié en réparation d'une discrimination dont il s'estime victime, ce salarié pourra agir une fois qu'il aura eu connaissance effective de tous les éléments lui permettant d'exercer son droit, c'est-à-dire lorsqu'il aura eu entre ses mains l'ensemble des documents permettant d'établir qu'il a été victime de cette discrimination. » Nous en sommes absolument d'accord, et ne disons d'ailleurs pas autre chose.
Seulement, à la page 21 du rapport, les choses se compliquent. Voici en effet ce qu'on peut y lire : « Votre rapporteur souligne que la “révélation” n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de la comparaison mettant en évidence la discrimination. Tant que le salarié ne dispose pas d'éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée… »
Monsieur le rapporteur, au vu de ces deux phrases, il apparaît clairement que vous allez ouvrir une brèche à tous ceux qui souhaiteront opposer la prescription à une action. Avec la « révélation » et les « éléments probants », vous introduisez une nouvelle notion qui prêtera à interprétation. Nous avons le sentiment que vous organisez une confusion que beaucoup tenteront d'exploiter.
La solution est extrêmement simple. Puisque le Gouvernement nous explique qu'il veut simplement modifier le délai sans changer aucune des conditions en vigueur, il suffit de reprendre la seule rédaction qui vaille, à savoir celle qu'il a lui-même utilisée dans ses explications et que l'on retrouve dans le rapport. C'est du reste le texte issu de l'explication donnée par la Cour de cassation et que nous avons repris dans nos amendements, M. Vaxès et nous-mêmes. Nous sommes au coeur du débat, il importe que l'action en réparation du préjudice commence à courir à partir du moment où le salarié discriminé a pu en connaître l'ensemble des éléments. Seule cette formulation apaisera les craintes que ce texte pourrait faire naître. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

Nous sommes en effet au coeur du sujet s'agissant de la prescription en matière de discrimination, sur laquelle nous reviendrons encore à l'article 8.
Quelques observations générales, tout d'abord. Ces amendements reviennent sur le délai de la prescription : je ne m'étendrai pas sur ce point puisque nous venons de le fixer à cinq ans – M. Vaxès proposait d'ailleurs le même délai.
S'agissant de la réparation totale du préjudice, nous sommes tous d'accord pour considérer que l'amendement Hyest répond à cette préoccupation.
Reste l'utilisation du terme « révélation ». Je le reconnais, je me suis interrogé, moi aussi, pour savoir ce qu'on pouvait entendre par ce mot. À cet égard, l'arrêt du 22 mars 2007 apporte une précision qui me paraît intéressante puisqu'il complète la connaissance de la discrimination par le fait de posséder concomitamment les éléments de comparaison, de preuve qui puissent établir cette discrimination. Autrement dit, il ne s'agit pas de la simple connaissance de la discrimination. Les éléments qui permettent de la démontrer sont également pris en compte.
La difficulté tient au fait que la discrimination est rarement le résultat d'un fait unique – c'est au contraire une action qui se prolonge dans le temps – et que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où le salarié est en possession de l'ensemble des éléments. Loin de vouloir jeter la confusion, j'essaie de démontrer que la notion de « révélation » est favorable au salarié puisque le délai de prescription de l'action, fixé à cinq ans, ne commencera à courir qu'à compter du moment où le salarié sera en possession de tous les éléments : l'existence de la discrimination et les preuves du dommage né de cette discrimination.
Je comprends donc mal les inquiétudes exprimées. La commission a rejeté ces amendements. Elle proposera à l'article 8 une solution globale, qui a fait l'objet de discussions approfondies au Sénat et qui a été validée par toute une série de consultations. Pour l'heure, j'invite l'Assemblée à s'en tenir à la rédaction du Sénat et à rejeter ces deux amendements.
M'étant déjà expliquée sur le délai, je n'y reviendrai pas.
S'agissant des modalités d'indemnisation et de réparation du préjudice, je rappelle que le texte n'apporte aucune modification en la matière. Cela peut être une indemnisation ou une réintégration, si la discrimination a donné lieu à un licenciement.
Pour ce qui est des éléments probants, ceux-ci ne sont pas seulement nécessaires en matière de discrimination, Pour qu'une décision de justice, une réparation interviennent, il faut des éléments de preuve ou des éléments probants, quelle que soit l'infraction. Ce n'est pas un régime propre aux discriminations. Vous souhaitez apporter des précisions pour éviter les polémiques. Mais cela va singulariser la lutte contre les discriminations, ce que nous ne souhaitons pas.

Le rapporteur et la ministre ne m'ont pas totalement convaincue. L'accumulation des termes employés m'inquiètent quelque peu. Mon collègue Vidalies y a fait allusion s'agissant du mot « révélation ». Il est vrai que l'interprétation de la révélation n'est pas simple… Du reste, il n'est jamais neutre d'introduire de nouveaux termes en droit car il y a derrière la construction d'une jurisprudence. Je crains qu'avec la réduction du délai et l'introduction de nouvelles notions, nous ne déstabilisions le droit en vigueur.
Je m'interroge par ailleurs sur un autre point très important. Actuellement, si un salarié introduit une action en justice de présomption de discrimination contre son employeur, c'est à ce dernier de prouver qu'il n'y a pas discrimination. Mais qu'en sera-t-il si la révélation implique que le salarié devra apporter des éléments probants ? Ne sommes-nous pas là en train d'inverser la charge de la preuve ? Il y a là en tout cas une ambiguïté.

Dans un cas, l'employeur devra prouver qu'il n'y a pas discrimination sous peine d'être condamné. Dans l'autre cas, et compte tenu de la phrase figurant page 21 du rapport que je rappelle ici : « Tant que le salarié ne dispose pas d'éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée et, donc, le délai de prescription de l'action du salarié ne peut pas courir. », c'est au salarié qu'il appartiendra d'apporter la preuve. Il nous faut donc préciser les choses et faire savoir que l'interprétation du rapporteur ne vaut pas.
Je rappelle en outre que l'amendement proposé par la commission à l'article 8 relatif à la prescription en matière salariale tend à réduire quelque peu la réparation, qui ne se fait pas forcément qu'en termes de salaire. Pour toutes ces raisons, l'amendement de Michel Vaxès, qui fixe le délai de prescription à cinq ans, me semble introduire une plus grande sécurité juridique. J'invite donc l'Assemblée à l'adopter.

Je partage totalement le sentiment de Mme Billard. Afin que cela figure dans le compte rendu de nos débats, j'attends que le Gouvernement confirme qu'il n'y a pas là inversion de la charge de la preuve.

Vous me le confirmerez.
Actuellement, c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'y a pas eu discrimination. Mais dans la nouvelle formulation, il semble que nous allions vers une inversion.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, et compte tenu notamment des extraits de votre rapport cités par M. Vidalies, je ne vois vraiment pourquoi vous demandez le rejet de nos amendements. Ainsi, la question du délai ne se pose plus, la rédaction des amendements sur ce point ne faisant que reprendre ce qui a été dit, tant par vous que par le président de la commission des lois. Et comme c'est le souci de la précision qui nous anime, nous souhaitons que les propos tenus ici trouvent une traduction législative ne souffrant d'aucune ambiguïté. Or seuls nos amendements semblent répondre à cette préoccupation. Si l'on ajoute à tout cela une suspicion d'inversion de la charge de la preuve, vous comprendrez qu'on puisse en déduire que les craintes soulevées dans la question préalable étaient peut-être légitimes.
Soyez rassuré, monsieur Vaxès, nous ne changeons rien aux règles de la charge de la preuve puisque les articles afférents ne sont pas modifiés. L'article 4 de la loi votée au Sénat le 9 avril 2008 est clair sur ce point. J'en rappelle les termes : « Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
Le demandeur pourra donc agir en justice. La plupart du temps, il faut attendre d'avoir un dossier complet pour agir en justice. Ici, cela devient possible dès la révélation des premiers faits, et c'est à l'employeur de déterminer que l'action est prescrite et non au demandeur : cela constitue un droit nouveau et une garantie supplémentaire pour le salarié. Enfin, c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'y a pas eu discrimination. Je vous confirme donc que les modalités de la charge de la preuve n'ont pas été modifiées.

Je suis saisi d'un amendement n° 26 .
La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour le soutenir.

Nous souhaitons supprimer les alinéas 32 et 33 de l'article 1er, qui créent un délai butoir, lequel a été critiqué par nombre de ceux qui ont étudié sa mise en oeuvre. En effet, cette disposition a pour effet que le report du point de départ du délai de prescription ne pourra conduire à ce que le délai de la prescription extinctive s'étende au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance de ce droit.
Ce délai butoir risque donc d'empêcher certaines personnes d'agir ; or, méconnaître le principe suivant lequel la prescription ne peut être opposée à celui qui est dans l'impossibilité d'agir est inconstitutionnel. C'est en tout cas ce qu'ont relevé certains commentaires, notamment le rapport de la Cour de Cassation.
Il serait donc de bon droit et de bonne justice d'éviter ce problème posé par le délai butoir. Par ailleurs, couplé à une réduction importante du délai de droit commun, ce délai apparaît comme une restriction par trop importante des possibilités d'action en justice.
Nous demandons donc la suppression de ces alinéas, non seulement à cause du risque d'inconstitutionnalité mais aussi parce qu'ils créent une discrimination nouvelle qui pourrait toucher les personnes dans l'incapacité d'agir.

Revenons à la notion de délai glissant qui ouvre le droit à l'action. À l'heure actuelle, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui revient à définir les choses du point de vue de la personne titulaire du droit.
Ce point de départ glissant a pour corollaire l'établissement d'un délai général au-delà duquel l'action est éteinte. Se pose alors la question du point de départ de ce délai butoir. Il est déterminé par le fait générateur, qui ouvre une période de cinq ans pendant laquelle, si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez exercer votre action. En tout état de cause, vingt ans après le fait générateur, cela n'est plus possible, de la même manière qu'avec la prescription trentenaire vous ne pouvez plus aujourd'hui exercer votre action trente ans et un jour après le fait générateur.
Le délai butoir est donc la conséquence du point de départ glissant du délai de prescription. Par ailleurs, il me semble qu'il doit y avoir un équilibre entre les droits de chacun des acteurs. La prescription ne joue pas uniquement pour le titulaire du droit ; elle est aussi un facteur de paix sociale, et l'on doit admettre qu'au bout d'un certain temps les actions cessent.
Ce délai butoir ne constitue donc nullement un risque ; c'est au contraire un facteur de pacification de notre système juridique. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le rapporteur, c'est le seul cas où, comme vous l'avez dit, c'est le fait générateur qui déclenche le déroulement des vingt années. C'est donc le seul cas où une personne peut être confrontée à la prescription d'un droit qu'elle ne connaissait pas. Parce que le délai butoir, c'est ça. Si la victime n'a pas eu connaissance du fait générateur, allez-vous lui expliquer, lorsqu'elle le découvrira au bout de vingt et un ans, que certes elle est victime, mais qu'elle était dans l'ignorance, qu'elle l'a appris trop tard et qu'il existe désormais un délai butoir qui n'existait pas auparavant ?
Je vous entends lorsque vous parlez de paix sociale, mais il s'agit ici d'un délai qu'on oppose à ceux qui n'ont pas exercé leur droit, et c'est bien le seul cas où il est opposé à ceux qui ne connaissaient pas ce droit. C'est pour ça que certains s'interrogent sur la constitutionnalité de cette initiative. S'il s'agit – et c'est bien la seule explication rationnelle que je trouve à cette disposition – d'inscrire dans la loi la première possibilité pour nos concitoyens de faire jouer l'exception d'inconstitutionnalité devant les juridictions, je comprends mieux… Mais dans le cas contraire, je vous invite à vous interroger sur cette démarche et à bien en mesurer la portée, car elle peut réserver des mauvaises surprises.

Aujourd'hui, la question se pose de la même manière avec la prescription trentenaire. La seule différence, c'est que nous réduisons ici le délai d'un tiers, alors que nous l'avons divisé par six pour la prescription de droit commun. Je maintiens donc mon avis défavorable.

Je suis saisi d'un amendement n° 4 .
La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

Il s'agit de ne pas appliquer le délai butoir pour la prescription entre époux et partenaires d'un pacte civil de solidarité.

Je suis saisi d'un amendement n° 27 .
La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour le soutenir.

Au chapitre des dispositions générales du cours de la prescription extinctive, nous souhaitons ajouter un article ayant pour objet de prévoir que les conventions qui ont pour effet d'abréger ou d'allonger la durée de la prescription sont réputées non écrites.
Nous souhaitons donner force à cette disposition en la déclarant d'ordre public, pour empêcher des rapports de force nuisibles dans les relations contractuelles. Il y a toujours un dominant et un dominé dans ce genre de situation, et nous voulons surtout empêcher un raccourcissement du délai de prescription au détriment du plus faible.
Il nous apparaît donc nécessaire et sécurisant d'intégrer dans ces dispositions générales un article qui donne force de loi à la disposition selon laquelle toute convention qui consisterait à allonger ou à raccourcir le délai de prescription est réputée non écrite.

La faculté d'aménagement contractuelle du délai de prescription constitue un renforcement de la liberté contractuelle, étant précisé qu'actuellement les parties peuvent de toute façon réduire contractuellement les délais de prescription, seul l'allongement étant interdit.
Le texte permet de mieux encadrer cette faculté, partiellement reconnue aujourd'hui par la jurisprudence. Elle est encadrée pour ne pas être préjudiciable aux parties les plus faibles, grâce notamment à l'adoption par le Sénat d'un amendement socialiste de M. Dreyfus-Schmidt, qui a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Cet amendement précise que les aménagements conventionnels du délai de prescription ne peuvent concerner les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers, charges locatives afférant à des baux d'habitation et fermages.
J'ajoute que ces aménagements contractuels ne s'appliquent pas en matière d'assurance ni en matière de consommation.
Par conséquent, il s'agit d'améliorer la liberté contractuelle, tout en préservant les droits des parties les plus faibles au contrat. La commission a donc mis un avis défavorable.
Même avis. Cette disposition consacre la liberté contractuelle. Dans le cas d'un contrat, les parties sont présumées égales : il n'y a ni dominant ni dominé, et c'est pour cette raison que, comme le disait le rapporteur, seules ont été prévues des dérogations interdisant la modification des délais de prescription dans les matières comportant un risque pour le consommateur, le salarié ou le locataire. S'il y a risque d'inégalité entre les deux parties, la prescription ne peut être modifiée. Pour le reste, c'est la liberté contractuelle, largement établie déjà par la jurisprudence.

Je suis saisi d'un amendement n° 28 .
La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour le soutenir.

Il s'agit, à l'alinéa 37 de l'article 1er, d'ajouter après le mot « condition », les mots « suspensive, jusqu'à ce que la condition se réalise. »
Selon nous en effet, le report du point de départ de la prescription au jour de la réalisation de la condition ne concerne que les obligations soumises à une condition suspensive. En présence d'une condition résolutoire, le droit est, à l'inverse, considéré comme exigible et la prescription commence donc à courir. La référence à la réalisation de la condition est à la fois plus technique et plus usuelle. Notre amendement est donc un amendement de précision, dont les utilisateurs de ce texte pourront faire le meilleur usage.

Nous sommes en effet dans une matière extrêmement technique. Le texte proposé reprend purement et simplement l'article 2257 du code civil, qui s'applique tant à la prescription extinctive qu'à la prescription acquisitive. Or, si pour la prescription extinctive il est généralement admis en doctrine que le texte ne vise que les conditions suspensives dès lors que rien n'empêcherait un créancier de poursuivre l'exécution de l'engagement dès le jour du contrat, tel n'est pas le cas en matière de prescription acquisitive.
Par le biais de l'article 2 de la proposition de loi, les règles de la prescription extinctive ont vocation à régir celles de la prescription acquisitive, sauf exception.
Dans la mesure où les conséquences de la modification proposée ne sont pas clairement identifiées, il me semble plus sage de s'en tenir au texte actuel, qui reprend l'article 2257 du code civil et qui, depuis 1804, n'a pas posé de problème. C'est la raison pour laquelle la commission a rejeté cet amendement.

Je suis saisi d'un amendement n° 29 .
La parole est à M. Alain Vidalies, pour le soutenir.

Avis défavorable du Gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 29 .
(L'amendement n'est pas adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 5 rectifié .
La parole est à M. Émile Blessig, pour le défendre.

Avis favorable du Gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié .
(L'amendement est adopté.)

Je mets aux voix l'article 1er, modifié par les amendements adoptés.
(L'article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 2 est adopté.)


Sur l'article 3, je suis saisi d'un amendement n° 30 .
La parole est à Jean-Michel Clément, pour soutenir cet amendement.
Jean-Michel Clément. Il est défendu.

Avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 30 .
(L'amendement n'est pas adopté.)


Sur l'article 4, je suis saisi d'un amendement n° 31 .
La parole est à M. Alain Vidalies, pour soutenir cet amendement.

Avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 31 .
(L'amendement n'est pas adopté.)

Sur l'article 5, je suis saisi d'un amendement de n° 32.
La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour défendre cet amendement.

Avec l'article 5, nous abordons les actions en annulation du mariage.
Comme nous l'avons dit en commission, la modification de l'article 181 du code civil est d'autant plus regrettable que la règle générale énoncée en matière de conventions matrimoniales, selon laquelle la prescription « ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts » – il s'agit de l'article 1304 du code civil –, n'est pas modifiée.
Cet amendement propose donc de supprimer l'alinéa 1 de l'article 5, dans un souci de cohérence.

La commission a rejeté cet amendement, et je vais m'en expliquer.
La disposition que l'amendement veut supprimer corrige une scorie de la loi de 2006. En effet, la proposition de loi vise à simplifier et à rationaliser le régime de l'action en nullité du mariage pour vice de consentement, prévu à l'article 181 du code civil. Le texte prévoit de ne retenir qu'un seul point de départ du délai de prescription, la date du mariage, et de supprimer le second point de départ, l'acquisition de la pleine liberté ou la découverte de l'erreur par l'époux qui l'invoque.
Avant la loi du 4 avril 2006, l'action en nullité du mariage pour vice de consentement était soumise au droit commun, c'est-à-dire un délai de cinq ans à compter de la cessation du vice. Toutefois, en cas de cohabitation pendant six mois, l'action de l'époux dont le consentement avait été vicié n'était plus recevable.
Dans les débats ayant précédé la loi du 4 avril 2006, les députés ont souhaité élargir ce délai de six mois à deux ans en cas de cohabitation, en maintenant l'autre délai de cinq ans, en l'absence de cohabitation. Dans un souci d'harmonisation des délais, le Sénat a porté, avec ou sans cohabitation, ce délai à cinq ans à compter du mariage.
La mention que la proposition de loi veut supprimer fait donc référence à l'ancienne rédaction de l'article 181 qui visait à restreindre les capacités d'action de l'époux. Son maintien involontaire étend les capacités d'action de l'époux au point que la nullité peut être demandée très tardivement. En effet, la conséquence de cette rédaction est que l'action est devenue possible dans les cinq ans à compter de la découverte du vice, et cela sans la limite du délai de cohabitation, cette référence ayant été supprimée. Elle est devenue possible sans réelle limite dans le temps.
Aussi, il est apparu nécessaire de fixer une seule et même limite, le délai de cinq ans, à compter de la célébration du mariage. Ce délai apparaît suffisant pour apporter une protection à l'époux qui veut contester la validité du mariage sur le terrain du vice du consentement. Et ne confondons pas la sanction des violences en cours de mariage et l'action en nullité du mariage pour vice de consentement du fait de violences.


Je suis saisi d'un amendement n° 33 .
La parole est à M. Alain Vidalies, pour le soutenir.

Madame le garde des sceaux, cet amendement vise à vous permettre d'harmoniser les délais dans un souci de cohérence.
En effet, ce texte comporte une curiosité. Alors qu'il prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les professionnels du droit qui perdent les pièces qui leur ont été confiées, certains bénéficient d'un traitement privilégié : les huissiers de justice. En effet, l'alinéa 3 de l'article prévoit que « l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans. »
Votre souci d'harmonisation des délais devrait vous amener à accepter cet amendement. Puisque nous sommes en train d'essayer de simplifier le droit et d'avoir un seul délai en matière de prescription, à quoi sert d'en créer un nouveau aussi spécifique ? Nous nous interrogeons sur les raisons de ce traitement particulier.

En fait, il ne s'agit pas d'un nouveau délai de prescription. Ce délai de prescription existait déjà : il est vigueur depuis 1971 et trouve mieux sa place ici.
Il existe pour les huissiers deux types de responsabilité : la responsabilité professionnelle, pour laquelle un délai de droit commun de cinq ans est prévu, et une responsabilité spécifique liée aux actes et qui tient au fait que les huissiers en France manipulent environ 10 millions d'actes par an. Depuis 1971 donc, il existe un délai spécifique lié à la possession des actes, délai de prescription qu'il convient de maintenir pour des raisons purement pratiques.
Avis défavorable.
Avis défavorable.

Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 8 .
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Je suis saisi de plusieurs amendements de la commission portant articles additionnels après l'article 6.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 10 .

Cet amendement est également de coordination. Le droit commun s'appliquera désormais aux experts judiciaires pour lesquels, jusqu'à présent, le délai de prescription était de dix ans. Celui-ci est ramené à cinq ans.


Cet amendement ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 6 bis est adopté.)

Sur l'article 6 ter, je suis saisi d'un amendement n° 34 .
La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour soutenir cet amendement.

L'article 6 ter dispose que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement […] se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage ». L'amendement n° 34 vise à remplacer la mention de « fait générateur » par celle de « manifestation » du dommage. En effet, le fait générateur du dommage sur l'environnement peut être fixé à une date très antérieure à la manifestation réelle de celui-ci. On parlait tout à l'heure de révélation : ce qui compte ici c'est la manifestation du dommage. Il ne faudrait donc pas que la mention « fait générateur » conduise à raccourcir les délais : ainsi, si la manifestation d'un dommage n'apparaît qu'après vingt-cinq ans, le délai de prescription risque de ne plus être que de trois ou quatre ans. Il faut donc éviter des conflits à venir.
Cet amendement s'inscrit dans le cadre de notre volonté d'une réparation obligée de la part ceux qui ont commis des dommages liés à l'environnement. On connaît des exemples dans des domaines industriels, pour lesquels la manifestation du dommage ne peut être réellement perçue qu'à l'occasion de faits bien particuliers : cela peut être le cas d'une construction qui nécessite de creuser le sol, alors que le fait générateur est bien antérieur et peut résulter, par exemple, de l'enfouissement dans le sol de matériaux polluants. Il peut également y avoir des manifestations beaucoup plus éloignées du lieu même où les biens auront été endommagés.

Le délai de trente ans découle d'une directive européenne du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. C'est cette directive qui fixe le point de départ de l'action en responsabilité en cette matière au moment de « l'émission, l'événement ou l'incident » ayant donné lieu au dommage. C'est pourquoi, à l'issue du débat au Sénat, l'article 6 ter de la proposition prévoit que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement […] se prescrivent par trente ans à compter de la date du fait générateur du dommage. »
L'adoption de l'amendement contredirait la directive. C'est la raison pour laquelle la commission l'a repoussé.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 7 est adopté.)

Sur l'article 8, je suis saisi d'un amendement n° 35 .
La parole est à M. Alain Vidalies, pour défendre cet amendement.


Cet amendement vise à préciser, dans le second alinéa de l'article L.3243-3 du code du travail, que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas arrêté de compte, pour lequel l'article 1269 du code de procédure civile s'applique. Il est en revanche proposé de supprimer la référence à l'article 2274 du code civil, qui est abrogé.

Je suis saisi d'un amendement n° 13 .
La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises au cours de la soirée. L'amendement n° 13 reprend le texte de l'article 4 bis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il est issu d'un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, adopté par le Sénat le 9 avril 2008.
Il vise à préciser, d'une part, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, d'autre part, que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Nous avons eu l'occasion d'approfondir cette question à propos d'amendements précédents. La commission a adopté celui-ci.

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

L'article 9 ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 9 est adopté.)

L'article 10 ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 10 est adopté.)

L'article 11 ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 11 est adopté.)

L'article 12 ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 12 est adopté.)

L'article 13 ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 13 est adopté.)

L'article 14 ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 14 est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 14 .
La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 14 .
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

L'article 16 ne fait l'objet d'aucun amendement.
Je le mets aux voix.
(L'article 16 est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 15 .
La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement n° 15 .
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 16 rectifié .
La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

Il s'agit d'un amendement d'harmonisation avec la rédaction retenue pour le premier alinéa de l'article 2222 du code civil.

Avis favorable du Gouvernement.
Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement n° 16 rectifié .
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Dans les explications de vote, la parole est à M. Alain Vidalies, pour le groupe SRC.

Ce texte aurait pu faire l'unanimité, mais ce ne sera pas le cas. En effet, sur le fond, nous voyons bien que d'importantes divergences subsistent. On y fait la part trop belle à la volonté d'offrir au monde des affaires un délai de prescription très court. Un consensus existait sur cette question jusqu'à la fin 2006, le Gouvernement et la Cour de cassation considérant que le délai devait être de dix ans. Or voilà que, brusquement, il est porté à cinq ans.
Nous notons également deux innovations importantes. La première est celle du délai butoir de vingt ans. Ainsi, quelqu'un pourra découvrir un fait générateur qu'il ne connaissait pas sans pouvoir faire valoir ses droits. Il s'agit d'une innovation considérable dans notre droit, à laquelle personne ici ne peut rester indifférent. La Cour de cassation elle-même s'est interrogée sur la constitutionnalité de cette initiative, ce qui n'a pas manqué de peser sur nos débats.
La question des aménagements conventionnels est également très complexe. On va pouvoir inscrire dans un contrat la possibilité d'une prescription inférieure à celle prévue par la loi. Or il ne s'agit pas simplement de liberté contractuelle, car la prescription n'est pas une disposition contractuelle ordinaire. La prescription n'a rien à voir avec le domaine contractuel. On mélange ici les genres. Au nom de l'assouplissement, on est en train de créer beaucoup de confusion.
Enfin, il y a la question de la discrimination. L'Assemblée nationale a tenté de réparer, pour partie, l'oubli − j'emploie ce mot pour ne blesser personne − du Sénat. Cette démarche a au moins réglé la question de la durée de l'indemnisation. Nos débats de ce soir ont permis de répondre à la question de l'absence de coïncidence entre la date butoir et la période d'indemnisation. L'indemnisation portera sur toute la période du préjudice, même si celui-ci a duré plus de vingt ans. Cependant, la rédaction retenue est mauvaise, source de difficultés, et nous regrettons de ne pas avoir trouvé une meilleure solution. Il s'agit de garantir des droits aux victimes des discriminations ; or je ne pense pas que la « révélation » qui a été inventée ce soir les protégera. Cette formule ouvrira plutôt la porte à des interprétations jurisprudentielles. Il aurait été préférable d'utiliser des mots simples. Je ne reproche à personne de ne pas vouloir lutter contre les discriminations, mais il est essentiel d'offrir aux victimes un droit clair et lisible.
C'est ce que vous n'avez pas fait ce soir et c'est pourquoi le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche votera contre l'ensemble du texte.

Je voudrais d'abord souligner l'excellente tenue et le grand intérêt des débats qui viennent de se dérouler. Au fil des articles et des amendements, Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur ont fourni des réponses convaincantes aux questions qui ont été posées sur tous les bancs. Je pense notamment au choix d'une durée de cinq ans, de préférence à une durée de dix ans, pour le délai de droit commun de la prescription extinctive, aux règles applicables à l'action et au droit à réparation des salariés qui s'estiment victimes de discrimination au travail.
En définitive, le texte auquel nous aboutissons est parfaitement équilibré. D'un côté, il atteint les objectifs de modernisation, de compétitivité, de simplification du droit, de sécurité juridique, qui lui étaient assignés ; de l'autre, il contient des dispositions précises qui protègent les intérêts des personnes en situation d'infériorité ou de vulnérabilité.
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'UMP est conforté dans l'impression favorable qui était déjà la sienne au stade de la discussion générale. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Comme nous avons exprimé notre préoccupation, Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur ont tenté de nous rassurer. Peut-être y sont-ils parvenus sur un point, en précisant qu'il n'y avait pas entre nous de différences d'appréciation, que nous n'avions pas, en tout cas, à être inquiets des motivations du Gouvernement. Dont acte.
Cependant, comme l'a dit mon collègue du groupe socialiste, même si nous avons le même souci concernant la réparation des discriminations en matière de droit du travail, la rédaction à laquelle nous avons abouti ne nous satisfait pas. Le groupe GDR votera donc contre ce texte, tout en souhaitant que le temps qui nous sépare d'une deuxième, voire d'une troisième lecture − puisque l'urgence n'a pas été déclarée sur cette proposition de loi −, soit mis à profit pour que nous nous mettions d'accord sur une rédaction consensuelle. Prenons le temps d'en discuter et de trouver ensemble une formulation qui satisfasse à la fois les représentants des salariés, que ce texte inquiète, et l'ensemble de la représentation nationale.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Déclaration du Gouvernement sur les langues régionales et débat sur cette déclaration.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 7 mai 2008, à zéro heure quarante.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma