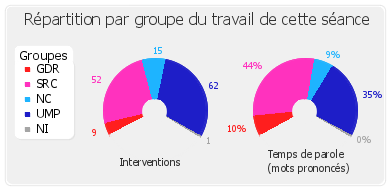Séance en hémicycle du 1er décembre 2010 à 15h00
Sommaire
- Questions au gouvernement (voir le dossier)
- Solidarité dans le domaine de l'alimentation en eau (voir le dossier)
- Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur (voir le dossier)
- Discussion d'une proposition de loi adoptée par le sénat après engagement de la procédure accélérée (voir le dossier)
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

L'ordre du jour appelle les questions au Gouvernement.
Mes chers collègues, le sida continue de progresser dans le monde. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'Assemblée nationale adresse un message de solidarité et d'espoir aux malades et à leurs proches, et réaffirme son soutien aux équipes médicales, aux chercheurs et aux associations.
À cette occasion, je souhaite en votre nom la bienvenue au professeur Willy Rozenbaum, président du Conseil national du sida. (Mmes et MM. les députés, ainsi que Mmes et MM. les membres du Gouvernement, se lèvent et applaudissent.)
Je vous rappelle que la Conférence des présidents a décidé, à l'unanimité, que les quatre premières questions au Gouvernement porteront aujourd'hui sur la lutte contre le sida.

La parole est à M. Jean-Louis Touraine, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

En cette journée mondiale du sida, ma question s'adresse à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Monsieur le ministre, l'épidémie de sida continue de progresser. Nous savons aujourd'hui que, pour la contrôler, il faut dépister et traiter tous les séropositifs. Les 50 000 Français porteurs du virus sans le savoir transmettent l'infection. Après un dépistage, ils deviennent plus précautionneux. Surtout, les trithérapies font chuter la quantité de virus dans leur organisme, ce qui permet une réduction très appréciable de la contagiosité.
Il a donc été opportun de corriger l'avant-projet de plan sida 2010-2014, en tenant compte des critiques du Conseil national du sida, de la Conférence nationale de santé et de beaucoup d'entre nous. Dorénavant, le plan inclut le dépistage généralisé et envisage de rattraper le retard de notre pays en termes de tests rapides.
Mais il n'y aura pas d'efficacité sans moyens humains et budgétaires appropriés.
Il importe en effet de diffuser les messages, d'organiser et de réaliser les tests de dépistage, de prendre en charge le traitement et le suivi des 50 000 sujets infectés supplémentaires, ce qui n'est compatible ni avec les regrettables mesures actuelles de réduction du nombre de services hospitaliers spécialisés, ni avec la diminution des effectifs de médecins, y compris généralistes, et d'infirmières. Il n'est pas raisonnable non plus de réduire le soutien financier aux associations qui vont accueillir davantage de malades.
Enfin, limiter la propagation suppose de traiter tous les malades sur notre sol et donc de revenir sur le choquant amendement Mariani, qui stipule que les malades étrangers ne peuvent pas bénéficier dans notre pays des thérapeutiques nécessaires. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC. – Exclamations sur quelques bancs du groupe UMP.)
Enrayer l'épidémie est maintenant devenu possible. Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à adopter une attitude moins frileuse et à amplifier très fortement les moyens dévolus à la lutte contre le sida ? Envisagez-vous, au moins pour des raisons de santé publique, de faire abroger l'amendement et les dispositions qui empêchent de soigner correctement les patients étrangers en France ? (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Monsieur le député, il est permis de penser que, pendant une journée au moins, en cette journée de lutte contre le sida, on pourrait laisser de côté un petit peu les positions partisanes (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC. – Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR) et reconnaître une chose au moins, que c'est une action collective, rassemblée, qui permettra de faire reculer cette terrible épidémie, cette terrible maladie.Rien de plus, rien de moins que cela.
Vous avez parlé de la contribution des uns et des autres. Tant mieux en effet que le plan 2010-2014, qui a été lancé par Roselyne Bachelot, tienne compte de la contribution de chacun, si cela permet de faire reculer cette maladie.
Mais, vous l'avez dit, tous les aspects sont importants dans la prise en charge du sida et une chose est certaine, c'est que le dépistage généralisé, que nous avons voulu instituer et auquel vous souscrivez vous-même, est un axe majeur.
Qui va porter ce dépistage ? L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, à travers des campagnes de promotion et d'information, mais aussi les médecins, qui ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Ne me dites pas que le nombre des médecins est en recul, ce n'est pas vrai. Ne me dites pas que les moyens sont en recul, ce n'est pas vrai. Les moyens sont sanctuarisés, ils ont même vocation à pouvoir augmenter pour répondre aux besoins qui sont les nôtres.
Nous avons bien conscience que la France a un rôle clef à jouer à l'international. Nous l'avons d'ailleurs toujours porté dans les sommets mondiaux sur le sida, je me souviens notamment m'être rendu à Toronto. Mais si la France a décidé d'augmenter de 20 % sa contribution triennale, c'est parce que nous sommes persuadés que ce rôle, nous devons le jouer aussi bien à l'intérieur de nos frontières qu'à l'international.
Nous étions tous ensemble pour applaudir le professeur Rozenbaum. Soyons ensemble pour lutter contre le sida. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
Journée internationale de lutte contre le sida

La parole est à M. Alain Marty, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État à la santé.
La journée mondiale de lutte contre le sida permet de faire le point sur cette maladie. Il faut rappeler que 33 millions de personnes sont malades dans le monde. Malgré les progrès accomplis ces dernières années en matière de prévention et de traitement, l'épidémie poursuit sa course à un rythme certes moins élevé mais toujours préoccupant, avec 2,6 millions de nouvelles infections en 2009. Rappelons que sur les 15 millions de personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenus faibles, seuls 5,2 millions de personnes bénéficient d'un traitement.
En France, en 2009, on estime à 7 000 le nombre de personnes contaminées par le VIH et à 6 700 le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité. Par ailleurs, comme vient de le rappeler le professeur Touraine, il resterait dans notre pays 50 000 personnes infectées qui ignorent encore leur situation sérologique et peuvent donc transmettre la maladie.
Au-delà des groupes les plus exposés ou les plus vulnérables que nous connaissons, les hommes ayant des rapports homosexuels, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes, les usagers de drogue, pour lesquels il faut poursuivre les actions spécifiques, il a été prouvé par modélisation que le dépistage systématique pouvait permettre de diminuer le nombre de personnes ignorant leur statut viral.
Ce dépistage permet un traitement plus précoce, à un moment où le nombre de lymphocytes est encore élevé, ce qui permet d'améliorer la survie et de réduire les contaminations. Les études montrant d'autre part l'intérêt en termes économiques et en termes de santé publique du dépistage systématique, pouvez-vous donc nous indiquer quelles sont les actions et les moyens que compte mettre en oeuvre le Gouvernement pour réduire le nombre des personnes séropositives et freiner la diffusion de cette maladie dans notre population ?
Monsieur Alain Marty, la France est résolument engagée dans la lutte contre le sida, et les campagnes que nous avons menées ont porté leurs fruits : le nombre de contaminations a baissé dans la population générale, et l'espérance de vie des malades a augmenté.
Néanmoins, on compte encore 7 000 contaminations par an et, parmi les 144 000 personnes qui vivent aujourd'hui avec le VIH, 40 000 à 50 000 ignorent encore leur séropositivité.
Nos prochaines campagnes ont donc pour but de banaliser le dépistage, d'une part pour un bénéfice individuel – il est important que le dépistage soit le plus précoce possible, pour augmenter les chances face à la maladie – et, d'autre part, parce qu'en matière de santé publique il est essentiel d'éviter la propagation de l'épidémie.
Il faut donc d'abord inciter la population à se faire dépister par des actions ciblant directement les individus mais également les médecins traitants. Il faut ensuite intensifier le dépistage chez les populations à risque, à savoir les hommes ayant des relations homosexuelles, les migrants, les usagers de drogue et les prostituées.
En 2011, nous mettrons en oeuvre les tests rapides d'orientation diagnostique, qui permettront de dépister plus facilement les personnes parfois exclues du système de santé. Ces tests seront disponibles pour les professionnels de santé mais aussi pour les non professionnels habilités par les agences régionales de santé.
Je terminerai en disant que la lutte contre le VIH doit combiner éducation, prévention grâce au préservatif et dépistage.
Journée internationale de lutte contre le sida

La parole est à Mme Marie-George Buffet, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, l'immense travail des chercheurs – et je veux à mon tour saluer le professeur Rozenbaum –, la compétence des soignants et l'engagement des associations ont permis de grandes avancées dans la lutte contre le sida. Après des années de plomb, un formidable espoir s'est levé.
Mais cette journée nous rappelle que, face au VIH, l'heure reste à la mobilisation : mobilisation pour la prévention et pour de nouveaux progrès dans les traitements et dans l'accès à ceux-ci.
Toutes les auditions du groupe d'études sur le sida que j'ai l'honneur de présider montrent qu'il est possible de marquer maintenant des points décisifs contre la maladie. C'est possible si des moyens supplémentaires sont dégagés rapidement et si tous les obstacles à l'accès aux soins sont levés.
Monsieur le ministre, c'est dans ce contexte qu'avec mes collègues je vous interroge sur les objectifs de votre gouvernement, car la France est, et peut être encore davantage, un repère dans ce combat.
Il faut impérativement dégager des moyens en allant vers un doublement de notre participation au Fonds mondial et en faisant le nécessaire pour développer le dépistage systématique ; lever les barrières dans l'accès aux soins en maintenant et en développant partout à l'hôpital public les accueils spécialisés, pour toutes et tous, sans discrimination – je pense notamment à l'accès à l'AME.
Il faut aussi retirer, comme le demandent les plus hautes instances de lutte contre sida, l'article 37 octies de la LOPSSI, qui criminalise le dépistage ; assurer la prévention dans les enceintes pénitentiaires avec, par exemple, l'échange des seringues, pour éviter de nouvelles contaminations. Enfin, alors que la maladie se féminise, il faut accorder des moyens supplémentaires aux associations qui agissent pour développer l'accès au préservatif féminin et faire reculer les logiques de domination patriarcale.
Monsieur le ministre, ce chantier est exigeant, mais il est porteur de progrès humain. Quelle nouvelle étape la France va-t-elle franchir dans ce combat contre le sida ? (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

La parole est à M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Madame Marie-George Buffet, je sais l'engagement qui est le vôtre à la tête de ce groupe d'études qui rassemble députés de droite et de gauche pour lutter contre le sida.
Concernant l'accès aux soins, vous avez évoqué l'AME : vous savez que la tuberculose et le sida sont des pathologies pour lesquelles l'accès aux soins sera toujours possible – et je vous remercie d'acquiescer ici à mon propos.
Concernant notre engagement international, la France est le deuxième contributeur au monde et le premier par habitant. Nous entendons intensifier cet engagement et continuer de faire pression pour que d'autres pays s'engagent aussi massivement.
En effet, même si aux yeux de certains l'épidémie marque le pas, il ne doit pas en être de même des financements. Parce que 10 millions de personnes sont encore en attente de traitement, les progrès réalisés au plan international sont insuffisants et doivent être poursuivis.
Parmi les objectifs du plan 2010-2014 figure une réduction de 50 % du nombre de personnes infectées dans les cinq prochaines années, notamment grâce à la généralisation du dépistage. C'est un objectif ambitieux, mais nous sommes persuadés qu'avec les associations et les nouveaux centres associatifs chargés du dépistage, avec les médecins généralistes et l'ensemble de la population, nous pourrons marquer des points contre cette maladie.
Je crois comme vous que la prévention est un éternel combat. Et je dis oui au développement du préservatif féminin, que nous avons initié il y a quelques années. Il faut par ailleurs relancer les campagnes d'accès facile au préservatif, comme le préservatif à 20 centimes que j'avais lancé en son temps. Il faut faire oeuvre de prévention auprès de toutes les populations, pour faire reculer cette maladie. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Journée internationale de lutte contre le sida

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour le groupe Nouveau Centre.

Monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, il y a quelques semaines, les représentants des pays les plus riches se sont rassemblés à New York pour discuter du financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
En seulement huit ans, le Fonds mondial a sauvé environ six millions de vies dans les pays récipiendaires de fonds et il s'est affirmé comme l'exemple éminent du partenariat au XXIe siècle dans la lutte contre ces trois maladies, que l'on peut prévenir et traiter. Il faut rappeler qu'elles sont responsables à elles seules de plus de 15 000 morts chaque jour, dont près de 6 000 victimes pour le seul virus du sida.
Malgré tout, cette réunion du Fonds mondial n'a même pas été en mesure de mobiliser le minimum de fonds attendus. En effet, sur les 20 milliards de dollars nécessaires afin d'atteindre les objectifs qui devaient notamment permettre un accès universel au traitement contre le VIH, seuls 12 à 13 milliards de dollars seraient rendus disponibles.
Pourtant, le Fonds a démontré son succès. Alors, que la crise planétaire menace la collecte des fonds, il convient donc de rechercher de nouveaux moyens de financement et de nouvelles ressources.
Une bonne piste me semble être la création d'une taxe sur les transactions de change en gros sur quatre devises majeures. Il faut savoir que le monde des devises étrangères est le plus gros marché du monde – il représente une valeur de 800 000 milliards de dollars par an – et que c'est le seul des secteurs financiers qui n'est pas du tout taxé. Si une taxe minuscule, au taux de 0,004 %, était appliquée, elle permettrait de lever environ 25 milliards de dollars tous les ans, soit plus que ce qui est espéré pour vaincre le VIH.
Alors que cette idée est évoquée depuis plusieurs années, le Président de la République française a lancé un appel pour cette nouvelle approche du financement lors du sommet de l'Objectif du millénaire pour le développement. En mobilisant son puissant réseau diplomatique, la France a une occasion historique d'offrir au monde une arme pour lutter contre le sida et le vaincre.
Monsieur le ministre, les vies de millions de malades, dépendent de nos actions collectives pour lever les fonds nécessaires à la lutte contre la maladie et à l'éradication de la pauvreté. C'est pourquoi je souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des initiatives diplomatiques pour y parvenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe NC.)

La parole est à M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Monsieur Jean-Christophe Lagarde, je sais l'engagement qui est le vôtre en faveur de cette cause, notamment en ce qui concerne ses développements internationaux – nous devons, en effet, nous mobiliser sur ce plan.
On compte un peu plus de 33 millions de malades dans le monde et 10 millions d'entre eux sont en attente de traitement. La France a toujours été aux avant-postes : il y a eu l'initiative d'Unitaid, portée par Philippe Douste-Blazy,…
…soutenue en permanence par le Président Jacques Chirac ; il y a également eu le GIP Esther, qui permet de développer de multiples coopérations dans de nombreux pays afin d'améliorer la prise en charge des malades.
Vous le savez, il faut aller encore plus loin. Le Président de la République l'a rappelé devant l'ONU, à New York. Nous sommes favorables à une taxation des transactions financières. Pourquoi la finance serait-elle exonérée de cette contribution légitime qui permettrait de faire reculer l'épidémie ?
Dans le cadre du G 20 et du G 8, dont la France assume cette année la présidence, nous voulons que Mme Christine Lagarde et Mme Michèle Alliot-Marie puissent porter ce dossier et que cela nous permette d'avancer.
Lors de création d'Unitaid et de son financement par une taxe de solidarité sur les billets d'avion, nous avons été pionniers ; nous voulons l'être encore, pas pour le plaisir de jouer ce rôle, mais pour que notre action ait un effet d'entraînement et pour que nous puissions ainsi trouver des ressources supplémentaires pour satisfaire les besoins de financement.
Nous devons avancer dans cet esprit ; il est de notre responsabilité de susciter une mobilisation sur le plan national mais aussi sur le plan international. Ce sera aussi l'honneur de notre pays. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

La parole est à M. Christian Paul, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, les déserts médicaux sont devenus dans nos territoires une angoisse pour de très nombreux Français, dans le monde rural, mais aussi dans beaucoup de quartiers de nos villes.
Ce sont des cantons sans médecins, des attentes de plus d'un an pour la consultation des spécialistes, des hôpitaux de proximité privés de services vitaux, d'urgences ou de maternité.
Face à ce drame, nous faisons ici, depuis des années, le même constat terrible : les incitations financières ne suffisent pas, il faut une refondation de notre système de santé, il faut réformer la formation et moderniser en profondeur les missions, les rémunérations et les conditions d'exercice.
Monsieur le ministre, il faut aussi le courage politique d'une régulation des installations. Le laisser-faire n'est plus possible, la liberté d'installation absolue ne doit plus être un dogme car il faut limiter, plafonner les installations dans les zones bien dotées, parfois trop dotées, en médecins. Ce n'est pas, comme vous nous le reprochez parfois, une intention de coercition brutale ; c'est de la régulation des installations, au nom de l'intérêt général. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe SRC.)
Face au drame des déserts médicaux, les professionnels tentent de s'organiser et les collectivités construisent des maisons de santé. Mais que fait le Gouvernement ? Rien de neuf, rien d'ambitieux et rien de sérieux. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) Il fait de la politique spectacle (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP), comme le Président de la République, ce matin, à la reconquête électoraliste du corps médical que vous avez déçu. (Mêmes mouvements.)
Vous faites des rapports, toujours des rapports, comme celui de madame Hubert, dont le diagnostic confirme, certes, le problème, mais dont l'ordonnance bien tiède n'est pas à la hauteur.
Alors, monsieur Bertrand, cessez de faire l'historique du problème – vous le faites depuis huit ans –, prenez à coeur cette question pour assurer enfin aux Français une égalité réelle d'accès aux soins et à la santé ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Monsieur Christian Paul, quel dommage que vous n'ayez pas été là, ce matin, à Orbec, car vous auriez pu saluer certains de vos amis politiques qui y accueillaient le Président de la République. Je les ai même vus acquiescer en écoutant les propos de Nicolas Sarkozy sur la médecine de proximité. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Voulez-vous que je vous donne des noms ? Je les tiens à votre entière disposition et Mme Norra Berra pourra vous confirmer mes propos. (Mêmes mouvements.)
La santé n'est pas une question de gauche ou de droite, mais la gauche et la droite ont le droit d'avoir des opinions différentes. Monsieur Paul, je ne partage pas vos opinions en la matière. Il faut appeler les choses par leur nom : votre limitation, ou votre régulation, est en fait de la coercition, de l'obligation (Vives protestations sur les bancs du groupe SRC),…
…ce qui est en contradiction avec l'exercice libéral de la médecine.
C'est à croire que vous n'avez toujours pas compris que l'on marche bien sur ses deux jambes. La médecine marche sur une jambe publique et sur une autre libérale ; il faut les prendre en compte toutes les deux. Je serais d'ailleurs très étonné que vous n'ayez pas un discours différent de celui que vous venez de tenir dans l'hémicycle, au nom de l'idéologie, quand vous adressez aux médecins libéraux dans votre circonscription. Voilà aussi la vérité du parti socialiste ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP. – Protestations sur les bancs du groupe SRC.)
Si l'on mettait en place vos propositions, il y aurait dans quelques années une crise des vocations. Vous pourriez toujours jouer sur le numerus clausus ; les jeunes se détourneraient des études médicales. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Si vous voulez nous accompagner dans le plan que nous mettrons en place dans les semaines qui viennent, libre à vous. Mais laissez-moi vous dire que l'ordonnance du parti socialiste en matière de médecine de proximité est tout sauf bonne, et, au fond de vous, vous le savez. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Serge Grouard, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Madame la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la conférence de Cancún vient de s'ouvrir. Après la déception de Copenhague, l'an dernier, les enjeux restent entiers ; ils sont au nombre de quatre.
Premièrement, il convient de fixer les règles de l'après-Kyoto, ce protocole arrivant à échéance en 2012. Deuxièmement, il faut rappeler l'objectif de limiter à deux degrés Celsius le réchauffement climatique. Troisièmement, il est nécessaire de limiter la déforestation et de prévoir les mécanismes qui permettront la reforestation, notamment dans les pays du sud. Enfin, il faut mettre en oeuvre et rendre opérationnel le fameux « Fonds vert », dont les moyens sont aujourd'hui plus virtuels que réels.
Nous savons la détermination avec laquelle la France s'engage dans ces négociations et aborde l'ensemble des questions liées au développement durable. Ainsi, le Grenelle de l'environnement a été et demeure une formidable dynamique. Quant à la négociation du paquet climat-énergie au niveau européen, qui fut une réussite, elle a été portée par la France, laquelle est particulièrement présente, depuis l'origine, dans les négociations internationales.
Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer, premièrement, quelle est, au regard des enjeux que je viens de rappeler, la situation exacte à Cancún, deuxièmement, quelle est la position des États – notamment celle des États-Unis et de la Chine, qui, à eux seuls, émettent 40 % des gaz à effet de serre – et, troisièmement, quelles sont les perspectives du système onusien, dont chacun sait qu'il est aujourd'hui fortement critiqué ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Monsieur Grouard, je tiens, tout d'abord, à vous féliciter pour votre élection, ce matin, à la présidence de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) Je souhaite pouvoir nouer des relations pérennes et de qualité avec chacun des membres de votre commission.
La conférence de Cancún, sur laquelle vous m'interrogez, s'est ouverte cette semaine et se prolongera jusqu'au 11 décembre. J'y participerai, avec plusieurs membres de votre assemblée, de la majorité comme de l'opposition, la semaine prochaine.
Cette conférence se construit sur l'accord de Copenhague, qui, en dépit de ses faiblesses, constitue une première étape. Tout d'abord, il est soutenu par plus de 130 États et associe des pays qui émettent plus de 80 % des gaz à effet de serre, dont les États-Unis et les pays émergents.
Ensuite, cet accord traduit clairement l'objectif, que vous avez rappelé, de limiter à moins de deux degrés Celsius le réchauffement des températures. Enfin, il propose d'allouer de nouvelles ressources aux pays en développement, dont 10 milliards de dollars par an à partir de l'année 2010, la France contribuant à hauteur de 420 millions d'euros.
Mesdames, messieurs les députés, à Cancún, il s'agit d'avancer sur ces espérances. Lors de l'ouverture de la conférence, l'ambiance a paru plus constructive que ce que nous avions pu envisager et, pour tout dire, que ce que nous avions pu craindre. Notre objectif est de parvenir à l'adoption d'un paquet de décisions de mise en oeuvre de l'accord de Copenhague qui soit équilibré et à une deuxième période d'engagement pour les pays signataires du protocole de Kyoto.
Le résultat n'est pas acquis, mais sachez, monsieur le député, que je me rendrai à la conférence en étant déterminée à faire entendre la voix de la France et à faire avancer les négociations internationales dans ce cadre multilatéral qui est garant de nos responsabilités envers la planète. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Noël Mamère, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. (Huées sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, ma question a trait à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à la Haute autorité de santé, qui sont au coeur de deux scandales, et peut-être d'un troisième. (Murmures sur les bancs du groupe UMP.)
Le premier de ces scandales concerne le Mediator, prescrit à 5 millions de patients et peut-être à l'origine de 500 décès. Le second met en cause une prothèse mammaire – pardonnez-moi cette paronomase en forme de jeu de mots bien involontaire – et concerne près de 30 000 femmes ; le laboratoire dont il s'agit exporte près de 90 % de ses produits.
Par ailleurs, un livre d'enquête consacré aux produits injectables destinés à combler les rides contient peut-être une nouvelle bombe. En effet, parmi ces produits, le Macrolane, fabriqué par un laboratoire suédois, a provoqué beaucoup de dégâts. Cela fait trois ans maintenant que les spécialistes ont alerté l'AFSSAPS et la Haute autorité de santé. Or, pour l'instant, rien n'a été fait. Nous sommes donc très loin, en matière de sécurité sanitaire, de la vigilance qu'exercent, par exemple, les États-Unis, grâce à la Food and drug administration.
Le Mediator est utilisé depuis 1976. En 1997, les États-Unis l'ont supprimé. En 1999, il fut à l'origine, d'un premier accident très grave survenu à Marseille, qui a été signalé. L'Espagne l'a interdit en 2005. Pourquoi, monsieur le ministre, alors que vous étiez déjà ministre de la santé, en 2006, avez-vous laissé la Haute autorité de santé déclarer qu'il n'y avait rien de grave ? Pouvez-vous nous dire pourquoi ce médicament n'a été interdit qu'en 2009 ?
Allez-vous prendre les décisions qui s'imposent pour mettre fin aux conflits d'intérêts entre les membres de l'AFSSAPS et les laboratoires pharmaceutiques ? (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

La parole est à M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Monsieur le député, le Mediator a été autorisé en 1974 et il a été commercialisé en 1976. Soyons précis : aux États-Unis, il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché. Ainsi que vous l'avez vous-même indiqué, il convient de bien respecter la chronologie des faits et de ne pas se perdre dans les approximations.
C'est la raison pour laquelle, avec Nora Berra, nous avons décidé, dès le lendemain de notre installation, de saisir l'Inspection générale des affaires sociales de ce sujet sur deux points importants.
Premièrement, nous souhaitons que soient reconstitués tous les événements qui se sont produits concernant le Mediator, en prenant en compte ce qui s'est également passé dans les pays étrangers, notamment en Europe, de façon à étudier, compte tenu des différents travaux, ce qui mérite, ou non, d'être revu et amélioré.
Deuxièmement, nous avons demandé qu'au terme de sa mission, l'IGAS nous fasse des recommandations afin que la santé publique soit améliorée en permanence ; si des progrès sont nécessaires, ils seront réalisés.
Monsieur Mamère, je crois qu'il faut renforcer la pharmacovigilance à partir de ce que les spécialistes appellent les signaux faibles. J'ai rencontré le docteur Frachon, qui avait eu connaissance de cas. Les données recueillies par les centres régionaux doivent permettre de renforcer la pharmacovigilance.
Nous devons également nous demander si nous pouvons utiliser davantage les données de l'assurance maladie, en respectant la confidentialité des données personnelles.
La mission de l'IGAS rendra ses conclusions, non pas dans plusieurs mois, mais dans le rapport d'étape qu'elle doit me remettre le 15 janvier. Comme vous, je veux tout savoir, et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires.
En attendant, permettez-moi de vous dire que la priorité, ce sont les patients ; nous devons nous assurer que toutes celles et tous ceux qui ont pris du Mediator peuvent consulter leur médecin traitant. La santé publique avant tout, monsieur Mamère ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP. – Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, il est évident pour chacun d'entre nous que la médecine ambulatoire libérale de notre pays, qui traverse une crise existentielle sans précédent, est en plein désenchantement.

Le médecin généraliste d'aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui d'hier. Les jeunes acceptent de moins en moins de sacrifier leur vie de famille à un métier qui, pourtant, les passionne. À l'aube d'un choc démographique sans précédent, causé par les départs à la retraite de très nombreux professionnels, non compensés par l'installation de nouvelles générations, la médecine dite de proximité attend désormais une reconnaissance, un cap et surtout des actes.
L'enjeu est évident : il s'agit de structurer un nouveau modèle d'exercice libéral apportant des réponses nouvelles aux questions de l'accès aux soins et de la santé publique. Après les EGOS, la mission Legmann, la mission Vallancien sur les maisons de santé, dernièrement, à la demande du Président de la République, une nouvelle mission de concertation sur la médecine de proximité a été confiée à Mme Élisabeth Hubert.
Monsieur le ministre, vous étiez ce matin en déplacement avec le Président de la République et Mme Hubert.

Je vous remercie de nous faire connaître les grandes orientations, qui seront certainement plus convaincantes que ce qui transparaît des propositions idéologiques du groupe socialiste que vient de nous révéler M. Paul.
Si renouveau et changement il y a, ce doit être dans l'intérêt de la profession, tout en garantissant à nos concitoyens un accès satisfaisant et équitable à l'offre de soins de premier recours. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Monsieur le député, notre objectif premier est de garantir et de renforcer, en de nombreux points du territoire, l'accès aux soins pour nos concitoyens. Que ce soit dans les zones rurales ou dans certains de nos quartiers, nous avons envie et besoin d'avoir davantage de professionnels de santé : des médecins généralistes, bien sûr, mais pas seulement. Il doit également y avoir des infirmières et un masseur kinésithérapeute, par exemple, comme nous l'avons vu ce matin à Orbec, de façon à produire une véritable offre de santé partout. Cela passe par un exercice davantage regroupé sur la base du volontariat…
…mais aussi par un mode de rémunération qui peut évoluer, à titre expérimental dans un premier temps : le paiement à l'acte, auquel peut s'ajouter un forfait, notamment pour la coordination des soins.
Cela passe, enfin, par le financement des structures de maisons de santé – il y a déjà, actuellement, des crédits pour 250 maisons de santé.
Nous souhaitons également permettre une valorisation de la médecine générale en termes de formation, à laquelle nous travaillons avec Nora Berra et Valérie Pécresse.
Sur tous ces sujets, le Président de la République a souhaité s'engager personnellement.
Pour simplifier la vie quotidienne et le travail des médecins, nous ne nous contenterons pas de mots, comme certains l'ont fait à une époque (Exclamations sur les bancs du groupe SRC), mais concrétiserons nos intentions par des actes. Très rapidement, avant la fin de cette année, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, j'installerai une instance de concertation avec l'assurance maladie et les représentants des professionnels de santé, et nous prendrons les premières dispositions dès le début de l'année 2011.
Dans un souci de pragmatisme, nous allons revenir sur un certain nombre de modalités de la loi HPST qui n'ont pas été comprises. Nous répondrons ainsi à une attente des professionnels de santé, dont nous avons besoin pour redonner confiance en notre système de santé au bénéfice des patients, de nos concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Jean-Marie Le Guen, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Ma question s'adresse à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, ainsi qu'à M. le garde des sceaux. Le 1er décembre est, pour tous nos compatriotes et pour nous-mêmes, sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, une journée de mobilisation contre le SIDA. Tous ensemble, nous voulons promouvoir les efforts en faveur de la recherche, du développement et de la coopération. Nous, députés, portons une attention toute particulière aux questions d'accès aux soins. Il est étonnant de constater que le Gouvernement, qui se targue de son rôle de premier plan dans la coopération internationale, refuse d'accueillir les étrangers présents sur son territoire. Nous voyons, sur ce défi de santé publique, une contradiction qui nous pose problème sur le plan moral. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP – Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Ma question, qui a pour objet de faire avancer nos politiques de santé publique, concerne tout particulièrement les personnes incarcérées. Comme vous le savez, 60 % de ces personnes sont des usagers de drogue. Parmi ces 60 %, 12 % ont reçu des injections de drogue à l'intérieur de la prison, dont 30 % après des partages de seringues. Vous mesurez, monsieur le ministre, les conséquences de cet état de fait en matière de santé publique : cela signifie des infections pour les personnes concernées et un foyer de développement de l'épidémie à l'intérieur des prisons – mais aussi, demain, à l'extérieur, lorsque ces personnes sortiront.
Ma question est simple, monsieur le ministre : pourquoi n'acceptez-vous pas la présence d'échangeurs de seringues à l'intérieur des prisons, alors que ce dispositif est admis sur la voie publique, dans nos quartiers ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le député, de nombreux individus entrant en prison déclarent une utilisation prolongée et régulière de la drogue. C'est pourquoi il est proposé à chaque détenu, lors de son incarcération, un bilan de santé portant notamment sur sa consommation de produits stupéfiants, d'alcool et de tabac.
Le suivi médical de ces détenus est pris en charge par le ministère de la santé dans le cadre des unités de consultations et de soins ambulatoires, les UCSA, présentes dans chacun des établissements et des services médico-psychologiques régionaux. Ces structures assurent une prise en charge sanitaire et la distribution éventuelle de produits de substitution, ainsi qu'une prise en charge sociale comprenant l'orientation, à la sortie des structures carcérales, vers des structures extérieures spécialisées.
Depuis 1992, il existe, dans les établissements les plus importants, des unités pour sortants ayant pour objet d'assurer à l'extérieur le suivi des détenus toxicomanes. (« La question ! » sur les bancs du groupe SRC.) Plus récemment et à titre expérimental, une dizaine de programmes de prévention de la récidive ont été mis en place.
Pour ce qui est des échanges de seringues (« Ah ! Tout de même ! » sur les bancs du groupe SRC), le ministère suit les préconisations d'une mission interministérielle qui souligne le caractère inopportun de ces échanges en prison. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Nous nous en tenons donc à cette préconisation.
Je profite que la parole me soit donnée à ce sujet pour rendre hommage au personnel de l'administration pénitentiaire, qui exerce un métier particulièrement difficile.

La parole est à M. Yves Albarello, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le président, ma question s'adresse à M. le ministre de la culture et de la communication, et j'y associe bon nombre de députés, amis, présents dans cet hémicycle. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Monsieur le ministre, dans quelques jours aura lieu la traditionnelle émission du Téléthon, diffusée par France Télévisions dans le cadre d'une convention pluriannuelle entre la télévision du service public et l'Association française contre les myopathies, l'AFM. Or cette émission, qui correspond à l'édition 2010, marque la fin de la convention pluriannuelle qui liait jusqu'à présent France Télévisions et l'AFM. Et, à ma connaissance, le renouvellement de cette convention n'a pas encore été signé pour 2011 et les années suivantes.
L'incertitude qui pèse ainsi sur les prochains Téléthon pourrait avoir de lourdes conséquences sur le devenir de l'AFM et son action en faveur de la recherche scientifique et médicale, tant en France que dans le monde. Les projets soutenus par l'AFM étant pluriannuels, ils ont besoin de stabilité et de visibilité pour que leur existence soit assurée.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner l'assurance, au nom du Gouvernement, que la signature de la prochaine convention avec France Télévisions permettra la poursuite de l'organisation du Téléthon dans les conditions actuelles, c'est-à-dire dans le cadre d'un partenariat récurrent avec l'AFM, à l'abri de tout risque de dilution ou de démantèlement du Téléthon ? Nous resterons, quant à nous, vigilants et déterminés sur la suite que vous voudrez bien donner à ce dossier. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe NC.)

La parole est à M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication.
Monsieur le député, le Téléthon est une formidable initiative qui a été lancée en 1987 par l'Association française contre les myopathies pour appeler l'attention sur les maladies génétiques méconnues, pas si rares que cela et toujours terribles. Tout le monde garde ainsi le souvenir de la mort du jeune Grégory Lemarchal, talentueux lauréat de la Star Academy, dont le combat et le destin justifient à eux seuls le Téléthon.
C'est aussi une fête populaire considérable. Tous, nous avons assisté à ces soirées dans les centres de promesses, la nuit, en région, où un formidable élan attirait les dons, multipliait les défis, suscitait le dévouement des artistes. Le Téléthon, ce sont aussi des résultats remarquables, avec des sommes importantes récoltées et scrupuleusement gérées, avec des avancées de la recherche considérables, avec un regain d'attention pour la dignité des malades et le soutien des familles, avec la découverte enfin de ce phénomène ignoré jusqu'alors, celui des maladies orphelines.
Cependant, le Téléthon sous sa forme télévisuelle connaît un certain essoufflement. D'autre part, la controverse de l'année dernière, insistant sur le fait que l'émission de télévision ne donnait peut-être pas suffisamment accès aux autres pathologies, a souligné cet essoufflement.
Pour toutes ces raisons, je pense, avec le soutien de Rémy Pflimlin, qui a décidé que l'édition 2010 serait exemplaire par la qualité et l'importance des artistes…
… qu'il faut être vigilant sur la renégociation de la convention entre le Téléthon et France Télévisions, et sur la dynamisation du programme télévisuel, qui est essentielle pour être assuré que l'émission perdure. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Serge Janquin, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Madame la ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, le sommet de Barcelone de l'Union pour la Méditerranée a été reporté sine die tant il est apparu impossible de mettre autour de la même table les représentants israéliens et palestiniens. C'est d'abord un échec sévère, quoique prévisible, de la diplomatie française.
Par ailleurs, la relance des discussions directes de paix soutenue par le Président Obama peine à sortir de l'ornière, le Premier ministre d'Israël M. Netanyahu conditionnant la prorogation de la période d'arrêt du processus de colonisation à une augmentation de l'aide militaire, économique et diplomatique américaine à Israël en même temps qu'à la fixation d'un nouveau tracé de la frontière.
L'État d'Israël répète les provocations comme l'ont montré l'opération « Plomb durci » contre Gaza, et l'attaque brutale, le 31 mai, d'un convoi humanitaire d'ONG sans armes, et hors des eaux territoriales israéliennes.
Sur le terrain, la descente aux enfers continue.

La colonisation israélienne se poursuit, implacable, bien au-delà de la ligne verte de l'armistice de 1949, déclenchant le risque d'une nouvelle intifada.
Face à cette situation, l'inertie française est patente.
Madame la ministre, la filiation politique qui est la vôtre exprimait une certaine politique arabe de la France. Entendez-vous, au titre de la diplomatie française, en liaison avec l'Europe et le quartet, rappeler le gouvernement d'Israël à ses obligations, telles qu'elles résultent des résolutions des Nations unies ? Quelles initiatives pensez-vous prendre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)

La parole est à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.
Monsieur le député Janquin, la position de la France a toujours été très claire et elle le demeure. Nous voulons la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, établi sur la base des frontières de 1967.
Nous voulons dans le même temps la garantie pour Israël de sa sécurité et de sa pleine intégration dans la région.
Nous voulons la proclamation de Jérusalem comme capitale des deux États. Cette position est claire et répétée à chaque occasion.
Nous déplorons aujourd'hui que les appels unanimes de la communauté internationale à une prorogation du moratoire israélien sur la colonisation n'aient pas encore été entendus.
La colonisation doit cesser, le maintien du moratoire est essentiel pour donner toutes ses chances à la négociation.
Dans cette négociation, nous le disons clairement : nous soutenons les efforts américains de façon qu'il puisse y avoir une avancée en la matière – même si nous déplorons que l'Europe et le quartet ne soient pas suffisamment associés.
Nous nous réjouissons également aujourd'hui que, dans ce contexte, la Ligue arabe ait laissé la porte ouverte à une reprise des négociations bilatérales. Il est évident qu'il faut progresser. C'est un domaine qui conditionne la stabilité de toute la région et même celle du monde.
C'est la raison pour laquelle notre diplomatie, à tous niveaux, et sur les bases qui sont celles que je viens de rappeler, agit au quotidien et avec beaucoup de fermeté et de clarté. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMPet sur plusieurs bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Jacques Kossowski, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Ma question s'adresse à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.
Madame la ministre d'État, depuis le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a fait quelque 250 000 morts, ainsi que de nombreux sans-abri et orphelins, Haïti et son peuple connaissent une nouvelle tragédie. En effet, depuis plusieurs semaines, ce pays est frappé par une importante épidémie de choléra qui a coûté la vie à plus d'un millier d'habitants et obligé à l'hospitalisation d'environ 3 000 personnes.
Cette situation catastrophique impose plus que jamais une mobilisation de la France dont les liens historiques et d'amitié avec Haïti sont étroits.
Alors que vient de se dérouler ce week-end, dans la plus grande confusion, le premier tour des élections présidentielles, pourriez-vous nous dire précisément où en est la phase de reconstruction du pays ?
Je tiens à rappeler que, dans ce contexte chaotique, plus de trois cents enfants adoptés par des familles françaises demeurent toujours bloqués sur l'île. Il est urgent d'obtenir leur rapatriement en France afin qu'ils soient enfin accueillis par leurs nouveaux parents.

Ces derniers font preuve d'une motivation et d'un courage exemplaires, comme je le constate à la lecture des différents courriers que je reçois à ce sujet.
D'autre part, il est surprenant que l'aide internationale fournie depuis un an par de nombreuses nations ou des ONG ne se traduise pas assez sur le terrain par une normalisation, surtout en matière d'accès à l'eau, aux soins et au logement. N'assistons-nous pas, comme par le passé, à un détournement de cette aide internationale par quelques réseaux mafieux ? Dans quelle mesure la France peut-elle veiller à ce que les aides financières et matérielles profitent bien à la population locale?
Madame la ministre d'État, je souhaiterais que vous pussiez répondre, devant la représentation nationale, à ces interrogations. Soyez-en remerciée. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et quelques bancs du groupe SRC.)

La parole est à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.
Monsieur le député, la situation d'Haïti est une préoccupation importante pour la France, qu'il s'agisse du problème sanitaire, du problème humain des enfants adoptés ou du problème politique et institutionnel. Sur le plan sanitaire, nous avons essayé, dès le début, d'ailleurs, de l'épidémie de choléra, d'aider au maximum les autorités locales par l'envoi de personnel médical, de matériel et de médicaments.
Je me suis entretenue avec le Premier ministre d'Haïti dès mon arrivée au ministère des affaires étrangères. Dès le lendemain, je lui ai envoyé un avion supplémentaire. Dans le même temps, je me suis également entretenue avec lui de la situation des 320 enfants adoptés qui se trouvent encore sur le territoire haïtien.
Tout d'abord, en ce qui concerne leur santé, nous avons envoyé un pédiatre spécialisé et des infirmiers pour permettre une prise en charge et le rapatriement de ces enfants.
Au cours de notre conversation téléphonique, le Premier ministre haïtien a accepté qu'il y ait un échange de lettres valant accord gouvernemental pour que ces enfants puissent être ramenés en France. J'espère qu'avant la fin de l'année les 300 enfants adoptés qui sont encore en Haïti rejoindront leur famille en France. Je pense que c'est un point important. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe NC.)
Enfin, sur le plan politique et institutionnel, il y a eu des élections, qui ont effectivement donné lieu à un certain nombre de difficultés, de violences et de fraudes. Néanmoins, la commission internationale chargée de superviser les élections estime que ces fraudes n'entachent pas totalement le premier tour de scrutin. Au départ, les candidats au premier tour avaient massivement refusé de participer. De nouveaux candidats ont néanmoins accepté de participer au deuxième tour. Celui-ci doit avoir lieu : c'est essentiel pour qu'il puisse enfin y avoir une reconstruction des institutions. Elle seule peut permettre une reconstruction de l'État, à laquelle, bien entendu, la France participera. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

La parole est à M. Alain Rodet, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Ma question s'adresse à M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, et concerne l'appel d'offres relatif au programme de fabrication du porteur polyvalent terrestre destiné à équiper notre armée de terre pour la prochaine décennie. Le montant de ce marché est de près d'un milliard d'euros, pour 2 400 véhicules lourds à huit roues motrices.
Selon certaines informations publiées la semaine dernière dans la presse économique, ce programme « PPT » pourrait être attribué à un constructeur italien, sur des recommandations de la direction générale de l'armement. Or les entreprises françaises du secteur concerné, Renault Trucks Défense, Nexter, Panhard et leurs sous-traitants ont acquis une grande expérience et enregistré des résultats probants dans le domaine des véhicules tactiques de l'armée de terre. De plus, s'agissant du présent appel d'offres, il apparaît que, si Renault Trucks Défense a bien intégré dans sa réponse tous les éléments contenus dans le cahier des charges, ce serait loin d'être le cas du soumissionnaire italien.
Si une telle décision de délocalisation de ces fabrications devait être confirmée, elle aurait de lourdes incidences économiques pour notre industrie : directement, plusieurs centaines d'emplois seraient menacées ; indirectement, de nombreux sites de sous-traitance seraient gravement affectés.
En outre, des informations émanant de l'Agence européenne de la défense indiquent, par ailleurs, que l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne recourent très peu souvent à la procédure des appels d'offres.
Aussi, monsieur le ministre d'État, pourriez-vous nous communiquer les éléments en votre possession à propos de cet appel d'offres et pourriez-vous nous rappeler votre attachement à notre industrie de défense qui, au cours des années écoulées, a consenti des efforts considérables de productivité et de qualité dans l'élaboration de ses matériels ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Éric Besson, ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Monsieur le député, je vous réponds en l'absence du ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, qui est en déplacement cet après-midi.
La direction générale de l'armement du ministère de la défense a effectivement lancé un appel d'offres destiné à l'acquisition d'environ 2 000 camions appelés « porteurs polyvalents terrestres », qui existent en plusieurs versions, notamment des dépanneurs et des transporteurs logistiques particulièrement attendus – vous l'avez souligné – par notre armée de terre. Deux groupements d'entreprises présentent des offres recevables. Le ministère de la défense sera amené à choisir par application des critères définis lors de la consultation et, évidemment, dans le respect de notre législation et du droit européen. Ces groupements comptent tous les deux des sociétés françaises. L'un d'entre eux ayant présenté une requête en référé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, vous comprendrez, monsieur le député, que le ministère de la défense attende que le tribunal rende son jugement avant toute initiative concernant la suite de cette procédure de marché public.
Pour le reste, nous ne pourrions bien entendu que nous féliciter d'une fabrication à dominante française. Nous devons cependant respecter scrupuleusement les procédures, et nous allons le faire. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Isabelle Vasseur, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, dans le cadre du vaste programme de réforme de l'État, la fonction publique est engagée dans un indispensable mouvement de réorganisation et de regroupement de ses services. Cela concerne l'ensemble des administrations, qu'elles soient centrales, régionales ou départementales ; des directions interministérielles ont récemment été mises en place, afin de répondre à l'intérêt général tout en assurant une meilleure offre de service public, dans le respect, naturellement, des agents.
Le décret relatif à la réorientation professionnelle des fonctionnaires est paru le 16 novembre dernier, à la suite du vote de la loi du 3 août 2009 sur la mobilité et les parcours professionnels des fonctionnaires.
Les syndicats s'en inquiètent et craignent, certainement à tort, que ce décret n'entraîne des licenciements de fonctionnaires. (Exclamations sur les bancs du groupe GDR.)
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur les intentions du Gouvernement ? Quelles seront les modalités d'application de ce décret, et quelles seront ses conséquences pour l'ensemble des fonctionnaires ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique.
Madame la députée, vous connaissez bien l'ensemble de la fonction publique, et pas seulement la fonction publique hospitalière. Le décret auquel vous faites référence est important.
De quoi s'agit-il ? François Baroin et moi-même avons engagé une série de discussions avec les organisations syndicales, afin de leur présenter nos grands chantiers de réforme. Certains touchent directement les agents – je pense aux moyens apportés aux organisations syndicales, au régime indemnitaire, et notamment au supplément familial de traitement, ainsi qu'au régime des non-titulaires. Certaines réformes touchent aux structures : c'est notamment le cas de la réforme de l'administration territoriale de l'État.
Tout naturellement, en raison de la réorganisation que vous avez très bien décrite, des postes seront supprimés.
Jusque-là, ce type de situation était régi par un décret de 1984, pris sous le gouvernement de M. Mauroy : lorsque le poste d'un agent était supprimé, si celui-ci n'acceptait pas le poste que l'on lui proposait, l'agent en question pouvait être radié de la fonction publique. Nous avons considéré, et je pense que tout le monde en est d'accord, qu'il fallait améliorer le système.
Dorénavant, trois postes seront proposés à l'agent, à la suite d'un long entretien professionnel au cours duquel ses perspectives de carrière seront évoquées. L'agent aura, trois fois de suite, la possibilité de dire que le poste proposé ne lui convient pas. Après trois refus, l'agent – qui jusqu'à présent, je le rappelle, était radié de la fonction publique après un seul refus – demeurera dans la fonction publique, mais en disponibilité. On lui proposera trois postes supplémentaires : c'est donc à l'issue de six propositions, et non plus d'une seule, que l'agent pourra être radié des cadres.
C'est donc, vous le voyez, une formidable avancée : au lieu d'une radiation immédiate, on passe à six propositions de postes. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Catherine Quéré, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, c'est au nom de tous mes collègues socialistes des régions viticoles que je souhaite vous interroger sur la libéralisation des droits de plantation qui doit intervenir dans l'Union européenne au 1er janvier 2016 et qui menace toutes nos régions viticoles.
Aujourd'hui l'encadrement du potentiel de production est défini par un système de gestion des droits de plantation, en France, mais aussi en Europe. Ce système permet d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande en conditionnant les droits de plantation aux capacités de croissance des marchés, tout en évitant les plantations anarchiques en période d'euphorie.
Monsieur le ministre, vous et votre prédécesseur vous êtes battus, c'est vrai, pour faire repousser l'échéance de cette libéralisation de 2013 à la fin de l'année 2015 ; mais dans le rapport que vous a remis il y a quelques jours Mme Catherine Vautrin, on peut lire page trente-et-un que la France ne fait pas partie des pays opposés à la suppression des droits de plantation. Comprenez notre stupeur !
C'est pourquoi nous vous demandons d'exprimer une position claire sur cet enjeu d'avenir capital pour nos régions viticoles, et de vous mobiliser au niveau communautaire contre ce système libéral, pour constituer un front des pays favorables au maintien d'outils de régulation pour notre secteur. Nous vous demandons enfin de faire de ce sujet l'une des priorités de la France dans la réforme de la PAC. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.
Je vous prie d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Bruno Le Maire, qui est actuellement en déplacement à Bordeaux – c'est d'ailleurs votre région – pour traiter de la question importante des légumes.
La position française, à propos des négociations sur la régulation des marchés agricoles, est très claire et très simple ; elle ne comporte aucune ambiguïté. La France est aux avant-postes d'une demande de régulation supplémentaire des prix et des marchés agricoles. La Commission européenne a d'ailleurs repris à son compte la position française, vaillamment défendue par le ministre de l'agriculture ; c'est un premier point marqué par la France.
D'autre part, l'accord franco-allemand arrête une position commune sur une régulation supplémentaire des marchés agricoles ; il nous permettra d'orienter la négociation diplomatique à l'échelle européenne sur l'après-PAC en 2013.
S'agissant de la question particulière des droits de plantation, notre position est également très claire : la France est opposée à la suppression des droits de plantation.
Le Gouvernement a sollicité Catherine Vautrin, élue de Champagne-Ardenne, remarquablement compétente en la matière. Le Gouvernement s'approprie son rapport, qui porte notamment sur une nouvelle gouvernance et sur la place de l'interprofession dans la définition des nouveaux droits de plantation.
La libéralisation des droits de plantation présente des risques importants : le risque, dans les zones très productives, d'une explosion des plantations sans règles et sans réglementation partagée par l'interprofession ; le risque de déplantations et finalement – l'histoire étant dans la géographie, la géographie étant dans l'économie – d'un appauvrissement progressif des départements qui s'appuient sur la richesse de leurs plantations.
La France souhaite une régulation supplémentaire ; elle est opposée à la suppression des droits de plantation, et elle s'approprie ce rapport, qui deviendra le fil conducteur de la position française à Bruxelles.
Droits de plantation

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Élisabeth Guigou.)

Madame la présidente, monsieur le rapporteur de la commission des lois, mesdames, messieurs les députés, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a consacré dans son article premier l'existence d'un droit à l'eau pour tous. Celui-ci à été codifié à l'article L. 210-1 du code de l'environnement, qui dispose : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »
L'eau est globalement peu chère en France : en moyenne, son coût représente 0,8 % du revenu des ménages. Le prix de l'eau est de 3,09 euros le mètre cube, contre une moyenne européenne de 3,44 euros. Pourtant, la facture d'eau constitue une charge importante pour les plus démunis : pour 200 000 foyers, elle dépasse 3 % du revenu du ménage, qui est la limite acceptable selon l'OCDE.
En outre, la disparité des prix de l'eau amplifie ce déséquilibre social. La moyenne départementale oscille en effet entre moins de 2,5 euros et plus de 4 euros le mètre cube.
La proposition de loi du sénateur Cambon, adoptée le 11 février 2010 en première lecture au Sénat dans une version amendée, renforce le dispositif du fonds de solidarité pour le logement. Elle permet aux services d'eau et d'assainissement d'aider les plus démunis à payer leur facture d'eau, par l'intermédiaire des fonds de solidarité logement.
Ce renforcement doit permettre de toucher une plus large proportion de bénéficiaires potentiels. Actuellement, 60 000 ménages ont bénéficié du FSL au titre du volet « eau », mais le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé à 526 000.
L'autre intérêt de ce dispositif est qu'il nous fait passer d'un fonctionnement par abandon de créance, très onéreux en coût de gestion, à un fonctionnement en « fonds réels », beaucoup plus économique. Les délégataires indiquent que pour 2,5 millions d'euros d'abandon de créance, les coûts de gestion des services d'eau peuvent atteindre entre cinq et sept millions d'euros.
Cette proposition de loi est soutenue par le Gouvernement, et notamment par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.
Ce dispositif « curatif » doit être complété par un dispositif « préventif », pour un financement de même ampleur.
Il faut remercier le Conseil national de l'eau, et particulièrement son président, André Flajolet, pour les travaux qu'il a menés depuis un an sur ce dispositif préventif.
En la matière, nous avons deux types de solutions.
Nous pouvons opter soit pour une tarification sociale, à l'instar de ce qui existe pour le téléphone, soit pour une allocation, comme pour l'aide personnalisée au logement.
La tarification sociale semble plus difficile à mettre en oeuvre pour l'eau, car, à la différence des opérateurs de téléphonie, qui ne sont qu'une poignée, ceux de l'eau sont plus de 15 000.
De plus, en matière d'eau, on trouve à la fois des abonnés individuels et des abonnés collectifs, de sorte que l'on ne peut proposer un tarif social sur les premiers mètres cubes de la facture qui bénéficierait aux abonnés en pavillons individuels, mais pas aux abonnés collectifs en HLM.
La solution d'une taxe de 0,5 % sur la facture d'eau, associée à une allocation aux ménages modestes pour que leur facture ne dépasse pas 3 % de leurs revenus, s'affranchit de ces contraintes.
Elle nécessite cependant de mettre en place une organisation pour comparer ces deux valeurs – la facture d'eau, d'une part, et les revenus, d'autre part – et risque également de générer des coûts de gestion importants.
Le Conseil national de l'eau a identifié les caisses d'allocations familiales comme possibles opérateurs. Mais elles sont plutôt réticentes, et elles ne connaissent pas tous les publics – je pense notamment aux agriculteurs. Les conseils généraux, gestionnaires du FSL, pourraient également être opérateurs.
Il me semble donc indispensable d'approfondir ces questions avant de choisir entre les deux solutions. C'est l'objet de l'amendement qui a été adopté en commission sur proposition de M. Flajolet, et qui demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur ce dispositif préventif. Pour travailler sereinement, le Gouvernement souhaiterait toutefois pouvoir disposer d'un délai de six mois pour remettre ce rapport. En contrepartie, il s'engage à présenter dans le cadre du PLF pour 2012 les modifications législatives nécessaires qui en découleront.
Notre pays, qui milite pour que le droit à l'eau pour tous soit reconnu au niveau international, accueillera à Marseille, en mars 2012, le Congrès mondial de l'eau. Nous disposerons alors d'une législation dotée, depuis 2006, d'un droit à l'eau, et forte désormais d'une maîtrise en amont par son aspect préventif, et en aval par son aspect curatif. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Guy Geoffroy, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce texte, relativement court, relativement simple, n'est pas pour autant anodin. Même s'il pourrait apparaître, vu son intitulé, comme relevant d'un cadre technique, il le déborde largement et revêt, au travers de sa dimension sociale, un caractère proprement politique, dans le sens le plus noble du terme.
Dans la continuité du droit à l'accès au logement inscrit dans la loi depuis 1990, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a affirmé le droit d' « accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». La présente proposition de loi, issue d'une initiative du sénateur Christian Cambon, vise à rendre plus effectif ce droit.
Elle nous permettra d'améliorer l'état existant. En partant des propositions qu'elle contient, et en nous appuyant sur les travaux de la commission des lois, nous avons aujourd'hui, en séance publique, l'occasion d'aller encore plus loin. Nous le ferons d'ailleurs sur la base des engagements qui viennent d'être pris par le Gouvernement, et que je reçois, si vous me permettez l'expression, « cinq sur cinq ». Non seulement nous allons pouvoir approfondir le volet curatif, mais nous pourrons définir un volet préventif dans un délai rapproché, dont le terme vient d'être fixé par le Gouvernement : la loi de finances pour 2010.
Il est important de réfléchir à la mise en place de ce volet préventif. À cet égard, je voudrais à mon tour saluer le très important et très décisif travail du Comité national de l'eau et de son président, notre collègue André Flajolet, avec lequel j'ai travaillé sur ce texte. Je suis d'ailleurs, avec certains de mes collègues, cosignataire d'un certain nombre d'amendements. Certains ont pu prospérer, puisqu'ils ont été acceptés en commission. D'autres ne pourront malheureusement pas être examinés en séance publique, ayant été déclarés irrecevables au titre de l'article 40.
Sans m'appesantir sur un sujet qui a été largement abordé en commission, je me propose de dresser ici le bilan du dispositif actuel, en exposant ses qualités mais aussi ses insuffisances. Cela me permettra de montrer en quoi la proposition du Sénat constitue une novation tout à fait intéressante, sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour lui adjoindre un mécanisme préventif.
Le système actuel est né dans la foulée de la création du RMI et des fonds de solidarité pour le logement, gérés par les départements, et dont la mission est d'apporter des aides financières sous diverses formes pour que nos concitoyens puissent honorer leurs factures d'eau, d'énergie, et de services téléphoniques.
Si l'on peut dire que ces mesures fonctionnent bien et permettent de couvrir les besoins s'agissant de l'énergie et des services téléphoniques, en ce qui concerne le service de l'eau, nous sommes loin du compte. Le secrétaire d'État a rappelé qu'en dépit des efforts des FSL, des CCAS et des CIAS, les difficultés subsistent. Les chiffres ont été rappelés : huit à dix fois plus de nos concitoyens sont potentiellement concernés par ces difficultés d'accès et de solvabilité par rapport à l'eau que l'ensemble des dépenses du FSL n'en prend en charge. Le rapport est de 65 000 à 500 000, ce qui est considérable.
Ajoutons que trois-quarts seulement des FSL intervient effectivement dans le domaine de l'eau, soit soixante-treize, ce qui montre qu'un quart de notre territoire n'a pas de politique structurée en la matière au sein des FSL.
Si l'on ajoute à cela que seul l'habitat indépendant est concerné, et que les personnes logées en habitat collectif paient leurs factures d'eau dans leurs charges générales, et ne peuvent donc bénéficier des dispositions en vigueur, il apparaît clairement qu'il fallait franchir une étape.
Cette étape, ce sont nos collègues du Sénat qui l'ont franchie. La proposition de loi du sénateur Cambon, qui a évolué lors de son examen, offre les bases de ce progrès. Le dispositif adopté a changé de forme et de valeur, initialement destiné à mettre en place une solidarité entre les communes, il traite désormais de solidarité entre les usagers, au profit de nos concitoyens souffrant d'insolvabilité.
C'est pourquoi le Sénat a proposé la création de cette contribution volontaire des services d'eau et d'assainissement, plafonnée à 0,5 % des redevances perçues hors taxes. Sachant que ce montant total est évalué à environ dix milliards d'euros, les contributions volontaires pourraient représenter cinquante millions d'euros, somme qui permettrait de couvrir l'ensemble des besoins.
Tous ceux que nous avons entendus sur cette question, et notamment les professionnels de l'eau et de sa distribution, sont non seulement d'accord pour assumer cette contribution volontaire à des fins curatives, mais également sur le principe d'une seconde contribution volontaire de 0,5 % pour instaurer un volet préventif.
Ce texte va donc permettre d'avancer, mais l'examen des différentes hypothèses que nous soumettons au Gouvernement doit permettre de progresser dans les mois à venir vers l'élaboration d'un traitement préventif.
Il existe deux voies pour mettre en place un traitement préventif. L'une d'entre elles, à laquelle j'avais adhéré avec un certain nombre de mes collègues, a été proposée par le comité national de l'eau. Notre collègue André Flajolet a présenté une proposition de loi qu'un certain nombre d'entre nous ont cosignée et qu'il a pris l'initiative de transformer en amendement au présent texte en reprenant les principaux aspects.
Cette proposition visait à mettre en place un système d'allocation différentielle afin que la dépense correspondant à la quantité nécessaire d'eau ne représente pas plus de 3 % des revenus nets d'une famille, dans tous les cas. C'est avec regret que nous constatons que cette proposition n'a pu prospérer, puisqu'elle est tombée sous le coup de l'article 40.
C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui un amendement sur la tarification sociale, comme je l'ai fait en commission. Je n'ignore pas les difficultés de mise en place de l'allocation différentielle, ou de la tarification sociale. Cet amendement n'est pas qu'un amendement d'appel, il vise à démontrer qu'une solution doit être trouvée dans l'année qui vient afin que le dispositif soit complet, et que nous ayons bien, en plus du volet curatif qui sera nettement amélioré par ce texte, un volet préventif.
Cette question ne doit pas être sous-estimée. Elle ne recouvre que 0,7 % du total des factures, mais touche plus de 500 000 de nos concitoyens, et ceci est considérable.
En mars 2012, notre pays accueillera le sixième forum mondial de l'eau à Marseille. C'est une chance, mais également une responsabilité. Je forme le voeu que, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement, nous disposions dans une année de ce dispositif d'ensemble que nous souhaitons. Cela repose maintenant entre les mains du Gouvernement, qui est le seul à pouvoir en prendre l'initiative, du fait de l'irrecevabilité qui nous a été opposée.
C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter le texte tel qu'il a été adopté par la commission des lois, enrichi des avancées qui pourront résulter de l'examen en séance. J'ai la certitude, et monsieur le secrétaire d'État pourra la conforter, qu'au-delà de ce texte, il y aura un achèvement de tout ce travail législatif dans la loi de finances pour 2012, ce qui permettra à tous nos concitoyens de bénéficier du même droit à l'accès sécurisé à l'eau, qu'à l'énergie et au téléphone. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6, du règlement.
La parole est à M. Olivier Dussopt.

Monsieur le secrétaire d'État a rappelé que cette proposition s'inscrit dans un contexte particulier, celui de l'application de l'article premier de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, adoptée en 2006, qui consacre un droit d'accès à l'eau potable pour chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiques acceptables par tous.
Force est cependant de constater, comme vous l'avez fait, que la mise en oeuvre de ce droit à l'eau, reconnu depuis août dernier par une résolution des Nations Unies, est difficile.
L'accès de nombreux ménages à l'eau potable est contrarié car l'eau reste un poste de dépenses important pour les ménages les plus modestes, du fait de l'augmentation régulière et importante des coûts de gestion et de traitement. C'est pourquoi l'élargissement du champ de la proposition de loi à l'assainissement nous paraît intéressant.
La facture moyenne est de vingt et un euros par mois, soit 1,6 à 1,8 % du revenu médian, mais 5 % du revenu des allocataires du RMI ou du RSA. Ces chiffres peuvent paraître modiques, mais il faut rappeler que près de huit millions de personnes sont concernées par la pauvreté dans notre pays, et vivent donc avec moins de neuf cent huit euros par mois, et 4,3 millions d'entre elles vivent avec moins de sept cent cinquante-sept euros par mois, dont 3,3 millions d'allocataires bénéficiant de minima sociaux s'échelonnant de trois cents à sept cents euros.
Face à cette pauvreté importante, vous avez souligné les disparités dans le prix de l'eau, et la grande inégalité qui régnait entre les consommateurs dans le prix qu'ils devaient payer pour avoir accès à ce bien essentiel, selon leur lieu d'habitation.
Il existe un certain nombre de systèmes d'aides, notamment le fonds de solidarité logement, qui permet de prendre en charge une partie de ces dépenses. Cela ne concerne que 60 000 ménages sur les plus de 500 000 que vous avez évoqués. Le volet eau n'est pas mis en oeuvre dans tous les départements, et ne concerne que les ménages abonnés individuellement. Il sera important de trouver des traitements suffisamment égalitaires entre les ménages abonnés individuellement et les ménages relevant d'abonnements collectifs.
Nous sommes nombreux à penser que l'eau est un bien public d'intérêt général, qui ne doit pas être géré comme une marchandise mais de manière responsable, efficace, solidaire et durable. C'est l'objectif de la charte fondatrice du premier réseau européen de gestion publique de l'eau.
L'idée d'un droit essentiel et d'un accès à celui-ci dans des conditions économiques raisonnables figure dans les propos de tous les orateurs, c'est par là que je veux commencer.
Le texte du Sénat que nous examinons ne propose qu'un traitement curatif des difficultés d'accès à l'eau, par une aide au paiement de la facture des ménages en difficulté alors que le vrai débat est celui de la gestion de cette ressource et du contrôle du prix de l'eau.
Les sénateurs nous ont transmis un texte a minima, adopté il y a quelques mois, et dont la vertu majeure est de conforter le rôle du FSL créé par la loi Besson du 31 mai 1990.

Le seul élément nouveau réside dans la fixation du montant de la subvention qui pourra être apportée pour l'accès à l'eau des plus démunis à 0,5 % du total des recettes du service.
Cette proposition de loi traite donc de l'accès à l'eau pour les plus démunis, mais sans aborder le calcul et le contrôle du prix. C'est là que le bât blesse, et qui nous fait dire qu'il s'agit d'une proposition de bons sentiments qui ne sera pas gage d'efficacité pour instaurer un accès durable de l'ensemble des ménages à l'eau.
Cette proposition de loi est un copier-coller de la loi Oudin-Santini qui permettait la création de cette nouvelle ressource de 0,5 %, mais elle n'améliore pas l'efficacité des dispositifs existants en matière d'action sociale. L'association des départements de France considère même qu'elle crée une couche supplémentaire dans la stratification des aides sociales.
Vos références sont subjectives !

C'est une référence paritaire.
Nous avons tout de même un espoir, qui réside dans un certain nombre d'amendements qui ont été déposés sur la tarification sociale. Soulignons que cet aspect demande des débats certainement beaucoup plus importants que ceux que nous avons pu y consacrer en commission, et que nous allons y consacrer cet après-midi.
Nous n'avons pas déposé de motion de rejet préalable, parce que nous considérons que le débat doit avoir lieu sur ce sujet. Mais nous déposons une motion de renvoi en commission, car la proposition de loi n'est pas suffisante en l'état, elle mérite plus de travail et plus de temps pour être véritablement efficace et complète.
Cette motion s'articule autour de trois raisons principales. La première raison est, vous l'aurez compris dans mon propos, que cette proposition nous paraît insuffisante et qu'il est nécessaire de la compléter pour arriver à un texte qui permette de réunir les conditions d'une vraie mise en oeuvre du droit à l'eau évoqué par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques et les autres textes.
Il s'agit d'intégrer de manière véritable, définitive et formelle une tarification sociale permettant de garantir aux ménages que la question de l'eau et de l'assainissement n'absorbera pas plus de 3 % de leurs revenus, quels qu'ils soient. C'est l'objectif qui nous semble devoir être poursuivi.
Il convient également de mettre en place des mécanismes de contrôle et de garantie sur la fixation des prix et leur niveau, afin de garantir une véritable égalité sur l'ensemble du territoire.
Il s'agit enfin d'aborder la question des modes de gestion, en prévoyant notamment un accompagnement des retours en gestion publique, puisque nous considérons que la seule solution pour trouver une véritable formule égalitaire, en tous les cas un accès égal à une eau de qualité pour tous, est de favoriser le retour en gestion publique de l'ensemble des réseaux et arriver à la mise en place de services publics locaux ou nationaux de l'eau.

La deuxième raison qui justifie cette motion de renvoi en commission est que la proposition de loi ne tient pas suffisamment compte de l'existant et du contexte dans laquelle nous l'examinons.
Le premier élément de contexte à souligner est la réalité financière des ménages et des collectivités. Le caractère volontaire de la subvention créée par le texte engendre une responsabilité morale supplémentaire pour les élus, qui pourraient être accusés ou mis en cause s'ils ne la mettaient pas en place. Dans le même temps, nous avons les plus grandes craintes sur les répercussions de cette cotisation sur le niveau global des factures. Avec un tel prélèvement sur les factures mis en place par les opérateurs, nous arriverions à une situation dans laquelle les ménages paieront pour les ménages.
Le texte ne tient pas suffisamment compte de l'existant, notamment pour les actions déjà mises en place par les collectivités par l'article 65 de la loi de 2004, qui prévoit que les personnes les plus en difficulté aient accès à une aide de la collectivité pour des questions d'eau, d'énergie ou de téléphone. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui gagnerait à être complétée par ces éléments.
Enfin, un certain nombre d'actions sont menées par des opérateurs de délégation de service public. Le rapporteur les a présentés comme favorables au texte ; ce n'est guère étonnant dans la mesure où ils ont tout à gagner à la mise en place d'un dispositif curatif qui vienne aider leurs clients les moins solvables à payer leurs factures.

Vous venez de souligner, monsieur le rapporteur, que vous êtes d'accord sur les deux points, pour un prélèvement de 0,5 % avec un aspect curatif et aussi pour un futur prélèvement de 0,5 % avec un aspect préventif.

J'ai envie de dire que ces opérateurs s'en sortent bien. En effet, la proposition initiale de M. Cambon fixait un taux de prélèvement de 1 % et le débat au Sénat l'a ramené à 0,5 %. En affirmant être d'accord sur les deux prélèvements, ils font un effort très mesuré est finalement par rapport au taux initialement prévu.
Si nous devons aller vers la mise en place d'un système public de soutien aux ménages pour l'accès à l'eau avec un système d'allocations ou d'aides curatives, comme le texte le propose, il faut travailler sur la nature, le montant et l'assiette de la ressource financière et établir le niveau pertinent de mise en oeuvre de cette solidarité. Cela nous ramène aux modes de gestion de l'eau et de l'assainissement et à différents choix en matière de garantie à cet accès.
On peut évoquer l'existence des FSL, mais s'il est abondé par un prélèvement sur les factures, ce seront finalement les ménages les moins pauvres qui paieront pour les plus pauvres. Mais on peut aussi imaginer un système permettant, quel que soit le mode de gestion – public ou privé –, un véritable contrôle du niveau de prix pratiqué par l'ensemble des opérateurs sur le territoire et fixer un prix en fonction des catégories sociales et plus particulièrement du niveau de revenus des habitants et des ménages concernés.
Cette question des modes de gestion et du contrôle du prix, mérite un débat plus approfondi, y compris avec les associations d'usagers. C'est la deuxième raison pour laquelle il nous semble opportun de renvoyer ce texte en commission.
La troisième et principale raison de cette motion de renvoi repose sur l'aspect du texte qui nous semble le plus critiquable : le fait de ne pas prévoir concrètement la tarification sociale.
Je voudrais dénoncer un faux argument ou en tout cas une mauvaise utilisation de l'argument selon lequel la tarification progressive par palier, par volume consommé, ne serait pas un outil social mais uniquement écologique. J'ai entendu en commission et lu dans différents rapports que la mise en place d'une tarification par palier de consommation n'aurait comme seule vertu que d'aider les ménages économes dans leur consommation d'eau, mais n'aurat pas de véritables qualités sociales. Nous pensons que c'est une erreur. Nous savons calculer et établir le niveau de consommation vitale. Il existe un certain nombre de régies – je connais plus particulièrement l'une d'entre elles – qui mettent en place la quasi-gratuité sur les 20 ou 30 premiers mètres cubes, …

…ce qui correspond à une consommation vitale, en tout cas à la consommation nécessaire, notamment pour des personnes âgées, isolées vivant de minima sociaux, qui n'ont ainsi qu'à payer la part fixe. Rappelons que la loi LEMA, que nous évoquions tout à l'heure, avait fixé également comme objectif de réduire la part fixe dans la facture d'eau. Malheureusement, cet objectif n'est pas encore totalement atteint.
Nous sommes favorables à une tarification sociale sur le modèle du gaz ou de l'électricité. Mais, malheureusement, un amendement des sénateurs socialistes avait été écarté par la majorité. Nous espérons cependant que les pistes ouvertes par les différents amendements défendus par le rapporteur le 24 novembre dernier en commission ou au titre de l'article 88 ne subiront pas, à terme, le même sort que les propositions de nos collègues du Sénat en matière de tarification sociale.
M. le secrétaire d'État et vous-même, monsieur le rapporteur, avez souligné tout à l'heure que la mise en place d'une tarification sociale était difficile du point de vue méthodologique. C'est une réalité. C'est pour cela que nous considérons qu'il s'agit d'un des meilleurs arguments pour renvoyer ce texte en commission, de façon à travailler ensemble sur ce sujet et à parvenir à un texte plus abouti.
Dire que la tarification sociale permettrait – cela a également été souligné – une action préventive et pas uniquement curative nous paraît un point d'autant plus important que l'on connaît aujourd'hui le poids croissant des fluides dans le budget des ménages et la nécessité de maîtriser ces charges. Ce n'est pas le secrétaire d'État au logement que je dois convaincre, compte tenu du dernier programme qu'il a lancé sur la maîtrise des charges dans les habitations des ménages.
Toutes ces modalités doivent être débattues pour tenir compte du revenu des ménages, des paliers de consommation, pour considérer l'aspect social et écologique et faire en sorte que nous puissions avancer.
J'ai évoqué tout à l'heure les amendements déposés par notre rapporteur ou par M. Flajolet. Nous considérons que celui que nous avons examiné le 24 novembre dernier représente un premier pas insuffisant pour nous rassurer. Nous n'avons pas disposé du temps nécessaire pour aboutir en ce qui concerne l'amendement examiné en vertu de l'article 88. Nous préférerions examiner en séance un texte qui permette de mettre vraiment en place la tarification sociale et non d'en ouvrir seulement la perspective.
Je voudrais rappeler pour conclure que nous n'avons pas d'opposition de principe à ce texte et que nous n'avons pas entamé sa discussion dans cet esprit. Nous constatons un certain nombre d'insuffisances et nous ne pouvons pas, de ce fait, l'adopter en l'état.
Nous pensons qu'il est nécessaire de faire mieux, de compléter ce texte en ce qui concerne la tarification sociale, d'ouvrir un débat sur les modes de gestion de l'eau et de l'assainissement et sur le contrôle des prix, que j'ai évoqué à plusieurs reprises.
Pour ces trois raisons, je vous propose de renvoyer ce texte en commission.
Il est certes inspiré par de bons sentiments mais il ne va pas assez loin en matière de contrôle public et d'égalité d'accès.
J'ai entendu le Gouvernement demander tout à l'heure à propos des amendements déposés par le rapporteur, six mois de réflexion pour travailler sur ce texte et sur la tarification sociale. Le groupe socialiste est tout à fait prêt à lui donner ces six mois et à s'investir – selon un terme, qui peut être cher à certains d'entre nous – dans la coproduction législative, afin qu'à l'issue du débat en commission nous ayons un texte acceptable, qui fasse consensus et qui permette un véritable droit d'accès à l'eau potable pour tous. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Je voudrais répondre sur la motion de renvoi en commission.
Dans les propos de notre collègue, il y a autant d'arguments qui plaident pour que nous étudions le texte dès aujourd'hui et que l'Assemblée se prononce dès maintenant afin que le Parlement parvienne très rapidement à un texte définitif que pour le renvoi en commission.
Il y a, me semble-t-il, une certaine confusion dans les arguments développés. Lorsque notre collègue indique qu'il est d'accord pour que le délai initial de trois mois soit prolongé à six mois, comme je l'ai proposé hier en commission, afin de travailler sur le volet préventif, il est en contradiction avec l'idée même de renvoi immédiat du texte en commission. Il reconnaît, c'est important, que ce travail doit être fait à l'initiative du Gouvernement. C'est cela qui est réellement important.
Très sincèrement – et M. André Flajolet pourra s'exprimer de manière plus technique sur la question – si l'amendement issu des travaux du Comité national de l'eau n'était pas tombé sous le coup de l'article 40, il aurait, évidemment été présenté en commission des lois et adopté, à n'en pas douter par celle-ci.

Il ferait partie du texte qui vous est soumis aujourd'hui.
La question est bien là. Un état de fait existe, mais il n'est pas satisfaisant. Nous allons progresser dans le volet curatif avec cette proposition de loi. La commission a eu largement le temps de tomber d'accord sur tout cela, parce que nos échanges – je ne vous contredis pas sur ce point – ont été positifs.
Il nous faut encore travailler sur un sujet que nous jugeons tous indispensable, mais infiniment complexe. Malgré la qualité des membres de la commission des lois, nous avons besoin de plus de temps – une, deux, voire trois séances – de travail assidu avec le Gouvernement dans les six prochains mois. Nous ne regretterons pas de disposer d'une loi déjà en vigueur sur l'amélioration du volet curatif, avant de passer à l'autre volet qui est celui que nous verrons dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012.
Nous devrons être vigilants lors de l'examen du budget pour 2012. Nous vérifierons tous ensemble que les engagements du Gouvernement, auxquels nous sommes sensibles, auront été tenus.
C'est la raison pour laquelle, au nom de la commission, je répète que les travaux menés ont été de qualité et suffisants par rapport à l'importance du sujet et des moyens notamment constitutionnels, dont nous disposions. Nous perdrions du temps, sans avancer davantage, si nous renvoyions ce texte en commission. Je propose donc à l'Assemblée de repousser cette motion de procédure.

Dans les explications de vote sur la motion de renvoi en commission, la parole est à M. André Flajolet, pour le groupe UMP.

Sur cette motion de renvoi en commission, je voudrais dire que le mieux est l'ennemi du bien.
Vos propos, monsieur Dussopt, auraient pu, pour une large part, être prononcés par moi, mais aboutir à une conclusion diamétralement opposée. Pourquoi ? Au coeur de votre démonstration, il y a deux choses. D'une part, sur le fond des choses, il y a un accord humaniste, malgré les oppositions politiques.
En revanche, je ne suis pas d'accord pour intégrer toute une série de sujets périphériques à la question essentielle de la solidarité, qui portent sur les modes de gestion et qui ne sont pas au coeur de notre problème. La proposition qui nous est faite, c'est que tous les opérateurs, quel que soit leur mode de gestion, puissent être participants du fonds, que nous allons créer pour la solidarité.
Vous avez parlé d'un copier-coller de la loi Oudin-Santini. Nous le revendiquons. En effet, nous revendiquons le fait que si nous pouvons être solidaires à l'international pour 1 %, nous devons être solidaires à l'interne pour 1 % – 0,5 curatif, 0,5 préventif. Ces raisons me conduisent, au nom de mon groupe, à repousser votre demande de renvoi en commission pour poursuivre l'examen du texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Nous pouvons partager les références à l'humanisme que vient de faire M. Flajolet. Ce n'est pas ce qui nous oppose.
Sa conclusion sur les opérateurs constitue peut-être le vrai problème. Nous estimons, comme Olivier Dussopt, que les « opérateurs s'en sortent bien » si l'on reste sur ce texte ainsi conçu. Nos différences d'appréciation se situent bien là.
Nous souhaitons une solidarité, qui ne concerne pas seulement les plus pauvres – certes, ils sont nombreux – qui seraient amenés à payer pour ceux qui seraient complètement désocialisés, pour ceux qui ne percevraient plus aucune ressource de quelque nature que ce soit et pour ceux qui seraient véritablement dans la misère. C'est ce que nous vous reprochons. En réalité, les seuls qui pourraient payer et qui nécessiteraient un encadrement du crédit, ce sont les opérateurs.
Une divergence nous oppose. C'est la raison pour laquelle la motion de renvoi proposée a pour but d'aplanir nos différences.
M. le rapporteur vient de dire : « Il faut dans l'année qui vient, en plus du volet curatif, trouver un volet préventif ».

Cela constituait pour moi l'aveu, la reconnaissance que ce texte n'est pas tout à fait à maturité.
Ce texte a été voté le 11 février par le Sénat ; nous l'avons reçu sur nos bureaux il y a soixante-douze heures. Nous en avons parlé il y a vingt-quatre heures ou quarante-huit heures et en tout et pour tout pendant trois heures.
Nous vous proposons de renvoyer ce texte, qui se voudrait sérieux, en commission, afin d'aborder le volet curatif et le volet préventif, puisque vous reconnaissez vous-même qu'il s'agit là d'une nécessité.
La version du texte qui nous est proposée est à la fois trop superficielle, trop partielle. Son caractère insuffisant est évident. Dans le cadre de cette solidarité, ce sont les plus pauvres qui paieront. Ce seront, une fois encore, les collectivités qui assumeront un certain nombre de charges financières. Celles-ci sont, vous le savez, déjà étranglées. Vous les stigmatisez très souvent en leur reprochant d'augmenter leurs dépenses. Paradoxalement, vous n'avez de cesse de nous infliger ici et là sur tel ou tel secteur des dépenses supplémentaires.
Dernier point : un élément essentiel est fondé sur la notion d'humanisme à laquelle vous faisiez allusion, monsieur Flajolet : la tarification sociale. Vous refusez le débat sur ce point. Rien n'est fait pour encadrer le prix de l'eau, ni pour imposer aux opérateurs un certain nombre de règles restrictives et contraignantes.
Par conséquent, nous demandons le renvoi du texte en commission afin que nous puissions discuter sérieusement des volets curatif et préventif. Si vous vous y opposez, nous ne voterons pas la proposition de loi.

Les précédents intervenants ont tous souligné que le texte est resté au milieu du gué ; il traite du volet curatif, mais il renvoie le volet préventif – le droit à l'eau – à plus tard.
Or les associations et le Comité national de l'eau ont fait des propositions extrêmement précises sur le volet préventif. En renvoyant le texte en commission, nous aurons la possibilité de retravailler sur les deux aspects du texte – curatif et préventif – ainsi que sur la question du financement de la solidarité.
Le groupe GDR se prononce en faveur du renvoi en commission afin que nous répondions aux attentes des usagers et que nous prenions en compte les propositions des associations.
(La motion de renvoi en commission, mise aux voix, n'est pas adoptée.)

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Dufau, pour le groupe SRC.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le renvoi du texte en commission aurait été la solution la plus sage et la plus consensuelle.

Le principal mérite de cette proposition de loi est de souligner que, dans notre pays, des familles modestes ont des difficultés à régler leur facture d'eau. Cela revient donc à reconnaître l'extraordinaire situation de précarité dans laquelle se trouvent bon nombre de nos concitoyens. C'est bien parce que huit millions de nos compatriotes vivent en dessous du seuil de pauvreté que nous avons ce débat.
Chacun peut admettre que l'accès au travail, à la santé et au logement constitue des droits primaires universels. Notre République se doit de les garantir, ce qui est très loin d'être le cas. Sur terre, l'eau, c'est la vie. Cette assertion vaut également dans la France du XXIe. C'est pourquoi, permettre aux plus démunis d'y accéder me semble être le minimum de la solidarité ; c'est un avis largement partagé.
Pour autant, telle qu'elle est formulée, la proposition de loi n'est pas satisfaisante. Même si cette question est complexe, notamment par le fait que des ménages sont abonnés individuellement et que leur facture est individuelle. Mais aussi du fait que 43 % des ménages sont abonnés collectivement et paient l'eau en même temps que leurs charges locatives.

La proposition de loi se propose d'améliorer le dispositif existant du FSL dans son volet eau. Mais, le rapporteur l'a souligné, celui-ci n'existe pas dans tous les départements. De plus, il ne concerne que les abonnés individuels. Malheureusement, la proposition ne règle pas le problème. En fait, elle reprend le dispositif, légèrement modifié, de la loi Oudin Santini votée en 2005. On peut donc douter de son efficacité.
En effet, ce dispositif est curatif et non préventif. Mieux prévenir que guérir dit l'adage.

Oui, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs : il faut d'abord prévenir.
Faut-il rappeler que le Conseil national de l'eau s'est prononcé le 6 juillet dernier en faveur de la mise en oeuvre d'un dispositif préventif fondé sur le versement d'une aide dépendant du poids de la facture en eau dans le revenu du ménage ? C'est le bon sens même.
Le groupe socialiste a, par le biais d'amendements, fait des propositions concrètes. Par exemple, instaurer un service social de l'eau pour certaines catégories d'usagers ; ou encore, donner la possibilité aux collectivités de modifier le tarif de l'eau en fonction de la catégorie d'usagers. On peut aussi instaurer le principe de la gratuité de ce qui constitue le minimum vital par personne – c'est le cas à Libourne pour les cinquante premiers litres. On pourrait enfin, comme c'est le cas pour le logement, instituer une aide à la fourniture d'eau pour les ménages les plus démunis comme il existe une APL. Ces différentes mesures peuvent être complémentaires et associées de façon efficace.
Vous voyez bien que la proposition de loi dont nous discutons ne fait pas preuve de beaucoup d'innovation et qu'elle se contente de proposer un prélèvement sur les recettes des collectivités, toujours les mêmes. On aurait pu imaginer une taxation à « due concurrence » des besoins sociaux, taxation prélevée sur les bénéfices colossaux des grandes sociétés fermières. C'est simple et d'application directe ; inutile même de renvoyer le texte en commission. Vous conviendrez avec moi que c'est une tout autre politique à laquelle je vous incite à réfléchir.
Ce qu'il faudrait véritablement mettre en place, c'est une grande politique publique de l'eau au plan national,déclinée ensuite dans les territoires. Ce serait reconnaître en actes que l'eau est un bien vital auquel chaque être humain a droit. Ce véritable débat de fond dépasse l'objet de la proposition de loi, mais est désormais incontournable.
Si elle soulève une vraie question, la proposition de loi y apporte une mauvaise réponse. Elle lève un coin du voile derrière lequel se cache un grand chantier de la solidarité que nous aurons à réaliser un jour. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur la proposition de loi du sénateur Cambon qui vise à donner un contenu partiel et curatif au principe que notre majorité parlementaire a voté en 2006 lors de la discussion portant sur la loi sur l'eau et les milieux aquatiques dont j'étais le rapporteur.
La loi votée à l'époque par la seule majorité présidentielle introduit le « droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiques acceptables par tous », M. le secrétaire d'État et M. le rapporteur l'ont rappelé. C'était un principe ; nous voulons lui donner un contenu. Si nous ne poursuivons pas notre action et nos propositions, je crains que nous en restions au seul aspect curatif.

En 2006, il n'avait pas été possible d'aller plus loin pour donner un contenu réel à la solidarité territoriale dans notre nation vis-à-vis de celles et de ceux qui sont en situation de souffrance, voire d'exclusion faute de moyens financiers pour régler leur facture d'eau.
Certes, la majorité avait introduit et sacralisé la loi Oudin Santini garantissant un principe de solidarité à l'international en ouvrant le droit au 1 % de la facture d'eau au profit des habitants des pays où l'eau est un bien rare en quantité et en qualité, un élément d'une survie très précaire. Cette loi présente un bilan positif : des associations, des collectivités, des écoles, des collèges ou des lycées ont, selon leurs engagements, ouvert des espaces de dignité, de santé publique et d'espérance à des populations très démunies.
Dès 2006, il était évident que le problème d'accès à l'eau potable se posait aussi pour certaines familles sur notre sol et que la structure de prise en charge de type FSL – fonds de solidarité pour le logement – avec un fonds dédié alimenté par le bon vouloir des entreprises de l'eau n'était pas une réponse structurée satisfaisante, parce que cette réponse se fait dans l'urgence, souvent après coupure du compteur, parce que cette forme d'assistanat ajoute à la déstructuration sociétale.
C'est ainsi que de tous les groupes acteurs d'une solidarité effective, durable et responsable sont montées des propositions qui ont conduit le Comité national de l'eau que j'ai l'honneur de présider à déposer une proposition de loi complémentaire à celle du sénateur Cambon. C'est tout le contraire d'un tarif social pour les premiers mètres cubes, concept séduisant à première vue, mais d'un coût très élevé à mettre en place et d'une équité plus que discutable. En outre ses incidences sur l'équilibre économique du service seraient dangereuses dans la mesure où elles réduisent les capacités financières permettant, sur le long terme, d'assurer le remplacement des réseaux et de garantir leur qualité patrimoniale.
Cette proposition de loi complémentaire du texte étudié consiste à dire qu'une contribution maximale de 0,5 % au titre de la solidarité territoriale doit permettre de limiter toute facture d'eau potable à 3 % maximum des ressources réelles d'un ménage. Pour gagner du temps, je l'avais déposée sous forme d'amendement parce qu'elle avait été validée à l'unanimité par le Comité national de l'eau au nom de toutes les sensibilités politiques, associatives et industrielles. Mais la commission des finances dans une lecture libérale, dont je n'ai pas saisi le secret, a opposé l'article 40 alors même qu'aucune charge publique n'était créée. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement de repli afin que le ministère que vous animez ait le temps d'expertiser la proposition du Comité national de l'eau. Je ne peux que regretter que l'accord de votre prédécesseur sur ce texte soit reporté pour expertise complémentaire, mais je me dois de dire que votre nouvelle équipe a été très attentive à cette proposition portant sur un aspect préventif et éducatif de la consommation d'eau potable.
Monsieur le secrétaire d'État, nous sommes tous d'accord pour considérer que l'accès à l'eau est un bien essentiel, garantie de santé pour chacun et de paix pour chaque peuple. Tels sont les fondamentaux philosophiques et humanistes que j'ai voulu développer et qui sont au coeur de notre travail de législateur. Nous sommes aussi d'accord pour dire que ce bien précieux, bien commun de la nation, est porteur d'investissements considérables pour en assurer la sécurité alimentaire, pour l'épurer et protéger certains milieux. C'est aussi un aspect non négligeable du Grenelle de l'environnement. Ce qui est payé, ce sont les services de l'eau, quel que soit le mode de gestion, même si par ailleurs un débat se poursuit sur ce sujet. Aussi, est-il souhaitable, sans frais excessifs, sans charges de structures complémentaires, que chacun bénéficie de la consommation de ce bien et prenne conscience, par un paiement même minoré que l'eau est une valeur, que l'eau a une valeur.
L'UMP soutient le texte du sénateur Cambon dans son intégralité et apportera son appui à l'amendement que j'ai déposé et que vous avez bien voulu accepter. En effet, ce texte se trouve conforté par le vote de la réforme des collectivités territoriales, qui conforte le rôle du maire, pierre angulaire de notre démocratie de proximité, et le rôle fondamental des départements par l'excellence de leurs services sociaux, la connaissance des situations de familles en difficulté et leur partenariat avec les collectivités en responsabilité des services de l'eau.
Dans votre propos liminaire, vous avez, monsieur le secrétaire d'État, indiqué les deux voies possibles qu'il faut encore expertiser : un partenariat avec la CAF comme l'a souhaité de façon majoritaire le Comité national de l'eau et pour lequel j'ai pris un certain nombre de contacts, aujourd'hui peu satisfaisants, il faut le reconnaître…

…ou avec les départements, dont le rôle a été confirmé par la loi sur la réforme des collectivités territoriales pour ce qui est de la solidarité.
Au nom du CNE, je regrette ce retard, mais je me dois de vous remercier pour votre esprit d'ouverture et de collaboration. L'essentiel est d'être au rendez-vous de la solidarité et de la dignité des familles en difficulté. De ce point de vue, je ne peux pas laisser dire qu'il y aurait des charges nouvelles pour les collectivités territoriales…

…pas plus qu'il n'y a eu de charges nouvelles pour l'État. Il y a l'exercice effectif d'un partage par lequel ceux qui ont plus donnent un tout petit peu pour ceux qui ont peu.
Ainsi, par le parallélisme des formes, chaque facture d'eau portera, je l'espère, le principe du 1 % de solidarité pour ici et 1 % de solidarité pour ailleurs donnant corps et sens à ce concept de solidarité. Ce serait une formidable anticipation du forum de Marseille…

…et une reconnaissance du rôle essentiel que jouent les associations, en particulier au coeur du Comité national de l'eau.
Je souhaite donc, monsieur le secrétaire d'État, que le comité national de l'eau, dans sa diversité, et, si vous le voulez bien, par l'intermédiaire de sa commission spécialisée, qui regroupe toutes les familles politiques, soit à vos côtés afin que le délai imparti – j'avais proposé trois mois, vous en demandez six – suffise à donner un sens effectif à notre volonté politique. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, par-delà notre appartenance politique, l'objet du texte dont nous sommes saisis nous intéresse tous en tant qu'élus locaux. En effet, il n'est pas rare désormais que nos concitoyens les plus démunis viennent dans nos permanences nous faire part de leurs difficultés à payer leur facture d'eau.
Certes, selon les statistiques, la facture d'eau ne représente au total que 1 % du budget des ménages en France ; mais cette charge, relativement réduite au premier abord, reste trop lourde pour nombre de nos concitoyens.
En effet, le tarif de l'eau varie fortement d'un territoire communal à l'autre, car les coûts supportés par les services dépendent de caractéristiques locales diverses – nature de la ressource en eau utilisée, contraintes d'exploitation, nature et nombre des habitations à desservir, politique d'investissement de la collectivité, entre autres.
D'après l'INSEE, le prix de l'eau a fortement augmenté au cours des années 1980 à 2000, la hausse atteignant 8 % en 1995. Et si, aujourd'hui, cette augmentation se rapproche du taux de l'inflation générale, il est de plus en plus nécessaire d'instaurer des mécanismes de solidarité envers nos concitoyens les plus fragiles.
La proposition de loi de notre collègue sénateur, M. Cambon, résulte en grande partie de la multiplication des normes de potabilité, qui visent à assurer à l'eau du robinet la meilleure qualité possible – ce qui est une très bonne chose.
Cette proposition vise à accroître la solidarité des communes en matière d'alimentation en eau et d'assainissement envers les personnes en situation de précarité résidant en France, sans discrimination entre les usagers, qu'ils soient abonnés directs ou non des services de l'eau et de l'assainissement.
À cette fin, elle autorise les communes à financer un fonds de solidarité pour l'eau géré par les centres communaux – les CCAS – ou par les centres intercommunaux d'action sociale – les CIAS. Ce fonds permettra de payer tout ou partie des factures d'eau et d'assainissement des personnes en difficulté.
Je rappellerai, comme mes collègues, que cette proposition fait suite à la loi LEMA. Celle-ci a énoncé dès 2006 un droit d'accès à l'eau potable pour tous à un prix abordable, et encadré très strictement les coupures d'eau en cas de non-paiement par l'usager ; mais elle en est restée au stade de principe, inappliqué dans les faits.
À l'heure actuelle, les personnes qui ont du mal à payer leur facture d'eau peuvent saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département. Ce dernier peut décider, après étude de leur dossier, de prendre en charge leur facture, en totalité ou en partie. Ainsi, près de 20 000 dossiers sont traités chaque année par les entreprises de l'eau, en lien avec les commissions départementales des FSL. Mais, trop souvent, les personnes les plus fragiles ne font pas appel à ces services, faute de les connaître.
Pour les centristes, il importe tout d'abord d'instaurer des dispositifs lisibles s'appuyant sur les structures existantes, afin de veiller à maîtriser les coûts de gestion. Nous saluons donc la logique de « guichet unique » que privilégie cette proposition de loi : nos concitoyens ne comprendraient pas la nécessité de s'adresser à des niveaux de collectivités différents selon la nature de la facture pour laquelle ils sollicitent une aide.
Il importe ensuite d'instaurer une solidarité entre les communes qui ne sont pas toutes dans la même situation en matière de pauvreté ; de ce point de vue, la péréquation à l'échelle du département s'avère à notre sens pertinente. Il y va de la bonne gouvernance des services de l'eau. Car, pour le Nouveau Centre, l'eau requiert une gouvernance rigoureuse : il revient à l'État de créer le cadre régissant la protection et l'usage de la ressource, et aux collectivités d'en assurer la gestion.
Pour conclure, je souhaite m'attarder un instant sur les responsabilités de la France dans le problème plus large de la gestion de l'eau à l'échelle mondiale. En effet, cette proposition de loi fournit l'occasion de le rappeler, la France est l'un des premiers bailleurs de fonds du secteur de l'eau, grâce à l'aide publique au développement. À ce titre, elle se doit d'exercer pleinement son influence.
Car tout indique que le problème de l'eau dans le monde va s'aggraver. D'ici à 2050, la population mondiale progressera de 50 %, et la demande d'eau bien plus encore, étant donné les besoins de ces trois milliards d'êtres humains supplémentaires. Et les aléas climatiques, en désorganisant les productions agricoles, ne nous faciliteront pas la tâche. C'est moins la ressource qui fait défaut que la demande qui va augmenter constamment au cours du siècle à venir – et, avec elle, les conflits d'usage autour de cette ressource naturelle.
Or le retard pris par les réalisations en matière d'eau et de l'assainissement sur les objectifs du Millénaire pour le développement définis en 2000 se confirme. À l'époque, la communauté internationale souhaitait réduire de moitié le pourcentage de personnes sans accès à l'eau et à l'assainissement de base avant 2015 ; nous savons aujourd'hui que nous n'atteindrons pas cet objectif.
Le groupe Nouveau Centre n'en appelle pas moins le secrétaire d'État et l'ensemble du Gouvernement à saisir l'occasion que représentera le sixième forum mondial de l'eau, prévu en mars 2012. En effet, la France jouit d'une légitimité certaine dans le domaine de l'eau, elle qui a été pionnière en faisant adopter un plan d'action pour l'eau par le G8 réuni à Évian en 2003. À cette occasion, notre pays peut donc contribuer à ce que soit franchie une nouvelle étape en matière d'accès à l'eau. Vous avez tout notre soutien dans cette entreprise, monsieur le secrétaire d'État.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, je ne répéterai pas ce qu'ont dit certains de mes collègues, et qui justifiait la motion de renvoi en commission déposée par le groupe SRC ; mais, si le texte qui nous est soumis représente une avancée indéniable, celle-ci est à l'évidence bien trop limitée.
En effet, le texte se cantonne au volet curatif, au détriment de l'aspect préventif. De ce dernier point de vue, l'amendement déposé à la suite des travaux du Comité national de l'eau et repoussé au titre de l'article 40 aurait permis un véritable progrès.
L'article premier de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques énonçait un droit d'accès à l'eau potable pour chaque personne physique à des fins d'alimentation et d'hygiène, dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Il n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucun texte d'application. Celui qui nous est soumis est un texte a minima, qui s'inscrit dans le droit-fil de l'affirmation du droit à l'eau, resté pour l'heure lettre morte.
Cette proposition de loi a pour principale vertu de conforter le rôle du FSL, créé par la loi du 31 mai 1990, dite loi Besson, et dont la gestion est placée sous la tutelle du département. Mais le FSL pouvait déjà venir en aide à ceux qui ne peuvent payer leur facture d'eau.
Certes, cette contribution complémentaire lui fournira des moyens nouveaux ; mais n'oublions pas que 20 % des départements n'ont pas de FSL et que 50 % des FSL existants ne se sont jusqu'à présent pas occupés des problèmes de règlement des factures d'eau, se limitant aux seules factures de gaz et d'électricité.
Dès lors, on peut se demander si, à la faveur de cette loi, les FSL s'impliqueront davantage dans le domaine de l'eau. Or, pour les personnes en grande difficulté, par exemple pour un ménage percevant le RSA ou pour un couple qui vit du SMIC, le coût de l'eau dépasse largement 3 % des revenus. Il faut donc que les FSL se mobilisent davantage et, pour qu'ils le fassent, il faut que les pouvoirs publics les y incitent.
J'ajoute que cette nouvelle dépense risque évidemment de conduire certains distributeurs à augmenter le prix de l'eau, ce qui placera d'autres ménages déjà fragiles en situation d'impayé.
Enfin, le meilleur moyen de garantir un véritable droit à l'eau serait sans doute une allocation sur le modèle de l'aide personnalisée au logement. Afin de développer l'aspect social du traitement du problème, la communauté urbaine de Lille a souhaité mener une expérimentation en ce sens sur son territoire. Comme M. Flajolet l'a fait au niveau national, nous avons donc interrogé les caisses d'allocations familiales de l'agglomération.
Or, quelque intérêt qu'elles portent à la question, elles ont émis un avis défavorable, car leur plan de charge, du fait de la réduction d'effectifs en leur sein comme ailleurs, ne leur permet pas de mener une telle expérimentation. Pourtant – vous le savez, monsieur le secrétaire d'État –, les CAF sont les organismes les plus à même de connaître précisément les ressources des ménages, donc les éventuels bénéficiaires d'une allocation.
Ce que nous avons fait pour le gaz et l'énergie, mais aussi pour le téléphone, ce que nous ferons probablement bientôt pour internet, exige que la solidarité en matière d'accès à l'eau progresse elle aussi de manière significative. Et cette solidarité ne saurait être uniquement territoriale : elle doit être l'une des expressions de la solidarité nationale. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette année, le prix de l'électricité a augmenté de 15 %, celui du gaz de 10 %, et la loi NOME, votée la semaine dernière, entraînera de nouvelles augmentations des tarifs de l'électricité.

Mes collègues socialistes vous ont longuement mis en garde contre cette conséquence inévitable.

La facture de l'eau représente déjà 5 % du budget d'un ménage au RSA alors que l'OCDE et les Nations unies préconisent une norme de 3 % des revenus comme limite maximale de ce poste de dépenses.
La présente proposition de loi offre certes quelques avancées en matière sociale. D'une part, elle permettra aux ménages payant leur facture d'eau dans les charges locatives de bénéficier de l'aide du Fonds de solidarité logement. D'autre part, elle simplifiera le système des abandons de créances en rendant automatique, dans une certaine mesure, la participation des gestionnaires de réseaux au FSL.
Mais les avancées sociales s'arrêtent là. Avec ce texte, vous tentez de vous donner bonne conscience en faisant un geste en faveur des plus démunis, mais ce geste est plus proche de l'aumône que du progrès social.
Cette proposition de loi manque cruellement d'ambition, pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, la taxe sur les bénéfices des gestionnaires de réseaux d'eau est insuffisante. Je vous rappelle que le texte initial proposé par M. Cambon prévoyait un prélèvement de 1 % que la commission économique du Sénat a ramené à 0,5 %, une goutte d'eau au regard des marges de 50 % à 60 % que réalisent certaines sociétés fermières.
Ensuite, la taxe proposée n'est pas obligatoire. Quelles communes consentiront donc à se priver d'une partie de leurs ressources alors qu'elles sont déjà asphyxiées par la réforme des collectivités territoriales et celle de la taxe professionnelle ?
Enfin, l'aide proposée est curative comme dans les dispositifs existants. Un dispositif préventif aurait été plus judicieux.
Nous aurions pu avoir, grâce à ce texte, un débat national de premier ordre, où auraient été discutées des questions aussi cruciales que celles de l'accès à l'eau pour les plus démunis, de la mise en place d'un tarif de première nécessité comme il en existe pour l'électricité, voire d'une allocation « eau » sur le modèle de l'allocation « logement », comme le proposait le rapport de l'Observatoire des usagers de l'assainissement de l'Île-de-France.
Nous aurions pu débattre également de la nécessaire péréquation nationale en matière d'accès à l'eau. Pour mémoire, je vous rappelle que le prix du mètre cube d'eau potable varie selon les villes de 1,86 euro à 4,10 euros.
Alors que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 consacre le droit d'accès à l'eau potable pour tous, nous aurions pu discuter dans cet hémicycle du mode de calcul et du contrôle du prix de l'eau et des possibilités de l'encadrer pour mettre un terme aux profits indécents des sociétés gestionnaires de réseaux. En effet, rien n'est prévu dans le texte actuel pour éviter une augmentation des tarifs. Les groupes de distribution d'eau ne se priveront certainement pas d'une hausse pour contrebalancer cette nouvelle taxe et sauvegarder les profits de leurs actionnaires. Finalement, ce seront les pauvres qui paieront pour les plus démunis. Drôle de vision de la solidarité !
Pour conclure, je dirai que cette proposition de loi vous donne bonne conscience, en ajoutant une goutte de solidarité aux dizaines de mesures injustes adoptées depuis 2007. Cette solidarité minimaliste, vous allez encore une fois la faire supporter aux collectivités territoriales, et au premier chef aux départements qui financent à plus de 75 % le FSL, alors que depuis 2004, la contribution de l'État est fixe malgré une inflation galopante des demandes d'aides sociales.
Pour améliorer ce texte, pour le rendre un peu plus juste, nous avons déposé quelques amendements.
D'abord, nous voulons rendre obligatoire la participation des gestionnaires de réseaux d'eau aux finances du FSL. Ensuite, nous vous demandons de fixer à nouveau à 1 % le taux de prélèvement sur les bénéfices, comme le prévoyait la proposition de loi de M. Cambon. En outre, afin d'éviter que cette taxe ne se dilue dans le financement global du FSL, nous souhaitons que le produit de ce prélèvement aille directement au volet « eau » du FSL. En effet, environ la moitié des départements n'accordent pas d'aides au paiement de l'eau. Enfin, nous voudrions que soit mis en place un barème qui prenne en compte les ressources des ménages afin d'instaurer une tarification sociale de l'eau.
Pour que ce texte ait une réelle portée en matière sociale, nous avons déposé un dernier amendement qui permet de prévenir les risques d'impayés en faisant intervenir le FSL en amont afin de réduire préventivement la facture d'eau.
Mes chers collègues, nous sommes tous conscients de l'importance de l'enjeu de cette proposition de loi et des moyens à mettre en oeuvre pour que celle-ci ne soit pas qu'un dispositif facultatif de plus parmi les aides au paiement de la facture de l'eau. C'est pourquoi nous estimons qu'elle doit être améliorée. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'occasion de cette proposition de loi, je me dois de vous rappeler au préalable que les centres communaux d'action sociale, dans le cadre de la solidarité municipale, ont d'ores et déjà la possibilité d'intervenir sur les factures d'eau impayées de leurs concitoyens.
Nous estimons que la proposition dans sa rédaction actuelle n'est pas satisfaisante. Elle suscite de nombreux questionnements.
Tout d'abord, la contribution prévue est facultative et volontaire pour les communes et les collectivités. Or la plupart ont délégué leur service d'eau à des prestataires privés à travers des contrats dont la durée de vie, vous ne l'ignorez pas, est relativement longue. Des avenants seront donc nécessaires pour contraindre les délégataires à verser cette contribution et je doute que les opérateurs privés dont le but est de faire des profits acceptent cette modification de leur délégation sans contrepartie alors même qu'ils s'en sortent très bien, comme le soulignait M. Dussopt.
Le volet facultatif de la contribution ne permet pas non plus d'obtenir des garanties sur l'avenir du projet.
La contribution proposée serait plafonnée à 0,5 % des recettes hors taxes. C'est grâce au paiement des factures des usagers des services qu'indirectement les recettes sont obtenues. De fait, ce sont les ménages, non seulement à travers le paiement de leurs factures d'eau mais également à travers l'impôt local, dans le cas des délégations, qui devront une nouvelle fois supporter le coût du dispositif de solidarité souhaité par la majorité.
L'aide apportée directement au FSL sera redistribuée dans un budget global départemental. Toutefois, le problème que pose le cas des départements dépourvus de fonds de solidarité logement n'est pas résolu. Or seuls soixante-treize départements en sont dotés.
Le caractère facultatif de la contribution conduit le législateur que je suis à se poser plusieurs questions, compte tenu du contexte difficile que connaissent les collectivités territoriales de notre pays.
Quelles communes accepteront de payer pour les autres ? Il sera difficile aux petites collectivités en régie de participer financièrement. Le budget des dotations de l'État aux collectivités récemment adopté ne peut que freiner leurs ardeurs en matière de contributions volontaires.
Ne nous trompons pas de débat, mes chers collègues. Il existe à ce jour une tarification sociale pour l'énergie, que ce soit pour le gaz, l'électricité ou le téléphone. Mais rien n'est prévu pour assurer l'accès à l'eau, reconnu par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques comme un droit fondamental.
C'est à une tarification sociale progressive qu'il faut penser et non à une aide volontaire et facultative des communes. Cette proposition est vouée à l'échec du fait de ses modalités de mise en oeuvre. L'accès à l'eau doit être un droit pour les publics les plus précarisés au lieu de reposer sur une demande d'aide sociale trop souvent synonyme d'assistanat.
L'accès à l'eau est un droit fondamental : l'eau est un bien public d'intérêt général et non une marchandise. Cette proposition de loi n'aborde absolument pas le débat sur l'eau comme bien commun de l'humanité, notion chère à Mme Danielle Mitterrand qui a élevé le droit d'accès à l'eau potable au premier rang des droits de l'homme pour les plus démunis.
La motion de renvoi en commission ayant été rejetée, j'espère que nos amendements seront adoptés afin d'améliorer ce texte. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous examinons fait un tout petit pas vers l'application de l'article premier de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques votée en 2006 qui consacre un droit d'accès à l'eau potable pour « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiques acceptables pour tous ».
L'accès à l'eau est un droit fondamental. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs rattaché le droit à une eau saine à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui protège la vie privée et familiale. Il est donc impératif d'assurer, réellement et concrètement, à chacun de nos concitoyens, un accès à l'eau potable, quels que soient son logement et ses ressources.
En moyenne, la facture d'eau en France est d'environ 21 euros par mois. Cette somme, très accessible pour nombre de nos concitoyens, représente 1, 6 % du revenu médian mais 5 % du RMI désormais remplacé par le RSA. Cette charge est donc loin d'être négligeable pour les personnes en difficultés. De plus, fait totalement inacceptable dans notre pays, il existe encore des ménages qui n'ont pas l'eau courante, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons géographiques. À cet égard, la Coalition Eau, qui regroupe vingt-six ONG, évoque le chiffre de plus de 500 000 ménages très démunis sans eau courante. Il s'agit de SDF, de gens du voyage mais également de personnes en situation très précaire, trop pauvres pour assurer leurs factures d'eau. De fait, les factures impayées sont en constante augmentation.
Il est donc plus que temps de prendre des mesures pour garantir un accès effectif à l'eau potable. Le texte proposé est, de ce point de vue, très décevant : il ne répond ni aux questions qui se posent quant à la constitution des prix de l'eau, ni aux interrogations portées par de nombreux observateurs sur la réalité de la concurrence entre les principaux distributeurs privés. Chacun sait bien qu'il est nécessaire de faire plus de clarté dans l'analyse du prix de l'eau distribuée ainsi que dans la mise en concurrence qui n'est pas toujours effective.
Il faut savoir que deux entreprises détiennent à elles seules plus de 80 % du marché de l'eau et de l'assainissement. Dans plusieurs villes, la gestion de l'eau est assurée par une société filiale détenue à parité par deux groupes supposés être concurrents. En 2002, le Conseil de la concurrence avait d'ailleurs dénoncé l'abus de position dominante de ces deux sociétés et demandé au ministre de l'économie le « réexamen, pouvant aller jusqu'au démantèlement, des filiales communes créées conjointement ». Or cela est resté lettre morte.
S'agissant de la constitution du prix de l'eau, des questions se posent également à propos du prix de traitement des eaux brutes, des surdimensionnements de certains investissements de traitement, comme l'a souligné la Cour des comptes elle-même.
Votre texte ne crée pas le service minimum que nous attendons pour l'accès de tous à l'eau. Joël Séché, président du groupe SAUR, a lui-même pris la plume et fait paraître une tribune dans Les Échos du mardi 23 novembre pour demander une « tarification vertueuse » de l'eau : « À l'image d'autres biens essentiels – électricité, gaz –, je partage pleinement la proposition d'élus et d'associations d'une tarification sociale de l'eau fondée sur les capacités financières des ménages. » Pourquoi ne pas avoir intégré ces options au texte ?
Cette proposition de loi se contente d'instaurer un système de subventions pour amoindrir les factures des personnes en situation de précarité avec une subvention au Fonds social du logement limitée à 0,5 % seulement du total des redevances perçues par le service de distribution concerné. Les collectivités feront ce qu'elles peuvent, comme les orateurs précédents l'ont souligné, selon ce que décideront leurs assemblées délibérantes, avec toutes les inégalités de traitement que cela peut produire sur notre territoire.
Les députés socialistes font donc des propositions. Nous suggérons notamment d'instaurer un service social de l'eau pour certaines catégories d'usagers, de donner la possibilité aux collectivités de modifier le tarif de l'eau en fonction de ces catégories d'usagers et de prévoir une aide de la collectivité pour le paiement des factures de façon préventive.
Ce texte, s'il permet d'ouvrir un débat très utile, est loin de répondre à toutes les questions posées. Il faudra certainement y revenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, près d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 2 millions d'hommes et de femmes meurent chaque année de maladies liées à l'absence ou à la mauvaise qualité de l'eau. Autant dire que le sixième forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Marseille en 2012, devra être marqué par des engagements concrets des États pour garantir le droit à l'eau.
Comme je le constate dans mes permanences, de plus en plus de familles éprouvent des difficultés pour payer leur facture d'eau. Une récente étude de l'Observatoire des usagers de l'assainissement en Île-de-France l'a montré, chiffres à l'appui. Certaines familles doivent consacrer plus de 5 % de leurs ressources pour accéder à l'eau alors que l'ONU a estimé qu'au-delà de 3 %, le droit à l'eau n'était plus garanti. De plus, l'injustice règne quand on sait que d'un territoire à l'autre, le prix de l'eau au mètre cube peut varier du simple au double.
Pendant ce temps, les deux multinationales qui se partagent en France l'essentiel des marchés font des profits faramineux. En 2008, qui fut pourtant une année de crise, elles ont réalisé chacune plus de cinq milliards de chiffre d'affaires.
Plusieurs associations nationales, l'UNAF, la Confédération nationale du logement, la Fondation Abbé Pierre, la CLCV se sont battues avec l'Observatoire des usagers de l'assainissement en Île-de-France pour dénoncer cette situation. Elles ont élaboré des propositions que j'ai voulu relayer en déposant une proposition de loi, à l'instar de M. Flajolet.
Ces associations ont obtenu des engagements de la part du Gouvernement. Au congrès de l'Association des maires de France de 2009, Mme la secrétaire d'État à l'écologie de l'époque, Chantal Jouanno, s'était engagée à déposer un texte rapidement, sous réserve d'un avis favorable du Comité national de l'eau. Cet avis a été rendu ; il était favorable, mais le Gouvernement ne s'en est pas emparé pour déposer un projet de loi. Aujourd'hui, nous en sommes réduits à examiner la proposition de loi de M. Cambon, qui reste à mi-chemin des recommandations du Comité national de l'eau.
Comment parler de droit si en lieu et place d'un mécanisme préventif et automatique fondé sur des critères définis par la loi, on instaure un système d'aide a posteriori, qui plus est au bon vouloir des collectivités ?
Nous savons tous qu'à l'origine des dettes d'eau se trouvent les bas salaires, l'extension de la misère. Le rapport n° 626 sur l'application de la LEMA soulignait que, dans le cadre du débat actuel sur le pouvoir d'achat où il apparaissait clairement que tout devait être fait pour améliorer le quotidien des familles les plus modestes, la question de la facture de l'eau devait être intégrée. Il faut donc garantir le droit à l'eau, comme tous les autres droits, en instaurant un mécanisme préventif et non suspensif. Il faut tout faire pour éviter la formation des dettes d'eau.
À l'initiative de M. Flajolet, l'adoption d'un rapport a été retenue en commission. Comme les députés communistes, il demande la mise en place d'une allocation de solidarité pour l'eau. Je m'en félicite. Mais pourquoi ne pas aller plus loin en proposant d'inscrire dans la loi le seuil de 3 % recommandé par l'ONU ? En prévoyant des mécanismes de contrôle démocratiques du droit à l'eau ? C'est souvent là que le bât blesse. Si nous avions un service public géré avec les usagers et les élus, le droit à l'eau serait garanti depuis longtemps. Pourquoi ne pas proposer encore de financer l'allocation par les entreprises de l'eau dont les profits résultent indûment de la marchandisation d'un bien commun de l'humanité. Ces entreprises captent une rente sur les usagers, qui n'ont pas d'autre choix que de passer par elles pour accéder à l'eau. C'est une part de ces profits qu'il faut mettre au service de la solidarité nationale.
Un amendement a été déposé par M. le rapporteur, proposant une tarification sociale de l'eau. Cela pourrait être une bonne nouvelle si la tarification sociale remplissait ses objectifs dans d'autres domaines. Les associations qui sont en train d'évaluer le dispositif dans le cadre des débats sur la précarité énergétique sont formelles : cela ne fonctionne pas bien. En raison du caractère très restrictif de ses critères d'attribution, 65 % des ayants droit potentiels ne sont pas bénéficiaires du tarif social de l'électricité. Pour en bénéficier, il faut gagner moins de 604 euros par mois !
Ce ne sont pas les seuls inconvénients de la tarification sociale de l'eau. En dehors du fait qu'elle est difficilement applicable au domaine de l'eau compte tenu du nombre des opérateurs, cette tarification ne peut pas être mise en oeuvre dans les logements collectifs. Enfin, et surtout, une tarification sociale ne permet pas de garantir de manière automatique que le seuil de 3 % recommandé par l'ONU, au-delà duquel le droit à l'eau n'existe pas, sera effectif. Voilà pourquoi je défendrai des amendements reprenant les propositions des associations et du Comité national de l'eau.
Pour répondre aux attentes de ces associations, je vous propose de mettre en place une allocation de solidarité plafonnant la charge d'eau des ménages à 3 % de leurs ressources. Elle serait versée sous conditions de ressources par les caisses d'allocations familiales, comme les APL, et gérée démocratiquement au niveau régional par les usagers, les élus et des représentants de l'État et des services publics de l'eau et de l'assainissement. Enfin, elle serait financée à titre principal sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur, au taux modique de 1 %. En 2008, cette taxe aurait rapporté plus de 110 millions d'euros, de quoi financer le droit à l'eau et des programmes de préservation de la ressource eau sans compromettre les nécessaires investissements que ces entreprises doivent réaliser. Le mécanisme que nous proposons est juste, simple et financé de manière pérenne.
Chers collègues, l'eau est un droit, pas une marchandise. Proclamer ce droit dans la LEMA n'est pas suffisant. En proposant une allocation de solidarité pour l'eau, financée par les profits des multinationales de l'eau et gérée démocratiquement, nous voulons poser les fondements d'un grand service public national de l'eau, seul à même de garantir un tarif unique sur tout le territoire, comme pour l'électricité. Cette allocation serait une grande avancée pour des centaines de milliers d'hommes et de femmes dans ce pays.
C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire le choix, défendu par les associations et les plus hautes instances dans le domaine de l'eau, d'une allocation eau. C'est ce choix innovant que nous souhaitons voir porter par la France lors du prochain sommet mondial.

Madame la présidente, madame la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, mes chers collègues, beaucoup a déjà été dit, ce qui va m'obliger à certaines redites. Toutefois, je crois qu'il ne sera pas inutile de répéter inlassablement nos observations pour parvenir à convaincre notre rapporteur de leur bien-fondé.
Rappelons d'abord quelques vérités. L'eau, bien public d'intérêt général, ne saurait être considérée comme une marchandise. Nous devrions donc retrouver dans nos lois l'idée que l'eau doit être traitée comme un bien public, de première nécessité de surcroît.
L'eau représente bien un besoin essentiel que tout le monde doit pouvoir satisfaire également et dont personne ne peut être privé, même ceux qui, précipités dans les affres du chômage en raison des difficultés économiques, n'ont plus les moyens de payer leur consommation.
Le texte de loi qui nous est proposé cherche essentiellement à mettre en oeuvre le droit « d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous ». C'est un volet curatif qui est mis en place dans des conditions qui pourraient paraître suffisantes.
Tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui qu'il faut aider les foyers qui en ont le plus besoin. La nécessaire inscription du mécanisme d'aide dans le cadre des dispositifs existants afin de maîtriser les coûts de gestion, la mise en oeuvre d'une solidarité entre les communes et la référence au FSL, en soulignant le rôle de chef de file du département dans le domaine de l'aide sociale, me paraissent donc les bienvenus. Cependant, la légèreté du texte lapidaire qui nous est proposé témoigne du caractère partial, superficiel, insuffisant des mesures prises.
Une fois encore, les élans généreux de cette proposition n'ont pour effet que de faire participer davantage les collectivités territoriales. Dans le contexte économique actuel, les communes et les départements auront des difficultés financières pour assumer ces choix, à supposer qu'ils en aient la volonté politique.
La proposition de loi issue des travaux de la commission reprend des dispositions déjà existantes qui, du fait de leur caractère optionnel, ont fait la preuve de leur efficacité toute relative, voire de leur inefficacité. De plus, elle ne vise qu'à renforcer le volet curatif sans s'attaquer aux véritables causes de dysfonctionnement de ce service public. J'ai entendu avec intérêt notre collègue Marie-George Buffet évoquer les bénéfices somptueux réalisés par deux opérateurs du secteur.
Chacun sait qu'aujourd'hui le dispositif des FSL ne fonctionne pas toujours correctement : 20 % des départements n'ont pas de FSL et 50 % des FSL existants n'ont pas, jusqu'à présent, pris en compte les problèmes de paiement des factures d'eau, s'occupant exclusivement des factures de gaz et d'électricité.
Il est regrettable de ne pas avoir renforcé, grâce à ce texte, la participation des entreprises, qui auraient pu et dû compenser le désengagement de l'État. Depuis 2004, les départements ont reçu la compétence de la gestion et du financement des FSL, dont la situation varie beaucoup d'un département à l'autre. La nécessaire péréquation nationale dans la gestion de ce service public national n'est plus effective. Ce transfert, vous le savez, a été opéré sans les moyens correspondants. Selon le rapport, la compensation s'élève aujourd'hui à seulement 93 millions d'euros, alors même que le financement des aides représentait 220 millions d'euros en 2008. C'est ce qui, entre autres raisons, explique que les sommes consacrées à ces aides restent limitées puisque seuls 72 000 foyers disposent aujourd'hui d'une aide au titre du FSL-eau, et uniquement à hauteur de 8,5 millions d'euros. Des problèmes de financement à ce titre sont donc clairement posés par le plafonnement de la contribution des opérateurs à 0,5 % des recettes provenant du service de l'eau. Ce texte remanié traduit manifestement un manque d'exigence vis-à-vis de la responsabilité des opérateurs.
Enfin, et ce point est essentiel, il faut dire et redire qu'une action en matière de tarification sociale de l'eau est absolument nécessaire. Il est légitime et utile de rappeler que les conditions d'accès à l'eau ne sont toujours pas économiquement acceptables pour les plus démunis. Autrement dit, le droit à l'eau est encore loin d'être effectif dans la pratique. De plus en plus de ménages sont amenés à dépenser plus de 3 % de leurs revenus pour le service d'eau et d'assainissement, seuil communément considéré comme « économiquement acceptable ». Ainsi, la facture d'eau moyenne s'élèverait à environ 21 euros par mois, ce qui représente 1,6 % du revenu médian mais 5 % du RMI.
S'agissant de la tarification sociale, le principe en est extrêmement simple : plus on consomme, plus le prix du mètre cube est élevé. La tarification progressive réduit la facture des plus démunis, alors qu'une taxe supplémentaire, si elle doit permettre de subvenir aux besoins de ceux qui sont dans la difficulté, n'en est pas moins une charge pour tous les revenus modestes. Avec la tarification sociale, ces derniers paieraient donc l'eau moins cher. Elle est donc juste sur le plan social et, en poussant les gros consommateurs à mettre en place des dispositifs d'économie ou de récupération, efficace sur le plan environnemental. Je peux vous dire que dans les communes – toujours de gauche – qui ont mis en place ce système, tout le monde est satisfait et que la consommation générale a tendance à diminuer nettement, de 7 % à 10 %.
Aujourd'hui, une étude d'impact nous aurait paru souhaitable pour un texte qui arrive trop vite, qui est trop superficiel et qui ne règle pas le problème de fond. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La discussion générale est close.
La parole est à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, je souhaite répondre aux différentes interventions par quelques éléments très concrets.
Nombre d'entre vous ont considéré que la proposition de loi manquait d'ambition en ne comportant pas encore de volet préventif. Je redis que la France est un des seuls pays à avoir inscrit le droit à l'eau dans une loi, celle de 2006, qui en prévoit l'exercice via le FSL et que la proposition de loi améliore et rend efficace. Ce n'est pas un renoncement à la mise en place d'un volet préventif, au contraire. Chacun conviendra avec moi qu'avant de l'instaurer, il nous faut avoir une idée claire de la façon dont l'aide arriverait aux bénéficiaires. À ce propos, je voudrais remercier le Comité national de l'eau et particulièrement son président, André Flajolet, pour les travaux qui y ont été menés depuis un an sur le dispositif préventif.
Il y a un choix à faire entre deux types de solutions, ce qui rend nécessaire d'approfondir les travaux : d'une part, la tarification sociale, à l'instar de ce qui existe pour le téléphone, qui est très séduisante ; d'autre part, une allocation, comme pour l'APL.
La tarification sociale sur le modèle du téléphone ne semble pas totalement transférable d'un secteur où exercent quelques opérateurs à un autre, comme celui de l'eau, qui en compte plus de 15 000 avec des abonnés individuels et collectifs. Il y aurait des risques d'injustice au profit d'ailleurs des premiers.
La solution d'une taxe de 0,5 % sur la facture d'eau, puis d'une allocation aux ménages modestes pour que leur facture ne dépasse pas les fameux 3 % que vous avez été nombreux à citer, nécessite de mettre en place une organisation pour comparer ces deux valeurs. Il ne faudrait pas, alors qu'on a rendu plus lisible, plus efficace, le volet curatif, se retrouver avec un volet préventif extrêmement complexe avec des coûts de gestion importants. Dans ce cas, nous aurions besoin d'un gestionnaire qui serait, selon le Comité national de l'eau, les caisses d'allocations familiales. Or ces dernières sont réticentes pour la raison qu'elles ne connaissent pas tous les publics, notamment les agriculteurs. On pourrait également imaginer que les conseils généraux, gestionnaires du FSL, soient opérateurs.
Nous avons vraiment besoin d'approfondir ces questions avant de choisir. C'est l'objet de l'amendement d'André Flajolet ; il me paraît très opportun, mais je proposerai de prolonger le délai prévu de quelques mois.
J'en viens à quelques réponses plus particulières. Madame Buffet, la proposition de loi a été déposée au Sénat avant la délibération du Conseil national de l'eau. Reste que, comme je viens de le démontrer, les travaux ne sont pas achevés en ce qui concerne le volet préventif et nous ne voulons pas retarder l'approbation du volet curatif. Cela ne signifie pas que rien n'ait été fait entre-temps et que les services du ministère n'y travaillent pas.
La dernière réunion sur le volet préventif a d'ailleurs eu lieu il y a trois jours, le 29 novembre, avec les services des ministères de la solidarité, de la santé, de l'intérieur, en vue d'une adoption rapide. Benoist Apparu a rappelé l'engagement du Gouvernement à inscrire ce volet dans le projet de loi de finances pour 2012.
Je répondrai à M. Dussopt, qui a présenté la motion de renvoi, que le texte ne se réduit pas à des bons sentiments puisque l'on passerait de 60 000 à 526 000 bénéficiaires. On ne peut pas non plus soutenir qu'il ne se passe rien en ce qui concerne les prix : depuis 2009, l'étude de leur évolution et de la qualité du service fait l'objet d'une plus grande transparence. J'ajoute que certaines propositions avancées dans cette motion seraient inconstitutionnelles. L'idée, par exemple, de fixer des niveaux de prix en fonction des revenus n'est pas possible si l'on s'en tient à la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle un tel dispositif contreviendrait au principe d'égalité entre les citoyens.
Jean-René Marsac et Marie-George Buffet ont évoqué les impayés. Il ne faut pas, en la matière, céder au catastrophisme dans la mesure où ils ne représentent que moins de 1 % des factures émises. Le tarif moyen par mètre cube pour une consommation annuelle de 120 mètres cubes est en France de 3,39 euros en 2008 avec, il est vrai, de fortes disparités. Dans certains départements ce prix est inférieur à 2,50 euros par mètre cube – la Réunion, la Guyane, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ain, le Jura, le Cantal –, alors que dans d'autres il dépasse 4 euros – la Seine-et-Marne, les départements de la Bretagne, mais aussi la Manche, la Vendée, la Guadeloupe, la Martinique. Au total, la part de la facture d'eau représente quelque 0,8 % des revenus des ménages. L'eau reste donc accessible à la plupart de nos concitoyens. Je ne minimise pas le problème que le texte tente de résoudre mais je le replace dans son contexte.
Je précise à l'attention de Jacques Valax et Marie-George Buffet que ce ne sont pas les collectivités territoriales qui payent mais tous les abonnés qui font preuve de solidarité. Cinq pour cent d'une facture d'eau annuelle de 300 euros représentent 1,50 euros. Il s'agit bien d'un système de solidarité entre abonnés.
À propos du forum mondial de l'eau, Guy Geoffroy nous appelait à être au rendez-vous et Raymond Durand a signalé qu'il devait constituer une nouvelle étape – point de vue que partage le Gouvernement. Il se tiendra à Marseille au mois de mars 2012 et, puisqu'il aura lieu en France, nous nous sentons une responsabilité particulière. Nous préparons par conséquent très activement cette échéance en nous appuyant sur les résultats du forum d'Istanbul.
Le prochain forum, sixième du genre, se veut celui des solutions. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Il s'agit globalement de mettre en oeuvre le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement autour de trois axes de discussion. Tout d'abord, si le cadre réglementaire est très achevé et très sophistiqué en France – ce n'est pas le cas partout. La plateforme d'aide internationale imaginée à Istanbul sur ce sujet pour aider les pays à développer un cadre réglementaire adéquat constitue un outil précieux. Le second point est la gouvernance locale : la France promeut un système de gestion par bassins versants, en vigueur depuis plusieurs décennies et répliqué au niveau de l'Union européenne. Ce système, qui permet une planification, une plus grande démocratie, se fonde sur un principe simple selon lequel l'eau paie l'eau au sein d'un espace cohérent du point de vue de la ressource. Le troisième point abordé à Marseille concernera les infrastructures et donc les financements. Je rappelle à ce propos que la France est d'ores et déjà très engagée à travers l'aide publique au développement depuis la loi Oudin-Santini. La France n'a pas à rougir de toutes ses actions en la matière, elle se situe même à la pointe. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

J'appelle les articles de la proposition de loi dans le texte de la commission.

Je m'étonne que la commission du développement durable n'ait pas été saisie au moins pour avis de cette proposition de loi. Comme le climat ou la biodiversité, l'eau est un bien commun de l'humanité : sans eau, nulle vie n'est possible. Près d'un milliard d'individus n'ont toujours pas accès à l'eau potable et, chaque année, 2 millions de personnes meurent du manque d'eau ou de l'usage d'une eau souillée.
La ressource en eau est limitée alors que la population mondiale va s'accroître de près de 50 % dans les quarante prochaines années. La ressource en eau est menacée par des pollutions de toutes sortes. Elle est de plus l'objet d'enjeux financiers particulièrement importants et qui, dans certaines régions du globe, sont source de tensions et de conflits.
On ne peut à nouveau que regretter que le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement ne soit même pas un des « objectifs du Millénaire pour le développement » mais seulement l'un de ses sous-objectifs.
Si les dispositions françaises sont claires, qu'il s'agisse de la loi du 30 décembre 2006 ou de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale, elles ne permettent pas actuellement de mettre en oeuvre une véritable politique de prévention. Bien sûr, nous reconnaissons les quelques avancées inscrites dans le texte, mais nous regrettons qu'elles se limitent au domaine curatif.
Nous ne réclamons pas un service gratuit de l'eau – gratuité du reste exigée par personne – qui ne serait que source de gaspillage. Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées à plusieurs reprises, comme le versement d'une allocation de solidarité établie en fonction des revenus et faisant l'objet d'une péréquation nationale, ou la mise en place d'une tarification sociale de l'eau et de l'assainissement.
Je rappelle que Mme Jouanno, lors de l'examen de ce texte, en février 2010, avait précisé aux sénateurs qu'il fallait éviter que la facture des plus défavorisés ne représente plus de 3 % de leurs revenus. Alors que la tendance est à l'augmentation finale du prix de l'eau, les personnes bénéficiaires du RSA y consacrent désormais plus de 5 %.
Nous constatons donc que le droit à l'accès à l'eau est un droit pour tous sauf pour les pauvres. Ne serait-il pas temps, madame la ministre, de tenir l'engagement de votre prédécesseur qui avait prévu d'intégrer dans le domaine préventif les préconisations du comité national de l'eau, au premier véhicule législatif qui le permettrait, à savoir celui-ci ?

Je suis saisie d'un amendement n° 16 .
La parole est à M. le rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à préciser que la contribution de 0,5 % sera imputée sur les budgets des services publics d'eau et d'assainissement et qu'elle ne sera pas attribuée par les gestionnaires en tant que tels.
Favorable.
(L'amendement n° 16 est adopté.)

Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de précision.
(L'amendement n° 14 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Cet amendement est de pure logique. Nous souhaitons que les prélèvements sur les montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues par le service de l'eau abondent le volet « Eau » des fonds de solidarité pour le logement. Nous souhaitons que soit établie une sorte de cloisonnement, d'affectation des fonds qui seront récupérés pour l'eau et dans le cadre de ce dispositif spécifique.

Cet amendement est la démonstration que les meilleures intentions du monde et la logique qui s'y rattache peuvent parfois conduire à des résultats inverses à celui espéré. Tout le monde a souligné que l'un des enjeux de ce texte consistait à ouvrir le droit au volet correctif à tous les habitants, y compris à ceux de l'habitat collectif.
Or, si nous adoptions cet amendement, nous irions, j'y insiste, en sens inverse de l'objectif poursuivi. Les opérateurs des services d'eau seraient empêchés d'aider au paiement des dépenses d'eau en habitat collectif, dépenses qui, par définition, font partie de l'ensemble des charges sans êtres distinguées en tant que telles.
La commission a repoussé l'amendement n° 5 …

…et émet donc un avis défavorable.
(L'amendement n° 5 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Le texte émanant de la proposition de loi initiale de M. Cambon avait prévu de fixer un prélèvement des recettes réelles de fonctionnement affectées aux budgets des services eau et assainissement dans la limite de 1 %. La commission a tenu à ramener ce taux à 0,5 %. Nous maintenons que pour que le dispositif soit efficace – et c'est bien la notion d'efficacité qui a présidé à la rédaction du texte –, le plafonnement doit être porté de 0,5 % à 1 %.

La commission a repoussé cet amendement. Ainsi que l'a détaillé le rapporteur des affaires économiques du Sénat, le taux de 1 % proposé initialement par notre collègue sénateur Cambon est très élevé par rapport aux abandons de créances puisqu'il s'agissait de contrebalancer la pratique consistant à payer la facture réellement due. C'est pourquoi ce plafond, qui représente 50 millions d'euros – soit 5 % de 10 milliards d'euros –, suffira largement pour le volet curatif et il faudra, pour le volet préventif, nous y reviendrons, procéder à l'autre prélèvement de 0,5 %.
La commission émet donc un avis défavorable.
Les impayés représentent aujourd'hui entre 0,1 % et 0,2 % des recettes. Aussi le taux de 0,5 % prévu par le texte paraît-il suffisant pour répondre aux impayés. En revanche, il ne faudrait pas faire porter au dispositif le règlement des impayés économiques liés, par exemple, à la liquidation de petites entreprises. Le plafond de 0,5 % est non seulement suffisant mais sans doute plus lisible.

Je souhaite apporter une précision à M. Valax puisque j'ai travaillé en collaboration avec le sénateur Cambon : le taux de 1 % recouvre le volet curatif et le volet préventif.
(L'amendement n° 4 n'est pas adopté.)


Cet amendement vise à revenir au texte initial. Je suppose que nous sommes tous d'accord pour considérer que l'ensemble des gestionnaires doivent avoir connaissance des problèmes.

Nous abordons un point important du texte. M. Flajolet propose très clairement de revenir à la rédaction du Sénat. J'appelle son attention sur deux difficultés. Son amendement s'inscrit bien dans le domaine couvert par le présent texte, à savoir celui de l'eau, mais ne va pas au-delà, alors qu'il faudrait peut-être envisager les autres secteurs couverts par les fonds de solidarité pour le logement.
L'amendement n° 2 a également l'inconvénient de préciser la délivrance d'un avis. Or l'article 6-1 de la loi du 31 mai 1990 interdit formellement que des décisions d'octroi d'aides au titre du FSL reposent sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine, les ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. L'article 6-2 de la même loi précise que toute décision de refus doit être motivée et peut donc faire l'objet d'un recours juridictionnel. Un avis défavorable en tant que tel, prononcé par un maire et qui ne serait pas suffisamment étayé, pourrait entraîner malencontreusement des recours juridictionnels et des décisions en cascade qui généreraient beaucoup de difficultés dans la gestion par les FSL de ces dispositions en apparence généreuses mais qui, finalement, deviendraient plutôt malencontreuses.
Voilà pourquoi je propose l'amendement n° 17 , dont la rédaction constitue une alternative à l'amendement n° 2 . Il vise en effet à garantir le rôle du maire dans la gestion des demandes présentées au FSL, en insérant dans le texte des dispositions qui organisent cette procédure et en prévoyant une procédure unifiée pour toutes les demandes d'aide au FSL. C'est la réponse au premier enjeu que je signalais tout à l'heure, à savoir un FSL qui couvre, surtout pour l'habitat collectif, l'ensemble des besoins et pas simplement le besoin en eau.
Il est important d'aller dans le sens qui était souhaité par nos collègues du Sénat. Aussi serait-il hasardeux et contre-productif d'accepter l'amendement n° 2 . Je demande donc qu'il soit retiré ou qu'il soit repoussé au bénéfice de l'amendement n° 17 .

Il y a une petite différence de lecture entre les deux amendements. En effet, l'amendement n° 17 concerne la question des biens essentiels, tandis que l'amendement n° 2 ne traite que de l'eau. Je me range à l'avis de celui qui fait la loi, c'est-à-dire à celui de la commission des lois. Aussi, je retire l'amendement n° 2 .
(L'amendement n° 2 est retiré.)
(L'amendement n° 17 est adopté.)

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
La parole est à M. Jacques Valax, pour soutenir l'amendement n° 7 .

La commission est défavorable à cet amendement car la demande des auteurs de l'amendement est satisfaite par le droit en vigueur, et plus particulièrement par l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation tarifaire applicable à la catégorie d'usagers correspondante. »
Aussi, je suggère le retrait de l'amendement n° 7 .
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui est déjà satisfait.
Si l'on peut fixer le prix de l'eau en fonction des exigences de l'usager vis-à-vis du service, par exemple une forte consommation ou des pics de consommation à une période donnée, il n'est pas possible de le déterminer en fonction du revenu des usagers.

Madame la ministre, vous avez effectivement compris quel était le sens de notre amendement. En effet, la mise en place d'un véritable service public de l'eau permettant une tarification en fonction du revenu des usagers nous semble être une solution beaucoup plus opportune que la multiplication des délégations et des sociétés privées qui multiplient les tarifs.
Par principe, nous maintenons cet amendement, même si nous entendons les arguments de Mme la ministre.
(L'amendement n° 7 n'est pas adopté.)


Il s'agit, avec cet amendement, d'aborder la question alternative de la création d'une tarification sociale de l'eau.
Lors de la première réunion de notre commission, j'avais regretté que l'amendement issu des travaux du Comité national de l'eau, plus connu sous le nom d'amendement Flajolet, auquel j'avais apporté ma signature, comme un certain nombre de mes collègues, soit tombé sous le coup de l'article 40.
J'avais indiqué que, puisque nous ne pouvions pas débattre de ce sujet, pourtant au coeur des préoccupations du Comité national de l'eau, il faudrait que nous évoquions, au sein de la commission, à titre alternatif et exploratoire, la dimension de la tarification sociale.
Lors de la discussion générale, j'ai bien entendu sur tous les bancs l'intérêt de principe mais aussi la limite dans la capacité d'un tel dispositif à produire de bons effets s'il s'agissait exclusivement de la tarification sociale. Je crois que nous avons tous compris que les travaux que le ministère va poursuivre et sur lesquels il s'est engagé à produire un résultat concret au travers du projet de loi de finances pour 2012 seront plutôt tournés vers l'allocation différentielle, et que le dispositif ressemblerait plutôt à l'APL et s'appuierait sur un pourcentage de revenu disponible des familles qui ne devrait pas dépasser 3 %, sans pour autant renoncer à y inclure des éléments qui peut-être entreraient plus dans le champ de la tarification sociale.
La commission a adopté cet amendement ce matin. Je constate que nous sommes tous d'accord, la seule question qui nous différencie étant le temps que nous devons y consacrer. Si nous devons y passer un peu de temps, ce ne sera pas une catastrophe dès lors que le résultat sera à la hauteur de nos attentes.
Si cet amendement est de nature à gêner le Gouvernement dans le travail qu'il s'est engagé à poursuivre, je proposerai de le retirer. Dans le cas contraire, ce dispositif constituerait une petite avancée, certes incertaine, mais qui aurait au moins le mérite d'exister.
Les arguments du rapporteur sont justes. Toutefois, je demande le retrait de cet amendement.
Je le redis ici solennellement : nous sommes déterminés à ajouter un volet préventif au volet curatif. Le Gouvernement pense en effet qu'un dispositif construit sur un schéma du type allocation APL plutôt que sur celui du tarif social de téléphonie serait plus adapté pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Pour autant, il ne peut pas être mis en place dès à présent, car il n'est pas suffisamment abouti. À l'heure où l'on simplifie le volet curatif, ce qui permet de réduire les coûts de gestion, il serait dommage de mettre en place un volet préventif qui lui-même entraînerait des coûts de gestion importants. Je m'engage donc, comme l'a fait Benoist Apparu, à présenter un dispositif à l'automne prochain et à poursuivre le travail déjà engagé au niveau ministériel, en associant naturellement tous les parlementaires qui sont mobilisés sur ce sujet, et à mettre en oeuvre par la suite un volet préventif dont le montant global des contributions pourrait représenter 50 millions d'euros. Si le périmètre commence à être assez clairement identifié, nous avons besoin de travailler, notamment sur la question du gestionnaire. Le gestionnaire doit être volontaire et le transfert de fichiers et de gestion des fonds ne doit pas entacher ce nouveau dispositif.

Tout à l'heure, en réponse à la motion de renvoi en commission que nous avons déposée, le rapporteur nous a dit qu'il fallait faire un premier pas sur le volet curatif, mais aussi travailler sur le volet préventif, l'essentiel étant d'apporter une première pierre à l'édifice. Pour notre part, si nous avons proposé de renvoyer ce texte en commission, c'est justement pour faire en sorte qu'il soit plus complet, plus efficace et qu'il ait plus d'ambition.
L'amendement n° 11 , que le rapporteur risque de retirer à la demande du ministre, constitue, pour nous, le seul gage de la volonté réelle du législateur et du Gouvernement d'avancer sur la question de la tarification sociale. Tout à l'heure, j'aurais dû saluer votre arrivée, madame la ministre, non que la compagnie de M. Apparu soit désagréable, mais parce que nous apprécions que vous soyez présente sur un tel sujet. Mais si vous êtes venue pour demander au rapporteur de retirer le seul amendement qui avait un minimum d'ambition, d'espoir et de souffle, c'est fort dommageable. En tout cas, cela vient conforter les arguments que nous avons développés tout à l'heure en défendant la motion de renvoi en commission et prouve que le texte n'est pas abouti, qu'il manque d'ambition, qu'il risque de ne pas être efficace et qu'il aurait mérité un travail législatif plus conséquent pour atteindre son objectif.

Je remercie Mme la ministre et M. le rapporteur de proposer le retrait de cet amendement. Il y va du respect du travail partenarial qui a été mené par le Comité national de l'eau.
Vous avez raison, madame le ministre, si le texte est abouti quant à sa philosophie générale, il ne l'est pas quant à l'opérateur et à sa technicité. Je le dis parce que toutes les sensibilités politiques, sans exception, ont participé à ce travail. Et je vous remercie de l'engagement que vous prenez de nous proposer, dans les six mois, un dispositif objectif, réaliste et qui ne coûte pas cher.

Je souhaite répondre à M. Dussopt.
En retirant cet amendement, il s'agit de tout sauf d'un recul. Si cet amendement n'avait pas été présenté, nous aurions pu passer à côté de l'évocation indispensable et en profondeur du sujet du traitement préventif de l'insolvabilité d'un certain nombre de nos concitoyens au regard de l'alimentation en eau.
Les arguments qui ont été échangés avant la présentation de cet amendement et au cours de son examen, attestent que ce travail de réflexion et de proposition, loin de s'achever avec le retrait de l'amendement, ne fait que commencer et qu'il s'agit d'une contribution complémentaire qui s'ajoute modestement au travail considérable effectué par M. Flajolet et le Comité national de l'eau.
Nos débats feront foi. Il ne s'agit pas de reculer face à une demande du Gouvernement de ne pas évoquer cette affaire, mais de lui donner plus d'efficacité et de lui assurer que j'apporterai ma contribution la plus efficace possible, aux côtés d'André Flajolet et de tous les collègues investis sur ce sujet au travail qui sera proposé et mis en place.

Je tiens à m'assurer que Mme la ministre présentera bien un dispositif dans les six mois.
Je l'ai dit tout à l'heure : nous allons travailler sur ce sujet dans les six prochains mois. Une concertation sera lancée et nous proposerons un dispositif à l'automne 2011 dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2012.
(L'amendement n° 11 est retiré.)

En conséquence, le sous-amendement n° 15 n'a plus d'objet.
(L'article 1er, amendé, est adopté.)

Sur l'article 2, je suis saisie d'un amendement n° 9 rectifié .
La parole est à Mme Marie-George Buffet.

Madame la ministre, je tiens à préciser que, dès décembre 2009, j'avais déposé avec mes collègues, en prenant appui sur le débat qui avait eu lieu dans les associations, une proposition de loi sur la mise en oeuvre du droit à l'eau qui reprenait les principales dispositions que j'ai défendues aujourd'hui. Un travail avait donc déjà été effectué sur cette question.
L'amendement n° 9 rectifié vise à préciser les axes de travail sur le volet préventif.
D'abord, il est important que nous validions la recommandation de l'ONU quant au plafonnement de la facture d'eau à 3 % des dépenses des ménages. Il serait dommage que cette référence forte, que nous avons tous évoquée dans nos interventions, ne figure pas dans cet article qui va guider votre travail, madame la ministre, dans les mois qui viennent.
Ensuite, nous voulons affirmer la nécessité d'une gestion démocratique de cette allocation. Nous pourrons toujours discuter après des cheminements pour trouver la bonne formule. Au moins, nous voulons que cette préoccupation figure dans la feuille de route.
Enfin, on a parlé de la solidarité entre les usagers. Certains de mes collègues ont expliqué qu'il était bien que des abonnés un peu plus riches paient un peu plus cher pour des abonnés un peu plus pauvres. Mais il existe des structures très riches, ce sont les entreprises gestionnaires de l'eau. Nous souhaiterions qu'il soit précisé dans cet article que la solidarité doit être également le fait des entreprises.

Lors de sa première réunion, la commission a exprimé des préoccupations similaires.
Toutefois, le délai fixé par cet amendement risquerait fort d'être illusoire. En effet, si nous votons, comme je l'espère, le texte aujourd'hui, nos collègues sénateurs devront le reprendre en deuxième lecture, et rien ne nous garantit que le texte soit définitivement adopté avant le 28 février. Nous ne pouvons pas faire référence à une date sans savoir si la loi sera bien adoptée à cette date-là.
Je proposerai à Mme Buffet, puisque nous partageons le même souci, de retirer son amendement, au profit de la disposition initialement approuvée par la commission et modifiée par l'amendement n° 12 adopté hier par la commission, qui vise à substituer au délai de trois mois un délai de six mois pour la présentation du rapport.
Nous avons tous entendu l'engagement du Gouvernement sur le fait que cette question serait traitée définitivement dans le PLF pour 2012. Plutôt que d'écrire des choses impossibles, adoptons un texte raisonnable et nous constaterons que l'ensemble des engagements auront été tenus.

Monsieur le rapporteur, j'accepterais un sous-amendement qui repousserait à six mois la date de remise du rapport pourvu que le reste de mon amendement demeure.

Parce que le délai n'est pas seul en cause. Mon amendement fait également référence aux 3 % et au paiement des entreprises.
Il n'y a pas que les trois mois qui me gênaient dans l'amendement.
Sur les 3 %, il n'y a pas de désaccord entre nous et, d'ailleurs, je crois que ce point a fait l'unanimité en commission. Simplement, il ne me semble pas utile de le préciser puisqu'il s'agit d'une norme OCDE.
Par ailleurs, nous avons tous à coeur de faire en sorte que les choses se passent démocratiquement et je ne suis pas sûre que le fait d'écrire ce terme ajoute grand-chose. Il faudrait qu'il soit précisé.
Mais le point qui me gêne le plus, c'est l'a priori sur le porteur de la redistribution. Je passe sur la question de savoir qui doit payer et pourquoi ce serait seulement une solidarité entre abonnés de la DSP, il y a de toute façon un problème sur le porteur. Vous proposez de vous tourner vers les caisses d'allocations familiales, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me paraît important, à ce stade, d'être plus ouvert. Les caisses d'allocations familiales ont certes été identifiées, mais elles ne sont pas forcément très demandeuses. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Je rejoins ce qui vient d'être dit. Il y a en réalité trois problèmes techniques que le Gouvernement devra bien examiner.
D'abord, pourquoi seules quelques personnes seraient appelées au paiement de la solidarité sachant qu'il existe 15 000 opérateurs en France ? Si nous ne faisions appel qu'à quelques opérateurs, cela reviendrait, étant donné que, in fine, c'est le client qui paie, à institutionnaliser une injustice entre certains et d'autres.

Ensuite, les contrats pourraient être mis en cause. Je rappelle qu'en bas des contrats figurent deux signatures : celle de l'opérateur et celle du maire.
Enfin, si on s'appuie sur le travail du Comité national de l'eau, on s'appuie sur le principe unanimement reconnu de non-dépassement des 3 %. Cela a été annoncé à chaque page et répété par Mme la ministre. Je n'ai aucune raison de douter : sa parole vaut un écrit.
(L'amendement n° 9 rectifié n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 12 .
La parole est à M. le rapporteur.

Je l'ai défendu, madame la présidente.
(L'amendement n° 12 , accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L'article 2, amendé, est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement, n° 10 , tendant à modifier le titre de la proposition de loi.
La parole est à Mme Marie-George Buffet.

Dans les explications de vote sur l'ensemble de la proposition de loi relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement, la parole est à Mme Marie-George Buffet, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Nous sentons bien que nous sommes au début d'un processus et que ce texte est très modeste : il traite l'aspect curatif sans aborder l'important dossier du traitement préventif qui est devant nous.
J'estimais que nous avions les outils pour traiter dès aujourd'hui de ce traitement préventif. Votre souhait est de reporter ce traitement à quelques mois. J'espère que, comme vous l'avez annoncé, madame la ministre, nous serons très largement associés à cette réflexion dans les six mois qui viennent.
Le groupe GDR ne s'opposera pas à ce projet mais s'abstiendra, dans l'attente de l'étude de ce volet préventif.

La parole est à M. Jacques Valax, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Le groupe socialiste a failli être plus extrême que nos amis qui viennent de s'exprimer puisque, au départ, nous pensions voter contre, avant de nous orienter vers l'abstention – mais nous resterons fermement campés sur cette position.
Objectivement, ce texte comporte de petites avancées.
Il nous a permis de faire valoir des thèses que vous n'aviez peut-être pas intégrées, notamment la notion de tarification sociale. Nous prenons acte du fait que vous reconnaissiez que la barre des 3 % était intangible. Vous reconnaissez par ailleurs que le maire, qui connaît bien le terrain, a incontestablement un rôle à jouer dans la décision. Je regrette cependant que, systématiquement, vous nous opposiez le fait que cette mesure sera supportée par la globalité des usagers car, au final, ce seront les pauvres qui paieront pour ceux qui sont encore plus pauvres. Je déplore que cette péréquation générale vers laquelle nous souhaitons tendre ne figure pas dans cette proposition de loi.
Du côté du négatif, je mettrai le fait que, monsieur le rapporteur, vous ayez, au tout dernier moment, retiré cet amendement n° 11 qui constituait, pour nous, une petite lueur d'espoir.

Vous nous aviez indiqué que le Gouvernement, par votre intermédiaire, accepterait des avancées. Vous deviez déposer un amendement posant les premiers fondements des prémices de ce que vous appeliez la tarification sociale, ce n'était pas tout à fait la même que la nôtre mais, au moins, vous acceptiez d'en parler. Cette dérobade de dernière minute m'inquiète.
Enfin, Mme la ministre maîtrise parfaitement son dossier mais elle connaît également la réalité des échéances électorales qui se profilent et lorsqu'elle nous dit que nous évoquerons ce texte au moment de la discussion sur le PLF 2012, c'est-à-dire en 2011, je crains qu'au dernier moment, elle ne nous dise qu'elle ne peut pas inscrire ce texte à l'ordre du jour.
Non.

À cause de ces craintes avérées, nous voulions voter contre cette proposition de loi. Mais, dans la mesure où nos amis communistes font preuve à votre égard d'une tolérance ou d'une indulgence coupable, nous nous contenterons de nous abstenir. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. André Flajolet, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

Nous avons vécu un moment de démocratie apaisée, avec essentiellement une vision réaliste des problèmes et non la vision misérabiliste à laquelle nous sommes malheureusement habitués dans des discours plus idéologiques que philosophiques.

Je remercie mes collègues qui ont voulu aller sur cette route à la fois du curatif et du préventif en reconnaissant que j'étais simplement porteur des travaux du comité national de l'eau. Ce texte inscrit déjà la perspective d'une écriture technique et pratique…

…de ce que nous serons capables de faire. Je vous remercie de votre capacité d'écoute. Je suis convaincu que d'ici à six mois, chacun ayant apporté sa pierre, il sera possible d'obtenir un vote unanime sur une proposition rénovée. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Je tenais à saluer le travail parlementaire qui a été le nôtre cet après-midi – nous avons exposé nos idées, nous avons échangé, nous avons débattu – même si, malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à un accord unanime autour de cette question qu'est l'accès à l'eau et à l'assainissement.
Vous l'aurez compris, chers collègues, les centristes voteront en faveur de cette proposition de loi.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)
Vote sur l'ensemble

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (nos 2948, 2981).
La parole est à Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, cette proposition de loi a pour origine les travaux conduits par les commissions de la culture et des finances du Sénat, dont notamment ceux des sénateurs Jean-Léonce Dupont et Philippe Adnot.
Votre commission des affaires culturelles a, elle aussi, été très active sur ces sujets – je pense, bien entendu, à tous les travaux qu'elle a menés tant sur la réforme des universités que sur d'autres sujets comme le vote électronique, avec la proposition de loi dont je salue ici le rapporteur, Arnaud Robinet. Je me réjouis toujours de voir que le Parlement porte un très grand intérêt aux sujets concernant l'enseignement supérieur et la recherche.
Avec cette proposition de loi, vous avez voulu, mesdames et messieurs les députés, apporter des réponses concrètes et efficaces aux obstacles techniques sur lesquels les projets de nos universités viennent parfois buter.
Armer nos universités dans la compétition mondiale de l'intelligence, leur permettre de s'adapter aux besoins de la société, de s'ancrer dans leur territoire tout en s'ouvrant au monde ; mobiliser chaque membre de la communauté universitaire autour d'un véritable projet d'établissement ; offrir à tous nos étudiants une formation de qualité et de véritables perspectives professionnelles : tels sont, vous le savez, les objectifs de la réforme des universités, tout entière fondée sur le socle de l'autonomie.
La loi du 10 août 2007 a reconnu aux universités la liberté de conduire et de construire une vraie stratégie de formation et de recherche. Et, vous le savez, c'est une réussite : les universités ont « envie » d'autonomie.
Dès le 1er janvier prochain, soixante-quinze universités seront devenues autonomes. En trois ans, à peine, 90 % des établissements seront ainsi passés aux responsabilités et compétences élargies. Il s'agit donc d'un véritable succès dont nous partageons tous la paternité.
Je l'avais rappelé au moment de l'examen du projet de loi sur la réforme des universités : l'autonomie ne se conçoit pas sans une coopération renforcée entre nos établissements d'enseignement supérieur.
Une université autonome, c'est avant tout une université ancrée dans son territoire qui créé des solidarités et des coopérations avec ses partenaires, vous le constatez au quotidien dans vos circonscriptions.
Une université autonome, c'est avant tout une université qui tisse des liens étroits avec les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi avec les acteurs économiques et le tissu associatif.
L'autonomie n'est ni le repli sur soi ni la concurrence, mais c'est bien le moyen pour nos établissements de construire de nouvelles coopérations fondées sur des ambitions et des stratégies communes définies à l'échelle d'un territoire.
Les universités et les écoles ont mis progressivement en commun leurs forces, pour construire des projets pédagogiques forts et pour rayonner à l'échelle territoriale, nationale et internationale. Pour organiser ces regroupements entre les établissements, des outils existent d'ores et déjà : je pense en particulier aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES, qui ont été créés en 2006 par la loi d'orientation de programme et de recherche.
Ces PRES sont de formidables outils de coopération et de mise en commun des potentiels. La formule a fait ses preuves et elle a séduit les établissements puisque, à ce jour, dix-neuf PRES ont été créés.
Cependant, ce n'est pas le seul outil qui existe, et je veux insister sur ce point : il ne peut pas, il ne doit pas y avoir de modèle unique. Car, une fois encore, il n'y a qu'une seule règle, un seul maître mot : le « sur-mesure ».
Cette proposition de loi se situe dans la droite ligne de notre objectif qui est de répondre aux besoins des universités en leur proposant tous les outils nécessaires, tant en termes d'immobilier que de diplômes, pour accompagner leurs projets. C'est pourquoi le Gouvernement la soutient. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Françoise de Panafieu, rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'université française change.
À la suite de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, ces dernières disposent d'une plus grande autonomie de gestion qui doit leur permettre d'atteindre les trois grands objectifs fixés par ce même texe : rendre l'université plus attractive, sortir de la paralysie qui caractérisait leur gouvernance, et rendre la recherche universitaire plus visible à l'international.
Ces évolutions sont également illustrées de manière très concrète par le grand chantier de la rénovation d'un immobilier universitaire souvent vétuste, qui donne de l'université française une image très peu attractive pour les étudiants et les chercheurs étrangers. Ainsi l'opération Campus, plan exceptionnel en faveur de l'immobilier universitaire, menée à l'initiative du Président de la République et suivie par Mme la ministre avec passion et constance, doit-elle permettre de faire émerger des campus d'excellence.
Madame Pécresse, vous avez obtenu pas moins de 5 milliards d'euros qui bénéficieront à douze grands projets destinés à devenir de véritables vitrines de l'université française. À ces projets s'ajoutent les onze sites retenus soit sous le label de « campus prometteur» soit sous celui de « campus innovant ».
Cependant, pour l'heure, cette opération se heurte à un obstacle juridique : les universités, qui ne sont pas propriétaires de l'immobilier mis à leur disposition par l'État, ne peuvent pas conclure de contrats conférant des droits réels à des tiers, comme les contrats de partenariat comportant la perception de recettes annexes par un opérateur privé ou les autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Or, ces formules sont précisément les plus intéressantes pour les participants à l'opération Campus.
Le premier objectif de ce texte, dont le Sénat a pris l'initiative à la suite d'un rapport d'information de ses commissions des finances et de la culture, est donc de faciliter les opérations de valorisation et de réhabilitation du patrimoine immobilier des universités, en permettant à ces dernières de conclure des contrats conférant des droits réels à des tiers.
Sans ces dispositions, de nombreux projets sont bloqués. Je n'en cite qu'un, celui de l'université de Strasbourg.

Strasbourg, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, a élaboré un projet concernant la rénovation de bâtiments des années soixante, la bibliothèque universitaire ou la vie étudiante.
Il est donc urgent que cette proposition de loi soit votée et promulguée pour permettre rapidement la réalisation des opérations du plan Campus.

Le deuxième objectif de ce texte est de renforcer la visibilité internationale de notre système d'enseignement supérieur et de recherche, en habilitant les pôles de recherche et d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes.
Aujourd'hui, seules les universités et autres établissements d'enseignement supérieur reconnus par l'État sont habilités à délivrer des diplômes nationaux tels que la licence ou le master. Pourtant, désormais, les grandes écoles et les universités se rapprochent de plus en plus au sein des PRES. Il est donc normal de faciliter ce mouvement et d'aller vers une labellisation des doctorats et des masters internationaux, voire de l'ensemble des diplômes.
L'article 2 de la proposition de loi ouvre donc aux EPCS, en tant qu'établissements publics exerçant des activités d'enseignement et de recherche, la possibilité d'être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux.
Le troisième objectif poursuivi par la proposition de loi est celui d'un renforcement des regroupements et de la coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à travers divers instruments.
L'article 2 bis élargit les possibilités de rattachement entre différentes structures publiques ou privées d'enseignement supérieur et de recherche afin qu'elles puissent mutualiser différents moyens, et qu'elles soient ainsi en mesure de mettre en commun des personnels administratifs, mais aussi du matériel de recherche ou des centres de documentation. Il devrait ainsi être possible de simplifier davantage les rapports entre les différentes composantes de la recherche et de l'enseignement supérieur en leur conférant une plus grande cohérence.
Les articles 2 bis A et 4 concernent quant à eux les fondations.
Les fondations partenariales ont été créées par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, sur le modèle des fondations d'entreprise, afin de permettre aux universités de développer une véritable coopération de moyen terme avec des entreprises. Je précise qu'au sein de ces fondations, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel fondateur dispose de la majorité des sièges au conseil d'administration.
L'article 2 bis A, introduit en séance publique par un amendement du rapporteur du Sénat, vise à permettre à ces fondations de se consacrer à des projets transversaux et de décliner ses projets sur une thématique précise à travers des « fondations abritées », sans personnalité morale, comme il en existe au sein des fondations d'utilité publique.
La fondation de coopération scientifique, dont le statut a été défini par la loi de programme sur la recherche en 2006, est une association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui prend la forme d'une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique. La dotation minimale de ces fondations s'élève à d'un million d'euros.
J'en viens à un point qui peut poser problème. La proposition de loi initiale comportait un article 3 qui modifiait le code de la santé publique pour permettre aux « personnels enseignants et hospitaliers titulaires des CHU, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, d'exercer la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d'un exercice limité à leur spécialité et, le cas échéant, la fonction de biologiste responsable ».
Le Sénat a supprimé l'article 3. Outre des arguments de fond, les sénateurs se sont surtout émus que des dispositions relatives à la biologie médicale, laquelle a fait l'objet d'une réforme par ordonnance en janvier dernier, soient introduites dans une proposition de loi relative à l'immobilier universitaire. Ils ont ainsi regretté que la commission des affaires sociales n'ait pu examiner cet article.
Lors de l'examen de ce texte en commission, nous avons décidé de maintenir la suppression de cet article 3, et de donner un avis défavorable à l'amendement de rétablissement de cet article. D'une part, un vote conforme à celui du Sénat permet de débloquer immédiatement des opérations de réhabilitation immobilière du plan Campus, dont on nous a suffisamment rappelé, à juste titre, l'urgence. D'autre part, et surtout, le rétablissement de l'article 3 a paru d'autant moins justifié à de nombreux députés lors de son passage en commission des affaires culturelles qu'il vise à modifier le code de la santé publique et à revenir sur une ordonnance de réforme de la biologie médicale prise sur le fondement de la loi « Hôpital, patients, santé et territoire ». Certains ont fait valoir que si cet article avait été l'article unique d'une proposition de loi, elle aurait été renvoyée à la commission des affaires sociales.
Nous pensons que les dispositions en cause trouveraient plus naturellement leur place au sein de véhicules législatifs plus adaptés permettant aux commissions des affaires sociales du Sénat et de l'Assemblée nationale de se prononcer.
En conclusion, je vous demanderai donc, chers collègues, au nom de la commission des affaires culturelles, d'adopter la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour discuter d'un texte qui devrait tous nous rassembler tant 1'université française mérite d'être soutenue.
La proposition de loi que nous examinons fait suite à un rapport de deux sénateurs qui ont souhaité analyser les modalités et les conditions de la mise en place du second volet de l'autonomie des universités prévue par la loi de 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Nous sommes saisis de ce texte dans une certaine urgence. Il était devenu une priorité politique, depuis l'annonce faite par le Président de la République, en 2007, de financer une opération immobilière d'envergure : l'opération Campus.
En effet, sur un total de 18,7 millions de mètres carrés d'immobilier universitaire, 15, 3 millions sont la propriété de l'État. De plus, 33 % de ce patrimoine immobilier est en mauvais état, voire dégradé, et ce en dépit des importants moyens que l'État lui consacre. Comment ne pas s'indigner devant les conditions de travail et d'accueil que nous réservons à notre communauté universitaire ? Comment ne pas être gêné par rapport aux étudiants étrangers qui découvrent les locaux et les laboratoires où ils devront travailler ?
Pour mémoire, la loi LRU que vous avez portée, madame la ministre, avec beaucoup d'énergie et de passion autorise l'État à transférer aux établissements qui en font la demande la pleine propriété de leurs bâtiments. L'État transfère ainsi gratuitement aux universités volontaires la propriété des biens immobiliers qui leur sont affectés. Elles pourront ensuite louer ces biens à un tiers, avec l'accord de l'autorité administrative compétente, sous réserve que soit respectée la continuité du service public. Il fallait rendre l'espoir à l'université.
Grâce à l'article 1er de la proposition de loi, les universités auront la possibilité d'établir des partenariats public-public avec la Caisse des dépôts – son président, M. Michel Bouvard, incite fortement à mettre en place ce dispositif – ou des partenariats public-privé dans le cadre des opérations Campus, sans que le partenaire privé soit propriétaire des locaux.
Dans ce contexte, le passage d'un « État propriétaire » à des « universités propriétaires » constitue à la fois une nécessité et une opportunité à saisir pour conforter l'autonomie des établissements dans un domaine stratégique pour la bonne conduite de leurs projets.
Il était donc nécessaire et indispensable d'établir des engagements réciproques et clarifiés entre État et universités, et de renforcer la confiance mutuelle afin que de nombreuses universités puissent se développer grâce à cette proposition de loi. Car, en définitive, l'objectif est bien de mettre l'immobilier au service de la vraie richesse des universités, à savoir leur capital humain.
J'aurais tant souhaité que l'université de Franche-Comté ait demandé la dévolution de son patrimoine immobilier, processus qui reste facultatif. Elle aurait ainsi permis de maîtriser une vision stratégique des établissements bisontins. Mais les vieux démons résistent. Le contact que j'ai pu avoir avec le président de cette université est néanmoins intéressant. Je cite ses propos : « Nous avons tout intérêt à gérer notre patrimoine et mon plan de rénovation est prêt. » Mais, alors, pourquoi ne pas agir ?
En revanche, l'université de Bourgogne voisine s'offre la possibilité par un partenariat public-privé de construire une résidence d'accueil de chercheurs étrangers. C'est bien là qu'est l'enjeu de la dévolution de l'immobilier aux universités. Elle doit permettre à chacune d'entre elles de construire une réelle stratégie immobilière. Il serait regrettable que certaines universités n'accédant pas rapidement à la possibilité d'une dévolution de leur patrimoine voient leurs projets devenir caducs. Je ne reviens pas sur les montages juridiques et financiers que les universités pourront utiliser pour réaliser leurs projets.
L'article 2 a trait aux compétences des pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Créés en 2006, ces derniers ont permis d'assurer une gestion satisfaisante de l'opération Campus. La formule a fait ses preuves et séduit les établissements, puisqu'à ce jour, 19 PRES ont été créés. Sans être coulés dans un moule unique, ils éclairent notre paysage universitaire, trop souvent éparpillé. C'est un grand pas en avant.
Certaines universités ont choisi la fusion, d'autres la création d'un grand établissement ou d'une université fédérale. Ce texte doit permettre aux PRES de délivrer des diplômes nationaux, notamment des doctorats, mais aussi des diplômes plus professionnels. Le cadre juridique, qui suscite l'inquiétude de nos collègues socialistes, est sécurisé, puisqu'il est précisé que les PRES seront autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans le cadre de la contractualisation de l'établissement avec l'État et dans les conditions d'habilitation applicables à tous les établissements d'enseignement supérieur. On peut néanmoins s'interroger sur une future configuration des PRES, avec de véritables lieux de débat démocratique.
Cette mesure traduit la réussite exemplaire d'une politique ambitieuse, qui a pour objectif de faire travailler ensemble universités et écoles sur des projets structurants pour notre territoire. Nous sommes ainsi parvenus à susciter la collaboration de membres de la communauté universitaire et scientifique, parfois bien éloignés les uns des autres. Les fondations abritées sont gérées dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages que les fondations affectataires. Cette possibilité permettra aux fondations partenariales d'offrir à ceux qui le souhaitent – entreprises, particuliers ou anciens élèves de l'établissement fondateur – la possibilité de concrétiser un projet d'intérêt général.
L'article 3, qui concernait le recrutement des responsables de biologie dans les centres hospitalo-universitaires, a été supprimé par le Sénat. Il permettait pourtant de placer le bon professionnel à la bonne place. Madame la ministre, au-delà des assurances que vous nous avez apportées sur le fait que cet article n'offrait aucune équivalence au DES de biologie médicale – ce qui suscitait l'inquiétude légitime des pharmaciens et des médecins qui exercent au sein de laboratoires privés –, il nous a semblé préférable de voter conforme le texte du Sénat, car il est urgent que nos universités puissent engager rapidement les travaux qui leur semblent nécessaires, après la dévolution tant attendue de leur patrimoine immobilier, prévue par la LRU.

Le cas de Strasbourg sera évoqué par mon collègue Reiss. Quoi qu'il en soit, il nous faudra réfléchir au problème des PUPH.
Enfin, pour conclure, l'ensemble de ces mesures contribueront à renforcer l'attractivité de l'université française. Madame la ministre, vous avez indiqué que 13 % d'élèves de terminale formulent désormais comme premier choix une pré-inscription à l'université. Nous voulons redonner à l'université française ses lettres de noblesse et prouver sa fonction sociale déterminante de réussite pour tous les étudiants. Refuser la modernisation de l'université française, à laquelle cette proposition de loi participe pleinement, serait un acte de démission. Parce que ce texte permet d'apporter des réponses pragmatiques aux problèmes que j'ai évoqués, je vous incite tous à l'adopter. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, dans la continuité de la loi LRU et du rapport d'information des sénateurs Adnot et Dupont, nous examinons ce soir, en urgence – c'est, du reste, toujours le cas des textes relatifs à l'université – et dans une certaine indifférence, un texte dont la portée est pourtant loin d'être négligeable. Texte fourre-tout,…
Non, puisque c'est l'objet du texte !

…puisqu'il traite à la fois de l'immobilier des universités, de la délivrance des diplômes et du recrutement des responsables de biologie dans les centres hospitalo-universitaires.
Texte d'opportunité également, car il est examiné à un moment où le Gouvernement s'est engagé sur la voie d'une restructuration profonde du service public d'enseignement supérieur et de la recherche. L'objectif officiel est d'assouplir le cadre juridique qui régit le patrimoine immobilier universitaire, dans le but d'en faciliter la réhabilitation et de réaliser des constructions nouvelles. Mais, en renforçant les attributions des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, le texte marque en réalité un profond changement de cap de la stratégie universitaire, sans que ce changement ait été précédé d'un bilan d'étape des PRES.
Votre volonté, madame la ministre, est bien de faire le tri entre les différents établissements afin de concentrer l'essentiel des moyens et de rassembler les meilleures formations dans un nombre très réduit de pôles d'excellence. Certes, il est important pour notre pays de se doter de campus d'excellence, et pas seulement au regard d'un classement modèle. Mais nous militons pour une réforme universitaire qui se fasse dans le respect des spécificités de l'université française.
Aussi considérons-nous que votre méthode n'est pas la bonne. Ce transfert accéléré ne peut pas se faire au détriment des universités, dont beaucoup n'auront pas de moyens suffisants pour gérer leur patrimoine. Il ne peut pas non plus consacrer de fait un système déjà très inégalitaire entre les établissements. Réformer l'université pour lutter contre l'échec à l'université, d'accord, mais remédions en priorité à son sous-encadrement et à son sous-financement : là sont les premières urgences.
Le texte aura pour conséquence de contraindre une grande majorité d'établissements de second rang à se contenter de financements en baisse et à limiter leur activité aux formations de niveau licence, donc, à terme, à abandonner la recherche.
Les deux premiers articles de la proposition de loi, qui confortent les PRES, porteurs de la plupart des projets du plan Campus, dans leur rôle d'opérateurs privilégiés de la recomposition du paysage universitaire, suscitent des interrogations.
Ces interrogations portent tout d'abord sur les activités immobilières, visées à l'article 1er, et sur l'accélération du processus de transfert de propriété pour les établissements qui en feraient la demande. Peu nombreux sont ceux qui en ont exprimé le souhait, mais l'accélération de la possibilité donnée aux universités de confier à des tiers des droits réels sur le patrimoine immobilier des établissements d'enseignement supérieur est un signe supplémentaire du désengagement de l'État du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il est bien précisé que la dévolution immobilière n'est que facultative, mais permettre aux PRES de disposer du patrimoine immobilier des universités avant même que celles-ci aient pu en demander la dévolution, n'est-ce pas leur permettre d'exercer des pressions sur les universités ? À court terme, leur patrimoine échappera à leur contrôle, puisqu'il sera confié aux PRES, qui auront eux-mêmes conféré les droits réels, c'est-à-dire l'exploitation, à un prestataire privé.
À notre sens, la mise en oeuvre d'un tel dispositif n'est pas urgente. Une remise à niveau préalable du patrimoine universitaire par l'État, donc un effort financier de celui-ci, nous paraît à tout le moins nécessaire. Assurer la sécurité est, du reste, une obligation qui s'impose à l'État, et nous connaissons – hélas, assez mal – l'état de besoin du patrimoine universitaire. Ce n'est pas la voie qui a été choisie, puisque les crédits consacrés à la sécurité et à la maintenance des bâtiments sont en baisse dans le PLF pour 2011. Le texte risque, en outre, de renforcer l'inégalité entre les territoires. La question des financements revêt une importance majeure. Dans quelle mesure les collectivités territoriales seront-elles concernées par ce transfert ?
Par ailleurs, présenter la dévolution des droits réels à des tiers comme indispensable à la mise en oeuvre des PPP n'est guère crédible, si l'on considère que des opérations de ce type ont pu être conduites sans transfert de droit. Je vous pose donc la question, madame la ministre : peut-on, oui ou non, conduire, sous le régime actuel de la propriété immobilière des établissements d'enseignement supérieur, des opérations de construction et de réhabilitation en partenariat public-public ou public-privé ? Si tel est le cas, on peut se demander si cette incitation au transfert et cette promotion des PPP nouvelle formule, dits intelligents, ne poursuivent pas un autre objectif. Souhaite-t-on offrir ainsi davantage à des partenaires privés qui espèrent un retour sur investissement important et dont l'appétit de rentabilité n'est pas forcément compatible avec l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur ? Notre intention est, non pas, bien entendu, de stigmatiser la coopération public-privé, qui peut avoir des aspects positifs, mais de souligner les facteurs de risque, à l'instar de la Cour des Comptes, qui a émis des réserves sur ces partenariats.
Nous nous posons un certain nombre de questions. Tout comme nos collègues sénateurs, nous aurions préféré que, deux ans et demi après le vote de la loi LRU, un bilan soit établi. Nous partageons également les inquiétudes de nos collègues quant au risque supplémentaire, même si ce n'est pas l'objet du texte, que la concentration fait courir aux petites universités et aux antennes universitaires, qui participent pourtant à l'aménagement du territoire.
Ce risque est, me semble-t-il, renforcé par le deuxième article de la proposition de loi, qui donne aux PRES la possibilité de délivrer directement des diplômes nationaux lorsqu'ils sont constitués en établissements publics de coopération scientifique. Aux PRES, la délivrance de diplômes nationaux et aux petites universités la délivrance de diplômes dont la valeur nationale sera douteuse : oui, le risque de fracture dans l'université est bien réel. Si nous sommes bien entendu favorables à la coopération universitaire, il nous semble que le monopole de délivrance des diplômes nationaux par les universités publiques est un gage d'égalité républicaine.
Avec l'article 2, nombre d'établissements privés pourront, dès lors qu'ils seront rattachés à un PRES, délivrer des diplômes nationaux au même titre que les établissements publics, sans être soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Vous instaurez ainsi une concurrence déloyale entre ces établissements, puisqu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Je ne m'attarderai pas sur les déséquilibres territoriaux qu'engendrera immanquablement la proposition de loi, puisque les pôles d'excellence seront forcément plus attractifs que les petits établissements implantés dans les territoires. L'université à deux vitesses est déjà en marche, et nous accentuons cette évolution.
L'article 3 de la proposition de loi a été supprimé par les sénateurs le 17 novembre dernier, et il n'y a aucune raison qu'il soit réintroduit dans le texte ce soir,…

…sinon pour satisfaire la conférence des doyens des universités de médecine – même si notre collègue Jardé avancera une autre justification. À l'évidence, cet article tendait à permettre à des personnes non qualifiées en biologie médicale d'en pratiquer l'exercice en CHU.

Or, cette disposition, si elle était adoptée – ce que je ne peux pas croire – serait en totale contradiction avec la réforme de la biologie médicale voulue par le Gouvernement dans le cadre de la loi HPST.
Depuis cette réforme, en effet, les actes de biologie médicale sont reconnus comme de véritables actes médicaux, avec les prérogatives et les responsabilités qui incombent à leurs auteurs. L'ordonnance du 13 janvier 2010 a ainsi acté le fait que le biologiste médical doit avoir bénéficié de la formation nécessaire, quel que soit son lieu d'exercice, y compris des hôpitaux universitaires.

Par manque de temps, je n'évoquerai donc pas les problèmes que l'article 3 poserait du point de vue de la sécurité sanitaire et de la santé publique.
En conclusion, parce que nous ne souhaitons pas, d'une part, valider la désaffection de l'État à l'égard de ses obligations de propriétaire et, d'autre part, faire des PRES l'acteur central de l'enseignement supérieur en lieu et place des universités, le groupe SRC votera contre cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi, qui vise à approfondir la libéralisation du système français d'enseignement supérieur, s'inscrit dans le droit fil de la loi LRU. Elle en prolonge les principes et, comme elle, trouve son origine dans le cadre idéologique du néolibéralisme le plus pur.
Le plan Campus entend allouer des millions d'euros à des universités-vitrines déjà situées en haut de la hiérarchie, aux dépens des universités plus modestes. Il s'agit donc de bâtir un système d'enseignement supérieur à deux vitesses, où quelques grandes universités ultra-subventionnées regroupent les meilleures infrastructures, et où toutes les autres sont laissées dans l'indigence. Il s'agit d'un programme férocement inégalitaire.
Ici comme ailleurs, vous adoptez la logique des pôles de compétitivité. Ainsi, vous donnez plus de capitaux aux pôles déjà développés et vous négligez les structures reléguées ou moins favorisées. C'est le système du shérif de Nottingham : vous prenez aux pauvres pour donner aux riches ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Cette proposition de loi prolonge la LRU alors qu'aucune évaluation de celle-ci n'a été faite. D'ailleurs, aucune étude d'impact n'a été produite à l'appui de l'examen du présent texte, dont la recevabilité financière est pourtant douteuse. Il est proposé de permettre aux universités de conclure des contrats conférant des droits réels à un tiers sur l'utilisation de leurs locaux appartenant à l'État. L'objectif du Gouvernement est d'augmenter encore le recours aux contrats de partenariat public-privé, les fameux PPP.
Ces partenariats sont d'ailleurs rendus obligatoires dans le cadre du plan Campus, puisque l'octroi des fonds est, en réalité, conditionné à la réalisation de partenariats public-privé et à la labellisation en initiatives d'excellence. Or, c'est une politique dont la Cour des comptes a déploré l'absence d'efficacité et de cohérence.
L'année dernière, sur les 420 millions d'euros prévus pour les campus, seuls 70 millions semblent avoir été dépensés. Le Gouvernement persiste pourtant dans sa volonté de faire passer entièrement le code des marchés publics à la moulinette du néolibéralisme. L'article premier du présent texte a pour objectif de permettre la multiplication des PPP. Partout où c'est possible, la droite favorise ce type de démarche pour dépecer l'État et confier le maximum de nouveaux marchés au secteur privé et aux grandes entreprises. Pourtant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2008-567 DC, avait indiqué que « la généralisation de telles dérogations » – les PPP – à la commande publique serait susceptible de nuire « à l'égalité devant la commande publique » et rappelé que ce critère devait être limité par l'exigence du « bon usage des deniers publics », qui a « valeur constitutionnelle ».
Pourtant, la rapporteure a vanté l'utilisation de ce système importé des États-Unis et du Canada. Ce sont ces partenariats qui permettront aux universités, a-t-elle dit, de construire notamment des résidences pour les étudiants. Ainsi, c'est une entreprise privée qui sera bailleur des logements dont l'État est propriétaire ! Autrement dit, les espaces publics seront gérés par une entité privée, ce qui est une aberration totale. En effet, les bailleurs privés auront tout loisir de fixer les loyers et de sélectionner précautionneusement les locataires. Ils reverseront un loyer modique à l'université concernée en échange de travaux de réhabilitation des espaces vétustes. Les étudiants seront sans doute heureux d'apprendre que le Gouvernement entend transférer les résidences étudiantes à des sociétés de gérance privées ! Aujourd'hui, pourtant, seules les structures publiques permettent à des dizaines de milliers d'étudiants d'avoir un toit, ce qui serait impossible dans le parc privé au vu des exigences qui y ont cours.
Les chantiers d'ores et déjà ouverts dans le cadre des partenariats public-privé montrent la faiblesse du dispositif. Ainsi, en ce qui concerne la rénovation de l'université Paris VII, plusieurs associations s'occupant de la sécurité incendie, de l'accessibilité pour les personnes handicapées ou encore du respect de l'environnement ont déposé une requête au tribunal administratif, demandant l'annulation des permis de construire délivrés par le préfet au groupe Vinci, en raison des manquements constatés dans tous ces domaines. Mme Pécresse, au sujet de ce chantier, avait reconnu que le PPP ne coûterait pas moins cher qu'un contrat classique de construction. Un nombre considérable d'irrégularités a été constaté. Souhaitez-vous voir la gabegie de Paris VII, qui fait les choux gras de la presse, s'étendre à toutes les universités françaises ? C'est clairement la direction que propose cette proposition de loi.
Les universités, dont les marges de manoeuvre financières sont fortement contraintes du fait des PLF successifs, risquent de devoir céder progressivement leurs murs au secteur privé, quitte à sacrifier l'intérêt des étudiants et la qualité de leurs formations. Cela revient à demander aux universités de se financer par un développement sur leurs fonds propres, ce que la plupart ne seront pas en mesure de faire. Cette logique de financement est d'ailleurs celle que la plupart des opérateurs de l'État sont contraints de choisir face à la RGPP et aux audits-flashs de Bercy. Ainsi les universités devront-elles faire du cost-killing et rechercher toutes les possibilités de rentabilisation à travers le panel classique des outils du libéralisme marchand : commercialisations, filialisations, financiarisation, marketing et même produits dérivés.
Cette dérive figure noir sur blanc dans le texte que nous examinons, à l'article 2 bis A, puisque celui-ci élargit la possibilité, pour les entreprises, de recevoir tout ou partie du patrimoine immobilier de l'université via les fondations. Ainsi, comme aux États-Unis, les multinationales pourront payer la rénovation des locaux vétustes ou subventionner un cours, une chaire, des associations universitaires, des laboratoires de recherche. C'est la porte ouverte à la privatisation pure et simple de l'enseignement supérieur, et à une restriction évidente de la liberté d'enseigner et de l'universalité des savoirs dispensés.
Les députés communistes, républicains, citoyens et du parti de gauche considèrent qu'avant d'introduire des portages financiers complexes permettant au privé de récupérer les marchés publics, la première des priorités est de donner au service public les moyens budgétaires de son efficacité. Depuis trop longtemps, les gouvernements réduisent les budgets des établissements publics, maintiennent l'enseignement supérieur en sous-financement, et déplorent ensuite que le service public ne soit plus à la hauteur et que ses défaillances doivent être palliées par le privé. Je souligne que c'est la droite qui a organisé les déficiences du public pour légitimer les PPP et la montée en puissance du secteur privé – dans le domaine de l'enseignement supérieur comme dans tous les autres services publics ! (Exclamations sur les bancs des groupes NC et UMP.)
Tout se passe comme si ce Gouvernement n'avait tenu aucun compte de la crise mondiale. Car ce sont bien les recettes que vous appliquez aujourd'hui à nos universités qui ont conduit à la déchéance du système bancaire international, aux plans de sauvetage ruineux et à une vague massive de chômage et de paupérisation. Ces mêmes recettes néolibérales, qui ont fait la démonstration définitive de leur nocivité, vous continuez sans relâche à les administrer au secteur public et à l'État ! C'est inadmissible !
En réalité, cette proposition de loi entérine un nouveau désengagement massif, puisque l'État se débarrasse du patrimoine immobilier vétuste et confie à des tiers le soin de le rénover, de l'entretenir et de le faire fructifier. Certes, la loi LRU prévoit qu'une contribution annuelle du ministère viendra compenser la dévolution du patrimoine, mais rien ne garantit que son montant sera suffisant. Je rappelle en effet que les besoins sont évalués à 125 millions d'euros par an. Manquant de moyens pour entretenir un patrimoine dégradé, les universités ne risquent-elles pas d'être amenées, à très court terme, à devoir vendre purement et simplement une partie de leurs bâtiments ? C'est, en tout cas, ce qu'a affirmé l'ancien ministre et député Éric Woerth la semaine dernière. Selon lui, l'État doit de toute urgence se débarrasser de son patrimoine immobilier pour faire face à la dette et aux déficits. S'il a vendu l'hippodrome de Compiègne pour un prix si modique à ses amis, c'est donc par pur altruisme vis-à-vis des générations futures !
Enfin, cette proposition de loi octroie aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur – les PRES – la capacité de mettre les bâtiments universitaires à la disposition de tiers. Ils pourront également délivrer des diplômes lorsqu'ils seront constitués en établissements publics de coopération scientifique. Cela revient à permettre à des établissements privés, au sein des PRES, de délivrer des diplômes nationaux, alors qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes exigences et aux mêmes devoirs. Contrairement à nos établissements publics, ceux-ci fixent librement les frais d'inscription et peuvent sélectionner à loisir leurs étudiants. Cette disposition renforcera donc encore le privé dans la concurrence qu'il fait à l'enseignement supérieur public. Les députés communistes et du parti de gauche entendent protester contre ce nouveau dispositif inégalitaire.
Vous l'avez compris, les députés communistes, républicains, citoyens et du parti de gauche voteront contre ce texte porteur de graves dérives.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un texte important, car la loi LRU constitue une réelle avancée. L'autonomie des universités, que j'appelais de mes voeux depuis vingt ans, est enfin arrivée. Néanmoins, il reste des adaptations à faire, notamment dans notre patrimoine immobilier, puisque 35 % de nos universités sont vétustes, voire inadaptées.
Des fusions sont en cours de réalisation, notamment à Strasbourg, qui nécessitent de nouveaux locaux. La construction et l'amélioration de ces locaux au moyen de partenariats public-privé ou public-public, voire de partenariats « aller-retour » susceptibles de changer de nature à certains moments, est une bonne chose, mais nécessite une souplesse supplémentaire.
Les PRES, créés en 2006, ont constitué un noyau dur de la loi LRU de 2007. Pour les petites universités, ils sont très positifs : la complémentarité entre deux universités de petite taille, comme l'université d'Amiens, permet d'augmenter l'efficience dans toutes les matières. Autre aspect positif, les PRES permettent l'incorporation de nos grandes écoles. Ayant travaillé sur la question des grandes écoles, je dirai que cette spécificité française peut être un frein au développement des universités, car si ce sont d'excellentes écoles professionnelles, ce ne sont pas des écoles de recherche. Or, la recherche est un moteur important de notre développement, qui permet une valorisation continue, même durant les périodes de crise. Le PRES offre l'avantage de permettre d'incorporer les grandes écoles sans en diminuer la valeur.
Le fait que les PRES puissent délivrer des diplômes nationaux me paraît nécessaire. Pour ma part, j'irais même plus loin, madame la ministre : je suis favorable à ce que l'on supprime les distinctions entre membres titulaires et membres associés pour ne conserver qu'un seul type de membres. Je pense que vous le ferez un jour, peut-être dans une autre phase de réforme.
Pour ce qui est des conseils d'administration des universités, les personnes qualifiées qui y siègent actuellement permettent d'avoir un lien avec le monde économique local, avec le territoire, ce qui est une bonne chose. Mais alors il est paradoxal que ces personnalités extérieures ne puissent pas participer au moment clé de la vie de l'établissement qu'est l'élection du président de l'université. Il est légitime qu'elles puissent désormais être parties prenantes et contribuer directement à la définition du projet pédagogique de leur établissement. J'ai déposé un amendement en ce sens, afin de rétablir un lien entre les universités françaises et l'économie. Nous ne sommes plus à l'époque de Robert de Sorbon, où la seule préoccupation était d'apporter la culture aux étudiants !
Puisque les fondations scientifiques fonctionnent très bien dans les grandes écoles, pourquoi les universités ne pourraient-elles bénéficier également de ce système ? De même, pourquoi n'existerait-il pas des associations d'anciens élèves des universités, à l'image de celles des grandes écoles ?
J'en viens à l'article 3 de la proposition de loi. (« Ah ! » sur les bancs des groupes NC et UMP.) Une ordonnance de janvier 2010 permet à de grands groupes de faire de la biologie en France…

…en supprimant le maillage territorial de nos unités, c'est-à-dire en transformant les petits sites en laboratoires multisites.

Actuellement, nos biologistes sont destinés à devenir salariés des quatre ou cinq grands groupes qui feront de la biologie en France.
Par ailleurs, les professeurs d'université, qui ont une triple mission – l'enseignement, la recherche et l'activité clinique – sont nommés par le conseil national des universités, qui comporte treize sections et cinquante et une sous-sections, mais pas une seule sous-section de biologie ! Faut-il en créer une ? Je ne le pense pas : à mon avis, il faut plutôt réduire le nombre de sections.
En revanche, il y a de plus en plus d'intersections. Ainsi, en addictologie – le professeur Fagniez le sait –, on fait de la psychiatrie, de la gastro-entérologie et de la médecine légale. Faisant du droit de la santé, je suis moi-même issu d'une intersection. En anatomie, on trouve des chirurgiens, des médecins rééducateurs, des anatomistes. Bref, on crée des intersections pour nommer des agrégés un peu partout.
Au nom de quoi les biologistes ne pourraient-ils pas bénéficier de cette possibilité d'intersection ? Des généticiens, des hématologistes ne peuvent-ils donc pas être nommés en biologie ? Si vous répondez non, vous mettez à la trappe Jean Dausset, Luc Montagnier et vous supprimez la moitié des prix Nobel !

Moi, je suis favorable à une université efficiente, dynamique et qui progresse. Je suis donc pour ces intersections, y compris en biologie. Je vous accorde néanmoins que cela doit être à titre dérogatoire et tout à fait exceptionnel. Mais pourquoi, alors qu'on fait des lois autorisant une certaine souplesse, verrouille-t-on tout pour la biologie ?
Je suis contre l'ordonnance de janvier 2010 pour la biologie, qui n'a d'ailleurs toujours pas été promulguée. Je suis contre les grands groupes de biologie qui se partagent la France à quatre ou cinq. Si vous souhaitez comme moi que cette ordonnance ne sorte jamais, votez le rétablissement de l'article 3 ! J'ai confiance dans votre bon choix, mes chers collègues. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis de l'arrivée de ce texte en discussion. Je tiens à saluer l'initiative prise par nos collègues Philippe Adnot et Jean-Léonce Dupont au Sénat. Avec Arlette Grosskost, nous avions déposé une proposition de loi similaire à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est vrai, madame la ministre, au-delà de la loi LRU, que vous avez eu le mérite de porter et qui a redynamisé l'université française, il fallait que nous allions jusqu'au bout de la logique en permettant la modernisation de cette université. Il importait donc de donner aux communautés universitaires de chercheurs et d'étudiants les pleins moyens de travailler dans les meilleures conditions grâce à des programmes immobiliers qui faisaient jusqu'à présent défaut.
Dès le début de cette législature, la Caisse des dépôts a approuvé un plan stratégique, Élan 2020, que nous avons porté avec le directeur général, Augustin de Romanet, plan dans lequel l'économie de l'intelligence a trouvé toute sa place. C'est à ce titre que la Caisse a accompagné à ce jour 132 établissements universitaires et d'enseignement supérieur sur 245 dans le cadre de conventions de partenariat, et qu'elle a participé à la réalisation de 41 schémas directeurs immobiliers et d'aménagement et de 38 autres études spécifiques qui en découlent et qui concernent aujourd'hui 1,2 million d'étudiants.
Madame la ministre, je veux saluer la qualité du partenariat avec votre ministère et le soutien constant dont nous avons bénéficié de la part du Premier ministre François Fillon. Ayant, en son temps, occupé les mêmes fonctions que vous, il avait le souvenir de réformes qui n'avaient pu, alors, aller jusqu'à leur terme.
C'est peut-être pour ces raisons que nous avons pu mobiliser, au-delà de l'ingénierie de la Caisse des dépôts, de moyens supplémentaires au travers des fonds d'épargne. Nous aurons l'occasion de reparler de l'importance de la centralisation de l'épargne réglementée dans le cadre d'autres débats. Mais j'insiste sur le fait qu'un milliard d'euros sur l'épargne réglementée est mobilisé en faveur de l'investissement dans les universités.
Or nous butions depuis plusieurs années sur le code de l'éducation, et notamment sur l'article 762-2 qui ne permet pas aux universités d'avoir un cadre plus large de compétences au niveau de leurs responsabilités. Les universités n'étaient donc pas en mesure d'assurer elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage de leurs opérations en PPP, traditionnels ou innovants. Je sais que les PPP traditionnels n'ont pas la préférence d'un certain nombre de nos collègues. Et ce point de vue, comme tous les autres, est respectable.
Voilà pourquoi, et afin de pouvoir promouvoir d'autres solutions à destination des communautés universitaires, la Caisse des dépôts a été amenée à imaginer ce qu'on peut appeler des partenariats public-public, consistant à mettre en place un co-investissement entre une université, la Caisse et la région pour porter ces projets de développement.
Force est de constater que, sur l'enveloppe d'un milliard qui était dédiée au niveau des fonds d'épargne à ces travaux, et depuis le plan de relance de l'économie, qui avait créé l'enveloppe en 2008, seuls cinq prêts pour un montant de 122,4 millions ont été mis en place depuis janvier 2009. Un certain nombre de projets était en effet bloqué, dans l'attente d'une évolution législative. Je pense aux projets montés avec les universités de Bordeaux, l'université de Strasbourg, et les universités lyonnaises. Je pourrais évoquer encore le projet de l'École vétérinaire à Maisons-Alfort, mais celui-ci semble connaître aujourd'hui quelques difficultés d'un ordre différent. Je sais, madame la ministre, que vous n'êtes pas à l'origine du problème.
Je salue encore une fois l'avancée incontestable que constitue ce texte, qui va débloquer les problèmes immobiliers. Il permettra aussi à la Caisse des dépôts, en liaison avec le ministère et la conférence des présidents d'université, avec laquelle nous venons de renouveler la convention de partenariat passée en 2008, d'intégrer le volet numérique dans ces projets, à travers un guide méthodologique et des outils d'analyse en cours d'élaboration. Aujourd'hui, avec dix études de schémas directeurs numériques, 42 établissements se sont engagés dans une réflexion sur leur schéma numérique.
Mes chers collègues, ce texte est très opportun et il est urgent de l'approuver, à l'unanimité si possible, car il y va de l'excellence de la recherche française dont nous avons tous besoin pour faire face à la mondialisation. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Avec cette proposition de loi relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, nous avons le sentiment que la majorité confond une nouvelle fois vitesse et précipitation. Pourquoi une telle précipitation en effet alors que nous ne disposons toujours pas d'une évaluation précise de la loi Liberté et responsabilité des universités, votée il y a maintenant trois ans, et que la quasi-totalité des universités est désormais engagée dans ce processus d'autonomie ?
Les universités ont envie d'autonomie, nous a dit Mme la ministre dans son bref propos introductif. Oui, c'est vrai. Nous avons, nous aussi, interrogé les acteurs de la communauté universitaire sur le terrain : que pouvons-nous en déduire ? Si la loi LRU a incontestablement amélioré l'autonomie financière des universités, elle a également généré de la bureaucratie supplémentaire, favorisé une forme de recentralisation des relations entre les universités et le ministère et, parfois, restreint la liberté pédagogique des établissements. Elle a conduit aussi, nous disent nos interlocuteurs, à plus d'opacité dans l'allocation des moyens financiers avec l'augmentation significative de la part contractualisée.

Ce n'est pas exactement ce qui a été mis en place.
Dois-je aussi vous rappeler, madame la ministre, les critiques formulées en juin dernier par la Cour des comptes sur la politique de regroupement dans l'enseignement supérieur et notamment à l'encontre de l'opération Plan Campus, sa gouvernance et la complexité des montages financiers auxquels elle a donné lieu ? Quelles suites comptez-vous donner à ces observations ? Nous aurions souhaité pouvoir en discuter aussi ce soir à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi.
La dévolution aux universités de leur patrimoine immobilier, objectif central de l'article 1er du présent texte, peut se révéler un cadeau empoisonné, comme le montre le faible nombre d'universités – moins de dix aujourd'hui – qui ont fait la demande de cette compétence immobilière.
Alors que 35 % des biens immobiliers des universités sont considérés comme vétustes et que 31 % d'entre eux nécessitent de lourdes opérations de réhabilitation, les crédits destinés à la mise aux normes et à la maintenance des bâtiments sont en baisse dans le projet de loi de finances pour 2011 – Pascal Deguilhem l'a rappelé.
Dans de telles conditions, on peut se demander si les universités qui choisiront d'exercer cette compétence immobilière recevront en retour de l'État une dotation annuelle suffisante leur permettant d'entretenir et de renouveler le patrimoine transféré.
L'article 2 de la proposition de loi nous pose plus de problème. La possibilité d'habiliter les PRES à délivrer directement des diplômes nationaux en lieu et place des universités nous semble en effet dangereuse en ce qu'elle porte une atteinte grave au monopole de délivrance des diplômes par les universités publiques.
C'est un cadeau aux établissements privés, alors qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations de service public que les universités, qu'il s'agisse des contenus pédagogiques, de la neutralité des formations, des modalités d'examens, de l'absence de sélection des étudiants, ou de la réglementation des droits d'inscription. Une telle possibilité va encore exacerber la concurrence entre établissements publics et privés.
Si les PRES peuvent constituer une chance pour les universités, qu'en est-il pour celles qui n'en font pas partie ? Faut-il, prenant pour seule boussole le classement de Shanghai, pourtant très contesté et contestable, et au nom de la concurrence et de la compétitivité, accroître encore le fossé qui sépare les pôles d'excellence des pôles universitaires de proximité, notamment ceux qui ne font pas partie des PRES ? Il ne faudrait pas qu'ils soient cantonnés aux premiers cycles et soumis à la concurrence des PRES pour la délivrance des diplômes nationaux.
Ces établissements de proximité obtiennent pourtant d'excellents résultats en matière d'insertion professionnelle des étudiants de niveau master. Une récente enquête faisait apparaître des taux de réussite proches de ceux des grandes écoles : autour de 92 %.
Nous souhaitons donc, à l'occasion de l'examen de ce texte, vous poser à nouveau la question essentielle de la concentration des moyens financiers dans l'enseignement supérieur sur les pôles d'excellence. Cette première interrogation en suscite une seconde : quelles sont les possibilités de financement des autres projets immobiliers dans les établissements de taille moyenne ou plus modeste ? Je prends souvent l'exemple du projet de transfert à Saint-Étienne de la faculté des sciences de la Métare sur le site Manufacture Plaine Achille. Ce petit projet en termes de coût – quelques millions d'euros – est en effet extrêmement structurant pour un pôle universitaire comme celui de Saint-Étienne. Pourtant, il ne bénéficie pas, pour le moment en tout cas, d'un soutien financier de l'État.
Madame la ministre, toutes ces observations s'ajoutant à celles présentées par Pascal Deguilhem, nous ne pourrons voter cette proposition de loi sur les activités immobilières dans l'enseignement supérieur. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Chers collègues, je suis prête à siéger jusqu'à vingt heures trente pour vous éviter de revenir en séance de nuit pour terminer l'examen de ce texte. Mais chacun devra faire un effort pour que nous puissions y parvenir.
La parole est à M. Frédéric Reiss.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, « Activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, structures interuniversitaires de coopération, et conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire » : voilà un titre très long pour une proposition de loi initiale de trois articles présentée par les sénateurs Dupont et Adnot.
Si l'article 1er doit permettre aux universités de disposer dorénavant des bâtiments que l'État leur a affectés – j'y reviendrai –, l'opportunité a été saisie pour élargir les compétences des établissements publics de coopération scientifique, afin de leur permettre de délivrer des diplômes nationaux.
L'article 2 conforte ainsi les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES, créés en 2006.
La proposition de loi renforce aussi les fondations partenariales et les fondations de coopération scientifique, leur constitution étant possible grâce à l'article 4, introduit par le Gouvernement au Sénat, et auquel je souscris totalement.
Quant à l'article 3, il a été supprimé par le Sénat et cette suppression a été confirmée en commission par l'Assemblée nationale. À titre personnel, je pense, comme notre rapporteure, que la dérogation à l'ordonnance du 13 janvier 2010 pour les biologistes médicaux et leur recrutement au sein d'un CHU aurait mérité d'être examinée au sein de la commission des affaires sociales, compétente en la matière.
Je voudrais revenir sur l'exercice des droits réels par les universités sur le patrimoine immobilier qui leur est affecté ou qui est mis à leur disposition par l'État. Personne ne sous-estime l'importance du cadre de vie et des conditions de travail pour les étudiants et les chercheurs.
C'est pourquoi, madame la ministre, je voudrais vous rendre hommage pour l'opération Campus, que vous avez lancée en 2008 pour remédier à la vétusté de certains locaux universitaires. Ce n'est pas une fin en soi, bien au contraire : il s'agit de renforcer l'attractivité et le rayonnement de l'université française avec des investissements d'avenir, des initiatives d'excellence et des projets scientifiques et pédagogiques ambitieux.
Encore faut-il aller au bout de la logique, et c'est là toute la justification de l'article 1er de cette proposition de loi. Il est nécessaire de modifier l'article L. 762-2 du code de l'éducation pour permettre l'application du plan Campus. Si tel n'était pas le cas, les projets en cours, qui ont déjà été évoqués – Bordeaux, Lyon ou Strasbourg –, cofinancés par la Caisse des dépôts et consignations, resteraient bloqués.
L'université de Strasbourg, précisément, refondée en 2009, unique et pluridisciplinaire, occupe aujourd'hui une place de choix dans l'espace européen de la connaissance.

C'est un exemple pionnier et réussi de fusion d'universités, avec pour objectif de se lancer résolument dans la compétition internationale.
L'université de Strasbourg a un projet cohérent de développement qui promeut, dans un contexte transfrontalier, l'interdisciplinarité dans les formations, valorisant ainsi un réel potentiel scientifique, social et culturel pour 42 000 étudiants. C'est une université portée par toute la région Alsace, consciente de ses responsabilités vis-à-vis des politiques locales, nationales et européennes. Son président, Alain Beretz, m'a confirmé que, pour garder la main en matière de développement stratégique, il est indispensable de disposer du droit d'occupation des locaux.
Les universités, dans le cadre de partenariats public-privé ou de nombreux montages alternatifs comme celui proposé par la CDC, auront ainsi la possibilité et la capacité juridique de gérer l'occupation des bâtiments, rénovés ou neufs, qui sont mis à leur disposition.
Les universités pourront ainsi donner une bonne image et améliorer leur attractivité, notamment pour les étudiants et chercheurs étrangers.
Je suis très favorable à cette excellente proposition de loi, pour laquelle la procédure accélérée me semble totalement justifiée. Je pense même qu'un vote conforme au texte issu du Sénat serait souhaitable, tant l'attente sur le terrain est forte. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, la proposition dont nous discutons comporte quatre dispositions principales, comme on l'a rappelé plusieurs fois.
L'article 1er vise surtout à modifier la loi dite LRU et à donner aux universités la possibilité d'exercer des droits réels sur leur patrimoine, qu'il soit encore propriété de l'État ou non, et ce pour conclure des contrats en vue de le valoriser.
L'article 2 donne le droit aux établissements publics de coopération scientifiques et aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur – les fameux PRES, sur lesquels je reviendrai – de délivrer des diplômes nationaux en lieu et place des universités et établissements d'enseignement supérieur qui les composent.
Je ne reprendrai pas l'ensemble des dispositions. Celles-ci appellent une remarque préalable et trois observations.
Ma remarque préalable concerne le contexte dans lequel nous discutons cette proposition de loi. Dans le rapport de présentation, il est fait état du plan Campus et des douze projets qui vont devenir la vitrine de l'université française.
On parle – certes en évoquant les PRES – de la centaine d'universités et de grandes écoles. L'idée qui sous-tend la proposition de loi est d'accélérer le plan Campus et la concentration des universités en vue d'augmenter leur visibilité internationale et, de la sorte, leur reconnaissance. Pour ce faire, on leur permet de trouver à l'extérieur des financements que l'État ne peut réaliser, notamment en ce qui concerne la réhabilitation de leurs locaux, dont on a rappelé tout à l'heure l'état qui est aujourd'hui le leur.
Selon un discours assez convenu, la recherche en France serait trop dispersée ; les chercheurs n'en feraient pas assez ; nos publications et notre innovation ne seraient pas assez concurrentielles dans la compétition mondiale, et ce malgré – d'après notre Président de la République – un effort sans équivalent dans le temps et dans le monde.
Cette préoccupation arrive justement au moment où, du fait d'une certaine politique fiscale et sociale, l'encours de la dette de l'État va augmenter de 90 milliards d'euros entre la fin 2010 et 2011, et où 45 milliards d'euros vont servir à payer en 2010 la charge de la dette.
La mission « Enseignement supérieur et recherche » pour 2011 représente environ 25 milliards d'euros. Autrement dit, on va dépenser en 2011 près de deux fois plus pour payer les intérêts de la dette de l'État que pour investir dans l'avenir ! Je pense qu'il faut avoir cette situation à l'esprit quand on évoque ce nouveau dispositif.

Sur le fond, l'article 1er vise à donner aux universités la possibilité de créer des partenariats publics et privés pour rénover les patrimoines immobiliers qui leur ont été confiés.
On a vu que, dans bon nombre de situations, le patrimoine est ou serait en mauvais état. Néanmoins, aucune évaluation précise de ce patrimoine n'a été préalablement faite.

On ne sait pas qui a financé antérieurement. Ce peut être l'État, les collectivités territoriales ou – le plus souvent d'ailleurs – les deux. On ne sait tout bonnement pas ce qu'il en est avant de décider d'accélérer le mouvement.

On considère que le transfert de la propriété, qui viendra, doit être anticipé, soit pour que les nouveaux établissements en gestation aient des droits, soit pour que la délégation vers le privé puisse se faire.
Deux choses sont sûres : d'une part, les collectivités territoriales voient leur capacité de co-investissement réduite par la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe professionnelle ; d'autre part, les partenaires privés qui viendront auront à coeur de financer à la condition d'en tirer des bénéfices significatifs,…

…que les universités – aujourd'hui encore publiques –, l'État comme garant, ou peut-être demain les étudiants, devront in fine financer, comme on le voit de plus en plus en Angleterre où différents mouvements de contestation ont eu lieu. Certes, cela ira plus vite, mais le coût sera supérieur.
Je terminerai sur ce point en notant que, si l'on communique beaucoup sur cette formule d'avenir que seraient les PPP, aucune donnée chiffrée sur ceux déjà passés ou ceux à venir n'est ici donnée ou même avancée, ce que je regrette.
Sur l'article 2, un rapport officiel de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche pointe en mars 2010 le fait que les PRES se mobilisent peu pour les diplômes et que, lorsqu'ils le font, c'est un peu pour les masters et surtout pour les doctorats.
Ce même rapport note qu'ils ont une implication modeste en matière de recherche et que la qualité de PRES sert notamment à l'identification de leurs chercheurs dans les publications scientifiques. La moitié de ces PRES ne feraient pas de valorisation.
Néanmoins, au travers de cette disposition, de nombreux établissements privés d'enseignement supérieur – les écoles de commerces particulièrement, mais aussi les universités catholiques – pourront demain obtenir la reconnaissance de leur offre de formation par l'État et délivrer les mêmes diplômes nationaux que les universités à travers leur PRES de rattachement.
Ces établissements n'ont pourtant pas les mêmes obligations en matière d'égalité d'accès aux formations, que ce soit en termes de critères d'inscription, de droits à payer, de contenu pédagogique, de neutralité des formations ou encore de modalités d'examens.
De la sorte, avec cette disposition, est ouverte la possibilité de modifier un pan entier de la réglementation actuellement applicable aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche, sans que la représentation nationale, du fait de l'application de la procédure accélérée, ait son mot à dire. De plus, nous ne disposons pas du temps nécessaire pour en mesurer les enjeux et conséquences.
La troisième remarque porte sur ce que je nommerai une survalorisation des outils en l'absence d'un message clair en direction de toutes les universités.
On l'a dit, les PPP ne sont pas la panacée annoncée. On l'a vu, l'utilisation de l'outil qu'est le PRES est variable et reste limitée. Que doit-on inférer de ces constats ? Que les outils ne remplacent jamais la volonté et la stratégie. Or c'est là que le bât blesse : avant de modifier les outils, n'aurait-il pas mieux valu expliquer quelle était la stratégie de l'ensemble de l'université française et quels en étaient les moyens privilégiés ?
Le discours qui consiste, comme je l'ai rappelé, à ne parler que des sites d'excellence et de la compétition mondiale n'est pas mobilisateur pour tous ceux que les dispositifs eux-mêmes excluent d'emblée, quelle que soit leur valeur. Cette concentration des crédits sur quelques universités ne manque pas d'ailleurs de poser des questions.
Elle est de nature à fragiliser la vocation de recherche de plusieurs universités de taille petite et moyenne – comme l'a très bien rappelé tout à l'heure Pascal Deguilhem –, qui contribuent de façon significative au développement économique et social de leur territoire.
L'idée de concentrer sur quelques sites les crédits d'État ne prend pas en compte le dynamisme de la recherche de l'ensemble des universités pluridisciplinaires, qu'elles soient de taille petite ou moyenne. Pourtant, on le sait, l'excellence n'est pas seulement du côté des universités les plus nombreuses ou à forte concentration.
D'une part, ces universités pluridisciplinaires font une recherche de qualité pour laquelle elles ont des formations communes. Elles ont noué de nombreuses coopérations et partagent des unités de recherche, notamment avec le CNRS. Je le rappelle, celui-ci figure au premier rang mondial des institutions et organisations de recherche selon le classement 2009 établi par le SCImago Institutions Rankings World Report, le SIR.
D'autre part, elles ont initié des partenariats locaux, publics et privés, fondés sur des échanges de proximité, personnels et professionnels, à l'image de ce que l'État entend faire, mais dont la réussite n'est pas encore acquise.
Enfin, se profile le risque que les entreprises soient tentées de déplacer des emplois existants dans des secteurs de haute technologie depuis des villes universitaires moyennes vers de grands campus pour bénéficier des retombées d'un plan de plus grande ampleur.
Autrement dit, cette proposition anticipe une politique de moyens juridiques et financiers dont les effets ou l'importance financière ne sont pas ici objectivés. Elle modifie également, sans discussion d'ensemble, un pan de la réglementation universitaire. Or les effets n'en sont pas clairement exposés, y compris dans le rapport. Enfin, elle ne dit rien de la stratégie capable de mobiliser l'ensemble des universités et des enseignants-chercheurs qui en font la richesse.
Les députés socialistes ne peuvent que déplorer tous ces éléments et ils voteront contre cette proposition. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Arnaud Robinet. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui poursuit un objectif simple : répondre aux obstacles techniques que rencontrent les universités dans leurs projets de modernisation.
Ce texte va accompagner l'autonomie de nos universités en assouplissant un certain nombre de règles aujourd'hui archaïques. C'est tout l'engagement du Parlement, qui s'associe à la détermination de la ministre de l'enseignement supérieur, que je tiens ici à saluer.
Je souhaite pour ma part appeler l'attention de mes collègues et du Gouvernement sur la biologie médicale, dont le fonctionnement avait été revu dans la proposition initialement discutée au Sénat. Cette question revêt une importance considérable. Nous sommes ici au coeur des questions de santé publique, mais aussi de recherche.
Depuis l'ordonnance du 13 janvier 2010, les services de biologie des centres hospitalo-universitaires ne peuvent plus recruter de médecins, pharmaciens ou scientifiques spécialisés en hématologie, immunologie, biochimie ou pharmacologie, et d'une façon générale de toutes les disciplines fondatrices de la biologie médicale. L'accès aux services de biologie médicale est exclusivement réservé aux titulaires d'un diplôme de biologie médicale.

Cette disposition de l'ordonnance est parfaitement adaptée à l'organisation de la biologie médicale en laboratoires privés ou dans les hôpitaux généraux. En revanche, elle est totalement inadaptée au recrutement des professionnels de biologie dans les CHU.
Ces scientifiques ont fait leurs preuves. Je rappelle que cette voie s'inscrit totalement dans la ligne de l'ordonnance de 1958 relative aux CHU. L'article 3 du texte initial n'avait qu'un objectif : placer le bon professionnel à la bonne place.

Ne pas l'adopter aboutirait à porter un coup fatal à l'organisation du service public de la biologie médicale, avec un risque évident de dégrader l'offre de soins des CHU.

L'article proposé se limite à corriger la situation particulière des CHU, afin de leur permettre de recruter pour les missions d'enseignement et de recherche des professionnels de santé qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, mais qui sont venus à la biologie médicale par d'autres disciplines.
C'est le cas du professeur Yves Agid, neurologue mondialement reconnu qui est devenu professeur de biologie cellulaire en raison de ses découvertes sur l'impact de la biologie cellulaire dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Il est faux de dire que cet article ouvre droit à une équivalence du DES de biologie médicale. Un hospitalo-universitaire non titulaire du DES de biologie médicale ne pourra en aucun cas prétendre à exercer au sein d'un laboratoire privé. Les hospitalo-universitaires ont une évolution de carrière complètement distincte des carrières de santé dans le secteur privé.
De plus, l'article précise clairement que le professionnel de santé n'exercera sa mission de soins que dans la spécialité pour laquelle il aura été diplômé. Cet article est en totale cohérence avec le travail considérable réalisé depuis plusieurs mois par le ministère de la santé pour organiser la biologie médicale sur l'ensemble du territoire.

D'ailleurs, l'ordonnance est tellement bien écrite qu'il faut déjà y revenir !

Cet article ne concerne en rien les laboratoires privés de biologie médicale, pas plus que les laboratoires des hôpitaux généraux. Il concerne uniquement le recrutement des hospitalo-universitaires dans les services de biologie médicale des centres hospitaliers universitaires.

Ce recrutement est assuré par le Conseil national des universités, instance nationale chargée du recrutement et des carrières des hospitalo-universitaires…

…non pas en fonction de la spécialité, car il n'existe pas de spécialité de biologie médicale au niveau des CNU, mais en fonction des disciplines. Cette instance exige des titres et travaux du niveau du doctorat et conférant l'habilitation à diriger des travaux de recherche.
Notons également que dans nombre de laboratoires de biologie, comme ceux de pharmacologie, on ne voit aucun interne en biologie médicale.
Ne pas voter cet article, c'est aussi faire un choix dangereux : le nombre de biologistes médicaux formés risque d'être trop faible pour assurer le remplacement des praticiens exclus par l'ordonnance du 13 janvier 2010. C'est là que réside le risque pour la santé publique.

Il ne s'agit pas d'opposer les titulaires de DES à d'autres spécialistes – chacun a ses qualités et sa formation. Ce qui compte, c'est le rayonnement de nos CHU et l'assouplissement d'une réglementation qui fait fuir certains de nos plus grands chercheurs.

Mes chers collègues, la question est simple : il faut choisir entre le carcan qui nuit à la vitalité de la recherche et la possibilité pour l'ensemble des scientifiques de concourir au fonctionnement des CHU, dans le respect des parcours de chacun. Je demande donc au Gouvernement et à mes collègues de faire le bon choix, en veillant à assouplir l'ordonnance ; je vous demande donc de vous montrer favorables à un régime dérogatoire de recrutement par les services de biologie de CHU, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le sens de l'amendement 6 rectifié déposé notamment par Olivier Jardé. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP et du groupe NC.)

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi de nos collègues sénateurs Dupont et Adnot fait suite au rapport d'information qu'ils ont consacré à l'autonomie immobilière des universités.
La loi LRU du 10 août 2007 prévoit la possibilité pour les établissements universitaires de demander la dévolution du patrimoine immobilier de l'État.
Dans les faits, ce processus est long : il nécessite au préalable que l'établissement ait inscrit dans un schéma directeur sa politique immobilière, qu'il ait défini une programmation pluriannuelle d'investissement, qu'il dispose d'une bonne connaissance de son inventaire et qu'il ait remis à niveau sa comptabilité immobilière.
Aujourd'hui, une université sur cinq a mis en place un schéma directeur immobilier, et une université sur deux connaît le coût de fonctionnement de ses bâtiments. Au final, cinq universités seulement peuvent prétendre à cette dévolution.
De plus, alors que 35 % du patrimoine universitaire sont vétustes, les crédits consacrés à la sécurité et à la maintenance des bâtiments diminuent de 166,3 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2011.
Le plan Campus, qui concerne une dizaine d'universités, est financé d'une part par la vente de 25 % des actifs d'EDF, soit 5 milliards d'euros, et d'autre part par un crédit de 1,3 milliard d'euros dans le cadre du financement des investissements d'avenir par le grand emprunt. Mais un rapport de la Cour des comptes du mois de juin dernier indique que le financement de ce plan Campus n'est pas opérationnel.
Malheureusement, l'absence de vision et de stratégie perdure avec ce texte.
Les dépenses d'éducation pour l'enseignement supérieur étaient de 72,4 % en 2009, contre 78,5 % en 2000. Pendant ce temps, la part des collectivités territoriales est passée pour la même période de 5,2 % à 9,8 %.
Les auteurs de la proposition de loi partent, à juste titre, du constat que les moyens alloués à la fonction immobilière des établissements d'enseignement supérieur, faute jusque-là de vision stratégique et globale, ne sont ni suffisants, ni utilisés de façon optimale.
Ils reconnaissent que la traduction comptable et budgétaire de la dévolution est délicate, car la budgétisation de la seule dotation comptable aux amortissements ne permet pas de couvrir les besoins réels de renouvellement des immeubles. La dévolution aura donc un coût pour l'État.
Enfin, ils arrivent à la conclusion selon laquelle il est nécessaire de sécuriser de manière pérenne l'aide de l'État, qui portera sur l'investissement, la maintenance et le renouvellement.
La question centrale du financement est éludée au profit des collectivités et des partenariats public-privé ou public-public, contribuant par là à creuser les inégalités déjà existantes. Ce désengagement manifeste de l'État, alors même que l'enseignement supérieur est l'une de ses compétences, est inquiétant.
Enfin, feu l'article 3, qui portait sur le recrutement des responsables de biologie dans les CHU, pourrait avoir s'il était rétabli des conséquences problématiques sur la sécurité sanitaire et la santé publique.
Le biologiste médical, pour pouvoir exercer, doit avoir obtenu, après un externat en médecine ou en pharmacie, un diplôme d'études spécialisées en quatre ans, sanctionné par un mémoire et suivi d'une thèse d'exercice, ou être qualifié par les instances ordinales au regard de compétences prouvées.
L'ordonnance du 13 janvier 2010 permet à des médecins et pharmaciens non titulaires du DES d'obtenir l'équivalence de la fonction de biologiste médical s'ils prouvent leur compétence et ont une formation équivalente à celle permettant d'exercer cette profession médicale. Elle ouvre également cette possibilité à l'ensemble du personnel enseignant et hospitalier titulaire des CHU.
La sagesse de nos collègues sénateurs a permis de supprimer cet article 3 qui constitue en outre un cavalier législatif.
Chers collègues, comme l'a dit tout à l'heure Pascal Deguilhem, responsable de notre groupe, je voterai contre cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte de la commission.

Je suis saisie d'un amendement n° 1 .
La parole est à Mme Colette Langlade.

Les universités doivent connaître avec précision la valeur du patrimoine transféré : elles ne peuvent s'engager dans un transfert sans disposer d'une vision complète de l'état du patrimoine. Celui-ci doit donc être connu, évalué et amorti.
Nous proposons donc de compléter cet article par l'alinéa suivant : « Les biens mobiliers et immobiliers font l'objet d'une évaluation préalable au transfert de propriété. »

Cet amendement a été rejeté par la commission. Il me paraît satisfait par les dispositions existantes.
À la suite du décret du 1er décembre 2008 modifiant le code des domaines, qui vise à généraliser les conventions d'utilisation des immeubles domaniaux, France Domaine est en train d'évaluer le patrimoine immobilier des opérateurs de l'État. À la fin du mois d'avril 2010, si j'en crois le rapport d'information du Sénat sur la dévolution du patrimoine aux universités, nous disposions déjà d'un nombre important d'évaluations.
D'autre part, l'article L. 719-14 du code de l'éducation dispose que le transfert du patrimoine immobilier aux universités « s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. »
Pour ces deux raisons, je pense que vous pourriez retirer cet amendement.
Même avis. Je peux même être plus précise : France Domaine s'est engagée à terminer cette évaluation du patrimoine au mois de janvier 2011 ; évidemment, pour toutes les universités qui ont demandé le transfert de la propriété de leur patrimoine, l'évaluation a déjà été rendue publique et a fait l'objet d'une confrontation avec les demandes des universités.
L'amendement est donc satisfait ; je vous demande donc moi aussi de le retirer ; à défaut, je donnerai un avis défavorable.

En attendant cette évaluation, il faut bien constater que l'amendement n'est pas satisfait. Nous maintenons donc notre amendement.
(L'amendement n° 1 n'est pas adopté.)
(L'article 1er A est adopté.)

L'article 1er ne fait l'objet d'aucun amendement.
(L'article 1er est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement de suppression, n° 2.
La parole est à M. Régis Juanico.

Cet amendement est très simple. Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ont pour objectif de conduire des projets communs afin de favoriser la coopération scientifique entre les différents établissements de recherche, en associant éventuellement des partenaires comme les entreprises et des collectivités territoriales.
La proposition de loi autorise les PRES à délivrer des diplômes. Cette compétence supplémentaire leur accorderait un rôle central dans l'enseignement supérieur. J'ai déjà indiqué, comme Marietta Karamanli, que ce serait une brèche dans le monopole de délivrance des diplômes aujourd'hui accordé aux établissements publics. C'est là un premier problème.
Un second problème tient à la gouvernance des PRES. Par leur constitution et leur mode de gouvernance, ils n'assurent pas une représentation démocratique ; les instances décisionnelles des PRES sont composées en majorité de personnalités extérieures : les enseignants chercheurs, les personnels et les étudiants y sont aujourd'hui minoritaires. Or, la délivrance des diplômes par les PRES irait à l'encontre de l'organisation de l'enseignement supérieur.
Les universités doivent conserver la faculté de recrutement d'équipes que le PRES ne fait que réunir. Il apparaît inutile de permettre aux PRES de délivrer les diplômes : ceux-ci doivent rester de la seule compétence des universités, dont le corps professoral a seul la compétence pédagogique et scientifique nécessaire à la délivrance de diplômes.
Même avis. Cet amendement prive le texte de son objet.
(L'amendement n° 2 n'est pas adopté.)
(L'article 2 est adopté.)

Sur les articles 2 bis A et 2 bis, je ne suis saisie d'aucun amendement.
(Les articles 2 bis A et 2 bis, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

La commission a maintenu la suppression de l'article 3.
Je suis saisie d'un amendement n° 6 rectifié tendant à le rétablir.
La parole est à M. Olivier Jardé.

Comme je l'ai dit dans la discussion générale, l'ordonnance du 13 janvier 2010 ne donne satisfaction à personne. Elle ne donne pas satisfaction aux biologistes, elle ne donne pas satisfaction à notre université.
Les PU-PH sont à la fois des enseignants, des chercheurs et des cliniciens. Actuellement, il n'y a pas de sous-section de biologie. Celle-ci est donc un lieu d'intersection entre plusieurs disciplines, ce qui est habituel dans notre université. Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait se priver de la possibilité de nommer en biologie des professeurs d'université issus de l'hématologie, de la génétique, ou encore de la virologie. Cela revient à se priver de plusieurs prix Nobel.
Cet amendement propose donc de rétablir l'article 3 afin que, par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 6213-1 du code de la santé publique, il demeure possible de nommer en biologie des personnes venues d'autres disciplines.
Voter cet amendement serait le moyen de bloquer l'ordonnance du 13 janvier 2010, qui n'est pas encore promulguée et qui, je le répète, ne donne satisfaction à personne.

La commission a émis un avis défavorable.
Il est proposé de rétablir, dans une rédaction différente, l'article 3 de la proposition de loi, qui a été supprimé par le Sénat et qui revenait sur la réforme de la biologie médicale mise en oeuvre par ordonnance au mois de janvier.
Comme je l'ai indiqué dans mon exposé liminaire, cet article, qui modifiait le code de la santé publique, paraissait, aux yeux de nombreux membres de la commission, relever plutôt de la compétence de la commission des affaires sociales. Son examen par celle-ci aurait été d'autant plus légitime que la réforme de la biologie médicale découle de la loi HPST, laquelle lui avait été renvoyée.
En tout état de cause, la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement sur ce texte. Il a donc été examiné en séance publique au Sénat le 17 novembre, et la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale l'a adopté moins d'une semaine après.
L'urgence qu'il y a à lever les obstacles juridiques à la réalisation du plan Campus ne me parait pas sujette à débat. Le Sénat comme notre assemblée ont d'ailleurs été suffisamment éclairés par le rapport d'information de nos collègues Jean-Léonce Dupont et Philippe Adnot sur la dévolution aux universités de leur patrimoine immobilier.
La commission a choisi de voter dans les mêmes termes le texte adopté par le Sénat, afin de ne pas prendre le risque de retarder la mise en oeuvre du programme de rénovation des universités, dont l'urgence a justifié le recours à la procédure accélérée.
Je vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 3, pour permettre la réalisation du plan Campus dans les meilleurs délais, et de renvoyer la question de la biologie médicale à un autre véhicule législatif plus adapté, qui permettrait aux commissions des affaires sociales des deux chambres, compétentes sur ces sujets, de se prononcer dans la sérénité.
Madame la présidente, permettez-moi d'exposer assez longuement la position qui sera la mienne.
D'abord, cet amendement est très important pour moi, pour mon ministère, et pour les chercheurs de France. L'ordonnance relative à la biologie médicale a reflété la volonté, tout à fait légitime, que les postes de biologie médicale soient réservés à des diplômés de biologie médicale. Il s'agit de l'exercice libéral de la biologie, il s'agit aussi de l'exercice hospitalier de la biologie. Cette ordonnance est parfaitement légitime, et je dis cela à des députés qui sont, je le sais, très soucieux de la voir appliquée.
Mais le CHU est un lieu très particulier. C'est un lieu de recherche. Dans les CHU, il y a des chaires, occupées par de grands chercheurs. L'un d'entre eux, Didier Raoult, lauréat cette année du Grand Prix INSERM, me disait hier : « Aujourd'hui, madame la ministre, avec cette nouvelle ordonnance, je ne pourrais plus occuper cette chaire ».
Nous avons donc un souci. Parce que le CHU n'est pas seulement un lieu hospitalier, madame la rapporteure. C'est un lieu de recherche, et de recherche de pointe. Avec les investissements d'avenir, nous voulons faire rayonner nos CHU au plan mondial. Pour cela, il faut nommer dans les chaires de ces CHU la bonne personne à la bonne place. Cela veut dire qu'il faut faire confiance au Conseil national des universités, qui, dans sa section hospitalo-universitaire, recrute, parmi les pairs, la bonne personne.
Quand on fait de l'hématologie, de la biochimie ou de la neurologie, on peut, un jour, dans sa carrière, être amené à faire de la biologie sans avoir pour autant fait des études qui mènent directement à la biologie.
J'ajoute qu'il y a dans l'ordonnance une contradiction, qui a été soulevée par M. About, ancien président de la commission des affaires sociales du Sénat. Il a fait remarquer, en effet, que pour les étrangers recrutés dans nos CHU, on ne demande pas qu'ils soient titulaires des diplômes de biologie qui sont demandés pour les Français. Autrement dit, un chercheur britannique, américain ou japonais peut être recruté dans un CHU français sans avoir de diplôme de biologie médicale, alors qu'un grand chercheur français aujourd'hui titulaire d'une chaire de biologie médicale risquerait d'en être privé.
Mesdames, messieurs les députés, ce que je vais vous dire, je vous le dis vraiment très solennellement, en vous remerciant d'être venus aussi nombreux, cet après-midi, pour examiner cette proposition de loi. On me dit que la commission des affaires sociales de votre assemblée préparerait un texte dans lequel cet amendement pourrait être intégré. J'en accepte l'augure. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai le sentiment qu'au sein de la commission des affaires sociales, il y a une incompréhension sur le sens de cet amendement, sur le fonctionnement de la recherche française, sur le fonctionnement de la recherche mondiale, en même temps que sur le coeur de compétence de la commission des affaires culturelles.
Je le répète, si l'on veut rayonner dans le monde, si l'on veut offrir les meilleures chaires aux meilleurs chercheurs, il faut recruter la bonne personne à la bonne place. Il faut en finir avec ces querelles liées à des diplômes qui auraient dû être passés vingt ou trente ans auparavant, mais qui ne l'ont malheureusement pas été.
Il s'agit là d'un sujet majeur pour le rayonnement de notre recherche biomédicale demain. L'ordonnance me paraît devoir absolument être réformée sur ce point.
J'en arrive à la position du Gouvernement sur cet amendement, mais vous aurez compris qu'elle m'arrache le coeur. La position du Gouvernement sera de vous demander, mesdames, messieurs les députés, de voter conforme le texte adopté par le Sénat. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, paraît-il, suffisamment de place dans le calendrier des deux assemblées pour que nous puissions poursuivre le débat sur cette question avec le Sénat. Permettez-moi de le regretter. Je croyais que la révision constitutionnelle avait été faite, justement, pour permettre l'examen d'un plus grand nombre de textes d'initiative parlementaire.
Cette proposition de loi illustre de manière exemplaire la capacité d'initiative des députés et des sénateurs. C'est pourquoi je regrette d'autant plus qu'on nous demande un vote conforme,…
…même si, par ailleurs, l'adoption rapide de la présente proposition de loi m'importe aussi, car je souhaite que le plan Campus démarre très vite, et que les partenariats public-privé puissent être signés très vite.
Pour toutes ces raisons, et en remerciant tous les députés ici présents, je demande le retrait de cet amendement. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.)

Madame la ministre, il faut bien sûr savoir parfois courber l'échine. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. Vous le déplorez, certes, mais dites-moi, qui a rédigé l'ordonnance du 13 janvier 2010 ?
Le groupe SRC est bien entendu opposé au rétablissement de l'article 3. Nous l'avons déjà dit, et je ne vais pas rouvrir le débat. Nous allons laisser la majorité face à ses contradictions.
Vous en avez appelé à votre majorité, madame la ministre. Je ne sais pas s'il y aura plus de – comment dire ? – plus de « raison » à la commission des affaires sociales. Vous même n'en êtes pas sûre. Laissons donc M. Jardé et M. Debré espérer que la commission des affaires sociales puissent produire un texte qui exauce leurs voeux.

Mes chers collègues, il n'y a pas meilleur ambassadeur, pour cet amendement, que Mme la ministre.
Nous comprenons tous l'exigence d'un vote conforme, qui est souhaité par le Gouvernement. Cela étant, je voudrais en appeler à la conscience de chacun d'entre vous. Cette ordonnance a été une erreur. Nous avons amalgamé la biologie libérale, la biologie publique et la biologie universitaire. Cela étant, qu'il n'y ait pas de malentendu : il n'est pas question de différencier la biologie libérale de la biologie publique et de remettre en question le diplôme qui valide la formation des biologistes. Mais, comme l'a dit Mme la ministre, le problème des CHU est tout à fait particulier. Ils accueillent des personnalités venues de mondes extrêmement différents, qui ont des carrières universitaires extrêmement difficiles. Elles sont confrontées à un imbroglio administratif dont le résultat est que cette qualification de biologie générale conduit à une impasse universitaire.
Des individus de tous horizons et de très grande qualité, qu'ils soient immunologistes, hématologistes, ou encore virologistes – et face au SIDA, on sait ce que cela représente –, sont aujourd'hui dans des filières universitaires, deviennent maîtres de conférence, professeurs d'université, et sont capables de gérer les plus grands laboratoires français.
Nous ne sommes pas en train de parler d'un problème qui ne concernerait que trois ou quatre personnes en France. Ce n'est pas vrai. Le problème concerne tous les universitaires qui travaillent dans les plus grands laboratoires français – et je rappelle qu'il y a vingt-six CHU en France.
Si cet amendement n'est pas adopté, que va-t-il se passer demain ? Il va se passer que telle personne hautement qualifiée, titulaire d'un diplôme particulier, par exemple un diplôme d'immunologie, ne pourra pas se voir confier la responsabilité de gérer tel laboratoire de biologie. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous en arrivons à l'inverse de ce que nous voulions faire ! Est-ce que c'est cela, l'intérêt des universités françaises ?
Aujourd'hui, pour des raisons que je peux comprendre, mais qui ne me paraissent pas primordiales, on nous demande de renvoyer à plus tard l'examen de cette disposition et de retirer l'amendement.

Il faut conclure, mon cher collègue. Vous avez dépassé votre temps de parole.

Et on nous le demande alors que nous avons la possibilité, dans quelques instants, et dans un moment solennel, de régler définitivement ce problème de la biologie universitaire, et de faire en sorte que des générations de biologistes ne soient pas pénalisées. Ils risquent de voir leur carrière bloquée parce que nous n'aurons pas eu le courage de prendre nos responsabilités.

Mes chers collègues, en votre âme et conscience, votez cet amendement. C'est plus important qu'un vote conforme, car il y va de l'intérêt de la France.

Madame la ministre, vous avez fait preuve d'une grande sagesse en demandant le retrait de cet amendement.
Cher collègue Domergue, il y a un an, j'ai été de ceux qui, avec Jean-Sébastien Vialatte, ont demandé que les problèmes de la biologie soient traités de manière globale dans cette ordonnance. Cela n'a pas été fait. Vous ne pouvez pas demander, monsieur Domergue, qu'il y ait deux catégories de biologistes. L'exemple que vous avez pris est faux : quand on est immunologiste, on a déjà un DES de biologie médicale.

Pardonnez-moi, mais c'est ainsi ! L'internat est à présent un internat qualifiant, avec un DES à la clé. Et l'on ne peut pas, madame la ministre, avoir, dans un centre hospitalier général, dans un centre hospitalier régional, des biologistes chefs de service ou adjoints, alors que dans un CHU, d'autres chefs de service auraient moins de qualification. Vous avez dit vous-même qu'il fallait mettre la bonne personne à la bonne place. Il y a dans les CHU français des centaines de personnes qui sont adjoints au chef de service et qui peuvent tout à fait occuper ces postes de responsabilité. Ils font de l'enseignement et ils font de la recherche. On voit que vous êtes loin de ces gens-là, cher collègue Domergue.
Un dernier mot, madame la ministre. Le Syndicat national des internes en médecine, le Conseil de l'ordre des médecins, le Conseil de l'ordre des pharmaciens vous disent de ne pas faire cela et de faire en sorte qu'il y ait la bonne personne à la bonne place, justement, en veillant à ce qu'elle ait la qualification nécessaire. On ne peut pas, au moment où l'on demande à une profession de s'accréditer – la biologie est la seule profession médicale qui soit sur la voie de l'accréditation –, faire un pas en arrière uniquement pour nommer dans les services des CHU des spécialistes qui n'ont pas les compétences de base. Cela n'enlève rien à leurs qualités de chercheurs, ni à leurs qualités d'universitaires.
Enfin, mes chers collègues, c'est pour cinq ou dix personnes que nous sommes en train de statuer ce soir.

Je pense vraiment que l'on peut remettre à quelques semaines l'examen de cette question, afin que l'ordonnance, qui est incomplète, soit complétée dans de bonnes conditions. De grâce, ne tirons pas cette discipline vers le bas. Ce serait une faute majeure pour le rayonnement de la médecine et de la biologie françaises, en France et en Europe.
(L'amendement n° 6 rectifié n'est pas adopté.)

Je suis saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 4.
La parole est à M. Olivier Jardé pour défendre l'amendement n° 3 .

Actuellement, des personnes qualifiées siègent dans les conseils d'administration des universités. C'est une excellente chose qui permet de créer un lien avec l'économie du territoire et ses élus.
Ces personnes, qui apportent une plus-value au conseil d'administration, n'ont pas la possibilité d'élire le président de l'université ni de contribuer directement à la définition du projet pédagogique. C'est tout à fait dommageable, et c'est pourquoi cet amendement propose de donner le pouvoir aux personnes qualifiées d'élire le président et de voter le projet pédagogique de leur université.
Là encore, cet amendement est très important pour l'université française, mais il mérite à lui seul un large débat. Les sénateurs, lors de la discussion sur la loi autonomie, souhaitaient que les personnalités qualifiées puissent voter lors de l'élection des présidents d'université. Le Président de la République lui-même nous a dit qu'il faudrait que nous y travaillions, mais évidemment, je ne vous ai pas demandé un vote conforme à l'article précédent pour ne pas faire de même sur cet amendement.
Je demande donc à monsieur Jardé de retirer cet amendement, qui est pourtant très important et très intéressant et sur lequel nous aurons à nous concerter avec la communauté universitaire, parce qu'il faut qu'elle s'ouvre sur les personnalités qualifiées.
Afin d'apaiser les débats qui continuent dans l'hémicycle, je voudrais dire à tous les députés qui sont peut-être frustrés suite au rejet de l'amendement sur la biologie médicale que je leur donne rendez-vous sans faute le jour où la commission des affaires sociales le présentera au vote dans l'hémicycle, car il faudra alors parler de la réalité de la recherche française. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
(L'amendement n° 3 n'est pas adopté.)

Cet amendement vise à empêcher les blocages lors de l'approbation des listes des personnalités extérieures.
(L'amendement n° 4 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Certains vacataires font beaucoup d'heures et sont très peu rémunérés. Il s'agit souvent plus de bénévolat que d'autre chose. Cet amendement vise simplement à ce que les établissements d'enseignement indiquent le nombre d'heures à réaliser et le montant de la rémunération, même si elle est minime.

Avis défavorable : les modalités de recrutement et de rémunération des chargés d'enseignement sont d'ordre réglementaire.
(L'amendement n° 5 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Mon explication sera très brève, car j'ai compris que nous étions en procédure très accélérée. (Sourires)
Tous, sur ces bancs, nous avons une ambition pour l'université française. Mais nous n'empruntons pas les mêmes voies. Nous notons qu'au fil des textes, vous avez choisi la voie de la libéralisation à l'extrême, et vous l'avez assumée.
Nous ne soutenons pas cette politique. Qu'il s'agisse d'immobilier, de diplômes, ces dispositions nous inquiètent pour les étudiants, leurs familles, et les droits d'inscription. Tous ces points, qui ne figurent pas dans le texte mais sont en germe dans votre politique, justifient que nous votions contre ce texte.

Ce texte est effectivement important. L'immobilier, la possibilité pour les pôles de recherche et d'enseignement supérieur de délivrer des diplômes nationaux : les fondations posées sont très importantes pour notre université.
Je regrette que l'article 3 et le problème des personnes qualifiées n'aient pas été retenus, mais j'engage tous mes collègues à se pencher sur l'ordonnance du 13 janvier 2010, qui pose problème pour la biologie. Elle n'est pas encore promulguée, et je pense qu'il faut vraiment la revoir, ainsi que la place des personnes qualifiées. Néanmoins, je voterai en faveur de ce texte.

Bien sûr, l'UMP soutient cette proposition de loi. La dévolution de l'immobilier est fondamentale si l'on veut moderniser nos universités. La délivrance des diplômes nationaux par les PRES est également un point important. Mais je souhaite surtout rendre hommage à madame la ministre pour ses paroles et son attitude à notre égard. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) Nous étions tous dans une situation difficile lors de l'examen de l'article 3, et nous vous donnons rendez-vous pour faire en sorte qu'en commission des affaires sociales, nous puissions régler un problème qui semble fondamental au niveau de la biologie et des CHU. (Même mouvement)

Vous m'avez bien écouté lors de mon intervention justifiant le vote défavorable du groupe GDR, je n'alourdirai donc pas les débats. Vous avez livré l'université à un libéralisme accru avec la loi LRU, et ce soir, vous nous invitez à vendre les meubles et les immeubles. C'est bien dommage que la privatisation aille jusque-là, et c'est pourquoi nous voterons contre.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, structures interuniversitaires de coopération et conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

Prochaine séance, jeudi 2 décembre à neuf heures trente :
Proposition de loi en faveur d'une fiscalité juste et efficace ;
Proposition de loi garantissant la souveraineté du peuple en matière budgétaire.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures cinquante.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma