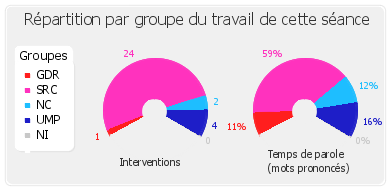Séance en hémicycle du 14 septembre 2009 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

En application des articles 29 et 30 de la Constitution, je déclare ouverte la deuxième session extraordinaire de 2008-2009, convoquée par décret du Président de la République du 29 juillet 2009.

J'ai reçu du Conseil constitutionnel communication d'une décision en date du 6 août 2009 constatant la déchéance de plein droit de M. Jacques Masdeu-Arus de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.
Acte a été pris de cette communication au Journal officiel du 7 août 2009.
La décision du Conseil constitutionnel sera publiée en annexe au compte rendu de la présente séance.

J'ai reçu de M. le Premier ministre des lettres m'informant qu'il avait chargé, dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 144 du code électoral :
M. Thierry Mariani, député du Vaucluse, d'une mission temporaire auprès de M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;
M. Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, d'une mission temporaire auprès de M. le ministre de l'éducation nationale.
Les décrets correspondants ont été publiés au Journal officiel des 29 juillet et 26 août 2009.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
La parole est à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, mesdames et messieurs les députés, le projet de loi organique soumis à votre examen vise à mettre en oeuvre le principe d'exception d'inconstitutionnalité prévu par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le texte présenté par le Gouvernement a fait l'objet d'un examen approfondi par votre commission des lois et je tiens à saluer tout particulièrement les travaux de votre président-rapporteur, Jean-Luc Warsmann. D'importantes améliorations ont permis au texte de gagner en lisibilité et de mieux assurer l'effectivité du dispositif. Le débat en commission a, en effet, permis d'enrichir le texte et je ne doute pas que notre débat en séance sera lui aussi constructif.
Telle qu'elle est posée aujourd'hui, la question de constitutionnalité est un moment historique : elle marque un progrès considérable dans l'approfondissement de l'état de droit et dans la pratique démocratique au quotidien.
En effet, elle permet au justiciable – pour la première fois – de soutenir qu'une disposition législative qu'on veut lui appliquer, quelle qu'elle soit, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Il s'agit de consacrer la vocation première de notre bloc de constitutionnalité : protéger les libertés et les droits fondamentaux des citoyens.
En prévoyant que « le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation », le constituant a voulu éviter certains risques : le risque d'engorgement par l'afflux de questions déjà tranchées, fantaisistes ou soulevées à des fins dilatoires ; le risque, plus profond, de déstabilisation de notre organisation juridictionnelle, lequel est peut-être moins perceptible par le non-spécialiste. Le texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui a pour but de permettre la mise en oeuvre concrète au bénéfice de nos concitoyens de l'exception d'inconstitutionnalité, mais d'éviter ces deux risques qui pourraient remettre en cause l'avancée démocratique ainsi réalisée.
La question de constitutionnalité s'inscrit en cohérence avec les principes de notre droit. Elle réaffirme la hiérarchie des normes juridiques, dans le respect de notre architecture constitutionnelle.
La primauté de la Constitution sur les règles de droit interne se trouve réaffirmée. Aujourd'hui, il est impossible au justiciable de soulever le moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi. C'est une anomalie. Désormais, le moyen pourra être soulevé au cours de toute instance devant toute juridiction, qu'elle relève du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, et, pour la première fois, il pourra être soulevé en cour d'appel.
En matière pénale, il pourra intervenir au cours de l'instruction et sera alors porté devant la chambre de l'instruction.
En assises, la question pourra être soulevée en amont, dans la phase d'instruction du procès criminel.
La question de constitutionnalité ne remet pas en cause notre organisation juridictionnelle. Le principe de spécialité des juridictions est respecté. Chacun reste dans sa sphère de compétence.
Les juridictions judiciaires et administratives vérifient la compatibilité entre les lois nationales et les normes internationales – comme elles le font aujourd'hui –, le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi à la Constitution.
L'équilibre des juridictions sera maintenu. Il n'est pas question de faire du Conseil constitutionnel une « super cour suprême » : son contrôle demeure abstrait et limité à la seule question de constitutionnalité qui est posée.
Par conséquent, les cours souveraines demeurent des cours souveraines. La question de constitutionnalité implique une coopération des juridictions nationales, dans le respect de leur compétence et de leur spécialité.
Mesdames et messieurs les députés, la question de constitutionnalité – grâce à la rédaction du texte à laquelle vous avez participé – préserve les principes et les équilibres de notre droit. Elle doit aussi garantir au citoyen la pleine effectivité du nouveau recours prévu par la Constitution. Les règles et les modalités concrètes d'examen par le juge doivent répondre à cette exigence.
Une règle est essentielle : la priorité d'examen de la constitutionnalité de la loi.
Le projet de loi articule les deux contrôles de la loi au regard des normes qui lui sont supérieures : le contrôle de conventionnalité vise à statuer sur la contrariété d'une loi française à une norme européenne ou internationale et à en écarter l'application si la réponse est positive. Il est pratiqué depuis longtemps par les juridictions judiciaires et administratives.
Le contrôle de constitutionnalité, prévu par le projet de loi, prérogative exclusive du Conseil constitutionnel, vise, in fine, à abroger les lois contraires à la Constitution.
Si le juge peut écarter l'application d'une loi contraire à une norme internationale, la question de constitutionnalité de la loi elle-même risque d'être privée de son effectivité si l'on commence par le contrôle de conventionnalité.
La cohérence impose donc que cette règle de priorité de l'examen de la constitutionnalité s'applique à toutes les juridictions, quelles qu'elles soient. Les travaux de votre commission ont permis d'améliorer sensiblement le texte sur ce point.
Les modalités concrètes d'examen doivent viser à la pleine efficacité du dispositif. La définition du moment d'examen par le juge mérite une réflexion approfondie.
Deux écueils doivent être évités : l'allongement de la procédure – que l'on nous reproche en matière civile et pénale ; il ne faut donc pas en rajouter – et l'engorgement des cours suprêmes. Il a fallu trouver un juste équilibre entre l'exigence de rapidité souhaitée par tous les justiciables et la nécessaire efficacité du filtrage.
Le texte adopté par votre commission prévoit un examen « sans délai, dans une limite de deux mois ». La question de constitutionnalité ne saurait devenir un facteur d'allongement des délais de jugement. C'est un point essentiel du projet de loi, une nécessité pour que ce projet recueille l'adhésion de nos concitoyens.
La limite de deux mois vise à préciser le délai. La transmission de la question aux cours suprêmes au-delà de ce délai – s'il est dépassé – ne doit pas compromettre l'efficacité du filtre. Un amendement du Gouvernement sera déposé en ce sens.
Par ailleurs, les critères d'examen ne peuvent être les mêmes à tous niveaux ; ils sont proportionnés à la capacité de chacun des juges de trancher. L'examen de la question de constitutionnalité par le premier juge saisi vise à déterminer si le moyen est opérant, et à l'écarter s'il ne l'est pas. Autrement dit, est-ce que le moyen soulevé par l'une des parties de la constitutionnalité correspond bien à la question qu'on lui demande de trancher ?
En revanche, l'examen de la question par les cours souveraines permettra de déterminer si le moyen est pertinent : y a-t-il bien un problème ? La cour ne tranchera pas elle-même, mais pourra dire s'il existe effectivement un problème de constitutionnalité. Ce second filtrage, effectué par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation, permet ainsi au juge constitutionnel de n'être saisi que de véritables questions de constitutionnalité, sur lesquelles on a effectivement besoin de son expertise et de sa décision. L'efficience du dispositif repose donc sur une claire distinction entre les deux types d'examen.
Mesdames et messieurs les députés, je ne voudrais pas être trop longue. Je souhaite simplement souligner en conclusion que tout le monde, ou presque, s'accorde à reconnaître que le principe de l'exception d'inconstitutionnalité est une nécessité, mais que – force est de le constater – nombreux sont ceux qui, au moment de franchir le pas et de lui donner réalité, ont reculé ; vous n'avez pas reculé, non plus que le Gouvernement.
Le projet de loi organique soumis à votre examen me paraît bien répondre aux attentes et aux questions posées. C'est un projet à la fois réaliste et ambitieux : réaliste, car il ne néglige aucune des difficultés juridiques soulevées par cette innovation ; ambitieux, parce qu'il vise à donner réalité à la protection des droits et des libertés garantis par la loi fondamentale de la France. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et Nouveau centre.)

La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, président et rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et Nouveau centre.)

Je veux vous dire, madame la ministre d'État, notre satisfaction d'être réunis ici, et remercier le Président de la République d'avoir inscrit en premier à l'ordre du jour de cette session extraordinaire ce texte d'application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. D'abord parce que cette révision est importante, et qu'il est essentiel que nous consacrions au vote de ses textes d'application toute l'énergie nécessaire ; ensuite, parce que ce texte aura des conséquences pratiques pour les justiciables et améliorera l'état de notre droit.
En effet, il doit permettre l'entrée en vigueur de l'article 61-1 – nouveau – de la Constitution, en vertu duquel, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation » – avons-nous ajouté par voie d'amendement parlementaire –, « qui se prononce dans un délai déterminé ».
À côté du contrôle de constitutionnalité a priori, qui a connu l'essor que chacun sait, notamment grâce à l'ouverture de la saisine à soixante parlementaires, il y aura désormais un contrôle de constitutionnalité a posteriori, qui permettra à chaque justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative qui lui serait appliquée lors d'un litige.
Le succès de cette nouvelle forme de contrôle de constitutionnalité dépend dans une large mesure des modalités pratiques que nous allons arrêter. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a soumis le projet de loi à un travail approfondi, en procédant à treize auditions publiques, d'universitaires, de chefs de cours, d'avocats.

Au texte initial du Gouvernement, la commission a souhaité, selon un très large consensus, apporter un certain nombre d'ajouts, afin de rendre le dispositif plus opérationnel.
Tout d'abord, au nombre des dispositions législatives qui pourront faire l'objet d'une question de constitutionnalité, nous avons clairement prévu d'inclure les lois du pays de Nouvelle-Calédonie.

La commission a également souhaité affirmer, par le nom même de la question, son caractère prioritaire, de crainte – une crainte partagée, je crois, sur tous les bancs au moment du débat sur la Constitution – que l'outil nouveau que nous mettons au service de nos concitoyens et de l'État de droit ne soit au contraire porteur d'un risque d'allongement des procédures, surtout lorsqu'une partie, beaucoup plus puissante que l'autre, aura les moyens financiers de recourir à des procédés dilatoires.
Voilà pourquoi nous avons procédé à d'autres simplifications ou clarifications. Nous avons ainsi réécrit l'alinéa relatif à l'articulation des questions de constitutionnalité et de conventionnalité devant les juridictions – il s'agit du problème de la conformité d'une loi aux traités internationaux – et introduit la même règle de priorité devant le Conseil d'État et la Cour de cassation.
Nous avons également beaucoup travaillé sur les critères de filtrage des questions par les juridictions saisies, ainsi que par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Selon le texte gouvernemental, le premier critère était que la disposition législative contestée commande l'issue du litige ; nous avons souhaité qu'elle soit simplement applicable au litige, critère à nos yeux moins exigeant et surtout beaucoup plus objectif pour déterminer les dispositions permettant l'application du texte.
Au terme d'un débat poussé, nous avons harmonisé le troisième critère, parce que la quasi-totalité des personnes que nous avons auditionnées, quelle que soit leur qualité, nous y ont incités. Nous avons choisi le point d'équilibre suivant : les juridictions devront s'assurer que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Cela a paru cohérent à nos collègues. Je veux le dire clairement : on ne peut revenir à la mesure initiale, qui prévoyait que la disposition ferait l'objet d'un pré-jugement par le Conseil d'État ou la Cour de cassation – plusieurs collègues sont intervenus très vivement tout à l'heure en commission à ce sujet –, car le rôle du Conseil d'État ou de la Cour de cassation n'est pas de juger de la constitutionnalité, mais de déterminer si une question de constitutionnalité se pose.

Ce point n'est pas seulement rédactionnel, mais touche au fond.
Nous avons ensuite débattu des délais. Nous avions fait voter ici même le principe selon lequel le Conseil d'État et la Cour de cassation doivent faire usage de leur filtre sous des délais à fixer dans la loi organique. Le projet de loi organique prévoyait un délai de trois mois lorsque les juridictions suprêmes sont saisies d'une question transmise par une juridiction. En revanche, rien n'était prévu lorsque ces mêmes juridictions étaient directement saisies d'une question de constitutionnalité. Nous avons comblé cette lacune ; cela n'est plus, me semble-t-il, un sujet de débat.
Dans le même temps, nous avons souhaité que les juridictions – relevant de l'un ou l'autre ordre de juridiction – qui sont saisies d'une question doivent la traiter dans des délais brefs. Soyons très concret : il s'agit de tribunaux de grande instance ou d'instance, de conseils de prud'hommes ou de tribunaux de commerce. Dès lors qu'une partie y pose la question de constitutionnalité, on ne peut admettre que celle-ci y reste pendante des mois durant, surtout si elle a été posée à la fin d'une procédure : on aboutirait alors à l'enlisement complet.

Nous avons adopté un amendement de notre collègue Jean-Jacques Urvoas prévoyant que la juridiction devait examiner la question sans délai, et complété par un sous-amendement précisant « dans la limite de deux mois ». Ce n'est pas nouveau : il existe dans la loi de nombreux domaines – je ne vous en infligerai pas la liste – où des délais maximaux s'appliquent.
Mais nous avons également débattu de la portée pratique du délai. Voici le point d'équilibre du texte qui vous est proposé par la commission : dès lors qu'une juridiction de base n'aurait pas respecté le délai de deux mois, toute partie dispose d'un délai d'un mois pour s'adresser au niveau supérieur, c'est-à-dire pour saisir le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Nous craignons en effet qu'un délai non assorti d'une sanction ne soit pas respecté.
Quant au Conseil d'État et à la Cour de cassation, nous avons eu la même attitude ; nous avons ainsi prévu que le dépassement par ces juridictions du délai déterminé de trois mois – hypothèse qu'à titre personnel je juge hautement improbable – serait suivi de conséquences : le Conseil constitutionnel serait saisi. Je crois que le Gouvernement n'est pas d'accord avec cette disposition ; nous en débattrons tout à l'heure. Mais je dois dire dès maintenant ma crainte que l'absence de disposition en ce sens expose le texte à un risque lors du contrôle de constitutionnalité. On nous en a avertis très clairement lors des auditions auxquelles nous avons procédé. Je songe notamment à l'audition publique de M. Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel : le principe posé par la Constitution et selon lequel les juridictions suprêmes se prononcent dans un délai déterminé, « ajouté par amendement lors des débats parlementaires », implique une sanction du non-respect du délai, ou tout au moins une indication de ses conséquences. En la matière, un vide juridique est inconcevable.

Nous avons dès lors proposé que, si le Conseil d'État – ou la Cour de cassation – ne s'est pas prononcé sous trois mois, la question de constitutionnalité doive être transmise au Conseil. Marc Guillaume suggérait même qu'elle soit transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe, montrant ainsi qu'il n'y avait pas là sanction, mais simplement continuité d'un processus voulu par la Constitution.
En tout état de cause, nous partageons avec le Gouvernement le souhait que cette procédure réussisse, qu'elle ne soit pas utilisée à des fins dilatoires et ne fasse pas l'objet d'abus, mais nous permette au contraire d'améliorer notre État de droit. Sous réserve des différents ajustements à opérer, je vous invite donc évidemment à adopter le texte. Et puisque nous avons la chance d'avoir avec nous dans cet hémicycle le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, je forme en outre le voeu très sincère que les autres textes d'application de la révision constitutionnelle nous parviennent dès que possible. (M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement approuve.)

Des quatre restants, ceux relatifs au CSM et au défenseur des droits ont été déposés devant le Sénat ; celui qui porte sur le Conseil économique, social et environnemental, devant l'Assemblée ; quant au texte relatif au référendum d'initiative conjointe, il n'a pas encore été déposé. Je forme le voeu qu'il le soit très rapidement, et surtout que les dates de vote des textes par chaque assemblée soient fixées. La réforme constitutionnelle a plus d'un an ; nous ferions preuve de cohérence en votant ces textes le plus rapidement possible.

Je redis néanmoins en conclusion ma très vive satisfaction de voir cette session extraordinaire s'ouvrir par l'examen de ce texte : cela augure très heureusement de notre capacité à appliquer efficacement la réforme constitutionnelle. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et Nouveau centre.)

Mes chers collègues, nous abordons la discussion générale.
La parole est à M. Guy Geoffroy.

Monsieur le président, madame la ministre d'État, monsieur le président et rapporteur de la commission, mes chers collègues, ce texte – le premier des très nombreux textes inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire – est important.
Tout d'abord, il est chargé par la commande constitutionnelle de venir décliner une proposition essentielle issue de la révision de juillet 2008. Ensuite, en tant que tel – vous le disiez tout à l'heure, madame la ministre d'État –, il vient enfin répondre à une demande venue des profondeurs de notre pays : que les citoyens soient encore mieux associés à la dynamique républicaine et au parcours sans cesse dialectique qui doit unir nos institutions à une société en constante évolution.
(Mme Catherine Vautrin remplace M. Bernard Accoyer au fauteuil de la présidence.)

Vous l'avez dit, madame la ministre d'État, et notre rapporteur l'a rappelé : il s'agit tout simplement de donner à nos concitoyens, à l'occasion d'une instance devant quelque tribunal que ce soit, à quelque niveau de la procédure que ce soit, la possibilité, très restreinte au début de la Ve République, d'obtenir du Conseil constitutionnel un contrôle de la constitutionnalité d'une loi votée par le Parlement.
Cette capacité a été étendue dans les années soixante-dix, avec la possibilité, largement et légitimement utilisée par toutes les oppositions successives, de recours devant le Conseil constitutionnel pour faire valoir qu'une ou plusieurs dispositions d'une loi votée ne sont pas conformes à la Constitution. Le nouvel élargissement proposé, et qu'il nous faut décliner au travers de cette loi organique, doit concrétiser ce socle du respect par le législateur de la conformité des lois à la Constitution, dans des conditions qui permettront incontestablement, dans un certain nombre de cas, un retour en arrière ; voilà pourquoi le texte doit être précis et ne rien laisser au hasard.
En effet, plusieurs cas de figure sont possibles. Tout d'abord, un citoyen pourrait demander devant une juridiction la vérification de la constitutionnalité d'un texte voté par le Parlement et qui n'a pas été déféré au Conseil constitutionnel. Mais il existe bien d'autres possibilités, et ce sont probablement elles auxquelles nos diverses instances judiciaires seront d'abord confrontées.
Première possibilité : un texte très ancien, toujours en vigueur, n'a pu être soumis à aucun contrôle de constitutionnalité étant donné la date à laquelle il a été promulgué. Ainsi, des lois votées sous les Républiques précédentes n'ont par définition jamais été soumises au contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel instauré par les institutions de la Ve République.
Il y a également des dispositions prises avant que la Constitution ne soit révisée. Je pense en particulier à des dispositions portant sur l'environnement et plus largement le développement durable qui ont pu se trouver en contradiction plus au moins flagrante avec des textes nouveaux de rang constitutionnel, comme vous l'avez souligné en commission, madame la ministre d'État. La Charte de l'environnement a en effet créé un contexte juridique nouveau, « interpellateur » dirons-nous.
Il faut donc veiller à ce que nos concitoyens puissent faire usage de ce nouveau droit à bon escient et soient en mesure de mener la procédure jusqu'à son terme. C'est tout l'enjeu de cette loi organique qui, rappelons-le, correspond à une obligation constitutionnelle. Il faut bien avoir à l'esprit que si cette loi organique ne comprenait pas tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre effective de ce droit, aucune loi ordinaire ne pourrait venir ensuite combler ses éventuelles lacunes.
Pour souligner l'importance de cet élargissement des droits de nos concitoyens, il suffit de rappeler que prises isolément, les dispositions de l'article 61-1 auraient probablement recueilli l'unanimité ou presque des voix lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008. Nous avons d'ailleurs pu constater un même esprit positif lors des réunions de commission sur le présent projet de loi.
La première question à traiter – et le projet de loi le fait parfaitement bien – est celle du bon ordre des choses : quand et comment saisir le juge ? La réponse est claire : le citoyen peut le faire au début de la procédure, en première instance, jusqu'au stade de l'appel ou de la cassation, devant les juridictions de rang supérieur que sont les cours administratives d'appel, le Conseil d'État et la Cour de cassation, ce qui a son importante car il se peut que des justiciables n'aient pas envisagé en première instance de soulever la question de constitutionnalité. Il me paraît donc bon que cette possibilité soit ouverte à tout moment de la procédure.
Le texte prévoit également que les juridictions soient guidées par les mêmes principes, à quelque niveau qu'elles se trouvent dans la procédure de saisine du Conseil constitutionnel. Ainsi, lorsque la Cour de cassation est saisie en premier, elle doit utiliser les mêmes critères que ceux auxquels un tribunal de grande instance, un tribunal des prud'hommes ou une cour d'appel auraient eu recours, s'ils avaient été saisis en premier.
Les choses sont claires et il est important de montrer le champ très vaste ouvert à nos concitoyens.
La deuxième question qui se pose est de savoir comment cette nouvelle disposition sera mise en oeuvre au stade de la procédure où elle interviendra. Il importe en effet de ne pas ralentir le cours de la justice ou de laisser commettre l'irréparable. Cela est d'autant plus important quand il s'agit de procédures pouvant entraîner de la part du juge judiciaire des décisions lourdes comme des mises en détention provisoire. La mise en oeuvre de cette disposition nouvelle ne saurait contrarier l'intérêt de la justice. Le texte se devait de se prémunir contre ces éventuelles difficultés et il répond parfaitement à l'attente de nos concitoyens à ce sujet. Je n'entre pas dans les détails – notre rapporteur, comme à son habitude, a fait un excellent travail.
La troisième question est celle de la place qu'occupe la question de constitutionnalité par rapport à d'autres questions comme celle de l'égalité, au coeur du travail des juridictions, ou celle de la conventionnalité, s'agissant de nos obligations internationales. La commission des lois, comme le texte constitutionnel le prévoyait, a veillé à ce que la question soit définitivement opposable : priorité est donnée au contrôle de la constitutionnalité. À l'instar du Gouvernement, nous n'avons pas souhaité que le juge ait la possibilité d'arbitrer entre plusieurs questions : la question de constitutionnalité est première, le projet de loi l'établit clairement. Libre ensuite aux justiciables de faire valoir, s'ils l'estiment nécessaire, d'autres questions, en particulier celle de la conventionnalité.
La quatrième question est celle des délais, et ce n'est pas la plus mince. À quoi cela servirait-il de créer un nouveau droit s'il ne permettait pas à la justice de s'exercer dans des délais compatibles avec la défense des intérêts des justiciables et de leurs droits et libertés fondamentales ? Cette question, je ne dirai pas qu'elle nous a divisés, mais elle a été à l'origine de très nombreuses et riches interventions : ces débats, grâce au travail du rapporteur, grâce aux contributions des uns et des autres, grâce à l'apport essentiel du Gouvernement, nous auront permis d'avancer de manière tout à fait satisfaisante.
Loin de nous, députés de la majorité – mais je crois qu'il en va de même pour les députés de l'opposition –, l'idée de créer une quelconque suspicion à l'égard des juridictions en laissant penser qu'elles seraient tentées de ne pas jouer le jeu de ces dispositions constitutionnelles, en ne respectant pas les délais et en créant une attente trop longue qui viendrait affecter le cours ordinaire de la justice. Ce n'est pas être suspicieux que d'être précis. Les juridictions ne devraient pas se sentir blessées par les dispositions relatives aux délais d'examen et de transmission, d'autant que, comme le rapporteur l'a fort opportunément rappelé, il ne revient pas aux juridictions saisies d'aller au fond de la question de constitutionnalité mais au Conseil constitutionnel.
Le groupe UMP est sensible à l'équilibre trouvé par la commission des lois, laquelle a prévu un délai au-delà duquel la saisine directe de la Cour de cassation et du Conseil d'État par toutes les parties ne sera plus automatique. De la même manière, nous sommes sensibles au fait que la Cour de cassation et le Conseil d'État disposent d'un délai de trois mois, que nous estimons tout à fait raisonnable, pour saisir à leur tour le Conseil constitutionnel.
Il faut bien savoir quels sont les enjeux à l'issue de la procédure. Il ne s'agit pour les justiciables de demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l'applicabilité d'une disposition dans telle instance mais de le saisir, comme peuvent le faire les députés et les sénateurs, afin qu'il annule purement ou simplement une disposition qui serait à cette occasion déclarée contraire à la Constitution, ce qui est fondamental.
Madame la ministre d'État, sachez que le groupe UMP est à vos côtés pour soutenir ce projet de loi important et bien rédigé, fruit d'un travail approfondi.
Pour finir, chers collègues, j'espère que l'esprit positif qui a présidé aux travaux de la commission des lois régnera à nouveau dans notre hémicycle cet après-midi. Ce serait l'honneur de notre assemblée que de créer un consensus autour de ce droit nouveau, afin qu'il n'y ait aucun doute sur les intentions du Gouvernement comme des parlementaires qui le soutiennent. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi organique vise à rendre applicable le nouvel article 61-1 de la Constitution tel qu'il a été créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Cet article, introduit à l'issue du travail effectué par le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, porte sur le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, dit principe d'exception d'inconstitutionnalité.
Ce principe devrait permettre aux citoyens mais aussi au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents des deux assemblées, à soixante députés ou à soixante sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel.
Nous pourrions nous réjouir de cette innovation, attendue depuis des décennies, d'autant que le Conseil d'État, déjà sollicité à propos de cette procédure à l'occasion de trois arrêts de décembre 2008 relatif à l'association de défense des droits des militaires, avait été obligé de répondre que les dispositions de l'article 61-1 étaient encore inapplicables car elles ne pouvaient « entrer en vigueur que dans les conditions fixées par les lois organiques nécessaires à leur application ».
Force est de constater que la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori fait l'unanimité ou presque – rappelons que Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, s'y est toujours opposé. Mais nombreux sont ceux qui émettent des doutes quant à l'efficacité du contrôle tel qu'il a été organisé par la loi constitutionnelle et tous attendent cette loi organique censée en préciser la mise en oeuvre.
C'est pourquoi, madame la ministre d'État, j'aborderai ce projet de loi à travers des questionnements portant sur des points me semblant poser problème.
Certaines personnes affirment que ce projet de loi constitue une avancée démocratique au sein de nos institutions. Or le filtrage à deux niveaux, exercé par le Conseil d'État et la Cour de cassation avant que le Conseil constitutionnel ne statue, risque fort d'aboutir au fait que certains recours soient considérés comme abusifs, ce qui déposséderait le citoyen du droit de saisine du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, ce filtrage, outre qu'il témoigne d'une certaine méfiance à l'égard du juge ordinaire, allonge la durée de la procédure et repose sur un postulat qui n'est nullement étayé par une étude circonstanciée du nombre potentiel de requêtes mettant sérieusement en cause, devant le juge ordinaire, la conformité de la loi à la Constitution.
Le mécanisme de double filtrage, finalement retenu pour éviter un éventuel engorgement du Conseil, nécessite donc quelques précisions de la part du législateur organique, à moins de vouloir laisser une large marge de manoeuvre aux juges, appelés à jouer un grand rôle au sein de ce mécanisme.
De plus, ce recours aux filtrages successifs entraînera non seulement une procédure longue mais aussi des frais importants. Pour éviter l'alourdissement des coûts du procès, aussi bien pour les avocats que pour les justiciables, il faudrait étudier le moyen, pour l'État, de garantir aux justiciables, et notamment les plus modestes, la prise en charge de l'ensemble des frais de la procédure.
Autre question : ce projet ne véhicule-t-il pas un affaiblissement de l'exception d'inconventionnalité ? Aux termes de l'alinéa 14 de l'article 1er de ce projet, le contrôle de constitutionnalité prime sur le contrôle de conventionalité. La juridiction devra se prononcer en premier lieu sur la question de constitutionnalité. Or le contrôle de conventionalité permet d'interroger en termes de stratégies procédurales. Soulever une question de constitutionnalité sera donc synonyme de réduction, voire de privation, pendant le délai à statuer, de toutes les stratégies relatives au contrôle de conventionalité reposant sur des normes impératives du droit international. Je pense bien sûr aux pactes et conventions des Nations unies ainsi qu'aux principes généraux du droit communautaire. Il est donc prévisible que les parties s'abstiendront, la plupart du temps, de poser une question de constitutionnalité pour se concentrer sur le contrôle de conventionalité.
Cette prévalence aura pour conséquence de déposséder les citoyens du recours effectif à la question d'inconstitutionnalité et d'affaiblir leur protection.
Il aurait été préférable que cette prévalence ne soit pas maintenue dans ce texte. En définitive, il n'appartient qu'aux parties de décider si elles souhaitent actionner l'exception d'inconstitutionnalité, qui permet le cas échéant l'abrogation de la loi, ou l'exception d'inconventionnalité, qui permet la mise à l'écart de la loi au cas d'espèce.
Imposer ainsi la Constitution, en affaiblissant un mécanisme qui fait preuve de son efficacité depuis vingt ans, constitue à nos yeux une mauvaise méthode.
L'instauration, symboliquement forte, de ce dispositif laisse en outre subsister des interrogations en ce qui concerne les obligations pesant sur les juridictions ordinaires. Celles-ci devront-elles saisir leur juridiction suprême, qu'il s'agisse de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, en cas de « simple doute », de « doute sérieux » sur la constitutionnalité ou bien encore lorsqu'il est fait état, en demande ou en défense, d'un « moyen sérieux de nature à mettre en cause la constitutionnalité de la disposition législative en cause » ? Le législateur organique devra donc préciser la condition de fond qui conduira la juridiction ordinaire à saisir sa juridiction suprême.
À ces incertitudes peuvent être ajoutées les interrogations relatives aux moyens pour les justiciables de contester les refus opposés par les juges du fond, statuant en premier ressort, de transmettre des questions de constitutionnalité.
D'autres questions plus précises concernent la possibilité en matière pénale pour les juridictions d'instruction ou la cour d'assises, compte tenu de leur composition, de soulever une question de constitutionnalité. N'oublions pas qu'avant l'entrée en vigueur de ce nouvel article, tous les juges, qu'ils soient de premier ou de dernier ressort, se référaient au contrôle de conventionalité afin de palier l'absence de contrôle de constitutionnalité a posteriori. Ils pouvaient de manière indirecte écarter une loi contraire à la Constitution en se servant des conventions internationales. Toutefois, saisir le Conseil sur l'inconstitutionnalité d'une loi à l'occasion d'une instance en cours implique qu'il devient un véritable juge, ce qu'il n'est pas jusqu'à présent.
En outre, l'article 61-1 peut se heurter à une multiplication de conflits de jurisprudence avec le Conseil constitutionnel et devenir de ce fait, à terme, un facteur d'insécurité juridique majeur, ce qui laisse place à un contrôle diffus de constitutionnalité. De plus, cet article ne donne pas aux justiciables une véritable légitimité à saisir le Conseil constitutionnel du fait de la restriction en matière de droits et libertés garantis par la Constitution.
À la suite de l'adoption de cette loi organique, le Conseil constitutionnel ne devra plus se prononcer avant la promulgation de la loi, mais a posteriori. Il sera donc compétent pour trancher un contentieux. Cela fait de cette institution une juridiction à part entière. En ce sens, l'impartialité de l'institution devient une nécessité absolue. Or elle est loin d'être acquise, compte tenu du mode de nomination de ses membres. Comme chacun le sait, c'est le pouvoir politique qui décide de la composition du Conseil constitutionnel, sans compter que les anciens Présidents de la République en deviennent membres de droit et à vie.
Dans bien des cas, les juges du Conseil constitutionnel auront participé à la rédaction, à l'adoption et à l'application des textes sur lesquels ils devront statuer. Ils deviendront de facto juges et parties.
C'est donc un vaste changement institutionnel que va induire ce texte. Il exige pour le moins de revoir le mode de nomination des juges constitutionnels. La question de son impartialité est posée, comme le souligne avec raison le Syndicat de la magistrature.
En conclusion, ce projet de loi organique propose un dispositif volontairement lourd, coûteux et inefficace. Il vise plutôt à dissuader le citoyen d'introduire des recours en inconstitutionnalité, tout cela parce que la présomption du législateur semble être qu'une procédure trop légère reviendrait à saturer le Conseil constitutionnel de demandes de statuer.
En l'état, ce projet ne correspond nullement à une avancée démocratique et il ne répond pas aux attentes des citoyens qui veulent se saisir de cette possibilité. En définitive, c'est beaucoup de bruit et d'agitation pour rien. Il vise plutôt à réduire les acquis démocratiques obtenus par les luttes et à ne pas créer de nouveaux droits pour les citoyens. Il ne fait que proposer des changements de façade pour que surtout rien ne change. Vous comprendrez, dès lors, que le groupe GDR votera contre ce projet.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avec l'examen de ce projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, nous entrons, à l'ouverture de cette session extraordinaire, dans une nouvelle étape de la mise en application effective de l'ensemble des dispositions de la révision constitutionnelle votée il y a maintenant plus d'un an par le Congrès.
Après une année passée à débattre de la modernisation de notre institution, des droits et prérogatives de l'opposition, de la majorité comme des groupes minoritaires et plus largement du rôle qui doit être celui du Parlement dans une démocratie moderne, c'est un autre débat, non moins essentiel pour l'avenir de notre démocratie, qu'il nous appartient aujourd'hui de reprendre, celui qui doit nous conduire à donner à nos concitoyens de nouveaux droits mais aussi de nouveaux moyens de s'impliquer et de peser dans le débat public.
Ainsi, la mise en place de cette question de constitutionnalité, devenue à la faveur des travaux de notre commission question prioritaire de constitutionnalité, s'inscrit-elle dans une démarche identique à celle qui nous conduira demain à mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, le défenseur des droits ou encore à revitaliser en profondeur le rôle du Conseil économique, social et environnemental en donnant à nos concitoyens la possibilité de le saisir par voie de pétition.
À mon tour, madame la garde des sceaux, et même si vous êtes en charge des ces questions depuis peu de temps, je souhaite vous dire, au nom du groupe Nouveau centre, que cette part essentielle de la réforme constitutionnelle qui nous tenait à coeur doit pouvoir entrer en application dans les meilleurs délais.
Première de ces réformes à être examinées par le Parlement, la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité permettra ainsi à l'ensemble de nos concitoyens de se prévaloir devant la justice des droits fondamentaux que leur reconnaît la Constitution. Désormais et devant toute juridiction, qu'elle relève de l'ordre administratif, judiciaire voire consulaire, le citoyen sera en mesure d'invoquer la dimension inconstitutionnelle de la disposition législative qui lui est opposée, que celle-ci semble en contrariété avec le texte de la Constitution lui-même, avec le préambule de 1946 ou encore avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Aussi cette réforme permettra-t-elle de mettre fin à un curieux paradoxe qui voulait que pour faire valoir certains de ses droits à valeur constitutionnelle, le citoyen soit contraint de se tourner vers les juridictions européennes et non pas vers un juge français. Ainsi que cela a été souligné devant notre commission, la question de constitutionnalité et son caractère prioritaire sur toute question préjudicielle constituera ainsi également le moyen de réaffirmer au sein de notre ordre juridique la prééminence de la norme constitutionnelle.
Enfin, et en vertu de l'article 62 de la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel pouvant mener à l'abrogation de la disposition législative jugée contraire à la Constitution, cette réforme sera aussi et surtout un progrès notable pour l'état de droit dans notre pays. Personne, en effet, ne peut comprendre que des dispositions inconstitutionnelles subsistent encore dans notre droit.
Si la réforme de 1974 a conduit à une quasi-systématisation du contrôle du Conseil sur les textes présentant un doute sérieux de constitutionnalité, ce contrôle exercé à titre préventif se trouvera désormais complété par un mécanisme à vocation curative. Celui-ci permettra ainsi de s'assurer de la conformité à la Constitution de l'ensemble de notre législation, des textes entrés en vigueur avant 1974 comme de ceux adoptés depuis qui n'ont jamais été soumis au Conseil au motif qu'ils étaient simplement présumés ne pas poser de difficulté sérieuse alors qu'ils en posaient peut-être.
Dans l'ensemble des pays ayant mis en place un contrôle a posteriori de la norme législative par la Cour constitutionnelle, la question de l'existence ou non d'un filtrage des requêtes a le plus souvent largement conditionné sa viabilité. À cette question, le constituant a souhaité apporter lui-même la réponse en disposant que le Conseil constitutionnel ne pouvait connaître d'une question que sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Il s'agit pour nous d'en définir les conditions de mise en oeuvre.
Le premier écueil qui pourrait nous menacer consiste à mettre en place un dispositif trop étanche qui conduirait à méconnaître tout à la fois le principe de spécialisation des juridictions, et donc celle du juge constitutionnel, mais aussi, et c'est plus grave, l'effectivité de ce droit que le constituant a souhaité ouvrir à chacun de nos concitoyens. Le second réside pour sa part dans l'excès inverse, dans la mesure où un filtre trop lâche aurait pour seul effet de transformer la question de constitutionnalité en un simple artifice de procédure n'ayant pour seul effet que de ralentir le cours de la justice et de conduire le Conseil constitutionnel à la paralysie, à l'instar de ce qu'a connu dans les années 1970 le tribunal constitutionnel allemand.
À ce titre, je me réjouis de l'équilibre trouvé dans le dispositif retenu par la commission des lois sur proposition de son rapporteur. Ainsi reviendra-t-il au juge devant lequel la question aura été soulevée puis à sa juridiction suprême d'examiner la requête en se basant sur les trois critères que sont l'applicabilité au litige ou à la procédure de la disposition contestée, l'absence de déclaration de conformité à la Constitution préalablement par le Conseil constitutionnel sauf changement de circonstances, enfin le caractère nouveau ou sérieux de la question posée. Ces critères nous paraissent la meilleure garantie pour que le filtre soit à la fois suffisamment strict pour qu'il ne serve pas de moyen pour retarder la justice, mais aussi suffisamment ouvert pour que chaque citoyen puisse y avoir accès.
Mais s'il importe, pour la viabilité du dispositif, que les critères qui seront appliqués soient les plus clairs possibles, les délais de cette nouvelle procédure devront également rester les plus raisonnables possibles, afin notamment de ne pas perturber excessivement le bon fonctionnement de la justice.
À ce titre, je tiens également à me réjouir des exceptions apportées au principe du sursis à statuer en cas de transmission de la question de constitutionnalité. Ainsi le juge pourra-t-il notamment déroger à ce principe lorsque la liberté d'une personne sera en cause ou encore lorsque le sursis à statuer se révélerait susceptible d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives. C'est là un point qui ne saurait à nos yeux être remis en cause à l'occasion de nos débats.
Toutefois, la question des délais de traitement de cette question prioritaire de constitutionnalité me conduit, madame la ministre, à vous demander ce qui se passera lorsque le Conseil d'État ou la Cour de cassation n'auront pas décidé de la transmission de la question au Conseil constitutionnel dans les délais impartis. Dans un tel cas, n'y aurait-il pas un risque d'enlisement de la procédure ? Le rapporteur et les membres de la commission ont essayé d'apporter des réponses sur ce point. Êtes-vous d'accord avec les propositions faites par notre commission pour fixer des délais suffisamment souples pour être applicables mais aussi clairs pour qu'un recours ne se perde pas dans les méandres de telle ou telle juridiction ?
Plus largement, je soulignerai que nous ne sommes pas ici de ceux qui décideront du succès ou non de cette réforme, pas plus que les parlementaires sur tous les bancs. Ainsi qu'il en sera pour le référendum d'initiative citoyenne, dont nous espérons au plus vite la mise en oeuvre, c'est bien l'effectivité de l'appropriation ou non par nos concitoyens de ces nouveaux droits qui doit être la priorité. Or le droit de contester la constitutionnalité d'une loi restera théorique si ce droit n'est pas largement ouvert, non seulement à partir des critères que j'ai évoqués, mais aussi pour que chacun de nos concitoyens puisse en bénéficier. Comme vous le savez, madame la ministre, je suis élu de la Seine-Saint-Denis, département où vivent de nombreuses personnes déshéritées. Or les juridictions visées ici, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel obligent à avoir recours à des avocats dont les tarifs ne sont pas accessibles à tous les citoyens.
Pour toutes ces raisons, il serait nécessaire de revoir le principe de l'aide juridictionnelle et de baisser des tarifs que les situations de rente ou de monopole rendent souvent excessifs, surtout dans de tels cas ! Une chose est de soulever la question de constitutionnalité au cours d'un procès, une autre est de déposer un dossier complet devant la Cour de cassation, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, sachant qu'ils ne doivent pas se prononcer sur le fond mais sur le sérieux de la requête.
Voilà, mes chers collègues, les conditions du succès d'une réforme que nous avons souhaitée, sur laquelle nous avons travaillé avec tous les parlementaires qui suivaient le dossier. Ce texte devrait tous nous rassembler. L'échec des projets de 1990 et 1993 donne incontestablement de la dimension à nos débats. Nous avons déjà essayé de donner ce droit à nos concitoyens, mais c'est la première fois que nous allons y parvenir, à l'unanimité espérons-le.
En tout état de cause, madame la garde des sceaux, les députés du Nouveau Centre apporteront leur plein et entier soutien à ce texte qu'ils souhaitaient de longue date. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

Je voudrais d'abord, pour une fois, me féliciter des conditions dans lesquelles ce texte vient en séance publique.
Le projet ayant été adopté par le conseil des ministres le 8 avril 2009 et mis à notre disposition dès le 15 avril, nous avons disposé de six mois pour travailler.
Qu'il est agréable de ne pas subir la pression de l'urgence et de pouvoir étudier le fond d'un dossier !
De surcroît, les auditions ayant été organisées suffisamment tôt avant la fin de la session ordinaire et la ministre entendue le 3 septembre, tous ceux qui voulaient se pencher sur cette délicate question ont eu le loisir de le faire.
C'est vrai, le sujet le méritait car il touche à la racine même de la chose juridictionnelle et porte des changements radicaux dans au moins deux dimensions, la logique organique du filtre et la logique procédurale du procès constitutionnel.
Le professeur Dominique Rousseau en a même déduit que cette réforme pourrait conduire à un « big bang » juridictionnel. Nous sommes bien loin du jugement du doyen Vedel pour qui, mais c'était en 1990, cette question, sans être un gadget, n'en était pas pour autant révolutionnaire.
En effet, alors que les juridictions ordinaires se refusaient à contrôler la constitutionnalité des lois, elles y sont désormais invitées par le mécanisme du filtre.
C'est par ce premier point que je voudrais débuter.
Dès lors que le justiciable n'a pas un accès direct au Conseil, la décision des juges ordinaires est la première pierre du nouvel édifice contentieux.
De ce fait, elle devient le moment où commence le contrôle de constitutionnalité.
De quelque manière que le filtrage soit présenté, deux opérations au moins conduisent nécessairement les juges à procéder à un premier examen de la constitutionnalité de la disposition discutée.
Certes, cet examen est incomplet, ou sommaire, mais il est néanmoins un examen de la constitutionnalité de la loi, pour lequel les juges judiciaires et administratifs se déclaraient jusqu'à présent régulièrement incompétents.
Ainsi, pour décider si la question soulevée n'a pas déjà reçu une réponse du Conseil constitutionnel par la voie du contrôle a priori, les juges devront étudier sa jurisprudence.
Dans l'hypothèse d'une contestation portant sur une même disposition, ils devront comparer si les arguments des requérants a posteriori sont identiques à ceux qu'avaient développé les requérant a priori...
En d'autres termes, il reviendra au juge ordinaire de déterminer les questions nouvelles de constitutionnalité.
Plus encore, pour décider si la contestation est manifestement fondée ou présente une difficulté sérieuse, les juges devront se livrer à une analyse de constitutionnalité, car le filtre n'est rien d'autre que cela.
Certes, la réforme ne cherche pas à ce qu'ils opèrent eux-mêmes le contrôle de constitutionnalité, sinon elle aurait mis en oeuvre un contrôle diffus, mais, et c'est là un point essentiel, les juges ne sont pas une simple boîte de transmission mais une instance où se forge un débat contradictoire.
Bien sûr, la sanction ne leur appartient pas.
Le contrôle de constitutionnalité proprement dit reste de la seule compétence du Conseil.
Mais un premier jugement de constitutionnalité aura été porté, déterminant, par ricochet, des changements profonds dans le comportement juridictionnel.
Pour cette raison avons-nous déposé un amendement qui vise à prévoir que les juges du fond se contentent d'une motivation « sommaire » plutôt que la « motivation détaillée » prévue par le texte.
Ainsi, parce qu'il est exercé successivement par le juge de base et par sa cour suprême, le filtrage de constitutionnalité est de nature à modifier les relations internes à chaque ordre juridictionnel.
Les divergences éventuelles de jurisprudence prendront une signification et une portée originale par l'enjeu qu'elles mettront en scène.
Un cas intéressant pourrait être celui où une cour suprême renvoie au Conseil une question prioritaire mais sur une argumentation distincte de celle utilisée par les juges du fond etou sur une disposition législative différente.
Sans doute le projet prévoit-il deux filtres, mais les nuances ne trompent personne: elles expriment seulement le souhait légitime de ménager les susceptibilités juridictionnelles.
Certes, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lors de son audition par notre commission en mai 2008, affirmait que « le filtre n'est pas un verrou ».
Pour autant, qui peut imaginer que le Conseil d'État et la Cour de cassation ne se bornent qu'à servir de courroie de transmission entre les juges du fond et le Conseil constitutionnel ?
Sans avoir une vision pessimiste qui pourrait conduire à une « guerre des juges », les illustrations du droit comparé démontrent plutôt la nocivité du filtrage par les juridictions suprêmes.
En l'espèce, le rôle qui leur est ici confié ouvre, comme l'écrit le professeur Bastien François, un risque d'arbitraire d'autant plus grave que leurs décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le filtrage a donc potentiellement des effets perturbateurs au sein de chaque ordre juridictionnel, effets qui se prolongent sur les relations avec le Conseil.
Aujourd'hui, les rapports entre le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation sont fondés sur la bonne entente.
Demain, avec le filtre, il y aura un lien organique entre les trois institutions.
D'un coté, la Cour de cassation et le Conseil d'État sont en position de force puisque le développement du contrôle de constitutionnalité a posteriori dépend de l'usage qu'elles feront du filtre et donc du nombre de questions prioritaires qu'elles accepteront de transmettre au Conseil constitutionnel.
Mais, de l'autre, une fois la question envoyée, la Cour de cassation et le Conseil d'État sont dans un position délicate puisque leur décision n'est pas souveraine mais soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, lequel apparaîtra toujours comme le résultat d'un contrôle sur l'appréciation de constitutionnalité portée par les cours saisissantes...
Pour cette raison, nous avons proposé en commission un amendement qui vise à atténuer le rôle des cours suprêmes.
Je regrette, à la réflexion, que le constituant n'ait pas retenu des suggestions qui m'apparaissent aujourd'hui plus pertinentes qu'au moment où nous les avons écartées.
Je pense à celle, avancée par le professeur Bertrand Mathieu au sein du comité Balladur, de créer, au sein du Conseil constitutionnel, une chambre des requêtes qui aurait assuré la fonction de filtre. Malheureusement, le texte de la Constitution est ainsi fait que nous ne pouvons plus y revenir.
La question prioritaire, et c'est mon second point, a aussi des conséquences pour le Conseil constitutionnel lui-même.
Avec le contrôle a priori, le contentieux de constitutionnalité était encastré dans la procédure d'élaboration de la loi. L'on a même pu parler du Conseil comme d'une « troisième chambre ».
Avec le contrôle a posteriori, le conseil constitutionnel s'enchâsse dans le contentieux général.
Lui qui n'avait pas une nature juridique très définie – le général de Gaulle n'avait pas voulu en faire un tribunal, il n'a d'ailleurs pas l'appellation de « cour » dans la Constitution et vous ne trouverez pas dans les articles de la Constitution de terme désignant les membres du Conseil constitutionnel comme des juges constitutionnels – devient aujourd'hui un tribunal.

Le comité Balladur, dans sa cohérence, avait mis en lumière que le Conseil était appelé à devenir une vraie juridiction. Il vient d'ailleurs de proclamer son « indépendance » dans une décision du 16 juillet 2008. La situation de ce conseil ne manquera pas d'évoluer, ne serait-ce que parce qu'il sera sous l'observation d'un certain nombre de juges internationaux.
Ce changement aura pour conséquence de soumettre le contentieux aux principes de l'impartialité du tribunal et aux exigences du procès équitable, comme l'a indiqué la cour de Strasbourg dans son arrêt Ruiz-Matéos en date du 23 juin 1993.
Il doit s'ensuivre une profonde transformation du Conseil constitutionnel, à commencer par le mode de nomination de ses membres, qui pourrait être considéré comme contraire aux exigences d'indépendance.
C'est la raison pour laquelle le rapport Balladur prônait la suppression de la présence de droit des anciens présidents de la République.

De même, pourra-t-on longtemps continuer à admettre que le dernier contrôle soit exercé par des personnes dont les textes n'exigent aucune compétence ni expérience juridique alors même que le premier examen de constitutionnalité des lois est exercé par un juge professionnel ?
En l'état, le Conseil constitutionnel est l'une des très rares cours constitutionnelles à n'imposer aucune exigence de qualification.
Ensuite, la procédure devra faire pleinement droit aux principes d'impartialité du tribunal et d'équité du procès, pour reprendre les mots du professeur Dominique Rousseau.
Certes, le débat contradictoire, au sein du Conseil, s'est progressivement organisé, sous l'influence du doyen Vedel et du président Badinter.
Mais il n'est pas codifié et ne répond pas encore à toutes les exigences du procès équitable.
Il en est ainsi de la place des parties à l'audience, qui sont censées ne pas exister dans le cadre du contrôle a priori mais qui devront être accueillies et entendues lors de l'examen par le Conseil d'une question prioritaire. Chacun le sait, et le président Debré l'a d'ailleurs évoqué lors d'un colloque sur la question de constitutionnalité avec les avocats aux Conseils le 19 juin dernier.
Cela concerne aussi l'ouverture du prétoire du Conseil à l'office des avocats, à l'oralité des débats ou à la publicité des audiences, même si la Cour de Strasbourg ne condamne pas toute absence d'audience publique devant le juge constitutionnel.
Enfin, le véritable changement pourrait concerner le pouvoir de décision du Conseil, qui ne se considère aujourd'hui lié ni par l'énumération des articles précisément contestés par les parlementaires, ni par les motifs articulés au fondement du recours.
S'il examine en priorité les dispositions critiquées, il rappelle, selon sa jurisprudence de 1996, que son contrôle «porte sur toutes les dispositions déférées y compris celles qui n'ont pas fait l'objet d'aucune critique de la part des auteurs de la saisine ».
Il n'est pas certain qu'il puisse maintenir cette position.
Même si l'affaire est portée devant le Conseil par une cour suprême, elle a été soulevée par une des parties au procès principal. Or, en matière civile au moins, « le procès est la chose des parties ».
Il serait alors logique que le Conseil ne s'aventure pas à contrôler autre chose que ce qu'on lui a demandé de vérifier.
Au demeurant, même s'il continue à statuer ultra petita ou à limiter son contrôle à la question précise, il va se trouver dans des situations inédites et difficiles. J'en ai retenu trois : celle où il jugerait que la disposition législative contestée ne commande pas l'issue du litige mais est contraire à la Constitution, celle où il estimerait que la difficulté sérieuse de constitutionnalité tient à d'autres motifs que ceux présentés dans la décision de renvoi, ou encore celle où il apprécierait qu'une disposition législative non contestée est contraire à la Constitution et commande l'issue du litige ou est contraire à la Constitution mais ne commande pas l'issue du litige.
Il devra encore décider si, dans ce contentieux, il n'a le choix qu'entre la déclaration de constitutionnalité et la déclaration d'inconstitutionnalité, ou s'il peut juger que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, sous réserve qu'elle soit, en l'espèce, appliquée de telle manière – hypothèse redoutable, qui ouvrira sans doute aux justiciables la possibilité de recours ultérieurs si le juge ordinaire ne respecte pas le mode d'application défini par le Conseil.
Cela créera également une logique de soumission progressive de la Cour de cassation et du Conseil d'État au Conseil Constitutionnel.
Comme je l'ai rappelé en commission, le succès d'un mécanisme constitutionnel, quel qu'il soit, tient moins, ou autant, à ses qualités propres qu'au moment et à l'état du jeu dans lequel il est introduit. Adoptée en 1958, en 1974 voire en 1989, la question préjudicielle de constitutionnalité se serait sans doute imposée tranquillement dans le paysage juridictionnel. Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, avait proposé d'introduire l'exception d'inconstitutionnalité le 3 mars 1989, c'est-à-dire à une époque où les arrêts Boisdet, Nicolo et Rothman n'avaient pas encore été rendus. Depuis lors, le Conseil d'État et la Cour de Cassation tiennent à leur contrôle de conventionnalité que le Conseil constitutionnel leur a malencontreusement abandonné depuis la jurisprudence IVG du 15 janvier 1975. Là réside la nouveauté de la situation juridique et là se joue en partie l'avenir de la question prioritaire de constitutionnalité.
En effet, elle n'a pas la même signification si elle intervient dans un champ contentieux où le contrôle de la loi par rapport aux traités n'est pas stabilisé – c'était encore le cas en 1989 – ou, au contraire, dans un champ où ce contrôle est régulièrement exercé par les juges ordinaires, comme c'est le cas depuis vingt ans.
Dans la première configuration, la question prioritaire avait sa place et son utilité. Dans la seconde, son intérêt se perd dans une concurrence improbable avec le contrôle de conventionnalité. En 2009, la chose se révèle – et révélera – plus difficile,…

…car elle dérange un champ juridictionnel bien structuré.
Nous confions au Conseil constitutionnel, dont la figure est pourtant si peu juridictionnelle, un pari, certes difficile, mais qui n'est pas impossible. Rendez-vous dans quelques années ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte – je le rappelle après d'autres – est le premier d'une série de lois organiques que le Gouvernement s'apprête à nous présenter afin de mettre en oeuvre des dispositifs qui, issus de la révision constitutionnelle de juillet 2008, demeurent toutefois à l'heure actuelle inapplicables.
C'est ainsi que ce texte sur les nouvelles modalités, a posteriori, du contrôle de constitutionnalité des lois prévoit les dispositifs nécessaires permettant enfin à nos concitoyens de bénéficier des avancées, certes imparfaites, que constituent le référendum d'initiative populaire, tant attendu, et le nouveau défenseur des droits.
Nous sommes sans doute d'autant plus nombreux à regretter que le Gouvernement ait jugé plus urgent d'imposer à l'Assemblée nationale une révision partisane de son règlement que de permettre une application rapide de ces mesures, que la commission a unanimement approuvé et salué le présent texte comme une avancée majeure de la démocratie et de l'État de droit en France.
Ce projet est loin d'être parfait : il doit être complété. Tel est l'objet du débat parlementaire. Les radicaux de gauche défendront des propositions en ce sens, notamment afin d'assurer que le texte couvre un maximum de droits et concerne un maximum de lois, y compris des lois antérieures à la Ve République.
Nous soutiendrons également d'autres propositions, notamment avec nos collègues du groupe SRC, afin de rendre ce nouveau droit pour nos concitoyens le plus complet et le plus opérationnel possible.
Sous réserve du sort qui sera réservé à nos propositions comme aux nouveaux amendements du Gouvernement, je ne peux que vous inviter, mes chers collègues, à suivre le vote unanime de la commission, ce que feront les radicaux de gauche s'ils obtiennent satisfaction sur certains points. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.)

Monsieur le rapporteur et président de la commission des lois, une fois n'est pas coutume : après Jean-Jacques Urvoas, je tiens, tant au nom du groupe SRC qu'en mon nom propre, à vous féliciter d'avoir créé les conditions favorables non seulement à l'étude de ce texte mais également à son approfondissement. Si je regrette de n'avoir pu participer aux travaux de la commission des lois, en raison d'une visite ministérielle dans ma circonscription, j'ai toutefois pris soin de lire attentivement le rapport ainsi que l'ensemble des auditions, lesquelles ont permis à tous les membres de la commission de se retrouver sur une version qui, au stade actuel, peut donner satisfaction. Je me dois également de souligner le travail important, accompli au nom des membres de notre groupe par Jean-Jacques Urvoas : le texte que nous discutons en porte la trace.
Je tiens, moi aussi, mais sur un registre plus second, en quelque sorte, à faire de la prospective, en soulignant les problèmes que ce projet de loi organique est susceptible de poser. N'en déplaise à ceux qui contestent cette qualification, le fait que le Conseil constitutionnel voie son rôle « juridictionnel » se renforcer nous amènera à nous poser certaines questions. Du reste, le secrétaire général du Conseil constitutionnel ayant évoqué, au cours de son audition devant la commission des lois, le « caractère juridictionnel » de la procédure, vous écrivez, monsieur le rapporteur, page 85 : « Il s'agira donc bien d'un procès, comportant un examen effectif du recours, des débats contradictoires et en principe publics, l'égalité des armes et un délai raisonnable de jugement ». Dans ces conditions, il faudra, comme l'a souligné Jean-Jacques Urvoas, que la procédure soit conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme.
Devenus des juges constitutionnels, les membres du Conseil constitutionnel ne devront pas pouvoir être suspectés de partialité. Ils devront être parfaitement indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas à la fois être juges et parties. Or le fait que le Conseil constitutionnel comporte des membres de droits qui ont été parties, puisque ce sont eux qui ont signé la promulgation des textes législatifs qui seront éventuellement déférés devant eux, ne sera pas sans poser des problèmes de plus en plus nombreux, ce que, du reste, je ne suis pas le premier à remarquer.
En effet, lors de la réforme constitutionnelle, le Sénat a longuement débattu de cette question et si celle-ci n'a pu faire l'objet d'un consensus en son sein, il n'en reste pas moins que des sénateurs appartenant à tous les groupes ont émis le souhait que les anciens présidents de la République ne soient plus membres de droit du Conseil constitutionnel, ce qui a entraîné l'adoption, à deux voix de majorité, d'un amendement en ce sens. Malheureusement, la majorité de l'Assemblée nationale est revenue sur cette disposition. Madame la garde des sceaux, une nouvelle réforme constitutionnelle sera donc nécessaire afin de modifier la composition du Conseil, réforme à laquelle il vaudrait mieux se préparer plutôt que de se la voir imposer à froid.
Pourquoi sommes-nous le seul pays démocratique au monde où les anciens chefs d'État sont membres de droit de cette cour juridictionnelle, et le sont, de plus, à vie, ce qui risque…

…de durer de plus en plus longtemps, compte tenu de la prolongation de la durée de la vie ? La raison, toute banale, en est matérielle. Le dernier Président de la IVe République, René Coty, s'est ainsi vu récompensé du rôle, connu de tous, qu'il a joué dans l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Il a, ce faisant, bénéficié d'une situation matérielle qui, autrement, n'aurait pas été la sienne, puisque, en vertu d'un texte d'avril 1955, un ancien Président de la République n'avait, et n'a toujours officiellement, pour seules ressources que le traitement d'un conseiller d'État – même pas celui d'un président de section et encore moins d'un vice-président de Conseil d'État ! Le fait de siéger au Conseil constitutionnel permettait d'améliorer sa situation financière.
Il s'agit donc là, madame la garde des sceaux, d'une situation tout à fait circonstancielle qui, depuis, a connu des modifications. Elle devra être revue du fait que si, aujourd'hui, le Président de la République dispose d'un traitement, fixé par la loi, tout à fait satisfaisant – je ne suis pas étranger à ces nouvelles dispositions –, en revanche, sa retraite est toujours fixée, je le répète, par un texte de 1955, qui n'a plus aucun rapport avec son traitement actuel.
Il conviendra d'autant plus de régler cette situation que le rythme du renouvellement des Présidents de la République s'accélère, ne serait-ce qu'en raison du raccourcissement du mandat présidentiel et du fait qu'un Président ne peut plus en effectuer que deux,…

…si bien que le nombre des anciens Présidents de la République, qui sont membres de droit, risque, un jour, de devenir plus élevé au sein du Conseil constitutionnel que celui des autres membres. Je rappellerai que cinq anciens présidents sont encore vivants aux États-Unis. Si nous arrivons un jour à une telle situation, le caractère juridictionnel du Conseil constitutionnel en sera modifié.
Afin de résoudre ce problème, il faut traiter une question qui peut paraître triviale. Toutefois, m'étant longuement battu pour améliorer la transparence du budget de la Présidence de la République – ce qui est le cas –, je pense qu'il ne suffit pas de s'en tenir à la question du traitement de Président de la République en exercice mais qu'il convient également d'envisager celle du traitement des anciens Présidents de la République. Je le répète : aujourd'hui, en dehors d'un texte de 1955, rien n'est prévu en matière de retraite des anciens Présidents de la République – rien, ou presque.
Je tiens en effet à rappeler la lettre du 8 janvier 1985 de Laurent Fabius, alors Premier ministre, une lettre que les services du Premier ministre qualifient de « décision » – en tout cas, même si elle n'a jamais été publiée, elle vaut décision. Inspirée par Michel Charasse, aujourd'hui sénateur, mais qui, à l'époque, travaillait beaucoup à l'Élysée, elle prévoit les avantages matériels alloués à un ancien Président de la République : « Outre une protection policière, les anciens Chefs de l'État disposent d'une voiture de fonction avec chauffeur, ainsi que de locaux, dont la maintenance et les charges sont assumées par l'État. Deux personnes sont affectées au service de ces locaux. Par ailleurs, l'État prend en charge sept collaborateurs permanents. Les dépenses de personnel sont supportées par les ministères mettant à disposition ces collaborateurs – intérieur, défense, finances, ministères sociaux. Ces derniers peuvent en outre se voir attribuer, comme les membres des cabinets ministériels, l'indemnité de sujétion particulière […]. Les services du Premier ministre prennent en charge le versement de cette indemnité – soit un montant total annuel de 230 000 euros –, ainsi que les dépenses de fonctionnement – 470 000 euros par an .»
Voilà les seuls éléments publics de réponse donnés à une question écrite que j'ai posée au Premier ministre. Il conviendrait d'aller au-delà, d'envisager sereinement de donner un nouveau statut aux anciens Présidents de la République. Je considère que lorsque l'on a quitté le palais de l'Élysée, on peut continuer à jouer un rôle politique important ; encore faut-il que la République, en toute transparence, offre aux anciens chefs de l'État les conditions matérielles et financières suffisantes pour cela. Voilà ce que je vous propose, madame la ministre, à titre de « prospective ».

La discussion générale est close.
La parole est à Mme la ministre d'État.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, laissez-moi vous dire ma satisfaction de ce débat court mais dense, traduisant bien la recherche d'un consensus et prolongeant le souci qui a prévalu en commission de trouver des solutions concrètes.
Je suis heureuse que la quasi-unanimité se soit faite sur ces bancs pour saluer l'avancée que constitue ce texte. Compte tenu des contraintes évoquées par les uns et les autres, ce souci d'unanimité implique que nous définissions ensemble les mesures techniques les plus pragmatiques afin de rendre le présent dispositif le plus efficace possible.
MM. Warsmann et Geoffroy ont insisté sur la sanction des délais. Le Gouvernement n'est pas insensible à cette préoccupation de la commission des lois. Reste que, même si une telle option a été évoquée, les travaux parlementaires portant sur la révision constitutionnelle ne confirment en rien que le constituant ait souhaité une sanction en cas de non-respect des délais impartis aux cours suprêmes. Ils ont même conclu à l'abandon de cette option. L'article 61-1 ne prévoit donc pas le dessaisissement automatique des cours suprêmes.
Une telle obligation pourrait poser un problème au regard des caractéristiques propres à chaque degré de juridiction. On ne demande pas la même chose au juge du fond, à la cour suprême et au Conseil constitutionnel. Du reste, concrètement, un dessaisissement automatique présenterait un véritable risque d'engorgement du Conseil constitutionnel, ce que personne ne souhaite.
En effet, monsieur Geoffroy, l'évocation de délais ne doit pas être prise comme un signe de suspicion à l'égard des juges. Néanmoins, on ne doit pas négliger les difficultés que peut présenter le dessaisissement automatique. Si l'on impose un délai au juge, on court toujours le risque qu'il attende le moment de son expiration pour se prononcer. Surtout – et je pense ici au juge du fond –, on court le risque que le juge laisse s'écouler ce délai s'il est embarrassé par la question, considérant qu'elle sera automatiquement transmise au niveau supérieur. Ce n'est pas là non plus ce que nous souhaitons.
Nous devrons, au cours de la discussion sur les amendements, répondre à ce double besoin : éviter l'allongement des procédures – nous souhaitons qu'une réponse, en matière de constitutionnalité, puisse être donnée pendant le déroulement de la procédure sur le fond – ; éviter ensuite l'engorgement du Conseil constitutionnel et une certaine déresponsabilisation éventuellement souhaitée par certaines juridictions.
Quant au filtrage des questions de constitutionnalité, il est prévu par l'article 61-1 de la Constitution lui-même. Il vise bien, notamment, à éviter l'encombrement du Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, doit en outre se prononcer sur les lois dont il a été récemment saisi – et nous savons tous qu'il y en a un certain nombre. Les dispositions relatives à ce filtrage me paraissent très pertinentes : le juge saisi en première instance doit vérifier si la question de constitutionnalité affecte ou non la solution du problème qui lui est soumis ; on demande ensuite à la cour suprême d'examiner la pertinence des arguments avancés ; enfin, il revient au Conseil constitutionnel de statuer avec une conséquence lourde : s'il conclut à l'inconstitutionnalité, la loi censurée sort du dispositif législatif.
Nous devons donc garder à l'esprit ces différentes exigences qui méritent d'être aménagées sur certains points pour éviter l'allongement des procédures, pour ne pas mettre en cause la « spécialisation » des différents niveaux de juridiction et pour éviter l'encombrement des cours suprêmes.
Puisque je viens d'y répondre, je ne reviens donc pas sur ces questions soulevées par M. Braouezec.
Dans mon propos introductif, j'ai déjà évoqué la question de la priorité entre le moyen soulevé de non-conformité aux règles internationales et le moyen d'inconstitutionnalité. Je rappelle que les parties ont le choix de n'invoquer que l'exception de contradiction avec la loi internationale, auquel cas on n'examine pas la question d'inconstitutionnalité. En revanche, si les parties décident d'évoquer d'abord l'inconstitutionnalité, il n'y a plus aucune raison de soulever l'exception de contradiction avec la loi internationale.
Je vous ai déjà en bonne partie répondu, monsieur Lagarde, en vous confirmant que le Gouvernement souhaite une procédure rapide, ou du moins vise à éviter toute manoeuvre dilatoire, d'autant que les procédures sont déjà trop longues – nous nous entretiendrons d'ailleurs prochainement sur le fait de savoir comment accélérer les procédures civiles.
Il ne faut pas non plus sacrifier l'efficacité du filtre que nous entendons mettre en place. Il s'agit donc de trouver un équilibre.
J'insiste, monsieur Urvoas : le filtrage n'a pas pour but de donner au juge du fond l'occasion de statuer sur la constitutionnalité de la loi. Chacun doit rester à sa place. Le premier juge doit simplement écarter les questions fantaisistes ou dilatoires en se demandant si la question de constitutionnalité a un rapport avec le problème de droit soulevé devant lui. La cour suprême concernée doit, pour sa part, au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, vérifier l'éventuelle pertinence des arguments dénonçant l'inconstitutionnalité. Enfin, seul le Conseil constitutionnel, fort de son autorité, se prononce sur le fond de la constitutionnalité.
Le système proposé respecte donc bien la spécialisation des juridictions. Le Conseil constitutionnel se l'applique du reste à lui-même puisqu'il ne jugera pas le fond de l'instance en cours, mais se contentera de vérifier la constitutionnalité de la loi applicable.
Vous avez également évoqué, monsieur Urvoas, la nature juridique du Conseil constitutionnel. Je n'aborderai pas ce débat qui n'est pas celui d'aujourd'hui.
Je vous rappelle simplement, comme je crois l'avoir déjà fait en commission, que le Conseil constitutionnel agit d'ores et déjà comme une juridiction, notamment en matière de contentieux électoral. Si ce n'est qu'une partie de son activité, elle n'en existe pas moins.
Monsieur Charasse, vous avez demandé si le contrôle du juge constitutionnel portera sur toute la législation. Je réponds par l'affirmative, d'autant que notre loi constitutionnelle a elle-même évolué. Ainsi, des lois qui n'ont pas été soumises au Conseil constitutionnel peuvent se révéler inconstitutionnelles, de même que des textes dont le Conseil constitutionnel aurait reconnu la constitutionnalité avant l'adoption de nouvelles dispositions constitutionnelles – combien de fois avons-nous modifié la Constitution ces dernières années, au point que j'ai pu parfois le regretter ?
Je laisserai de côté, vous le comprendrez, monsieur Dosière, tout ce qui touche au statut des Présidents de la République,…
…sujet qui me paraît quelque peu décalé par rapport à la présente discussion.
Pour le reste, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel statue comme une juridiction en certains domaines et que l'éventuel manque d'impartialité, selon vous, de certains de ses membres, est une question qui pourrait se poser aujourd'hui pour le Conseil d'État,…
…à la fois parce que le Conseil d'État est amené à juger des textes sur lesquels il a donné son avis – nous avons d'ailleurs trouvé des moyens pour l'éviter – et parce que certains de ses membres ont pu appartenir à des cabinets ministériels et, à ce titre, examiner ou participer à la rédaction de certains textes sur lesquels on leur demande aujourd'hui de se prononcer.
Aussi, quand on avance certains arguments, convient-il les mettre en perspective.
Et je reste persuadée que vous ne nourrissez pas la moindre suspicion ni vis-à-vis des membres du Conseil d'État ni, par conséquent, à l'encontre des membres du Conseil constitutionnel. (Vifs applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Avant de passer à l'examen des articles, je vais suspendre la séance pour quelques instants.
Discussion générale

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures.)

J'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi.

Je suis saisie de trois amendements portant articles additionnels avant l'article 1er.
La parole est à M. René Dosière, pour soutenir l'amendement n° 10.

L'objet de cet amendement est de poser le principe de la publication des opinions séparées. Si celles-ci permettent à leurs auteurs éventuels d'expliquer à leurs collègues les raisons de leur dissentiment, elles ont également pour finalité de les exposer au public. Leur avènement au Conseil constitutionnel permettrait de parfaire sa juridictionnalisation amorcée il y a trente ans. La décision fondatrice du 16 juillet 1971, l'ouverture de la saisine aux parlementaires en 1974, la publication au Journal officiel des lettres de saisine en 1986, de même que les observations du Gouvernement à partir de 1994, la publicité des mémoires en défense de la loi en 1994, la mention au bas de chaque décision des noms des juges ayant siégé et délibéré en 1995, ou encore la création de la fonction de greffier pour le contentieux constitutionnel, sont autant de signes de juridictionnalisation d'une instance qui au départ n'était qu'un « conseil » et non une « cour », chaque président ayant apporté une pierre à l'édifice.
De plus, la pratique étrangère – la France étant l'un des rares pays à ne pas encore autoriser les opinions séparées – démontre les vertus pédagogiques de ces dernières, puisqu'elles permettent de rendre les décisions majoritaires davantage compréhensibles, tant pour le lecteur néophyte que pour le commentateur averti.
La création de cette possibilité n'étant pas incompatible avec le secret des délibérations, il s'agit pour le législateur organique de compléter plutôt que de modifier l'ordonnance sur ce point. Cependant, l'obligation pour les membres du Conseil constitutionnel de ne prendre aucune position publique sur sa jurisprudence n'a plus lieu d'être.

Avis hélas défavorable. Nous n'avons pas été convaincus, madame la présidente. Ce n'est pas la tradition du droit français que de publier les opinions séparées lorsque la décision est collégiale.
Je ne crois pas non plus que cela soit de nature à renforcer l'autorité d'une décision que de publier telle ou telle opinion minoritaire ou divergente.
Au-delà des arguments que vient d'exposer le président de la commission et rapporteur, je voudrais souligner que la disposition proposée concerne le fonctionnement général du Conseil constitutionnel, qui n'est pas l'objet de la présente loi.
(L'amendement n° 10 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 11.
La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas.

Je voudrais à mon tour me lancer dans un plaidoyer pour l'opinion séparée. La répétition étant la base de la pédagogie, nous finirons bien, un jour ou l'autre, par convaincre le législateur.
Je crois que nous partageons ici une conception du droit selon laquelle celui-ci n'est pas un dogme révélé, inaccessible à la raison. J'entends l'argument du rapporteur estimant que ce n'est pas la tradition française que de publier les opinions que l'on appelle aujourd'hui séparées, que l'on a parfois appelées dissidentes – mais ce terme était assez impropre, puisque ces opinions peuvent proposer des motivations différentes pour fonder un jugement identique. C'est vrai que cela n'appartient pas à la tradition française. Mais jusqu'en 1958, le contrôle de constitutionnalité n'appartenait pas non plus à notre tradition, alors qu'il est aujourd'hui formidablement accepté. Il devient même une référence puisque ce modèle a priori, et maintenant a posteriori, nous l'exportons dans différents pays. L'argument du changement est donc au moins aussi pertinent que celui de la tradition.
En outre, la publication des opinions séparées n'est pas destinée à fragiliser quoi que ce soit. La force d'une décision du Conseil constitutionnel ne repose pas sur le nombre de voix. Elle tient d'abord au fait que c'est le Conseil constitutionnel qui l'a prise – et à soi seul, cela devrait suffire –, et, ensuite, à la qualité de l'argumentation juridique qui a été développée et qui a convaincu un nombre suffisant de membres du Conseil. Par définition, l'opinion séparée est d'ailleurs minoritaire.
Le but n'est donc pas de perturber l'équilibre d'un édifice qui a mis quelques années à se stabiliser. Le but est d'éclairer les collègues du Conseil constitutionnel, et, au-delà d'eux, l'ensemble des observateurs de la doctrine, sur des arguments qui ont été avancés sans être retenus. C'est important, parce que, demain, la jurisprudence peut évoluer. Et cela sera profitable à tout le monde.
Il est de notoriété publique, je le redis, que certains membres du Conseil constitutionnel semblent aujourd'hui avoir été convaincus. Le Conseil est d'ailleurs allé en Espagne pour voir comment fonctionnait l'opinion séparée dans le tribunal espagnol. Que ce soit dans un proche avenir ou dans quelque temps, la publication des opinions séparées sera décidée de manière prétorienne. Il serait plus normal que le législateur organique la codifie.

Monsieur Urvoas, je vous ai laissé défendre cet amendement n° 11 que vous aviez vous-même qualifié d'amendement de cohérence. Puis-je considérer que vous venez de défendre en même temps l'amendement n° 12 ?

La pédagogie étant l'art de répéter la même chose, je réitère mon avis défavorable.
Défavorable, pour les motifs que j'ai déjà développés.
(Les amendements nos 11 et 12, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)

Nous en venons à l'examen de l'article 1er.
Je suis saisie d'un amendement n° 14.
La parole est à M. Gérard Charasse.

Si l'article 61-1 est novateur dans notre ordonnancement juridique, cet amendement à l'article 1er de la présente loi organique a pour principal objet d'approfondir l'avancée souhaitée par le constituant du 23 juillet 2008.
Il s'agit de ne plus enfermer la protection des droits et libertés dans le carcan du texte constitutionnel stricto sensu, mais de l'étendre aux objectifs à valeur constitutionnelle mis en exergue par la jurisprudence de nos cours suprêmes.
Tel qu'il est rédigé, le texte de l'article 1er ne concerne que celles des dispositions de fond relatives aux droits et libertés qui sont contenues dans le texte de la Constitution. Cela est certes déjà important, étant entendu que cela exclut du champ d'application du recours les dispositions relatives aux questions de procédure et de compétence, mais pourquoi ne pas étendre ce champ aux objectifs à valeur constitutionnelle, qui, rappelons-le, concernent notamment la sauvegarde de l'ordre public, la préservation du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, la bonne administration de la justice ou encore le droit de disposer d'un logement décent ?

Avis défavorable. D'abord, les droits et libertés dont il est question sont ceux qui sont garantis par le texte constitutionnel. Nous sommes donc dans la lignée exacte d'une loi organique qui applique une disposition constitutionnelle.
Ensuite, ce n'est pas ici le lieu de paraître discuter le bloc de constitutionnalité, lequel est défini par le Conseil constitutionnel au fur et à mesure de sa jurisprudence.
Troisièmement, si votre amendement répond à une inquiétude quant à la portée du texte, je voudrais vous rassurer, monsieur Charasse. Lors des auditions, nous avons très souvent demandé aux personnes entendues quelles avancées, selon elles, ce projet de loi organique permettrait. La quasi-totalité de nos interlocuteurs ont déclaré qu'à leur avis, l'ouverture de cette nouvelle voie permettra d'aller plus loin que le contrôle de constitutionnalité actuel dans la protection d'un certain nombre de droits et de libertés, ou contribuera à accroître la force de certains principes posés par le Conseil constitutionnel, par exemple en matière d'égalité.
Le texte qui nous est proposé n'est pas vide. Il est fidèle à la Constitution. En outre, je crains qu'un tel amendement ne nous entraîne sur un terrain qui n'est pas le nôtre.
Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
Il est clairement dans l'intention du constituant de permettre au justiciable d'évoquer les principes constitutionnels qui sont inclus dans le bloc de constitutionnalité. L'amendement est donc satisfait. C'est la raison pour laquelle j'émettrais un avis défavorable s'il n'était pas retiré.

Non, je le maintiens, madame la présidente.
(L'amendement n° 14 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 13.
La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas.

Le caractère très lapidaire de cet amendement masque son importance. C'est un débat que nous avons eu longuement en commission. J'avoue ne pas avoir été totalement convaincu par les arguments du rapporteur et je voudrais donc à nouveau essayer de préciser la pensée du groupe SRC en la matière.
En l'état, le texte ne précise pas si l'examen serait justifié par un changement de circonstances de droit ou de fait. Je comprends bien qu'il vise l'hypothèse dans laquelle une réforme constitutionnelle serait intervenue entre-temps, avec pour effet d'accroître la liste des droits et libertés qui auraient une valeur constitutionnelle. On songe par exemple aux griefs d'inconstitutionnalité qui pourraient être formulés sur le fondement de la Charte de l'environnement à l'encontre de textes examinés antérieurement à son insertion dans la Constitution.
Mais un changement de jurisprudence de la part du Conseil constitutionnel – et il y en a beaucoup – constitue-t-il un « changement de circonstances » ?
En est-il de même du changement dans l'interprétation de la loi par le juge ordinaire ?
En réalité, il me semble que cette condition renvoie à la question de l'office même du Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a posteriori. La question fondamentale sera de savoir si le Conseil constitutionnel sera le juge de la loi ou de l'application de la loi.
De plus, le changement de circonstances sera apprécié d'abord par le juge du fond, puisqu'il sera chargé du contrôle de la recevabilité de la demande.
Pour des raisons qui tiennent, d'une part, à l'autorité des décisions du Conseil, et, d'autre part, au respect de la compétence du législateur, c'est à ce dernier, et non pas au juge, qu'il revient d'adapter la loi aux circonstances.
Dès lors, la dérogation ne devrait concerner que les changements de circonstances de droit, en particulier le changement du texte constitutionnel, et non le changement de circonstances de fait.
C'est l'objet de cet amendement, qui nous semble d'autant plus justifié qu'il y a un risque, s'il n'était pas adopté, que cette condition devienne purement formelle, et que les décisions du Conseil constitutionnel soient alors systématiquement remises en cause, puisque les circonstances de fait ne seront évidemment jamais les mêmes, monsieur le rapporteur.

Avis défavorable. Le texte présenté par le Gouvernement prévoit que le Conseil constitutionnel peut s'appuyer sur tout changement de circonstances. La commission a jugé que cette rédaction était bonne. En effet, il n'y a pas que des changements de circonstances de droit. Exemple : dans sa décision du 8 janvier 2009 relative au redécoupage électoral, le Conseil constitutionnel considère qu'il est contraire à la Constitution de maintenir un minimum de deux députés par département. Il fonde sa décision sur un changement de droit, à savoir le fait que la révision constitutionnelle a fixé un maximum de députés – 577 –, et sur un changement de fait, à savoir l'augmentation de la population française.
Deuxième exemple : la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi HADOPI. Évidemment, les conséquences qu'il va tirer de la liberté de communication figurant à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme sont différentes à partir du moment où Internet est généralisé à la société. Voilà un exemple très concret d'une modification qui n'est pas juridique, puisqu'il s'agit de la démocratisation d'un outil scientifique, mais qui conduit à tirer des conséquences différentes d'un principe constitutionnel posé à une époque où l'on n'imaginait même pas l'existence de cet outil.
Troisièmement, le fait de s'en tenir aux seuls changements de circonstances de droit conduirait le Conseil constitutionnel à examiner la constitutionnalité de manière différente selon qu'il est saisi par soixante parlementaires ou par un citoyen. Il faut maintenir l'unité des modes de travail du Conseil constitutionnel.
La souplesse de la rédaction actuelle est utile, comme je l'ai montré avec ces exemples, à un bon fonctionnement du contrôle de constitutionnalité.
Avis défavorable, pour les raisons excellemment développées par le rapporteur et président de la commission.
(L'amendement n° 13 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 20.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans la présentation générale, c'est aux cours suprêmes qu'il revient de jouer le rôle de filtre voulu par la Constitution, de façon à ce que le Conseil constitutionnel ne soit pas surchargé de questions accessoires. Il est évident – et je réponds à ce qui vient d'être dit à l'instant – que les juges du fond ne sont pas en mesure d'opérer un tel contrôle. Il leur appartient simplement d'écarter des questions fantaisistes, dilatoires ou dépourvues de consistance. Je pense qu'on les mettrait en difficulté en leur demandant d'aller plus loin et d'apprécier la pertinence des questions, qui plus est dans des délais relativement brefs.
Cette répartition des rôles entre juridictions et cours suprêmes me semble être le gage du bon fonctionnement et de l'équilibre du système.

La commission et le Gouvernement ont suivi deux logiques différentes. Pour la commission, il semblait cohérent d'avoir les mêmes critères pour la juridiction du fond et pour la juridiction suprême – Conseil d'État ou Cour de cassation – et de demander aux deux de vérifier si la question était nouvelle ou présentait un caractère sérieux. Cela nous semblait d'un fonctionnement simple, d'autant que nous savions que dans des pays étrangers le choix de critères différents s'était soldé par un échec. En outre, nous ne doutions pas que, très vite, le Conseil d'État et la Cour de cassation mettraient en place leur propre jurisprudence, sur laquelle les juges du fond s'appuieraient.
Le Gouvernement nous propose de revenir à un mécanisme « en entonnoir » : le juge du fond procédera à une évaluation large – sur le caractère sérieux ou non de la question –, tandis que le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononceront sur le fait de savoir si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. On part ainsi sur une base assez large pour resserrer ensuite.
Les logiques sont donc différentes mais le débat me semble très secondaire par rapport à celui, essentiel, que nous aurons tout à l'heure s'agissant des délais. Je veux bien que l'Assemblée se rallie au dispositif du Gouvernement…

Je voudrais défendre, au nom du groupe SRC, la position qui avait été adoptée en commission.
Je ne trouve pas que la rédaction du Gouvernement apporte une simplification. Selon vous, madame la garde des sceaux, il ne faut pas que les juges fassent un contrôle de constitutionnalité, ou, le cas échéant, il faut qu'ils le fassent a minima. Or en supprimant l'élément de précision – le caractère nouveau ou non de la question – qui permettrait de le restreindre, vous tendez plutôt à l'élargir. Je pense donc que votre objectif n'est pas atteint.
En outre, vous prétendez que cette rédaction éviterait aux juges d'avoir à faire un contrôle de constitutionnalité, mais vous ne la maintenez pas pour le Conseil d'État.
Bien sûr ! Ce ne sont pas les mêmes juridictions.

À l'amendement n° 21, en effet, vous reviendrez à la rédaction de la commission. Si vous proposez une rédaction en vue de simplifier le contrôle en première instance, pourquoi permettez-vous au Conseil d'État d'aller vers le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire de faire l'inverse de ce que vous souhaitez ?
(L'amendement n° 20 est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 24.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Il s'agit de revenir au texte initial présenté par le Gouvernement pour éviter d'avoir un système de saisine automatique ou quasi automatique lorsque la juridiction ne s'est pas prononcée dans le délai.
Je ne nie pas qu'il y ait une certaine logique à prévoir, au-delà d'une simple incitation, une sanction en cas de non-respect du délai fixé. Si je peux tout à fait le comprendre, je réfléchis cependant aussi à d'éventuelles conséquences négatives. J'en vois de deux types, qui vont à l'encontre de notre souci à la fois d'éviter les mesures dilatoires et de mettre en place un filtre efficace.
D'abord, le juge du fond peut parfois être embarrassé. Devant des questions qu'il n'a pas l'habitude d'examiner, il peut hésiter à se prononcer et attendre le dernier moment, voire ne pas se prononcer du tout puisqu'un autre s'en occupera, et « laisser filer ». Dès lors, au lieu du gain de rapidité recherché, on aura un allongement des délais par une incitation à aller jusqu'à leur terme, si ce n'est au-delà.
Ensuite, dans un tel système, si ces pratiques se généralisent, le filtre de premier niveau censé éviter l'encombrement du Conseil constitutionnel ne jouera plus, et l'encombrement touchera d'abord les cours suprêmes, puisque le Conseil d'État et la Cour de cassation recevront tout, comme s'il n'y avait pas de filtre. Et l'afflux sera encore supérieur auprès du Conseil constitutionnel.
D'un point de vue technique et pratique, je vois un véritable risque et j'ai envie de vous dire : attention !

La commission n'a pas été saisie de cet amendement déposé tardivement. À titre personnel, j'y suis défavorable : il est complètement étranger au travail de la commission.

Depuis le début, nous disons notre crainte qu'en ouvrant un nouveau droit pour nos concitoyens, on ouvre une possibilité de manoeuvre dilatoire dans les procédures judiciaires, par exemple, devant un tribunal, en saisissant le juge au dernier moment d'une question de constitutionnalité de la loi. Au premier niveau – tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance, conseils de prud'hommes, tribunaux de commerce –, les juges ne sont pas tous des juges professionnels. C'est pourquoi nous avons introduit un délai. Nous demandons que ce juge transmette au niveau supérieur, c'est-à-dire à la cour suprême – Cour de cassation ou Conseil d'État –, dans un délai de deux mois. Nous ne voulons pas, si le juge hésite à prendre une position parce qu'il n'est pas spécialiste de la matière constitutionnelle, qu'il mette son coude sur le dossier et le retienne cinq mois, six mois, huit mois ou dix mois dans la juridiction.
L'économie du système est très simple : le juge du fond a deux mois pour rendre son avis ; s'il ne l'a pas fait, il est en quelque sorte dessaisi, et c'est l'une des parties qui peut transmettre au niveau supérieur, et ce dans un délai d'un mois. Ainsi, en trois mois, c'est fini.
En résumé, le dispositif a trois niveaux : au premier étage de la fusée, le juge du fond est saisi pour une durée de trois mois maximum ; au deuxième étage, le Conseil d'État ou la Cour de cassation ont trois mois pour prendre position ; au bout de trois mois, le dossier monte directement au Conseil constitutionnel. Celui-ci est donc forcément saisi au bout de six mois. Le Gouvernement lui ayant également fixé un délai de trois mois, on peut donc attendre une décision au bout de neuf mois. C'est déjà long ! C'est pourquoi il nous semble indispensable de poser des verrous, des jalons. Nous y tenons beaucoup pour l'équilibre de la procédure.
Je ne souhaite pas, dans quatre ou cinq ans, nous voir accusés, nous qui avons voté l'exception d'inconstitutionnalité, d'avoir mis en place un nouvel outil de retardement des procédures en France. Je ne souhaite pas qu'on nous le dise à chaque procédure impliquant un justiciable qui a des moyens – par exemple une société pétrolière, pour citer au hasard !
Il me semble que nous avons trouvé un bon équilibre pour atteindre nos objectifs.

C'est un débat important, mais on ne peut pas parler d'opposition entre le Gouvernement et la commission.

Il y a deux logiques qui peuvent se recouper mais qui sont, malgré tout, assez distinctes, entre le texte de départ et celui auquel est arrivée la commission.
En adoptant l'amendement n° 20, nous avons pris acte que son exposé des motifs insistait beaucoup sur la nécessité de tenir des délais brefs pour la prise en compte à la fois dans la juridiction de première instance et dans la juridiction qui transmet in fine au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Il y a, me semble-t-il, une vraie cohérence à être très précis sur les délais par rapport à ce que nous venons de voter.
J'ajoute un autre élément, probablement plus décisif que le premier. Lorsque notre assemblée s'est penchée sur la révision constitutionnelle, lorsqu'elle a étudié ce projet de nouvel article 61-1, elle a voulu aller plus dans le détail que le texte initial ne le prévoyait, notamment en termes de délais. Le Gouvernement nous avait alors répondu : cette question des délais est essentielle, mais elle ne relève pas du texte constitutionnel en lui-même et il vaudrait mieux que ces dispositions soient incluses dans la loi organique. Eh bien, nous y sommes !
Pour ces deux raisons, sans vouloir, en aucune manière, nous mettre en opposition ou en contradiction avec le Gouvernement, je recommande que nous suivions l'avis très sage et expert de la commission.

Une fois n'est pas coutume, je voudrais soutenir aussi le président de la commission, dont nous partageons le souci de célérité du procès constitutionnel. Ce débat, nous l'avions eu au moment de la révision de la Constitution, exactement dans les mêmes termes, et la commission des lois de l'Assemblée nationale avait souhaité intégrer cet élément dans le texte constitutionnel. Il nous avait été répondu, probablement à bon droit, d'ailleurs, ce que vient de dire notre collègue Geoffroy : l'argument est bon, mais mieux vaut inscrire cette disposition dans la loi organique que dans la Constitution. Aujourd'hui, on nous refuse de la mettre dans la loi organique. Or je rappelle qu'il n'y aura pas de loi ordinaire. C'est maintenant ou jamais !
J'entends bien qu'il est probable que les délais que nous mettons gênent des membres du Conseil d'État, qui manifestement ont mis du temps à réagir. Ce n'est pas le problème de la représentation nationale ! Je souhaite que nous nous en tenions au texte tel qu'il existe.
(L'amendement n° 24 n'est pas adopté.)

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
Je suis saisie d'un amendement n° 21.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 20 précédemment voté. Après discussion avec le président de la commission, il convient d'y apporter une rectification et de lire : « et que la question soulevée est nouvelle ou présente un caractère sérieux ».

Le rapporteur a déjà exprimé l'avis favorable de la commission.
(L'amendement n° 21 rectifié est adopté.)

Il s'agit d'un amendement de précision.
Le justiciable pour lequel nous écrivons la loi doit connaître le champ d'application matériel et temporel de la nouvelle procédure. Il est très important de savoir si la procédure peut être engagée pour une loi qui a été votée avant la Constitution.

Je comprends les objectifs des auteurs de l'amendement, mais ils ont satisfaction par la révision constitutionnelle même, parce que nous avons supprimé la différence faite entre les textes d'avant et d'après 1958.
Aussi, dans le cas où nos collègues maintiendraient cet amendement, je serais obligé de donner un avis défavorable pour l'unique raison qu'il est inutile.

Je suis saisie d'un amendement n° 22.
La parole est à Mme la ministre d'État.
Il s'agit d'un amendement de coordination, qui, comme le précédent amendement déposé par le Gouvernement, tire les conséquences de la modification des critères de renvoi par le juge premier saisi.

Madame la ministre d'État, ne faudrait-il pas tenir compte de la rectification apportée à l'amendement n° 21 ?
En effet. Il faut apporter ici la même rectification.

Je suis saisie d'un amendement n° 2.
La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas.

Les dispositions précisant la nature et la composition de la formation spéciale de la Cour de cassation rendant un arrêt relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne nous semblent pas de nature organique, mais relever de la loi ordinaire, comme le professeur Mathieu l'avait indiqué lors de son audition.
Nous proposons de supprimer les alinéas 31 à 33 de l'article 1er. Il est en effet important que le législateur ordinaire reste compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement des tribunaux, compétence qui se déduit in fine de l'article 34 de la Constitution.
En outre, l'argumentation développée par notre collègue Geoffroy en commission peut être aisément contournée, puisque la création d'un organe spécialisé au sein de la Cour de cassation n'est aucunement commandée par l'article 61-1 de la Constitution, et elle n'est d'ailleurs pas nécessaire, comme l'a souligné encore le professeur Mathieu. Cette situation n'est pas cohérente, car elle conduirait à créer des sections spécialisées pour l'application du contrôle de conventionnalité.

La commission était défavorable parce que ce type d'organisation et de formation est classique au sein de la Cour de cassation. Elle existe déjà lorsque la Cour doit donner des avis en matière autre que pénale.
Je ne dis pas que l'argument selon lequel la disposition ne serait pas de nature organique n'a pas de portée. Mais il n'est pas décisif, puisqu'il revient au Conseil constitutionnel d'apprécier en tout état de cause ce point.
La Cour de cassation souhaite avoir cette formation pour obtenir plus de rapidité et une cohérence au niveau de la jurisprudence.
Il s'agit bien d'une disposition qui détermine les conditions d'application de la loi constitutionnelle. Elle relève donc tout à fait de la loi organique. Vous avez d'ailleurs vous-même relevé tout à l'heure, monsieur Urvoas, qu'il n'y aurait pas d'autre loi.
(L'amendement n° 2 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 3.
La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas.

La décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie une question au Conseil constitutionnel n'a pas besoin d'être motivée : le renvoi suffit à attester que, aux yeux de la juridiction suprême contestée, les conditions énoncées par la loi organique sont réunies. Il n'y a donc aucune nécessité, ni même utilité, d'en dire plus.
En revanche, si la décision est de refuser le renvoi, il semble à la fois légitime et utile que le justiciable sache, au moins sommairement, quelle condition n'était pas présente là où, par hypothèse, il s'était trouvé au moins un juge d'un niveau inférieur pour penser le contraire.
Nous touchons, me semble-t-il, au coeur de la faille du dispositif imaginé, dont je souligne au demeurant qu'il n'existe nulle part ailleurs – sans doute est-ce une manifestation du génie français en matière constitutionnelle, où nous inventons des choses que les autres ne sont pas parvenus à faire !
Il existe pour nous un risque que ce double filtre tue cette nouvelle procédure avant même qu'elle puisse montrer son utilité. Nous pensons utile d'encadrer le rôle des cours. Le Conseil d'État et la Cour de cassation devraient se limiter à un rôle d'enregistrement, pour éviter les saisines un peu fantaisistes.
Dans l'état du texte, en appréciant ainsi la légalité de la disposition législative incriminée et indépendamment du problème d'une éventuelle contrariété avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les cours vont ainsi opérer un pré-contrôle de constitutionnalité. Le mécanisme de la question prioritaire risque d'être pris dans un tunnel juridictionnel et de s'en trouver singulièrement ralenti.
Chacun sait que l'on peut craindre que le Conseil d'État, notamment, ne considère trop souvent que la question n'est pas assez importante ou assez sérieuse pour mériter un renvoi devant le Conseil constitutionnel. Comme il n'est plus question de revenir sur ce point, qu'au moins les cours se limitent à une décision sommairement motivée !

La commission a émis un avis défavorable. En France, le principe général est la motivation des décisions. Nous souhaitons donc que ce principe s'applique en la matière.
L'informatique permet maintenant, lorsqu'il y a des motivations très répétitives, de gérer les choses de manière assez simple administrativement. Le principe des décisions motivées nous semble devoir être maintenu et il doit s'agir de décisions normalement et non sommairement motivées.
Même avis.

Je voudrais vous faire remarquer, madame la garde des sceaux, que notre amendement est tout à fait dans l'esprit de ce que vous avez défendu lors de votre intervention, à savoir que le contrôle de constitutionnalité doit rester au Conseil constitutionnel et que les cours ne doivent pas trop entrer dans le détail de constitutionnalité. En demandant que leurs décisions ne soient pas trop explicitement motivées, nous répondons bien à ce souhait. En revanche, si la Cour de cassation et, notamment, le Conseil d'État veulent essayer d'entrer dans toute une série de justifications, nous risquons de les inciter au contraire à s'engager dans le contrôle de constitutionnalité – ce que vous voulez éviter.
(L'amendement n° 3 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 23.
La parole est à Mme la ministre d'État.
L'amendement n° 23 vise à revenir au texte primitif. Nous revenons là à la question de ce qu'il adviendra si les délais ne sont pas respectés, mais je ne vais pas répéter l'argumentation que j'ai développée tout à l'heure. S'agissant des cours suprêmes, je voudrais simplement vous faire remarquer que jamais ne se sont posés des problèmes de non-respect des délais, notamment pour le Conseil d'État, lorsqu'il est saisi de demandes d'avis sur des textes gouvernementaux. Il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment pour la Cour de cassation.
Je pense que le souci d'accélérer la procédure sera respecté par les cours suprêmes. Comme il n'y a pas de sanction pour non-respect des délais lorsque le Gouvernement consulte le Conseil d'État, le parallélisme des formes me conduit à dire qu'il serait aussi bien que nous gardions la même position pour l'ensemble des actions de ce type.

J'ai évoqué tout à l'heure les trois étages de la fusée. Nous sommes ici au deuxième étage. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Au cas où les délais ne seraient pas respectés, on montera à l'étage supérieur.
Lors de son audition, le secrétaire général du Conseil constitutionnel indiquait que tout laisse à penser que le délai de trois mois sera respecté. Néanmoins, quelle serait la sanction dans le cas contraire ? Le constituant semble avoir expressément donné la réponse à l'article 61-1 de la Constitution, qui impose que ces juridictions se prononcent dans un délai déterminé.
Cette précision ajoutée par un amendement parlementaire implique une sanction en cas de non-respect de ce délai. Dès lors, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sous trois mois, la question de la constitutionnalité doit être transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe.
C'est la position que nous prenons, par souci pratique et par souci juridique. J'ai en effet indiqué tout à l'heure dans mon intervention que si l'on ne se prononce pas sur le sujet, il pourrait y avoir un problème de constitutionalité lorsque la loi organique sera contrôlée, car nous n'aurons pas répondu à l'une des questions posées par la Constitution.
Enfin, je suis obligé de confirmer ce que MM. Urvoas et Geoffroy ont dit tout à l'heure à propos de la révision constitutionnelle. La commission des lois avait voté à l'article 26 un amendement au projet de loi constitutionnelle disposant que « le Conseil constitutionnel peut également être saisi à la demande d'une partie si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans le délai prévu à cet effet ». Nous n'avons pas maintenu cet amendement en séance, à la demande du Gouvernement, qui nous a dit que ce n'était pas l'objet de la révision, et qu'il fallait le déposer lors de l'examen de la loi organique.
Mes chers collègues, cet examen, c'est ce soir. Je vous demande donc de ne pas voter cet amendement.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
Je suis saisie d'un amendement n° 5.
La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas.

Il s'agit de préciser que la question est transmise de plein droit au Conseil constitutionnel si le juge suprême n'a pas statué dans les trois mois de sa saisine, à moins que le justiciable ne s'y oppose. Ce manque actuel du projet de loi organique risque de priver le justiciable de ses droits. L'amendement est conforme aux ambitions du constituant, qui tendait à conférer au citoyen, et plus précisément au justiciable, un nouveau droit qu'il doit pouvoir activer ou « désactiver ».
Même avis.
(L'amendement n° 5 n'est pas adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 4.
La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas.

Cet amendement vise à permettre à soixante députés ou soixante sénateurs d'intervenir dans la procédure d'examen par le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. Dans la mesure où, depuis 1974, les parlementaires sont à l'origine de la quasi-totalité des saisines du Conseil constitutionnel, en application de l'article 61 de la Constitution, il serait contradictoire qu'ils soient privés du droit de prendre position sur une question de constitutionnalité posée en application de l'article 61-1 de la Constitution.
Ce point importe d'autant plus que la loi contestée a pu être adoptée par un Parlement et une majorité autres que ceux en fonction au moment de la contestation. Il est donc légitime que les auteurs réels de la disposition puissent faire connaître leur point de vue au Conseil constitutionnel, sans que cela soit une obligation. Il est assez logique que les membres de l'opposition puissent faire valoir leurs arguments lorsque la disposition législative contestée a été adoptée à un moment où leur famille politique était majoritaire.
Ainsi, l'amendement demande que les membres des assemblées soient informés de la saisine du Conseil et que soixante députés ou soixante sénateurs puissent faire parvenir leurs observations au Conseil constitutionnel sur la question qui leur est soumise. Le texte actuel prévoit simplement que le Président de l'Assemblée sera informé. Nous souhaitons que l'ensemble des parlementaires le soit.

Monsieur Urvoas, je suis d'accord pour que le Président, une fois informé – comme le dispose le texte de la commission –, informe à son tour les membres du Parlement.
Mais un point nous pose problème dans l'amendement. C'est le fait de calquer cette procédure sur celle du contrôle a priori, où soixante députés ou soixante sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel. Il s'agit ici de quelque chose de totalement différent : d'un procès au cours duquel l'une des parties dit : « Attention, cette loi va être applicable, je souhaite que l'on vérifie si elle est ou non conforme à la Constitution. » Au terme, on arrive au Conseil constitutionnel, qui tranche. Nous ne sommes plus dans une procédure de vote législatif, où il faut assurer la représentation de groupes ou de portions d'assemblée. En revanche, rien n'interdit – je le dis clairement – à un, deux ou dix députés d'écrire au Conseil constitutionnel, qui en fera ce qu'il voudra. Mais on ne peut pas placer la lettre d'un député au même niveau de procédure qu'une des parties.
C'est pour cela que la commission a légèrement modifié la rédaction du Gouvernement, qui prévoyait que le Président de l'Assemblée ou du Sénat présente des observations. Cela impliquait que personne d'autre ne pouvait faire de même. Nous préférons un équilibre.
Imaginez, pour reprendre votre exemple, une alternance politique. Le Président de l'Assemblée et le président de l'ancien groupe d'opposition qui avait lui-même formé un recours devant le Conseil constitutionnel seront dans une position un peu difficile.
Nous avons donc une idée un peu différente. Si les députés veulent écrire, ils le font, mais cela ne peut pas tenir dans la procédure la même place qu'une demande des parties.
Même avis.

Comprenons-nous bien : mon but n'est pas de créer une procédure comparable au contrôle a priori. Les propos de M. Warsmann me rassurent : si les parlementaires qui appartenaient à la majorité lors du vote d'une loi plus tard contestée ont la faculté de soumettre leur point de vue au Conseil constitutionnel afin d'expliquer pourquoi ladite loi leur paraissait conforme à l'intérêt général lors de son adoption, alors je serai satisfait. Cependant, le texte ne prévoit en l'espèce que l'information du seul président de l'Assemblée nationale.

En effet, le président est avisé. Interrogeons le Bureau de l'Assemblée en conférence des présidents pour examiner sous quelle forme il pourrait en faire part à l'Assemblée tout entière ; ce pourrait être dans le feuilleton, par exemple. Quelle que soit la voie retenue, il s'agit d'un point d'organisation interne à l'Assemblée ; la diffusion de l'information dont dispose le président à tous les membres des deux assemblées, toutefois, est un objectif qui va de soi.

Je suis saisie d'un amendement rédactionnel n° 7, présenté par M. Warsmann.
(L'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 6.
La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas.

Cet amendement – le dernier du groupe SRC – vise à inscrire dans la loi organique le fait que « la procédure garantit les règles du procès équitable ». L'article 23-9 prévoit le respect du principe du contradictoire devant le Conseil constitutionnel – et à ce stade, c'est même la seule garantie donnée. Or, cela ne suffit pas à rendre un procès équitable : la contradiction n'est pas l'équité. Nous suggérons donc d'élargir la disposition par une référence plus générale aux règles du procès équitable telles qu'elles s'entendent dans le langage des juristes, y compris le principe d'impartialité et l'égalité des armes. Chacun conviendra – je ne force là aucune décision – que ces principes doivent être garantis ; le président Debré lui-même a, le 19 juin dernier, estimé devant les avocats à la Cour qu'il incombe au Conseil de les respecter. Nous suggérons donc de le préciser dans la loi organique.

Avis défavorable. Il s'agit de principes qui s'appliquent dans toutes les procédures. Il est donc tout à fait inutile de le préciser pour cette procédure particulière.
Même avis : cela relève du règlement intérieur du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel n'a pas de règlement intérieur !
(L'amendement n° 6 n'est pas adopté.)

Nous en venons à l'amendement rédactionnel n° 8, présenté par M. Warsmann.
(L'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L'article 1er, amendé, est adopté.)

Je suis saisie d'un amendement n° 9 qui corrige une erreur de référence, présenté par M. Warsmann.
(L'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L'article 2 bis, amendé, est adopté.)

Lors des débats constitutionnels, la question aujourd'hui dite « question prioritaire de constitutionnalité » n'était pas au coeur de nos discussions, et pour cause : il s'agit d'une initiative prise par François Mitterrand sur proposition de Robert Badinter, concrétisée par Nicolas Sarkozy sur proposition d'Édouard Balladur. Une telle paternité ne pouvait que susciter notre accord. Le principe a donc fait consensus, et c'est tant mieux ; le texte est aujourd'hui écrit.
J'aurai toutefois deux remarques à vous faire. Une de forme, tout d'abord : le fait que la loi organique propose des modifications qui seront intégrées dans l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel n'est pas anodin : il imposera de prendre toutes les dispositions réglementaires, y compris celles qui concernent la procédure administrative ou civile, « par décret en Conseil des ministres après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d'État », comme le précise l'article L. 55 de l'ordonnance. Il ne me semble pas que la précision ait été apportée au cours du débat ; c'est chose faite.
Ma deuxième remarque a trait à une question qui a beaucoup animé nos débats en commission et dans l'hémicycle : la priorité entre contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité. Chacun s'est accordé à juger habile la solution proposée : elle ménage des exigences contraires mais de valeur juridique différente. En effet, l'examen prioritaire de la question constitutionnelle deviendra une exigence organique, tandis que l'examen prioritaire de la question de droit communautaire sera une exigence constitutionnelle. Il faudra donc bien, tôt ou tard, se poser la question – ce que M. Debré a déjà fait devant le comité Balladur, me semble-t-il, bien que nous n'y ayons pas encore apporté de réponse – de la réunification, sous une forme ou sous une autre, du contrôle de constitutionnalité et du contrôle de conventionnalité. Cette révolution n'a pas eu lieu, car les deux cours veillaient. Le résultat est donc normal.
Demain, peut-être, une autre voie – une voie « prétorienne » – s'ouvrira : celle de la réunion des deux contentieux entre les mains du juge ordinaire. J'appelle l'attention de la représentation nationale sur le travail remarquable – à la disposition de tous les députés – d'un jeune docteur de l'Université de droit de Montpellier, qui convainc le lecteur qu'aucune règle de droit positif n'interdit au juge ordinaire de contrôler la constitutionnalité des lois. Jamais le constituant n'a formellement consacré le monopole du Conseil pour apprécier la constitutionnalité des lois. À ce jour, il ne s'agit que d'une habitude, d'une culture, voire d'un esprit, qui justifie le refus des juges ordinaires de se livrer à ce travail. Le constituant aurait pu agir en ce sens ; nous introduirions une véritable exception de constitutionnalité – c'est-à-dire un contrôle diffus. Cette révolution, apparemment compliquée mais simple au fond, pourrait avoir lieu.
Enfin, les divergences d'appréciation que nous avons pu avoir sur tel ou tel point du texte ne relèvent pas d'une lecture partisane. Le groupe SRC votera donc ce texte, et ce sera la première fois qu'il votera en faveur d'une loi organique issue de la révision constitutionnelle. Nous espérons avoir à renouveler bientôt un tel vote sur le référendum d'initiative populaire et sur la création du défenseur des droits.

En l'absence de M. Lagarde – dont il vous prie de l'excuser –, je vous informe, au nom du groupe Nouveau Centre, que nous voterons en faveur de ce texte.

Un droit nouveau, dont nous avons souhaité l'inscription dans la Constitution ; les conditions précises de sa mise en oeuvre ; des délais que nous avons souhaité encadrer, afin que ce droit ne fasse pas perdre du temps à nos concitoyens et n'entrave pas le cours de la justice : voilà le travail auquel nous avons abouti grâce à ce projet de loi organique de belle qualité et au travail de haute volée accompli par la commission. Chacun a pu apprécier l'effort consenti par tous les groupes pour converger dans la même direction. À cet égard, je salue nos collègues de l'opposition qui, tant en commission qu'en séance publique, ont joué un rôle utile, positif, « prospectif » même, pour reprendre un terme utilisé par M. Dosière.
En dépit de la difficulté – qui ne doit pas être majeure – qui nous oppose au Gouvernement sur la question de l'encadrement des délais, ce texte nous donne entièrement satisfaction. Le groupe UMP le votera donc, je le sais, à l'unanimité.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
(L'ensemble du projet de loi organique est adopté.)

J'ai le plaisir, madame la garde des sceaux, de vous annoncer que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).
Vous avez la parole, madame la ministre.
Permettez-moi de célébrer en quelques mots ce moment historique. Sur le fond, le texte ouvre un droit nouveau à nos concitoyens et nous fait entrer dans la modernité pour ce qui est du rapport du citoyen au droit constitutionnel. Il conclut un débat de très haut niveau. Je tiens donc à féliciter et à remercier tous les parlementaires qui siègent dans l'hémicycle aujourd'hui.

Prochaine séance, mardi 15 septembre à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Vote solennel sur l'ensemble du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet ;
Projet de loi pénitentiaire.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma