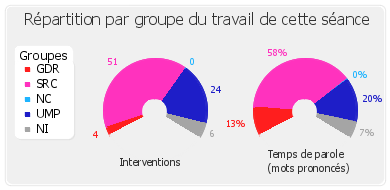Séance en hémicycle du 21 janvier 2010 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

L'ordre du jour appelle le débat sur les collectivités locales et le processus de recentralisation en France.

Monsieur le président, je souhaite m'exprimer au nom des députés non inscrits qui rencontrent de grandes difficultés pour suivre les débats portant sur les affaires européennes, et cela pour deux raisons.
Premièrement, depuis la réforme du règlement, le nombre des membres de la commission des affaires européennes a sensiblement augmenté, puisqu'il est passé, je crois, de trente-six à quarante-huit. Or il n'y a pas de place pour les députés non inscrits. C'est un cas unique en ce qui concerne les commissions parlementaires. Aussi souhaiterais-je que vous vous fassiez l'écho de cette difficulté auprès du président et du Bureau de l'Assemblée nationale car il s'agit d'une situation extrêmement gênante et regrettable.
Deuxièmement, chaque fois qu'un débat est organisé sur les affaires européennes – il en est de même en matière de défense et de politique étrangère – il n'y a pas de temps de parole réservé aux députés non inscrits. Là aussi, je souhaite que vous vous fassiez l'écho de cette situation qui est préjudiciable. Je sais bien que les députés non inscrits ne pèsent pas d'un poids considérable à l'Assemblée, sinon ils auraient créé un groupe administratif, comme c'est le cas au Sénat. Il n'empêche qu'ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'intervenir dans ces débats alors qu'ils représentent souvent des sensibilités importantes au niveau national.

Monsieur Garrigue, acte vous est donné de cette observation, qui est un vrai rappel au règlement.

Oui, et toujours avec la complicité bienveillante de la présidence ! (Sourires.)
Je m'engage à transmettre au président Bernard Accoyer le contenu et l'objet de ce rappel au règlement. Je pense que le Bureau qui se réunit le 27 janvier aura à connaître et à débattre de cette situation ; j'y veillerai personnellement.

Mes chers collègues, l'organisation du débat ayant été demandée par le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, la parole est à Mme Élisabeth Guigou, première oratrice de ce groupe.

Monsieur le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, le sujet qui nous occupe aujourd'hui est tellement important que nous devons essayer de nous comprendre davantage. Aussi reviendrai-je sur quelques-uns des arguments que nous avons déjà eu l'occasion de développer avec Laurent Fabius, Bernard Derosier, Alain Rousset et François Pupponi.
Une véritable réforme territoriale eût mérité une autre méthode, une autre concertation, pour aboutir véritablement à un consensus sur un acte III de la décentralisation.
Nous connaissons tous cette histoire que nous avons partagée. D'abord l'acte I, avec les grandes lois de décentralisation Mauroy-Defferre, au début des années 80, puis l'acte II, avec la réforme portée par M. Raffarin, où il est désormais inscrit que la France est une République décentralisée. Un consensus avait fini par se forger après les oppositions du début sur l'objectif de la décentralisation, tout simplement parce que la décentralisation ça marche. Monsieur le ministre, vous qui êtes depuis longtemps ancré localement, vous savez très bien le prix qu'attachent nos concitoyens à la réalité des services que leur offrent nos régions, nos départements et nos communes.
Une réforme aurait dû avoir lieu parce que, vingt-cinq ans après cette grande loi, il y a toujours des améliorations à apporter pour corriger les erreurs, approfondir la décentralisation et le faire avec une concertation sérieuse. Or, c'est l'inverse qui a été fait. Pour travailler sur ce sujet depuis un an au sein de notre parti et ici de notre groupe avec notre président Jean-Marc Ayrault, j'ai constaté que le Gouvernement a effectivement rencontré les associations mais que la concertation politique proprement dite s'est réduite à une audition, par le comité Balladur, d'un peu plus d'une heure, même si elle fut fort intéressante et sympathique – les autres groupes ont été traités de la même manière – et à un entretien d'une heure environ de la première secrétaire du parti socialiste avec M. Hortefeux. Franchement, un tel sujet méritait mieux. Vous avez pu mesurer, je crois, l'ampleur des désaccords avec les associations qui représentent des élus de la majorité et de l'opposition.
Autre problème : l'objectif électoral est apparu immédiatement tout à fait central. Les propositions qui sont faites visent avant tout à limiter et à diminuer l'influence de la gauche dans les collectivités car nous gagnons les élections locales – et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là.
Malheureusement, c'est l'idéologie qui a prévalu. On restreint les services publics au niveau local, comme on l'a fait au niveau national. M. Fillon a clairement dit il y a peu que l'État supprime un fonctionnaire sur deux, que la fonction publique hospitalière est soumise à une cure d'amaigrissement accélérée qui suscite de grandes inquiétudes et que les collectivités locales doivent faire la même chose.
Dans ces conditions, vous aurez compris que le consensus est impossible.
Dès que vos projets ont été connus, nous avons considéré qu'en réalité c'était une contre-réforme tournant le dos à vingt-cinq ans de décentralisation qui nous était proposée. Plutôt que de pousser au bout la décentralisation, vous recentralisez. On a affaire à un État gribouille qui empiète constamment sur les compétences des collectivités, c'est-à-dire qui fait doublon avec des compétences souvent transférées par la loi aux collectivités, pour les exercer lui-même. Les rapports de la Cour des comptes et de l'inspection générale des affaires sociales sont nourris d'exemples, notamment en matière de formation professionnelle des jeunes.
L'État se décharge de plus en plus de ses compétences propres sur les collectivités, par exemple en matière de financement des lignes à grande vitesse. De surcroît, il étrangle financièrement les collectivités locales, soit par des transferts de charges non compensés, soit par une diminution des dotations, en ayant recours à des artifices plus ou moins visibles.
Le projet du Grand Paris, cette invention sortie tout droit de l'imagination du ministre en charge du dossier, préfigure ce qui risque d'arriver à toutes les collectivités locales de France. En la matière, votre volonté de recentralisation n'a pas de limites. Là encore, les compétences des collectivités en matière d'urbanisme, de transports et d'aménagement sont reprises en main par l'État, qui n'hésite pas à s'attribuer de surcroît de nombreuses procédures dérogatoires au droit commun. Pour financer un tel projet, l'État s'apprête à gaspiller 21 milliards d'euros sans traiter les besoins concrets des populations franciliennes. Voilà un motif qui nous conduit à refuser net un tel projet.
Quant aux régions, on revient au vieux système de l'établissement public qui existait avant la décentralisation. Il n'y a plus d'autonomie fiscale, alors que l'Europe d'aujourd'hui nous montre qu'il faudrait au contraire la renforcer.
Bref, nous avons un État tatillon, alors que nous voulons un État stratège, qui refuse les doublons. Nous voulons un État qui, lorsqu'il transfère les compétences, transfère également les personnels et les financements, un État qui assume totalement ses responsabilités, ces missions régaliennes que sont la justice et la police, de plus en plus mal assurées sur le terrain – et j'en sais quelque chose en tant qu'élue de Seine-Saint-Denis. L'État n'assure plus non plus correctement son devoir de solidarité – nous le voyons en ce qui concerne les hôpitaux et la sécurité sociale –, il prépare de moins en moins l'avenir puisqu'il n'accorde pas les moyens nécessaires à l'éducation nationale et il ne joue pas le jeu du partenariat avec les collectivités.
À nos yeux, la réforme est fondée sur la défiance vis-à-vis des collectivités territoriales, alors qu'il faudrait au contraire la fonder sur la confiance.
Nous sommes face à une régression sociale et territoriale. Le principal problème à régler, c'est celui des inégalités territoriales, tant dans les territoires ruraux qu'urbains. Or votre réforme fiscale va les aggraver. La suppression de la clause de compétence générale pour les régions et les départements mettra les communes les plus pauvres dans l'incapacité de financer correctement la culture, le sport, les associations.
Pour réduire ces inégalités territoriales, nous avons des propositions à formuler, qui visent à s'attaquer au problème de la péréquation, à remédier à l'injustice de la taxe d'habitation, à remplacer la taxe professionnelle par un véritable impôt professionnel qui maintienne le lien et la dynamique des ressources pour les collectivités et clarifie les compétences respectives des régions et des départements.
En ce domaine des progrès sont encore possibles. Il y a déjà une spécialisation : les régions – heureusement qu'elles sont là – excellent en matière de stratégie économique, de développement et d'aménagement du territoire, tandis que les départements travaillent sur la proximité.
Si vous aviez voulu faire de véritables propositions, vous auriez poursuivi la spécialisation, déjà largement engagée, et renforcé les atouts des différentes collectivités, plutôt que de risquer, avec l'instauration du conseiller territorial, d'affaiblir les régions comme les départements. En effet, des régions privées de leurs propres élus et de toute autonomie fiscale n'ont plus les moyens de mettre en oeuvre leur politique.
Je passe brièvement sur la manipulation électorale car vous aurez compris que nous considérons comme une erreur stratégique le remplacement des conseillers généraux et régionaux par des conseillers territoriaux. Nous espérons que le Gouvernement reviendra sur cette funeste proposition. Quant au mode de scrutin, il relève d'une grossière manipulation.
Nous avons des propositions à vous soumettre en la matière. Tout d'abord, chaque collectivité doit avoir ses propres élus. C'est le principe même de la décentralisation. Il conviendra par ailleurs, dès que ce sera possible, et au terme, si nécessaire, d'une période de transition, de mettre fin au cumul des mandats, d'accorder aux étrangers le droit de vote aux élections municipales, et de favoriser les intercommunalités. En effet, monsieur le ministre, nous vous rejoignons sur l'idée de terminer, mais nous avons besoin de rationaliser et surtout de démocratiser.
Vous voyez bien dans quel état d'esprit nous intervenons. Nous nous opposons résolument à vos projets car une vraie réforme était possible, une réforme juste, qui s'appuie sur les atouts considérables que représentent nos élus locaux ainsi que les services et les collectivités qu'ils dirigent. Nous aurions ainsi pu présenter une réforme qui ne soit ni contestée ni contestable devant le Conseil constitutionnel, comme ce sera le cas si le Gouvernement maintient ses projets. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Je me réjouis, avec les députés communistes, républicains, du parti de gauche, que nous soit enfin donnée, à la faveur de cette journée d'initiative parlementaire, l'occasion de nous exprimer dans l'hémicycle sur l'ensemble des réformes envisagées par le Gouvernement s'agissant des collectivités locales.
Il est heureux en effet que nous puissions solennellement dénoncer ce massacre, habilement masqué par un saucissonnage de la réforme qui a de quoi impressionner, mais qui ne dévie pas d'un pouce de la méthode habituellement employée par Nicolas Sarkozy depuis son élection: diviser pour mieux régner, mettre l'accent sur l'accessoire pour faire oublier l'essentiel, agiter un chiffon rouge pour mieux porter l'estocade finale!
Je vais donc m'efforcer de dresser la liste exacte des textes qui composent la réforme territoriale, et qui est fort impressionnante : un projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, un projet de loi, proprement dit, de la réforme des collectivités territoriales, un projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, un projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, un projet de loi sur la ventilation des compétences entre départements et entre régions ainsi que les règles limitant les cofinancements. J'y ajouterai évidemment la dernière loi de finances, qui a entériné la suppression de la taxe professionnelle, mais aussi le projet de loi sur le Grand Paris, le futur projet relatif à l'Ile-de-France et l'ordonnance relative au découpage des nouveaux cantons. Au vu de cette impressionnante liste, chaque citoyen est en droit de se demander ce qui va se passer !
Depuis le début, les critiques pleuvent. Ces projets rencontrent de très nombreux opposants, y compris dans les propres rangs de la majorité – je pense à MM. Raffarin et Juppé, pour ne citer qu'eux. Ils sont déplorés par la plupart des associations d'élus, 76 % des Français estiment que la réforme est incompréhensible et confuse, tandis que 73 % refusent la suppression du département et le transfert de ses compétences à d'autres échelons.
Dès les premières lois mises en application – je pense notamment à la suppression de la taxe professionnelle –, les élus locaux et leurs collectivités accuseront encore un peu plus le coup et très rapidement, les administrés en ressentiront les premiers effets négatifs sur leur quotidien.
Cette multitude de mesures, présentées en catimini devant le Parlement de façon à les soustraire complètement à l'avis des Françaises et des Français, est un véritable scandale. Nous continuons à en exiger le retrait ou, à défaut, à appeler à l'organisation d'un référendum pour que nos concitoyens puissent s'exprimer sur l'ensemble d'une réforme qui touche aux fondements de nos institutions et de notre démocratie.
À cet égard, nous faisons parfaitement nôtres les termes du débat tel que l'a proposé aujourd'hui le groupe SRC, tant les orientations fixées par le chef de l'État semblent aller à l'encontre de la décentralisation initiée par les lois Defferre de 1982 et 1983. Rappelons-en les principales avancées: suppression de la tutelle administrative exercée a priori par le préfet et remplacement par un contrôle de légalité a posteriori par le tribunal administratif et la chambre régionale des comptes, transfert de l'exécutif départemental du préfet au président du conseil général, transformation de la région en une collectivité territoriale de plein exercice administrée par un conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel, répartition précise des compétences entre l'État, les communes, les départements et les régions, instauration du transfert de ressources sous la forme de dotations – dotation globale de fonctionnement, dotation d'équipement, dotation de décentralisation – inscription à l'article 72 de la Constitution du principe de subsidiarité : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. »
Ces lois furent complétées par les lois Raffarin de 2002-2004, dites « acte II de la décentralisation », qui ont consacré le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales, leur ont octroyé un droit à l'expérimentation, inscrit les termes de « région » et de «décentralisation » dans la Constitution et créé le référendum décisionnel local ainsi que le droit de pétition. Avec lucidité, nous avons fortement critiqué ces lois faussement décentralisatrices qui ont surtout abouti au transfert des responsabilités de l'État sans assurer la nécessaire compensation financière.
Aujourd'hui, en quoi peut-on affirmer que la réforme territoriale participe d'un processus de recentralisation, voire de ce que je qualifierai de forme de « subsidiarité ascendante contrainte »?
Comment comprendre les propos du chef de l'État qui qualifiait, à Saint-Dizier, la réforme de l'organisation territoriale de « rendez-vous historique pour la décentralisation »?
Quelle alternative proposer, notamment dans une perspective progressiste, pour ce fameux acte III de la décentralisation?
Sur le plan des institutions, on assiste à un phénomène inédit, une inversion de la traditionnelle dévolution du pouvoir qui caractérise habituellement la décentralisation: les collectivités locales sont en quelque sorte soumises à une « subsidiarité ascendante contrainte ». Si en effet, selon la classique « subsidiarité descendante », c'est l'échelon local qui permet de répondre au mieux et au plus près aux besoins des habitants, de nos jours il revient de plus en plus à l'échelon supérieur de reprendre en main et de suppléer ce qui ne peut plus être appliqué localement.
Pourquoi?
En réalité, cela tient à une équation relativement simple: elles doivent faire autant, sinon plus, avec moins de moyens car les charges, elles, se décentralisent effectivement!
Rappelons que ces collectivités réalisent 73 % de l'investissement public, comptabilisent 1 750 000 emplois, ont permis la création et le maintien de 850 000 emplois de la sphère privée. Or voici la liste de ce qui pèse déjà sur elles en plus des transferts incessants de charges: réduction des dotations, poids des intérêts d'emprunt, non-remboursement intégral de la TVA, hausse de la contribution à la CNRACL, besoins en constante progression, dont certains sont liés à la privatisation des entreprises publiques et à la réduction drastique des moyens des services publics nationaux. À cette liste s'ajoute à présent la suppression de la taxe professionnelle, laquelle constitue 50 % des recettes fiscales des collectivités territoriales.
Les conséquences de ce cadeau supplémentaire de 11 milliards au MEDEF seront dramatiques: dépérissement des services publics locaux ou hausse des impôts, fin de leur autonomie fiscale.
Plutôt que de regarder les choses en face, la majorité UMP a refusé notre proposition de moderniser la taxe professionnelle en intégrant dans ses bases les actifs financiers, ce qui aurait pourtant permis de créer un fonds national de péréquation !

Il ne fallait pas la moderniser mais la supprimer, ce que nous avons fait !

D'après vous, les collectivités coûteraient trop cher, ce qui justifie le projet de réduire le nombre des 6000 conseillers généraux et régionaux à 3000 conseillers territoriaux.
C'est ridicule et vous le savez.
Ensemble, ces conseillers ne représentent que 1% des 525000 élus locaux qui, faut-il le rappeler, sont bénévoles dans leur très grande majorité et ne coûtent que 28 millions d'euros à la collectivité, soit 0,01 % des dépenses locales. Il aurait fallu au contraire proposer un statut de l'élu. Ainsi, vous voulez nous mener vers la professionnalisation d'élus qui s'éloigneront encore plus de leurs administrés et du terrain.
Pour ce qui est du millefeuille territorial tellement décrié, je n'y vois qu'un gâteau en trois couches, que les Français semblent finalement aimer, mais aussi les européens, puisque la plupart de nos voisins connaissent aussi trois niveaux de collectivités.
Le projet de loi de réforme territoriale prévoit en outre la suppression de la clause de compétence générale ce qui serait dramatique pour le financement de très nombreuses politiques publiques, associatives, culturelles, sportives, en faveur de la petite enfance etc.
Concernant la couverture intercommunale du territoire, la méthode serait encore plus directive. Le «schéma départemental de la coopération intercommunale» sera élaboré après consultation par le seul préfet du département. C'est également celui-ci qui, dans une période de deux ans, pourra proposer de créer un EPCI à fiscalité propre conformément au schéma proposé. Il pourra en outre imposer le rattachement d'une commune isolée ou enclavée à un EPCI à fiscalité propre après simple avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Avec les élus communistes et républicains, nous ne comptons pas laisser passer ce coup de force.
De quoi parle le Président de la République quand il décrit un rendez-vous historique avec la décentralisation? Probablement de l'apparente « décentralisation fonctionnelle » qu'il a lancée avec la création d'établissements publics en tous genres, à qui sont transférés la gestion de certaines activités, voire de certains territoires. Cette décentralisation n'en a que le nom, car elle participe finalement de la même logique de concentration des pouvoirs.
Pour ce qui est des établissements publics nationaux, ils sont soumis à un contrôle de tutelle du Gouvernement. C'est que qui avait par exemple conduit le syndicat Paris-Métropole à dénoncer avec le projet de loi sur le Grand Paris «la mise entre parenthèses de la décentralisation en Ile-de-France» !
Pour les autres établissements publics, le contrôle exercé est plus subtil encore, puisque ce sont leurs présidences qui sont confiées à des personnes proches, voire très proches, du pouvoir central : vous voyez de quoi je veux parler.
C'est le fameux « centralisme despotique », formule qui caractérise bien l'attaque contre ladémocratie portée par Nicolas Sarkozy depuis son élection, opérant une prise de pouvoir personnelle manifeste qui, lorsqu'elle rencontre une résistance, qu'elle soit citoyenne ou institutionnelle, fait tout pour la faire plier.
Le futur mode d'élection des conseillers territoriaux illustre également ce penchant puisqu'il balaiera le pluralisme pour donner une suprématie élective à l'UMP. Il institutionnalisera aussi un peu plus le cumul des mandats puisqu'il y aura moins de postes. Je passe rapidement sur le fait qu'un scrutin uninominal à un tour, même avec la minidose de proportionnelle promise, remettra en cause, au passage, l'obligation de parité inscrite dans la Constitution. Mais à y bien réfléchir, cela en agace peut-être de voir que les régions comptent actuellement 47,7 % de conseillères.
Enfin, il est probable que le chef de l'État ne supporte pas le fait que les collectivités locales puissent représenter les derniers contre-pouvoirs locaux à sa politique néolibérale. Notre collègue André Chassaigne, président de l'association nationale des élus communistes et républicains, dénonce son intention de « livrer ainsi les services publics locaux à la boulimie de la marchandisation ». Le Président de la République voudrait privatiser des services rendus aujourd'hui par les collectivités et réduire l'intervention publique pour ouvrir de nouveaux marchés.
Votre projet de réforme permettra un jour l'application de la RGPP aux collectivités territoriales, et tant d'autres mesures de ce type à des entités pourtant réputées, selon vous, « imprivatisables ».
Les fonctionnaires territoriaux l'ont bien compris, comme en témoigne leur engagement aujourd'hui, dans la rue,…

…pour défendre le service public et protester contre les réformes du Gouvernement.

Eh oui, chers collègues, il y a une manifestation en ce moment même dans les rues de Paris.
Il y a quelques années, les élus communistes et républicains avaient fait valoir leurs propositions concernant une VIe République solidaire et démocratique, et les moyens par lesquels provoquer un nouveau souffle démocratique pour la décentralisation.
Pour l'essentiel, ces propositions n'ont pas perdu de leur actualité. Nous continuerons donc de défendre, avec les élus et les citoyens, une réforme des institutions qui vise avant tout à réduire les inégalités territoriales, à garantir l'égalité entre les collectivités en leur donnant des moyens financiers et humains importants ; une réforme qui fasse vivre la démocratie locale en donnant plus de pouvoir aux citoyens, et qui réponde aux besoins d'une France moderne, à même de relever les défis sociaux, environnementaux et économiques du XXIe siècle. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

…je remercie le groupe socialiste de nous donner l'occasion d'échanger sur ce sujet (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC), comme nous l'avons d'ailleurs déjà fait pendant plusieurs heures cette semaine, au risque, les uns et les autres, de nous répéter,…

…ce qui n'est jamais inutile.
Je reviendrai sur un point qui fait peut-être consensus, madame Guigou : la nécessité de la réforme ; une réforme qu'il faut avoir le courage d'engager, reconnaissons-le.
De nombreux rapports ont conclu dans ce sens, qu'il s'agisse de celui rédigé par M. Mauroy, de celui de la commission des lois de l'Assemblée, sous l'égide de Jean-Luc Warsmann, ou des propositions de M. Richard, ancien président de Dexia. Tous regrettent la relative confusion et la grande complexité dans laquelle les élus locaux sont contraints de travailler.
Il est important, lorsqu'on souhaite engager une réforme, de prendre un peu de recul historique, de se rappeler les événements des vingt, trente ou quarante dernières années.
Ainsi, un grand mouvement de décentralisation a été lancé, l'État confiant aux régions, aux départements et aux communes une partie de ses compétences. Sans doute ne pouvait-on agir autrement, mais cette décentralisation s'est réalisée avec des structures héritées de notre histoire territoriale : des régions alors embryonnaires, des départements très intégrés, au contraire, à notre patrimoine institutionnel, et, bien sûr, les fameuses 36 000 communes. C'est donc avec des structures inadaptées que l'on a procédé à la décentralisation ; mais il fallait bien lancer le mouvement.
Vingt à trente ans plus tard, il paraît indispensable de prendre acte de l'exercice de ces nouvelles compétences, très larges, et de constater la difficulté du travail des élus locaux qui doivent se débrouiller avec cette complexité. Toutefois, hommes et femmes en général ingénieux, ils ont trouvé des réponses concrètes. Nous avons tous exercé ou continuons d'exercer des responsabilités locales et nous avons fait en sorte que le système fonctionne. Le prix à payer, d'un point de vue collectif, en est toutefois très élevé quand on songe au nombre de réunions de coordination, aux efforts requis par la recherche de partenariats multiples…
Une réforme des structures s'impose par conséquent, même si elle a déjà été engagée. La loi Joxe puis la loi Chevènement – sur laquelle j'avais beaucoup travaillé entre 1995 et 1997 – ont constitué une première réponse de fond à la décentralisation avec la mise en place progressive de l'intercommunalité, vers laquelle les élus locaux se sont précipités tant ils ont compris qu'ils trouveraient là la réponse à une partie de leurs difficultés. Il convient cependant d'aller plus loin.
Il va de soi, madame Guigou, qu'il n'y a jamais assez de concertation, nous l'affirmons tous depuis longtemps… Il se trouve que j'ai vécu l'élaboration du présent projet de réforme depuis le début et que je suis donc fondé à en parler. Dans un premier temps, le comité Balladur était politiquement hétérogène puisque Pierre Mauroy et André Vallini, Gérard Longuet et moi-même en faisions partie, tout comme un certain nombre d'experts non politiques. Vous l'avez rappelé, madame, nous avons auditionné l'ensemble des forces politiques, des associations et des gens qui souhaitaient être entendus. Ensuite, comme il est normal, le Gouvernement a repris la discussion, essentiellement avec les institutionnels.
Je regrette franchement que nous n'ayons pu aboutir à un consensus. J'ai cru que nous y parviendrions, que le vote serait unanime sur l'ensemble des propositions du comité Balladur. Pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de juger – je respecte les personnes et les forces politiques –, il en a été décidé autrement par le parti socialiste.
Par exemple, en ce qui concerne le mode de scrutin pour l'élection du conseiller territorial, dont nous discutons beaucoup, vous savez sans doute, madame Guigou, que nous ne sommes pas passés très loin d'un accord entre la droite et la gauche au sein du comité Balladur.

Si, devant les membres du bureau politique de l'UMP, j'avais pu déclarer que le mode de scrutin faisait consensus, la réponse n'eût sans doute pas été celle que j'ai reçue : une réponse négative.
Quand on constate qu'il n'y a pas consensus, il convient de savoir pourquoi.

On peut le regretter au vu de vingt-cinq ans de vie politique et en particulier de vie politique locale.
J'évoquais l'intercommunalité : Jean-Pierre Chevènement a toujours eu l'amabilité de rappeler avoir trouvé, à son retour au Gouvernement en 1997, un projet de texte rédigé par Dominique Perben. Il a pu ouvrir, ce qui n'était pas négligeable, une enveloppe annuelle de 500 millions de francs pour le financement des communautés d'agglomération.

Mais il avait obtenu du ministre des finances ce que je n'avais pas été capable d'obtenir, il faut savoir être lucide.

Je n'en avais du reste peut-être pas eu le temps puisque la dissolution de l'Assemblée a été décidée entre-temps.
Cela signifie en tout cas qu'une réelle continuité dans l'action, et donc un consensus, est possible, et je regrette qu'il n'en ait pas été ainsi cette fois-ci.
Toujours en ce qui concerne la méthode, madame Guigou, outre le comité Balladur, je rappellerai le travail mené au Sénat sous la présidence de M. Belot et dont on ne peut pas dire qu'il ait été partisan puisque tout le monde y a pris part, comme M. Krattinger. Les conclusions de ce rapport n'ont pas été partagées par tous mais on doit noter la recherche du consensus, même si, vous avez raison, une audition d'une heure peut paraître sommaire.

Des actes de bonne volonté ont été faits de part et d'autre.
Au total, pour le présent projet de réforme, je note que nous avons essayé de parvenir autant que possible à un consensus.
J'en viens maintenant au contenu de la réforme. Vous parlez de recentralisation ; or il faut savoir ce que les mots veulent dire. La recentralisation signifie le contraire de la décentralisation, c'est-à-dire que, selon vous, l'État voudrait reprendre les compétences qu'il a confiées aux collectivités territoriales. Ce n'est pas ce que prévoit la réforme.
Elle comporte trois éléments. Le premier concerne l'intercommunalité. Nous sommes tous d'accord, et je suppose que le débat au Sénat va le montrer, sur le fait qu'en la matière nous pouvons adopter une attitude plutôt consensuelle : il faut démocratiser l'intercommunalité car nous ne pouvons plus laisser des assemblées locales lever l'impôt sans qu'elles soient désignées par le suffrage universel. Le statu quo est dangereux pour la démocratie.
Il nous faudra prendre nos responsabilités et revoir le schéma départemental de l'intercommunalité, mettre en place des intercommunalités vraiment capables d'assumer les services de proximité, bien plus que ce n'est le cas aujourd'hui.

Surtout en Île-de-France, région la plus en retard en la matière, vous avez raison de le souligner, monsieur Pupponi.
Nous devons donc aller de l'avant et introduire suffisamment de dispositifs un tant soit peu ambitieux pour améliorer le schéma directeur des départements. Nous devrons nous montrer courageux et ne pas refuser l'idée de contrainte.
Le deuxième point de cette réforme, très important et auquel je suis particulièrement attaché, M. le ministre comme d'autres le comprendront, est celui des métropoles. Voilà un enjeu considérable. Notre pays ne dispose pas des grandes métropoles indispensables pour assurer la compétitivité des territoires. Nous devons par conséquent donner à un nombre restreint de grandes villes, tant en termes d'intégration des responsabilités qu'en termes de dimension territoriale, les moyens de polariser les emplois à haute valeur ajoutée dont nous avons besoin. Or, en la matière, le texte approuvé par la commission des lois du Sénat me paraît insuffisant. Il nous faudra y revenir pour « doper » nos futures métropoles. Ce débat peut très bien, lui aussi, être transpartisan, l'affrontement droite-gauche n'ayant pas lieu d'être sur un tel sujet.
Le troisième élément de la réforme touche à l'articulation entre les régions et les départements. Vous avez raison, madame Guigou, de considérer que les trois niveaux de collectivités existent dans de nombreux pays. Comme nous ne proposons d'en supprimer aucun, nous sommes d'accord à la fois sur le constat et sur la conclusion à en tirer.
Nous n'en souhaitons pas moins éviter la concurrence entre deux collectivités, l'émiettement des actions entre la région et le département. Nous voulons que la région puisse se concentrer sur un certain nombre de grandes responsabilités, tout comme, de son côté, le département. C'est pourquoi, pour assurer dans la durée la spécialisation de ces deux niveaux de collectivités ainsi que leur bonne articulation, la réforme propose de façon fort astucieuse à la fois la création du conseiller territorial – « guichet unique » de la décentralisation –, et la suppression de la clause de compétence générale pour le département et la région.
J'ai souvent eu l'occasion d'évoquer avec M. Rousset la question de savoir si ce nouveau dispositif était susceptible de nuire au département ou bien de nuire à la région.

Quand on a des amis à la fois départementalistes et régionalistes, monsieur Derosier, on est bien obligé de répondre cela.

Nous vous avons démontré que le dispositif que vous proposez était nuisible à la région et au département.

Tâchons d'être sérieux.
Je crois à la décentralisation et, après vingt-cinq ans d'expérience locale, je suis convaincu de la nécessité d'une réforme. Or le présent dispositif renforcera la cohérence régionale, non seulement celle de la politique menée par la région, mais la cohérence de la politique menée par les différents départements composant la région.
Nous aurons un phénomène absolument identique à celui que nous avons connu lorsque les communautés d'agglomération ont été créées. Nous sommes partis de territoires au sein desquels les maires d'une même agglomération ne se connaissaient pas, ne travaillaient pas ensemble. Nous avons créé les communautés d'agglomération. Ces maires et ces équipes municipales ont appris à travailler ensemble, ils ont construit des schémas ensemble. Et ensuite, non seulement la politique de la communauté d'agglomération a été quelque chose de collectif, mais, de plus, les communes ont su s'intégrer progressivement dans une vision d'agglomération. Je pense qu'il en sera de même demain pour les départements, qui s'intégreront davantage dans une vision régionale. C'est en tout cas ma conviction et j'espère pouvoir la faire partager. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas une minute que cela remette en cause la puissance et la dynamique régionales.
Il y a eu beaucoup de discours et de procès d'intention politiques. Cela n'a pas été le cas à cette tribune, et j'en suis heureux, mais je sais un peu ce qui s'est passé depuis un mois dans nos départements, en particulier à l'occasion des voeux. Je regrette personnellement que certaines collectivités locales, notamment certains départements, aient dépensé de l'argent public pour mener une campagne politique. Je crois que ce n'est pas le rôle des élus, quels qu'ils soient, d'utiliser de l'argent public pour mener directement des campagnes politiques sur un projet.

Et il n'a jamais financé des campagnes politiques qui ressemblent à des tracts, vous le savez très bien. D'ailleurs, nous verrons bien ce que diront les commissions de campagne dans les prochaines semaines, quand elles seront saisies. Je pense que ce n'est pas une bonne manière de mener le débat.
Un mot sur la région parisienne. J'ai beaucoup regretté que nous n'ayons pas pu, au sein du comité Balladur, faire des propositions susceptibles d'être retenues, au moins en partie, par le Gouvernement. Nous avons été étonnés lorsque les présidents des conseils généraux d'Île-de-France sont venus dire au comité Balladur que tout allait bien dans la région parisienne. On peut critiquer la politique du Grand Paris du Président de la République, mais il faut quand même voir ce qui a été dit par les élus de gauche devant le comité Balladur. « Tout va bien ! ». C'était cela, leur discours. A tel point que le président Mauroy est entré dans une colère absolument extraordinaire devant ses propres amis politiques.
Je crois qu'il nous faudra revenir sur ce dossier. Il faudra que la République s'en saisisse à nouveau. Compte tenu du vide sidéral de propositions susceptibles de faire consensus, le Président de la République a eu raison de s'engager dans un certain nombre de grands investissements structurants, au service des habitants de la région parisienne. Parce que c'est cela qui est essentiel : quel est le mode de vie des citoyens d'Île-de-France, quelles sont leurs conditions de vie et comment peut-on les améliorer ? Le Président de la République a donc raison de procéder à des rationalisations en termes d'investissements. Dans la foulée de ces actions concrètes, il faudra que nous reprenions la réflexion sur l'organisation de la gouvernance en région parisienne.
Puisque Mme Guigou et Mme Amiable ont évoqué la question du mode de scrutin des conseillers territoriaux, je voudrais en dire un mot. Ayant rencontré beaucoup d'élus locaux et de citoyens dans le cadre de déplacements systématiques en province, depuis maintenant neuf mois, dans une quarantaine de départements, j'ai été frappé par l'attachement, toutes tendances politiques confondues, au scrutin uninominal. A tel point que cet attachement m'a personnellement surpris. J'ai toujours été un élu urbain, mais j'ai été très surpris de la force de l'attachement de nos concitoyens, en particulier dans l'espace rural, mais pas seulement, au scrutin uninominal.
Je pense qu'il faut être sensible à cela. Je le dis devant vous, monsieur le ministre, qui êtes responsable de l'espace rural. J'ai senti que si l'on abandonnait totalement le scrutin uninominal, cela serait ressenti par nos concitoyens vivant dans l'espace rural comme la disparition d'une représentation politique spécifique. Il faut être attentif à cela.
C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut trouver un mode de scrutin qui, pour l'essentiel, soit à caractère uninominal. Néanmoins, et c'est là que les choses se compliquent, j'en conviens, il serait bon que, dans les assemblées départementales et régionales, puissent être présentes l'ensemble des forces politiques, même si elles sont de dimension modeste. La question de la proportionnelle se pose donc aussi.
C'est la raison pour laquelle, sous réserve d'inventaire, je pense que le projet du Gouvernement, qui lie le scrutin uninominal et la proportionnelle, me paraît un bon compromis. Nous aurons l'occasion d'en discuter. J'ai cru comprendre que le Gouvernement ne considérait pas que ce débat était d'une urgence absolue, qu'il souhaitait que les forces politiques aient le temps d'y réfléchir. C'est ce que je fais, avec un certain nombre d'amis. Mais je voulais rappeler, à l'occasion de ce débat sur la décentralisation, ces deux éléments : un attachement très fort au scrutin uninominal et, à mon avis, la nécessité d'avoir dans nos assemblées départementales et régionales, une représentation de l'ensemble des forces politiques.
Pour répondre à l'intitulé de ce débat, il n'est aucunement question, pour le Gouvernement ou pour la majorité, de revenir sur la décentralisation. Au contraire, il s'agit de tirer les conclusions de cette décentralisation, après une trentaine d'années d'exercice sur le terrain, en termes de structures, pour que les conditions d'exercice de leurs responsabilités par les élus locaux soient plus faciles, pour que nos concitoyens puissent mieux comprendre ce dont il s'agit, comment fonctionne la démocratie locale, et bien entendu pour répondre à l'exigence d'économie globale.
Sur ce dernier point, je ne veux pas entrer dans le débat, qui est permanent, entre l'État et les collectivités locales. Cela n'a pas un intérêt considérable. J'ai quelques idées sur le sujet, mais je les garde pour moi aujourd'hui. Ce que je veux simplement dire, c'est que nous devons tous être convaincus que les vingt prochaines années seront évidemment beaucoup plus difficiles, en termes de finances publiques, que les vingt années que nous venons de vivre. Ce n'est pas parce que je suis UMP que je dis cela. Chacun, en conscience, ne peut qu'en être convaincu. Il est donc évident que, pour les collectivités locales comme pour l'État, comme pour la branche maladie de la sécurité sociale et notre système de retraite, il nous faut faire des économies de structures. Il faut donc aussi que la réforme des collectivités locales soit porteuse d'économies. C'est la raison pour laquelle, avec beaucoup d'autres, j'en soutiendrai les différents éléments. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, vous m'autoriserez certainement un petit mot personnel pour saluer vos invités du Loir-et-Cher. Ce département est cher à mon coeur, peut-être un peu moins qu'au vôtre. Je voulais les saluer. Ils sont là, dans les tribunes, accompagnés par le président du conseil général.
Monsieur le ministre, je vais féliciter le Gouvernement, une fois n'est pas coutume. Car vous avoir désigné, vous, pour être au banc du Gouvernement dans ce débat, vous qui êtes réputé pour être décentralisateur, défenseur des collectivités territoriales, cela témoigne d'une bonne intention de la part du Gouvernement. Ou alors, c'est un cadeau empoisonné. Car je vous écouterai tout à l'heure, et à moins de contredire vos prises de position passées, je ne sais pas comment vous allez vous en tirer.
Quand, en 1982, la gauche a initié la décentralisation, la droite s'y est violemment opposée.

Les avantages pour les citoyens des villes, des départements, des régions, sont rapidement apparus aux yeux de tous.
Ce concept de décentralisation est devenu la référence pour toutes les sensibilités politiques du pays.
Un consensus partagé était donc bien établi pour garantir l'organisation décentralisée de la République, à tel point que Jean-Pierre Raffarin en faisait une disposition constitutionnelle. « Ça marche bien », a dit à l'instant M. Perben. Alors, pourquoi faire compliqué quand les choses fonctionnent bien et simplement ?
En vérité, tout allait bien jusqu'au moment où le locataire de la rue Saint-Honoré, disposant du pouvoir d'État, s'est aperçu que le pouvoir local lui échappait : vingt régions métropolitaines sur vingt-deux présidées par un socialiste,…

C'est très élevé, vingt régions sur vingt-deux. Avec en outre 60 % des départements et 60 % de la population des communes animés par une majorité de gauche, cela devenait insupportable.
Dominique Perben a bien voulu rappeler que Pierre Mauroy, Premier ministre de la décentralisation, et André Vallini siégeaient au sein du comité Balladur. Mais à un certain moment ils ont vu dans quelle direction on voulait les entraîner. Et vous n'avez pas développé, monsieur Perben, toutes les raisons qui les ont amenés à prendre leurs distances avec ce que suggérait l'ancien Premier ministre Balladur, soutenu en cela par l'UMP.
Et puis il y a eu ce rapport établi par quelques sénateurs. Les propositions des rapporteurs, M. Krattinger et Mme Gourault, ont fait l'unanimité. Pourquoi ne les reprenez-vous pas ?

Là, il y aurait consensus.
Or, aujourd'hui, incontestablement, ce consensus est fortement remis en cause. La réduction drastique de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales est un élément central de cette remise en cause.
Depuis 1982 et la réforme initiée par François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre, le mouvement décentralisateur a permis de reconnaître aux collectivités territoriales la possibilité de déterminer librement une partie de leurs ressources.
Cette marge de manoeuvre fiscale constituait le corollaire indispensable de la libre administration des collectivités territoriales, dont le principe est affirmé par l'article 72 de la Constitution.
Cette liberté a toujours eu pour contrepartie l'obligation faite aux élus locaux d'assurer l'équilibre des budgets des collectivités territoriales. Cet équilibre a pu être apprécié au plus près des besoins de la population.
Mais le Gouvernement a souhaité revenir sur ce mouvement décentralisateur, seul garant de la satisfaction des intérêts des Français.
L'un des moyens les plus efficaces de ce processus de recentralisation à rebours du sens de l'histoire a consisté dans la réduction draconienne de la part des ressources propres des collectivités territoriales, avec comme point d'orgue, il y a quelques semaines, la suppression de la taxe professionnelle.
En remplaçant la plus grosse part de la fiscalité directe des collectivités territoriales par une dotation provenant du budget de l'État, le Gouvernement rétablit sa tutelle et achève de les conduire à une situation financière insoutenable. Certaines d'entre elles sont déjà dans ce cas. Plus de vingt départements auront un résultat d'exercice 2009 déficitaire.
L'Assemblée des départements de France a sollicité une audience de toute urgence auprès du Premier ministre pour évoquer la situation des premiers départements faisant face à de graves difficultés financières. Celui-ci, à ce jour, n'a pas donné de réponse à cette demande d'audience. Il y a urgence, monsieur le ministre. Il a répondu, mais il n'a pas indiqué de date pour une audience. Il a dit qu'il allait s'informer, rassembler les éléments. Mais, pendant ce temps, les départements sont dans la panade, pardonnez-moi l'expression.
Ces mauvais coups portés aux collectivités territoriales ne se limitent pas, à mes yeux, à la seule autonomie fiscale. C'est aussi leur autonomie financière qui est malmenée.
Car les effets de la réforme fiscale se conjuguent avec ceux de la politique de compression des dotations attribuées aux collectivités locales.
La loi de finances pour l'année 2010 aura pour conséquence d'accroître la dette de l'Etat envers les collectivités territoriales, ces dernières enregistrant de lourdes pertes.
Les premières simulations sur les futures ressources des collectivités territoriales réalisées par Bercy ont été connues le 8 janvier dernier. Je conseille aux collectivités territoriales de ne pas s'y fier pour leurs projections budgétaires. En effet, ces simulations ne sont pas satisfaisantes. Elles ont d'ailleurs fait l'objet de vives critiques de la part des spécialistes. Une analyse approfondie réalisée par un cabinet spécialisé dans les finances des collectivités territoriales a mis en lumière des oublis et des anomalies.
Autonomie fiscale réduite à la portion congrue, autonomie financière menacée : après ces multiples attaques, on pouvait croire que le Gouvernement pourrait faire l'économie d'une réforme territoriale achevant de mettre à mal les collectivités.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même à plusieurs reprises : le Gouvernement pourrait se dispenser de proposer, dans le cadre de la réforme territoriale, de supprimer la clause générale de compétence des départements et des régions, puisque les départements comme les régions n'auront plus les moyens de l'exercer.
Par ailleurs, l'autonomie financière, reconnue par la Constitution, et l'autonomie fiscale, pratiquée depuis plusieurs années, ont un corollaire indispensable : la péréquation.

La décentralisation ne peut être juste et supportable que si elle contient une part suffisante de mécanismes de redistribution visant à réduire les écarts de richesse et à garantir l'égalité entre les territoires. En effet, l'autonomie locale peut conduire à creuser les écarts de richesse entre les collectivités territoriales, ce qui serait de nature à accentuer les déséquilibres géographiques et à porter atteinte au principe d'égalité devant les services publics. La péréquation est donc la pierre angulaire de la solidarité territoriale.
Cette belle idée a fait son entrée concrète dans notre construction financière publique en 1991, sous l'impulsion de notre collègue Michel Delebarre, alors ministre d'État chargé de la politique de la ville, avec la loi sur la solidarité financière. Ce texte instituait trois mécanismes de péréquation en faveur des communes pauvres supportant de lourdes charges liées aux dysfonctionnements urbains : la dotation de solidarité urbaine, le fonds de solidarité pour les communes d'Île-de-France et la dotation particulière de solidarité urbaine.

Les gouvernements qui ont suivi n'ont jamais remis en cause cette démarche. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 l'a même érigée en objectif de valeur constitutionnelle, puisqu'à partir de cette date « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ».
À la suite des débats qui ont accompagné l'examen de la loi de finances pour 2010 et la question du remplacement de la taxe professionnelle, la péréquation a été définie par l'Assemblée des départements de France comme un des trois piliers des ressources financières des collectivités territoriales, à côté de l'autonomie et de la compensation des charges transférées. À partir de 2011, la taxe professionnelle sera remplacée par la contribution économique territoriale. Des mécanismes de péréquation fiscale sont associés à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Un dispositif très compliqué a été imaginé.
Ces mécanismes sont jolis sur le papier, mais leur efficacité est loin d'être démontrée. Nous ne savons pas, à ce jour, quelle sera leur force péréquatrice véritable. Personne n'est dupe des simulations réalisées jusqu'à présent, qui n'ont été que parcellaires en ne prenant en compte que le fonds de péréquation et en excluant les écrêtements. J'ajoute que les statistiques utilisées portent sur une seule année, alors que nous aurions besoin de simulations construites dans le temps. Bien au contraire, certains craignent même que ces mécanismes ne produisent l'effet inverse de leur objectif et aggravent, avec le temps, les inégalités existantes entre collectivités riches et pauvres, grandes et petites, rurales et urbaines.
Je veux insister aujourd'hui sur le fait que territorialisation et péréquation ne sont pas incompatibles. L'écueil serait de prôner, au nom de la péréquation et donc de l'égalité territoriale, une nationalisation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est inopportune et dangereuse pour les collectivités territoriales. De plus, la péréquation s'opère plus efficacement dans une approche pluriannuelle que dans une attribution ponctuelle d'une fraction d'un produit national, dont l'évolution resterait forcément liée aux contingences du moment et de chaque loi de finances.
À côté de cette péréquation fiscale, une péréquation budgétaire est aujourd'hui indispensable. Une de nos propositions en la matière est d'affecter 25 % des dotations d'État à la péréquation dans un délai de dix ans et de garantir constitutionnellement que, dans les dix ans, aucune collectivité n'ait une ressource financière inférieure à 80 % et supérieure à 120 % de la moyenne par habitant de la même catégorie de collectivité.
Autonomie fiscale et péréquation constituent ainsi les deux facettes d'une même médaille, et l'une ne va pas sans l'autre. Ces deux notions sont intrinsèquement liées à la décentralisation et en constituent les piliers. Elles doivent se conjuguer vertueusement.
Nous devons, dans le cadre des débats parlementaires actuels, dangereux pour notre modèle républicain, nous mobiliser fortement pour cesser de suivre la fausse route prise depuis quelques années et stopper l'emballement constaté depuis quelques mois.
Tout à l'heure, j'ai entendu M. Perben formuler de façon très atténuée des menaces au regard des dépenses engagées par les collectivités territoriales pour faire connaître à l'opinion les menaces qui pèsent sur ces collectivités. Je veux croire qu'il s'agissait de propos sans suite : une telle volonté d'intervention sur les décisions prises par les élus locaux serait grave.
Le groupe socialiste sera vigilant et actif contre les régressions en cours et ne laissera pas voler en éclats ce qui fait la fierté de notre architecture institutionnelle : la décentralisation. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat relatif à la réforme des collectivités territoriales n'est pas une nouveauté. Relancé après les lois de 1982 et 2004, le voici une fois de plus inscrit à notre calendrier parlementaire en 2010. Un constat s'impose, qui conduit à se demander s'il n'existe pas une loi inexorable qui condamnerait la France centralisée à n'en jamais finir avec sa décentralisation.
Après des années de réformes incomplètes, un empilement de nouvelles structures a engendré un maillage administratif et institutionnel trop rigide, une multiplication des échelons politiques et administratifs, et une illisibilité criante tant pour les administrés que pour les échelons dans leurs responsabilités politiques. Ce millefeuille institutionnel est non seulement incompréhensible mais aussi extrêmement coûteux dans son fonctionnement.
Dans l'élan présidentiel des réformes et des économies budgétaires, ce sujet ne pouvait pas nous échapper. Espérant faire avancer le débat, j'ai choisi, dans cette intervention, d'être pragmatique et concret. Le but de l'opération est de parvenir à une rationalisation de l'organisation des structures territoriales et à une clarification dans la répartition des compétences. Des économies budgétaires et de personnels ainsi qu'un raccourcissement des délais en résulteront.
D'abord, il est nécessaire d'améliorer les rapports des collectivités territoriales avec l'État.

Il est indispensable d'établir un climat de confiance pour assurer efficacement la mise en oeuvre des compétences transférées.
L'État territorial se doit d'adapter ses propres structures aux missions nouvelles assurées par les services décentralisés. Cependant, ayons bien à l'esprit aussi que cette adaptation doit être faite au regard de la diversité des territoires, en apportant des solutions institutionnelles différenciées aux grandes métropoles, aux territoires urbains et périurbains et aux territoires ruraux. Il est évident que l'on ne peut gérer et structurer matériellement, humainement et budgétairement de la même manière des territoires comme ceux de la Lozère et du Nord.

Ces exemples sont volontairement aux antipodes l'un de l'autre pour illustrer que la réalité du terrain est vraiment un critère primordial de cette réforme.
Il en est de même pour les DOM-TOM : instaurer une collectivité unique regroupant départements et région, ne serait-ce pas une solution envisageable ?
La restructuration territoriale passe aussi prioritairement par l'approfondissement de l'intercommunalité à partir d'un réexamen de la pertinence des périmètres et le renforcement de l'intégration entre communes et intercommunalité. Or l'attachement des Français à l'identité communale demeure une réalité forte, une base de la démocratie locale que l'on ne peut occulter. La solution consisterait peut-être en un « fléchage » des conseillers communautaires sur les listes de candidats aux élections municipales. Il est souhaitable d'encourager la fusion volontaire de communes sur la base de référendums proposés par une majorité qualifiée des membres des conseils municipaux des communes concernées. Dans le même esprit, il serait souhaitable également d'avoir la possibilité de regrouper ou de modifier les limites territoriales des régions, mais aussi des départements, encore une fois sur la base du volontariat, sur propositions concordantes des assemblées délibérantes concernées. (Exclamations sur les bancs du groupe GDR.)
Enfin, notons que la mutualisation des moyens et le cofinancement de projets par plusieurs collectivités, s'ils allongent les procédures, sont pour certaines d'entre elles essentiels à leur aboutissement.

Autre impératif de cette réforme : parvenir à une clarification dans la répartition des compétences entre les divers niveaux de collectivités, pour une meilleure lisibilité et une meilleure efficacité, tant pour les responsables politiques que pour les administrés. (Exclamations sur les bancs du groupe GDR.)

Pour information, monsieur Pupponi, il n'y a pas de continuité territoriale. Reprenez votre géographie !
Cette nécessité conduit à s'interroger sur la pertinence de la clause générale de compétence et sur son éventuelle articulation avec une spécialisation renforcée de celles-ci.

Ainsi, dans le secteur de l'enseignement scolaire, l'imbrication, l'enchevêtrement et l'addition de niveaux dans les prises de décisions et dans le financement ont fini par former une véritable pelote de laine qu'il est devenu impératif de démêler. Il en est de même du domaine du logement : qui fait quoi, quand, pour qui, dans quel délai, avec quel argent ?
Une chose est certaine, il faut améliorer le système, dans le respect du principe de l'autonomie financière et fiscale locale ainsi que du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Il faut également réaffirmer les départements dans leur rôle de garant des solidarités sociales et territoriales, et les régions dans leurs missions stratégiques de préparation de l'avenir. Aussi, il semble primordial de développer et d'encourager le droit à l'expérimentation comme moyen de tester, voire d'améliorer des situations vécues et des systèmes en place.
Dans un souci d'organisation et d'économies budgétaires, il est indispensable de refonder les relations entre l'État et les collectivités territoriales, en subordonnant toute nouvelle décision à une concertation préalable et codifiée avec les associations nationales des élus locaux.
Après ces quelques propositions, je souhaite aborder quelques cas concrets de questions locales.
Depuis de nombreuses années, nous avons vu se multiplier les vecteurs de communication – magazines, lettres, affiches, campagnes dans les médias audiovisuels, bureaux dans les capitales d'Europe… la liste est longue. Et tout cela est financé par les impôts ! L'objectif premier est de valoriser les présidents des régions ou des départements, au mépris des lois sur le financement des campagnes électorales.
Dans un autre registre, les 35 heures ont été, dans les collectivités locales, un facteur d'augmentation des charges salariales et de désorganisation. Certains conseils généraux, tel celui de la Seine-Saint-Denis, avaient même anticipé la loi pour en faire plus, avec pour conséquence une explosion de la masse des salaires.

Pour sa part, la ville de Villemomble, que je dirige depuis dix ans, qui compte 28 000 habitants, qui a des ressources limitées – à peine 15 % de taxe professionnelle –, et dont les impôts n'ont pas augmenté depuis dix ans, s'est complètement désendettée depuis le 1er janvier 2010, tout en investissant et en faisant vivre son monde associatif de la même façon que de nombreuses villes. Contrairement à ce que j'ai pu lire ces derniers jours, ma commune n'est pas une commune low cost, comme le dit le président du conseil général de Seine-Saint-Denis dans Le Figaro de ce matin. Nous offrons dans nos domaines de compétence plus de services que certains. Ceux qui ont à craindre cette réforme sont donc ceux qui gèrent mal depuis trop longtemps.
Pour terminer, je parlerai en quelques mots du territoire de l'Île-de-France, qui me concerne plus particulièrement. Ce débat sur les collectivités territoriales est l'occasion de rappeler l'opportunité de mettre en oeuvre le plus rapidement possible le projet du Grand Paris, dont nous avons débattu récemment dans cet hémicycle, pour le bien-être des Franciliens. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, mes chers collègues, mon propos portera sur le domaine dont vous avez en principe la responsabilité, monsieur le ministre : la politique des territoires. Historiquement, la décentralisation et l'aménagement du territoire ont été difficiles à concilier, à articuler. Selon les périodes et les régions, cette articulation a été plus ou moins réussie. Aujourd'hui, le phénomène de recentralisation auquel nous assistons risque d'aggraver considérablement la situation d'un certain nombre de territoires et de villes moyennes dans notre pays, et il est à craindre que la réforme annoncée n'accentue cette situation.
Je prendrai trois exemples de recentralisation.
Le premier est le regroupement de services de l'État dans les territoires. Lorsque nous avons discuté de votre budget, monsieur le ministre, j'avais indiqué combien la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, également dénoncée par la Cour des comptes, avait un impact redoutable sur les services territoriaux de l'État. On le voit avec le regroupement des directions départementales en une direction unique qui porte le nom évocateur de DDT. (Sourires.)
M. Borloo va bientôt l'interdire !

Nous le voyons aussi avec la baisse des effectifs des sous-préfectures. Je pense à certaines catégories de dossiers comme les titres de séjour, dont il est très difficile d'obtenir le renouvellement dans des délais normaux.
Nous le voyons aussi avec l'implantation de plus en plus régionalisée des DRIRE. De ce fait, celles-ci ne veulent plus s'occuper d'un certain nombre d'établissements, car elles ne sont plus intéressées en dessous d'un certain seuil et pensent qu'il vaudrait pratiquement mieux les faire disparaître – j'en ai eu un exemple récemment avec l'exploitation d'une carrière.
Le deuxième exemple concerne tous les réseaux de proximité en matière économique. Beaucoup de moyens ont été donnés à Oseo, on essaie de renforcer les moyens d'Unifrance. Mais nous pouvons constater que ces services sont organisés essentiellement dans les métropoles régionales. Il y a très peu de réseaux sur le terrain. De surcroît, la concentration des réseaux consulaires risque de priver sur le terrain des réseaux de proximité et des acteurs de proximité dont on a besoin.
Il y a, dans notre pays, ce que les Allemands appellent des champions cachés, c'est-à-dire des PME ou de petites entreprises, souvent très performantes à l'exportation, mais qui ont besoin de réseaux d'accompagnement. Le danger est que, compte tenu de la situation actuelle, ces champions cachés risquent de devenir demain des champions inconnus ou même des champions abandonnés.
Troisième exemple : le refus de régulation et même de régulation concertée pour les médecins. Ce phénomène touche d'ores et déjà de manière dramatique beaucoup de territoires ruraux, mais il va également commencer à affecter les villes moyennes. Nous assistons là aussi, de façon générale, à un phénomène de métropolisation, à un phénomène spontané de recentralisation territoriale au détriment de territoires où, paradoxalement, la démographie progresse. Nous voyons un nouveau monde rural très différent de l'ancien : la composition de la population est très différente et beaucoup de villes moyennes connaissent une progression démographique marquée.
Je crains que la réforme qui nous est annoncée ne fasse qu'accentuer ces phénomènes. Pourquoi ?
D'abord, la réforme de la taxe professionnelle a été accomplie largement au détriment – c'est tout le débat que nous avons eu ici – des départements ruraux, des villes moyennes et des communautés de communes rurales.
Nous avons, comme vous, le souci de voir les communautés de communes se renforcer. Mais lorsqu'il s'agit de territoires ruraux dont la superficie est relativement élevée, on ne peut pas indéfiniment multiplier les concentrations de communautés de communes, car il faut, un jour, résoudre le problème de gestion kilométrique. Le problème pour les communautés de communes est de disposer d'un interlocuteur fiable. Je doute fort que celui-ci puisse être uniquement les régions – il ne s'agit pas de mauvaise volonté de celles-ci, mais je crains qu'elles n'aient pas la capacité de suivre l'ensemble des communautés de communes rurales. Demain, l'existence d'un interlocuteur généraliste risque donc de se poser pour ces communautés. De ce point de vue, la remise en question de la compétence générale des départements, au moins dans un certain nombre de régions, me paraît extrêmement dangereuse.
Je vois mal comment pourront exister les nouveaux conseillers territoriaux, écartelés entre la région et le département. Il aurait peut-être été bon de rechercher une certaine différenciation, comme cela se fait dans beaucoup d'autres pays, entre les grandes zones d'agglomérations urbaines et les territoires à dominante rurale qui n'ont pas forcément besoin de disposer tout à fait du même système d'organisation territoriale.
Pour les conseillers généraux, qui jouent un rôle de proximité très important, la vraie priorité réside aujourd'hui beaucoup plus dans le redécoupage cantonal, car il existe des disparités de représentation absolument inacceptables.
Monsieur le ministre, je suis extrêmement inquiet pour l'avenir des territoires, sur la politique des territoires, dont vous avez en principe la charge. Si nous ne sommes pas capables de donner à ces territoires les interlocuteurs, les réseaux, la représentation qui leur permettront de se faire effectivement entendre, vous les condamnerez au renoncement ou à la révolte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je souhaite articuler mon propos autour de plusieurs points. Je voudrais examiner la situation actuelle, l'histoire de la décentralisation, comme l'a fait Dominique Perben, et voir, comme Elisabeth Guigou, ce qui est proposé.
J'essaierai, en reprenant la formule de Nicolas Sarkozy –« N'essayons pas de réinventer la roue, regardons ce qui se passe en Europe » –, montrer en quoi ce que propose aujourd'hui le Gouvernement est en totale contradiction avec tout ce qui se passe en Europe.
Ai-je besoin d'insister longuement sur l'impressionnant bilan de la décentralisation ? Selon les chercheurs qui font autorité en la matière, les inégalités territoriales ont diminué depuis trente ans. Lorsque l'on fait le bilan de chacune des compétences transférées, quelle que soit la sensibilité politique des exécutifs locaux, nous constatons que tous les services publics se sont améliorés, que ce soit au niveau des départements ou des régions. Pour les TER il s'agissait de régionalisation ou de privatisation, de même pour les lycées et les collèges. En ce qui concerne les formations sanitaires et sociales, songez, monsieur le ministre, que l'État faisait payer leurs études aux aides soignantes, à ces personnes que l'on sortait de « fin de droits ». Aujourd'hui une région comme la mienne sort mille personnes de « fin de droits » et du RMI.
En ce qui concerne les transferts de techniciens et ouvriers de l'éducation nationale, nous récupérons des dizaines de milliers de personnes, dont un pourcentage non négligeable bénéficient d'emplois précaires, licenciés en juin par l'éducation nationale et recrutés de nouveau en septembre ou en octobre.
Toutes les expériences menées par la décentralisation sont positives. Progressivement, la montée en puissance de ces expérimentations et de la gestion de ces services publics fait que nous sommes obligés d'arriver à une spécificité des compétences. En effet, 90 % du budget des départements ou des régions portent sur des compétences différentes. Le millefeuille est donc en train de se simplifier.
Mais il faut aller au-delà. Mme Lagarde, à la suite à des propositions que j'avais formulées voici quelques mois, avait suggéré d'expérimenter la création d'un service public régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Dans les régions, les services de l'emploi n'ont pas de patron, pas de pilote. Il existe plusieurs dizaines d'organismes. Entre les missions locales, le Pôle Emploi, les PAIO, les PLI, le chômeur devient un nomade qui termine souvent dans le bureau du maire.

Nous savons tous ce que cela signifie.
Un de nos collègues a évoqué tout à l'heure les expérimentations. Ma région, comme l'Alsace, était volontaire pour expérimenter le pilotage. Dans ce pays vertical, jacobin, cloisonné, qu'est la France, la réforme de Jean-Pierre Raffarin en 2004 a été départementaliste, alors qu'elle devait être régionale. L'heure des régions doit arriver, comme partout en Europe. Il aurait été intelligent que les compétences de formation, d'enseignement, d'apprentissage et de développement économique que les régions acquièrent progressivement soient mises les unes en face des autres pour qu'enfin les entreprises ne disent pas : « Je recrute, mais je ne trouve pas de salariés. » Des dispositifs ont été mis en place dans ma région, parce qu'une des entreprises du sud de l'Aquitaine devait recruter cent personnes par an. Cela a marché avec une personne, qui a assuré la coordination. Cela aura été un progrès.
De la même manière, ne faut-il pas se dire que l'enseignement professionnel, qui a été révolutionné par les régions, pourrait passer plus encore sous la responsabilité des régions, comme l'enseignement agricole ? Après tout, l'enseignement professionnel a aujourd'hui, dans la qualité de ses bâtiments, de ses plateaux techniques, de son informatisation, obtenu des résultats exceptionnels. Il existe même, monsieur le ministre – il faut le dire au Président de la République –, des internats d'excellence financés par les régions,
Et même parfois par les départements !

Peut-être !
Il existe également des internats d'excellence où les élèves internes sont automatiquement branchés, si je puis dire, sur les systèmes d'information et d'orientation.
La décentralisation pouvait se faire dans ce sens-là.
Aujourd'hui, nous nous trouvons devant un paradoxe assez incroyable. Le Président de la République – je transmettrai à Dominique Perben toutes les citations des responsables politiques de la majorité montrant qu'ils sont en totale contradiction avec ce qu'ils ont pensé, dit et voulu il y a quatre, cinq ou six ans – disait : « La condition de la réforme de l'État, c'est la décentralisation. Pour cela il faut que l'État se réforme. Pour que l'État se réforme il faut la décentralisation. » Or, aujourd'hui, vous êtes en train d'inverser le paradigme. Nous sommes en pleine centralisation pour le programme régional des formations – demain, il faudra la signature du préfet et du recteur – et pour la politique industrielle. Les régions ont-elles été associées aux États généraux de l'industrie ? Non !

Ce sont les préfets, alors même que les régions sont chefs de file de développement économique. Tout cela a été mené par l'appareil d'État.

Pourtant, nous aurions besoin d'un dialogue avec l'État, sur ce qu'il doit faire en matière de politique industrielle, pour les fonds propres, les secteurs stratégiques, les technologies clefs. L'État s'est même engagé sur les États généraux de l'aménagement rural, sans associer les départements ou les régions.

On marche sur la tête ! Aujourd'hui, celui qui complexifie tout, c'est l'État.

Pourquoi ? Pour des raisons simples : l'État est en difficulté budgétaire. Chaque fois qu'il veut lancer un projet relevant de ses compétences, il doit demander le cofinancement des collectivités locales. Je pense notamment au projet Campus, qui n'aurait pas pu être réalisé autrement.
Pour la LGV, c'est pareil. Si nous faisons une comparaison avec l'Espagne, nous avons l'impression de marcher sur la tête.
Aujourd'hui, qui est le responsable du millefeuille ? C'est l'État, qui veut maintenir à tout prix les services partout sur le territoire. Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de nos collègues. Contrairement à mon collègue Garrigue, je suis pour la suppression des sous-préfectures. Sinon, nous ne parviendrons jamais à responsabiliser les intercommunalités. Je suis pour que les services de l'État soient rapatriés dans leurs compétences régaliennes et que l'on responsabilise les collectivités locales pour les leurs.
Mais, aujourd'hui, l'État veut continuer à intervenir partout. Et, ce faisant, il intervient mal partout, en voulant tout commander. Je crois qu'il y a là une réforme dont on a besoin.
Monsieur Perben, le couple région-département n'a pas de sens, vous le savez. Et j'ai rappelé que les orientations budgétaires sont à 90 % différentes.
Le couple département-commune gère le social, les collèges, les infrastructures, les équipements. Où vont les crédits du département du Rhône ? Comment ce département fonctionne-t-il ? La région a des compétences que l'État a décentralisées et les régions fonctionnement relativement bien. Je viens d'avoir une discussion avec le parlementaire chargé d'une mission sur les fonds européens. Si les régions ne s'étaient pas mobilisées, il y aurait eu, partout en France, des dégagements d'office. Vous pouvez en témoigner, monsieur le ministre.

Sauf dans une seule région, parce que vous avez proposé la délégation globale à certaines communes du sud de la France.
Nous en parlerons tout à l'heure.

J'ai organisé suffisamment de réunions techniques pour pouvoir l'affirmer. Il sera difficile de me prendre en défaut.
Pourquoi la gestion actuelle fonctionne-t-elle mal ? Parce que nous ne sommes pas allés au bout de la décentralisation. Allons-y ! L'unité nationale de la France n'est pas menacée. Arrêtons avec le système vertical. Cessons de croire qu'il faut des missi dominici, des proconsuls. Les élus ont fait des études. La France a besoin de se responsabiliser.

J'en appelle à la responsabilité de chacun et à la démocratie.
Votre texte ne favorise pas la légitimité démocratique des intercommunalités, et je parle en connaissance de cause. Le fléchage pour les élus intercommunaux, ce n'est pas une élection au suffrage universel. Cela ne change rien.

Allons jusqu'au bout et essayons de trouver un scrutin mixte, pour partie au suffrage universel – afin que les métropoles disposent d'un véritable pouvoir – et pour le reste avec des représentants des communes. Créons au niveau du département une élection départementale à la proportionnelle. Vous savez très bien qu'avec votre conseiller territorial on aboutira à une conférence interdépartementale, le professeur Bruno Rémond l'écrivait dans le Figaro il y a quelques jours. Les régions financent la recherche à la même hauteur que l'ANR. Lorsque des conseillers généraux seront à la région, comment voulez-vous que des actions de long terme prévalent sur des actions d'équipements locaux ? Je sais ce qu'est un établissement public régional, les élus venaient y faire leur marché. C'est ce que vous êtes en train d'organiser. À la différence des autres pays européens, la France est en train de tuer les régions alors que depuis trente ans – depuis Olivier Guichard – elle avait essayé de bâtir un modèle un peu régional.
La faiblesse de la représentation politique des régions, au Sénat notamment, fait qu'aujourd'hui la France va marcher à rebours. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre débat m'a permis de comprendre quelle était la philosophie de la majorité en matière de collectivités locales. Les propos tenus par M. Perben m'ont pour le moins surpris. Je m'étonne en effet que M. Perben, qui est un homme intelligent, …

…qui a été ministre et qui a travaillé au sein du comité Balladur, ne puisse admettre qu'un certain nombre de projets et de propositions de loi votés par la majorité actuelle vont, de fait, dans le sens d'une recentralisation. L'État essaie de reprendre ce que la loi a donné aux élus. Je vais illustrer mon propos avec la loi sur le Grand Paris, exemple parfait de la stratégie gouvernementale de reprise en main d'un certain nombre de pouvoirs. Nous faisons tous le même constat : l'Île-de-France souffre de graves inégalités et connaît des problèmes de transports et d'organisation territoriale. Le Gouvernement, c'est de bonne guerre, considère que la responsabilité de cette situation incombe à Jean-Paul Huchon et Bertrand Delanoë.

Le Gouvernement oublie de dire que si nous en sommes là, c'est parce que l'État a dirigé cette région pendant cinquante ans. Il y a encore trois ans, les fonctionnaires d'État dirigeaient le STIF. Jean-Paul Huchon n'est président de ce syndicat que depuis trois ans. Or certains voudraient lui faire porter la responsabilité des désordres dans le fonctionnement des transports en commun de cette région.
Les lois de décentralisation découlent du constat – qui remonte à vingt-cinq ans – de l'incapacité de l'État à organiser intelligemment la région métropole, après que le préfet Delouvrier eut oeuvré. Rappelons que, jusqu'en 1977, c'était un préfet qui dirigeait la ville de Paris. Les lois de décentralisation consistaient à donner le pouvoir aux élus et aux habitants afin qu'ils puissent mettre en oeuvre un projet politique après des élections démocratiques et développer les territoires. Petit à petit, la situation s'améliorait. En partie grâce à Paris Métropole, les élus commencent à se parler en Île-de-France, ce qui n'était pas le cas auparavant. Jamais le maire de Paris ne se déplaçait en banlieue pour parler avec ses collègues. Paris parlait à Paris, la proche banlieue à la proche banlieue, la grande banlieue à la grande banlieue. Progressivement, les élus ont commencé à se parler, à réfléchir ensemble et à avoir des projets communs, droite et gauche confondues. Or, au moment où la situation s'améliore, le Président de la République – désapprouvant sans doute cette situation – invente le projet du Grand Paris,...

…qu'il confie à M. Christian Blanc, lequel ne propose, dans un premier temps, qu'un projet de loi consacré à l'organisation des transports. Si cela n'est pas de la recentralisation, qu'est-ce donc, monsieur Perben ?
Le STIF est l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France. La loi lui a conféré ce pouvoir. Mais comme cela déplaît au Gouvernement, il crée une nouvelle structure – la Société du Grand Paris – constituée par un directoire de trois membres nommés par décret, sur avis d'un conseil de surveillance dont la moitié au moins est composée de représentants de l'État. La Société du Grand Paris est maître d'ouvrage de la réalisation des nouvelles infrastructures de transports. Elle conçoit, elle élabore, elle réalise, elle exproprie. Si la loi est votée, elle bénéficiera de textes dérogatoires au droit commun : elle pourra exproprier, saisir des terrains. Elle deviendra propriétaire des terrains de RFF, de la SNCF et de la RATP pour l'euro symbolique. Bref, elle aura la maîtrise de l'organisation non seulement des métros, mais également de la construction de quarante-trois nouvelles gares et des quartiers périphériques autour de ces gares, sans aucun contrôle démocratique. Certes, il nous fut concédé que les maires pourraient signer des contrats de développement territoriaux, mais, s'ils refusent, la Société du Grand Paris peut passer outre. On en revient aux outils d'État créés par le préfet Delouvrier – sans contrôle parlementaire, sans que les élus aient droit à la parole – en matière de construction de gares, de logements et d'organisation des activités en Île-de-France. Vous proposez de revenir à ce qui n'a pas fonctionné il y a cinquante ans en faisant fi de toutes les lois de décentralisation. Et vous prétendez, monsieur Perben que dessaisir quelqu'un de son pouvoir pour le confier à un autre n'est pas de la recentralisation ? En outre, la Société du Grand Paris ne sera soumise à aucun contrôle démocratique. Vous allez même plus loin avec la suppression de la taxe professionnelle. Je rappelle que deux articles qui sont passés inaperçus lors de l'examen du projet de loi de finances concernent la suppression de deux fonds de péréquation, les seuls qui existaient pour les communes.

Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle a juridiquement disparu. Ce fonds était calculé sur la taxe professionnelle ; celle-ci ayant disparu, il disparaît avec elle.

Ce fonds n'avait rien de scandaleux dans la mesure où il bénéficiait à des communes défavorisées situées à proximité de grandes infrastructures comme les aéroports, les centrales nucléaires ou les ports. Ce fonds leur permettait de bénéficier de la retombée des ressources fiscales de ces grands établissements.
Le Gouvernement nous dit de ne pas nous inquiéter pour 2010, mais que se passera-t-il en 2011 ? Nous serons fixés au mois de juin pour 2011 et 2012. Nous saurons alors à quelle sauce nous serons mangés !
Le fonds de solidarité de la région Île-de-France était unique en son genre dans la mesure où les communes riches payaient pour les communes pauvres. La taxe professionnelle des communes riches était reversée aux communes pauvres, soit 180 millions d'euros par an ! Ce fonds a disparu et je vous mets au défi, monsieur le ministre, de me démontrer le contraire. C'est mathématique : la suppression de la taxe professionnelle entraîne la suppression de ce fonds. M. Woerth lui-même que j'ai interpellé sur ce sujet a été obligé de reconnaître qu'il y avait un problème auquel il fallait réfléchir. Toujours est-il que la réalité est aujourd'hui la suivante : le FDTP et le fonds de solidarité Île-de-France ont disparu. Les communes les plus pauvres n'ont plus les moyens de mettre en oeuvre leur politique, le STIF n'a plus les moyens d'organiser intelligemment le transport en Île-de-France. L'ANRU ne disposant plus d'aucun financement, la solution consistera à aller frapper à la porte de M. Blanc puisque, pour les vingt ans à venir, c'est lui qui organisera l'aménagement urbain, le logement et les transports. Si ce n'est pas de la recentralisation, ça y ressemble ! Pour obtenir des financements, il faudra aller voir des ministres ! Les communes n'auront plus les moyens de mettre en oeuvre leurs projets, notamment en raison de la disparition des fonds de péréquation. Comme il y a quarante ans, il faudra aller frapper à la porte du préfet ou du ministre afin qu'ils daignent accorder une gare ici ou un équipement là.
M. Perben approuve la suppression de la clause de compétence générale. Avec cette suppression, un maire sera dans l'incapacité d'assurer la rénovation des écoles. Si la région et le département ne financent pas les écoles, la commune ne pourra pas le faire. Nous n'aurons plus non plus la possibilité de mettre en oeuvre les équipements culturels. Tous les projets dépendent de financements croisés et c'est possible jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas de clause de compétence générale. La région et le département peuvent en effet financer des projets dans l'intérêt général. Si vous supprimez la clause de compétence générale, cela ne sera plus possible.
Pis : vous souhaitez qu'une collectivité finance à hauteur d'au moins 50 % les équipements. La quasi-totalité des communes de France sont dans l'incapacité de le faire.

Les communes ont besoin de davantage de financements, il leur est impossible, en raison de la suppression de la taxe professionnelle, de financer à plus de 50 % les équipements indispensables aux populations. Priver les intercommunalités et les collectivités locales de leurs ressources, décider de transférer les pouvoirs du STIF à la Société du Grand Paris, qui ne sera pas contrôlée, tout cela s'apparente à de la recentralisation en dépit de ce que vous prétendez.
Nous vous appelons, chers collègues, à vous ressaisir. Si l'Île-de-France est dans une telle situation, c'est à cause de la politique qui a été mise en oeuvre il y a cinquante ans. S'il y a des ghettos sociaux, ethniques, urbains, c'est pour cette raison. Ne préparez pas les ghettos de demain ! (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Depuis la révision constitutionnelle de 2003, notre République est une République décentralisée, avec une certaine vision politique des libertés locales, mais aussi avec les progrès nombreux de la décentralisation depuis deux cents ans. Aujourd'hui, nos collectivités gèrent librement les affaires relevant de leur compétence et décident de leur budget. Selon notre Constitution, inventée – c'est-à-dire mise à jour – par le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration implique qu'elles puissent disposer de ressources suffisantes pour exercer effectivement leurs responsabilités, mais aussi que le nombre et le poids de leurs dépenses obligatoires ne soient pas excessifs.
En 1911, dans son Histoire du droit français de 1789 à 1814, Adhémar Esmein, qui fut l'un des grands juristes de la Troisième République et un spécialiste de l'histoire du droit, évoque ainsi la France d'avant 1789 : la France « soupirait après les libertés locales autant qu'après la liberté politique », enserrée qu'elle était dans « une centralisation étouffante » depuis plusieurs siècles.
Il rappelle ensuite que le cadre juridique uniforme, donné par l'Assemblée constituante aux communes en 1789, reposait sur l'idée qu'il fallait étendre à tous les citoyens le bénéfice d'un privilège réservé jusqu'alors à quelques citoyens des villes : celui d'un gouvernement par elles-mêmes des unités administratives et politiques de base. L'Assemblée constituante concilia la nouveauté avec le réalisme en décidant d'étendre la démocratie en l'appliquant aux communautés, aux paroisses notamment, déjà existantes.
Enfin, Esmein indique que la création des départements répond, à l'origine, à une logique d'harmonisation et d'extension de la démocratie locale, sous-tendue par la volonté politique de créer une unité vivante et pas seulement une circonscription administrative.
Pourquoi évoquer dans notre débat, me direz-vous, les circonstances ayant présidé à l'émergence de nos collectivités, il y a déjà fort longtemps ? Évidemment pour y trouver une façon d'éclairer nos débats actuels.
Trois raisons m'amènent à le faire. Dans la tradition républicaine, l'exercice des libertés locales a toujours été lié à l'exercice de la liberté politique des citoyens ; historiquement, les attributions des collectivités ont été pensées de façon large et leurs pouvoirs libres, comme on disait à propos de la gestion des intérêts locaux, ont toujours été reconnus – même si le pouvoir central les a souvent limités ou a été tenté de les superviser ; enfin, le cadre uniforme donné avait pour objet de faire vivre la démocratie partout, tout en ayant la préoccupation de ne pas en faire seulement le support à de simples circonscriptions administratives gérées par des élus.
À bien y regarder, la réforme annoncée par le Président de la République constitue – malgré les évidentes différences entre hier et aujourd'hui – une triple rupture.
Ce qu'on nous propose, ce sont d'abord des collectivités étroitement spécialisées, et donc incapables de réactivité par rapport aux besoins locaux ; ce sont ensuite des collectivités devenues des guichets de délivrance de prestations qu'elles ne maîtriseront pas, et qu'elles n'auront pas les moyens financiers d'assurer ; ce sont enfin des élus réduits à être, pour les uns, des décideurs sans légitimité majoritaire, et, pour les autres, des administrateurs de circonscriptions administratives.
J'ajouterai qu'à cette triple fracture s'ajoute une crainte sur la capacité des collectivités à pouvoir continuer à jouer leur rôle fondamental d'investisseur et donc d'innovateur et de préparateur de l'avenir. Ainsi, la clause de compétence générale, qui permet d'intervenir dans tous les secteurs d'intérêt local, ne serait plus demain, après la réforme, que le fait des communes et de l'État, les régions et les départements étant désormais spécialisés.
En pratique, cela veut dire que les départements et les régions n'auront plus la capacité d'intervenir en fonction de ce qui fait l'intérêt d'une opération ou d'un projet pour leurs concitoyens. Un intérêt local restera définitivement un intérêt communal, et les pouvoirs libres des départements et régions disparaîtront.
Limiter de façon mécanique l'intervention de plusieurs collectivités sur un même objet ou projet – au motif que celles-ci seraient par définition rivales – relève d'un a-priori consistant à juger les libertés locales comme dangereuses pour la maîtrise de la dépense publique locale.
La liberté locale pour les citoyens et pour leurs élus doit pourtant être de pouvoir approuver un projet s'ils considèrent que celui-ci sert leurs intérêts complémentaires de contribuables locaux, départementaux et régionaux.
L'exercice de cette liberté suppose, il est vrai, qu'elle soit évaluée. Cette évaluation est le fait naturel des citoyens éclairé par un avis indépendant. C'était le choix fait par les lois de décentralisation des années 1980 qui, au-delà de la consécration du suffrage universel à tous les niveaux des collectivités locales, l'avait accompagné de la création des chambres régionales des comptes. Je note que le Gouvernement a délibérément choisi l'option de les supprimer. Autrement dit, la majorité entend faire reculer la liberté et la responsabilité par une interdiction de principe.
De façon plus générale, je conteste une méthode qui consiste à mettre d'emblée sous contrainte des collectivités et à limiter leurs libertés, sans avoir préalablement engagé une réflexion de fond sur leurs missions. On s'éloigne donc résolument du principe de liberté, tel que le concevaient les hommes des Lumières.
Je constate ensuite que les dernières lois organisant, en 2004, un transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales ont valu report de charges pour l'exercice d'activités dont le coût croissant n'a pas été compensé par des ressources fiscales suffisantes et évolutives.
Cette étape d'externalisation des dépenses de l'État vers les collectivités s'est faite au coût historique des transferts, sans dispositif de compensation en vue de tenir compte des évolutions économiques et démographiques. L'augmentation des dépenses sociales des départements, évoquée tout à l'heure, supportée par les contribuables locaux dans le cadre d'une fiscalité inadaptée, en est malheureusement un bon exemple.
Pourtant, la réforme qui nous attend, couplée avec l'instauration de la cotisation économique territoriale, va prolonger et amplifier ce mouvement.
L'autonomie fiscale va continuer à être remplacée par un système complexe et lourd de dotations dont la lisibilité et l'intelligibilité sont quasiment impossibles pour un citoyen-contribuable – même éclairé. Pourtant celui-ci verra toujours, tous les mois, tous les ans, lentement et sûrement, les montants à payer augmenter.
Ainsi les collectivités, privées de marges de manoeuvre, vont-elles tendre à devenir de super-guichets de financement – sur lesquels l'État disposera d'un droit de tirage, tout en les laissant responsables des augmentations devant les citoyens.
Sans autonomie fiscale, l'autonomie financière, support des libertés locales, devient un ectoplasme, c'est-à-dire, littéralement, quelque chose en dehors de ce qui est déjà formé.
Enfin, la République s'est enracinée pendant deux siècles dans le terreau de libertés locales qui permettent aux citoyens d'agir au plus près de leurs besoins. L'idée était et reste d'organiser, mais surtout de faire vivre la démocratie. Communes, départements et régions ont, à leur moment et dans leur espace, su répondre à cet objectif. En fusionnant deux champs démocratiques en une organisation à deux têtes, avec d'une part des élus dont on nous dit qu'ils pourront être désignés comme décideurs sans être majoritaires devant le peuple, et d'autre part des élus d'opposition administrateurs dans un double conseil découplé du territoire concret, nous risquons une véritable déconnexion démocratique.
Je voulais enfin rappeler le risque de recul des projets, donc de la démocratie vivante, qu'illustre selon moi la probable diminution des investissements faits par les collectivités locales.
À cela s'ajoute l'adoption de la contribution économique territoriale, qui n'est pas un véritable impôt économique local, flexible dans son taux et adaptable à la réalité de terrain.
Pour investir, les collectivités ont pourtant besoin de percevoir des impôts et non des dotations. Le risque est réel que les collectivités diminuent leurs investissements, alors même qu'elles contribuent au dynamisme économique en finançant 70 % de l'investissement public. Baisser les investissements, ce sont moins de travaux et d'équipements pour l'avenir. Ce sont aussi moins de projets qui structurent une communauté humaine autour de son avenir.
C'est donc en définitive fragiliser les libertés locales, qui ont toujours été liées dans notre pays à la liberté politique. Je l'ai dit dans un autre débat : être français, c'est avoir une grande solidarité de vie et d'avenir.
Monsieur le ministre, en voulant réformer vite et contre la démocratie vivante, le Président de la République et le Gouvernement prennent le risque d'une réforme peut-être compatible avec le texte constitutionnel, mais qui, assurément, met à mal la constitution sociale de notre pays : à un moment ou à un autre, nous en paierons le prix ! (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je voudrais tout d'abord excuser l'absence de M. Brice Hortefeux, retenu à une réunion des ministres de l'intérieur européens.

On ne le voit pas beaucoup, Hortefeux. En tout cas, sur la LOPPSI, on l'attend toujours !
Je vais essayer de le remplacer ; ce sera probablement moins bien, mais je vais faire de mon mieux ! (Sourires.)
Madame Guigou, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir introduit le débat sur un ton extrêmement modéré, en vous efforçant de vous demander comment améliorer la décentralisation, tout en recherchant un certain consensus.
Aujourd'hui, la décentralisation – je le dis d'emblée – est notre bien commun : un démocrate-chrétien comme moi peut employer ce terme. Il n'est donc pas question de revenir sur la décentralisation. Mais on peut en discuter, et j'espère bien pouvoir débattre avec vous des propositions du Gouvernement.
Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, il faut rechercher un minimum de consensus dans la décentralisation. C'est vrai. Mais il est vrai aussi – l'histoire récente l'a montré – que ceux qui sont dans l'opposition, quels qu'ils soient, étant plutôt contre les propositions du gouvernement et l'alternance jouant, nous avons tous été, à un moment donné, plutôt contre la décentralisation, alors qu'il aurait sans doute fallu être pour afin de dégager une philosophie commune permettant de la mettre en oeuvre. J'espère que nous y parviendrons. La méthode qu'a choisie le Gouvernement est de mettre sur la table, à la disposition des parlementaires, tous les textes, mais de ne pas les discuter tous ensemble, afin de conserver une certaine clarté.
Nous avons commencé depuis deux jours la discussion du texte institutionnel au Sénat ; viendront ensuite le texte électoral et le texte sur les compétences. Cela nous laisse du temps pour discuter, améliorer, approfondir et rechercher partout le plus grand accord possible.
Je vais essayer de répondre à chacun d'entre vous. Je comprends bien que les membres de l'opposition s'opposent aux propositions du Gouvernement lorsqu'elles leur paraissent mauvaises ; mais je voudrais redire que jamais l'idée de remettre en cause la décentralisation ne nous a traversé l'esprit : d'une part, parce que nous adhérons à l'idée de décentralisation, qui est pour nous une valeur ; d'autre part, et très simplement, parce que l'État n'a pas aujourd'hui les moyens de remplacer les collectivités territoriales en revenant sur la décentralisation.
Toutes les collectivités territoriales – communes, départements, régions – ont fait du bon travail. Si la France a changé ces dernières années, c'est parce qu'il y a eu des élus locaux qui, à travers les institutions locales, se sont donnés complètement à leur mission. Mais, comme l'a souligné M. Perben, toutes les lois qui se sont succédé depuis 1981 ont été des lois de transfert de compétences : beaucoup de compétences ont été transférées aux communes, notamment celles relatives au droit du sol, et aux départements – et comme l'a souligné tout à l'heure le président Rousset, toutes les réformes qui devaient être régionales ont fini par être départementales. Toutes les collectivités se sont donc vu transférer des compétences. Mais aujourd'hui, on peut juger que le transfert de compétences est fait, ou en tout cas nécessite une pause ; et il faut se pencher sur l'organisation institutionnelle de la décentralisation. C'est ce que nous essayons de faire par la réforme qui va nous occuper pendant de nombreux mois – une année probablement.
Sans doute, madame Guigou, la concertation n'a-t-elle pas été suffisante : on n'en fait jamais assez. Mais il faut aussi qu'une envie d'aboutir se manifeste chez les uns comme chez les autres. Du reste, le temps de la concertation n'est pas terminé.
Vous avez fait allusion aux conclusions de la commission Belot sur lesquelles le Gouvernement a annoncé qu'il se fonderait pour tout ce qui concerne les compétences, question sur laquelle elles portent pour l'essentiel. Sachez que, en ce domaine, nous sommes tout à fait ouverts au dialogue.
Permettez-moi à présent de revenir au projet de loi dont votre assemblée sera saisie dans quelques semaines. S'il y a une loi qui a restructuré les territoires, c'est la loi Chevènement sur l'intercommunalité, dont j'étais l'un des deux rapporteurs au Sénat, qui l'a adoptée dans un assez large consensus. Elle a permis, je crois, de répondre à une véritable demande des élus locaux et d'organiser le territoire à partir des structures intercommunales.
Le projet de loi du Gouvernement vise une mise en place complète de l'intercommunalité, en comblant les lacunes, en rationalisant les périmètres et en démocratisant les structures quand cela s'impose.
Les propositions du Gouvernement sont simples et claires. Dès lors que l'intercommunalité vote l'impôt et intervient dans des domaines de plus en plus importants, qui touchent à la vie de nos concitoyens, il apparaît normal que ce soit à nos concitoyens qu'il revienne de choisir directement les délégués au conseil de l'intercommunalité, quelle qu'en soit la nature. Nous proposons un système de fléchage. L'important est de parvenir à démocratiser ces structures.
Pour ce qui est des autres structures, M. Perben a attiré notre attention sur les métropoles. Aujourd'hui, un constat s'impose : les impératifs liés à la compétitivité économique et scientifique nécessitent d'organiser quelques grandes métropoles. Les propositions du Gouvernement résultent de la concertation qui a eu lieu. J'ai bien compris que certains d'entre vous – M. Perben en particulier – souhaitaient aller plus loin. Je dois dire que je suis d'accord avec lui, car les métropoles ont un poids déterminant. Le Gouvernement a annoncé, par la voix de M. le ministre de l'intérieur, en préambule de la discussion du projet de loi au Sénat, qu'il était prêt à aller plus loin en ce domaine.
Comme l'a gentiment souligné M. Derosier, cela fait un certain temps que je suis président de conseil général, et je sais que, dans un département urbain, il importe d'être extrêmement présent en ville.
J'ai toujours veillé à ce que le conseil général du Rhône soit présent au coeur de l'agglomération. Là, nous recevons un meilleur accueil de la part de la population que n'en a la mairie de la ville préfecture.
Si, demain, le progrès institutionnel réclamait que les métropoles reposent sur des conseils démocratiquement élus par les citoyens et aspirent, pour ainsi dire, les compétences du département, cela me paraîtrait normal. Il n'y aurait aucune raison de s'opposer à cette évolution au nom du statu quo. Il faut être capable de changer quand il le faut. J'ai déclaré à plusieurs reprises que, pour ma part, j'y étais prêt. Nous sommes déjà deux à être d'accord, il nous reste à attendre le troisième ! Nous verrons bien ce que cela donnera : peut-être rien, peut-être quelque chose. Toujours est-il que c'est ainsi que les évolutions doivent intervenir.
À cet égard, je suis persuadé que, dès que j'aurai dit « oui », M. Derosier dira « oui » également.
Il y a aura ainsi en France deux exemples de métropoles bien construites, démocratiques et fortes, avec lesquelles des accords pourront être passés. Les limites administratives ne sont pas des frontières : je suis partisan de l'alliance des territoires. Les métropoles sont une réalité, mieux vaut l'organiser pour être plus efficaces.
Deux grandes critiques ont été formulées : d'abord, sur les conseillers territoriaux ; ensuite, sur les questions financières.
En ce qui concerne le conseiller territorial, les reproches portent sur le fait qu'un même élu gérera le département et la région, et sur le mode d'élection. Je voudrais, sur ces deux points, vous donner mon sentiment personnel et la position du Gouvernement.
Certes, nous aurions pu choisir de supprimer un échelon. Mais je crois que cela aurait constitué une grave erreur. Comme l'a très bien dit M. Garrigue, le département joue un grand rôle de proximité dans le domaine social et pour les territoires ruraux. Il est l'interlocuteur privilégié des communes rurales, car l'élection des conseillers généraux repose sur une base territoriale. Un scrutin proportionnel induirait un tout autre type de dialogue. Nous avons donc fait le choix tout simple de conserver les deux structures et de les rapprocher au travers d'un élu commun, qui assurera leur gestion.
C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la suppression de la clause de compétence générale. Je rappelle – parce que je suppose que personne ne l'a jamais lue – qu'elle figure à l'article 48 de la loi du 10 août 1871, qui l'a introduite pour la première fois dans notre droit. La République naissante a créé les conseillers généraux, démocratiquement élus, en prévoyant que, par leurs délibérations, ils régleraient les affaires du département.
Les « affaires du département », monsieur Derosier. En tout état de cause, je suppose que le conseil général du Nord, comme celui du Rhône, ne règle que des affaires relevant de l'intérêt général et non des affaires particulières.
Dès lors que les deux assemblées sont gérées par les mêmes personnes, il n'y a plus de chevauchement possible. Il n'est donc pas utile qu'elles invoquent la clause de compétence générale. Nous allons donc dresser la liste des compétences légales de chacun et, en cas de silence de la loi, l'article 35 du projet de loi soumis au Parlement prévoit un droit d'initiative pour les assemblées locales. Je crois pouvoir dire que le Sénat va amender les dispositions de l'article 35, comme vous pourrez le constater lorsque le texte viendra ici en discussion dans quelques semaines.
Sachez que je n'éprouve pas un respect théologique pour la clause de compétence générale. C'est avant tout une disposition pratique et il nous faut éviter les doublons. Elle ne pourra être invoquée dans les deux assemblées, où les mêmes élus siégeront : il faudra choisir ou l'une ou l'autre des assemblées, selon une logique de rationalisation.
En ce qui concerne le mode d'élection des conseillers territoriaux, le Président de la République et le Gouvernement ont bien précisé que les propositions n'étaient pas définitives : le dialogue et la concertation peuvent continuer de s'exercer.
À la suite de M. Perben, je rappelle que nous avons la tâche extrêmement compliquée de trouver un système qui réponde à trois impératifs.
Le premier est d'aboutir à un ancrage territorial des élus, qui correspond à une vraie demande de la population, et pas seulement en milieu rural. Dans le département du Rhône, grâce au redécoupage auquel nous avons procédé, avec M. Chevènement, après une délibération votée à l'unanimité par le conseil général, nous avons pu établir des cantons correspondant à des réalités humaines et historiques, dans lesquels chaque conseiller général est connu de la population.
C'est en tout cas ainsi que nous avons procédé, et tout le monde a voté pour – mais vous savez que, au conseil général du Rhône, les décisions sont toujours prises à l'unanimité ; sinon, nous ne votons pas. (Sourires.)
Le deuxième impératif est d'assurer la représentation de toutes les tendances politiques.

C'est un véritable chemin de croix pour un démocrate-chrétien, et certaines stations sont particulièrement pénibles ! (Sourires.)
Si je parvenais à vous convertir, monsieur Derosier, ce serait un grand succès ! (Sourires.)
Le troisième impératif est d'établir la parité, ce qui n'a rien de facile. Comme l'a indiqué M. Perben, la commission Balladur était parvenue à un quasi-accord sur un système qui n'était pas loin de répondre à ces trois exigences. On ne peut que déplorer qu'elle ne soit pas allée plus loin, mais peut-être pourrons-nous avancer tous ensemble en ce domaine.
S'agissant des questions financières, …
…nous allons tenter d'être clairs…
Je vous remercie de l'avoir rappelé, madame Rosso-Debord.
Nous reprocher d'avoir supprimé la taxe professionnelle, c'est quand même faire preuve d'une certaine audace, car il n'en restait plus que la moitié, puisque vous aviez déjà fait l'essentiel du chemin. Dans ce genre d'affaire, ce qui compte, c'est de commencer. Nous n'avons fait que finir le processus que vous aviez entamé, en supprimant ce très mauvais impôt.
En ce domaine, nous n'avons pas de reproches mutuels à nous adresser.
La comparaison de l'évolution des bases de la taxe professionnelle et de celle de la valeur ajoutée permet d'établir un constat simple, que nous pouvons tous faire, en tant qu'élus locaux. Les entreprises investissant de moins en moins ces dernières années, les bases de la taxe professionnelle ont connu une moindre progression, perdant en dynamisme.
Les statistiques montrent que la valeur ajoutée a, quant à elle, augmenté grâce aux efforts que les entreprises ont consentis pour être plus performantes, notamment en matière de recherche. Les bases fondées sur la valeur ajoutée ont connu un plus grand dynamisme que les bases fondées sur l'investissement. Il faut le dire.
Madame Guigou, vous n'êtes pas très convaincante, mais la vérité finit toujours par triompher.
Nous verrons !
Est-ce que cela produit le même montant ?
D'abord, l'État a garanti que le montant des recettes serait le même en 2010.
Monsieur Pupponi, il est plus facile d'ironiser que de garantir les recettes des collectivités locales alors que celles de l'État se sont effondrées de 25 %.
Cela représente un vrai effort, et je vous remercie de le reconnaître.
Un nouvel impôt sera créé, tel qu'il a été voté après les amendements de l'Assemblée nationale et du Sénat.
M. Derosier a annoncé qu'il allait prouver que le vote des taux et la péréquation sont compatibles. Il ne l'a pas prouvé, pour la bonne raison que c'est impossible : il faut choisir entre la territorialisation de l'impôt et la péréquation.
Je vous ai écouté sans rien dire, vous pouvez faire de même. Nous en reparlerons ensuite, sans aucun problème !
Quant aux deux types de fonds évoqués par M. Pupponi, ils sont juridiquement maintenus, notamment les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
La loi de finances pour 2010 prévoit expressément des rendez-vous sur l'adaptation de ces deux fonds au nouvel impôt. Preuve est faite de leur existence, puisqu'ils vont être adaptés !
Pour avoir été rapporteur de la loi au Sénat, je connais bien le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. Je me souviens de discussions acharnées entre les représentants des communes d'Île-de-France. Nous autres, provinciaux, regardions ces riches se disputer entre eux. Nous étions émerveillés par tout cet argent, nous nous demandions comment c'était possible et pourquoi nous en avions si peu.
C'était juste pour vous entendre !
Je précise que la loi de finances pour 2010 prévoit d'autres fonds de péréquation.
Bien entendu, vous avez voulu à tout prix voter les taux ! Il fallait choisir de garder le projet du Gouvernement !
Le fonds de garantie individuelle des ressources que nous avons créé donne à toutes les collectivités l'assurance de recevoir les mêmes sommes qu'en 2009. Les communes ne subiront donc aucune perte de ressources.
Pour les départements et les régions, il existe un autre fonds, abondé par l'écrêtement des ressources des collectivités les plus riches, qui permet une redistribution. Il s'agit là de l'effort de péréquation le plus important jamais réalisé. Je tenais à le souligner.
Pour conclure, car nous n'allons pas épuiser le sujet dont nous débattrons ensemble dans quelques semaines, je voudrais dire que je partage le sentiment de M. Calméjane : il faut aborder toutes les questions au cours de débats sereins, et rétablir le nécessaire climat de confiance entre l'État et les collectivités locales.
Si l'État et les collectivités s'opposent, la décentralisation est impossible.
On demande beaucoup à l'État. Il est sommé de se réformer et – si je m'en réfère aux propos de M. Rousset – de disparaître du champ de compétences des collectivités locales. C'est l'objet de la réforme en cours des préfectures.
M. Calméjane estime, lui, que l'État doit rester. Il n'a pas tort, car nous entendons cette demande sur tous les territoires, notamment en zone rurale. L'État doit donc se transformer. Il en va ainsi des sous-préfets dont nous n'avons pas besoin pour contrôler les collectivités locales et qui doivent plutôt jouer un rôle d'assembleurs.
Si les collectivités locales – notamment les intercommunalités – le veulent, les sous-préfets seront à leur disposition pour monter leurs dossiers, leur ouvrir des portes, faire en sorte qu'elles aient accès aux bons financements d'État et surtout aux bons crédits européens.
Mesdames et messieurs les députés, ce débat constitue une sorte d'introduction aux échanges sur la loi institutionnelle que nous aurons dans quelques jours…
…lorsque l'Assemblée voudra inscrire ce texte à son ordre du jour, et dont je vais aller soutenir la discussion au Sénat dans quelques instants.
J'espère que ce débat nous aura permis de déceler l'existence de marges de discussion, de concertation, et que nous pourrons avancer vers des solutions discutées et en quelque sorte partagées, même si elles ne sont pas adoptées par tous.
Je vous remercie donc d'avoir été à l'initiative de ce débat.
Et un acte de contrition, ça ne peut pas faire de mal ! (Sourires.)
Ouverture du débat

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures trente.)

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, relative à la protection des missions d'intérêt général imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive services (nos 2149, 2218).
La parole est à M. Jean-Patrick Gille, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État chargée des aînés – bon anniversaire, si j'en crois Wikipedia (Sourires) –,…

…mes chers collègues, nous entamons, en cette fin d'après-midi, l'examen de la proposition de loi déposée par le groupe SRC, relative à la protection des missions d'intérêt général imparties aux services sociaux et à la transposition de la directive services. Si l'intitulé peut sembler aride, le sujet est essentiel pour l'avenir du modèle des services sociaux français, unique en son genre en Europe.
Le présent texte poursuit trois objectifs : exclure clairement et largement les services sociaux du champ d'application de la directive services ; mettre clairement les services sociaux sous la protection de nouvelles dispositions inscrites dans le traité de Lisbonne, qui vient d'entrer en vigueur ; sécuriser, enfin, les relations entre les collectivités locales et le tiers secteur par rapport à la réglementation relative aux aides d'État, et ce en définissant clairement la notion de mandatement.
C'est dans un esprit constructif que nous souhaitions aborder ce sujet d'intérêt collectif, qui concerne un secteur auquel, je crois, nous sommes tous attachés, tant il préoccupe de nombreux élus locaux. Malheureusement, cette attitude n'a pas été partagée par la majorité de la commission des affaires sociales, qui a préféré repousser notre proposition de loi en utilisant des arguments assez inquiétants, voire étranges : je pense par exemple au caractère prétendument inéluctable de l'harmonisation par le bas de notre système social.
Mais revenons à la proposition de loi et à la directive services. Celle-ci a fait l'objet d'un débat important, et parfois tendu, entre le Parlement européen et la Commission européenne. L'intention de cette dernière était de faciliter la libre circulation des services, objectif du traité de Rome resté jusqu'alors inappliqué. Pour donner une idée exacte de l'impact potentiel de ce texte, rappelons que, en moyenne, les deux tiers des échanges entre les États membres se font au sein du marché intérieur et que les services représentent 70 % du PIB de l'Union européenne. J'appelle également votre attention sur le fait que la directive services, appelée à faire l'objet de révisions régulières, n'est pas un texte comme les autres. Elle figurera durablement dans le calendrier européen et dans le débat public. Si la première phase du processus – la révision générale des règles d'autorisation – a pris fin le 28 décembre 2009, nous entrons maintenant dans la phase d'évaluation mutuelle entre les États membres, laquelle conduira à la révision de la directive en 2011.
La directive services vise à assurer à tout prestataire de services d'un État membre la liberté d'établissement et de prestations sur tout le territoire de l'Union. Je rappelle à ce sujet, pour éviter tout faux débat, que le principe du « pays d'origine », contenu dans feue la directive Bolkestein, n'existe plus.
En privilégiant un texte « horizontal » plutôt que des initiatives législatives sectorielles, la Commission a souhaité inclure l'ensemble des services dans la directive. Le Parlement européen s'est élevé contre cette vision trop large, soulignant la nécessité d'exclure, entre autres, les services sociaux du champ d'application de la directive. Ce combat a rassemblé bon nombre de parlementaires français, dont M. Jacques Toubon. La directive finalement adoptée est donc un texte de compromis qui prévoit, en ses articles 2.2.a et 2.2.j, l'exclusion de certains services sociaux de son champ d'application. Se pose alors la question de la définition des services concernés par cette exclusion.
La France avait, comme les autres États membres, jusqu'au 28 décembre 2009 pour transposer la directive et répondre à cette question. Elle l'a fait, semble-t-il, avec quelques jours de retard, en retournant à la Commission européenne, le 5 janvier dernier, 500 fiches dites IPM, relatives à l'élaboration interactive des politiques, soit autant de notifications de régimes d'autorisation. Observons que certains État membres en auraient envoyé plusieurs milliers.
Le problème est que, en France, lesdites fiches n'ayant pas été rendues publiques, nous manquons d'informations. À cela s'ajoute que le sort de certaines activités a été traité dans plusieurs textes de la législation française récente : le guichet unique dans la loi de modernisation de l'économie, la possibilité d'appel d'offres pour les services médico-sociaux dans la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », ou encore différentes dispositions contenues dans la récente proposition de loi de simplification du droit.
Il nous a par ailleurs été indiqué qu'un rapport un peu plus « littéraire » – attendons de voir – serait élaboré par le Gouvernement d'ici à la fin du mois de janvier. Ce rapport devrait nous permettre de nous faire une idée précise de l'état des lieux. Bref, madame la secrétaire d'État, pour l'heure, nous n'avons aucun document précis sur l'état de la transposition, laquelle, il faut bien le dire, a été faite un peu en catimini.

La démarche du Gouvernement encourt deux reproches. Si la qualité du travail administratif semble indiscutable, l'exercice a été mené isolément dans chaque ministère ; aucun débat public n'a eu lieu, et les arbitrages politiques n'ont fait l'objet d'aucun contrôle du Parlement, lequel n'a même jamais été informé.
Les gouvernements de vingt-cinq des vingt-sept États membres ont, eux, choisi de soumettre une loi-cadre à leur représentation nationale. L'Allemagne et la France font exception, mais la première est un État fédéral ; en France, le choix a été fait de transposer la directive le plus discrètement possible, sans doute pour ne pas réveiller de vieux débats. Cette approche méfiante pose néanmoins problème car elle a, en retour, nourri les inquiétudes les plus diverses, non seulement au sein du secteur social, mais aussi dans les associations d'élus territoriaux, qui estiment n'avoir pas été suffisamment consultées.
Par ailleurs, certains choix du Gouvernement sont éminemment discutables. Pour l'essentiel, celui-ci a suivi le raisonnement juridique de la Commission européenne et intériorisé ses injonctions, parfois excessivement contraignantes, alors même que le Parlement européen fait une lecture beaucoup moins restrictive du champ possible des exclusions. Mme Evelyne Gebhardt, rapporteure de la directive services, nous l'a confirmé lorsque nous l'avons rencontrée : le Parlement européen a adopté un amendement refusant à la Commission la possibilité de proposer une « communication interprétative » de la directive ; elle nous a également dit que le manuel de transposition publié par la Commission n'avait pas de valeur juridique contraignante. Ayant aussi rencontré la direction générale du marché intérieur et des services de la Commission européenne, nous avons été frappés par la différence d'interprétation de la directive, selon que l'on se place du point de vue du Parlement ou de la Commission. La divergence est telle que Mme Gebhardt a estimé nécessaire de constituer une commission de suivi de la transposition de la directive au sein du Parlement européen.
La Commission européenne considère ainsi que les services liés à la petite enfance entrent dans le champ d'application de la directive, alors que le Parlement européen estime qu'ils peuvent en être aisément exclus sur le fondement de l'article 2.2.j. La négociation avec la Commission européenne a précisément conduit le Gouvernement français à inclure dans le champ de la directive le secteur des services à la petite enfance, selon un raisonnement juridique contestable et d'ailleurs fortement contesté par l'Association des maires de France, l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et de nombreux autres acteurs du secteur. Cette inclusion était si peu évidente que, le 16 septembre dernier, M. Darcos déclarait : « La majorité des services sociaux et médico-sociaux devraient pouvoir être exclus du champ d'application de la directive. Il devrait en être de même pour tous les services d'aide à domicile, crèches et haltes-garderies. » Malheureusement, ces options ont été battues en brèche par les arbitrages ultérieurs.
Le Gouvernement nous explique à présent que le fait d'inclure ce secteur dans le champ de la directive n'entraînera aucune modification de la réglementation et que celle-ci est parfaitement justifiable – et justifiée – dans le cadre de la directive. Mais je ne partage pas cet optimisme : l'exclusion du champ d'application est plus protectrice qu'une simple dérogation par rapport au droit commun. Ces services inclus dans le champ de la directive, la Cour de justice de l'Union européenne les considérera en effet comme d'autres services économiques, et leur appliquera à ce titre sa jurisprudence traditionnelle en matière de règles du marché intérieur.
Il existait pourtant une autre manière de procéder : d'une part en privilégiant la transparence avec l'élaboration, comme ce fut le cas dans la quasi-totalité des États membres, d'une loi-cadre reprenant les principales dispositions de la directive, ce qui aurait permis un vrai débat au Parlement – comme nous essayons de le faire aujourd'hui – ; d'autre part, en exploitant jusqu'au bout les possibilités d'exclusion des services sociaux du champ de la directive, donc en excluant les services à la petite enfance, la partie de la formation professionnelle à destination des demandeurs d'emploi ou encore la formation initiale différée. Je vous pose la question, madame la secrétaire d'État : pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas fait ce choix ?
Deuxième objectif de la proposition de loi : transposer en droit français le droit communautaire applicable aux services sociaux. Comme on le sait, ce droit est composé des traités, des directives et des principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; aussi demandons-nous, avec l'article 2, que toutes les dispositions protectrices des services sociaux contenues dans le droit communautaire soient utilisées, d'autant plus que le traité de Lisbonne récemment entré en vigueur comporte de nouvelles dispositions plus protectrices pour les services sociaux. Il est indispensable d'exploiter ces nouvelles possibilités. Le tiers secteur, comme l'économie sociale et solidaire, peut et doit être sécurisé par les dispositions contenues dans les traités européens.
Enfin, les articles 3 et 4 adaptent en droit français les exigences communautaires pour sécuriser le financement des services sociaux, et traitent la question du mandatement. En ne le faisant pas, le Gouvernement fragilise le modèle français des services sociaux. En effet, outre le problème immédiat de la transposition de la directive services, un autre dossier suscite de fortes inquiétudes chez tous les acteurs du secteur social, donneurs d'ordre – souvent les collectivités locales – comme prestataires : celui des aides d'État, régies par le paquet Monti-Kroes, et de la compatibilité des modes d'action des collectivités locales avec les règles de la concurrence. C'est toute la question du mandatement, c'est-à-dire la manière dont une collectivité publique charge un opérateur d'un service social d'intérêt général et le finance. Or le mandatement est précisément le critère d'exclusion du champ d'application de la directive services.
Le Gouvernement lui-même a reconnu ces difficultés dans un rapport remis à la Commission européenne sur l'application du paquet Monti-Kroes, soulignant « le décalage extrêmement important qui existe entre les préoccupations des collectivités publiques lorsqu'elles organisent les services publics dans les ressorts de leur compétence, et la façon dont le droit européen appréhende ces services ». Le même rapport conclut que des « incompréhensions fortes subsistent entre les pouvoirs publics français et les autorités communautaires », et qu'elles sont « sources d'insécurité juridique, mais également de coûts importants ».
Notre proposition de loi tente précisément de résoudre ces difficultés en établissant clairement l'exigence de mandatement, en définissant cette notion et en créant, conformément à la proposition contenue dans le rapport de Michel Thierry, une convention de subvention spécifique pour les services sociaux appelée « convention de partenariat d'intérêt général ». Ce nouvel outil, qui va plus loin que la convention pluriannuelle d'objectifs remaniée présentée par le Gouvernement le 17 décembre dernier, serait un instrument solide et juridiquement sûr pour tous les acteurs publics.
Notre objectif est donc de mieux utiliser la marge de manoeuvre et d'appréciation dévolue aux États membres par le traité de Lisbonne, de permettre aux collectivités de créer des services publics locaux et de sécuriser le fonctionnement des opérateurs en définissant, dans le droit français, la notion de mandatement. On ne peut se satisfaire plus longtemps de cette situation paradoxale, dans laquelle les régions peuvent largement financer les centres de formation d'apprentis, que ce soit pour le fonctionnement ou les investissements, tout en se voyant imposer de lancer des appels d'offres de marché public d'une grande complexité pour financer une petite association locale de lutte contre l'illettrisme.

Les collectivités territoriales sont en première ligne. Alors que la mise en oeuvre de services publics et sociaux au niveau local leur est de plus en plus souvent confiée, on ne leur permet pas, en contrepartie, de sécuriser leurs financements. Le Gouvernement leur refuse le droit de mandater, au sens du droit communautaire, les services sociaux. Face aux risques de contentieux, les collectivités privilégient dès lors systématiquement les instruments d'ouverture au marché, tels que l'appel d'offres. Cela peut avoir, dans certains cas, des résultats contraires aux effets recherchés. Les acteurs sociaux nous ont ainsi interpellés sur les risques de déstabilisation du secteur par le développement conjoint d'une offre rentable, prise en charge par les acteurs privés, et celui d'une offre non rentable, assurée par les services sociaux et financée par des fonds publics. Une telle évolution signifierait l'émergence progressive d'un modèle social à deux vitesses, composé, d'une part, de services sociaux réduits à la portion congrue et restreints aux plus démunis, et, d'autre part, de services pourvus par l'initiative privée, que seuls les plus fortunés pourront se payer. Ce seraient alors les principes mêmes d'accès universel, de mixité sociale et de solidarité propres au modèle social français qui seraient remis en cause.
Il s'agit donc de soutenir et de conforter, par ce texte, le tiers secteur associatif et l'économie sociale et solidaire, en pleine expansion. Ils regroupent quelque 2 millions d'emplois, et constituent une spécificité française. Certes, les Allemands ont aussi un secteur associatif caritatif, mais celui-ci a été expressément exclu de la directive.
Toute la proposition ne fait que reprendre des éléments du droit européen. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter une telle transposition législative, qui conjugue la transparence de la méthode avec les meilleures garanties pour nos services sociaux. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, la proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui traduit avant tout une crainte, celle de voir remise en cause une composante de notre modèle social. Selon ses auteurs, la directive services menacerait en effet les services publics et les services sociaux d'intérêt général.
Je peux vous dire en toute confiance qu'il n'en est rien. Les services publics et les services sociaux d'intérêt général incarnent des valeurs essentielles à notre cohésion sociale : l'égalité, la proximité, le soutien apporté aux plus fragiles de nos concitoyens. Comme l'ensemble des Français, le Gouvernement y est très attaché, tout particulièrement en temps de crise.
Les analyses éclairantes du rapport Thierry ainsi que le travail d'expertise mené par notre administration, en lien avec le secrétariat général aux affaires européennes, le SGAE, ont permis d'apporter à la Commission européenne tous les éléments relatifs au travail de transposition de la directive services effectué par la France. C'est forte de cet examen approfondi que je peux vous exposer les raisons pour lesquelles cette proposition de loi est non seulement inutile, mais pourrait même se révéler contre-productive.
Sous prétexte d'apporter des garanties, elle créerait davantage d'instabilité pour les services publics qu'elle entend justement préserver.
Avant d'examiner ces deux points, je voudrais revenir brièvement sur la méthode de transposition retenue par la France et l'allégation selon laquelle l'Assemblée nationale aurait été victime d'un déni démocratique, car, à cet égard, le Gouvernement a eu le souci de l'efficacité autant que celui du respect de nos règles institutionnelles.
Pour dire les choses simplement, cette directive invite chaque État membre à passer en revue, sur son territoire, les activités réglementées et les régimes d'autorisation en vue de garantir la liberté d'établissement et celle de prestation de services au sein de l'Union. C'est donc bien à un examen de la conformité du droit existant, plus qu'à une transposition de norme nouvelle, que cette directive conduit.
Je connais, comme vous, le lourd passé de ce texte, mais regardons les choses objectivement. Ce qui inquiétait, à savoir l'application de la loi du pays d'origine, n'est plus, et ce qui reste est très circonscrit, tant les exclusions sont nombreuses. De ce point de vue, il est significatif que le débat soulevé par cette proposition de loi se concentre essentiellement sur les services dédiés à la petite enfance.
Or, s'agissant de ce point précis, comme, plus largement, de notre organisation sociale et médico-sociale, je vous assure que tout est déjà très largement compatible avec les dispositions de la directive services : peu de mesures d'adaptation étaient donc nécessaires. J'y reviendrai cependant.
Partant de ce constat, le Gouvernement n'a pas fait autre chose que respecter la répartition des compétences entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif. Lorsqu'une adaptation législative était nécessaire, le Parlement a bien évidemment été associé. J'en veux pour preuve, par exemple, la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », adoptée cet été, par laquelle nous avons modifié la procédure d'autorisation dans le secteur médico-social, notamment en instaurant la procédure d'appel à projets.
Certains se sont également étonnés, sur un plan plus général, que le rapport du Gouvernement n'ait pas été rendu public. Qu'ils se rassurent : ce rapport le sera bien évidemment. Il sera même disponible sur internet dès les prochains jours. Il sera également transmis à la commission et, dans le cadre du processus d'évaluation mutuelle qui va bientôt débuter, examiné par le groupe d'États membres auquel appartient la France. Tout cela est, et continuera d'être, largement public. Il n'y pas plus de place, en ce domaine, pour la dissimulation que pour la suspicion. Aussi j'invite chaque acteur de ce débat à renoncer à la crainte de la première, et au maniement de la seconde.
J'en viens au coeur du débat que soulève cette proposition de loi, en vous indiquant sur quels arguments repose le constat de son inutilité.
Cette proposition de loi est inutile parce que, contrairement à ce que vous prétendez, les régimes d'autorisation et d'agrément dans notre secteur social et médico-social ne sont nullement remis en cause par la directive services. Dans leur quasi-totalité, les services sociaux et médico-sociaux sont exclus du champ même d'application de la directive. Ils satisfont en effet aux deux critères cumulatifs d'exclusion qui sont précisés dans l'article 2.2.j de la directive : d'une part, ils sont relatifs « au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin » ; d'autre part, ils sont assurés par des prestataires mandatés par l'État ou une collectivité publique,
Ensuite, il est vrai que certains services entrent dans le champ de la directive, par exemple les services d'aide à domicile, qui ne remplissent pas le critère du mandatement, ou les crèches et haltes-garderies, qui n'ont pas été considérées comme des services d'aide à l'enfance.
Sur ces points, nous avons avec vous une divergence d'interprétation et de définition. C'est certes regrettable, mais – c'est là l'essentiel – cela ne porte pas à conséquence. Il importe de rappeler que l'inclusion de ces services dans le périmètre de la directive ne remet en cause ni leur régime juridique ni leurs caractéristiques essentielles. Leurs régimes d'autorisation et d'agrément sont en effet justifiés pour des raisons impérieuses d'intérêt général, remplissant ainsi la condition posée aux articles 9 et 16 de la directive. Ces raisons impérieuses d'intérêt général sont bien sûr leurs objectifs d'ordre public et de santé publique.
Il n'y a donc aucun risque de dérégulation ni d'abaissement des exigences de qualité : chacun doit être pleinement rassuré sur ce point.
Je prendrai un exemple qui vous inquiète particulièrement, celui des établissements d'accueil des jeunes enfants. Aujourd'hui, pour créer une crèche ou une halte-garderie, il faut une autorisation préalable du président du conseil général, après avis du maire de la commune, s'il s'agit d'un projet porté par une personne privée. La directive services ne remet pas en cause cette exigence qui répond à d'évidentes préoccupations d'intérêt général.
En outre, les crèches et haltes-garderies sont actuellement soumises au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de la PMI. La directive ne remet pas en cause l'exercice de ce contrôle. Aucune modification n'est donc nécessaire.
Lorsque le préfet estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont menacées, il peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, de l'établissement. Ici encore, des raisons impérieuses d'intérêt général justifient pleinement ces prérogatives.
Vous voyez donc bien que ce texte n'ouvre pas la porte à la dérégulation de ce secteur. Il en est de même pour l'aide à domicile.
Enfin, une des questions qui vous préoccupent et qui inquiètent les collectivités locales concerne les concours et subventions versés à ces services sociaux par l'État et les collectivités territoriales. Je veux vous rassurer sur ce point également : ils ne sont remis en cause ni par la directive ni par le droit communautaire des aides d'État. Cette question a été longuement débattue lors de la conférence de la vie associative, et des assurances ont été apportées dans une note diffusée à tous les participants le 17 décembre.
Tout d'abord, la directive ne remet pas en cause les concours et subventions, car elle ne traite ni des questions de financement, ni des problématiques de marché public.
Ensuite, les règles du droit communautaire de la concurrence n'imposent pas l'utilisation du marché public et ne remettent donc pas en cause le régime actuel des subventions, puisque les aides dites d'État sont parfaitement autorisées lorsqu'elles sont versées à une entreprise ou une association sous les conditions suivantes : premièrement, que l'entreprise ou association gère un service d'intérêt économique général ; deuxièmement, qu'elle soit expressément mandatée à cette fin par les pouvoirs publics ; troisièmement, que les paramètres qui ont permis de calculer la compensation financière liée à cette mission aient été préalablement établis de façon objective et transparente ; enfin, que les financements n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts afférents aux obligations de service public.
Vous le savez, un nouveau modèle de convention d'objectifs a été élaboré avec les associations et avec les représentants des élus locaux dans le cadre des travaux préparatoires à la deuxième conférence pour la vie associative du 17 décembre dernier. Il a été diffusé en début de semaine par circulaire du Premier ministre à tous les ministres et publié au Journal officiel afin que tous puissent se l'approprier. Vous constaterez comme moi qu'il permet à tous les acteurs de bien prendre en compte les exigences communautaires, notamment celle d'ajustement de la compensation aux obligations de service public. En outre, il sécurise l'allocation des subventions aux associations.
Le haut-commissaire Martin Hirsch a d'ailleurs demandé hier aux préfets de sensibiliser les élus locaux à cette convention de sorte que tous puissent en faire usage lorsqu'ils attribuent des subventions. Je voudrais enfin rappeler que le Premier ministre s'est engagé à poursuivre cette démarche de clarification, autant qu'il sera nécessaire, dans le dialogue avec les associations et les élus locaux.
Ces divers éléments montrent combien les craintes exprimées par les signataires de la proposition de loi sont infondées. Les services sociaux et médico-sociaux ne sont en rien menacés.
Soit ils sont exclus du champ de la directive, soit ils y sont inclus, mais, étant conforme à ce texte, leur régime n'a pas à être modifié et n'est pas remis en cause.
Les modalités de financement public de ces services ne sont pas non plus remises en cause. Cette proposition de loi est donc sans objet.
Elle présente même un certain nombre de risques. Non seulement elle n'apporte aucune garantie complémentaire, mais elle risque de fragiliser celles qui existent. Il est clair que son adoption créerait davantage d'insécurité que de garanties pour le secteur social et médico-social.
L'article 1er de la proposition de loi est clairement contraire au droit communautaire et, par là, source d'insécurité juridique.
En excluant l'ensemble des services sociaux et médico-sociaux du champ d'application de la directive, la proposition de loi va au-delà du champ d'exclusion prévu par la directive. La France pourrait, à ce titre, être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Les conséquences qui seraient tirées de cette condamnation pourraient ensuite fragiliser tous les régimes d'autorisation aujourd'hui en vigueur dans ces secteurs. Est-ce cela que nous voulons pour nos services publics : perdre les acquis d'une réglementation sous le prétexte de vouloir la protéger ?
Il en est de même pour les articles 2 à 5 de la proposition de loi relatifs au financement versés aux services sociaux. Leurs dispositions reproduisent de manière beaucoup trop approximative certaines définitions issues du droit communautaire, et l'absence de conformité au droit communautaire est évidente.
De plus, en renvoyant à un décret d'application le soin de définir le modèle de convention, la proposition de loi renvoie à une date inconnue la sécurisation des financements des associations et expose au risque d'une instabilité dont les premières victimes seraient justement les associations. À l'inverse, la convention prévue par le Gouvernement est d'application immédiate, et désormais connue de tous.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, il n'y a nulle crainte à avoir, car, vous le voyez clairement, notre modèle social n'est pas remis en cause, même lorsqu'un service, comme la petite enfance ou l'aide à domicile, est inclus dans le périmètre de la directive.
Je vous le dis à nouveau, nous sommes déterminés à protéger nos services sociaux. Avec Xavier Darcos, nous nous y étions engagés en septembre dernier devant le congrès de l'Union nationale des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons travaillé à ce nouveau modèle de convention. Celle-ci est disponible ; le rapport de synthèse rédigé par la France sera disponible dans les prochains jours ; le rapport complet va être transmis à la commission et sera examiné. Tout est donc à la fois public et clair.
Le Gouvernement ne peut que s'opposer à cette proposition de loi. Je crois avant tout que le devoir des politiques n'est pas de faire naître des inquiétudes ou de créer de la confusion, sous prétexte qu'il est question de concurrence. Notre mission, au contraire, est d'éclairer les différents opérateurs en prenant nos responsabilités. Car c'est aussi cela le service public que nos concitoyens sont en droit d'attendre. Et, en ce mois de janvier, je vous invite à partager ces voeux. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la secrétaire d'État, vous venez de dire que notre proposition de loi était sans objet, inutile, contre-productive et approximative. Rien que cela ! Vous comprendrez que le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, qui défend cette proposition de loi, et son rapporteur, Jean-Patrick Gille, ne partagent pas ce point de vue quelque peu lapidaire. Nombre des députés présents ce soir et qui, à gauche comme à droite, travaillent sur ce dossier depuis des mois, sont loin de partager vos certitudes. Nous avons donc souhaité avoir ce débat-là où il doit avoir lieu, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, dans la transparence, au vu de tous.
L'enjeu de la proposition de loi est clair : c'est la préservation de la spécificité de notre modèle social et de nos services publics locaux.
Les services sociaux d'intérêt général sont au coeur de notre modèle social et du modèle social européen. Les services sociaux d'intérêt général, ce sont les services d'intérêt général qui contribuent à la cohésion sociale dans nos territoires. Il s'agit des services à la personne – petite enfance, personnes âgées –, des services sanitaires, sociaux, de la formation, mais aussi du secteur associatif, soit 1,2 million d'associations, 15 millions de bénévoles et 2 millions de salariés, dans le domaine du sport ou de la culture, par exemple, sans oublier le mouvement d'éducation populaire.
Les services sociaux d'intérêt général jouent un rôle fondamental de protection de la population, en particulier des personnes les plus modestes, dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent. Ils sont bien souvent, pour nos concitoyens, le dernier rempart contre l'exclusion, la grande précarité et la pauvreté.
Les services sociaux d'intérêt général sont au coeur de notre économie : ils représentent plus de 10 % des emplois en France, mais aussi en Europe, avec notamment le secteur très dynamique de l'économie sociale et solidaire.
Enfin, les services sociaux d'intérêt général jouent un rôle d'animation primordial dans nos territoires : je pense aux centres sociaux ou aux structures socio-éducatives dans nos quartiers populaires. Toutes les collectivités locales, soit nos 36 000 communes et 60 000 opérateurs locaux, sont directement concernées.
Voulons-nous que ces services sociaux d'intérêt général soient considérés comme des activités marchandes comme les autres, soumises, au plan européen, aux règles de la concurrence et du marché intérieur, au risque de les fragiliser, voire de menacer leur existence ? Ou bien décidons-nous, en tant que législateurs, dans le cadre de la transposition de la directive services, de leur apporter un maximum de sécurité juridique et financière ?
Tel est l'enjeu politique majeur de cette proposition de loi, durablement inscrit dans l'agenda politique national et européen, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Patrick Gille. La question posée par cette proposition est de savoir si nous voulons, oui ou non, consolider notre modèle français de services publics sociaux.
Que pouvons-nous faire ?
L'idéal, nous le reconnaissons tous, aurait été de disposer d'un cadre de sécurisation juridique sur le plan européen. Mais nous savons que, à ce stade, les conditions d'adoption d'une directive cadre sur les services sociaux d'intérêt général ne sont pas réunies.
L'enjeu de cette proposition de loi est de remettre le Parlement, c'est-à-dire la représentation nationale, au coeur du processus de transposition de la directive services. Le Parlement ne peut être dessaisi de cette question. Nous souhaitons jouer pleinement notre rôle de législateur et exercer nos fonctions de contrôle.
Il ne s'agit pas, comme nous l'avons entendu sur les bancs de l'UMP, de réécrire la directive services, mais de la transposer en droit interne, en respectant l'esprit et la lettre du compromis politique intervenu en décembre 2006, entre le Parlement européen et la Commission européenne.
La directive elle-même prévoit une large latitude pour les États membres dans le processus de transposition, afin d'apprécier, en fonction du contexte national, ce qui relève ou non de la catégorie des services sociaux.
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009, renforce cette latitude en accordant, dans son article 14, une place plus importante aux Parlements nationaux pour « établir les principes et fixer les conditions garantissant le bon accomplissement des missions de services publics dans l'Union Européenne ».
La directive européenne, comme le traité de Lisbonne, fournit expressément un certain nombre de garanties et de dispositions protectrices dont il revient à chaque État membre de se prévaloir.
Le calendrier était connu de tous : la directive devait être transposée avant le 28 décembre 2009. Dès octobre 2008, un rapport de la mission d'information parlementaire, présidée par Pierre Morange, sur le financement et la gouvernance des associations, formulait un certain nombre de propositions pour sécuriser les associations qui exercent des missions d'intérêt général et demander leur exclusion du champ d'application de la directive services.
La circulaire publiée hier répond en partie aux besoins du secteur. Cependant, elle est loin de tout régler : les coordinations associatives continuent de revendiquer la préservation d'un secteur non lucratif. Le refus d'exclure un certain nombre d'acteurs associatifs du champ de la directive apparaît comme une occasion manquée.
Le rapport demandait aussi au Gouvernement de profiter de la présidence française de l'Union européenne pour agir avec force. Nous avons laissé passer la présidence française de l'Union européenne, qui aurait pu être un moment fort pour inscrire à l'agenda politique des institutions européennes la question des services sociaux d'intérêt général. Aucun résultat !
Par la suite, le groupe SRC n'a cessé de vous interpeller sur la méthode retenue par la France pour transposer la directive services. En mars 2009, j'ai interrogé M. Bruno Le Maire, alors secrétaire d'État aux affaires européennes, sur les intentions du Gouvernement : pas de réponse claire ! La commission des affaires européennes s'est emparée de ce débat et a produit, à l'initiative, notamment de Valérie Rosso-Debord et de Christophe Caresche, un rapport d'information sur les services sociaux d'intérêt général. Ce rapport, que nous avons voté, demandait une exclusion claire et large des services sociaux d'intérêt général à l'occasion de la transposition par la loi de la directive services.
À son tour, la commission des affaires sociales a examiné, le 10 juin 2009, deux propositions de résolution sur la question, l'une émanant de la commission des affaires européennes, l'autre, plus volontariste, du groupe SRC, demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la séance publique de l'Assemblée, ce qui nous a été refusé.
À l'occasion de l'examen du projet de loi sur la formation professionnelle à l'été 2009, avec Jean-Patrick Gille, nous sommes revenus à la charge, sans obtenir de réponse satisfaisante et claire du Gouvernement sur sa position.
Las, nous apprenons, fin 2009, que le Gouvernement a fait le choix d'écarter, de squeezer littéralement le Parlement pour transposer de façon administrative, technique et réglementaire, la directive services.
Sur les vingt-sept États membres, la France est, avec l'Allemagne, le seul pays à avoir choisi une telle méthode de transposition, préférant négocier avec la Commission européenne des régimes d'autorisation plutôt qu'une loi-cadre générale !
L'UMP, qui aime à répéter que notre pays est isolé et cultive sa singularité en Europe sur un certain nombre de sujets, comme les services publics ou les acquis sociaux, pour mieux les affaiblir, se trouve prise en flagrant délit : nous sommes les seuls en Europe, avec l'Allemagne, à avoir fait un tel choix de transposition.

Ce choix incompréhensible d'une transposition discrétionnaire, en catimini et dans l'opacité, n'est pas seulement discutable, il est contestable. C'est un véritable déni de démocratie. Les 500 fiches d'autorisation transmises à la Commission ne sont pas publiques et les parlementaires n'ont pas eu connaissance du rapport de transmission en date du 5 janvier. Vous venez de nous dire, madame la secrétaire d'État, que nous l'aurions dans quelques jours. Tout juste apprend-on, au hasard des conversations, que les services de la petite enfance ne seraient pas exclus du champ d'application de la directive services, alors que les laboratoires d'analyses médicales le seraient. Quelle est la cohérence ?
À travers cette dissimulation inacceptable pour les représentants du peuple que nous sommes, le Gouvernement a fait preuve de légèreté, de désinvolture et d'une inconséquence coupable.
Face à cela, notre proposition de loi fait, dans la transparence, le choix clair d'une exclusion large des services sociaux d'intérêt général du champ d'application de la directive services. La méthode législative est préférable au régime d'autorisation négocié au cas par cas, au marchandage entre le Gouvernement et la commission.
Nous proposons une loi de clarification pour les services sociaux. Elle permet à ceux-ci de bénéficier des dispositions du traité de Lisbonne sur la protection des missions d'intérêt général. Elle permet également d'exempter de notification à la Commission européenne des aides d'État au titre du financement public des services sociaux, tout en précisant les modalités concrètes de mandatement. Enfin, elle crée une convention de partenariat d'intérêt général pour sécuriser en droit les pratiques de contractualisation des collectivités locales, ce qui permettra d'éviter le recours systématique non justifié aux procédures de marchés publics.
Bref, ce texte sécurise juridiquement le fonctionnement et le financement des services sociaux d'intérêt général et clarifie la notion clé de mandatement.
Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe SRC votera des deux mains cette proposition de loi relative à la protection des missions d'intérêt général confiées aux services sociaux et à la transposition de la directive services. Je rappelle que ce texte est soutenu par le collectif services sociaux d'intérêt général qui regroupe dix-neuf organisations nationales de services sociaux et par la CPCA – la conférence permanente des coordinations associatives – qui représente 500 000 associations.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en dépit de l'importance des services sociaux partout en Europe et de l'attachement des peuples à leur pérennité, lequel s'est manifesté par une mobilisation sans précédent pour infléchir la directive Bolkestein, la menace sur les services sociaux reste aujourd'hui entière.
Entre une terminologie communautaire confuse et un refus constamment affirmé par la Commission européenne de toute initiative susceptible d'aboutir à un texte transversal sur les services d'intérêt général, nos services sociaux ne sont pas à l'abri des règles de la concurrence du traité et de la logique libérale et mercantile qui le sous-tend.
Conscients de cette menace et animés par la volonté de protéger un élément fondamental de notre modèle social et républicain, les députés communistes, républicains et du parti de Gauche avaient déposé, le 9 avril dernier, une proposition de résolution européenne qui demandait notamment au Gouvernement français de saisir la Commission européenne d'une demande d'initiative sur les services d'intérêt général, qui reconnaisse pleinement les caractéristiques spécifiques des services sociaux et les protège explicitement contre l'application des règles de la concurrence.
Nous avions porté ce débat devant la représentation nationale le 28 mai 2009, dans le cadre de notre niche parlementaire. Cette intervention nous paraissait d'autant plus urgente que la directive services devait être transposée avant la fin 2009 et que le Parlement ne pouvait légiférer sans que le cadre juridique des services sociaux d'intérêt général ait été clarifié et stabilisé au niveau européen. Malheureusement, le Gouvernement n'a mené aucune action en ce sens pour protéger des règles de la concurrence les services sociaux d'intérêt général.
Aujourd'hui, alors que la date limite de transposition de la directive est dépassée, nous regrettons que la France, contrairement à d'autres pays, comme la Belgique, ait renoncé à l'élaboration d'une loi-cadre générale excluant clairement de son champ d'application les « services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin ».
Le choix du Gouvernement de transposer la directive en plusieurs morceaux, en catimini, en évitant soigneusement le débat, témoigne de votre refus de défendre les services sociaux d'intérêt général, qui touchent aux fondements mêmes de notre pacte social.
Nous partageons le constat établi par la proposition de loi de nos collègues socialistes qui dénonce le manque de transparence du processus de transposition de la directive services et sommes animés par le même souci de protéger les services sociaux d'intérêt général.
Cependant, contrairement aux dispositions de la proposition de loi, nous pensons que la protection des services d'intérêt général nécessite une remise en cause du système libéral et nous voyons une contradiction à protéger les services sociaux d'intérêt général en s'appuyant, je cite la proposition de loi, « sur les dispositions protectrices contenues dans le droit européen pour sécuriser le fonctionnement des services sociaux » et sur les « nouvelles garanties offertes par le traité de Lisbonne [...] pour permettre aux autorités publiques […] de sécuriser les services d'intérêt économique général ».
La proposition de loi entend, en effet, intégrer les services sociaux de nature économique, je cite encore, « dans le champ protecteur des articles 14 et 106, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que dans celui des dispositions de l'article 1er du protocole n° 26 sur les services d'intérêt général et de l'article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ». Selon les auteurs, « l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne au 1er décembre 2009 contribue à renforcer la protection des missions d'intérêt général imparties à certains services qualifiés d'intérêt général, y compris aux services sociaux ».
Non, les dispositions du traité de Lisbonne ne peuvent protéger les services sociaux d'intérêt général des règles de la concurrence. C'est pour cette raison essentielle que nous avions voté contre le traité ; c'est aussi pour cette raison que la majorité du peuple français l'avait rejeté. Seuls les services non économiques d'intérêt général bénéficient d'une exclusion de principe des règles du traité, alors que les services d'intérêt économique général relèvent de l'application du droit de la concurrence, sauf « exception exceptionnelle ». D'ailleurs, la Cour de justice a retenu une définition très extensive de la notion d'entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général. Elle estime que toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son mode de financement ou son statut juridique, constitue une entreprise. Peu importe le but lucratif ou non de son activité. Un organisme sans but lucratif peut parfaitement être considéré comme une entreprise. En outre, elle considère que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché. C'est donc simple, pour les structures européennes, les services sociaux d'intérêt général, dans leur quasi-totalité, relèvent des activités économiques et sont donc soumis aux règles de la concurrence.
L'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne auquel se réfère la proposition de loi soumet d'ailleurs explicitement la mise en oeuvre des services d'intérêt économique général aux règles des traités. L'article 106 du même traité, sur lequel s'appuient aussi les auteurs de la proposition de loi, précise que les services d'intérêt économique général « sont soumis aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, et ne peuvent y déroger que si cela n'entrave pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union ». De plus, « la Commission veille à l'application de ces dispositions », ce qui signifie qu'elle est seule juge de l'équilibre entre services d'intérêt économique général et concurrence, et des dérogations au droit de la concurrence. Or on sait que la Commission européenne a une vision étroite des services d'intérêt économique général et considère que les restrictions apportées aux règles du traité ne doivent notamment pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission.
Cette vision étroite des services d'intérêt économique général, conçue comme une exception non seulement encadrée, mais véritablement corsetée, au principe cardinal du « tout marché », n'est pas démentie par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à laquelle la proposition de loi, faussement naïve, se réfère également. Certes, son article 36 affirme que « l'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union ». Toutefois, cette énième pétition de principe est éclairée par le commentaire article par article du projet de charte établi par la convention, aux termes duquel cet article, qui se fonde sur l'article 16 du TCE, ne crée pas de droit en lui-même.
Un exemple récent de cette vision étriquée des services d'intérêt économique général témoigne de l'empiétement de la Commission, par le biais de l'erreur manifeste d'appréciation, sur la liberté des États membres de définir ce qu'ils estiment relever d'une mission d'intérêt général. Cette censure s'est notamment exercée aux Pays-Bas. Ainsi, la Commission, à l'occasion de la notification par le gouvernement hollandais de son système d'aide aux logements sociaux, a estimé que le service d'intérêt général du logement social devait établir un lien direct avec les ménages défavorisés et que la location de logements aux ménages autres que socialement défavorisés ne peut être considérée comme un service d'intérêt général. La preuve est ainsi faite que les dispositions du droit communautaire garantissent avant tout les valeurs marchandes et de concurrence et qu'il est bien naïf de vouloir s'appuyer, comme le fait la proposition de loi : « sur les dispositions protectrices contenues dans le droit européen pour sécuriser le fonctionnement des services sociaux ».
De même, contrairement à ce que prétendent les auteurs de cette proposition de loi, le protocole 26 sur les services sociaux d'intérêt général n'apporte aucune nouvelle garantie, aucune nouvelle protection pour les services sociaux d'intérêt général. En énonçant que « les dispositions du traité ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser » de tels services, le protocole se limite à rappeler la jurisprudence de la Cour de justice : les services non économiques d'intérêt général ne sont pas des entreprises et échappent, de ce fait, aux règles de la concurrence.
De manière générale, le traité de Lisbonne se contente donc de rappeler les règles existantes reposant sur la jurisprudence de la Cour de justice et n'apporte aucune inflexion susceptible d'esquisser une quelconque évolution vers une Europe plus sociale, plus solidaire et plus démocratique, contrairement à ce que voudrait faire croire cette proposition de loi.
Force est de constater qu'en dépit des déclarations d'intention au niveau communautaire, la notion même de service d'intérêt général a été l'outil de démantèlement et de casse de nos services publics en les soumettant à une concurrence inutile pour les usagers.
Nous considérons, pour notre part, que la question de la définition des services publics et de leur protection ne peut se poser indépendamment d'une remise en cause globale du modèle libéral tel qu'imposé par l'Union européenne.
Nous estimons que la proposition de loi du groupe SRC, si elle part d'une bonne intention, comporte une contradiction majeure. En effet, elle ne peut à la fois protéger les services sociaux d'intérêt général et s'appuyer, pour ce faire, sur les traités. C'est antinomique !
Nous l'avons démontré : aux termes des dispositions du droit communautaire, seuls les services non économiques d'intérêt général bénéficient d'une exclusion de principe des règles des traités, alors que les entreprises chargées d'un service d'intérêt économique général sont soumises aux dispositions des traités, notamment aux règles de la concurrence. Sur le fond, aucun changement, aucune avancée en matière de services sociaux d'intérêt général n'a été apporté par le traité de Lisbonne, contrairement à ce qu'indique la proposition de loi.
Nous avons, pour notre part, une autre exigence pour les services publics, une autre exigence pour l'Europe et ne pouvons nous satisfaire de cette proposition. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, même si nos rangs sont assez clairsemés, le débat auquel vous nous conviez, monsieur le rapporteur, n'est pas médiocre, il est au contraire important. Comme l'a fort justement rappelé M. Juanico, nous avons déjà eu cette discussion à plusieurs reprises : d'abord en commission des affaires européennes avec M. Caresche – nous avons rédigé un rapport ensemble –, ensuite à votre initiative, dans le cadre de la commission des affaires sociales.
Je pense que nous partageons exactement le même objectif, mais que nous divergeons sur les moyens de l'atteindre. Je vais vous démontrer que je n'ai pas changé d'avis, mais que le traité de Lisbonne et les avancées supplémentaires qu'il a permises m'ont effectivement amenée à avoir une position différente de celle que j'avais lorsque M. Caresche et moi avons commis cet excellent rapport.
La transposition de la directive services a effectivement suscité, ce que nous comprenons parfaitement, l'inquiétude de certains acteurs du secteur social. La secrétaire générale de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale que je suis ne peut qu'y souscrire. Les services sociaux et les services de santé constituent, en effet, un secteur important de notre économie et touchent en profondeur à notre modèle social, à l'idée que nous nous faisons du service public, à notre attachement à un niveau de protection sociale élevé, apparemment mis en cause.
La complexité des règles européennes applicables aux services d'intérêt général et la situation toute particulière des services sociaux d'intérêt général avaient amené la commission des affaires européennes à débattre avec la commission des affaires sociales. Un certain nombre de remarques, que je souhaite faire en amont du débat, devraient permettre de l'éclairer.
Il convient d'abord de souligner qu'il existe bien une spécificité européenne dans ce domaine. La place du social est plus importante en Europe qu'ailleurs. Les pays européens ont une culture commune : ils reconnaissent que le règlement des situations difficiles ne peut être laissé à la seule initiative privée et que l'État, ou plus largement les collectivités territoriales, doivent s'en occuper. Cependant, pour ce qui concerne les modalités et les règles précises qui régissent l'organisation et le fonctionnement des services sociaux, l'Union européenne est clairement le terrain de la diversité. C'est ce qui fait toute la difficulté de ce dossier qui, sous un aspect technique, s'avère somme toute très politique.
Les SSIG sont le reflet de l'histoire de chaque pays, de ses choix institutionnels, philosophiques, religieux – on pourrait citer l'Allemagne pour ce qui est des choix religieux – ou politiques. Ainsi, la France, contrairement au modèle anglo-saxon dans lequel le marché et l'appel d'offres jouent un rôle essentiel, a une forte tradition d'intervention publique – ce dont nous nous réjouissons, je le crois, sur tous les bancs de cette assemblée –, complétée par un secteur associatif important et stratégique. Cette situation correspond à notre conception des SSIG et du public concerné, une conception large, qui comprend notamment la protection sociale, le médico-social, les services à la personne, les services d'accompagnement des publics fragiles, l'insertion par l'activité économique, l'accueil de la petite enfance ; cette liste n'étant évidemment pas exhaustive.
Par ailleurs, je souhaite souligner qu'il y a bien une complexité et parfois une inadaptation des règles communautaires en ce qui concerne les SSIG.
Historiquement, il a fallu attendre le traité d'Amsterdam en 1997 pour que soit reconnu le rôle des SIG dans les valeurs de l'Union et dans le maintien de sa cohésion sociale et territoriale. Quant aux SSIG, ils ne sont mentionnés dans aucun traité. Ils ne constituent, en effet, qu'une catégorie au sein des SIG.
L'une des grandes difficultés de ce débat tient donc à ce que le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les SSIG n'est pas des plus clairs, et c'est un euphémisme. En effet, il n'a pas été calibré pour les SSIG et les règles sont essentiellement d'origine jurisprudentielle, comme cela a été rappelé. Elles ont été édictées à l'occasion de contentieux sur la mise en oeuvre du principe de libre concurrence. C'est le cas notamment pour le « paquet Monti-Kroes » qui précise, à la suite de l'arrêt Altmark de la Cour de justice, les conditions de versement des aides publiques. Celui-ci n'impose pas le recours à l'appel d'offres, mais uniquement à des procédures transparentes et préalables. Dans la pratique, cependant, les nombreux acteurs se montrent inquiets et perçoivent, par conséquent, l'appel au marché comme plus sécurisé de crainte de porter atteinte aux règles communautaires.
Le problème est donc que le droit européen n'est ni clair ni stabilisé. Si, au niveau national, des mesures d'ordre technique peuvent être prises pour sécuriser les acteurs sociaux, c'est essentiellement au niveau communautaire qu'une véritable clarification doit intervenir. À cet égard – et je suis, monsieur Lecoq, en parfait désaccord avec vous sur ce point –…

Vous n'allez pas être déçu !
À cet égard, donc, le traité de Lisbonne apporte certaines améliorations grâce au protocole interprétatif qui lui est annexé. Ce protocole confirme en effet les compétences des États membres sur les services non économiques d'intérêt général – les SNEIG – et les renforce sur les services économiques d'intérêt général.
Concernant les services d'intérêt économique général, on notera un certain nombre de principes : le pouvoir discrétionnaire des États membres – j'insiste sur le pouvoir discrétionnaire car, même si on peut en discuter, cette notion figure dans le traité – pour organiser ces services d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ; la reconnaissance de leur diversité et des disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes – c'est également écrit – ; un niveau élevé de qualité et de sécurité, de même qu'un caractère abordable et la promotion de l'accès universel.
Aujourd'hui, qu'apporterait une loi visant la protection des missions d'intérêt général imparties aux services sociaux ? Tel est bien l'objet de notre discussion.
Rappelons, au préalable, que la transposition d'une directive ne nécessite pas nécessairement un acte positif de transposition, ce qui importe, c'est que notre réglementation y soit conforme. À cet égard, notre organisation sociale et médico-sociale était déjà, pour une très large part, compatible avec les dispositions de la directive. Le Gouvernement a en effet passé en revue l'ensemble des dispositions applicables à nos services et ce qui devait être modifié l'a été.
Ainsi, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, les choses ont été clarifiées en droit interne par la loi HPST. De même, la question du guichet unique a été traitée dans la loi de modernisation de l'économie.
La proposition de loi dont nous débattons a pour objectif d'exclure l'ensemble des services sociaux du champ d'application de la directive services. Cela ne me semble ni justifié, ni surtout souhaitable.
La plupart des services sociaux et médico-sociaux sont déjà exclus du champ d'application de la directive. Elle exclut en effet les services répondant aux deux critères posés en son article 2.2.j, à savoir le public concerné – les services sociaux relatifs « au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin » –, et le mandat – les prestataires « mandatés » par l'État ou une collectivité publique. C'est très clair.
Seuls les établissements ne faisant pas appel à des fonds publics relèvent du champ de la directive services, qui oblige uniquement à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle à la libre prestation de services transfrontalière.
Les services d'aide à domicile et les établissements d'accueil des jeunes enfants, eux, ne relèvent pas directement de la politique sociale et ne s'adressent pas à des personnes en situation de besoin au sens de la directive.

Ainsi, contrairement aux établissements chargés d'accueillir les enfants pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, les structures du type des crèches et des haltes-garderies ont avant tout pour mission d'offrir un service aux familles. Il s'agit de concilier vie professionnelle et vie privée, et non de mettre l'enfant à l'abri d'un danger.
Toutefois, leur inclusion dans le périmètre de la directive ne remet pas en cause leur régime juridique et leurs caractéristiques essentielles. Elle n'induit ni dérégulation, ni abaissement des exigences de qualité.
En revanche, en excluant l'ensemble des services sociaux et médico-sociaux du champ d'application de la directive, la proposition de loi prévoit un champ d'exclusion bien plus large que la directive, et là est le danger.

Elle n'est pas conforme au droit communautaire et expose la France à faire l'objet d'une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui, vous serez d'accord avec moi, ferait mauvais effet pour un pays aussi social que le nôtre. Ce serait totalement contre-productif et fragiliserait notre régime d'autorisation.
La proposition de loi vise par ailleurs à sécuriser les financements versés à ces services par l'État ou les collectivités locales.
Ne nous trompons pas de débat ! L'ambition de la directive services est de faciliter la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne. Elle ne concerne pas les questions de financement, de subvention, ou les problématiques de marché public. Nous sommes donc hors sujet.
Dès lors, la proposition de loi n'est pas fondée. Les services sociaux et médico-sociaux ne sont pas directement menacés par l'application de la directive services puisque, soit ils sont exclus du champ de la directive, soit leur régime juridique n'est pas remis en cause.
L'Europe ne menace donc pas le fond des spécificités françaises.

Elle n'impose pas de modèle unique et uniforme. La subsidiarité joue pleinement, et comme cela a été précédemment évoqué, elle se trouve renforcée par le traité de Lisbonne.
Sur la base de ces clarifications, le groupe UMP sera amené à rejeter cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Notre intention, madame la secrétaire d'État, n'est pas d'exploiter des craintes ou des peurs. Les parlementaires ici présents travaillent depuis plusieurs mois sur cette question, qui est complexe sur le plan juridique. C'est donc après avoir mûrement réfléchi que nous avons décidé de présenter cette proposition de loi.
Vous avez parlé de confusion et de trouble ; je suis tenté de vous retourner le compliment. M. Darcos a déclaré le 16 septembre devant le congrès de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale : « La majorité des services sociaux et médico-sociaux devraient pouvoir être exclus du champ d'application de la directive. Il devrait en être de même pour tous les services d'aide à domicile, crèches et haltes-garderies. » Pourquoi le Gouvernement a-t-il donc finalement décidé de ne pas exclure les crèches et les haltes-garderies ?
Il est évident que, sur cette transposition et notamment sur le régime d'exclusion, il y a eu au sein du Gouvernement des discussions et des arbitrages, et pas seulement sur les crèches et les haltes-garderies. Ce que nous voudrions savoir, ce sont les raisons qui ont amené le Gouvernement à arbitrer pour tel secteur, les laboratoires d'analyse médicale par exemple, en faveur de l'exclusion du champ de la directive services et, dans tel autre, les crèches et haltes-garderies, en faveur de l'inclusion. Dans les deux cas, il y a une interprétation juridique, extensive pour les laboratoires d'analyse médicale, restrictive pour les crèches et haltes-garderies.
Vous ne pouvez donc pas dire que c'est l'opposition qui, dans cette affaire, a créé le trouble et la confusion ;…

…ils trouvent d'abord leur origine dans les incertitudes du Gouvernement et son incapacité à tenir un discours clair et compréhensible aux acteurs intervenant dans ce domaine. Il y a évidemment les acteurs directement concernés, et l'on a parlé du collectif SSIG, mais il y a aussi les élus. L'Association des maires de France a officiellement interpellé le Gouvernement sur la question des haltes-garderies et des crèches : ce n'est pas une invention de quelques députés socialistes ruminant dans leur coin ! Vous voyez donc bien que les questions que nous posons aujourd'hui ne sont pas artificielles ; elles sont réelles et inquiètent un grand nombre de ceux qui travaillent dans ces secteurs.
Nous sommes prêts à entendre vos explications et vos arguments. Encore faut-il que l'on puisse en discuter car la méthode choisie pour la transposition n'a jamais permis à cette assemblée de débattre et de se prononcer clairement.
Oui, des mesures législatives ont été prises, mais dans des textes totalement différents comme la loi HPST ou celle sur la modernisation de l'économie. Toute une partie de ces mesures ont été prises dans le cadre d'une proposition de loi sur la simplification du droit. Avec une méthode aussi éparpillée, dispersée, éclatée, comment voulez-vous que l'on puisse avoir ici un débat sérieux ? Nous avons donc déposé cette proposition de loi d'abord pour que le débat ait lieu, que chacun puisse s'expliquer, que nous puissions confronter nos arguments, essayer de nous comprendre et d'avancer.
Que vous n'ayez pas encore rendu publiques les justifications fournies à la Commission à l'appui des déclarations de régimes d'autorisation est évidemment un élément qui sème encore un peu plus le trouble. Je ne fais aucun procès d'intention mais je le constate. Nous sommes le 21 janvier. La liste des régimes a été déposée le 5 janvier. Il y en a un peu plus de 400, mais nous ne savons pas précisément lesquels et nous ne savons pas quelles motivations le Gouvernement a avancées.
Cela relève du domaine réglementaire, nous dit-on, mais ce n'est pas un argument. Le Parlement contrôle le Gouvernement, y compris sur ces questions. Selon le traité de Lisbonne, les parlements nationaux doivent être impliqués dans le processus de décision européen, et il est parfaitement légitime et normal que l'Assemblée nationale soit informée et puisse discuter de cette transposition.
La question des exclusions est complexe, et il ne s'agit pas de donner de leçons, mais nous n'en avons pas non plus à en recevoir.
Selon vous, l'article 1er que nous avons rédigé serait susceptible d'être cassé par la Cour de justice européenne. Or il reprend exactement la formulation de la directive. Je ne vois donc pas comment la Cour pourrait le casser. Vous nous expliquez en même temps qu'il est inutile, superfétatoire, parce qu'il n'a pas de valeur normative. À la limite, je peux entendre ce second argument, mais certainement pas le premier.
Ce qui est vrai, c'est que nous avons un réel désaccord sur l'interprétation de l'article 2.2.j. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, notamment avec les fonctionnaires très compétents qui sont venus nous rendre visite pendant que nous préparions ce rapport.
Pour nous, cet article exclut explicitement du champ de la directive services l'aide à l'enfance, qui est nommément citée. Vous considérez que l'exclusion s'applique aux services destinés aux populations en état de besoin. Mais l'argument ne vaut pas pour le logement social, l'aide aux familles, l'aide à l'enfance, également visés par la directive. J'en veux pour preuve le fait que le logement social a été exclu en bloc par le Gouvernement. Or, le logement social ne concerne pas seulement des populations démunies ou en situation de besoin. Sont donc exclus les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide aux familles et à l'aide à l'enfance, et, en général, les services sociaux relatifs aux populations en situation de besoin. Cette interprétation, nous l'avons vérifié auprès de Mme Gebhardt, semble être celle du Parlement européen.
Nous n'avons donc pas la même interprétation de l'article 2.2.j, et nous considérons qu'il faut notamment exclure l'aide à l'enfance du champ de la directive services.
Vous nous dites aussi que cela n'a de toute façon pas beaucoup d'importance. Que le secteur soit ou non dans le champ de la directive, cela ne changerait pas grand-chose. Là non plus, nous n'avons pas la même interprétation et nous sommes en désaccord.
Je concède bien volontiers qu'il n'y a pas d'impact sur la question des aides de l'État, j'y reviendrai dans un instant. En revanche, deux problèmes vont tout de même se poser.
On peut d'abord se demander comment la Commission va évaluer les régimes d'autorisation qui seront déposés par la France. Ne sera-t-elle pas tentée de demander des modifications pour un certain nombre d'entre eux ? C'est une vraie question car, une fois que les régimes d'autorisation seront déclarés, il y aura évidemment des discussions. Si vous ne sortez pas la petite enfance, par exemple, du champ de la directive, vous aurez une discussion sur les régimes d'autorisation. Nous prenons date aujourd'hui. Nous verrons dans les mois qui viennent s'il y a des demandes de la Commission sur un certain nombre de régimes.
Nous sommes également en désaccord sur la stratégie politique.

Au moment où l'on commence à percevoir une reconnaissance positive des services d'intérêt général, notamment dans le traité de Lisbonne, ce n'est pas le moment pour la France d'affaiblir sa position et de se désarmer vis-à-vis de la Commission.
Si nous avions fait jouer le régime d'exclusion, nous aurions sans doute eu une discussion avec la Commission, mais nous aurions affirmé notre position. Inclure un certain nombre de services sociaux, c'est les fragiliser sur le plan politique par rapport à une reconnaissance ultérieure au niveau par exemple d'une directive européenne.
J'en termine par l'importante question des aides d'État, dont on nous dit qu'elle n'a aucun rapport avec le sujet.
Au passage, j'ai le sentiment que ce débat n'aura pas été inutile puisqu'une circulaire a été publiée aujourd'hui. C'est sans doute un hasard total. Permettez-moi cependant d'y voir un premier effet de notre mobilisation.
Cette circulaire prévoit une convention pluriannuelle d'objectifs, ce qui va plutôt dans le sens que nous souhaitons, et assortit cette disposition de toute une explication sur la directive services, dont il ne faudrait pas avoir peur parce qu'elle n'aurait rien à voir. Ça n'a jamais rien à voir ! La directive Bolkestein n'avait rien à voir non plus ; on nous expliquait, au début, qu'il n'y avait rien dedans et qu'il ne fallait donc pas s'inquiéter. Nous avons vu depuis que c'était un peu plus compliqué que cela !
Quand, avec Jean-Patrick Gille, nous avons rendu visite aux services de la Commission européenne, ils nous ont accueillis de manière fort sympathique et courtoise, mais nous avons tout de même compris que la position française était plutôt un caillou dans la chaussure de la Commission, et que ses services n'étaient pas véritablement animés de la volonté de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Ce rendez-vous nous a quelque peu échaudés. Il ne faudrait pas croire que le point de vue de la France prévale sans difficulté à la Commission. La France devra se battre, parce que les choses vont être compliquées. Avec Michel Barnier comme commissaire au marché intérieur, nous aurons toutefois un point d'appui important.

Nous proposons une sécurisation. Vous y procédez par le biais d'une circulaire. Nous avons la faiblesse de penser qu'une disposition législative aurait plus de force. Pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi ? Vous auriez pu reprendre au moins la convention de partenariat que nous proposons, tirée de l'intéressant rapport Thierry.
Concernant les aides d'État, la France a deux choses à faire. Elle doit, d'abord, continuer à se battre pour essayer de faire reconnaître au niveau européen la spécificité des services d'intérêt général. Il serait même bon qu'une directive soit prise à ce sujet.
Mais il faut également adapter notre droit de manière à sécuriser la situation d'un certain nombre d'acteurs et de services sociaux. Dans ce domaine, je suis pour le pragmatisme, je ne suis pas dans une attitude de refus dogmatique des décisions de la Cour de justice. Tout ce que nous pouvons faire pour sécuriser juridiquement les service sociaux, notamment par le biais de la définition du mandatement, va dans le bon sens.
Cependant, la circulaire prise ce matin pose problème dans la mesure où elle ne concerne que les associations. Mme Rosso-Debord, secrétaire générale de l'UNCCAS, devrait s'en émouvoir, car la circulaire ne concerne pas, par exemple, les CCAS, qui ne sont pas sous régime associatif. Nous souhaiterions que la sécurisation couvre non pas seulement les associations, mais l'ensemble des organismes.
Mes chers collègues, le débat a été tout à fait intéressant. Nous voulions non seulement exprimer un certain nombre de désaccords, mais aussi prendre date. Nous continuerons à suivre cette question et à travailler pour qu'elle soit pleinement prise en compte au sein de l'Assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi ouvre un débat essentiel parce que, sur la question des services sociaux d'intérêt général, nous sommes dans une très grande incertitude.
Incertitude, tout d'abord, à cause de l'attitude de la Commission, qui a longtemps été hésitante et a même opéré plusieurs revirements.
Incertitude aussi parce que la latitude nouvelle que nous offrent le traité de Lisbonne et le protocole qui lui est annexé ne peut manquer de nous interroger.
Incertitude, enfin, parce que nous sommes face à des enjeux particulièrement importants. L'une des grandes questions posées porte sur le champ que doivent couvrir ces services sociaux d'intérêt général. Je vous ai entendue dire, madame la secrétaire d'État, que ce champ couvrait la petite enfance et le secteur médico-social, mais il s'agit d'un domaine beaucoup plus vaste, qui peut aussi comprendre l'éducation populaire, les centres sociaux, les centres de loisirs, les centres de vacances, les maisons des jeunes et de la culture. Nous avons donc vraiment besoin d'y voir clair.
Par ailleurs, c'est un enjeu européen essentiel. On parle souvent du déficit d'intérêt pour les enjeux européens dans notre pays. Eh bien, ce dossier concerne l'ensemble de nos concitoyens.
Dans ces conditions, nous avons beaucoup de mal à comprendre pourquoi le Gouvernement n'accepte pas de légiférer, pour délimiter les secteurs, définir l'exclusion concernant les services sociaux d'intérêt général et préciser la notion de mandatement qui doit garantir cette exclusion. C'est d'autant moins compréhensible que la date limite pour la transposition de la directive services est dépassée depuis le 31 décembre 2009.
Il me semble que trois raisons devraient au contraire nous conduire à légiférer.
La première, c'est le respect des prérogatives du Parlement. Le dossier de la directive services est l'un de ceux sur lesquels le Parlement français s'est le plus mobilisé. Lors de l'élaboration de la directive, nous avons examiné plusieurs rapports de ce qui s'appelait alors la délégation aux affaires européennes, et qui est aujourd'hui une commission. La rapporteure en était Mme Anne-Marie Comparini. Nous avons eu un débat en séance publique, et des échanges continus ont été conduits avec le Parlement européen, en particulier par l'intermédiaire de Jacques Toubon, qui a particulièrement suivi ce dossier.
Par ailleurs, le Gouvernement saupoudre les mesures dans différents instruments juridiques, arguant du fait que certaines dispositions relèvent du domaine législatif et d'autres du domaine réglementaire. Or, sur un dossier qui constitue un bloc et où il se trouve des dispositions de caractère à la fois législatif et réglementaire, la tradition donne priorité à la voie législative, parce que c'est la plus lisible et que c'est elle qui assure une cohérence d'ensemble.

Par conséquent, nous comprenons difficilement que vous refusiez de passer par cette voie.
La deuxième raison qui justifierait, à mon avis, l'intervention de la loi, c'est la nécessité de réduire l'incertitude. Je vous ai entendue nous dire que nous courrions le risque, en légiférant, d'être sanctionnés par la Cour de justice, mais si chaque fois que nous risquons d'être sanctionnés, nous renonçons à légiférer, ce ne sera bientôt plus la peine de réunir le Parlement français !
Je vois quant à moi un danger beaucoup plus grand : c'est que, si nous n'utilisons pas les possibilités ouvertes pour la subsidiarité par le traité de Lisbonne, en son article 14, et par le protocole annexé, alors que certains de nos partenaires ont décidé de le faire, notre passivité sera cause qu'en cas de contentieux, la Cour de justice nous donnera tort, considérant que, n'ayant pas voulu légiférer, nous nous en remettions à sa seule interprétation. Voilà le danger !

Il me paraît également très important de légiférer sur le mandatement. Avec le mandatement, les gestionnaires de services sont chargés de les mettre en oeuvre par l'autorité publique. Or cela ne correspond pas tout à fait à la réalité en France où, bien souvent, les services sociaux d'intérêt général ont été créés à l'initiative d'associations. Par conséquent, si nous adoptons une interprétation trop restrictive de la notion de mandatement, nous risquons d'anéantir ce qui est l'une des forces des associations dans notre pays, à savoir l'innovation sociale, la capacité de prendre des initiatives innovantes dans une multitude de secteurs.
Enfin, la troisième raison pour légiférer, c'est que nous conduisons, au sein même de l'Union européenne, une bataille juridique. Face à ceux qui ont une conception du droit d'inspiration plutôt anglo-saxonne, celle d'un droit flou ou mou où l'on s'en remet beaucoup à la jurisprudence, si nous voulons défendre la conception qui est la nôtre, il est essentiel que nous légiférions dans un domaine tel que celui-ci. On parle beaucoup des règles de la concurrence, mais les textes européens – et le traité de Lisbonne ne fait pas exception – n'en font pas moins référence à l'économie sociale de marché. Or l'économie sociale de marché, c'est le marché encadré et même, dans certains cas, délimité. Les services sociaux d'intérêt général sont à l'évidence un domaine où il faut délimiter le marché. C'est l'esprit même du traité de Lisbonne et des autres textes européens.
Pour conclure, je pense qu'il est très important que ce débat ait lieu ce soir, que cette proposition de loi ait été déposée. Si nous continuons, sur un sujet comme celui-ci, à assister à la même passivité de la part de la Commission, qui ne remplit pas ses obligations, alors qu'elle pourrait très bien prendre l'initiative de présenter une directive-cadre, et à la même passivité de la part des États, il faudra trouver d'autres voies pour la construction européenne. Il conviendra en particulier d'envisager une démarche commune du Parlement européen et des parlements nationaux pour se substituer à la Commission et aux États défaillants. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à Mme Danièle Hoffman-Rispal, dernière oratrice inscrite dans la discussion générale.

Madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, chers collègues, la transposition de la directive services pouvait sembler au premier abord bien difficile d'accès, mais l'excellent travail de décorticage réalisé par notre rapporteur démontre que, derrière la technicité des textes concernés, sont dissimulés des enjeux politiques qui méritent d'être débattus haut et fort sur la place publique.
Fervente partisane de l'intégration européenne, je m'étonne d'ailleurs que le Gouvernement ne saisisse pas cette occasion pour redorer le blason de l'Union. Vous avez en effet délibérément décidé d'écarter le Parlement de la transposition de la directive services, alors même que la discussion d'une loi-cadre à l'Assemblée aurait pu avoir un intérêt considérable pour nos concitoyens, dans la foulée de la présidence française et des élections européennes.
Cette voie que vous avez choisie, la voie du travail dans l'ombre et du morcellement en plusieurs projets de loi, présente bien des avantages, mais seulement pour l'exécutif.
Vous avez dit que si nous ne transposions pas selon votre méthode, nous serions sanctionnés. Or vingt-cinq pays de l'Union européenne ont une loi-cadre et aucun n'a été sanctionné : vingt-cinq sur vingt-sept ! Pourquoi donc ne pouvions-nous pas faire comme nos voisins ? Ils ont démontré que les représentations nationales avaient la légitimité de définir les possibilités d'exclusion du champ de cette directive. Non seulement elles ont cette légitimité mais les définir fait même partie de leurs prérogatives. Étant donné les méthodes qu'utilise le Gouvernement, il ne faut pas s'étonner de la défiance qui s'exprime parfois envers une prétendue opacité européenne.
Dans ce contexte, il faut le rappeler, de nombreux représentants du secteur social ont tenu à exprimer leur inquiétude et réclament depuis plusieurs mois davantage de transparence. Nous avons un débat, c'est déjà un début, mais la proposition de loi permettrait de répondre à leurs attentes, notamment en ce qui concerne le secteur de la petite enfance et, dans une certaine mesure, celui du médico-social.
En effet, la petite enfance relève de la solidarité nationale : la meilleure illustration en est son examen dans la branche famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Marie-Françoise Clergeau, rapporteure de la branche famille, a d'ailleurs clairement exprimé en commission son incompréhension et son inquiétude face à la non-reconnaissance du secteur de la petite enfance comme un service d'intérêt général. M. Fasquelle a, quant à lui, déclaré en commission que ce n'était pas un problème si un secteur se retrouvait dans le champ d'application de la directive services ; il devrait donc être d'accord pour en conclure avec nous que ce n'est pas plus un problème d'en exclure un. À moins bien sûr qu'exposer un secteur comme la petite enfance à un nivellement par le bas de sa régulation ne constitue un moyen détourné pour le Gouvernement de créer 200 000 places au rabais pour la petite enfance. Car le risque de privatisation…

…et de déréglementation grandit encore avec cette directive si elle est mal transposée. Le parti socialiste plaide depuis longtemps pour un service public de la petite enfance et vous propose donc d'aider à parvenir à cet objectif en excluant ce secteur de la transposition.
En outre, madame la secrétaire d'État, vous qui êtes chargée de nous aider à régler ce problème, je tiens à vous dire que ce que je trouve surprenant dans cette affaire, c'est l'application du principe « deux poids, deux mesures » : les établissements médico-sociaux, notamment les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, sont exclus de l'application de la directive, mais les services d'aide à domicile qui optent pour le régime de l'agrément qualité – nous nous sommes battus ici même et souvent, depuis plusieurs années, pour qu'ils le fassent – restent dans le champ de la directive ! Or nous savons, vous comme moi, ce qu'apportent en termes de qualité et d'activité ces associations. Un tel dispositif est donc pour moi incompréhensible. Quand on sait l'importance qu'accordent nos concitoyens à la possibilité de rester le plus longtemps possible à leur domicile, on ne peut que trouver la méthode contre-productive.
Mes collègues ont précisé leur position sur d'autres secteurs potentiellement concernés. Pour ma part, je souhaite terminer mon intervention en vous citant le programme d'un certain parti aux dernières élections européennes – j'ai de bonnes lectures : « Clarifier rapidement et de manière exhaustive pour la France le champ des services publics, notamment les services sociaux afin d'éviter que des règles de concurrence aveugles viennent sanctionner les intervenants de notre système social. » Ce programme, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues de la majorité, vous l'avez bien entendu reconnu… c'est le projet de la majorité présidentielle pour les européennes de 2009.

Je ne doute donc pas que les représentants de la majorité présidentielle mettront leurs actes en accord avec leurs paroles…

…en votant cette proposition de loi. Ils seront ainsi en parfaite harmonie avec ce qu'ils ont défendu il n'y a que quelques semaines. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la secrétaire d'État, vous avez dit que notre proposition de loi était inutile, contre-productive, déstabilisatrice et risquée. Cela fait beaucoup, c'est pour le moins exagéré, et vous ne le démontrez pas. Je pense qu'au contraire, c'est votre attitude et votre méthode qui sont risquées tandis que notre proposition est productive et constructive. Notre divergence de méthode cache une divergence de fond.
S'agissant de la méthode, la position du Gouvernement consiste à assurer la conformité a minima du droit existant aux règles communautaires alors que nous, nous proposons une transposition législative dans toute sa transparence. Vous avez reconnu vous-même que le Gouvernement a déjà procédé a des adaptations législatives pour se mettre en conformité avec la directive, mais je vous rappelle qu'il y a obligation d'en informer le Parlement. Or je ne suis pas sûr que tous mes collègues qui ont participé à ces débats aient eu conscience qu'il s'agissait de transposer ladite directive. Vous nous avez accusés d'être suspicieux par principe, mais il y a déjà là chez vous une tendance à la dissimulation.
Sur le fond, vous affirmez que les régimes d'autorisation et d'agrément ne sont pas remis en cause. A priori on vous croit. On ne demande pas à examiner les 500 réponses fournies à la Commission européenne – et que nous n'arrivons toujours pas à avoir – car ce serait un peu fastidieux, mais il aurait été souhaitable de nous en communiquer au moins une, en particulier celle concernant la petite enfance puisque le débat s'est cristallisé sur ce sujet. Je vous informe que le président Ayrault a envoyé une lettre au Premier ministre pour tenter d'obtenir des précisions au sujet de ces réponses. Je vous rappelle que le traité de Lisbonne prévoit une plus grande concertation entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Il est de la responsabilité des gouvernements nationaux d'y contribuer. Il y a des progrès à faire en ce domaine.
Vous dites que notre proposition de loi est inutile alors que, au contraire, elle prouve son utilité en visant à introduire le mandatement dans le droit national. En effet, ce dispositif est au coeur à la fois de la question des aides publiques et de la directive services puisque c'est le critère du mandatement qui permet de procéder, selon l'article 2.2.j, à l'exclusion de nombreux services du champ de la directive. Je ne sais toujours pas pourquoi vous refusez que la notion de mandatement trouve un contenu dans le droit national. Mais je crois que cette idée va avancer petit à petit, ce qui serait un des mérites de ce débat. Sinon, cela signifierait qu'il y a de la part du Gouvernement une volonté de ne pas autoriser les collectivités locales à utiliser ce dispositif. Cela renvoie au problème des services publics régionaux de formation : les conseils régionaux veulent les mettre en place mais l'État bloque.
S'agissant de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs, je note que, depuis la conférence gouvernementale du 17 décembre dernier, cette question a avancé – quoique tardivement – puisque la circulaire est sortie hier. Mais je vous fais remarquer qu'elle ne résout pas tous les problèmes puisqu'elle gère essentiellement les rapports entre l'État et les associations. Certes, vous avez estimé que l'on pouvait entendre le mot « État » dans son acception européenne, c'est-à-dire les autorités publiques au sens large. Mais je crois que ce point n'est pas éclairci alors que notre proposition le permettrait. Quant aux associations, il faut aussi penser aux opérateurs du tiers-secteur relevant du privé non lucratif. Il convient donc d'améliorer la nouvelle convention car elle ne s'étend pas à tous les acteurs concernés. On nous reproche de renvoyer les modifications que nous proposons à un décret. C'est un peu fort ! Nous, nous proposons de donner force de loi à la convention de partenariat d'intérêt général alors que vous la créez par voie de circulaire.

Je n'ai donc pas tout à fait compris l'argument.
Et puis notre proposition serait déstabilisatrice, elle fragiliserait les garanties existantes. Cela rejoint l'argument central du Gouvernement et de la majorité : notre texte ne serait pas tout à fait conforme. Mais nous n'avons pas vu en quoi il ne le serait pas. Vous ne l'avez pas démontré. Nous, nous considérons que la proposition de loi colle au texte de la directive en l'écrivant en droit français. Pourtant, vous nous dites qu'il y a un risque de condamnation par la Cour de justice. M. Garrigue, me semble-t-il, l'a fait remarquer : il est tout de même possible, dans l'année qui vient, d'avoir des discussions à ce sujet avec le commissaire compétent. Je n'imagine pas Michel Barnier nous mettre tout de suite au pied du mur. Vous dramatisez ! Et je redis que vous n'avez pas montré le risque juridique que présenterait notre texte.
Je vais, avant de conclure, vous poser trois questions qui sont au coeur du sujet et auxquelles vous n'avez pas répondu.
Premièrement, pourquoi le gouvernement français sera-t-il le seul – avec l'Allemagne – à ne pas procéder à la transposition par une loi-cadre ? Les Allemands sont dans une situation différente puisqu'ils ont un État fédéral et que les associations caritatives qui caractérisent leur système figurent déjà dans le 2.2.j. Une loi-cadre ne leur est donc pas nécessaire.
Deuxième question : pourquoi le Gouvernement n'utilise-t-il pas toutes les ressources de la directive et du traité de Lisbonne ?
Enfin, pourquoi ne pas donner dans notre droit national un contenu au mandatement ? Ne pas le faire revient en réalité, comme c'est régulièrement le cas de la part du Gouvernement, à clamer d'abord la valeur de nos services publics de proximité et de nos services sociaux, et la nécessité de les défendre, puis à baisser pavillon d'emblée quand on en vient à l'examen d'un texte. Surtout, ne pas le faire revient à laisser se développer une offre privée importante – cela se passe déjà dans le secteur de la petite enfance – et à prendre le risque que, dans quelques mois ou dans quelques années, au nom de la concurrence, on exige un abaissement des normes et on remette en cause des financements publics insécurisés aujourd'hui du fait de la non-obligation de mandatement.

Mais peut-être le véritable objectif du Gouvernement est-il d'abandonner aujourd'hui plusieurs secteurs pour pouvoir demain y imposer une dérégulation.

Et encore une fois, on nous expliquera que c'est au nom de l'Europe qu'il faut mener la dérégulation. C'est ce qui est insupportable dans votre démarche. Vous allez me dire, madame le secrétaire d'État, que j'exagère. Mais c'est exactement le raisonnement qui a été suivi pour l'AFPA, sans vrais débats. On nous a dit : « Voilà, c'est l'Europe, la concurrence s'impose, c'est comme ça ! »
Une citation pour conclure : « Il ne faut pas faire porter à Bruxelles la responsabilité de ce qui est fait ici ou là au titre de la subsidiarité de chaque État. » Vous aurez reconnu les propos de Michel Barnier,…

…qui a vocation à devenir le futur commissaire au marché intérieur. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Je veux d'abord remercier les orateurs pour la qualité du débat. Je tiens ensuite à rassurer M. Juanico et M. Lecoq : les services sociaux ou d'intérêt général sont préservés avec la méthode de transposition choisie par la France. Rien, je le répète, n'a été fait en catimini puisque le Parlement a été amené à se prononcer chaque fois que des modifications ont été nécessaires.Mme Rosso-Debord l'a d'ailleurs confirmé. Tout le reste de la réglementation était déjà conforme à la directive. Aucune loi-cadre n'était donc nécessaire.
Je rappelle en outre que la France n'est pas le seul pays à avoir choisi cette façon de transposer la directive : l'Allemagne a fait de même. Ce sont les deux pays qui ont les services sociaux les plus développés et les plus forts.
Monsieur Caresche, vous conviendrez avec moi qu'il y a un bien plus grand risque juridique à exclure des activités qui devraient être dans le champ de la directive plutôt qu'à les y inclure en justifiant les régimes particuliers dont ils font l'objet par des motifs d'intérêt général.
C'est le choix qu'a fait la France. C'est celui du Gouvernement. Nous assumerons nos responsabilités dans la suite de la procédure communautaire et nous continuerons à défendre le régime d'autorisation des services inclus dans le champ de la directive.
Vous le voyez, le Gouvernement reste très attaché à la spécificité de nos services sociaux d'intérêt général.
Monsieur le président, en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande la réserve du vote des articles et des amendements sur cette proposition de loi.

La réserve est de droit.
Mes chers collègues, vous l'avez vu, j'ai laissé la discussion se dérouler pleinement.

Dans ces conditions, je pense que vous pourrez vous exprimer autant que nécessaire mais avec concision dans le débat sur les amendements. De la sorte, nous pourrions éviter la tenue d'une séance de nuit, même si je reste bien entendu à la disposition de l'Assemblée, et achever nos travaux vers vingt heures.

J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement puisque la commission n'a pas adopté de texte.

À l'article 1er, je suis saisi d'un amendement n °1 .
La parole est à M. le rapporteur.

L'article 1er précise la nature des services sociaux exclus du champ d'application de la directive au titre des articles 2.2.a et 2.2.j, mais aussi des services d'intérêt économique général en s'appuyant sur l'alinéa 4 de l'article 15 et non 14, comme il est écrit dans la proposition de loi.
L'amendement n° 1 vise donc à corriger une erreur de référence. Aussi son adoption ne devrait-elle pas poser de problème particulier.

Vous le savez, nous avons mis en annexe des listes de services sociaux qui pourraient être exclus du champ de la directive. Il convient d'ajouter à cette liste, même si elle n'est qu'indicative, les missions locales et les PAIO.
Cet amendement, comme le précédent, a été rejeté par la commission.
Défavorable.
(Les votes sur l'amendement n° 2 et sur l'article 1er et l'annexe 1 sont réservés.)

À l'article 2, je suis d'abord saisi d'un amendement n° 3 .
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement, qui a subi le même sort que les précédents en commission, est rédactionnel. Il permet d'éviter une répétition qui alourdit le texte, lequel n'est pas, il faut le reconnaître, d'une lecture très facile.
Défavorable.
(Le vote sur l'amendement n° 3 est réservé.)

Là aussi, il s'agit de corriger une erreur rédactionnelle. Mais cet amendement a, lui aussi, subi les foudres de la commission, ce qui est quelque peu surprenant.
Défavorable.
(Le vote sur l'amendement n° 4 est réservé.)

Il convient de préciser à l'annexe 2 que les missions locales pour l'insertion des jeunes sont bien des services sociaux d'intérêt général.
Je crains que cet amendement ne subisse le même sort que les précédents, comme cela a été le cas en commission.

J'ai peur de le craindre avec vous ! (Sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Défavorable.
(Les votes sur l'amendement n° 5 et sur l'article 2 et les annexes 2 et 3 sont réservés.)

À l'article 4, je suis saisi d'un amendement n° 6 .
La parole est à M. le rapporteur.

Amendement de précision : la convention de partenariat d'intérêt général ne s'adresse pas seulement au secteur associatif, elle peut concerner plus largement les opérateurs que je qualifierai comme relevant du secteur privé non lucratif.
Malheureusement, la commission a émis un avis défavorable.
Défavorable.
(Les votes sur l'amendement n° 6 et sur l'article 4 sont réservés.)

Nous avons achevé l'examen des articles.
Je rappelle que la Conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote, par scrutin public, sur l'ensemble de la proposition de loi auraient lieu le mardi 26 janvier, après les questions au Gouvernement.
Pour chacune des deux propositions de loi inscrites aujourd'hui à l'ordre du jour, le Gouvernement, en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, demande à l'Assemblée nationale de se prononcer par un seul vote sur les articles et sur l'ensemble de la proposition de loi, à l'exclusion de tout amendement.

Les votes, par scrutin public, sur les articles et sur l'ensemble de ces propositions de loi, auront donc lieu, mardi prochain, selon les modalités annoncées par le Gouvernement.

Prochaine séance, vendredi 22 janvier, à neuf heures quarante-cinq :
Suite du projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma