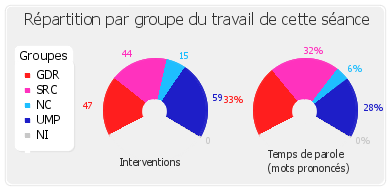Séance en hémicycle du 12 juillet 2007 à 9h30
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)


Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.

Monsieur le président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 58, alinéa 2.
Madame la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, nous sommes réunis pour discuter d'un texte particulièrement important, pour vous comme pour nous, compte tenu des conséquences qu'il aura pour notre pays.
Nous ne sommes pas, ici, éloignés de l'actualité ni des relations entre l'Élysée et certains ministères. On ne sait par quel artifice constitutionnel, le Président de la République vous a adressé une lettre de mission pour les années qui viennent. Or nous avons pu lire dans la presse que certains des éléments qui y sont évoqués nous concernent directement.

Madame la ministre, plutôt que de le découvrir dans la presse spécialisée, il serait préférable que vous exposiez devant nous le contenu de la lettre de mission que le Président de la République vous a adressée et qui n'est pas sans lien avec ce texte puisqu'elle semble concerner des questions relatives au salariat et au fait de travailler certains jours. Au-delà de l'aspect constitutionnel, nous en informer, comme évoquer devant nous la réunion de Bruxelles où vous avez accompagné le Président de la République, serait une marque de considération envers la représentation nationale.

La parole est à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Monsieur le député, je m'engage volontiers à le faire tout à l'heure pour ce qui, dans cette lettre de mission, a un rapport manifeste avec le texte que nous examinons.
Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que je serai malheureusement obligée de quitter l'hémicycle tout à l'heure, pour une courte durée. En effet, j'ai rendez-vous avec M. le Premier ministre, ce qui me permettra d'évoquer cette lettre de mission, dont j'ai pris connaissance hier. Je vous prie donc de m'excuser par avance de devoir m'absenter de l'hémicycle entre neuf heures cinquante et dix heures quarante environ.

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement n° 171 portant article additionnel après l'article 1er.

Madame la ministre, lors de la discussion générale, j'ai appelé votre attention sur la question du cumul entre emploi et retraite, véritable course de haies pour les jeunes retraités qui désirent travailler un jour, deux jours ou six mois dans telle ou telle entreprise et que des dispositions malthusiennes empêchent de le faire alors que l'économie nationale a besoin d'eux.
L'amendement que j'ai l'honneur de défendre devant vous a trait au personnel navigant de cabine, dont la situation est plus que paradoxale : les pilotes de ligne, c'est-à-dire le personnel navigant qui pilote des aéronefs, peuvent, eux, travailler jusqu'à soixante ans – voire soixante-cinq ans, comme le leur permettent les recommandations de l'Organisation internationale de l'aviation civile, sous réserve naturellement de leur aptitude physique.
La loi du 27 juillet 2004 a renvoyé à un décret le régime des retraites du personnel navigant de cabine. Ces personnes sont quasiment obligées de partir en retraite à cinquante-cinq ans puisqu'elles n'ont plus la possibilité de voler. Le procédé de reclassement au sol qui leur est proposé est illusoire dans la mesure où les compagnies aériennes n'ont en général guère besoin de personnel supplémentaire au sol.
Les personnels navigants de cabine sont ainsi amenés à partir en retraite à cinquante-cinq ans. J'ajoute que la plupart d'entre eux n'ont pas réuni le nombre de points nécessaire, même s'ils sont indemnisés pendant deux ou trois ans en vertu des dispositions relatives aux cotisations sociales.
Il y a là une injustice flagrante. Ces personnes souhaitent travailler et sont souvent parfaitement aptes physiquement à effectuer leur mission en cabine. Je vous répète que les pilotes peuvent aller jusqu'à soixante ans, l'âge légal, et parfois soixante-cinq ans. C'est pourquoi je demande la suppression des deux dernières phrases de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile.

La parole est à M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du plan, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 171 .

La commission a rejeté cet amendement, pour une raison générale que j'ai évoquée hier matin au début de notre discussion : elle s'est fixé pour règle de rejeter tous les amendements tendant à modifier le code du travail – comme les dispositions du code de l'aviation civile qui s'y apparentent. Cette objection s'applique donc à votre amendement.

La parole est à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 171 .
Monsieur Myard, pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Permettez-moi toutefois de préciser que cette catégorie de salariés relève des questions qui seront évoquées à la rentrée lors d'une conférence relative au plan « Seniors », initié par M. Gérard Larcher et repris par M. Xavier Bertrand.

J'entends bien le Gouvernement, mais le temps presse ! Il y a une injustice patente à empêcher des personnes qui le souhaitent de travailler. D'un côté, les pilotes de ligne, qui ont pourtant une importante responsabilité, peuvent travailler jusqu'à soixante ans et, de l'autre, les personnels de cabine sont littéralement débarqués – c'est le cas de le dire ! – des aéronefs à cinquante-cinq ans. Le reclassement qu'on leur propose ne fonctionne pas – mais, naturellement, monsieur le rapporteur général, cela dépend du code du travail ! Je maintiens donc ma position et vous demande d'abroger cet article.
Savez-vous, monsieur le rapporteur général, ce que disait Clemenceau à propos des principes ? Qu'il fallait s'appuyer dessus jusqu'à ce qu'ils cassent ! (Sourires.) Nous devons prendre nos responsabilités et avoir le courage de modifier une loi contraire à l'intérêt de celles et de ceux qui souhaitent travailler au bénéfice de l'économie nationale.
Je maintiens donc mon amendement.

Monsieur le président, l'amendement de M. Myard rejoignant la thématique du travail et des retraites, nous souhaitons nous concerter pour faire le point.
Sans vouloir retarder nos travaux, je sollicite une courte suspension de séance pour réunir notre groupe.

La suspension est de droit.
Je vais donc suspendre la séance pour une dizaine de minutes.
Après l'article 1er

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures quarante, est reprise à neuf heures cinquante.)

Je suis saisi d'un amendement n° 252 .
La parole est à M. Éric Jalton, pour le soutenir.

Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a fixé un objectif de 5 % de chômeurs à la fin de la législature. Nous aimerions que cet objectif soit également valable pour l'outre-mer, et notamment pour la Guadeloupe.
Cet amendement, présenté par ma collègue Jeanny Marc, et que j'ai cosigné avec Victorin Lurel, vise à exonérer, en Guadeloupe et en Martinique, quelle que soit la superficie cultivée, les agriculteurs propriétaires de terrains contaminés par la présence de chlordécone, de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, à l'invalidité, à la maternité et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret. Cette mesure est à mettre en place pour toute la durée de la décontamination des sols.
Ces agriculteurs, dont les productions sont devenues impropres à la consommation, se voient privés de revenus et confrontés à des contentieux sociaux et fiscaux inextricables du fait de cette catastrophe environnementale touchant une partie du territoire national. La pollution des sols de ces deux collectivités françaises d'outre-mer est aujourd'hui avérée, et l'expression de la solidarité nationale vis-à-vis de nos compatriotes doit s'exprimer pleinement à l'occasion de ce premier texte portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat.
Pesticide organochloré utilisé entre 1981 et 1993 et employé pour le traitement des bananeraies afin de lutter contre le charançon, le chlordécone appartient à la même famille que le DDT, le lindane et le mirex. Il s'agit en effet d'un polluant organique persistant, extrêmement rémanent dans l'environnement, qui peut s'avérer très toxique. Il a été classé comme cancérigène potentiel chez l'homme dès 1979, mais n'a été interdit qu'en 1993, après avoir été utilisé, notamment aux Antilles.
Le chlordécone est une substance très stable, qui se dégrade difficilement et a tendance à s'accumuler dans les sols et les graisses. Cette pollution se retrouve dans d'anciennes terres de cultures bananières rendues à la culture vivrière. Du fait de sa rémanence, le chlordécone est encore présent dans des sols et contamine certains produits cultivés sur ces terrains. Une quinzaine de sources d'eaux de captage, également polluées par ce produit, sont progressivement traitées au charbon actif. Rappelons que le capital premier de la Guadeloupe est constitué de son or bleu, d'autant que cette collectivité a pour nom originel Karukera, « l'île aux belles eaux ». Les végétaux les plus contaminés sont d'abord les légumes racines, en raison de la migration directe du chlordécone du sol vers la racine. Certains végétaux, dont les parties comestibles sont proches de leur racine, ou qui sont en contact avec la terre, peuvent être aussi contaminés, mais plus faiblement.
À la demande des ministères de l'agriculture, de la consommation et de la santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été chargée d'évaluer l'exposition alimentaire de la population antillaise au chlordécone et de fixer des limites maximales de contamination des denrées.
Par un arrêté du 5 octobre 2005 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sont considérés comme impropres à la consommation humaine un certain nombre de produits tels que la viande de volaille et les denrées alimentaires d'origine animale. Par un arrêté du 10 octobre 2005 du même ministère, sont également considérés comme impropres à la consommation humaine certains produits de consommation courante, comme les carottes, les concombres ou les tomates. On constate que les principaux produits touchés sont des cultures vivrières ou de diversification agricole.
La solidarité nationale envers les agriculteurs des Antilles est donc indispensable.
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi, et considérant que ce projet vise à augmenter le pouvoir d'achat, à stimuler l'emploi et le travail, que l'emploi et le travail des agriculteurs de la Guadeloupe et de la Martinique se trouvent être passablement compromis par une catastrophe environnementale sans précédent, il est politiquement justifié et juridiquement établi que les exploitants agricoles ne disposant plus de leurs outils de production bénéficient d'exonérations de charges durant la période de décontamination de leurs exploitations.

Bien que la commission reconnaisse l'extrême gravité du problème soulevé par M. Jalton, elle est défavorable à cet amendement, dans la mesure où une exonération de charges sociales ne semble pas être le meilleur moyen de traiter la question.
Jean-Charles Taugourdeau, qui est membre de la commission des affaires économiques, laquelle a rendu un rapport d'information sur ce sujet, complétera mes propos.

La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.

La commission des affaires économiques a travaillé sur ce sujet en 2005 et préconisé que l'État verse une aide aux agriculteurs dont les terrains sont pollués. En outre, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, M. François Baroin avait annoncé qu'une indemnisation serait accordée aux agriculteurs amenés à détruire leur récolte ou à abandonner leurs productions en cours. Il semble donc plus approprié de reparler de cette question lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008.

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 252 .
Le Gouvernement est très sensible à vos arguments, monsieur Jalton, et nous sommes conscients qu'il s'agit d'un problème majeur pour votre département. Le FEADER – le fonds européen agricole pour le développement rural – s'apprête à soutenir la diversification et la reconversion des exploitations touchées par la contamination des sols au chlordécone. À cet effet, le ministre de l'agriculture a écrit le 21 juin dernier au préfet de la Martinique – cela concerne également la Guadeloupe – pour lui demander de mobiliser des crédits.
Enfin, je précise que les exploitations inférieures à quarante hectares sont déjà exonérées de charges sociales.
Pour toutes ces raisons, monsieur Jalton, le Gouvernement souhaite que vous retiriez cet amendement. Si cet amendement était maintenu, il en demanderait le rejet.

Permettez-moi de revenir sur la question posée par mon collègue Éric Jalton, afin que chacun d'entre nous prenne conscience de l'ampleur de la catastrophe.
Il ne s'agit pas seulement de la Guadeloupe et de la Martinique, mais de la Caraïbe tout entière, dont les sols sont pollués par les pesticides de la famille des organochlorés, notamment le chlordécone, le mirex, ainsi que tous les isomères de cette famille.
En Guadeloupe, sur 40 000 hectares de terres, 5 000 sont concernés. Alors que ce texte vise à encourager ceux qui travaillent déjà à « travailler plus pour gagner plus », nous allons perdre des emplois.
Les reconversions, les diversifications sont désormais inadéquates. Les chercheurs ont montré que, les pesticides remontant dans la sève, les bananes – production majeure de la Guadeloupe et de la Martinique – ne sont plus à l'abri de la contamination.
Lors d'une session plénière, le conseil régional de la Guadeloupe a été envahi par des militants politiques –écologistes ou nationalistes – et par des élus venus dénoncer l'inertie de l'État. Nous connaissons le taux de prévalence du cancer de la prostate, du cancer du sein, des malformations congénitales le plus important au monde ! Il s'agit d'une véritable catastrophe sanitaire ! Et si l'on ne fait rien, il faudra faire face à l'opinion publique guadeloupéenne et martiniquaise.
Il y a bien eu une mission d'information, en effet – alors qu'une commission d'enquête parlementaire d'enquête avait été demandée. Mais elle a plus divisé que réuni. Savez-vous que le ministère de la santé a refusé de nous recevoir ? Que le service des douanes n'a pas été entendu ? Ni celui de la protection des végétaux ? Les responsabilités n'ont pas été recherchées : on n'a fait que ménager les uns et les autres. Quatorze ans après l'interdiction, décidée en 1993, il subsiste encore des stocks de Curlone ou de Kepone – noms commerciaux de ces produits – dans les hangars à bananes ! Manifestement, il existe des filières d'importation illégale en provenance des États-Unis, mais ce point n'a jamais été élucidé !
L'État, par la voix de M. Bussereau, alors ministre de l'agriculture, a promis des indemnisations. Mais, à mesure que les questions posées se font plus précises, les engagements tendent à s'amenuiser. On nous a dit que les pertes liées à la destruction des récoltes seraient indemnisées, alors que nous savons, dans l'état actuel de la recherche, que les sols pollués de Guadeloupe et de Martinique devront être gelés pendant 516 ans !
L'État doit prendre un engagement fort. Il existe une demande de l'opinion publique, relayée, je l'espère, par tous les parlementaires d'outre-mer, au-delà des clivages politiques, en faveur d'une véritable commission d'enquête parlementaire, afin de faire toute la lumière sur le sujet.
Par ailleurs, depuis la loi de juillet 1992, les distributeurs d'eau doivent mettre à la disposition des usagers une eau exempte de toute contamination. Or, depuis quinze ans, en Guadeloupe et en Martinique, les communiqués des DSDS et les DRASS, qui valident la conformité des eaux distribuées, sont mensongers. La responsabilité des services de l'État est donc engagée, comme l'est celle des sociétés commerciales de distribution, mais personne ne veut en parler. Quand on évoque la question, comme aujourd'hui, on nous renvoie aux calendes grecques : « Dormez tranquille, nous pensons à vous ! »
L'État doit s'engager à résoudre ce problème de santé publique ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen.)

Monsieur Jalton, eu égard à l'engagement du Gouvernement, retirez-vous votre amendement ?

Nous aimerions entendre la réponse du Gouvernement ! Ce qui a été dit n'a rien d'anodin !
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Il a déjà répondu !

La question dépasse la portée de l'amendement. Permettez-moi, monsieur le président…

Le ministre a évoqué la loi d'orientation pour l'outre-mer, adoptée par les socialistes, qui exonère de charges sociales les exploitations inférieures à quarante hectares. Mais il s'agit d'une surface pondérée qui, compte tenu du coefficient appliqué, revient en fait à dix hectares pour la culture de la banane. Or la surface réelle de la plupart des exploitations dépassant dix hectares, nous en avons déjà perdu plus de huit cents. Une grande part des surfaces agricoles concernées est donc condamnée à rester en friche. Il faut faire quelque chose !
Une solution serait de modifier l'article L. 762-4 du code rural en portant le seuil de quarante à cent hectares pondérés, soit vingt-cinq hectares. Si, au moins, le Gouvernement prenait cet engagement, nous pourrions nous en satisfaire, malgré le rejet de l'amendement. Il faut donner un signe à l'opinion publique, non pas seulement guadeloupéenne ou martiniquaise, mais aussi métropolitaine. Dans le cas du Régent, qui a fini par être interdit et contre lequel M. de Villiers avait manifesté dans les rues du Puy-du-Fou, les agriculteurs ont été indemnisés et des mesures d'accompagnement prises. Pourquoi cette discrimination à l'égard des outre-mer français ? Je demande une réponse du Gouvernement !

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.
Monsieur le député, j'ai en effet évoqué le seuil de quarante hectares, mais j'ai aussi souligné à quel point le Gouvernement était préoccupé par ce sujet, et notamment le ministre de l'agriculture, dont c'est la compétence directe, et qui a donné instruction aux préfets concernés de mobiliser les crédits du FEADER. Je ne peux que renouveler mes déclarations.

Je suis saisi d'un amendement n° 390 .
La parole est à M. Michel Bouvard, pour le soutenir.

La loi sur les retraites de 2003 a prévu d'encourager la reprise d'activité des retraités en permettant partiellement le cumul de la pension de retraite et des revenus d'une activité réduite. Mais il subsiste une anomalie à laquelle cet amendement a pour objet de remédier. Dans un certain nombre de cas, en effet, les cotisations réclamées sont anormalement élevées au regard de l'activité effectuée. En particulier, les cotisations forfaitaires appelées par certaines caisses de retraite finissent par amputer très fortement les ressources complémentaires dégagées par les retraités demeurés actifs. Nous proposons donc de faire en sorte que les taux de cotisation appliqués soient adaptés à l'ampleur des revenus tirés du complément d'activité.

La commission n'a pas retenu cet amendement, pas plus que l'amendement n 171 de M. Myard, dans la mesure où le sujet général du maintien de l'activité en période de retraite sera abordé lors du rendez-vous consacré aux retraites.
Je souhaite souligner l'importance de la question évoquée par Michel Bouvard.
Notre pays, vous le savez, connaît un taux d'activité des seniors particulièrement bas. Un des objectifs du Gouvernement est donc de permettre aux plus de cinquante-cinq ans de retrouver une activité, en allant plus loin que la mobilisation déjà engagée par Gérard Larcher avec le plan « Seniors ».
Cela étant, la question dépasse celle des heures supplémentaires dont nous discutons aujourd'hui, même si nous sommes amenés à évoquer les retraites et les cotisations sociales. Elle devrait plutôt être abordée dans le cadre du rendez-vous « retraites » et, de manière plus globale, dans celui du PLFSS.
Je sollicite donc le retrait de l'amendement.

Compte tenu de la consultation effectuée pendant la suspension de séance, je vais donner suite à la demande du Gouvernement.
J'aimerais cependant citer le cas d'une personne, retraitée de l'industrie chimique et qui, ayant acquis un certain savoir-faire en matière de sécurité, a décidé de monter une micro-entreprise afin d'aider les entreprises du secteur de la chimie – assez nombreuses dans le département où je suis élu – à progresser dans ce domaine. Or, contrairement à l'URSSAF et à la caisse d'assurance maladie, qui ont bien voulu prendre en compte les ressources réelles tirées de cette initiative, la CIPAV fait preuve de mauvaise volonté : elle réclame en effet, pour l'année, une cotisation forfaitaire de 840 euros, alors que les revenus générés par la micro-entreprise ne s'élevaient, pour la première année d'exercice, qu'à 2 500 euros. Telle est une des aberrations que nous souhaitons voir corriger.
Compte tenu de l'engagement du Gouvernement, je retire mon amendement, mais je souligne l'urgence de la situation, non seulement du point de vue du maintien de l'activité, mais aussi de celui de la transmission des savoirs.


Considérant le caractère explosif du chômage dans les quatre départements d'outre-mer, le postulat « travailler plus pour gagner plus » s'y révèle totalement inopérant. En effet, l'évolution du marché de l'emploi est particulièrement préoccupante dans ces départements. Selon l'INSEE, le taux de chômage, qui atteignait en 2006 27,3 % en Guadeloupe, 29,1 % à la Martinique et 25,2 % en Guyane a augmenté respectivement de 1,3, de 3,5 et de 2,6 points, tandis qu'à la Réunion il régressait pour la première fois sous la barre des 30 %.
Pour ne prendre que l'exemple de la Guadeloupe, les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans demeurent, avec un taux de 58,4 %, les plus touchés par le chômage, et ce malgré les dispositifs du congé solidarité mis en place en 2000. Et je ne parle pas des femmes au chômage ni des chômeurs de longue durée !
Au 31 décembre 2006, les demandes d'emploi par niveau de formation étaient, en Guadeloupe, au nombre de 11 500. Dès lors, la véritable priorité en matière de lutte contre le chômage est de permettre à notre jeunesse diplômée de travailler pour vivre dans la dignité du fruit de leur labeur.
Par ailleurs, la hausse des prix est bien supérieure dans les DOM à celle enregistrée en France hexagonale – 2,7 % contre 1,5 % –, en raison de l'augmentation des prix de l'énergie, du logement et des transports.
Si la relance de nos économies insulaires passe actuellement par les dispositions prévues par la loi de programme pour l'outre-mer – exonérations de charges sociales et incitations fiscales –, la crise de l'emploi revêt de telles proportions, en dépit des efforts consacrés à la lutte contre le chômage, qu'il devient urgent de renforcer le dispositif d'exonération de charges, dès lors que le salarié est un jeune diplômé d'études supérieures, demandeur d'emploi depuis plus de six mois.
En adoptant le dispositif présenté par cet amendement, nous voulons amplifier un instrument de lutte contre le chômage des jeunes et, de manière concomitante, améliorer le pouvoir d'achat d'un public fragilisé par l'insularité et l'exiguïté du marché du travail.
Nos populations veulent un signal fort. Elles réclament des solutions concrètes et pragmatiques pour lutter contre ce chômage omniprésent outre-mer, qui brise notre jeunesse. Quant à cette dernière, elle aspire non à travailler plus, mais à travailler tout court !


Monsieur Jalton, le dispositif d'exonération de charges patronales spécifiques à l'outre-mer a donné des résultats positifs. Je tenais à insister sur ce point.
La commission a rejeté l'amendement n° 250 pour des raisons notamment techniques. En effet, tel qu'il a été rédigé, il jouerait pour de nouveaux salariés qui viendraient à être recrutés, mais les charges patronales ne seraient plus exonérées pour un salarié déjà présent dans l'entreprise et dont le salaire dépasserait 1,3 fois le SMIC. Ce serait donc vraiment contraire à l'intérêt de l'entreprise. De plus, lier cette majoration à une condition de diplôme risque de confiner les salariés non diplômés dans une trappe à bas salaire.
J'ai participé à la commission d'évaluation des charges sociales patronales, instaurée sous la précédente législature. Son appréciation du dispositif actuel est plutôt positive. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui en rester là.
Monsieur Jalton, le Gouvernement partage votre volonté d'adresser un signal fort aux populations d'outre-mer qui veulent des solutions en matière d'emploi et d'activité économique. Le Président de la République, vous le savez, s'est engagé sur la mise en place d'un dispositif de zones franches globales d'activité permettant de traiter dans leur ensemble les questions de développement économique, d'emploi et de lutte contre le chômage.
Par ailleurs, une réflexion est en cours au sein de la Commission nationale d'évaluation de la mise en oeuvre de la loi d'orientation pour l'outre-mer de 2003, ainsi qu'un rapport d'audit de modernisation sur l'évaluation du dispositif d'exonération de charges sociales spécifique à l'outre-mer.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite traiter cette question de manière globale. Il n'est donc pas favorable à l'adoption de cet amendement dans le cadre de ce projet de loi.

Nous avons une difficulté conceptuelle.
Il s'agit d'un texte en faveur de l'emploi, du travail et du pouvoir d'achat. Or vous nous objectez qu'il existe un dispositif spécifique qu'il convient d'évaluer. Une commission nationale a apparemment commencé à travailler. Elle aurait même publié des documents. Mais le député que je suis n'en a pas eu connaissance.
Votre premier acte, en guise d'évaluation, a été de supprimer la quote-part de financement de l'État sur le dispositif du congé de solidarité. Je rappelle à nos collègues que le congé de solidarité – peut-être n'est-ce pas votre conception – est destiné à favoriser le départ à la retraite d'un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans, qui a les annuités suffisantes, à condition que l'entreprise embauche un jeune de moins de trente ans ou de trente ans au plus. Cette mesure était financée à raison de 60 % par l'État, les 40 % restants étant à la charge des collectivités et des entreprises. Le financement de l'État a été réduit à 50 % dans la loi de finances pour 2007, alors que vous vous étiez escrimés à nous expliquer l'efficacité du dispositif. La région Guadeloupe, que je préside, finance le délestage, la défausse de l'État, alors que cette mesure permet pourtant de créer des emplois.
Dans un environnement gangrené par le chômage, il faut livrer ce que le philosophe Stevenson appelait « l'équivalent moral d'une guerre ». Or nous avons l'impression que, en guise de guerre contre le chômage, ce ne sont que des atermoiements, des petits dispositifs, du rafistolage, des cautères sur une jambe de bois. Et j'ose rappeler les propos du Président de la République, Nicolas Sarkozy : il faut une discrimination positive, non pas territoriale, ajouterai-je, mais en faveur des jeunes diplômés, chômeurs de longue durée.
Nous rencontrons un véritable problème en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. C'est également vrai en Guyane et dans les autres pays d'outre-mer. Des jeunes ont ainsi fait l'effort de se qualifier, d'être diplômés et regardent passer le train de l'emploi. Ils sont au chômage chez eux ! Nous sommes donc face à de jeunes lettrés, de jeunes intellectuels qui commencent à sombrer dans l'agitation. Si vous refusez d'aller au-delà de votre philosophie libérale selon laquelle l'emploi est un solde – ce qui reste quand on a croisé l'offre et la demande –, vous susciterez de la désespérance et de l'agitation ! Il convient de répondre plus positivement aux sollicitations. (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen.)

Je suis saisi d'un amendement n° 137 .
La parole est à M. Roland Muzeau, pour le soutenir.

En défendant cet amendement, je souhaite tout simplement porter au débat la question des astreintes. En réaction aux tentatives de certaines branches patronales de contourner l'effectivité de la réduction de travail, la seconde loi Aubry s'est attachée à clarifier légalement la définition du temps de travail effectif et le régime des astreintes, notamment.
À l'époque déjà, les tentations étaient fortes d'assimiler les périodes d'astreintes à du temps de repos, de banaliser leur utilisation dans l'objectif de permettre aux chefs d'entreprise de continuer à les organiser à leur guise, sans être contraints par un surplus de rémunération, de récupération, donc de contreparties insupportables.
Pratique courante dans de nombreux secteurs, l'astreinte contraignante pour les salariés se devait d'être encadrée, l'accord exprès du salarié n'étant pas requis. Les garanties légales encadrant la mise en place de celles-ci dans l'entreprise alors posées n'étaient pas abusivement sévères. Faute d'accord de branche étendu ou d'accord d'établissement, l'employeur pouvait toujours unilatéralement les mettre en place et décider des compensations sous forme financière ou sous celle de repos. Mais c'était déjà trop. Comme dans d'autres domaines la jurisprudence, jugée trop protectrice des salariés, gênait. La définition équilibrée qu'elle donnait de l'astreinte était insupportable à ceux qui n'avaient pas abandonné l'idée de l'assimiler définitivement à du temps de repos, afin de s'affranchir des règles d'ordre public social relatives au repos quotidien et hebdomadaire, dont l'objet est la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Ainsi, en porte-plume du MEDEF, la majorité UMP d'alors, habituée aux mauvais coups, a profité de la loi Fillon de 2003 pour introduire une modification de l'article L. 212-4 bis du code du travail et remettre en cause la jurisprudence Dalkia. Exit donc le principe selon lequel « un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est en astreinte » et place à une tout autre sécurité au bénéfice de l'employeur puisque, depuis lors, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. »
Décidément, avec votre majorité, tout est possible : même d'être considéré comme en repos tout en restant en alerte, mobilisable, à disposition et obligé de rester à son domicile, à distance raisonnable de son employeur pour être en mesure d'intervenir.
L'État français a été rappelé à l'ordre à ce propos par le Comité de la charte sociale du Conseil de l'Europe dans une décision du 4 mai 2005.
Nous proposons simplement, via notre amendement n° 137 , de supprimer les dispositions incriminées.

La commission a rejeté cet amendement. Comme vous venez de le préciser, monsieur Muzeau, nous avons rejeté tous les amendements tendant à modifier le code du travail, considérant que ce n'était pas l'objet du projet de loi.
L'article 1er porte avant tout sur les conditions d'exonération des heures supplémentaires ou complémentaires. Il ne remet en cause ni la définition de ces heures ni telle ou telle disposition du code du travail.
Telle est la position de principe que nous avons prise.
Au-delà des arguments évoqués par le rapporteur général, je tiens à rappeler que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité. Toutefois, lors du vote de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, il était apparu nécessaire de clarifier la situation du salarié lorsqu'il n'est pas appelé à intervenir pendant cette période d'astreinte. La loi l'a clairement explicité. Cela faisait suite à des arrêts de la Cour de cassation. Dans ce cas, lorsque le salarié n'est pas appelé à travailler, l'astreinte est assimilable au repos.
Pour toutes ces raisons, et parce que cela ne relève pas directement des sujets qui nous préoccupent, le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet amendement.

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

Monsieur Muzeau, j'aimerais que l'on parle un jour différemment de l'entreprise et du rapport entre les salariés et les employeurs. Hier, vous citiez les entreprises vertueuses, semble-t-il, peu nombreuses. Mme Billard évoquait, quant à elle, les conditions de travail épouvantables ! Comment voulez-vous aujourd'hui donner l'envie aux jeunes de devenir, demain, chefs d'entreprise, vu le peu de considération que vous avez pour eux ? Nous aurons besoin, à l'avenir, des entrepreneurs pour créer des emplois et de la richesse ! (« Bravo ! » et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. – Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

Monsieur le ministre, nous disons forcément la même chose, puisque nous nous référons au même texte ! Le seul problème, c'est que notre analyse n'est pas identique !

D'une clarté biblique, la jurisprudence de la Cour de cassation vous gênait. Vous avez donc profité d'un texte de loi pour l'annuler et imposer des conditions très restrictives…

…et très dommageables aux salariés en position d'astreinte. Telle est la situation !
Monsieur le rapporteur pour avis, vous vous plaignez de l'appréciation que nous portons sur le monde de l'entreprise. Mais vous vous trompez complètement. Ce n'est pas moi qui ai inventé la formule « patrons voyous », mais le Président de la République de l'époque, Jacques Chirac.

L'exemple venait tout de même d'en haut !
Dans l'hémicycle dans lequel je siégeais précédemment, des collègues de la majorité étaient peu avares d'exemples trouvés dans leurs circonscriptions où des entreprises se montraient assez insouciantes quant au sort de leurs salariés. Elles déménageaient, par exemple, un dimanche et les salariés se retrouvaient le lundi dans leur entreprise qui ne comptait plus une seule machine !

Contrairement à ce que vous semblez craindre, monsieur le rapporteur pour avis, je n'ai jamais fait d'amalgame entre toutes les entreprises et tous les chefs d'entreprise. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Vous remarquerez que, depuis le début de nos débats, je cite des exemples nominatifs. Quand je dis que, malheureusement, peu d'entreprises sont vertueuses en matière de salaires ou d'égalité entre hommes et femmes, je m'appuie sur des statistiques. Si elles étaient différentes, j'en serais le premier ravi, mais tel n'est pas le cas ! Mais il ne faut jamais désespérer de rien. Cela étant, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.
Malgré l'assurance que m'avez donnée de ne pas toucher au code du travail, monsieur Carrez, nous avons constaté, lors de l'examen de l'article 1er, que le fameux principe « travailler plus pour gagner plus » dépassait le plafond des 1 607 heures ! Nous touchons là tout de même aux aspects fondamentaux du code du travail et des garanties sociales !

Je suis saisi d'un amendement n° 139 rectifié .
La parole est à M. Roland Muzeau, pour le soutenir.

Les salariés sous contrat à temps partiel, dans leur immense majorité, se trouvent dans cette situation professionnelle par nécessité et non par choix. Dans certaines branches professionnelles, en particulier la grande distribution, la recherche de flexibilité et de rentabilité de l'employeur se traduit directement par le temps partiel imposé aux salariés, surtout aux salariés les moins qualifiés et aux femmes, et les livre – personne n'en doute ici – à la précarité. On peut affirmer que la quasi-unanimité de la grande distribution se comporte ainsi. Nous ne risquons donc pas de nous tromper.
Une étude récente de la DARES montre, à cet égard, que, dans la population active à temps partiel, la catégorie des employés est sur–représentée, à hauteur de 59 % contre 8 % de cadres.
S'agissant des femmes, une enquête de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail publiée cette année relève que, si l'on additionne leur temps de travail rémunéré en temps partiel et leur temps « domestique » travaillé, on arrive à un temps total supérieur à celui des hommes travaillant à temps plein !
Le rapport de force entre employés et employeur, dois-je vous le rappeler, n'est pas un rapport d'égalité. Nous souhaitons tous ici, j'en suis sûr, je l'espère en tout cas, le voir tendre vers la justice et l'équilibre, principalement par l'intermédiaire du code du travail, qu'il nous faudra améliorer et arrêter de dégrader. Or force est de constater que les dispositions qui nous sont proposées sur le recours aux heures complémentaires pour les contrats à temps partiel ouvrent au contraire toute grande la porte aux abus.
C'est pourquoi l'amendement défendu par mon groupe vise à modifier l'article L. 212-4-3 du code du travail, insuffisant en l'état. En effet, celui-ci ne prévoit qu'une modification des heures de travail prévues au contrat partiel initial en cas de dépassement des heures complémentaires réglementaires. L'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1998 ne résout en rien ce problème.
Il est donc nécessaire d'aller plus loin et de donner la possibilité à l'employé en temps partiel de demander une requalification de son contrat en temps plein en cas de dépassement abusif des heures complémentaires au-delà des conditions prévues par la loi.

La commission a donné un avis défavorable à cet amendement (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine), toujours parce qu'il touche le code du travail, mais je vais apporter quelques éléments de fond.
Votre amendement, monsieur Muzeau, prévoit le cas où, en raison des heures complémentaires, le temps de travail d'un titulaire d'un contrat à temps partiel atteindrait la durée légale. Or ce cas est exclu par le code du travail puisque le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Un tel dispositif vise justement à protéger les salariés à temps partiel de l'utilisation abusive du temps partiel alors qu'on leur demanderait de faire du temps plein. Il a pour objet d'inciter à proposer des contrats à temps complet.

De surcroît, et l'on n'a pas évoqué ce point jusqu'à présent, si l'article 1er ouvre le droit à exonération de cotisations salariales pour les heures complémentaires, il n'y a pas de déduction forfaitaire de la cotisation patronale, et cela précisément pour ne pas encourager les employeurs à proposer des contrats à temps partiel mais pour les inciter à proposer plutôt des contrats à temps plein. Seuls les contrats à temps plein ouvriront droit à la déduction forfaitaire, qui sera fixée par décret – 0,50 euro au-delà de vingt salariés, 1,50 euro au-dessous de vingt salariés.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement…
…pour les raisons qu'a évoquées M. le rapporteur général.
Vous savez, monsieur Muzeau, que, dans le code du travail, il existe aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une clause anti-abus. Si le salarié effectue des heures complémentaires à hauteur de la durée du travail, le contrat de travail est immédiatement modifié, sauf opposition de sa part. Cette disposition a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 14 juin 2006.

Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié .
(L'amendement n'est pas adopté.)

Je suis saisi d'un amendement n° 140 .
La parole est à M. Roland Muzeau, pour le défendre.

L'article L. 212-4-3 du code du travail dispose notamment, dans son quatrième alinéa, que le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Cette disposition est importante dans la mesure où le salarié est loin d'être placé dans une situation d'égalité par rapport à son employeur. La liberté de consentir est largement entamée par le poids du chômage et le caractère immédiat des pressions intérieures à l'entreprise et des pressions économiques et familiales extérieures.
Il importe donc de protéger le salarié contre toute forme de chantage.
L'employeur ne peut invoquer, en cas de refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires, une quelconque faute constituant un motif réel et sérieux de licenciement. Cette disposition protectrice doit toutefois être élargie. Elle vise seulement le refus d'exécuter des heures complémentaires au-delà du dixième de l'horaire prévu au contrat, possibilité ouverte par simple accord collectif de travail, ce qui permet de repousser la limite dans laquelle ces heures restent légalement possibles. Lorsque les heures complémentaires sont proposées dans la limite d'un dixième de l'horaire prévu au contrat, le salarié peut les refuser à condition que le délai de prévenance de trois jours n'ait pas été respecté.
Nous connaissons la situation faite aux personnes qui travaillent à temps partiel et qui, majoritairement, y sont contraintes. Les horaires de travail sont éclatés, les plages horaires sont larges. Nous savons en conséquence qu'il leur est tout particulièrement difficile d'organiser leur vie, d'articuler leur activité professionnelle avec leurs contraintes familiales et leurs envies personnelles.
Nous savons également que les employeurs, intentionnellement ou pas d'ailleurs, nécessités économiques obligent, ont tendance à s'affranchir de ce délai de prévenance, délai passablement assoupli par la récente loi sur le développement des services à la personne et portant diverses dispositions en faveur de la cohésion sociale.
Notre amendement n° 140 lève en conséquence toute ambiguïté quant aux motifs valables permettant aux salariés de refuser de faire des heures complémentaires. Il propose que, même à l'intérieur des limites autorisées par le contrat de travail, le salarié soit libre de refuser.

La commission a rejeté cet amendement dans la mesure où le code du travail fixe très précisément les règles du jeu.
Pour les contrats à temps partiel, le salarié est libre de refuser des heures complémentaires au-delà de ce qui est prévu dans le contrat. Pour les contrats à temps complet, il est libre de refuser les heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures – ce qu'on appelle les heures choisies. J'ajoute que celles-ci sont bien entendu couvertes par l'exonération de charges salariales.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement pour les raisons qu'a exposées M. le rapporteur général.
Les dispositions concernant les heures complémentaires sont protectrices pour le salarié, qui peut choisir. Il n'y a donc pas lieu de les remettre en question.

Je suis saisi d'un amendement n° 217 .
La parole est à M. Jean Launay, pour le défendre.

Nous nous sommes demandé qui avait besoin de gagner plus, et nous répondons que ce sont ceux qui travaillent le moins et qui auraient besoin de travailler plus. Cet amendement est donc une déclinaison de la formule magique !
Il faut porter attention aux salariés à temps partiel imposé. Nous souhaitons donc que l'accord collectif de travail fixe les conditions dans lesquelles ils doivent se voir proposer en priorité les heures complémentaires et les heures choisies.

La commission a rejeté cet amendement, mais nous avons tous constaté hier soir que nous étions d'accord sur le fait que, dès lors que l'activité de l'entreprise permet un surcroît de travail, la priorité doit aller aux salariés à temps partiel.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement puisque le dispositif des heures choisies qui s'applique aux salariés à temps plein n'empêche nullement les salariés à temps partiel qui le souhaitent d'augmenter par avenant à leur contrat le volume de travail fixé dans le contrat de travail. Cet amendement ne prend pas en compte la liberté d'organisation des entreprises ni le fait qu'un salarié ne peut pas se substituer à un autre.

Nous venons d'entendre deux réponses assez contradictoires.
Le rapporteur général, qui ne se renie pas par rapport à son propos d'hier, et je l'en remercie, nous dit en gros ce que nous écrivons dans notre amendement, c'est-à-dire que, lorsqu'il y a plus de travail, il doit être donné en priorité à ceux qui sont en temps partiel et qui ont envie de travailler plus. Il vient donc de donner un avis favorable à notre amendement, et je l'en remercie.

On pourra lire le compte rendu, monsieur le président, mais il a repris, en le formulant autrement, ce que nous écrivons dans l'amendement.
Monsieur le secrétaire d'État, on vous a connu une plus grande souplesse de langage. Vous n'étiez certes pas dans la même situation, mais vous allez chercher une drôle d'argumentation. Il faut bien en effet que vous argumentiez parce que vous êtes gêné quand on vous propose une mesure de cette nature.
Vous nous répondez qu'un tel dispositif n'empêche nullement ceux qui veulent travailler plus de travailler plus mais, si l'employeur décide de donner priorité aux heures supplémentaires pour ceux qui sont déjà à temps plein, parce que les heures complémentaires ne sont pas concernées par la déduction de charges, il y a bien un effet pervers. La formule que nous proposons est parfaitement responsable puisqu'il s'agit, métier par métier, type d'emploi par type d'emploi, d'avoir une approche pour donner la priorité à ceux qui sont à temps partiel non choisi.
C'est une question majeure. Un grand nombre de salariés qui n'ont pas choisi de travailler à temps partiel et qui souhaitent faire plus d'heures seront finalement empêchés de les faire parce que vous refusez la disposition que nous proposons, contrairement d'ailleurs à l'avis qu'a donné le rapporteur général, même si, j'en conviens, monsieur le président, sa conclusion n'était pas tout à fait conforme à une approbation de notre proposition.
Franchement, monsieur le secrétaire d'État, vous ne pouvez pas dire que l'on porte atteinte à la liberté d'organisation du travail dans une entreprise. Si, dans une entreprise, dix salariés font le même métier, cinq à temps partiel non choisi, qui veulent travailler plus, et cinq à temps complet, et que l'on privilégie ceux qui sont à temps complet, il ne s'agit pas de l'organisation de l'entreprise : une telle disposition constitue en la circonstance pour les employeurs un effet d'aubaine.

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, monsieur Brottes, mais il faut laisser la liberté aux chefs d'entreprise.

Quand il y a un surcroît pérenne de travail, on va forcément le proposer aux salariés que l'on connaît : on ne va pas recruter à l'extérieur des gens que l'on ne connaît pas.

Bien sûr, mais il faut faire travailler ceux qui sont à temps partiel afin de leur permettre d'avoir un revenu décent.

À ceux qui travaillent à temps partiel dans l'entreprise, on va proposer à un moment donné de passer à temps plein. C'est bien sûr à des salariés que l'on connaît que l'on va s'adresser en priorité.
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical et citoyen. Écrivons-le !

Laissez aux gens un peu de liberté ! On essaie aussi de développer la liberté d'entreprendre ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.
Au-delà de l'argument du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques sur la liberté, je vous rappelle, monsieur Brottes, que, dans l'alinéa 5 de l'article 1er, contrairement à ce que vous avez indiqué, il est explicitement précisé que les heures complémentaires sont bien concernées par ce texte.

Ce que nous voulons, c'est qu'elles soient prioritaires par rapport aux heures supplémentaires.
Ne changeons pas de débat, monsieur le secrétaire d'État ! J'ai posé une question sur un point et vous me répondez sur un autre. Nous souhaitons que les salariés à temps partiel imposé soient prioritaires car ce sont eux, qui travaillent parfois simplement pour survivre, qui ont le plus besoin de travailler plus.


L'objet de cet amendement est de protéger légalement le salarié qui refuserait d'exécuter les heures supplémentaires demandées par son employeur.
Contrairement à ce que beaucoup se plaisent à laisser croire à l'opinion publique, les salariés ne sont pas libres de travailler plus ou moins, pas plus que d'être exposés à des produits ou à des situations dangereuses pour leur santé. Ils ne négocient pas d'égal à égal avec leur employeur leur temps de travail, ni leur salaire.
Les thèmes du code du travail, qui enserre, par opposition au contrat, qui libère, ou du salarié qui serait désormais « majeur », sont instrumentalisés pour tenter de convaincre de l'inutilité d'une législation sociale protectrice des droits individuels et collectifs des salariés.
La liberté, omniprésente dans les thèses que vous développez depuis l'ouverture de nos débats, et le rapporteur à l'instant, et qui justifierait toutes les « réformes » de ces cinq dernières années, n'est que pure fiction. Comme Philippe Waquet le rappelait il y a deux ans, lorsque des députés UMP défendaient une proposition de loi déclinant le concept des « heures choisies », « le contrat de travail est la seule convention qui établisse une relation de subordination entre les parties : le salarié doit obéir au patron ».
S'agissant plus précisément des heures supplémentaires, la jurisprudence constante en la matière est que le refus du salarié d'accomplir sans motif valable lesdites heures pour effectuer un travail urgent dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et même, dans certains cas, une faute grave.
Le salarié ne peut refuser de s'exécuter qu'en cas de non-paiement des heures supplémentaires relevant du travail dissimulé. Dans les autres cas, sauf circonstances très exceptionnelles, s'il peut être justifié d'obligations familiales, les juges accepteront de ne pas caractériser le refus en acte d'indiscipline portant atteinte à l'autorité de l'employeur et de considérer le licenciement comme fondé. Telle est la réalité et l'état de la jurisprudence.
Comme vous, nous avons à coeur de sécuriser les relations entre employeurs et employés. Comme vous, nous tenons à ce qu'un salarié volontaire et consentant, dans certaines limites non préjudiciables à sa santé, à l'emploi, puisse effectuer ponctuellement des heures supplémentaires.
Mais, contrairement à ce que vous proposez, nous envisageons de poser les garanties nécessaires à l'existence d'un vrai choix pour le salarié, et non d'un pseudo-choix fait sous contrainte. C'est le sens de notre amendement, qui pose explicitement le principe selon lequel « le refus d'effectuer des heures supplémentaires ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ».
Je suis peut-être un grand naïf, messieurs les rapporteurs, mais il me semble que nous pourrions tomber d'accord sur un amendement de cette nature. Depuis le début de nos débats, vous déployez toute votre force de conviction à affirmer que ce que demandent les salariés, c'est du pouvoir d'achat en plus – sur ce point nous sommes tous d'accord – et de pouvoir travailler plus : nous sommes d'autant plus d'accord que ceux qui travaillent à temps partiel ou en temps fractionné ne demandent que cela, et que l'immense majorité de ceux qui n'ont pas de travail demandent à en avoir.
Apporter une telle garantie aux salariés ne nous semblerait donc nuire en rien à l'objectif que vous dites poursuivre au travers d'un certain nombre de dispositions du texte que nous examinons.

La commission a rejeté cet amendement, qui vise lui aussi à modifier le code du travail.
Votre présentation a été tout à fait équilibrée, monsieur Muzeau, et la réponse à votre question s'y trouve. Le régime actuel est justifié par la nécessité pour l'entreprise de faire face à des « coups de feu », des surcroîts de travail qui rendent nécessaire une mobilisation des salariés. D'où ce principe bien établi : le refus d'effectuer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires prévues au titre du contrat peut être un motif de licenciement.
Mais, comme vous l'avez dit vous-même, la jurisprudence est venue atténuer la rigueur du principe, pour des raisons familiales, médicales, pour toutes sortes de raisons. Et il me semble qu'il y a là, entre l'affirmation du principe, la jurisprudence, et surtout le bon sens de la plupart des employeurs, que M. Taugourdeau a eu raison de rappeler à plusieurs reprises, un équilibre qu'il ne convient pas de rompre.
Vous savez, monsieur Muzeau, que le législateur a laissé la possibilité aux partenaires sociaux de négocier par branche, ou par entreprise, le contingent d'heures supplémentaires, et que cette règle protège le salarié, notamment contre toute demande injustifiée de la part de l'employeur en matière d'heures supplémentaires.
Votre amendement remettrait en cause ce principe, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'y est pas favorable.

Cet amendement va dans le même sens que le précédent ; du moins traite-t-il du même problème.
Notre discussion est étrange : il ne s'agit pas ici de remettre en cause le principe, mais simplement de trouver une règle minimale pour protéger la situation des salariés. On voit bien ce qui se passe : chaque fois que nous proposons des protections minimales pour les salariés, vous nous opposez un refus, au nom du principe de la liberté du chef d'entreprise. Par contre, quand il s'agit d'entraver ou de limiter l'exercice d'un droit des salariés – on le verra dans quelques semaines pour le droit de grève – alors là, il n'y a plus de limite, et il faut absolument inscrire ce type de dispositions dans le code.

Vous ne pouvez pas, quand il s'agit de dispositions protectrices des droits des salariés, refuser systématiquement de les inscrire dans la loi en nous renvoyant à la négociation sociale, et quand il s'agit d'imposer des obligations nouvelles aux salariés, faire fi de cette même négociation sociale pour les inscrire sans attendre dans le code du travail.
Le dispositif proposé par l'amendement n° 271 n'a rien d'extraordinaire : si vous m'écoutiez, monsieur le rapporteur général et messieurs les ministres, vous apprendriez qu'il reprend pour partie une possibilité qui est déjà dans le code du travail pour les heures complémentaires. Il s'agit simplement d'appliquer la même règle aux heures supplémentaires.
Vous avez tout intérêt, et, je pense, les chefs d'entreprise aussi, à ce que, sans remettre en cause le principe de l'obligation pour le salarié – nous sommes d'accord là-dessus – la loi prévoie les cas exceptionnels où le refus du salarié ne constituera pas une faute.
Il n'est pas non plus extraordinaire d'inscrire dans la loi un délai de prévenance, dont on peut d'ailleurs discuter de la durée – il peut être de deux jours au lieu de trois. En tous les cas, il me semble légitime que les salariés, à qui vous voulez imposer des délais de prévenance pour exercer leur droit de grève, puissent eux aussi revendiquer un délai de prévenance si vous devez leur imposer des heures supplémentaires qui vont changer leur emploi du temps. Ils peuvent après tout avoir des engagements, en matière de formation ou de nature familiale, par exemple.
Cette disposition ne ferait donc pas peser sur les entreprises une contrainte au-delà de ce qu'impose le respect des hommes et des femmes qui travaillent : nous souhaitons simplement inscrire dans la loi que ce refus ne constitue pas une faute lorsqu'il est justifié par « des obligations familiales impérieuses » ou « le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ».
Le code du travail prévoit déjà ces limitations s'agissant des heures complémentaires. Il est assez incompréhensible, puisque vous voulez faire des heures supplémentaires la base de votre politique, que vous n'ayez pas prévu un minimum d'encadrement. Voilà pourquoi cet amendement me paraît absolument indispensable.

La commission a rejeté cet amendement pour les raisons que je viens d'évoquer.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, monsieur le président, pour les raisons que je viens d'évoquer.

Je veux dire un mot en faveur des amendements de mes collègues. Ma collègue du parti des Verts, Martine Billard, avait d'ailleurs déposé un amendement dans le même sens.
En effet, on nous parle beaucoup de liberté, du moins quand il s'agit de la liberté d'entreprendre, que M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles invoquait encore à l'instant. On nous a dit que ce système allait permettre aux salariés de travailler plus s'ils le souhaitaient.
On a déjà démontré que certains qui souhaiteraient travailler plus ne le pourraient pas, tout simplement parce qu'on ne leur proposerait pas d'heures supplémentaires. On a là le cas inverse, qu'il faut quand même bien évoquer : celui de la liberté du salarié de ne pas travailler plus s'il ne le souhaite pas. Et ce n'est pas une question d'idéologie.
Je voudrais prendre un cas concret, celui d'un salarié, ou plus probablement d'une salariée – vous savez très bien que cela touchera surtout les femmes – qui accomplit ses 35 heures en quatre jours ou quatre jours et demi, et qui a organisé sa vie en conséquence, notamment pour assurer la garde de ses enfants. Cette personne pourra être obligée d'exécuter des heures supplémentaires, et donc de payer quelqu'un pour garder ses enfants...

…et de subir in fine une baisse de ses revenus, ce qui est le comble s'agissant d'une disposition censée soutenir le pouvoir d'achat. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Vous le savez très bien, ou alors nous ne rencontrons pas les mêmes salariés. J'ai pour ma part rencontré des salariés notamment de la distribution : ils vont gagner moins que ce qu'ils seront obligés de dépenser pour faire garder leurs enfants.

Si je ne suis pas d'accord avec la position soutenue par M. Carrez, du moins je comprends ce qui la fonde. En revanche, je ne peux pas du tout approuver l'explication que vous avez donnée, monsieur le secrétaire d'État. L'accord de branche et l'accord de méthode n'ont rien à voir avec le point en débat : nous sommes là au niveau de l'entreprise, et non de la branche.
Tout le monde est évidemment capable de comprendre qu'en cas de surcroît de travail exceptionnel, même durant un certain temps, le recours aux heures supplémentaires soit la seule manière d'absorber ce surcroît momentané. Mais cela ne se règle pas par les accords de méthode et les accords de branche : nous sommes bien dans le cadre de la relation entre employeurs et salariés, et dans un grand nombre de cas le salarié accepte sans difficulté de faire ces heures supplémentaires, tout simplement parce que, avec le blocage des salaires et la faiblesse du pouvoir d'achat, c'est le seul moyen de « mettre du beurre dans les épinards », comme on dit. Mais elles occasionnent surtout beaucoup de travail et beaucoup de fatigue.
Mais au-delà, monsieur le secrétaire d'État, nous disons qu'un salarié doit pouvoir refuser. Et s'il refuse, il ne le fait pas pour embêter son employeur ; comprenez qu'il refuse parce que cela lui « pourrit » quelquefois la vie ! Il a quand même le droit de dire « stop », parce qu'il ne peut pas en faire plus.

Et ses raisons ne sont pas toujours communicables : cela peut être des raisons personnelles, telles des difficultés conjugales, qu'on n'a pas envie de « chanter sur les toits » ! Quand un salarié refuse sans plus d'explication ou de justification, son employeur doit pouvoir lui faire confiance et ne pas croire qu'il agit ainsi pour entraver l'activité de l'entreprise, mais parce qu'il est aussi un être humain qui a à défendre sa vie personnelle. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
La disposition que nous vous avons proposée et que vous rejetez est une garantie qui, sans peser sur les employeurs, peut en revanche soulager un certain nombre de salariés, qui n'en peuvent plus de ne pas pouvoir refuser.

Sans vouloir remettre en cause le droit d'amendement, monsieur le président, je voudrais dire que ce débat m'étonne un peu.
Il y a encore quelques mois – il s'agissait certes de la législature précédente – tout le monde, la main sur le coeur, prônait le dialogue social, et disait qu'il ne fallait pas modifier le code du travail sans avoir consulté auparavant les partenaires sociaux.

Or que fait-on d'autre depuis tout à l'heure que d'essayer de modifier le code du travail ? Je ne conteste pas les amendements qui touchent à la fiscalité, mais lorsqu'on commence à vouloir introduire dans le code du travail des dispositions qui relèvent à mon avis de l'accord interprofessionnel, cela me gêne davantage. Je voulais donc simplement rappeler ce dont tous les groupes ont convenu il y a encore quelques mois : il serait bien de consulter les partenaires sociaux préalablement à toute modification du code du travail.

Je voudrais ajouter une remarque.
Il y a dix ans, mesdames, messieurs, quand vous avez mis en place la réduction autoritaire du temps de travail, vous avez évidemment provoqué, notamment dans les petites entreprises, une explosion du nombre des heures supplémentaires, du fait de la différence entre 39 heures et 35 heures.

À cette époque pourtant, alors que votre réforme multipliait les heures supplémentaires sans que pour autant elles soient mieux rémunérées, vous n'avez absolument pas envisagé de supprimer du code du travail la possibilité de motiver le licenciement par le refus du salarié de faire des heures supplémentaires.

Nous sommes aujourd'hui dans un contexte radicalement différent, puisque nous cherchons au contraire à améliorer fortement la rémunération de ces heures supplémentaires. La question se pose donc beaucoup moins, puisque les salariés auront un plus grand intérêt à faire des heures supplémentaires. Et vous venez ouvrir ce débat, que vous aviez soigneusement évité il y a dix ans !

Il faudrait faire preuve d'un minimum de cohérence ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Nouveau Centre.)

Ces derniers jours, nous avons entendu répéter comme une antienne, plusieurs fois par jour, que le Président Nicolas Sarkozy faisait ce qu'il disait et tenait ses engagements. À maintes reprises durant la campagne électorale, comme dans ses documents électoraux, il nous a dit : « Je veux que celui qui veut travailler plus puisse le faire. » Or cette volonté est contredite par la loi, qui ne laisse rien à la liberté du travailleur. Celui-ci, en effet, ne peut choisir ni de ne pas faire d'heures supplémentaires, ni d'en faire. Il y a là un véritable problème de principe, de morale, évoqué à maintes reprises de l'autre côté de l'hémicycle. Ce seul point devrait convaincre de voter notre amendement. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

Je suis saisi d'un amendement n° 143 .
La parole est à M. Roland Muzeau, pour le soutenir.

L'amendement n° 143 vise à supprimer l'article L. 212-6-1 du code du travail, qui a introduit dans notre législation sociale le concept des heures choisies – concept singulier qui laisse croire lui aussi qu'il existerait un nouveau monde où les rapports au sein de l'entreprise, entre l'employeur et ses salariés, seraient de parfaite égalité, offrant à ces derniers la possibilité de négocier l'aménagement et l'organisation de leur temps de travail. Nous le redisons : cette liberté n'est qu'une fiction juridique créée par la loi de mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, texte initié par les députés UMP Patrick Ollier, Hervé Novelli et Pierre Morange.
Ces heures choisies présentent pour les employeurs le fabuleux avantage d'échapper au régime de droit commun applicable aux heures supplémentaires. Ce sont des heures travaillées au-delà du contingent d'heures supplémentaires, élargi de 130 à 180 heures grâce à M. Fillon, contournant les deux autres obstacles que sont l'autorisation de l'inspecteur du travail et le droit à un repos compensateur obligatoire – autant de garanties qui étaient de nature à protéger la santé des salariés, mais aussi à privilégier l'embauche de nouveaux salariés ou le passage à temps complet de ceux qui sont à temps partiel.
Vous objecterez – comme vous l'avez fait tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'État, en vous trompant de sujet – que ces heures ne peuvent être imposées, la loi prévoyant qu'elles sont subordonnées à l'existence d'un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, et à un accord entre l'employeur et le salarié.
Le MEDEF, vous le savez bien, rêvait de cette individualisation des relations de travail, de discussions aussi décentralisées que possible, quasiment de gré à gré, entre l'employeur et le salarié. Il s'est montré très satisfait des innovations et assouplissements permis par le texte de 2005. Il se félicite aujourd'hui encore que l'on aille « à la vitesse de l'entreprise », avec des heures supplémentaires et complémentaires quasiment gratuites pour les patrons, donnant lieu à une majoration de 10 % à 25 % et ouvrant droit, surtout, à d'avantageuses exonérations de cotisations patronales.
Demain, toujours au nom de l'emploi, du travail et du pouvoir d'achat, vous défendrez avec ardeur la liquidation du SMIC, la fin de la durée légale fixée par la loi, et quoi d'autre encore ? On n'arrête pas le progrès ! Modernité, direz-vous ?
Je conclurai en citant ceux un professeur d'économie, M. Olivier Favereau, qui notait en 2005 – mais son propos n'a pas pris une ride – que « regardés de près, ces deux slogans, “Travailler plus pour gagner plus” et “Rétablir la liberté de choix”, sous couvert de modernité et de flexibilité, traduisent une vision de l'économie et de l'entreprise qui fleure bon le xixe siècle ».

La commission a rejeté cet amendement.
Autant, monsieur Muzeau, nous pouvions partager certains points de vue dans l'exposé des motifs d'autres amendements que vous avez présentés, autant notre désaccord est ici total. La notion d'heures choisies introduites par la loi de 2005 est, contrairement à ce que vous affirmez, un progrès pour le salarié.
Vous êtes en pleine incohérence avec vos collègues. Voilà un instant, on se plaignait de ce que le refus de faire des heures supplémentaires puisse être un motif de licenciement. Or, comme son nom l'indique, la catégorie des heures choisies permet précisément au salarié de choisir, éventuellement, de ne pas faire ces heures sans pour autant courir le risque d'un licenciement. Le motif de licenciement est, je le répète, exclu au titre des heures choisies.
En outre, ces heures choisies que nous incluons dans l'article 1er, totalement libres du point de vue du salarié, entrent également dans le champ de l'exonération. Il s'agit donc, monsieur Muzeau, d'un véritable progrès et j'aimerais vous en convaincre.
Comme M. le rapporteur général, je tiens à souligner cette étonnante contradiction : il y a quelques instants, vous insistiez sur le fait que le salarié devait avoir le choix et vous voudriez maintenant, en quelque sorte, remettre en cause le fait qu'il ait le choix d'effectuer des heures choisies en dehors du contingent des heures supplémentaires. La disposition du 31 mars 2005 est une disposition de choix importante et le Gouvernement ne juge pas opportun de la remettre en cause.

Monsieur Muzeau, depuis une heure que je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre que tous les patrons sont esclavagistes. Je souhaiterais donc vous rappeler quelques éléments d'information. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen.)
Votre discours surprend un peu le jeune chef d'entreprise que je suis.
Permettez-moi donc de vous rappeler, puisque vous semblez ne connaître que le CAC 40, que les PME et TPE représentent 1,6 million d'entreprises en France. Surtout, les PME sont des entreprises patrimoniales, où les relations humaines, fondées sur la proximité entre le chef d'entreprise et les salariés, font converger les intérêts réciproques autour d'un même projet, ce qui est aux antipodes de la seule logique financière. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Il importe aussi de rappeler que le renforcement de la cohésion sociale et la préservation de la vitalité économique de nos régions consistent aussi à organiser le marché du travail en prenant en compte la réalité économique actuelle et l'exigence d'une compétitivité accrue du fait de la globalisation. Accepter de faire évoluer certaines règles, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, reconnaître que la flexibilité peut davantage rimer avec emploi qu'avec précarité, sont certainement quelques-unes des voies à explorer, sans dogmatisme, dans un esprit de dialogue et d'ouverture. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Par souci de pédagogie, monsieur Muzeau, je me permets de rappeler que la loi de 2005 que vous avez évoquée et dont j'ai été le rapporteur et l'un des cosignataires, loi dont la gauche et les syndicats, qui partageaient votre analyse, avaient dit pis que pendre au nom d'une vision quelque peu passéiste héritée du xixe siècle – pour vous retourner les termes de l'économiste que vous avez cité –, six mois après sa publication au Journal officiel, a bénéficié à près de deux millions de salariés avec la signature des syndicats mêmes qui la contestaient.

L'utilité de nos débats est peut-être aussi que nous nous écoutions.
Je soulignais que cette loi présentée par MM. Morange, Novelli et Ollier, qui instituait les heures choisies, présentait un fabuleux avantage pour les employeurs, en ce que ces heures échappent au régime de droit commun applicable aux heures supplémentaires. Voilà le dispositif en vigueur aujourd'hui. Il faut donc m'écouter quand je vous dis de telles choses.
Il s'agit d'heures travaillées au-delà du contingent d'heures supplémentaires…

Oui, mais vous me répondez à côté !
Il s'agit donc d'heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires, et qui…

C'est pédagogique, cher collègue ! (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Voulez-vous que je vous donne mon sentiment sur les répétitions que nous avons entendues à la télévision tous les jours pendant un an et demi de campagne électorale du candidat Sarkozy ? Heureusement qu'on avait l'estomac solide !
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Les Français ont voté !

Qui plus est, vous reprenez mot pour mot ce qu'il a dit pendant un an et demi.

C'est un peu fatigant ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Nous tenons nos promesses !

C'est d'ailleurs là toute la pureté de votre texte, madame la ministre !

Ne craignez rien, monsieur le président ! (Sourires.) Mais je vois bien qu'ils ont besoin d'être un peu chatouillés. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Monsieur Morange, ce texte dont vous étiez un fervent défenseur – et je vous en reconnais le mérite – avait aussi l'avantage de contourner l'inspection du travail et le droit à un repos compensateur obligatoire. Ce sont des avantages non négligeables pour les entrepreneurs, ou du moins pour ceux qui souhaitent établir une relation de gré à gré qui, je le répète, nous rappelle le xixe siècle.

Je suis saisi d'un amendement n° 336 .
La parole est à M. Pierre Méhaignerie, pour le soutenir.

Tout texte législatif doit être précédé d'une étude d'impact. Cette étude d'impact a été collective : ce fut le débat de l'élection à la Présidence de la République. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen.)
J'ai toutefois voulu faire moi-même une étude d'impact sur un bassin d'emploi industriel. J'ai d'abord constaté que les attentes des salariés liées à la défiscalisation des heures supplémentaires sont très fortes. Ils attendent en effet de voir progresser le salaire direct.
Comme l'observait le rapport du CERC élaboré sous la présidence de Jacques Delors, au cours des dernières années le salaire indirect a beaucoup plus progressé en France que le salaire direct. Je rappelle à ceux qui agressent souvent les entreprises qu'à l'échelle européenne notre pays se situe actuellement au deuxième ou au troisième rang pour ce qui est du coût horaire du travail. Pour ce qui est, en revanche, du salaire direct, il se place au dixième ou onzième rang sur quinze pays européens, en raison du poids des charges sociales pesant sur le travail.
Face à cette forte attente de pouvoir d'achat, diverses réponses ont été formulées. D'abord, bien sûr, celle de la croissance, vers laquelle convergent aujourd'hui tous les projets. La prime pour l'emploi fut une autre réponse. Je rappelle à tous ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas eu de coup de pouce en faveur du SMIC qu'il y en a eu un en faveur des bas salaires par l'intermédiaire de la prime pour l'emploi en 2007. Pour un salarié au SMIC, en effet, la seule augmentation de la prime pour l'emploi représente une progression de près de 2,5 % de pouvoir d'achat. Pour l'avenir, la prime pour l'emploi reste un élément permettant de concilier la compétitivité des entreprises et la revalorisation du salaire.
Une autre amélioration du pouvoir d'achat repose sur la maîtrise des impôts locaux. Il y a, dans ce domaine, des efforts à faire.
Une autre voie encore est celle de la compétitivité des secteurs qui font payer cher leurs services aux autres. J'espère que les réflexions du rapport Rueff-Armand permettront de remettre en question les rentes de situation de secteurs, publics ou privés, qui sont dans ce cas.
Restent les heures supplémentaires, qui sont une idée très importante et très attendue. Il ne faudrait pas, cependant, que les secteurs qui ont fait ces dernières années le plus d'efforts de productivité et qui sont soumis à une forte contrainte internationale du fait des exigences de la compétitivité soient privés de cette possibilité.
Nous avons évoqué hier la situation des salariés du transport et des réponses ont été proposées. Il nous faut résoudre le problème difficile de tous les salariés du secteur industriel qui, souvent, pour faire face aux 35 heures, sont passés aux deux-huit ou aux trois-huit : quelle est, pour ces salariés, la marge de bénéfice des heures supplémentaires ?
Il y a, enfin, les accords de modulation. Dans de nombreuses branches, cependant, on ne peut choisir entre le repos compensateur et le paiement des heures supplémentaires, l'accord de branche ayant imposé le repos compensateur.
L'amendement que je propose, madame la ministre, vise à donner le choix aux salariés. Certes, ils ont déjà ce choix, par l'intermédiaire des accords d'entreprise, mais ces accords empêchent parfois de déroger à certaines dispositions. Que peut-on faire à cet égard ?
Par ailleurs, même lorsqu'il existe des accords d'entreprise, que se passerait-il dès lors que les délégués syndicaux s'opposeraient à ce qu'il soit donné priorité aux heures supplémentaires par rapport à la modulation et au repos compensateur ?
C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, vous avez décrit hier ce texte comme un texte de liberté.
Pourquoi dans certains cas ne pas donner aux salariés eux-mêmes la possibilité de choisir ? Je propose de mettre en application un référendum d'entreprise permettant réellement aux salariés de s'exprimer et de choisir directement entre le repos compensateur et le paiement des heures supplémentaires.

La commission des finances a accepté l'amendement de Pierre Méhaignerie parce qu'elle était confrontée à une question fondamentale à laquelle il convenait absolument de répondre. Du fait de la réduction autoritaire du temps de travail par la loi sur les 35 heures, les entreprises ont dû s'organiser, et des accords de modulation ont été signés dans beaucoup de branches. Ces accords ont consisté à permettre des variations sur l'année dans le cycle de travail en autorisant à travailler davantage certaines semaines – par exemple 40 ou 42 heures – et, en contrepartie, à réduire au titre du repos compensateur les autres semaines – par exemple 30 ou 32 heures seulement –, pour que sur l'ensemble de l'année on reste dans les limites de l'enveloppe de 1 607 heures. Ces accords de modulation, pour beaucoup d'entre eux, ont eu comme conséquence de supprimer en fait les heures supplémentaires.
Le problème soulevé parM. Pierre Méhaignerie est très important : en raison de l'intérêt nouveau que va présenter le paiement des heures supplémentaires – puisqu'elles seront exonérées de charges sociales et d'impôt sur le revenu –, il y aurait intérêt à ce que ces accords de modulation puissent être revus pour les monétiser, pour transformer le repos compensateur en heures supplémentaires ; à condition bien entendu que la charge de travail de l'entreprise, liée à son carnet de commandes, le permette.
La commission des finances s'est toutefois demandée s'il fallait obligatoirement passer par une modification des accords de branche. L'amendement de notre collègue Pierre Méhaignerie affirme que oui, mais les accords de branche sont lourds à modifier, la procédure est longue, et il serait intéressant de pouvoir traiter cette question non pas au niveau de la branche mais de l'entreprise.
Madame la ministre, nous avons donc besoin d'une réponse claire sur ce point : est-il possible de transformer ces repos compensateurs en heures supplémentaires dans le cadre d'accords de modulation de branche qui renvoient à une négociation d'entreprise ? Si c'est possible au niveau de l'entreprise, je pense qu'il serait plus sage de ne pas interférer par la loi, parce que ce sera tout de même beaucoup plus facile et plus rapide de parvenir ainsi à des accords.
Monsieur le rapporteur général, monsieur Méhaignerie, après m'en être assurée auprès de mes services, je vous confirme que tous les accords de branche comportent une disposition permettant – pour la plupart dans le cadre de l'entreprise et, pour certains d'entre eux, dans le cadre du contrat individuel de travail – de recourir soit au repos compensateur soit à la rémunération des heures supplémentaires. Il n'est donc pas nécessaire d'en passer par une renégociation des accords de branche pour permettre tant aux salariés qu'aux entreprises de tirer parti des dispositions de l'article 1er qui a été voté hier.
J'ajoute à titre de précision que le recours au référendum existe déjà, notamment dans le domaine de la mise en place des contrats d'intéressement au sein des entreprises. Il s'agit d'une voie intéressante qu'il faudra explorer dans des textes de travail, et qui nécessite bien sûr une négociation avec les organisations syndicales représentatives comme cela a été convenu dans la loi de janvier 2006.

Mais, madame la ministre, que se passera-t-il, dans les nombreux mois qui viennent, quand les accords de branche ne permettent pas la dérogation dont vous venez de parler ?

et M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Mais si, ils permettent cette dérogation !

Ces accords ne permettent pas toujours la dérogation permettant de choisir entre le repos compensateur et les heures supplémentaires. Et même au niveau d'un accord d'entreprise, s'il y a un refus des délégués syndicaux, que se passera-t-il ?
Je pense donc que le système le plus démocratique, c'est le référendum d'entreprise.

Pourquoi ne pas expérimenter ce référendum, compte tenu de ce formidable besoin d'amélioration du pouvoir d'achat, laquelle passe par les heures supplémentaires ? Madame la ministre, j'aimerais que nous puissions faire un bilan en fin d'année parce que je crains des frustrations chez les salariés qui auront espéré dans ce texte de loi et qui verront leurs espoirs déçus. Nous aurons besoin d'effectuer le bilan le plus vite possible pour répondre à leurs attentes.
Monsieur Méhaignerie, je n'ai peut-être pas été suffisamment clair, mais je viens de le revérifier : tous les accords de branche en vigueur aujourd'hui prévoient la faculté d'opter, dans le cadre d'une renégociation, pour la rémunération des heures supplémentaires plutôt qu'en faveur du repos compensateur. En outre, je retiens tout à fait votre idée de faire à la fin de l'année une évaluation des possibilités ainsi ouvertes aux entreprises en application des accords de branche. Au bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre amendement.

La nuit dernière, nous avons adopté à l'unanimité un amendement préparé par nos collègues socialistes qui prévoit un bilan d'évaluation annuel, par entreprise, de l'utilisation de ce dispositif relatif aux heures supplémentaires. Ce bilan sera soumis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ce faisant, mon cher collègue, nous couvrons parfaitement le champ de votre préoccupation.

Je ne voudrais pas que ce soient, une fois de plus, les ouvriers qui fassent les frais d'un texte par trop rigide.

C'est pourquoi je souhaite, madame la ministre, non seulement un bilan établi à partir des accords de modulation, mais aussi un bilan concernant tous les salariés qui travaillent en 2×8 ou en 3×8 afin de savoir ce que nous leur apportons.
Moyennant les réserves que je viens d'exprimer, et compte tenu de votre position favorable au bilan de fin d'année, pour être conciliant, je retire mon amendement.


Notre collègueFrançois de Rugy a évoqué tout à l'heure les difficultés de gardes d'enfant qu'éprouvent certains de ceux qui font des heures supplémentaires, mais, moi, j'évoquerai la situation inverse : nous avons des salariés qui gagnent 300 euros de plus par mois parce qu'ils travaillent le dimanche dans le cadre d'accords avec les partenaires sociaux et qui, si demain ils ne le peuvent plus, auront eux, par contre, des problèmes de garde d'enfants parce qu'ils travailleront les jours ordinaires alors qu'aujourd'hui ils s'entendent avec leur conjoint pour garder les enfants l'un après l'autre et sept jours sur sept.
Madame la ministre, j'ai noté que dans la feuille de route que le Président de la République vous a adressée, il fait référence à l'ouverture dominicale et que, ce matin, sur France Info, il a déclaré : « Je veux que ceux qui veulent travailler le dimanche puissent le faire rapidement, sur la base du volontariat. » Quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses ; mais il faut trouver la solution. Et celle-ci, mes chers collègues, ne peut être que législative parce que le code du travail…

…permet certaines dérogations – il y en a 156 –, mais tous les magasins ne peuvent pas ouvrir ce jour-là.
J'ai l'outrecuidance de vous proposer une solution. Elle est basée sur un constat : la question de l'ouverture dominicale ne se pose en fait que dans les zones agglomérées. Des sondages et des études d'opinion ont en effet établi qu'il y a là une demande de la part de plus de 65 % des habitants – 75 % en Île-de-France. Ailleurs, la mesure ne présente guère d'intérêt, ne serait-ce que parce que les commerçants qui ouvrent le dimanche tiennent eux-mêmes leur magasin. Ils n'ont pas besoin de dérogation. Nous sommes tout de même dans une société de liberté, c'est donc la moindre des choses qu'on puisse faire ce qu'on veut dans le cadre de sa propriété. Certes, très souvent, ils ont des salariés, mais ils ne demandent pas une dérogation au préfet, les choses se font de manière très familiale et très conviviale. Je crois aussi que ça n'intéresse pas la grande distribution. (Exclamations sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

En tout cas, je suis opposé à ce que la grande distribution ouvre le dimanche.
Dans le cadre d'une dérogation, il faudrait une consultation des élus locaux et des chambres de commerce et d'industrie intéressés. Une telle dérogation ne peut se faire que s'il y a volontariat de la part du salarié et accord entre les partenaires sociaux. Cet accord, préalable à la dérogation, doit prévoir un repos compensateur et une contrepartie financière. J'ai fait état de salariés qui gagnent 300 euros de plus tous les mois grâce au travail le dimanche, mais je connais aussi des zones où l'employeur oblige à travailler le dimanche sans contrepartie financière, et même bien souvent sans repos compensateur.
J'ajoute qu'il faudrait, à l'issue de la dérogation accordée pour une période de cinq années, une évaluation économique et en termes d'avantages pour les salariés.
Je conclurai en disant qu'il y a urgence. Nous voulons défendre le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, mais, pour cela, il faut que cesse une situation où les arrêtés préfectoraux sont attaqués et cassés et où l'on va même devant le juge civil pour réclamer amendes et dommages-intérêts. Une vingtaine de zones sont concernées par l'ouverture dominicale …

…– dont Plan-de-Campagne, dans ma circonscription, comme vous le savez, madame la ministre, et Vélizy-Villacoublay, dans celle de Valérie Pecresse.
Madame la ministre, je souhaite vous entendre là-dessus.

La commission a discuté de cet amendement, mais il a été retiré ensuite par son auteur.
J'ose espérer que ce premier retrait était un prélude, car c'est bien sûr la conclusion à laquelle je voudrais vous amener, monsieur Mallié. C'est une question évidemment extrêmement importante, surtout dans le contexte de ce que notre gouvernement souhaite mettre en oeuvre : le plein emploi, la croissance, l'augmentation du pouvoir d'achat. Telles sont les trois grandes missions que vous êtes en train d'examiner et de détailler sous la forme de « Douze travaux d'été ».
Et je dis « Douze travaux d'été » parce que, clairement, il y a urgence à mettre en oeuvre toutes ces mesures.
Pour autant, l'ouverture dominicale obéit aujourd'hui à un certain nombre de règles qui sont soumises à l'appréciation des tribunaux quand elles ne sont pas respectées. Donc, en vertu de l'indépendance des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif, il ne m'appartient évidemment pas de me prononcer sur l'application de la règle actuelle dans tel ou tel cas, à Plan-de-Campagne, à Vélizy ou ailleurs.
En outre, c'est une question qui est actuellement en débat au Conseil économique et social. M. Bailly a été saisi de cette affaire et entend poursuivre les négociations. Au sein de mon ministère et avec l'aide de Luc Chatel, secrétaire d'État à la consommation et au tourisme, un processus de consultation a déjà commencé avec les organisations de consommateurs bien sûr, mais aussi des représentants de la grande distribution, des petits détaillants et de toute la distribution, sous toutes ses facettes. Ces concertations seront très utiles ; les conclusions qui en seront tirées nous aideront à mettre en oeuvre des dispositions. Sans oublier que la commission « Séguin-Séguin » – si on veut l'appeler ainsi – sera peut-être amenée à examiner dans quelle mesure la fermeture le dimanche dans tel ou tel type d'agglomération, dans telle ou telle type de zone de chalandise, constitue ou non un frein à la croissance et à la consommation.
Ce sont tous ces efforts qui convergent vers un mouvement certainement de nature législative dont nous espérons qu'il pourra être mis en oeuvre très vite, parce que nous savons qu'il y a urgence. Mais je vous demanderai, sous ces réserves-là, de bien vouloir retirer votre amendement.

C'est un sujet sensible et je n'imagine pas qu'il soit traité comme ça, par un amendement rédigé – quand même un peu, monsieur Mallié – à la sauvette pour traiter un problème local. On ne va pas en faire une généralité.
Il existe quelques situations de ce type. Mais, de toute façon, madame la ministre, vous avez reçu une lettre de mission du Président de la République qui vous donne mandat pour, au fond, libéraliser l'ouverture du dimanche. C'est très clair : on ouvre les magasins quand on veut et où l'on veut. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) C'est à peu près ce que le Président de la République vous a demandé de faire C'est d'ailleurs conforme à ce qu'il a dit pendant la campagne électorale : si l'on veut travailler le dimanche, on doit pouvoir travailler le dimanche ! Remarquez : si l'on ouvrait les magasins à minuit, il y aurait quand même toujours du monde dedans !
Je pense que ce sujet n'est pas mineur. Il faut le traiter, en tout état de cause, avec un préalable : la négociation entre les partenaires sociaux. Rien n'est possible autrement. Cette question n'est pas seulement économique, mais profondément sociale.
Elle peut se poser dans un certain nombre de cas. D'ailleurs, il existe des dérogations. Les maires peuvent donner des autorisations cinq dimanches par an. Moi, j'ai été confronté à cette demande en tant que maire. J'ai répondu : il y a un préalable. Si l'on peut se mettre d'accord sur un ou deux dimanches, au moment des fêtes par exemple, il y a un préalable : l'accord entre les partenaires sociaux. Sans accord, je ne m'engage pas à donner un avis favorable. Il n'y a pas eu de négociations, donc pas d'accord non plus. Alors, j'ai donné un avis défavorable.
Et je peux vous dire que j'ai eu l'appui, sur cette position, non seulement des salariés – qui, à une large majorité, exigeaient des contreparties et des négociations –, mais aussi du petit commerce. (« Bien sûr ! » sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
Vous dites que vous voulez faire une différence entre la grande distribution, qui ne serait pas intéressée par l'ouverture du dimanche, et le petit commerce. Je ne vois pas comment vous pourriez autoriser tel type de magasin à ouvrir et obliger tel autre à rester fermer dans la même ville ou la même agglomération. Cela ne tient pas !
Mais les petits commerces ont d'énormes problèmes à ouvrir le dimanche, contrairement à ce que vous dites. Si vous les laissiez ouvrir tous les dimanches, ils seraient incapables de faire face. Familialement, comme vous le disiez, mais même aussi avec des salariés. Dans ce dernier cas, leurs charges augmenteront considérablement et, au bout du compte, le bénéfice ne sera pas évident.
C'est un problème qui mérite beaucoup mieux que des injonctions simplistes comme celles que vous avez reçues, madame la ministre.
De plus, il ne faut pas oublier que les consommateurs sont aussi parfois salariés de ces magasins, ou salariés d'autres entreprises ou d'administrations. Ils exigent du temps libre pour eux-mêmes et leur vie de famille et estiment que cela doit aussi être accordé aux salariés de la distribution.
Et quand même, il existe un certain mode de vie, une manière d'être en Europe. On n'est pas obligé de se conformer automatiquement au modèle anglo-saxon qui n'impose pas de règles en la matière – on fait ce qu'on veut – sous prétexte que ça va stimuler la croissance.

À mon avis, il faut penser aux conditions de vie et de travail. D'ailleurs, j'ai entendu M. Méhaignerie parler d'étude d'impact sur un autre sujet, tout à l'heure. Il a dit une chose qui m'a amusé : l'étude d'impact sur les heures supplémentaires aurait été faite pendant la campagne électorale. Je pense que c'était une forme d'ironie, d'autodérision ou de dérision à l'égard de ceux qui avaient évoqué ce type d'évaluation.

Je pense qu'il faut des études d'impact sur tout. Or, sur les heures supplémentaires, il n'y en a pas eu – c'est une évidence. C'est pour cela que le texte est très difficile, très complexe, et que son application ne va pas être simple pour beaucoup d'entreprises et de salariés. Nous le voyons poindre dans ces débats. Mais, concernant la question de l'ouverture le dimanche, même mesurée, elle nécessite de toute façon une étude d'impact.
Madame la ministre, cette étude d'impact ne peut pas simplement faire l'objet d'une concertation ! Maintenant, c'est le mot à la mode : « concertation ». Et puis après, c'est : « Je décide et vous exécutez. » Non ! De toute façon, sur cette question, on ne pourra rien faire sans le préalable qui, selon moi, est vital si l'on veut que notre société fonctionne bien : c'est la négociation entre les partenaires sociaux. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

Madame la ministre, je vous avais interpellée, hier soir, à la suite d'une dépêche qui dévoilait la lettre de mission très précise que le président Nicolas Sarkozy vous avait adressée justement au sujet de l'ouverture des magasins le dimanche. Il y avait même une injonction : que ce soit réglé cet été ! D'ailleurs, vous avez repris un peu cette injonction en disant : « Il faut absolument que l'on règle cette question vite, le plus vite possible. »
Il y a quand même un vrai problème : celui du respect du code du travail. Depuis des années et des années, de très nombreux cas, en France, montrent que les préfets n'appliquent pas la loi. C'est tout de même assez fort !
Des entreprises de la grande distribution grignotent, peu à peu, au-delà des cinq dimanches qui peuvent être autorisés. Quand les soldes commencent, vous avez des magasins qui les démarrent à minuit une ! Pour être dans la journée ! C'est complètement débile tout ça ! Sur les Champs-Élysées, vous avez Virgin, qui, quand il lance un produit, une Game Boy ou je ne sais trop quel jeu vidéo, ouvre son magasin à minuit une. Les grandes chaînes alimentaires – Carrefour, Auchan et j'en passe – multiplient les demandes de dérogations auprès des préfets et des élus locaux au seul motif qu'il faut vendre pour la rentrée scolaire, et la fois suivante qu'il faut vendre je ne sais trop quoi. Bref, petit à petit, on aboutit à une désorganisation totale, à une mise en danger de la santé des salariés et à leur surexploitation.
Dans ces métiers-là, ces entreprises-là, les salaires sont tellement des salaires de misère ! Alors, oui, les salariés veulent peut-être gagner 300 euros de plus. Ce sont souvent beaucoup de jeunes qui travaillent dans ces entreprises. Bien sûr qu'ils veulent gagner 300 euros de plus. Quel choix ont-ils ? D'être payés un salaire de misère ou de rajouter un peu d'argent à la fin du mois ? Le choix n'existe pas en la matière.
Si l'exigence d'une règle nationale est incontournable, nous avons un exemple : en Alsace, il n'y a rien d'ouvert le dimanche. Ils n'en sont pas morts, les Alsaciens ! D'ailleurs, c'est la seule région que vous avez conservée. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

C'est tout dire ! C'est massivement accepté. Ce qui est possible en Alsace l'est partout. Et les problématiques ou les menaces sur la perte de pouvoir d'achat entraînant des licenciements, c'est du bidon ! Si toutes ces grandes surfaces étaient fermées le dimanche, le marché se reporterait sur les six autres jours. Ne racontons pas d'histoires !
Ce qui pose aujourd'hui problème, c'est vrai, ce sont ces atteintes à la concurrence parce que certains sont ouverts et d'autres fermés. Ça c'est un vrai problème ! Et on ne le résoudra pas en permettant à tous d'ouvrir, mais, bien au contraire, en les obligeant tous à fermer. (« Bravo ! » sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

M. Mallié, qui avait eu la sagesse de retirer son amendement en commission, le remet maintenant en débat. Sans doute a-t-il anticipé, en fait, les désirs du Président de la République. En effet, on a appris hier soir que, si vous faites une version encore un peu encadrée de l'ouverture des magasins le dimanche, le Président de la République, lui, veut généraliser cette ouverture de tous les magasins le dimanche.
Je voudrais répondre point par point à plusieurs arguments que vous avancez. Sur le fond, j'ai lu dans la presse que l'élection présidentielle a marqué une rupture, un changement. Jusqu'à présent, la droite accusait souvent la gauche d'être excessivement matérialiste. On voit qu'aujourd'hui vous allez, mesure après mesure, sans doute liquider les dernières digues qui subsistaient en la matière. C'est bien dommage qu'on aille dans cette voie-là.
Je voudrais faire une première remarque sur la question des zones agglomérées. Je ne vois pas pourquoi vous voulez introduire cette notion. Pourquoi y aurait-il une différence à faire ? Vous introduiriez une distorsion de concurrence – il n'y a pas d'autre qualification – entre les zones urbaines et les zones rurales.
Deuxième remarque : vous dites que les amendes sont très faibles en cas de non-respect de la loi. Mais peut-être pourrions-nous proposer un amendement pour que ces pénalités soient renforcées et pour que la loi soit bien appliquée ?
Cela m'amène à relever, dans votre exposé des motifs, une phrase un peu choquante : « Il est temps de favoriser le retour à un État de droit. » Si je comprends bien, il faut donc que les pratiques des zones de non-droit, de tous ceux qui se mettent hors la loi, soient légalisées. Nous mettons là le doigt dans un engrenage qui me paraît particulièrement dangereux. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, car ce serait un bel encouragement pour tous ceux qui se mettent hors la loi. On leur dit : « Ce n'est pas grave, on légalisera ensuite ! »
Autre argument que vous avancez : la vente par Internet. On a beaucoup entendu ça pour justifier le commerce le dimanche. Mais la vente par Internet, ce n'est jamais qu'une nouvelle version de la vente par correspondance, qui a toujours existé. La différence entre les achats par Internet et ceux effectués dans les commerces ouverts le dimanche, c'est que celui qui achète par Internet n'oblige personne à être présent dans un magasin. Les demandes sont traitées le lundi et le reste de la semaine. Il n'y a aucun problème de travail le dimanche en l'occurrence.
Dernier point concernant le chiffre d'affaires : vous nous faites valoir que les commerces réalisent ce jour-là un chiffre d'affaires qu'ils ne font pas les autres jours. M. Ayrault en a parlé tout à l'heure pour la ville de Nantes et l'agglomération nantaise. Étant moi-même élu nantais, je peux témoigner que, lorsque nous avons eu le débat, des directeurs de grandes surfaces commerciales nous ont expliqué qu'ils ne faisaient aucun chiffre d'affaires supplémentaire s'ils globalisaient les ventes sur l'année. Tout simplement parce que le pouvoir d'achat des consommateurs reste le même, quoi que vous fassiez. Simplement, ces directeurs nous ont dit : « Si d'autres ouvrent, nous allons être obligés de le faire, parce que, sinon, nous serions soumis à une concurrence déloyale. »
Donc, nous restons attachés au maintien du repos dominical, non pas pour des raisons religieuses – qui regardent chacun –, mais parce qu'il nous paraît nécessaire de conserver un moment pour que les familles et les amis puissent se retrouver. Vous savez très bien que, si l'on commence à généraliser le travail le dimanche, notamment dans les commerces, cette possibilité n'existera plus. Alors, qu'il y ait quelques autorisations par an, pourquoi pas ? Mais aller au-delà serait très dangereux.
Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Franchement, je vous le dis : il ne faudra pas se plaindre que des enfants restent livrés à eux-mêmes des journées entières, des samedis et des dimanches, si vous obligez – car ce sera ça – leurs parents à travailler le dimanche.

Si nos collègues socialistes étaient animés par un « désir d'avenir », je n'entendais pas spécialement, avec cet amendement, exaucer les voeux du Président de la République.

Cela fait en effet quatre ans que je travaille à cette question que Nicolas Sarkozy, m'ayant écouté, a repris dans son programme. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

Je travaille donc sur cette question depuis plus longtemps que vous, monsieur de Rugy.
J'aimerais également répondre à M. Ayrault qu'il ne s'agit pas d'un problème seulement local. Vous ne m'avez pas écouté jusqu'au bout ! Il est vrai que la question se pose dans ma circonscription, mais une vingtaine de zones françaises sont concernées, parmi lesquelles, par exemple, Vélizy-Villacoublay. Certes, certaines d'entre elles sont aujourd'hui dans une situation de « non-droit ». Mais pourquoi la CGT et la CFDT contestent-elles, dans les Bouches-du-Rhône, les arrêtés des préfets ? Sur les 6 000 employés de Plan-de-Campagne, seuls une quinzaine sont à la CGT, et ce sont ceux-là qui empêchent les autres de travailler.

Quand vous affirmez que ce syndicat est là pour défendre les salariés, permettez-moi d'avoir des doutes !
Il faut vivre avec sont temps. Nous sommes au XXIe siècle, et plus au XIXe.

Nous ne sommes plus à l'époque des diligences mais au temps du commerce en ligne, ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an. Étant moi-même fils de petits commerçants, tombé dans le pétrin dès le plus jeune âge – puisque mes parents avaient un commerce d'alimentation –,…

…je puis témoigner que le commerce oblige à s'aligner sur la concurrence et à se mettre au service des clients : l'homme au service de l'homme. Internet le permet vingt-quatre heures sur vingt-quatre, fort bien ! C'est plus facile, les gens iront y faire leur marché pour équiper leur maison, les commerçants traditionnels n'auront plus de clients et leur chiffre d'affaires s'effondrera !

Si vous aviez lu l'amendement n° 182 jusqu'au bout, monsieur Ayrault, vous auriez constaté que le dispositif proposé est conçu sur la base du volontariat des salariés et d'un accord avec les partenaires sociaux.

Ce dispositif est déjà mis en place dans deux zones, mais nous ne disposons aujourd'hui d'aucun moyen légal pour le généraliser, puisque le code du travail interdit l'ouverture dominicale à des magasins spécialisés, par exemple, dans l'équipement de la maison.
Vous parlez, monsieur Ayrault, d'une étude d'impact. Mais, dans ma circonscription, celle-ci est faite en conditions réelles depuis quarante ans, puisque cela fait quarante ans que la zone commerciale de Plan-de-Campagne est ouverte le dimanche ! Elle est en revanche fermée le lundi et le mardi matin. Bref, depuis quarante ans, nous connaissons l'évolution des chiffres d'affaires, et nous savons que celui du dimanche représente de 30 à 40 % du chiffre des magasins : voilà une véritable étude d'impact, fondée sur la réalité.
Cela dit, vous comprenez bien, madame la ministre, que vos propos ne me satisfassent guère dans la mesure où il y a urgence : dans certaines zones, je le répète, bien qu'un accord entre les partenaires sociaux existe déjà et que les salariés soient volontaires, le code du travail ne permet pas la mise en place du dispositif. J'ai néanmoins bien noté que vous en étudiiez la possibilité, comme le préconise votre lettre de mission.
Je me tiens donc à votre disposition sur ce point et, compte tenu de vos explications, je retire mon amendement.

Ce rappel au règlement a trait au déroulement de nos travaux et à leur contexte.
Certains de nos collègues ont évoqué la lettre de mission du Président de la République à Mme Lagarde. Nous avons un Président putschiste qui se mêle de tout ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Les mots ont un sens : il n'est du pouvoir de personne, même à l'occasion d'un vote, de changer la Constitution – sauf dans le cas d'un référendum ou d'un vote du Congrès.
Article 5 de ladite Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. » Il n'est écrit nulle part que le Président de la République a le droit de donner des missions aux ministres ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Article 19 : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. »

Le Président de la République n'a pas qualité pour violer la Constitution ni adresser une lettre de mission à qui que ce soit, sauf si cette dernière est contresignée par le grand vizir M. Fillon ou l'un de ses ministres. (Mêmes mouvements.)

Avez-vous, monsieur Chatel – puisque vous êtes, si j'ai bien compris, le ministre compétent sur le sujet –, contresigné la lettre de mission du Président de la République ? Dans le cas contraire, cette lettre est non seulement nulle et non avenue, mais elle viole nos institutions ! (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Il y a 96 % des Français qui ne partagent pas votre avis, monsieur Brard !

Vous voyez, monsieur le président, qu'il y va de notre loi fondamentale et non plus seulement du bien-fondé des usages alsaciens :…

…en l'espèce, ces derniers n'ont rien à voir avec le Concordat puisque la fermeture dominicale n'est pas destinée à permettre aux Alsaciens de chanter matines et d'aller à vêpres, mais à respecter le repos des familles. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical et citoyen.)

M. Mallié ayant retiré son amendement, je renoncerai à demander une de suspension de séance. La situation n'en était pas moins surréaliste. Après avoir retiré l'amendement en commission, M. Mallié l'a redéposé avant la séance publique. C'est évidemment son droit, mais j'ai été frappé par le fait que le groupe de l'UMP ne s'est pas exprimé : nous étions très près d'un vote dont le résultat ne faisait aucun doute – et pour lequel j'avais d'ailleurs demandé un scrutin public – et qui aurait pu aboutir à l'autorisation d'ouvrir les magasins le dimanche !

Vous avez, madame la ministre, une feuille de route. Je n'ajouterai rien à ce que vient de dire M. Brard : il n'y a eu aucune réforme de nos institutions… (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Mes chers collègues, c'est une question importante et il est normal que le débat ait lieu : laissez M. Ayrault s'exprimer.

Il nous provoque ! L'amendement a été retiré et M. Ayrault fait tout pour que nous réagissions !

M. Chartier a demandé la parole : il l'aura.
Monsieur Ayrault, veuillez poursuivre.

J'ai en effet demandé la parole pour un rappel au règlement. Je suis président du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, lequel compte 204 députés : je demande simplement à nos collègues de la majorité de nous respecter, comme nous les respectons.

Les choses iront bien mieux ainsi.
J'ignore ce que fera Mme Lagarde, qui a reçu une injonction du Président de la République. (« Oh ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Les propos de M. Brard sur ce sujet étaient tout à fait justes. Cela montre en tout cas à quel point nous avons non seulement le droit mais aussi le devoir d'exiger que le Parlement soit consulté et associé sur les révisions constitutionnelles envisagées.
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Consultez M. Lang !

C'est en effet une part de notre pouvoir, c'est-à-dire de la souveraineté nationale, qui est en cause.
On assiste à une rapide et inexorable dérive de notre système institutionnel sans qu'à aucun moment le Congrès ou le peuple français, par la voie du référendum, ne se soient prononcés. Mais peut-être aurons-nous des précisions cet après-midi : nous ne manquerons pas, alors, de nous exprimer.
Mais, sur le fond, permettez-moi de vous mettre en garde, madame la ministre : puisque vous devez apparemment agir vite, faites attention à ce que vous allez décider pendant l'été au sujet de l'ouverture des commerces le dimanche. Il faut une étude d'impact, laquelle doit porter sur tous les plans, le plan social aussi bien qu'économique.
Il ne suffit pas d'avoir travaillé dans un magasin, monsieur Mallié, pour détenir la vérité ! Savez-vous que, le jour où les magasins ouvriront le dimanche, il faudra réorganiser le service des transports publics ?

Peut-être n'avez-vous pas songé non plus à l'organisation de la sécurité pour ces milliers de personnes qui circuleront dans les rues de nos villes !

Et pour ce faire, il faudra bien mobiliser des policiers, et pas seulement municipaux ! Sans doute avez-vous aussi pensé à l'organisation des services de nettoyage !
Bref, l'impact de cette décision dogmatique ou idéologique n'a pas encore été mesuré. Je vous mets donc en garde sur ce que vous envisagez de faire, madame la ministre : compte tenu des propos que vous avez tenus à la tribune de notre assemblée, je crains le pire. Au sujet du dimanche, vous avez affirmé que vous pensiez à ceux qui se lèvent tôt et que pour d'autres, c'était dimanche tous les jours. De qui parlez-vous, madame ? Le projet de loi que vous défendez favorise – nous allons y venir – la rente : ceux pour qui ce sera « dimanche tous les jours », ce sont bien plutôt les bénéficiaires de vos mesures fiscales, en particulier de celles qui concernent les successions !

Un bébé né dans certaines familles n'aura pas besoin de travailler une fois adulte car il sera déjà doté ! L'économie de la rente n'a jamais engendré la croissance ; elle est d'ailleurs contraire à l'économie de marché. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Voilà des propos bien constitutionnels ! Que faites-vous de la propriété, droit fondamental ?

Ne nous faites pas la leçon sur l'idéologie et, cet été, gardez-vous de prendre de telles mesures, qui risquent non seulement d'avoir un impact économique négatif en augmentant les charges publiques mais aussi de dégrader durablement la vie des salariés, notamment des plus modestes : comme le rappelait M. Muzeau, ce sont d'ailleurs le plus souvent des femmes qui travaillent dans les grands magasins, dans des conditions difficiles. Vous parlez de volontariat, mais, bien souvent, ces femmes n'ont pas le choix.

Je termine en évoquant le cas qui préoccupe M. Mallié. J'ai vu des reportages et même participé à des débats avec des responsables économiques de la zone commerciale en question.

Les étudiants, par exemple, sont en effet volontaires et contents de pouvoir travailler le dimanche pour payer leurs études. Mais ce n'est quand même pas sous ce seul angle que nous allons traiter la question générale de l'ouverture dominicale ! Si les étudiants ont des problèmes pour financer leurs études, peut-être faut-il envisager d'autres solutions !

Vous voyez qu'il s'agit d'une question sérieuse. C'est pourquoi, je le répète, je vous mets vraiment en garde et prends date, madame la ministre : nous serons vigilants pour éviter que vous ne fassiez n'importe quoi. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et sur plusieurs bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

Je voudrais moi aussi faire un rappel au règlement.
Je vous verrai tout à l'heure à l'extérieur de l'hémicycle, monsieur Brard – vous pourrez ainsi en faire part au Canard enchaîné –…

…pour vous expliquer les articles 8 et 9 de la Constitution, puisque vous vous êtes arrêté à l'article 5 : certains compléments d'information vous seront, je le crois, bien utiles.
Puisqu'il s'agit d'un rappel au règlement, permettez-moi de le rappeler explicitement : l'article 58 dispose que « les rappels au règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ». C'est entendu.

Je poursuis : « La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention.
« Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend » – écoutez bien, monsieur Ayrault – « à remettre en question l'ordre du jour fixé, le président lui retire la parole. »
Monsieur le président, au nom du groupe UMP, je demande la stricte application du règlement intérieur de notre assemblée ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. – Vives exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et de la Gauche démocrate et républicaine.)

Monsieur Chartier, il s'agit moins d'un rappel au règlement que d'un rappel du règlement ! (Sourires.)
Au moins l'amendement n° 182 , qui, je le répète, a été retiré, aura-t-il eu le mérite d'ouvrir le débat sur une question importante.
La parole est à M. Jean-Marc Ayrault.

Non, non, monsieur Brard, je viens d'indiquer que j'y renonçais.
Juste un rappel au règlement sur ce qui vient d'être dit.

Celui-ci sera très rapide et sans esprit polémique, monsieur le président.
Je le dis au nom de mon groupe : s'il est une chose à laquelle nous nous refusons, c'est de mettre en cause la présidence.
Monsieur le président, je respecte la présidence de l'Assemblée, quelle que soit la personne qui se trouve au perchoir. (Applaudissements sur divers bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Vous pouvez méditer ces propos, car nous venons d'assister à quelque chose d'assez original en entendant M. Chartier !

Monsieur le président, je demande une suspension de séance ! Elle est de droit, et j'ai la délégation.

Merci de me donner la parole, monsieur le président, d'autant plus que, si j'obtiens la réponse que j'attends, je renoncerai à ma demande de suspension de séance. (Sourires sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
D'abord, nous avons bien compris que M. Chartier veut être président à votre place, monsieur le président. Il n'y a pas de place pour tout le monde au Gouvernement, alors on vise ce qu'on peut !
Ensuite, M. Chartier a voulu faire assaut de constitutionnalité en évoquant l'article 9 de la Constitution, qui énonce : « Le Président de la République préside le conseil des ministres. » Point barre ! Or tout le monde connaît la lettre d'injonction, de mission qui a été adressée à Mme Lagarde. Le ministre compétent peut contresigner la lettre.

Ce qui permettrait de dire que la Constitution n'a pas été bafouée par le Président de la République, c'est que M. Chatel ait contresigné la lettre. La Constitution le prévoit en son article 19…

…qui énonce : « Les actes du Président de la République autres que ceux [que j'ai cités tout à l'heure] sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. »
Monsieur le ministre Chatel, avez-vous retrouvé votre stylo pour contresigner la lettre d'injonction du Président de la République ?
Si nous obtenons la réponse, nous n'avons pas besoin d'une suspension de séance, monsieur le président. Dans le cas contraire, il faut laisser le temps à M. Chatel de retrouver la lettre pour la contresigner !
Monsieur Brard, monsieur Ayrault, je vais vous apporter deux précisions.
Premièrement, je suis ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. J'ai la chance et l'honneur d'avoir auprès de moi deux secrétaires d'État, M. Chatel, chargé de la consommation et du tourisme, et M. Novelli, chargé des entreprises et du commerce extérieur.
Deuxièmement, la lettre, non pas d'injonction, mais de mission – c'est ainsi que le Président de la République et le Premier ministre procèdent à l'égard de leur équipe gouvernementale – que j'ai reçue du Chef de l'État et dont vous avez pu avoir connaissance pour certains aspects, en tout cas par voie de presse, est cosignée par le Premier ministre.
Au termes de la Constitution, les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et – le cas échéant, vous l'avez dit vous-même – par les ministres responsables. Dans le cas présent, la lettre de mission est cosignée : deux signatures figurent sur une même feuille de papier. Je parle donc de cosignature.
Nous pourrons, si vous le désirez, faire l'exégèse de « cosignature » et « contresignature » ! En tout cas, les deux signatures figurent sur la même feuille de papier.
La précision « le cas échéant » qui figure dans la Constitution éclaire la situation.
Enfin, j'aime mieux recevoir une lettre de mission de mon Premier ministre sur laquelle figure également la signature du Président de la République que des mises en garde de quelque sorte que ce soit ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Monsieur Brard, le débat est clos. (M. Brard proteste.)
Jouer sur les mots fait perdre du temps ! Est-ce le but recherché, monsieur Brard ?

Monsieur le président, puisque vous m'interrogez, je vais vous répondre brièvement.
En dehors de vos fonctions de vice-président de l'Assemblée, que vous assumez, vous êtes un homme libre, et vous l'avez démontré dans le passé. Vous êtes également sourcilleux… (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Ce n'est pas, messieurs, parce que M. Salles n'est pas à l'UMP qu'il faut s'exclamer…

Monsieur le président, vous êtes sourcilleux quant au respect de la Constitution.
Madame Lagarde, je ne vous fais pas une « mise en garde », je souligne votre mauvaise foi. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Vous êtes avocate et connaissez le sens des mots : « cosigner » ne signifie pas « contresigner » !
Rappels au règlement

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à douze heures quinze.)

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour un rappel au règlement. J'espère, cher collègue, qu'il s'agit cette fois d'un vrai rappel au règlement.

Oui, c'est un vrai rappel au règlement, monsieur le président. Grâce à la suspension de séance que vous nous avez accordée, nous nous sommes concertés à l'intérieur du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et avec nos collègues du groupe socialiste, radical et citoyen, sur cette lettre de mission. Il s'agit d'un acte public. Où cette lettre est-elle publiée ? Les membres de la représentation nationale en auront-ils une copie ?
Nous avons une autre question à vous poser sur le même sujet, madame la ministre. Cette lettre est-elle rédigée avec « je » ou avec « nous » ? (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Si c'est « nous », est-ce un « nous » synonyme de « je », c'est-à-dire un pluriel de majesté, ou s'agit-il du « nous » collectif ?
Il est primordial que nous ayons connaissance de cette lettre : nous ne sommes pas dans le champ de la vie privée, ce n'est pas une lettre privée qui vous est adressée. Si on ne nous répond pas, nous serons obligés d'insister !

Monsieur Brard, ce débat a été suffisamment long et fourni. Je pense que vous aurez la réponse dans les jours qui viennent.

J'ai bien compris que vous vous intéressiez davantage à la Suisse, mon cher collègue !

Je suis saisi d'un amendement n° 215 .
La parole est à Mme Marisol Touraine, pour le soutenir.

Cet amendement a pour objet de moduler le taux de la contribution des entreprises aux ASSEDIC en fonction de la nature des emplois qu'elles proposent. En effet, votre texte a pour objet « la réhabilitation du travail comme valeur, comme outil d'amélioration du pouvoir d'achat ». Or, on le sait, l'un des principaux obstacles à cette amélioration, l'une des causes de la défiance de certains salariés à l'égard du travail, c'est le fait que les emplois qui leur sont proposés et auxquels ils peuvent accéder sont souvent à temps partiel ou précaires. C'est aujourd'hui le cas pour 28 % des salariés, en particulier pour les jeunes qui doivent effectuer un véritable parcours du combattant avant de pouvoir entrer dans la vie active avec un contrat stable.
Vous le savez, aujourd'hui, trois embauches sur quatre se font sur des contrats précaires à durée déterminée et des contrats à temps partiel. Il ne s'agit pas de prétendre qu'ils sont à rejeter dans tous les cas. Nous savons bien que les entreprises ont, à certains moments, besoin de faire face à des augmentations de leur plan de charge, à des demandes saisonnières, et qu'il y a des hommes ou, le plus souvent, des femmes qui souhaitent pouvoir travailler à temps partiel pour se consacrer à d'autres activités, par exemple à l'éducation de leurs enfants. Malheureusement, ce n'est pas la majeure partie des cas. Les trois quarts des salariés employés à temps partiel et ne bénéficiant pas de revenus leur permettant de vivre dans des conditions décentes n'ont pas choisi leur situation et souhaitent pouvoir disposer d'un contrat à temps plein. C'est la raison pour laquelle, dans le souci de réhabiliter le travail et d'augmenter le pouvoir d'achat, nous proposons un amendement qui permettrait de moduler les cotisations en fonction de la nature des emplois existant dans les entreprises.
Le Gouvernement émet un avis défavorable à cet amendement. Je voudrais cependant apporter deux précisions. D'une part, le code du travail consacre pas moins de vingt-deux pages aux contrats à durée déterminée et c'est dans des conditions très réglementées que l'employeur a recours soit au travail à temps partiel, soit aux contrats à durée déterminée et, plus généralement, à ce que vous appelez les contrats de travail précaire. Leur utilisation est prévue dans trois cas de figure principaux. Par conséquent, il n'y a pas lieu de surajouter de la réglementation. Nous proposons un texte de liberté visant à encourager le travail et non pas à sanctionner un mode de recours au travail qui est lui-même très réglementé, très encadré, et qui, grâce à l'excellente administration du travail dont nous disposons, fait l'objet de contrôles réguliers.

Je déplore cet avis défavorable, car nombreux sont les salariés qui souhaiteraient pouvoir travailler davantage, mais la réglementation en vigueur, qui devrait peut-être être revue pour encadrer de façon plus stricte le recours à de tels contrats, ne leur garantit pas des conditions de travail satisfaisantes. N'assiste-t-on pas, depuis quelques années, à l'explosion du phénomène des travailleurs pauvres, dont vous prétendez pourtant combattre le développement ?

Je suis saisi d'un amendement n° 345 .
La parole est à M. François de Rugy, pour le soutenir.

Monsieur le président, madame la ministre − j'allais oublier que vous vouliez qu'on vous appelle « madame le ministre », car j'aurais du mal, quant à moi, à m'entendre appeler « monsieur la députée » −,…

…monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en matière de hausse du pouvoir d'achat, on se contente généralement de deux approches traditionnelles : la hausse des salaires − mais on a bien compris que la majorité n'en voulait pas − et la hausse du temps de travail, dont nous parlons depuis le début de l'examen de ce projet de loi. Avec cet amendement, je voudrais ouvrir une nouvelle voie : celle des gains de pouvoir d'achat que l'on peut obtenir en faisant réaliser aux ménages, aux salariés, des économies sur certaines dépenses.
On sait que, dans le budget des ménages, le deuxième poste de dépense, après le logement, est constitué par les déplacements. Bien entendu, il ne s'agit pas de voyages à l'autre bout de la planète, mais de déplacements quotidiens pour se rendre au travail. Nous sommes donc bien au coeur de notre sujet. Ces dépenses sont subies et non choisies : si les cours du pétrole et les prix à la pompe augmentent, personne ne l'a choisi, mais tous ceux qui se déplacent en voiture le subissent. Je propose de créer une dynamique durable de pouvoir d'achat pour les salariés. Je puis vous dire, en tant qu'élu local, responsable des transports à Nantes,…

…qu'il y a une demande des salariés. Nous avons mis en place des dispositifs locaux qui ont connu un grand succès, mais les demandes des salariés se heurtent parfois au refus des employeurs. Je propose donc que le chèque-transport qui a été créé sur le modèle du chèque-déjeuner ne soit plus facultatif, mais que, si un salarié le souhaite − car il n'est pas question de le lui imposer −, il puisse exiger de son employeur qu'il le finance.
J'ai parlé, dans la discussion générale, de mesures concrètes en faveur du pouvoir d'achat. Je me suis livré à un petit calcul : un salarié qui, 250 jours par an, fait vingt kilomètres par jour dans une petite voiture pour se rendre à son travail − dix kilomètres aller, dix kilomètres retour, et vous voyez que je suis plutôt en dessous de la moyenne nationale −, parcourt 5 000 kilomètres dans l'année et dépense pour cela quelque 1 500 euros. Si on lui permet d'économiser cette somme en prévoyant un cofinancement par l'employeur et l'employé de ces déplacements en transports en commun, on pourra quasiment dégager un treizième mois pour un salarié payé au SMIC.
Dernier argument en faveur de l'amendement : il supprimerait une forte et ancienne inégalité territoriale entre l'Île-de-France et les autres régions, puisque les salariés d'Île-de-France peuvent exiger de leur employeur, public ou privé, le remboursement partiel − jusqu'à 50 % − de la carte Orange, alors que, dans nos régions de province, ce n'est pas possible.

, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Ce n'est pas 250 jours, mais 218 !

La commission a rejeté cet amendement. Comme je l'ai dit en commission à M. de Rugy, nous n'allons pas légiférer de nouveau sur le chèque-transport qui vient à peine d'être créé et qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier dernier. Ayons la sagesse d'attendre une évaluation avant de modifier le dispositif.
Même avis, monsieur le président.
J'ajoute que le décret d'application de ce texte a été publié au mois de février. Dans le cadre des réflexions actuelles sur le développement durable, ce texte mérite que l'on évalue son application et son efficacité. Par ailleurs, les dispositions du mois de janvier avaient fait l'objet de consultations auprès des organisations syndicales et d'employeurs. Elles représentent le fruit d'un compromis auquel l'État apporte une importante participation financière. Nous souhaitons donc rester dans ce système qui est facultatif pour les entreprises et je demande le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.

Je maintiens mon amendement et regrette simplement l'argument du report à plus tard, invoqué par M. le rapporteur général. J'avais cru comprendre, depuis le début de cette session extraordinaire, qu'il y avait au contraire urgence à apporter des réponses en matière de pouvoir d'achat. J'en proposais une qui me paraissait fort concrète. Je regrette qu'elle soit rejetée.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 121 et 429 .
J'indique d'ores et déjà que, sur le vote de ces amendements, je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. Jean-Claude Sandrier, pour soutenir l'amendement n° 121 .

La dix-huitième chambre de la cour d'appel de Paris a validé vendredi dernier un jugement du conseil des prud'hommes de Longjumeau portant sur un litige entre un employeur et un de ses salariés à propos de la rupture d'un contrat nouvelles embauches.
Au-delà de ce cas d'espèce et des vicissitudes politico-judiciaires qu'a connues cette affaire, il s'agit du premier jugement rendu par une juridiction de ce niveau qui invalide le CNE, institué par l'ordonnance du 4 août 2005 prise par le gouvernement de M. de Villepin et que l'UMP, alors présidée par M. Sarkozy, a totalement soutenu.
Cet arrêt, qui est bien entendu appelé à faire jurisprudence, signifie que la justice de notre pays a rejoint l'avis des millions de personnes qui, pendant des semaines, ont manifesté dans les rues pour exiger et obtenir le retrait du CPE, frère jumeau du CNE.
Je rappelle que, si le premier était réservé aux jeunes pour une première embauche et le second destiné à toutes les embauches dans les entreprises de moins de vingt salariés, ces deux contrats de travail avaient pour particularité commune de permettre, durant deux ans, le licenciement des salariés sans indication de motif.
La cour d'appel de Paris a notamment motivé sa décision en jugeant le CNE non conforme à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail, que la France a signée voici plus de vingt ans et qui fait obligation aux employeurs de motiver tous les licenciements de salariés.
En vérité, le régime commun à ces deux contrats avait pour but inavoué de devenir la règle générale à l'embauche des jeunes et de tous les salariés des PME pour supplanter, en définitive, le CDI, qui prévoit, lui, des périodes d'essai légales ou conventionnelles raisonnables. Au fond, il s'agissait de rendre taillables et corvéables à merci des millions de salariés, ce qui n'est pas la meilleure façon, vous l'avouerez, de valoriser le travail.
Ces deux contrats relevaient ensemble d'une seule et même stratégie, à laquelle le MEDEF et la CGPME n'ont cependant toujours pas renoncé. Le but de la manoeuvre était de faire en sorte que CPE et CNE deviennent la nouvelle norme pour l'embauche des salariés, afin d'exercer, par la menace permanente du licenciement, une pression maximale sur les conditions de travail et de salaire.
La période d'essai, qualifiée de période de « consolidation », devait durer deux longues années pendant lesquelles le nouvel embauché pouvait être congédié sous les plus fallacieux prétextes et sans que l'employeur ne soit tenu de motiver le licenciement.
Dans son arrêt, la cour d'appel de Paris a constaté, je cite, que « durant une période de deux années, le CNE prive le salarié de l'essentiel de ses droits en matière de licenciement ».
Elle a estimé qu'il était anormal que le salarié soit obligé de prouver le caractère abusif de son licenciement.
Elle a déclaré dans ses attendus, je cite encore, que « cette régression, qui va à l'encontre des principes fondamentaux du droit du travail dégagés par la jurisprudence et reconnus par la loi, prive les salariés des garanties d'exercice du droit du travail » et que « dans la lutte contre le chômage, la protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen au moins aussi pertinent que les facilités données aux employeurs pour licencier ».
La cour d'appel de Paris a ainsi fait litière du principal argument du MEDEF et de la CGPME selon lequel la précarisation extrême des nouveaux embauchés serait favorable à l'emploi.

Je rappelle d'ailleurs qu'une étude de la DARES, qui est une direction du ministère du travail, confirmait que le CNE constituait avant tout un effet d'aubaine pour les patrons de PME qui auraient de toute manière embauché si le CNE n'avait pas existé.

La DARES indiquait en effet que, sur les 9 000 contrats de travail conclus sous le régime du CNE, seuls 8 % pouvaient être imputés à ce genre de dispositif.
À propos du délai de deux ans pendant lequel le CNE prévoit que l'employeur peut licencier sans motif le salarié, la cour d'appel a enfin souligné qu'« aucune législation de pays européens comparables à la France n'a retenu un délai aussi long durant lesquels les salariés sont privés de leurs droits fondamentaux en matière de rupture du contrat de travail ».
Vous qui êtes toujours en train de montrer en exemple les autres pays européens, vous feriez bien de vous en inspirer notamment s'agissant de l'un des droits de l'homme fondamental qu'est le droit au travail.
Avec l'amendement n° 121 , nous demandons au Gouvernement et à notre assemblée de prendre acte de cette décision de justice et des griefs qui sont ainsi faits à une disposition législative inique et scandaleuse, instituée par ordonnance, sans discussion ni vote explicite au Parlement. Nous demandons solennellement l'abrogation du CNE. C'est la raison de notre demande de scrutin public sur l'amendement n° 121 .

La parole est à M. François de Rugy, pour soutenir l'amendement n° 429 .

Je suis tout à fait d'accord avec les arguments de fond que vient d'exposer M. Sandrier contre le contrat nouvelles embauches qui avait été imposé par ordonnance, au forceps, selon la méthode chère à l'ancien Premier ministre et contre l'avis de toutes les organisations syndicales.
Je suis également tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue à l'instant sur la perte par les salariés de leurs droits élémentaires dans le cadre de ce contrat. Je n'y reviens pas. Je voudrais simplement ajouter un argument.
Je sais que le Président de la République veut créer plusieurs dispositifs juridiques – il a même défendu l'idée d'aller devant les tribunaux pour faire valoir ses droits à faire garder ses enfants –, mais, pour ma part, je ne souscris pas du tout à ce modèle-là pour la simple raison que, concrètement, avec ce type de dispositif, on insécurise la vie des entreprises, on insécurise à la fois les employés et les employeurs. Cela me paraît très grave.
Plutôt que de s'épuiser dans des batailles juridiques très longues, il vaudrait mieux mettre fin à cette incertitude et remettre cette question dans le champ du dialogue social. Notre collègue Méhaignerie a dit souhaiter tout à l'heure à propos d'un autre amendement l'instauration d'un véritable dialogue social et pas simplement de la concertation. Il ne suffit pas de recevoir des syndicalistes à déjeuner.

Il faut mettre des sujets sur la table pour qu'ils soient négociés, négociés entre les partenaires sociaux et discutés au Parlement.

Dans l'attente de cette discussion, je souhaite l'abrogation de l'ordonnance du 2 août 2005 par l'adoption de l'amendement n° 429 .

La commission a rejeté ces deux amendements sans la moindre hésitation, principalement pour deux raisons simples.
La première, c'est que le contrat nouvelles embauches a été un dispositif extrêmement efficace, qui a contribué à créer des dizaines de milliers d'emplois.

La seconde raison, vous venez de l'évoquer, monsieur Sandrier, c'est que, s'il y a bien eu un jugement en appel, la procédure judiciaire est loin d'être close. L'employeur s'est pourvu en cassation et il n'y a aucune raison d'interférer à ce stade.
Même avis.

Mme la ministre a eu l'amabilité et la courtoisie, hier, de nous répondre que, la procédure n'étant pas terminée, elle n'avait pas de commentaire particulier à faire. Je crois cependant que l'adoption de ces amendements rendrait un véritable service à l'ensemble de notre communauté, à la fois au Gouvernement, qui va être en difficulté lorsque la cassation confirmera cette disposition,…

… ainsi que, cela vient d'être dit, aux entreprises, qui sont aujourd'hui dans une insécurité juridique. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) C'est une supposition, nous verrons bien. En tout cas, pour les entreprises, l'insécurité juridique est réelle. Or il n'est pas convenable de mettre en difficulté, en interrogation juridique permanente, des entreprises de ce pays, comme il n'est pas convenable de mettre l'inquiétude au rang des préoccupations principales des salariés. Ils sont 900 000 concernés, la plupart d'ailleurs embauchés par effet d'aubaine, monsieur le rapporteur général, chacun le sait bien – cela a été démontré.
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical et citoyen. Bien sûr !

Beaucoup d'emplois étaient prévus, on a considéré que c'était la meilleure formule.
Je veux, pour finir, revenir un instant sur les propos de notre collègue Mallié tout à l'heure. Il proposait que le travail du dimanche des salariés se fasse sur la base du volontariat, mais, quand on est en contrat nouvelles embauches et qu'on a deux ans de période d'essai, avec une possibilité de licenciement sans motif, l'une des motivations pourrait être le constat d'un refus de travailler le dimanche. On voit bien qu'il existe une grande perversité dans la façon dont on argumente les choses. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Ce serait une bonne chose que la majorité vote ces amendements identiques. Sinon, nous allons nous retrouver – pardonnez-moi cette expression un peu triviale – dans le mur dans pas longtemps sur cette question. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

Madame la ministre, la loi a permis le CNE, c'est vrai. Mais, au terme d'une procédure, la cour d'appel a tranché. Comme vous rappeliez, la justice est indépendante, même si, parfois, on peut avoir des doutes. Tout va bien d'ailleurs à la justice puisque, au cabinet de la ministre, c'est la fuite, l'exode, l'évasion. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) C'est un lieu où ne se posent, si l'on en croit les gazettes, que des problèmes personnels et privés, puisqu'ils s'en vont tous pour des raisons d'ordre privé.
Cela étant, vous vous êtes trompés en faisant voter le CNE. Vous vouliez livrer de la main-d'oeuvre taillable et corvéable à merci. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Nouveau Centre.) Mme Lagarde sourit, elle voit bien que nous avons débusqué les réelles intentions gouvernementales. Pour une fois, vous assumez la continuité, il n'y a pas de « rupture » entre le gouvernement précédent et le gouvernement actuel, ce que confirme sur son banc M. Mariton.
Madame la ministre, vous vous grandiriez – si j'ose dire – en permettant que cet amendement soit adopté. Cela vous éviterait de subir un camouflet légitime et vous épargnerait les confrontations sociales que, immanquablement, vous aurez à affronter tellement ce CNE est immoral et inéquitable. Ne parlez pas de liberté de choix et de tout cela. Quelle liberté, quelle égalité y a-t-il, madame la ministre, entre le cheval et l'alouette ? Aucune ! Faites plutôt un geste qui montre votre ouverture, non pas l'ouverture du Président de la République, conçue pour tripatouiller et essayer de débaucher, mais l'ouverture au dialogue, en nous entendant et en anticipant une décision de justice qui ne manquera pas.

Oh non ! Je ne suis pas candidat à la prostitution, comme tous ceux qui ont rejoint (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Nouveau Centre)…

Le groupe Nouveau Centre est opposé à cet amendement, pour plusieurs raisons.
D'abord, je voudrais rappeler un peu l'histoire.
Les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle portaient sur le CPE, non sur le CNE.

Pas du tout ! Le CPE concernait une catégorie de population, notamment les jeunes, le CNE concerne une catégorie d'entreprises, ce qui est différent. On travaille là sur une catégorie d'entreprises, celles de moins de vingt salariés, donc les petites entreprises. Donc, même si, sur la forme, ils se ressemblaient, ce n'est pas le même type de dispositif.

Lors de la discussion du CPE, j'avais soutenu que la durée de deux ans de la période d'essai était beaucoup trop longue. Nous avions d'ailleurs proposé par voie d'amendements de la ramener à six mois avec motivation.

J'avais expliqué à l'époque que, pour un jeune qui démarrait dans la vie, ne pas lui dire pourquoi on le licenciait ne me paraissait pas une bonne formation pour la vie professionnelle.

Le CNE concerne tout type de salariés dans les petites entreprises. Le gouvernement avait indiqué, à l'époque, qu'il allait remettre un rapport sur l'efficacité de ce dispositif et nous étions d'accord d'attendre ce rapport. Nous sommes sur la même position.

Nous attendons du Gouvernement qu'il nous dise combien d'emplois ont été créés avec le CNE, s'il a été efficace, comment cela s'est traduit, quelles sont les entreprises qui ont souscrit, les entreprises de plus de dix salariés ou celles de moins de dix salariés – le code du travail, je vous le rappelle, fait une différence entre les moins de dix et les plus de dix. Et nous attendons ce rapport pour prendre position.

Nous préférons la réforme du CNE à son abrogation. C'est pourquoi nous ne voterons pas ces amendements.

En revanche, nous souhaitons savoir si, dans l'hypothèse où, à l'issue de cette procédure, la Cour de cassation donnerait raison à ceux qui voulaient abroger ou en tout cas supprimer le CNE du code du travail, le Gouvernement envisage d'introduire une période d'essai plus courte, de six mois par exemple comme nous le souhaitions, ainsi qu'une motivation dans le licenciement en cas de rupture.


Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 92
Nombre de suffrages exprimés 92
Majorité absolue 47
Pour l'adoption 30
Contre 62
Les amendements sont rejetés.
Je suis saisi d'un amendement n° 213 .
La parole est à Mme Marisol Touraine, pour le soutenir.

Cet amendement vise à augmenter les cotisations sociales des entreprises de plus de vingt salariés employant plus de 25 % de salariés à temps partiel, et ce pour l'ensemble des salariés à temps partiel. Cela fait écho aux propos que j'ai tenus tout à l'heure sur l'amendement n° 245 .
L'une des raisons principales du développement du nombre de salariés dits pauvres est précisément le choix fait par de nombreuses entreprises de développer un temps partiel imposé qui concerne plus de 15 % des salariés du secteur privé, essentiellement des femmes. Or, si l'on veut pouvoir leur offrir des conditions de vie décentes et réhabiliter le sens du travail pour ces femmes qui ne voient pas très bien, dans leur activité quotidienne, en quoi ce travail est synonyme d'identité ou de dignité, il faut établir une différence entre les cotisations payées par les entreprises qui respectent leurs salariés en ne faisant appel au temps partiel que lorsque cela est réellement nécessaire pour faire face à des besoins conjoncturels et celles des entreprises qui font de ce recours une véritable politique. Le seuil de 25 % d'emplois à temps partiel dans une entreprise nous semble suffisant pour permettre aux entreprises de répondre à d'éventuels besoins d'ajustements. C'est la raison pour laquelle nous proposons que les entreprises de plus de vingt salariés qui emploient plus de 25 % de salariés à temps partiel soient soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés à temps partiel.

La commission est tout à fait d'accord avec l'idée générale qui inspire cet amendement selon laquelle il faut encourager en priorité le dépassement du temps partiel plutôt que celui du temps plein. C'est tellement vrai, madame Touraine, que l'article 1er vous donne satisfaction. Je vous rends en effet attentive au fait que la déduction forfaitaire au titre de la cotisation employeur, qui sera fixée par décret, sera applicable aux seules heures supplémentaires, et non aux heures complémentaires.
Je fait mienne l'argumentation de M. le rapporteur général. J'ajoute que l'amendement n° 11 , adopté hier à l'initiative de M. Tian, a renforcé le dispositif anti-abus, ce qui répond à l'objectif que vous poursuivez, comme le Gouvernement, à savoir lutter contre le travail partiel subi. Je souhaiterais donc que vous retiriez votre amendement. À défaut, l'avis du Gouvernement serait défavorable.

Nous avons bien compris l'objectif anti-abus poursuivi par l'amendement n° 11 visant à éviter que des entreprises faisant appel à du temps partiel ne puissent trop compléter celui-ci par des heures supplémentaires, mais la question n'est pas là. On nous dit qu'il faut travailler plus. Or, nous constatons tous les jours que 15 % des salariés, dont 80 % de femmes, subissent un temps partiel. Ces salariés voudraient travailler plus, notamment parce que ce sont souvent des familles monoparentales et des femmes qui, pour élever leurs enfants, auraient besoin d'un temps plein. Cet amendement tend justement à lutter contre l'abus non pas d'heures supplémentaires sur du temps partiel, mais de temps partiel. Nous regrettons donc que vous y soyez défavorables.

Je suis saisi d'un amendement n° 253 .
La parole est à M. Charles de Courson, pour le soutenir.

Nous aurions souhaité que cet amendement soit examiné avant l'article 1er, et non après. En effet, comme je l'ai expliqué dans la discussion générale, le groupe du Nouveau Centre estime que le coût des mesures que nous sommes en train de voter – estimé à 11 milliards pour 2008 – doit être gagé par des économies. La commission des finances a reçu récemment M. Woerth, puis M. Séguin, Premier président de la Cour des comptes. En outre, nous discuterons lundi des orientations budgétaires, qui sont très simples. Face aux 8 milliards d'augmentation spontanée des dépenses, auxquels s'ajoutent les 11 milliards que nous sommes en train de voter, les orientations budgétaires tablent sur une hausse spontanée des recettes de 13 milliards. Il faut donc faire 6 milliards d'économies si l'on veut maintenir le niveau du déficit public. Et comme le Président de la République s'est engagé, à juste raison, devant ses partenaires de l'Eurogroupe, à réduire dès 2007 les déficits publics d'un dixième de point, c'est-à-dire de 2 milliards, et de nouveau d'un dixième de point au minimum en 2008, il faut même faire plutôt 10 milliards d'économies. Le groupe du Nouveau Centre a donc déposé cet amendement pour dire quels sont les trois grands axes qui permettraient de dégager une dizaine de milliards d'économies.
Il s'agit, tout d'abord, du plafonnement des niches fiscales, qui représentent 35 milliards d'euros, par l'impôt minimum alternatif – l'IMA. Je rappelle qu'il n'y a aucun plafond global pour ces niches, ce qui permet à certains contribuables d'annuler leur impôt sur le revenu. Comme l'ont dit plusieurs orateurs de la majorité, il n'est pas cohérent de mettre en place un bouclier fiscal si l'on n'instaure pas simultanément un impôt minimum alternatif. Cette première mesure devrait facilement permettre de dégager 3 ou 4 milliards.
Deuxième mesure : en matière de dépenses publiques, l'État doit appliquer à ses transferts aux collectivités territoriales les règles qu'il s'applique à lui-même. Les transferts de l'État aux collectivités territoriales ne doivent donc pas augmenter plus vite que sa dépense brute. J'ajoute que le Président de la République a lui-même soulevé ces deux questions dans son discours de l'Élysée en disant qu'il fallait faire des économies dans ces deux domaines.
La troisième mesure consisterait à réduire l'excès de prise en charge par le budget de l'État, suite aux 35 heures, mais pas uniquement – les 35 heures représentent plus de la moitié de cette prise en charge –, des cotisations patronales des grandes entreprises, dont l'effet sur l'emploi est, selon la Cour des comptes, faible, voire nul. Dans son rapport à la commission des finances, la Cour des comptes citait les grands groupes de distribution, montrant non seulement que cette disposition n'avait pas eu d'effet en termes de création d'emplois, mais qu'elle avait eu un effet pervers en termes de rémunération, puisqu'elle crée des trappes à bas salaires.
Tels sont, à notre sens, les trois grands domaines dans lesquels on peut réaliser une dizaine de milliards d'économies. Certes, nous reprendrons ce débat lundi après-midi, mais nous aimerions connaître dès maintenant la position du Gouvernement sur ces propositions.

La commission a repoussé cet amendement, mais le rapporteur général n'en est pas moins très intéressé par les propositions de M. de Courson. En effet, dégager 13 milliards, cela relève d'une oeuvre de réflexion intense ! Ces propositions, qui portent sur un nouvel impôt – l'impôt minimum alternatif –, sur un réexamen des conditions d'exonération de charges sociales patronales à partir du rapport de la Cour des comptes que nous avions commandé il y a deux ans, sur les relations financières de l'État avec les collectivités locales, vont nourrir notre réflexion pendant l'été, dans la perspective de la préparation de l'équilibre du budget 2008, qui va être difficile.
Le Premier ministre a réuni avant-hier les préfets et les directeurs d'administration pour leur enjoindre de réfléchir à une véritable revue de programme, dans le cadre de laquelle ces propositions auront toute leur place. Votre troisième idée, monsieur de Courson, a d'ailleurs fait l'objet d'un début de mise en oeuvre : le Premier ministre a indiqué dans son discours de politique générale qu'en 2008 le prélèvement sur recettes en direction des collectivités locales serait pris en compte dans la norme de dépenses générales qui ne suivra que l'inflation. Il serait néanmoins prématuré de voter cet amendement dès à présent.
Monsieur de Courson, le Gouvernement est lui aussi très intéressé par vos trois propositions, qui visent chacune l'un des postes de dépenses dites maastrichtiennes et sur lesquelles vous proposez des économies de l'ordre de 13 milliards d'euros. Ces propositions seront examinées non seulement dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2008, mais aussi dans celui du réexamen de l'ensemble des prélèvements de nature fiscale que nous entamons actuellement. L'IMA, déjà pratiqué par un certain nombre d'États, sera bien sûr l'un des moyens à envisager pour parvenir à une meilleure maîtrise de la dépense publique.
Compte tenu de ces indications et de l'engagement que nous prenons de travailler dans des délais très brefs, je vous suggère de retirer cet amendement au profit de l'amendement n° 273 de M. Méhaignerie, qui sera défendu après l'article 5 et qui prévoit la remise au Parlement, avant le 15 octobre, d'un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'une imposition minimale. Cela ne retire rien à l'intérêt de vos autres propositions visant à supprimer les allégements de cotisations patronales pour les entreprises employant plus de 500 salariés et à mieux encadrer les transferts de l'État aux collectivités territoriales, deux autres postes de dépenses maastrichtiens extrêmement importants et auxquels nous devons être vigilants dans les mois à venir.

La parole est à M. Didier Migaud, président de la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

Cet amendement est intéressant à plus d'un titre. Il devient en effet urgent de disposer d'une évaluation sérieuse de l'efficacité des exonérations de cotisations sociales. C'est un débat récurrent, que nous avons abordé hier après-midi encore avec le Premier président de la Cour des comptes. Le ministère de l'économie dispose d'études qui ont été conduites sur le sujet et il faudrait que la commission des finances s'en saisisse pour être en mesure de formuler des propositions à l'occasion de la discussion de la prochaine loi de finances. Jean-Pierre Brard disait que le Premier président de la Cour des comptes avait fait preuve, hier, d'humilité. En fait, pour un certain nombre de ces exonérations, l'effet d'aubaine est réel.
Dans le cadre de notre réflexion sur l'efficacité de la dépense publique fiscale ou budgétaire, il faut que nous puissions progresser ensemble sur ce sujet.
Mais ces amendements possèdent une autre portée. À ce sujet, vous avez évoqué, madame la ministre, l'amendement de Pierre Méhaignerie. J'en ai moi-même déposé, dont nous reparlerons. Ils soulèvent le problème de la justice fiscale. Est-il légitime que l'on puisse s'exonérer de tout impôt sur le revenu ? Nous reviendrons bien sûr sur la question du bouclier, mais le problème de la justice fiscale doit être posé de manière beaucoup plus vaste. Il ouvre tout le débat sur le plafonnement et les niches fiscales, et par conséquent sur l'opportunité d'une cotisation minimale à l'impôt sur le revenu. J'espère que nous aurons cette discussion.
À plusieurs reprises, nous l'avons effleurée, mais reconnaissons que, pour le moment, nous bottons systématiquement en touche. Pour ma part, je souhaite que nous ayons un débat de fond et que nous recevions des propositions dès la prochaine loi de finances. Désormais, nous disposons d'études suffisantes et, au vu de l'exemple de pays étrangers qui ont trouvé une formule satisfaisante, nous devrions parvenir à une solution sans trop tarder.
Pour l'heure, je crois qu'il serait bon que M. de Courson retire son amendement. Il interviendra de nouveau dans la discussion, lorsque l'Assemblée examinera les amendements nos 273 et 157 à 159 .

Bien entendu, je retire mon amendement. Mais, parmi les trois pistes qui viennent d'être évoquées, le groupe Nouveau Centre retiendra celle de l'IMA. Il est de notoriété publique que nous avions rêvé de déposer, avec M. le rapporteur général, un amendement à ce sujet, mais sa rédaction s'avère si délicate qu'il a dû provisoirement y renoncer.
Pour ce qui est des deux autres pistes, on ne peut pas se contenter de la déclaration du président Séguin. Celle-ci n'est d'ailleurs pas absolument conforme au rapport sur les exonérations de charges patronales qui a été transmis à la commission des finances, lequel proposait clairement de supprimer le dispositif pour les grandes entreprises. La grande distribution est l'exemple même d'un secteur où les aides envisagées seraient inutiles, voire perverses.

Aider la branche pétrole ou la branche chimie ne présenterait absolument aucun intérêt.

Ce serait de l'argent public perdu. Or je rappelle que les sommes en jeu sont de l'ordre de 25 milliards, dont une politique courageuse, d'ailleurs proposée par la Cour des comptes, permettrait d'extraire 5 à 7 milliards en deux ou trois ans. Autant dire que le sujet est d'une importance considérable.
Si Mme la ministre participe au débat d'orientation budgétaire, je lui donne rendez-vous pour lundi. Nous reprendrons la discussion dans ce cadre.


Il s'agit d'un amendement d'appel.
En commission, puis lors de la discussion générale, nous avons évoqué le fait que les mesures prévues par l'article 1er ne concernaient que les salariés, ou plutôt seulement une partie d'entre eux. D'où ma question : quelle est la position du Gouvernement à l'égard des 10 % de travailleurs qui ne sont pas salariés et quelles mesures envisage-t-il pour eux ? Nous aimerions connaître le discours qu'il va leur adresser et les propositions concrètes qu'il envisage de prendre pour eux.

La commission n'a pu que rejeter cet amendement. Certes, la question qu'il soulève est ouverte, mais les modalités proposées par M. de Courson ne sauraient être retenues. Même si le Gouvernement incite les salariés à effectuer des heures supplémentaires, tous n'en feront pas. Il n'est donc pas possible de prévoir un dispositif qui s'adresse de manière systématique aux travailleurs indépendants.
Le Gouvernement est bien conscient de la difficulté que pose le statut des travailleurs indépendants et que M. de Courson a soulignée. Pour autant, il n'est pas possible de comparer leur situation professionnelle et celle des salariés. Leur régime d'imposition est d'ailleurs différent, puisque les seconds sont soumis à l'impôt sur le revenu, tandis que les premiers sont imposés au titre des BNC. M. de Courson sait d'ailleurs combien il serait difficile de s'ingérer dans la gestion du temps d'un travailleur indépendant, que, par définition, il organise lui-même à sa guise.
Néanmoins, très consciente des difficultés que rencontrent certaines sociétés, en particulier civiles, je vous informe que le Conseil des prélèvements obligatoires étudie actuellement la situation fiscale et sociale des travailleurs indépendants, et qu'il publiera à l'automne un rapport sur ces questions. Les différences de traitement entre travailleurs salariés et non salariés, et l'opportunité d'éventuels ajustements fiscaux permettant d'harmoniser leurs situations pourront être examinés à la lumière de cette étude. Cet examen pourrait avoir lieu dans le cadre de la revue générale des prélèvements obligatoires annoncée par le Président de la République.
Au bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre amendement. À défaut, je demanderai à l'Assemblée de le rejeter.

Je retire mon amendement. Mais, encore une fois, madame la ministre, il aurait été préférable, pour montrer que le Gouvernement s'adresse à tous les Français, que ce texte prévoie des dispositions en faveur des travailleurs non salariés.
Admettons toutefois que le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale comprendront quelques mesures en leur faveur.


Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement est un amendement d'appel, qui devrait à mon sens recueillir l'agrément de tous. Il vise seulement à intégrer – je devrais dire : à réintégrer – dans les statistiques nationales officielles du chômage les personnes sans emploi résidant dans les outre-mer français.
Je n'ignore pas la polémique sur la sincérité des chiffres officiels et du baromètre mensuel publié et commenté par le Gouvernement. Le différentiel entre le nombre des chômeurs inscrits à l'ANPE, qui, de source officielle, s'élevait à 4,45 millions en septembre 2006, et les 2,172 millions de chômeurs recensés par le Gouvernement et la DARES invite à conclure à l'existence 2,276 millions de chômeurs invisibles. Parmi eux se trouvent 220 000 chômeurs des outre-mer français. Une distinction a certes été faite, qui prête à sourire, entre les chômeurs radiés, les déboutés et les dégoûtés. Mais, en l'espèce, il s'agit de chômeurs zombifiés, qui existent sans exister et que l'on a réduits à l'état virtuel afin de pouvoir ne pas les compter.
Je veux bien convenir que les statistiques officielles prennent en compte des critères qui se rapprochent de la définition internationale élaborée par le BIT. Mais peut-on ainsi exclure des chiffres les demandeurs d'emploi temporaires ou à temps partiel qui, d'après le réseau ACDC, sont 871 000, les dispensés de recherche d'emploi, qui sont 412 000, les chômeurs en activité réduite, qui sont 452 000, les demandeurs d'emploi non immédiatement disponibles, qui sont 321 000, et les chômeurs des DOM, qui sont 220 000 ? Les premiers cités, je l'ai dit, sont exclus de la définition officielle, ce que je peux comprendre, même si, sur les bancs de l'opposition, nous n'approuvons pas de telles manipulations. Mais les demandeurs d'emploi des DOM remplissent parfaitement la définition des DEFM de catégorie 1. Pourquoi donc seraient-ils exclus, alors que ces départements font partie intégrante de la République ? On n'a jamais invoqué à cet égard la moindre dérogation ni je ne sais quelle adaptation de la législation.
Quand la question avait été posée à votre prédécesseur M. Borloo, en sa qualité de ministre de l'emploi, il l'avait soigneusement esquivée, refusant même de répondre aux journalistes du Monde. Mais j'aimerais obtenir du Gouvernement une réponse claire : comment entend-il dézombifier les statistiques du chômage ?
J'ajoute que, quand il veut présenter de manière avantageuse les chiffres du commerce extérieur, il n'hésite pas à considérer les DOM comme des territoires d'exportation. Nous figurons à ce titre dans le solde du commerce extérieur, que nous contribuons à augmenter : c'est le cas chaque fois que l'Hexagone envoie des marchandises en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, alors que, si nous exportons, le solde diminue. Dans ces conditions, pourquoi le Gouvernement ne nous prend-il pas en compte dans les statistiques du chômage ?

Je voudrais qu'il s'engage à comptabiliser désormais nos demandeurs d'emploi, qui doivent figurer enfin dans chaque BMST. Ce n'est pas le cas actuellement. Or nous savons que ce qui ne se mesure pas n'existe pas ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical et citoyen.)

La commission a retenu cet amendement, mais en souhaitant que le rapport du Gouvernement ne soit remis au Parlement qu'au 31 décembre 2007. Nous sommes en effet à la mi-juillet et, si nous voulons disposer d'un rapport sérieux sur les modalités d'intégration des personnes concernées, il faut se laisser un peu de temps. À cette réserve près, avis favorable.
Bien entendu, monsieur le député, les départements et les territoires ultramarins ne sont ni oubliés ni sortis des statistiques. Je me suis référée au bulletin mensuel publié chaque mois par la DARES et l'ANPE. L'ensemble des chiffres figure sur la même page même si, je vous l'accorde, chaque département ultramarin figure sur une ligne individuelle. La raison de cette présentation est purement statistique et il serait facile de la corriger. Il faudrait toutefois que les calculs indiciels du chômage dans les départements ultramarins soient calculés en continu sur l'année, ce qui n'est pas le cas actuellement.
J'attire également votre attention sur le fait que le Conseil national de l'information statistique, présidé par Jean-Baptiste de Foucauld, a été mandaté pour réfléchir aux indicateurs à utiliser ou à construire afin de déterminer le nombre et le pourcentage de salariés inactifs ou inemployés. Le but est que nous puissions nous accorder sur un indicateur consensuel et conforme à la définition du chômage élaborée par le BIT. Les conclusions de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales sur le calcul précis du chômage devront également être prises en compte. Ainsi, nous parviendrons à une définition homogène. Je précise toutefois que les calculs actuels sont effectués sur la base des mêmes indicateurs que ceux qui étaient utilisés il y a cinq ou dix ans.
Le problème de l'intégration des départements ultramarins dans les statistiques « France entière » a précisément été évoqué lors de la première réunion du Conseil national de l'information statistique, le 8 mars 2007. Il fera l'objet d'une réflexion au sein d'un groupe de travail spécialement constitué à cet effet. Soyez assuré, par conséquent, que les départements ultramarins ne sont pas oubliés dans les statistiques nationales.
J'ajoute que le Gouvernement est favorable à l'amendement, sous réserve qu'il soit sous-amendé dans le sens suggéré par M. le rapporteur général. Un délai paraît en effet nécessaire pour que nous puissions disposer de chiffres cohérents.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, je vous remercie pour vos commentaires et vos avis favorables, et je suis d'accord pour déposer un sous-amendement.
J'ajoute à mes propos précédents que la pratique des inscriptions à l'ANPE, les définitions des statistiques et catégories concernant le chômage ne sont pas différentes en outre-mer. Alors, pourquoi les chiffres, publiés en septembre 2006, que j'évoquais tout à l'heure font-ils disparaître 220 000 chômeurs ? Parmi eux, 165 000 demandeurs d'emploi en fin de mois de catégorie 1 entrent pourtant dans la définition du BIT, ce qui ne laisse aucune place au doute.

Si vous êtes d'accord, monsieur Lurel, nous pouvons nous contenter de rectifier l'amendement en remplaçant la date du 1er octobre 2007 par celle du 31 décembre 2007 ?

Je mets donc aux voix l'amendement n° 249 , tel qu'il vient d'être rectifié.
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Cet après-midi, à quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi, n° 4, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat :
Rapport, n° 62, de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
Avis, n° 61, de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
Avis, n° 59, de M. Jean-Charles Taugourdeau, au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
Avis, n° 58, de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures quinze.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,
Jean-Pierre Carton