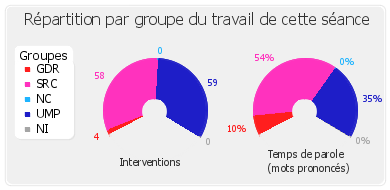Séance en hémicycle du 25 mars 2010 à 15h00
Sommaire
- Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les étrangers non ressortissants de l'union européenne résidant en france (voir le dossier)
- Situation de m. ibni oumar mahamat saleh ressortissant tchadien disparu (voir le dossier)
- Modernisation du congé maternité (voir le dossier)
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi constitutionnelle de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (nos 2223, 2 371).

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale. La parole est à M. Richard Mallié.
M. Richard Mallié.
La parole est à M. RichardMallié.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État à la justice, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui a pour objet d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers résidant en France.

Une idée si novatrice qu'elle faisait déjà partie des fameuses « 110 propositions » du candidat Mitterrand en 1981.

Étrangement, aucun texte sur ce sujet n'a été inscrit à l'ordre du jour au cours de sa présidence longue de quatorze années.
Cette volonté politique est aussi illégitime qu'incohérente. Il est évident qu'on ne peut différencier citoyenneté et droit de vote, ce dernier étant indissociable de la nationalité française. Il existe un lien intime entre ces notions, car on ne peut être citoyen français sans avoir la nationalité française et on ne peut voter si on n'est pas citoyen.
Tel est le sens de l'histoire de France. Chaque pays a sa propre histoire et c'est pourquoi, sur ce sujet, comparaison ne peut être raison.

Vous allez nous dire que les ressortissants des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales et européennes dans leur pays de résidence, et c'est vrai.
Cependant, cette exception s'appuie sur une notion importante, celle de réciprocité. Ce qui est vrai pour un Italien en France sera vrai pour un Allemand en Italie ainsi que pour un Français en Allemagne. Un citoyen français est un citoyen européen, et il apparaît normal qu'un citoyen européen puisse voter aux élections européennes mais aussi aux élections municipales.

Si des étrangers qui séjournent en France depuis longtemps, qui y travaillent et y ont une famille, veulent obtenir le droit de vote, ils n'ont qu'à demander la nationalité française. C'est du simple bon sens !

Cette procédure n'est d'ailleurs pas rare puisque un peu plus de 108 000 personnes l'ont obtenue en 2009. De plus, depuis 1973, il n'existe plus de délai entre l'acquisition de la nationalité et l'exercice du droit de vote.

Avec ce texte, que deviendrait la notion de citoyenneté française si la première prérogative de cette citoyenneté pouvait également être exercée par un étranger ? Votre raisonnement est tout simplement incohérent et repose sur une citoyenneté de résidence, de passage, une citoyenneté de consommateur. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

Ça vous va bien de dire ça, vous qui voulez faire ouvrir tous les commerces le dimanche !

Oui, je sais que c'est à cause de moi que les gens n'ont pas pu aller voter au deuxième tour des élections régionales. Vous l'avez dit dans la presse, madame le rapporteur. Mais en ce cas, je me fais fort d'avoir enlevé 200 000 voix au parti socialiste !

Comme l'avait si bien dit le président Chirac : « Le droit de vote, ce n'est pas l'expression d'une humeur, c'est une décision à l'égard de son pays, à l'égard de ses enfants. » C'est pourquoi je voterai contre ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte proposé aujourd'hui faisait certes partie, en 1981 des 110 propositions du candidat François Mitterrand – que vous souteniez alors, monsieur le secrétaire d'État. Mais il constituait aussi un élément de programme de M. Sarkozy – que vous soutenez maintenant. (Sourires.)

Nous savons tous, malheureusement, ce que peuvent devenir certaines promesses électorales. Ne nous étonnons pas trop, dès lors, des records d'abstention que nous enregistrons, à l'instar de celui de dimanche dernier.
Le Président de la République, comme nombre d'orateurs l'ont souligné, s'était dit « intellectuellement favorable au droit de vote des étrangers »,…

…ajoutant, par prudence ou par réalisme, que sa majorité n'était pas mûre.

À écouter les débats en commission et les orateurs en séance publique ce matin, on constate que la majorité n'est en effet pas mûre. Le Président de la République ne s'est pas trompé à ce sujet.
Pourtant, les dispositions que nous proposons aujourd'hui sont souhaitées par une majorité de Français, recommandées par l'Union européenne, préconisées par le Conseil de l'Europe, dont la France n'a toujours pas ratifié la convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local.

Que faut-il de plus pour vous faire mûrir, chers collègues ?
De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit de mettre un terme à ce qu'on pourrait qualifier d'ethnicisation de la citoyenneté, en permettant à tous ceux qui vivent et travaillent légalement en France depuis cinq ans de prendre part à la vie de leur cité en votant aux élections locales.
En juin 2009, pour les élections européennes, le Gouvernement, dans sa campagne officielle d'incitation à la participation au vote, avait imaginé un très beau et très fort slogan : « Voter, c'est exister. » C'est très juste ! Et si « voter, c'est exister », maintenir les étrangers non communautaires dans l'incapacité de s'exprimer alors que, par ailleurs, ils remplissent l'ensemble des obligations qui s'imposent à tous les citoyens, c'est les empêcher d'exister.
Bien pire, en établissant une différenciation entre Européens, qui sont citoyens, et étrangers, on met en place une stigmatisation empêchant toute réelle intégration. C'est d'autant plus insupportable que certains d'entre eux vivent et travaillent depuis plus de vingt ou trente ans en France, participent à la vie locale et associative, bref, sont des acteurs de la vie publique au sein de leur commune.

Soyons clairs : il n'y a pas de problème juridique. Il suffit de modifier la Constitution française, comme nous l'avons fait pour les ressortissants de 1'Union européenne. La citoyenneté a été séparée de la souveraineté nationale en 1992. Les Françaises ont obtenu le droit de vote quatre-vingt-seize ans après les hommes. Les étrangers non communautaires devront-ils donc attendre 2088 pour obtenir à leur tour le droit de vote ? Le problème n'est pas juridique, il est politique.
On ne peut se défausser sur l'existence des conseils de quartier pour dire que les étrangers participent à la vie politique de la cité. Ces démarches, si elles sont positives et nécessaires, ne peuvent remplacer le droit de vote. On ne peut envisager une intégration dans notre société si le droit de l'étranger qui réside et travaille en France depuis plusieurs années s'arrête aux frontières de la politique.
Il est temps d'agir et de mettre un terme à cette stigmatisation. Les Français demandent ce droit de vote, l'Europe le préconise, nombre d'États l'ont déjà mis en place et, depuis plus de vingt-cinq ans, la gauche et les associations le réclament.
Pour illustrer la nécessité d'agir, je conclurai mon propos en reprenant les paroles du président de la Ligue des droits de l'homme qui, lors de la « votation citoyenne » de mars 2009, affirmait : « Il y a dix ans que la population de ce pays est en avance sur ses dirigeants politiques. Il faut que ceux-ci rattrapent l'opinion des citoyens, qui a déjà compris ce qu'est l'avenir de la démocratie, en ce début du XXIe siècle. »
Monsieur le secrétaire d'État, messieurs de la majorité, au regard des résultats des dernières échéances électorales, il me semble que vous devriez porter une attention particulière à ces propos. Il est plus que temps de mettre fin à l'exclusion de plus de deux millions de personnes résidant, travaillant, vivant dans notre pays, qui ne demandent qu'à pouvoir exister. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le texte que nous étudions aujourd'hui repose sur trois contresens.
D'abord, le vote des étrangers n'est pas un progrès. La conception pavlovienne du progrès défendue dans ce texte consiste à prolonger indéfiniment les courbes, à accroître sans cesse les droits. Cette vision du progrès, c'est l'application au droit de ce qu'est l'entropie en physique. On pense qu'en détruisant les distinctions nécessaires à un ordre juste, on fait avancer le droit. En fait, on crée surtout du désordre.
Aux communautés de citoyens, de personnes conscientes de l'histoire de leur nation, préoccupés par un avenir pérenne et possédant l'usage de la langue ou des langues qui y sont légalement reconnues, on substitue une foule d'individus davantage reliés au pays par l'espace et par l'économie que par le temps et par la culture. Or, la citoyenneté ne repose pas sur la participation économique à la société civile, mais bien sur l'adhésion consciente et volontaire à la communauté des citoyens, à ses valeurs.
Une conception libérale sur le plan économique peut bien souhaiter des individus très mobiles sur un marché mondial. Une conception humaniste exige, elle, des citoyens qui adhérent à des valeurs. On ne vote pas parce que l'on paie des impôts, mais parce que l'on est citoyen.
Si la vieille Europe voit s'éroder ces distinctions essentielles, l'Amérique au contraire a commencé, à l'époque où la plupart des Américains étaient des immigrés, par accepter le vote des étrangers et l'a ensuite restreint en devenant une nation. Le dernier État à y avoir renoncé est l'Arkansas en 1926.
Ensuite, ce texte se prétend démocratique. Voilà un nouveau contresens. Par définition, la démocratie repose sur l'idée qu'il y a un peuple, un demos, une nation. Il est frappant de constater que les pays qui identifient le moins la nationalité et la citoyenneté sont ceux qui sont le plus éloignés des valeurs issues de la Révolution française. Certes, on donne l'exemple des sujets de Sa Gracieuse Majesté, mais ce n'est pas un bon exemple.
En France, c'est le droit du sang qui a coïncidé avec l'avènement de la République, car le droit du sol reposait sur le roi propriétaire du sol. Hériter de sa citoyenneté comme les nobles pouvaient hériter de leurs privilèges, c'est une conquête de l'égalité, le passage entre la situation passive de celui qui naît quelque part et la participation active de celui qui sera appelé à « entrer dans la carrière quand ses aînés n'y seront plus ». À ce droit du sang doit s'ajouter un droit qui dépasse à la fois le droit du sang et le droit du sol : le droit de la volonté. Le citoyen, c'est aussi celui qui veut devenir citoyen, et qui le mérite parce qu'il veut les conséquences de son choix : la maîtrise de la langue, le respect des lois et la participation durable aux efforts de la communauté nationale.
Troisième contresens : le vote des étrangers permettrait leur intégration. C'est évidemment le contraire, puisque les étrangers pourraient participer à la vie politique sans être des citoyens. Ils auraient encore moins de raison de le devenir par la naturalisation. La distinction entre l'homme et le citoyen est essentielle à la démocratie moderne. La démocratie antique reposait uniquement sur la reconnaissance du droit des citoyens de participer à la vie de la cité, mais elle méconnaissait les droits de ceux qui vivaient sur le territoire de la cité. La démocratie moderne repose au contraire sur la distinction entre la protection de tout homme par la cité, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. C'est la fameuse opposition de Benjamin Constant entre la liberté des anciens et celle des modernes. Comme le disait Jean Rivero : « Les droits de l'homme sont des libertés. Ils permettent à chacun de vivre sa vie personnelle comme il l'entend. Les droits du citoyen sont des pouvoirs, ils assurent la participation à la conduite de la cité. » Or, c'est la force et la cohésion de la communauté des citoyens fidèles aux valeurs qui la fondent, qui permet de garantir la protection des droits sur le territoire de la République. Des mesures comme celle que nous examinons aujourd'hui ne peuvent que la diluer et l'affaiblir.
On me dira, bien sûr, que la proposition actuelle ne concerne que les élections municipales. Il s'agit là d'un faux-semblant destiné à grignoter subrepticement les valeurs essentielles de la citoyenneté et de la nation. Les communes ont au moins trois types de rapports avec la nation. D'abord, celui de l'analogie. Les communes sont de petites communautés constituées aussi d'histoire plus que d'espace. En second lieu, les élus municipaux, dès lors qu'ils ont une certaine importance, pèsent dans la vie politique nationale. Enfin, chacun sait que nos sénateurs sont élus par les élus municipaux.
Vous avez rappelé la Constitution de 1793. Elle a condensé les bergeries les plus utopiques avec les massacres les plus sanglants, et pensait imposer à l'Europe sa conception universaliste avant que celle-ci ne rejette la France et ses valeurs… (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

C'est vrai, on peut penser à une citoyenneté du monde qui est une idée généreuse. Toutefois, il convient de ne pas mettre la charrue avant les boeufs. Le vote des ressortissants européens lors des élections municipales traduit l'existence d'une citoyenneté européenne dans le cadre de la construction de l'Europe. La mondialisation de l'économie et l'élargissement des marchés, la circulation des hommes et des marchandises, ne créent pas une conscience collective, un sentiment d'appartenir à une communauté de citoyens. Alors qu'il est déjà bien difficile d'établir une telle communauté au niveau de l'Europe, il serait absurde et contre-productif de l'étendre au monde.
Aux élus de gauche qui défendent cette conception hyperlibérale et mondialiste d'une foule d'individus se promenant dans le monde entier et acquérant au fil de leurs passages telle ou telle citoyenneté, je voudrais opposer les phrases de ce grand républicain qu'était Jaurès (Exclamations sur les bancs du groupe SRC) : « La nation, c'est le seul bien des pauvres. » Sachez défendre ce bien des pauvres ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues : « Un Maghrébin qui parle notre langue, paie des impôts et a construit des choses en France n'a pas le droit d'élire son maire, mais un Italien qui travaille dans une grande entreprise, lui, en a le droit ». Ce constat plein de bon sens n'est pas le mien, bien que je le partage. Il s'agit, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, d'une citation de Jean Sarkozy tirée d'une interview donnée à un hebdomadaire.

Cette prise de position n'est pas unique dans la majorité. Jean-Louis Borloo, Yves Jégo, Nicolas Sarkozy, Françoise de Panafieu, et j'en oublie,...

..ont déjà eu l'occasion de se prononcer en faveur du droit de vote des étrangers aux élections locales. Pourquoi tant de déclarations à l'extérieur alors que nous entendons le contraire ici ? Des paroles, mais aucun acte ensuite. Pourquoi cette absence de « parler vrai », pour reprendre un vieux slogan ?
Notre pays s'est plié très tardivement aux standards internationaux en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère politique. La diversité dans la représentation reste bien souvent un voeu pieux.
En ce qui concerne l'intégration des ressortissants étrangers à la vie démocratique, nous avons pris un retard considérable. La convention du Conseil de l'Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local a dix-huit ans. Le Parlement européen a recommandé à la France de la signer et de la ratifier il y maintenant sept ans. Le gouvernement grec, malgré la situation à laquelle il est confronté, a déposé un projet de loi prévoyant d'autoriser le vote des étrangers résidant sur son territoire.
Accorder le droit de vote aux étrangers, c'est pour nous, comme pour les personnalités que j'ai citées au début de mon intervention et qui font partie de votre majorité,...

..le moyen de répondre aux aspirations de la société française. Les études d'opinion démontrent que nos concitoyens sont devenus favorables à un tel progrès.
En avril 1994, seuls 32 % des Français étaient favorables à l'extension du droit de vote pour les élections municipales et européennes aux résidants étrangers non membres de l'Union Européenne vivant en France. En janvier 2010, ce sont plus de 55 % de nos concitoyens qui souhaitent accorder ce droit de vote aux résidents étrangers pour les élections locales.

Les dispositions prévues dans cette proposition de loi constituent aussi une piste à explorer pour lutter contre un phénomène dont nous avons pu, à nouveau, mesurer l'importance aux dernières élections régionales : l'abstention, notamment dans les bureaux de vote des quartiers populaires, et en particulier dans ceux où la proportion d'étrangers est importante. L'excellent rapport de Mme Mazetier rappelle le rôle joué par la famille dans l'inculcation de comportements politiques. L'intégration des jeunes Français d'origine étrangère passe aussi par celle de leurs parents. Dans cette optique, le Conseil de Paris a décidé la naissance de l'Assemblée des citoyens parisiens extracommunautaires, qui succède au Conseil de la citoyenneté des Parisiens non communautaires. Cette assemblée pourra formuler des avis, proposer des voeux au Conseil de Paris et remettre un rapport annuel au maire de Paris. Cette expérience locale, aussi louable soit-elle, ne suffit malheureusement pas, et c'est pourquoi la ville de Paris s'est aussi prononcée depuis longtemps, que ce soit par des voeux ou par des « votations citoyennes », en faveur du droit de vote des étrangers aux élections locales.
En résumé, le droit de vote des étrangers aux élections locales est soutenu par des personnalités de droite comme de gauche et a déjà fait l'objet d'un vote positif, ici même, y compris de la part de membres de l'actuelle UMP.

La majorité de nos concitoyens y est favorable. C'est devenu l'un des critères d'appréciation de la vitalité démocratique d'un pays, en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud et même en Asie. Dans ces conditions, vous comprendrez que je soutienne pleinement cette proposition de loi et que je conserve encore l'espoir de voir certains membres de la majorité rester fidèles à leurs convictions en joignant leurs voix aux nôtres.

Si nous restons fidèles à nos convictions, nous ne voterons jamais pour !

Nous avons déjà pu observer un tel consensus, aussi rare que bienvenu, lors de l'examen de la récente proposition de loi sur les violences faites aux femmes.

N'espérez pas de la majorité une trahison nationale ! On laisse ça à la gauche !

En conclusion, je citerai la jeune écrivaine Joy Sorman qui a publié aujourd'hui un texte sur ce sujet : « Je vis là, j'habite et même je travaille, je suis femme de ménage et je ramasse vos ordures, je suis ouvrier sur les chantiers et je construis vos maisons, je suis issu de vos anciennes colonies, c'est ici chez moi et je suis un usager de la cité, j'ai donc absolument le droit de voter. » (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, qui peut avoir le droit de vote ?

Que représente le fait de voter ?
Je pense qu'il n'est pas inutile de se poser la question des droits et devoirs en matière de vote, expression même de la démocratie, au sortir d'un scrutin marqué par un aussi fort abstentionnisme.
Je rappelle tout d'abord qu'il s'agit, par cette proposition de loi, de permettre à des étrangers non communautaires, vivant en France de manière continue, de pouvoir voter aux élections municipales et non aux élections nationales, ce qui est effectivement une autre question.
La question de fond qu'il nous faut tout d'abord poser est la suivante : faut-il être citoyen de nationalité française pour avoir le droit de voter en France ? Ou la citoyenneté, qui donne ce droit, peut-elle être attachée à d'autres critères, à d'autres valeurs que le seul fait d'être français ?
Cela ne fait pas si longtemps que les femmes ont le droit de vote en France. Avant 1945, elles étaient exclues du monde des citoyens dignes de prendre part au choix de ceux qui pourraient administrer la cité. Et puis, fort heureusement, même si ce fut très tardivement, les femmes ont obtenu le droit de vote, ce qui prouve qu'il est toujours possible de faire évoluer le droit sans commettre un sacrilège républicain. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Alors, pourquoi pas à d'autres personnes, tout aussi dignes de confiance républicaine, que le sont les femmes françaises ?
Je rappellerai que les étrangers ressortissants de pays de l'Union européenne ont déjà le droit de voter aux élections municipales et que de nombreux pays d'Europe, en avance en matière de démocratie, ont ouvert le droit de vote aux élections locales aux étrangers hors Union européenne – sous certaines conditions, bien entendu.
La « votation », comme disent nos amis Canadiens, est un acte de responsabilité, d'engagement et d'adhésion à la société. Mais c'est avant tout un droit et un devoir : un droit, qui reconnaît le statut de citoyen de celui qui vote ; un devoir vis-à-vis de la société dans laquelle nous vivons qui prouve que l'on ne se désintéresse pas de son organisation ; une responsabilité par le choix de son vote ; une adhésion aux valeurs de la République ; enfin, le respect de celles-ci.
Chaque personne qui vit sur notre territoire profite de ce que la société apporte à la communauté : les routes, les transports, les hôpitaux, les écoles, la sécurité, etc. En retour, par son vote, elle se doit de soutenir ou d'encourager les élus de son choix, amenés à administrer la collectivité.
Si cette personne paie des impôts, il est alors encore plus logique qu'elle ait en contrepartie le droit de donner son avis sur la manière dont sa contribution sera utilisée.

Quelle différence y a-t-il entre un Roumain, un Vietnamien, un Letton, un Canadien vivant en France depuis plusieurs années et parfaitement intégré ? Le premier et le troisième ont le droit de voter aux élections municipales, tandis que le second et le quatrième ne l'ont pas.

Mais s'ils étaient tous installés en Italie, au Danemark ou aux Pays-Bas, il n'y aurait aucune différence entre eux. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
En ce qui concerne la qualité de citoyen qui serait inhérente à la nationalité française, nous avons tous des exemples du contraire, c'est-à-dire des exemples de personnes françaises qui ont un comportement bien moins civique que des personnes étrangères.

Inversement, nous connaissons tous des personnes étrangères qui ont un comportement admirable,...

Ce n'est pas parce que les Français ne votent pas qu'il faut faire voter les étrangers !

..qui ont parfois reçu des décorations françaises, mais qui sont privées du droit de vote, parce qu'étrangères.

Par ailleurs, à ceux qui m'opposeraient l'argument selon lequel les personnes qui veulent voter n'ont qu'à demander la nationalité française, je demande de regarder ce qu'il se passe aujourd'hui dans les préfectures.

Dans ces cas-là, mes chers collègues, je vous demande de me soutenir lorsque je fais valoir des dossiers de personnes étrangères parfaitement intégrées dans notre pays qui ne demandent qu'à devenir françaises et qui ne le peuvent pas en raison de lourdeurs administratives. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Quant à l'argument de la réciprocité, il est une insulte aux réfugiés politiques vivant sur notre sol. Il est inutile, je pense, de développer davantage. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Pour toutes ces raisons, mais il y en a d'autres, je suis favorable à l'ouverture du droit de vote aux élections municipales aux étrangers hors communauté européenne, sous certaines conditions évidemment.
Je regrette cependant…

…qu'une loi aussi importante n'ait pu faire l'objet d'un grand débat, pas seulement parlementaire, mais aussi avec des étrangers qui auraient pu donner leur opinion et apporter des argumentaires…

..de pays où le droit de vote est ouvert aux étrangers non communautaires et qui nous auraient fait part de leur expérience. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Ce n'est pas à vous, madame, de décider du temps dont vous disposez.
La parole est à M. Daniel Goldberg.

Pourquoi revenons-nous à ce débat ? Une proposition de loi avait été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, le 3 mai 2000. Aujourd'hui, à écouter les interventions de nos collègues de la majorité – hormis Mme Hostalier dont le point de vue est proche du nôtre –, nous constatons un profond décalage avec ce que nous pouvons entendre à la télévision ou à la radio ou avec ce que nous pouvons lire dans les journaux. Aussi avons-nous voulu crever un abcès : il apparaît à présent clairement – reconnaissons au passage à M. Vanneste que la position qu'il vient de défendre fut toujours la sienne – que vous êtes viscéralement opposés au droit de vote et d'éligibilité des étrangers aux élections locales et que les déclarations de Nicolas Sarkozy, faites à un moment où il était de bon ton de parler en termes de « triangulation », c'est-à-dire d'aller chercher sur les valeurs de la gauche les moyens de recevoir une partie du pactole électoral,…

…appartiennent à un temps révolu.
J'ai bien écouté vos arguments, notamment ceux tenant à l'association ou à la dissociation entre nationalité et citoyenneté, mais, reconnaissons-le, depuis que les étrangers européens votent aux élections municipales, tout un pan de votre discours tombe.

La citoyenneté européenne, mes chers collègues, pourrait s'exprimer au niveau des élections européennes, mais en quoi vaut-elle pour choisir son maire ?

Monsieur Vanneste, nous vous avons suffisamment entendu tout à l'heure. Vous n'êtes pas le seul ici à réfléchir, bien heureusement. (Sourires.)
En mettant en avant la notion de citoyenneté européenne pour refuser aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne le droit de vote aux élections locales alors même que cette notion fait tomber l'obstacle du lien entre citoyenneté et nationalité, vous créez dans ce pays deux sortes d'étrangers, de la même manière qu'à l'époque de l'empire colonial coexistaient deux sortes de Français, ceux qui pouvaient voter et ceux qui ne le pouvaient pas.
J'ai par ailleurs entendu dire que, pour voter, il fallait maîtriser notre langue.

Que ne proposez-vous donc, monsieur Vanneste, un concours de français à l'entrée des isoloirs pour déterminer si les citoyens français maîtrisent ou non notre langue ! Suivez-le, chers collègues de la majorité !
Allons même plus loin ! Revenons sur le droit d'association reconnu en 1981, sur les droits syndicaux, sur le droit de vote aux élections prud'homales, sur le droit d'élire les représentants des parents d'élèves dans les conseils d'école, au nom de la sacro-sainte – mais elle l'est aussi pour moi – citoyenneté française.
Mme Hostalier l'a dit, les procédures de naturalisation sont longues, compliquées et restrictives. Monsieur le secrétaire d'État, il y a quelques mois, alors que vous étiez au banc du Gouvernement pour discuter d'un texte qui, lui non plus, ne correspondait pas totalement à votre champ ministériel, nous avions eu un débat sur le délit de solidarité. J'avais alors dénoncé les restrictions à l'acquisition de la nationalité française par une femme en situation régulière qui aurait hébergé son conjoint ou le père de ses enfants. Vous m'aviez promis, suite à l'un de mes amendements, que la situation serait réglée. Ce n'est hélas toujours pas le cas !
Et que dire des grandes phrases que nous avons entendues ! La République serait en danger ! Vous en appelleriez presque à Valmy, monsieur Vanneste, si nous n'étions autant qualifiés que vous à en porter les valeurs. Rappelons-le : nous ne parlons que des élections municipales.
Monsieur Vanneste, vous avez dit en commission des lois qu'est citoyen celui qui en a les droits parce qu'il le veut et parce qu'il le mérite. Vous êtes convaincu, et c'est sans doute ce qui ressortira de nos débats, qu'il faut mériter le droit, non seulement d'être français, mais surtout de choisir son maire. Nous n'avons pas la même conception de ce que l'on appelle la méritocratie.

…c'est l'histoire de la Révolution française, que nous portons autant que vous.

L'histoire de la France, c'est aussi l'histoire de son empire colonial, notamment celle de sa présence durant cent trente-deux ans en Algérie. Quand on est issu de cet empire colonial, quand on est né dans ce qui était alors la France,…

…lorsque l'on a combattu dans les rangs de l'armée française, lorsque l'on a conquis son indépendance, lorsque l'on a travaillé dans les usines en France après l'indépendance,…

Et que l'on a dû fuir les massacres comme l'ont fait les harkis qui, eux, sont Français !

…lorsque l'on a des enfants et des petits-enfants qui sont français et ne demandent qu'à voter, je pense que le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales devrait être accordé unanimement par notre Assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Permettez-moi d'introduire mon propos par deux rappels. M. Pupponi le disait ce matin, notre débat concerne prioritairement deux millions de personnes que nous aimerions pouvoir appeler nos concitoyens. Deux millions de personnes qui participent à la vie économique, sociale, associative, mais qui sont exclues de la vie élective. Avec la proposition que défend Sandrine Mazetier aujourd'hui, nous voulons avancer vers davantage d'égalité pour ces deux millions de personnes.
Rappelons encore que ce débat concerne un élément essentiel du pacte républicain, l'exercice de la citoyenneté, mais qu'il touche aussi aux limites de l'hypocrisie de notre système puisqu'en matière prud'homale, au sein des conseils d'entreprise ou des caisses de sécurité sociale, les étrangers non ressortissants de l'Union européenne peuvent désigner leurs représentants. Le seul champ d'expression dont ils demeurent exclus est le champ électoral. Cette proposition nous permettrait de faire un premier pas vers une vraie représentativité et une vraie dignité pour ces personnes qui vivent et travaillent dans notre pays.
À l'issue de cette discussion générale, nous pouvons distinguer trois enjeux qui sont autant de questions au Gouvernement et à sa majorité.
Le premier est celui de la représentation. Nous proposons que les assemblées municipales ressemblent enfin à la population que les élus municipaux administrent et qu'ils servent au quotidien. Comment expliquer à des familles entières qui habitent des quartiers où la majeure partie de la population est privée de ce droit essentiel, qu'il faut aller voter pour des conseils municipaux qui ne représentent pas, parce qu'ils ne leur ressemblent pas, les quartiers et les villes où elles habitent ?
Le deuxième enjeu est celui de l'égalité, avec notre volonté de faire un pas vers une reconnaissance de ces ressortissants non communautaires, vers davantage de citoyenneté, vers la possibilité de leur faire bénéficier des mêmes droits que nos concitoyens puisque, depuis bien longtemps, ils sont soumis aux mêmes devoirs : ils paient des impôts, ils travaillent, ils contribuent à la vie économique et à la richesse de notre pays. Pourquoi seraient-ils privés d'une première expression ? Je parle bien d'une première expression car ce texte, tel qu'il avait été adopté en 2000 par notre Assemblée, concerne les seules élections municipales.
Enfin, on parle beaucoup d'une véritable résurgence du communautarisme : communautarisme religieux, communautarisme fondé sur l'origine. Quelle meilleure réponse que celle d'un premier pas vers la citoyenneté ? Ces communautés n'ont pas aujourd'hui, dans nos villes, de lien représentatif avec ceux qui les administrent, en dehors d'un lien de nature transactionnelle avec le maire ou le conseil municipal, prenant la forme d'un échange entre les représentants de ces communautés et les élus qui, eux, représentent toute la ville.
En ouvrant le droit de vote aux élections municipales à l'ensemble des étrangers, nous permettrions à toutes ces personnes d'appartenir à la seule communauté que nous reconnaissons, la République, fondée sur la citoyenneté.
Nous devons avoir en tête que la meilleure manière de rétablir l'égalité et d'intégrer l'ensemble de la population d'une ville à la vie municipale est de leur reconnaître la même identité que l'ensemble de ceux et celles qui, aujourd'hui, peuvent participer à l'élection de leurs représentants.
Nous avons cette occasion. En 2000, notre Assemblée avait adopté un texte identique, prévoyant les mêmes dispositions. Le temps a manqué, ainsi que la majorité politique au Sénat, pour que nous puissions accorder le droit de vote aux élections municipales à l'ensemble des personnes qui vivent dans notre pays. Bien évidemment, nous devrons poser des conditions, mais celles-ci peuvent être discutées.
Il est d'usage ces derniers temps, surtout depuis une semaine, de parler de « retour aux fondamentaux ». Pour notre part, nous connaissons les nôtres et nous n'en varions pas : ils reposent sur l'égalité. Avec cette proposition que le groupe socialiste soutiendra, nous faisons un premier pas vers davantage d'égalité. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Le moins que l'on puisse dire est que ce texte n'arrive pas au bon moment. C'est vrai, la proposition d'accorder le droit de vote aux municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne a été avancée à plusieurs reprises et interpelle toutes les sensibilités politiques, de droite comme de gauche. Mais aujourd'hui, trois jours après des élections où un Français sur deux n'est pas allé voter et où près de 20 % de nos concitoyens, dans certaines régions, ont voté pour des partis extrêmes, croyez-vous que la symbolique du droit de vote des étrangers arrive à propos ? Il me semble au contraire que vous risquez de provoquer l'effet inverse de celui escompté.
Les divers pays européens ont réglementé le droit de vote de manière très différente. Dans certains d'entre eux, comme la Suède, le droit de vote est accordé aux étrangers non communautaires, mais il y est très difficile d'acquérir la nationalité. D'autres, telle l'Espagne, ont choisi de faire prévaloir le principe de réciprocité.
La France, quant à elle, a opté pour un système fondé sur par la nationalité. Chaque année, 120 000 personnes deviennent françaises, et l'on considère que devenir français est un geste volontaire qui donne des droits mais impose également des devoirs.
Ce lien entre droits et devoirs est essentiel. Il sous-tend la logique selon laquelle celui qui acquiert la nationalité – et je rappelle qu'ils sont 120 000 par an – acquiert ipso facto le droit de vote.
Ce système a été choisi et il faut continuer de le défendre. Peut-être un jour évoluera-t-il – nous nous sentons tous citoyens du monde…

…même si, hélas, trop peu nombreux sont ceux qui se sentent citoyens européens.
Avec les citoyens ressortissants de l'Union, les règles sont claires et reposent sur le principe de réciprocité. Nul ne peut discuter le fait qu'un Européen s'exprime dans son pays d'origine à l'occasion d'élections locales et s'exprime ensuite lors des élections européennes.
Pourquoi donc, alors qu'on donne à des étrangers extracommunautaires la possibilité d'acquérir la nationalité française, leur donner le droit de vote aux élections municipales sous prétexte qu'ils vivent et travaillent sur notre sol ?
Votre proposition n'a pas le poids symbolique de notre conception de la nationalité. Être français, c'est accepter le principe d'une communauté de valeurs, un même mode de vie, le partage des mêmes droits et le respect des mêmes devoirs. Voilà qui est plus fort que l'octroi du droit de vote au simple motif qu'on réside sur le territoire national.
Je vois dans cette proposition de loi – n'y décelez aucune mauvaise intention de ma part – un calcul politique. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Ce calcul va à l'encontre du message qui nous a été donné dimanche dernier. Notre priorité ne doit pas être de donner le droit de vote aux étrangers extracommunautaires aux élections locales, mais de faire en sorte que les Français qui ont ce droit se sentent concernés par l'élection,…

…s'éloignent des votes extrêmes et votent pour ceux qui sont capables de diriger le pays. Il s'agit de faire en sorte qu'on soit fiers d'être français ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Je tiens à remercier l'ensemble des orateurs : nous n'avions pas été habitués, à l'occasion de la discussion de propositions de loi de l'opposition, à entendre autant d'interventions. Je félicite en particulier les députés de la majorité qui ont tenu à développer leurs arguments.
De nombreux orateurs de l'UMP ont prétendu que la citoyenneté de résidence que nous appelons de nos voeux ressortissait à une vision mondialisée, voire, selon certains, consumériste, de la citoyenneté – il y a une certaine ironie à voir le père de la loi autorisant le travail dominical nous reprocher de favoriser le consumérisme électoral…
Au contraire, à travers l'idée de citoyenneté de résidence, nous entendons prendre en considération l'ancrage local de populations qui vivent depuis longtemps dans nos communes et qui ne font pas partie, mes chers collègues, des « élites mondialisées » que vous stigmatisez. Nos voisins de palier, les parents des camarades de classe de nos enfants, nos collègues de travail vivent dans nos quartiers et n'ont, j'y insiste, rien à voir avec les « élites mondialisées ».
En revanche, il ne vous choque nullement qu'un propriétaire d'une résidence secondaire qui n'y passe que peu de temps et ne s'investit donc pas dans la vie de la commune, puisse participer aux élections municipales et se comporter, pour le coup, en consommateur – là réside sans doute la citoyenneté consumériste que vous dénoncez.
De nombreux membres du groupe SRC sont revenus sur la question de la réciprocité. Le droit de vote, la citoyenneté, la démocratie ne sont pas des questions qui se traitent de la même manière que des traités de commerce ou que la taxe carbone. Le rôle historique, la mission éternelle – du moins je l'espère – de la France n'est pas d'attendre que les autres bougent pour bouger, mais de proposer un projet au monde. Telle est la vision de la France que partagent les députés de gauche.
Monsieur Garraud, vous considérez que donner aux étrangers extracommunautaires le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales sans qu'ils puissent toutefois devenir maires, reviendrait à les ravaler au rang de citoyens de seconde zone. Outre que rien ne lui interdisait d'amender le texte pour y remédier, croit-il vraiment qu'un ressortissant européen, aujourd'hui éligible en tant que conseiller municipal sans pouvoir devenir maire, soit un citoyen de seconde zone ?

Croyez-vous qu'il ne puisse participer valablement et utilement au débat politique local comme national ?

Je vais vous citer un exemple, puisque je citais de Gaulle dans mon intervention ce matin.

Il s'agit d'un exemple des plus actuels : Daniel Cohn-Bendit. Croyez-vous vraiment que Daniel Cohn-Bendit soit un citoyen de seconde zone et que ses interventions ne contribuent pas puissamment à animer le débat politique ?

Souligner que votre proposition crée des citoyens de seconde zone n'est pas un jugement de valeur mais un fait !

Et je n'ai pas connaissance que « Dany » Cohn-Bendit se considère lui-même comme un citoyen de seconde zone !
Laissez-moi rendre hommage à la courageuse intervention de Françoise Hostalier, qui a rappelé toutes les difficultés rencontrées par les candidats à la naturalisation. Je vais tâcher de dissiper vos inquiétudes en ce qui concerne le modèle français. Certains pays n'accordent la nationalité qu'en fonction du droit du sang et autorisent donc plus facilement le droit de vote des étrangers aux élections communales, d'autres ont une pratique inverse. Cela a-t-il à voir avec le développement du communautarisme ? Très franchement : non. Le modèle choisi par les États-Unis est fortement assimilationniste. Quand on entre régulièrement aux États-Unis, on a vocation à devenir citoyen américain. Les États-Unis « fabriquent » du citoyen américain. En revanche, la société américaine, comme de nombreuses sociétés anglo-saxonnes, sont structurées par les communautarismes.

Il n'y a donc pas forcément de lien entre le droit de vote aux élections locales, la capacité à naturaliser et le développement du communautarisme. Le modèle français ne repose pas sur un communautarisme que la République réprouve.
C'est précisément pour combattre ces tentations qui travaillent toutes les sociétés occidentales que nous proposons d'accorder le droit de vote aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne.
M. Vanneste a fourni un bel effort pour tenter de dénoncer, par des références historiques, des citations – de Benjamin Constant notamment – notre conception qu'il juge ultra-libérale, digne d'« élites mondialisées ». Il nous semble qu'il défend là une conception patrimoniale, passive de la citoyenneté, selon laquelle celle-ci ne ferait que s'hériter au lieu de s'obtenir par l'activité, la présence, l'investissement.
Nous avons, nous, une conception active, dynamique de la citoyenneté alors que certains d'entre-vous en promeuvent encore, malheureusement, j'y insiste, une idée passive, patrimoniale.

Il s'agit d'un beau débat, qui mérite d'être mené, et je vous remercie d'y avoir participé. Nous tenterons à nouveau de vous convaincre.

Nous espérons en tout cas avoir convaincu certains d'entre vous aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Nous avons eu des échanges de qualité sur une question importante.
Vous avez eu raison de souligner, monsieur Garraud, que le fait de ne pas être favorable à l'octroi du droit de vote municipal aux étrangers extracommunautaires n'était en rien l'indice d'une quelconque volonté de les stigmatiser. Je rappellerai à mon tour que la France reste parmi les premiers pays d'immigration en Europe. C'est dans cet esprit que, plus que dans d'autres pays européens et malgré des difficultés évoquées par certains orateurs, la France offre largement la possibilité d'acquérir la nationalité.
M. Pupponi, à l'instar de ses collègues, a établi des comparaisons avec d'autres pays européens. Je rappelle que de grands pays démocratiques proches de nous, comme l'Allemagne et l'Italie, ne donnent pas le droit de vote aux étrangers. En outre, la législation de certains États en matière d'acquisition de la nationalité est bien plus restrictive que la nôtre, ce pourquoi ils accordent plus volontiers de droit de vote des étrangers aux élections locales. Comparaison n'est donc pas raison.
Nous partageons le regret de M. Cochet. Reste que notre conception ne constitue en rien un obstacle à la participation des étrangers non communautaires à la vie économique et sociale de la France. On ne peut pas, en matière d'intégration, tout relier au droit de vote aux élections municipales. On le constate tous les jours sur le terrain, et certains ont décidé de ne pas faire ce choix pour des raisons qui leur sont propres et qui sont respectables.
L'intervention de M. Siffredi a mis en lumière le rôle essentiel de la naturalisation. La France offre largement cette possibilité. Il s'agit d'un acte important de la part de ceux qui souhaitent rejoindre la communauté nationale. Nous avons raison de l'encourager sans le banaliser. S'il y a ici ou là des difficultés administratives qui ne se justifient pas, nous devons y remédier.
Mme Pau-Langevin s'est opposée à ceux qui redoutent un regain de communautarisme dans l'hypothèse de l'octroi du droit de vote local aux étrangers. Je ne porterai pas de jugement de valeur sur son intervention, de qualité comme toutes, mais je souhaite la renvoyer à celle de M. Pupponi, qui décrivait la réalité – la même que celle que je constate dans ma ville – de certaines communautés étrangères. Malgré les efforts importants de l'État en matière d'intégration, le risque du repli communautaire est réel.
Sans porter de jugement de valeur, ni parler d'effet mécanique, on ne peut pas non plus considérer que le risque n'existe pas – je suis sincèrement persuadé du contraire – que cette démarche encourage, ici ou là, une telle dérive.
M. Brard a évoqué, avec la verve qu'on lui connaît, des exemples historiques dont je voudrais lui rappeler qu'ils n'ont jamais conduit à la mise en cause du lien entre la nationalité et le droit de vote. C'est bien la preuve que, à travers tous ces moments forts de l'histoire, la communauté nationale était attachée à ce lien.
M. Mallié a rappelé, comme plusieurs autres de ses collègues, la règle de réciprocité qui s'applique au droit de vote des étrangers communautaires. Nos engagements européens placent les intéressés dans une situation particulière, qui justifie l'exception, au demeurant limitée, faite à leur bénéfice, à la règle liant droit de vote et nationalité.
Madame Dumont, il n'est pas juste de prétendre que la France nie aux étrangers résidant sur son territoire le droit d'exister. Ils bénéficient de nombreux droits, y compris constitutionnels, au même titre que les nationaux. Ils peuvent également, si tel est leur choix, rejoindre la communauté nationale. Il n'y a nulle exclusion stigmatisante. Je pense que votre propos, de ce point de vue-là en tout cas, était excessif.
M. Vanneste rappelait tout à l'heure, à juste titre, que le fait de payer des impôts ne saurait suffire à fonder la citoyenneté. Celle-ci doit rester attachée à une histoire, à une culture, à un ensemble de principes et de valeurs que l'on fait vivre en choisissant de devenir français. Certains ont évoqué le colonialisme, qui fait partie de l'histoire de notre pays. Ils ont eu raison de le faire, cela fait partie du débat. Mais cette histoire est une histoire partagée. Et lorsque quelqu'un choisit, quelle que soit son origine, de faire le pas de la naturalisation, il décide de faire un pas de plus dans cette histoire partagée, qui compte des heures très fortes, parfois très douloureuses, mais qui est notre patrimoine commun, que personne ne remet en cause.
Madame Hoffman-Rispal, vous évoquez, à mon avis à tort, l'isolement de la France en matière de vote des étrangers aux élections locales. Encore une fois, chaque pays a une tradition différente. Certains pays qui ont décidé de faire ce choix ont une conception de l'acquisition de la nationalité beaucoup plus restrictive que la nôtre.
Madame Hostalier, il y a dans notre Constitution un principe d'égalité, qui est fondamental et qui rend inacceptable que les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes, avec lesquels elles composent le peuple français, source exclusive de la souveraineté. Les étrangers sont, de ce point de vue, dans une situation différente.
Si vous avez évoqué, exemples à l'appui, un certain nombre de situations où des freins administratifs peuvent apparaître comme décourageants pour les candidats à la naturalisation, je pense que notre devoir, que ce soit au niveau des administrations centrales, des responsables politiques, ou au niveau local, est de pointer ces difficultés et de les surmonter. Je ne nie pas une réalité que nous connaissons tous, puisque nous sommes tous confrontés à des freins administratifs, dans ce domaine comme dans d'autres. Mais personne ne peut nier non plus, car nous connaissons les chiffres de 2008 et de 2009, l'importance de l'exercice, en France, du droit à la naturalisation. Nous organisons tous, dans nos communes, et il est bon qu'il en soit ainsi, des réceptions qui réunissent maintenant très régulièrement des dizaines, voire des centaines de personnes nouvellement naturalisées. Il faut vivre ces cérémonies pour mesurer la diversité de ces personnes, leur état d'esprit, leur aspiration, leur fierté. Et là, nous nous rendons compte que la naturalisation n'est pas une démarche marginale ou automatique. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Plus encore en France qu'ailleurs, c'est une réelle possibilité. Et nous devons la parfaire, j'en suis d'accord avec vous.
Monsieur Goldberg, croyez bien qu'il n'est nullement question, pour quiconque, de remettre en cause le droit qu'ont les étrangers de participer aux élections professionnelles ou sociales. Le Gouvernement ne dit pas non plus qu'il faille mériter le droit de vote.
Il dit simplement qu'il faut le vouloir. On est libre de ne pas le vouloir. Vous avez souligné, avec d'autres, que, quand on est étranger, on a déjà un certain nombre de droits en matière sociale. Ce fait montre bien l'état d'esprit qui est le nôtre, en France, par rapport aux personnes étrangères qui vivent, qui travaillent, qui s'intègrent dans notre pays. Mais on peut avoir des droits en dehors du droit de vote. Qu'il y ait une gradation, une hiérarchie entre les droits dont disposent les personnes qui vivent dans notre pays, ce n'est pas quelque chose qu'il faut caricaturer.

Il y a une hiérarchie à l'intérieur d'une même catégorie de personnes. C'est cela qui est grave !
Monsieur Dussopt, les éléments que vous avez rappelés montrent justement que notre pays est particulièrement ouvert à la possibilité pour les étrangers d'y trouver leur place.
Vous avez fait référence aux conseils municipaux. De plus en plus, la composition de ceux-ci, justement grâce à la multiplication des naturalisations, reflète la diversité de la population des communes, notamment dans celles où se côtoient des personnes de toutes origines et de tous continents.
Monsieur Domergue, vous avez rappelé, vous aussi, le nombre important de naturalisations, et cette faculté ouverte à tous ceux qui veulent devenir français est précisément ce qui justifie le maintien du lien entre nationalité et droit de vote. C'est aussi pour cette raison qu'il n'y a aucune exclusion, aucune stigmatisation.
Mesdames, messieurs les députés, sur un sujet comme celui-ci, tous les points de vue peuvent se défendre, et il ne s'agit pas de caricaturer la position des uns et des autres. Cela étant, le risque, au fond, c'est peut-être la confusion, et ce alors que la cohésion nationale et la cohésion sociale, auxquelles nous sommes tous attachés, supposent la clarté des règles du jeu.
Monsieur le président, en application de l'article 96 du règlement de l'Assemblée nationale, le Gouvernement demande la réserve des votes des articles et des amendements de la présente proposition de loi.

J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi constitutionnelle dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n'a pas adopté de texte.

La parole est à Mme Danièle Hoffman-Rispal, inscrite sur l'article 1er.

Je voudrais revenir un instant sur les arguments qui nous ont été opposés par nos collègues de la majorité, s'agissant de cet article 1er, lors de la discussion générale. On nous a dit : 120 000 naturalisations en France ; tout est simple, tout est facile ; droits, devoirs ; demandez donc à ces gens, s'ils veulent voter, de demander plutôt leur naturalisation.
Sauf que c'est un tout petit plus compliqué que cela. Il y a des gens qui sont en France depuis très longtemps, mais qui n'ont pas souhaité demander leur naturalisation parce que leurs pays d'origine, souvent nos anciennes colonies, refusent la double nationalité. Et perdre sa nationalité d'origine, c'est parfois très difficile. C'est comme perdre ses parents. C'est perdre quelque chose de soi.
Leurs enfants, leurs petits-enfants, souhaiteraient parfois demander leur naturalisation. Mais c'est un choix si cornélien que, souvent, ils ne le font pas.
Il me semble que nous devons prendre en considération cet argument, car le droit de voter aux élections municipales leur permettrait peut-être de sortir de ce dilemme.
Deuxièmement, si on nous a parlé de 120 000 naturalisations, on ne nous a pas parlé des refus, dont je ne connais pas le nombre. Vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d'État, les démarches auxquelles nous sommes, les uns et les autres, confrontés : des délais pouvant atteindre quinze ou dix-huit ans, des pertes de papiers difficilement obtenus dans les pays d'origine.
Je conclurai en citant l'exemple d'un vieux monsieur arrivé en France en 1942, mort en 1994. Il avait un fort accent. En cinquante-deux ans, on ne lui a jamais accordé la nationalité française. Il est mort apatride et ses derniers mots ont été pour me dire : « Comme j'aurais aimé voter ! »

Je suis saisi d'un amendement n° 1 .
La parole est à M. Olivier Dussopt.

Il faut souligner que cette proposition de loi a été rédigée dans un esprit de consensus, puisqu'elle reprenait uniquement une disposition relative aux élections municipales adoptée en 2000 par notre assemblée. Malheureusement, nous subodorons que le Gouvernement et la majorité n'auront pas laissé les esprits évoluer suffisamment pour accepter notre texte, ce qui nous étonne particulièrement de la part de M. le secrétaire d'État.
L'amendement propose d'aller plus loin, et répond à l'argument selon lequel la proposition aboutirait à créer des citoyens de seconde zone, qui ne pourraient voter qu'aux élections municipales. À ceux de nos collègues qui nous ont reproché de ne pas aller assez loin, nous proposons que tous les ressortissants étrangers puissent avoir le droit de vote à toutes les élections locales, et pas seulement municipales.

Mes chers collègues du groupe socialiste, je suis vraiment désolée. Autant j'étais favorable au texte de loi initial que vous avez déposé, et je crois l'avoir dit assez fortement, autant je ne peux pas être favorable à cet amendement, qui ne se situe pas dans le même registre. Il élargit le droit de vote des étrangers aux élections cantonales et régionales, et peut-être prochainement territoriales. Or, ceux qui sont élus à l'occasion de ces élections sont ce qu'on appelle des grands électeurs, c'est-à-dire qu'ils élisent les sénateurs, lesquels sont des parlementaires qui font la loi, qui contrôlent, et éventuellement sanctionnent, le Gouvernement. Ce n'est donc plus la même catégorie d'élections. Il ne faut pas brûler les étapes, et je ne suis pas favorable à cet amendement.

Sur l'article 2, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Je rappelle que les votes sont réservés.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Monsieur le président, en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble des articles du projet de loi, à l'exclusion de tous les amendements.

Il me semble que la demande que vient de faire M. le secrétaire d'État aurait dû être formulée avant la fin de la discussion générale. Je voudrais que l'on vérifie ce point précis de notre règlement.
En outre, j'avoue ne pas comprendre que le Gouvernement adopte une attitude différente sur le texte relatif à la garde à vue, qui a été examiné ce matin, et sur celui relatif au droit de vote des étrangers. S'agissant de la garde à vue, le vote a eu lieu article par article. Cet après-midi, il en va autrement. Faut-il comprendre que la conception que le Gouvernement a de l'application du règlement de l'Assemblée nationale varie selon le sujet abordé, voire – pardonnez-moi de le dire, madame Hostalier – selon que sa majorité est soudée, comme elle l'était ce matin, ou selon qu'elle l'est moins ? Il est pour le moins surprenant que la procédure assez classique qui a été suivie pour le texte relatif à la garde à vue, et qui consiste à discuter des articles tout en reportant à mardi prochain le vote sur l'ensemble, ne soit pas retenue pour le présent texte. Le déjeuner a peut-être porté mauvais conseil, car le Gouvernement en revient à une conception fermée du débat parlementaire, que nous avions cru dépassée depuis ce matin.

J'ai bien indiqué, après l'intervention de M. le secrétaire d'État, que la réserve était de droit.
Nous avons achevé l'examen des articles de la proposition de loi constitutionnelle.
Je rappelle que la Conférence des Présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble auront lieu le mardi 30 mars après les questions au Gouvernement.
Rappel au règlement

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt.)

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de M. Gaëtan Gorce et plusieurs de ses collègues sur la situation de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh disparu à N'Djamena, capitale du Tchad, le 3 février 2008 (n° 2291).
La parole est à M. Gaëtan Gorce, auteur de la proposition de résolution.

Pourquoi, monsieur le président, monsieur le ministre des affaires étrangères, mes chers collègues, sommes-nous ici, sinon pour que justice soit rendue à un homme, Ibni Oumar Mahamat Saleh, disparu le 3 février 2008 et dont nous sommes sans nouvelle depuis ?
On me dira peut-être que la vie d'un homme pèse bien peu dans un monde, sur un continent, dans une région, dans un pays où des centaines, des milliers de femmes et d'hommes voient chaque jour leur vie menacée. Sans doute aura-t-on raison au regard de l'éternité : la vie d'un homme pèse bien peu. Mais la vie d'un homme au regard des principes de justice pèse énormément. Nous avons par conséquent le devoir absolu de rendre la justice à Ibni Oumar Mahamat Saleh et à sa famille.
Ce faisant, nous n'agissons pas pour un seul homme. Nous agissons au nom d'un principe qui s'applique à toutes celles et tous ceux qui sont victimes de l'arbitraire et de ses habituels complices : le cynisme, l'indifférence, le mensonge, le silence. C'est bien cette conspiration du silence qu'il nous a fallu, progressivement, briser, sans être sûrs d'y être tout à fait parvenus, sur le dossier d'Ibni Oumar Mahamat Saleh. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui nous aident et nous y ont aidés : sa famille évidemment, mais aussi mon collègue sénateur Jean-Pierre Sueur, les députés et les sénateurs qui ont bien voulu signer, l'an dernier, l'appel que nous avions lancé et les organisations non gouvernementales – Amnesty International, ACAT France – qui se sont mobilisées également autour de ce dossier.
Il s'agit de rendre justice à un homme et, en même temps, à tous les hommes. Lorsque l'injustice recule, ne serait-ce que d'un millimètre, c'est la liberté qui progresse, même si ce n'est que d'un millimètre.
Pourquoi sommes-nous ici, sinon pour que la vérité soit faite ? La vérité, vieille ennemie de tous les pouvoirs. Nous ne voulons pas seulement la vérité pour Ibni Oumar Mahamat Saleh : nous voulons la même vérité sur ce qui est arrivé, par exemple, à Anna Politkovskaïa en Russie, aux dizaines d'étudiants disparus en Iran à la suite de manifestations qui ont suivi les élections. Nous voulons la vérité pour tous les disparus de Colombie, du Liban, de Libye, bref, pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de trouver ailleurs que dans leur pays une voix qui rappelle ce qui leur est arrivé, leur existence et leur engagement.
Pourquoi sommes-nous ici, à la tribune de l'Assemblée nationale de la République française ? Parce qu'il s'agit de vérité et de justice, parce que ces mots sont chéris à cette tribune, mais aussi parce qu'il existe entre la France et le Tchad, à travers l'Histoire, des liens particuliers, qui font que, si l'on veut évoquer l'affaire concernant Ibni Oumar Mahamat Saleh, c'est par cette tribune que passe le message qui doit arriver au gouvernement tchadien. C'est par le gouvernement français que nous atteindrons le gouvernement tchadien. C'est parce que nous demandons ici vérité et justice que nous avons une chance de l'obtenir à N'Djamena. Nous avons au Tchad, monsieur le ministre, un engagement particulier et une responsabilité particulière. Nous y sommes profondément engagés sur le plan diplomatique et militaire et sur celui de la coopération. Nous agissons pour tenter de trouver des solutions aux questions stratégiques mais aussi politiques qui concernent ce pays.
Notre engagement sur cette question des droits de l'homme, et tout particulièrement concernant Ibni Oumar Mahamat Saleh, doit être à la hauteur des engagements et de la responsabilité qui sont les nôtres. Je vous demande, monsieur le ministre, d'être omniprésent sur ce dossier, parce que nous sommes omniprésents au Tchad sur tous les dossiers qui concernent ce pays.
Ce n'est pas le lieu – en tout cas peut-être pas encore – d'engager le procès de certaines politiques, de certaines complaisances. Je dois cependant vous avouer, moi qui ne suis spécialiste ni de l'Afrique ni du Tchad, que, lorsque j'ouvre ce dossier, lorsque j'entends ce que l'on me dit, lorsque je lis ce qui s'écrit, que je ne suis pas toujours fier de ce que je découvre. Je ne suis pas convaincu que les principes que j'exprime ici, à cette tribune soient toujours bien mis en pratique. Mais là n'est pas la question. Je m'en tiendrai aujourd'hui aux faits et aux procédures judiciaires.
Une action a été entreprise, voulue d'ailleurs par le Président de la République française, auquel nous avons écrit à plusieurs reprises, qui s'était engagé et qui a obtenu une commission d'enquête. Cette dernière, après bien des difficultés, a rendu son rapport.
Ce rapport est, à bien des égards, accablant. Accablant, naturellement, pour les forces rebelles, mais plus accablant encore pour l'armée nationale tchadienne, dont les exactions contre sa propre population civile sont soulignées et décrites. Et particulièrement accablant s'agissant du cas d'Ibni Oumar Mahamat Saleh. Il y est indiqué clairement qu'il a été arrêté par des éléments appartenant à l'armée régulière tchadienne et que, compte tenu du désordre qui régnait à N'Djamena ce dimanche 3 février 2008, les ordres d'intervention n'avaient pu provenir que de la seule cellule opérationnelle qui continuait à agir, à fonctionner, et qui était placée auprès de la Présidence de la République.
Selon les termes du rapport de la commission d'enquête, la question du rôle de la chaîne de commandement et dans celle-ci du chef de l'État tchadien doit naturellement être posée.
Tels sont les points d'appui à partir desquels le travail doit être effectué. Depuis, une enquête judiciaire a été ouverte par le gouvernement tchadien. Elle devait déboucher sur un premier procès. On nous a annoncé que les procès auraient lieu un peu plus tard que prévu, mais, normalement, au printemps prochain ou avant l'été. Ces procès concerneront des centaines de victimes : victimes de disparitions, de tortures, de viols. Il n'est que justice que ces dossiers soient évoqués.
Quelle assurance avons-nous que le cas d'Ibni Oumar Mahamat Saleh sera bien traité ? Quelle assurance avons-nous qu'il le sera dans des conditions qui garantissent l'objectivité des procédures et des décisions ?
C'est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité – et je remercie le président de la commission des affaires étrangères pour les propos qu'il a tenus lors de l'audition de l'ambassadeur de France au Tchad, qui nous a en quelque sorte promis son appui – déposer une proposition de résolution. Nous demandons, comme la commission d'enquête l'a suggéré dans sa onzième recommandation, qu'un comité de suivi soit mis en place, constitué non seulement de personnalités politiques nationales, mais aussi de représentants de la communauté internationale, à savoir un représentant de l'Union européenne, un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, un représentant de la France. Il est urgent de s'en préoccuper, il est urgent de voter cette proposition de résolution. Il est urgent, monsieur le ministre, que vous obteniez que ces nominations interviennent et que la fin de la procédure engagée puisse être suivie dans des conditions qui apportent toutes les garanties. C'est notre intérêt à tous : celui du gouvernement tchadien, celui des victimes et de leurs familles.
Nous vous demandons, monsieur le ministre, d'user de tous les moyens dont vous disposez pour obtenir ce que chacun avait accepté à l'issue des travaux de la commission d'enquête. Il sera temps ensuite de dresser un bilan lorsque nous disposerons de tous les éléments.
Justice et vérité : y a-t-il deux principes plus élémentaires ? Y a-t-il des mots plus simples sur lesquels nous mettre d'accord et recueillir l'unanimité de cette Assemblée ?
Justice et vérité, ces deux mots doivent nous préoccuper. Ils sont souvent au coeur de bien des déclarations. Nous avons aujourd'hui l'occasion de les mettre non seulement au coeur de nos déclarations, mais également de notre action concrète. À la différence d'autres pays, nous disposons des moyens et des coopérations pour les faire aboutir. C'est à cela que nous devons nous travailler. À quoi bon invoquer la vieille flamme censée brûler dans le coeur de tout Français, celle de la liberté, si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser lorsque celle-ci est menacée ? Pourquoi siéger dans cette assemblée ? Pourquoi nous référer à notre Constitution dont l'inspiration est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
Certes, nous pourrions souhaiter être beaucoup plus nombreux dans l'hémicycle pour aborder un tel problème, symbole de tant d'autres. C'est la représentation nationale tout entière qui devrait venir ici exprimer sa réprobation et sa volonté d'obtenir justice et vérité. Nous ne sommes que quelques-uns. Mais, au regard du long chemin que nous avons parcouru depuis le 3 février 2008, quelques-uns, c'est déjà beaucoup, et je les remercie de leur présence, répartie sur tous les bancs. Je les remercie d'avoir accepté de participer à cet échange et de soutenir la résolution qui vous est présentée. C'est peut-être le signe que les temps changent, notamment lorsqu'il s'agit de la « Françafrique ». Il est rare qu'un Président de la République française ne commence pas par dire, au début de son mandat, qu'il souhaite faire changer les vieilles relations entre la France et l'Afrique pour les établir sur de nouvelles bases.
Peut-être avons-nous là l'occasion de faire en sorte que les temps changent. Ces temps changeront si la volonté politique s'exprime, et nous pouvons tous sur ce dossier concret y contribuer, tout simplement parce que les principes auxquels nous sommes attachés demeureront. (Applaudissements sur tous les bancs.)

La parole est à M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes.
J'ai écouté avec attention, monsieur le député, ce que vous avez dit avec gravité sur la nécessité – au-delà du cas particulier que vous avez évoqué – de faire respecter les droits de l'homme et de défendre les libertés. Je vous remercie de cette occasion qui m'est donnée, à travers cette proposition de résolution, de réaffirmer de manière solennelle que nous croyons – comme vous – au principe de responsabilité dans l'action extérieure de la France. Ce principe guide notre action de manière constante, en particulier dans le domaine des droits de l'homme. Il l'a donc guidée tout au long de l'affaire qui nous rassemble aujourd'hui : le drame de la disparition, à ce jour non élucidée, de l'opposant tchadien Ibni Oumar Mahamat Saleh. Je souhaite revenir, après vos interventions et afin de répondre aux interrogations qu'elles contiennent, sur les aspects principaux de cette affaire. Ces éléments permettront, je l'espère, d'éclairer votre vote.
Mais auparavant, laissez-moi replacer le débat dans son contexte, qui est celui de l'action continue de la France dans la lutte contre les disparitions forcées et l'impunité. Car c'est la France qui, avec l'Argentine, porte depuis vingt ans le combat sur la scène multilatérale pour que les disparitions forcées – on en dénombre 43 000 à ma connaissance – fassent enfin l'objet de poursuites. C'est à l'action de notre diplomatie que l'on doit l'adoption d'une convention internationale qui marque un tournant dans la répression de ces crimes particulièrement odieux.
Partout, au Tchad comme ailleurs, les défenseurs des droits de l'homme connaissent le prix de nos efforts. Mais il ne suffit pas de faire adopter des textes – comme vous l'avez dit – pour changer les réalités. C'est pourquoi la lutte contre l'impunité est au coeur de notre action extérieure. La France a porté depuis l'origine l'idée d'une cour pénale internationale ; elle en finance le fonctionnement et en soutient les procédures. Que ce soit au plan local ou au plan international, la France soutiendra sans faillir l'action de ceux qui se battent pour la manifestation de la vérité et la sanction des auteurs de ces crimes.
Que cela soit bien clair : la France entretient avec la plupart des États une longue relation. Elle a parfois des amitiés anciennes. Mais nous plaçons les droits de l'homme au-dessus de toute autre considération. Lorsqu'il est question de crimes, la France ne couvre ni ne couvrira personne. Ce n'est pas l'intérêt des droits de l'homme, ce n'est pas son intérêt.
Revenons maintenant sur la disparition ignoble de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh. Je suis d'accord avec vous : cette affaire est grave, insupportable. Pourtant je veux, devant vous, réaffirmer de manière très claire que la France peut s'enorgueillir de son action. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire déclencher une enquête, pour qu'elle aboutisse, et donc pour obtenir l'application effective des recommandations émises dans le rapport de la commission d'enquête tchadienne concernant les événements de février 2008. Nous n'avons pas agi seuls, et j'ajouterai même que nous avons toujours été en première ligne de l'action internationale. À ce jour, la lumière n'a toujours pas été faite sur la disparition de M. Saleh. Nous ne nous en satisfaisons pas. Nous n'aurons de cesse d'agir pour que le mystère de cette disparition soit élucidé, ne serait-ce que pour permettre à sa famille, avec qui nous sommes en lien constant, de faire – éventuellement – son deuil et d'obtenir – en tout cas – des explications.
Vous connaissez le contexte particulier de ces événements. Le 28 janvier 2008, une colonne de près de 300 véhicules des forces rebelles a lancé une incursion en territoire tchadien à partir du Soudan. Les 2 et 3 février, les rebelles ont livré bataille au coeur de N'Djamena, sans parvenir à s'emparer de la présidence de la République tchadienne. La coalition rebelle a entamé son repli à partir du 4 février, vers les zones frontalières de l'est du pays. C'est donc dans un contexte particulièrement troublé – un contexte de guerre – qu'est intervenue cette disparition. L'ambassade de France était sous le feu ; notre souci prioritaire était d'assurer la protection, la sécurité et l'évacuation de nos compatriotes et des autres ressortissants étrangers. Les troupes françaises présentes à N'Djamena se sont concentrées sur cette mission et ont mené à bien l'évacuation de 1 600 ressortissants français et étrangers – autrichiens, saoudiens, etc. Les forces spéciales autrichiennes ont été évacuées de l'hôtel Kempinski par les forces françaises. Notre attaché de défense et son équipe n'ont pas quitté l'ambassadeur, qu'ils ont aidé dans cette tâche. Je rappelle que l'ambassade était « bunkérisée » et que les communications étaient coupées. Nos forces n'ont ouvert le feu que pendant une très courte période, en évacuant les ressortissants étrangers – autour, il est vrai, de la présidence.
Dès que nous avons appris sur place, par un appel du fils de M. Lol Mahamat Choua, la disparition de trois opposants politiques dont ce dernier, et conformément aux principes qui guident notre action, nous avons immédiatement réagi. Qu'a fait la France depuis lors ? Son action peut se décrire en quatre phases, dont la dernière se poursuit encore aujourd'hui.
Durant la première phase, au cours du mois de février 2008, nous n'avons eu de cesse de nous inquiéter auprès des dirigeants tchadiens du sort des disparus. Nous avons appris le 3 février au soir, comme je l'ai dit, la disparition d'un opposant, M. Lol Mahamat Choua. Des rumeurs ont circulé – dans une ville qui bruissait de rumeurs, et où plus aucun réseau de téléphonie ne fonctionnait – sur la disparition d'autres opposants. La France est alors immédiatement intervenue au plus haut niveau auprès des autorités tchadiennes. J'ai moi-même appelé en ce sens le président Déby en présence de mon homologue, M. Allam-Mi, dès le 5 février. Nos multiples efforts de sensibilisation ont permis de retrouver deux des opposants disparus, M. Lol Mahamat Choua et M. Ngarjely Yorongar. M. Saleh est resté introuvable. Je le sais parce que j'étais sur place et que je suis aller chercher moi-même M. Yorongar.
La deuxième phase de notre action a alors consisté à appuyer la commission d'enquête tchadienne, dont le travail est aujourd'hui salué par tous. Ce sont d'ailleurs sur ses recommandations que se fonde votre proposition de résolution. Cette commission, c'est bien la France, accompagnée par l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie, qui en a obtenu la création : le président Sarkozy, présent à N'Djamena dès le 27 février, a demandé au président tchadien Idriss Déby la création d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur la disparition d'Ibni Oumar Mahamat Saleh et sur l'ensemble des événements de février. Il l'a obtenue et, vous le savez, les conclusions de la commission sont rudes. Nous avons également insisté pour que la composition de cette commission soit équilibrée. Nous avons ensuite participé à toutes ses réunions, en tant qu'observateurs, et appuyé son action à travers la mise à disposition d'un expert. Cette commission a rendu son rapport au chef de l'État tchadien le 5 août 2008. De l'avis de tous, ce rapport est d'une qualité rare pour le Tchad et les pays environnants.
Le président Déby a alors pris publiquement deux engagements fermes : la publication rapide du rapport et la mise en place d'un dispositif de suivi, en particulier judiciaire, des enquêtes non achevées et des recommandations du rapport.
Le souci de mise en oeuvre de ces recommandations nous a amenés, dans une troisième phase, à encourager le Tchad à agir et à mettre en place les instruments normatifs nécessaires. C'est bien pour cela que le gouvernement tchadien a créé, au début du deuxième semestre 2008, un « comité interministériel de suivi des recommandations du rapport de la commission d'enquête », présidé par le Premier ministre et composé de huit ministres. Ce comité se réunit tous les deux mois environ ; sa dernière séance s'est tenue le 26 janvier 2010. Un sous-comité technique a également été constitué pour traiter les dossiers au fond et arrêter les mesures de mise en oeuvre des recommandations du rapport. Il est composé de quatre cellules – sécurité, action juridique, soutien psychologique et matériel, investigation économique et financière. Je note que ces instruments sont précisément ceux que réclame la proposition de résolution. Vous souhaiteriez que ce comité de suivi soit international : les autorités tchadiennes en ont jugé autrement. Mais notre ambassadeur n'a jamais eu à se plaindre de son fonctionnement : toutes ses demandes ont été exaucées.
En outre, toutes nos démarches ont directement contribué à ce que le gouvernement tchadien dépose en décembre 2008 une plainte contre X, qui a déclenché une enquête judiciaire portant notamment sur la disparition d'Ibni Oumar Mahamat Saleh.
Durant la quatrième phase en cours, nous demeurons très attentifs aux avancées de cette enquête – tout en respectant, bien sûr, le secret de l'instruction –, à travers des démarches bilatérales ou européennes auprès du président tchadien, de son Premier ministre ou des ministres concernés. J'ai moi-même eu l'occasion de m'y employer lors de chacun de mes déplacements au Tchad. Nous veillons notamment à ce que l'équipe de magistrats tchadiens dispose des moyens nécessaires à son action.
Cette enquête, encore en cours, a débouché sur de nombreuses auditions qui concernent des acteurs politiques, des militaires et des membres de la société civile. Le mandat du cabinet d'instruction vient d'être prolongé de six mois, et son budget augmenté. Le gouvernement tchadien affirme vouloir accélérer l'enquête pour qu'un procès puisse avoir lieu dans le courant de cette année.
Mais je n'oublie pas l'application des autres recommandations. Ainsi, la France et ses partenaires ont pesé pour que les femmes violées soient indemnisées, ce qui a été fait.
En réponse à votre question, monsieur Gorce, je réaffirme que la France ne connaissait pas – et ne connaît toujours pas – les circonstances de la disparition de M. Saleh. Seule l'enquête judiciaire pourra les déterminer.
Enfin, je tiens à souligner l'importance de cette séance : pour la première fois, vous discutez d'une proposition de résolution. En effet, vous le savez, nous expérimentons pour la première fois cette nouvelle procédure d'initiative parlementaire en matière de politique étrangère. Il faut en rappeler le cadre légal : l'article 34-11 de la Constitution dispose bien que l'action du Gouvernement ne peut être mise en cause. Nous ne sommes pas non plus dans le cadre d'une commission d'enquête ; nous n'avons donc pas, à ce stade, à prendre d'autres initiatives éventuelles.
Ne répondez pas à ma place : posez donc la question !
Pour ces raisons, je me suis pour l'heure borné à éclairer votre vote en soulignant l'action résolue de la France.
Si je comprends et partage votre désir de vérité, nous devons également tenir compte de la façon dont notre position sera appréciée au Tchad. Ce pays progresse actuellement sur la voie de la démocratie et de la consolidation de l'État de droit, et nous l'y encourageons. Dans ce contexte, je laisse à votre appréciation la manière dont la résolution dont vous discutez pourrait être interprétée localement.
Il ne faudrait pas que, soucieux de voir le débat s'ouvrir au Tchad et sous couvert de bons sentiments, nous en arrivions à galvauder les progrès accomplis par le pays.
Je connais l'enchaînement des prises de pouvoir au Tchad, pour les avoir vécues. Je pourrai vous les détailler, si vous le souhaitez. Entre 2006 et ce qui se prépare aujourd'hui, des progrès ont été accomplis ; ne les négligeons pas.
S'il est tout à fait normal de demander que justice soit faite en mettant à profit nos bonnes relations diplomatiques, il serait absurde d'interférer sur le cours de la justice de cet État indépendant. Aucun pays ne mérite la caricature, et nous nous honorons d'encourager ceux qui tirent leur force des droits de l'homme.
Je vous remercie à nouveau de cette occasion qui m'a été offerte de revenir sur notre action inlassable en faveur des droits de l'homme, en particulier celle qui concerne les drames des disparitions, dont je vous ai fourni le nombre. Dans ce dernier domaine, nous nous attachons à faire appliquer la résolution que nous avons obtenue.
Il s'agit en particulier, bien sûr, de la disparition de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh, qui nous rassemble aujourd'hui, après deux ans. Je vous le répète : la France continuera d'agir pour contribuer à ce que la vérité soit faite, par le Tchad, sur ce drame. C'est dans ce cadre que je demanderai à notre ambassadeur chargé des droits de l'homme de se rendre très prochainement à N'Djamena. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, cher Gaëtan Gorce, nous sommes ici pour évoquer un honnête homme : Ibni Oumar Mahamat Saleh, disparu à N'Djamena, capitale du Tchad, le 3 février 2008.
Sans revenir sur les attendus de la proposition de résolution inscrite à notre ordre du jour, excellemment exposés par son auteur, je signale que le groupe socialiste, radical et citoyen se joint à l'exigence exprimée par notre collègue : celle de savoir, celle de recevoir une réponse après deux ans de silence, deux longues années pour les proches du disparu.
Ibni Oumar Mahamat Saleh demeure aujourd'hui un disparu forcé, selon la formule d'usage en pareil cas – que vous avez rappelée, monsieur le ministre. Il y a là quelque chose d'insupportable d'un point de vue humain et d'inadmissible d'un point de vue moral.
Permettez-moi de rendre hommage à mon collègue Gorce. Certes, nous sommes mobilisés en nombre assez faible cet après-midi – même si la qualité est essentielle !

Mais, à quatre reprises déjà – le 2 avril 2008, le 18 mars 2009, le 3 novembre 2009 et le 8 février 2010 –, Gaëtan Gorce a évoqué ce grave problème au nom de notre groupe lors de la séance de questions au Gouvernement, devant un hémicycle plein. Les réponses qu'il a alors obtenues nous ont conduits à pousser plus loin notre exigence.
Si cette disparition est insupportable et inadmissible, c'est d'abord en raison de la personnalité même de l'intéressé. Ibni Oumar Mahamat Saleh était – ou est ? – un intellectuel, un mathématicien apprécié de ses pairs et de ses condisciples de l'université d'Orléans. Il avait fait son chemin, comme on dit, en suivant la voie difficile et méritoire du travail et de l'investissement personnel.
Ce profil avait attiré l'attention. Tous ceux qui souhaitaient le bien de leur pays, entendu comme un mouvement progressif vers la démocratie, l'avaient sollicité. Cumulant savoir et sagesse, il avait accepté cette responsabilité. Secrétaire général du parti des libertés et du développement, il était, au moment des événements, le principal responsable de la coalition des opposants non violents et pacifiques. Inutile de préciser qu'il n'était nullement impliqué dans l'aventure sanglante et militarisée qui a dévasté N'Djamena de la fin janvier au 8 février 2008.
Insupportable et inadmissible, cette disparition l'est aussi pour des raisons politiques. Disputé entre les siens, le Tchad s'est perdu en querelles régionales et locales depuis l'indépendance. Ibni Oumar Mahamat Saleh avait compris les maux qui ont empêché son pays d'entamer son développement. Il savait également les exposer en termes simples. « Depuis son accession à l'indépendance », écrivait-il ainsi en 2007, « le Tchad n'a pas connu la paix. Depuis 1990, date de la prise du pouvoir par Idriss Deby, la démocratie a été proclamée. Le Tchad est donc censé enterrer définitivement les alternances politiques violentes. Or, plus que jamais, c'est le retour à la guerre ».
II avait également su en tirer les conséquences politiques. Seuls le dialogue, le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires des voisins, seules la démocratie et ses valeurs, en somme, pouvaient, selon lui, sortir le Tchad d'une impasse tragique. « Un dialogue démocratique inclusif, réclamé par l'opposition démocratique, est seul à même », a-t-il ainsi écrit, « d'instaurer un consensus national, une transition et des élections réellement libres et démocratiques. La communauté internationale doit l'imposer. »
L'exigence de changement était d'autant plus pressante que le Tchad, devenu producteur de pétrole au cours des dernières années, en consacrait les redevances à des dépenses improductives, notamment à l'achat d'armements. Le disparu prétendait mettre un terme à ces gaspillages qui obéraient l'avenir.
Insupportable et inadmissible, cette disparition l'est encore pour non-assistance à personne en danger, et même, ajouterai-je, à personne amie en danger. En effet, Ibni Oumar Mahamat Saleh avait été convaincu par l'enseignement de maîtres formés à l'école républicaine. Il partageait nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Il en avait tiré une leçon simple à la lumière des tourments passés de notre histoire et de ceux, non moins agités, du présent tchadien : l'exigence de poser les fondements d'une convivialité citoyenne. Nous – non seulement le groupe que je représente ici, mais tous ceux qui ont les valeurs de la République en partage – avions un devoir d'assistance envers cet artisan ambitieux de la vie démocratique. Nous avions – et avons – un devoir de solidarité morale et politique envers lui.
Insupportable et inadmissible, cette disparition l'est enfin parce qu'elle coïncide avec le cinquantième anniversaire des indépendances en Afrique francophone. Qu'avons-nous fait avec ces jeunes pays indépendants ? Qu'avons-nous fait avec le Tchad depuis 1960 ? Qu'ont-ils fait, avec nous, de leur autogestion au cours des cinquante dernières années ? Beaucoup sont encore en voie de développement. Certains continuent de faire partie des PMA, les pays les moins avancés. Quelques-uns peinent à accepter les règles d'une vie démocratique authentique. Le Tchad est malheureusement de ceux-là.
La coopération, initialement destinée à leur donner le coup de pouce leur permettant d'accéder au bien-être économique, s'est prolongée. Les soldats français sont toujours là. Ne font-ils que protéger une souveraineté en effet souvent violée ? Assurent-ils au contraire ou par ailleurs la perpétuation de gouvernants démocratiquement hétérodoxes – et je pèse mes mots ? Ainsi, au Rwanda, M. Paul Kagamé semble vouloir éliminer ses opposants. Il serait temps, monsieur le ministre, de regarder la réalité en face et de rajuster notre vision de l'Afrique et de notre relation avec elle.
L'an passé, dans l'excellent rapport de la mission présidée par notre collègue Jean-Louis Christ et dont M. Remiller était le rapporteur, nous avons formulé des propositions auquel le Gouvernement a malheureusement été fort peu attentif – il s'agit évidemment d'un euphémisme. Un signal doit pourtant être donné, un signal d'espoir, de renouveau, un signal de vérité et d'authenticité éthique. La France doit bien entendu être attentive aux équilibres, à la stabilité et à la paix ; vous le disiez à l'instant, monsieur le ministre.
En déposant cette proposition de résolution, le groupe SRC a pris en considération tous ces éléments. Voilà pourquoi nous avons souhaité inscrire dans le cadre défini par les autorités tchadiennes elles-mêmes le droit à la vérité de la famille, des proches et des amis d'Ibni Oumar Mahamat Saleh. La commission d'enquête créée en 2008 par décret présidentiel – tchadien, bien entendu – a remis des conclusions importantes, mais insuffisantes. Elle a recommandé, le 3 septembre 2008, la poursuite des travaux d'investigation et l'intégration des contributions d'experts extérieurs qui représentent, selon ses propres termes, la communauté internationale. Or la France est, au Tchad plus qu'ailleurs, partie prenante de cette dernière.
Au nom des valeurs que nous partageons avec M. Saleh, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter l'article unique de notre proposition. J'espère que vous le ferez sur tous les bancs de cet hémicycle.
Permettez-moi, en conclusion, de vous en rappeler précisément les termes : « Conformément aux dispositions prévues par le point 11 des recommandations de la commission d'enquête tchadienne, la France est en droit d'exercer éventuellement en liaison avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union européenne, qui ont participé aux travaux de la commission, de pressantes démarches auprès des autorités tchadiennes afin qu'elles se conforment à la lettre des obligations signalées par la commission d'enquête, à savoir, la mise en place dans les délais les plus brefs d'un comité restreint de suivi « aux fins de veiller à l'application des recommandations émises. » Vous voyez donc notre modération, monsieur le ministre.
Si elle suivait, unanime, les conclusions du rapporteur, l'Assemblée nationale honorerait la liberté et la justice. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la résolution présentée aujourd'hui par le groupe SRC s'attache à rendre justice à un homme victime de ses idées, à le rétablir dans sa dignité politique et à bannir l'impunité qui couvre trop souvent les pires exactions.
Les députés communistes et républicains souscrivent pleinement à cet objectif.
Ce drame humain, la disparition de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh, interroge de manière impérieuse la position de la France au Tchad et, plus généralement, sur le continent africain, dans le cadre de la rupture annoncée par le Président de la République.
Il y a un peu plus de deux ans disparaissait M. Ibni Oumar Mahamat Saleh, membre éminent de l'opposition au régime d'Idriss Déby. L'incursion de groupes rebelles de l'est du Tchad dans la capitale, au cours de la dernière semaine de janvier 2008, fournit le décor d'une vague d'arrestations et d'enlèvements non revendiqués dont furent victimes plusieurs hommes politiques incarnant l'espoir d'une modernisation du pays.
Malgré la mise en place d'une commission d'enquête sous l'égide de la communauté internationale peu après ces événements, la disparition de M. Saleh demeure à ce jour désespérément irrésolue. L'éventuelle participation de la présidence tchadienne à l'élimination de ces opposants fait l'objet de soupçons convergents et largement étayés par les conclusions de cette commission d'enquête et les divers témoignages recueillis.
En effet, au moment où les enlèvements d'opposants se sont produits dans N'Djamena, l'ordre avait été rétabli depuis plusieurs heures. Les groupes rebelles qui avaient semé le chaos, provoqué des centaines de morts et menacé le pouvoir central d'un coup d'État étaient très clairement en fuite. À cet instant, seules les forces armées de la Présidence de la République détenaient le contrôle du territoire, et il est difficile de croire que les plus hauts responsables du régime aient été dans l'ignorance de ces exactions.
Les conclusions de la commission d'enquête relative à cette vague d'enlèvements sont particulièrement éloquentes. Elles jugent que « des enlèvements et des arrestations, des actes d'intimidation à l'encontre d'opposants politiques ont eu lieu après le retrait des rebelles de N'Djamena ; ceci met ainsi clairement en cause la responsabilité des forces de défense et de sécurité » dirigées par la Présidence de la République. Elles rejettent également le caractère fortuit de ces arrestations en évoquant une probable préméditation de ces enlèvements.
Ces accusations sont d'une extrême gravité.
Pourtant, depuis 2008, rien n'a été mis en oeuvre pour rechercher les coupables et les traduire en justice. L'impunité demeure, et le pouvoir tchadien a botté en touche en créant un comité de suivi qui ne comporte aucune personnalité de l'opposition ou de la communauté internationale, contrairement aux recommandations de la commission d'enquête.
La France ne peut rester sourde à ces accusations et impuissante face à l'immobilisme du gouvernement tchadien. Elle a une responsabilité particulière, puisqu'elle a oeuvré à la création de cette commission d'enquête et participé à ses travaux aux côtés de la communauté internationale. Elle ne peut s'en tenir là et doit aller au bout de cette démarche vers la vérité et la justice.
Le 27 février 2008, lors d'un déplacement à N'Djamena, Nicolas Sarkozy déclarait : « La France veut la vérité et je ne céderai pas sur ce point. »
Monsieur le ministre, la France doit instamment presser le gouvernement tchadien de respecter les conclusions de la commission d'enquête, et exiger d'intégrer son comité de suivi. J'aimerais que vous nous éclairiez de manière très précise sur les initiatives que vous allez prendre pour mettre fin à cette insoutenable impunité.
Plus généralement, cette affaire souligne les responsabilités encore fortes de notre pays dans les destinées du continent africain, malgré la rupture vantée par le Président Sarkozy en 2007. Ce sera le deuxième point de mon propos.
La France apporte un soutien « sans faille » – j'emprunte là les mots du ministre de la défense – au régime d'Idriss Déby depuis son accession au pouvoir. Faut-il rappeler que cette accession s'est pourtant effectuée au prix d'un coup d'État ? Que ce pouvoir ne doit son maintien qu'à plusieurs fraudes électorales, en 1996 et 2001, d'ailleurs dénoncées par l'Union européenne ?
Cette région de l'Afrique est incontestablement une zone sensible et complexe, théâtre de nombreux conflits qui menacent les populations civiles. Les rivalités entre le Soudan et le Tchad, qui semblent enfin s'apaiser, sont un puissant facteur de déstabilisation. En fomentant des révoltes internes par groupes armés interposés, ces deux pays se sont adonnés à un jeu dangereux.
Le conflit du Darfour, avec ses nombreuses victimes, qui empoisonne toujours la situation interne du Tchad avec 350 000 réfugiés dans l'est du pays, limitrophe du Soudan, trouve là quelques-unes de ses racines.
Si la nécessaire stabilité du Tchad et le maintien de son unité territoriale, invoqués par la diplomatie française, sont des préoccupations que nous partageons, en quoi justifient-elles, monsieur le ministre, le soutien infaillible à un régime aussi peu recommandable que celui de M. Déby ?
Malgré les violations des droits démocratiques et humains pointées par les défenseurs des droits de l'homme, la France n'a pas hésité à intervenir militairement pour soutenir ce régime en 2006. Son rôle n'en a pas été moins négligeable en 2007 et en 2008, lorsqu'elle a fourni des renseignements militaires sur les insurgés et accru de manière conséquente ses livraisons d'armes.
J'ouvre à ce propos une parenthèse pour dire à quel point le contrôle parlementaire sur ces accords d'armement avec des pays sensibles demeure, de mon point de vue, insuffisant, pour ne pas dire virtuel. Il serait souhaitable que le rapport au Parlement sur ces exportations fasse chaque année l'objet d'un débat en séance. Je formule cette proposition en espérant qu'elle puisse être mise en oeuvre dès l'année prochaine. La révision de la Constitution et la réforme du règlement de l'Assemblée devaient affirmer les pouvoirs du Parlement dans le domaine des affaires étrangères. Là encore, les mots doivent se traduire en actes pour que le domaine réservé de l'Élysée revienne enfin dans la normalité démocratique.
Je crains que le sort dramatique de M. Saleh n'illustre à quel point la France sacrifie les populations africaines sur l'autel de ses intérêts économiques et géostratégiques. La disparition de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh est le symbole de l'oppression politique, mais aussi des méfaits d'une politique françafricaine qui n'a probablement aucunement cessé.
D'aucuns décrivent le Tchad comme une pierre angulaire du pré carré de la France. Outre les richesses de son sous-sol récemment découvertes, qui attirent les appétits des multinationales, ce pays constitue une base arrière de notre influence sur le continent noir, 1 500 militaires y étant déployés en vertu d'un accord de défense secret conclu au lendemain des indépendances africaines.
La France ne peut continuer à s'enorgueillir de ses valeurs démocratiques et poursuivre en Afrique cette politique de type néocolonial.
En 2007, le candidat Sarkozy avait affirmé avec force que cette page des relations avec l'Afrique serait tournée sous sa présidence, suscitant de grands espoirs. Quel est le bilan de la rupture vantée par le Président ? Un secrétaire d'État limogé par les amis du clan Bongo pour avoir élevé la voix contre la corruption gangrenant les réseaux françafricains ; des fraudes électorales avalisées dans le Congo de M. Denis Sassou N'Guesso et la Mauritanie de M. Abdel Aziz ; des coups d'État mollement réprouvés à Madagascar et en Guinée ; une succession dynastique adoubée dans le Gabon de la famille Bongo, sous l'oeil bienveillant du réseau Bourgui. L'image de Nicolas Sarkozy veillant sur le cercueil d'Omar Bongo scellait l'enterrement de première classe de la rupture françafricaine sous les intérêts économiques proches de l'Élysée, de Bolloré et de Bouygues.
Dans ce triste panorama, la célébration en 2010 du cinquantenaire des indépendances africaines résonne comme une énième offense à la souveraineté des peuples africains. De l'invitation lancée aux chefs d'État africains aux festivités du 14 juillet au titre de secrétaire général des indépendances décerné à Jacques Toubon, éminent acteur de cette Françafrique, tout rappelle la volonté du gouvernement français de vassaliser ces pays au détriment de leurs populations, et d'imposer une vision déformée de l'histoire, selon laquelle la France aurait généreusement octroyé ces indépendances – image d'Épinal qui gommerait les luttes menées par les peuples d'Afrique au prix de nombreuses victimes pour se libérer d'un système colonial injuste et oppresseur dont nombre de pays européens étaient les responsables.
Aussi, vous comprendrez le sens que nous donnons à la résolution présentée aujourd'hui : elle engage le Gouvernement à rendre justice à M. Saleh mais également à modifier radicalement sa politique africaine afin de respecter les choix souverains des peuples africains et promouvoir une coopération pacifique et équilibrée. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais rendre hommage à la mémoire de Ibni Oumar Mahamat Saleh et saluer sa famille, présente dans les tribunes de notre assemblée. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les autres personnes disparues lors des événements que nous avons rappelés et pour leur famille.
La situation politique au Tchad, depuis des décennies et même depuis son indépendance, le 11 août 1960, a été rythmée par des moments d'instabilité, des coups d'État et des menaces rebelles.
À de nombreux titres, la France a toujours été très présente dans ce pays, et nous avons écrit ensemble de grandes pages de notre histoire ; faut-il citer des hommes tels que Félix Éboué ou le maréchal Leclerc ? Même si elles sont moins actives que dans d'autres pays d'Afrique francophone, notre présence et notre coopération sont significatives dans de nombreux domaines, notamment le domaine militaire avec l'opération Épervier, en cours au Tchad depuis février 1986.
C'est pourquoi nous nous sentons particulièrement proches du Tchad et des Tchadiens. C'est pourquoi également notre assemblée ne peut rester insensible à ce qui se passe dans ce pays.
Par ailleurs, les conflits régionaux, particulièrement celui du Soudan, ont une incidence sur la situation politique au Tchad. Le meilleur exemple en est le conflit du Darfour, qui a déstabilisé la zone est du Tchad avec des milliers de réfugiés soudanais et des milliers de déplacés tchadiens et qui a ainsi créé une zone de non-droit d'où sont partis de nombreux raids de rebelles en direction de N'Djamena.
Jusqu'en février 2008, il faut le reconnaître, hormis de rares et courageux reportages sur la situation dans cette région, personne ne s'intéressait vraiment à ce qui se passait au Tchad ou au Soudan. Cependant, du 28 janvier au 8 février 2008, les événements se sont précipités : les rebelles étaient à N'Djamena, il fallait alors évacuer tous les Occidentaux. La France était en première ligne et a permis d'évacuer 1 600 personnes de soixante-huit nationalités, y compris américaine.
Que s'est-il passé exactement dans ces moments si incertains ? La situation en ville était très confuse et très dangereuse. J'étais moi-même, à plusieurs reprises, en contact téléphonique direct avec quelques amis réfugiés au Béguinage à N'Djamena, et j'ai suivi leur évacuation sur Libreville. Je peux donc attester de la gravité de ces événements et du degré de confusion qui régnait.
Les rebelles ont été repoussés in extremis, mais il y a eu de nombreux « dommages collatéraux », pour reprendre l'expression en vigueur dans les milieux diplomatiques : des assassinats, des viols, des pillages, des destructions incroyables. Je suis allée à N'Djamena en juin 2008, et j'ai vu, par exemple, les locaux de l'assemblée nationale tchadienne totalement détruits, de même que ceux de plusieurs ministères, et des quartiers incendiés.
Parmi ces exactions, il y a eu l'enlèvement de trois leaders de l'opposition au régime du Président Idriss Déby, dont le professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh. Si les deux autres opposants ont été retrouvés sains et saufs, le professeur Saleh est toujours porté disparu.
Je ne reviens pas sur les qualités personnelles de Ibni Oumar Mahamat Saleh, qui font de lui le principal opposant au pouvoir en place et l'un des rares leaders politiques capables d'unifier l'opposition démocratique. Son enlèvement et sa disparition ont créé un émoi considérable, à la fois dans les milieux universitaires, notamment celui des mathématiques – et je salue particulièrement les nombreuses initiatives des professeurs de mathématiques et des professeurs des universités d'Orléans et de Rennes –, et dans le monde politique, qui ne peut accepter qu'un opposant pacifiste soit ainsi enlevé sans raison à son domicile, devant sa famille, pour ne jamais réapparaître.
Le mercredi 27 février 2008, alors qu'il se rendait en Afrique du Sud, le Président Nicolas Sarkozy a conditionné son escale au Tchad à la création d'une commission d'enquête internationale sur l'ensemble des événements et, surtout, sur la disparition des opposants politiques.
Cette commission d'enquête a été mise en place, composée de quarante membres, assistés de quatre experts internationaux, munie de moyens financiers conséquents. Elle a adopté son rapport le 31 juillet de la même année.
Fortement encouragée par la communauté internationale, la commission a suggéré – c'est l'objet de sa proposition n° 11 – la création d'un comité de suivi de ses conclusions, « au sein duquel la représentation de la communauté internationale sera assurée », de manière à aller au fond des choses.
Ce rapport est exemplaire. Très fouillé et même très courageux, il ouvre des pistes sur certains événements, notamment sur l'arrestation de ces trois opposants et, page 157, la disparition de Ibni Oumar Mahamat Saleh. En réponse, le gouvernement tchadien a émis une analyse contradictoire très critique mais il a conclu ainsi : « D'ores et déjà, le Gouvernement s'engage à saisir les instances judiciaires, à faire poursuivre des investigations par les instances appropriées pour la manifestation de la vérité et à mettre en place un comité restreint de suivi tel que suggéré dans le rapport ». J'insiste sur ces mots : « tel que suggéré dans le rapport ».
Le comité de suivi a été créé par un décret du 20 septembre 2008. Mais il semble que la situation n'ait pas vraiment avancé.
L'audition de l'ambassadeur de France au Tchad, qui a eu lieu mardi – et je remercie le président de la commission des affaires étrangères de l'avoir organisée –, nous a appris que la justice poursuit son travail, qu'elle procède à de nombreuses auditions et qu'elle a demandé six mois de délai supplémentaires pour rendre ses conclusions, soit vers le mois de juin de cette année.
Je vous rassure, monsieur le ministre, il n'est évidemment pas question de nous positionner en donneurs de leçons ni de nous immiscer dans les affaires intérieures du Tchad. Nous voulons seulement encourager les instances compétentes de ce pays à poursuivre sur la voie courageuse de la commission d'enquête et à faire éclater la vérité, quelle qu'elle soit, sur cette douloureuse affaire.
C'est pourquoi j'approuve l'esprit de cette résolution, tout en faisant remarquer que ce qu'elle demande – le comité de suivi – existe déjà. Le problème, c'est que ce comité de suivi n'a peut-être pas les moyens techniques pour faire avancer l'enquête qui devrait permettre d'accéder à la vérité.
Pour être claire, il ne faudrait pas, compte tenu des efforts déjà faits par la commission d'enquête, qu'il y ait le moindre prétexte à ce qu'un doute soit émis lors de la conclusion de cette affaire.

Aussi, je propose que notre assemblée suggère aux autorités tchadiennes, comme le précise le rapport de la commission d'enquête et comme s'y est engagé le gouvernement tchadien, de solliciter à nouveau la participation d'experts internationaux qui pourraient, cette fois, être associés aux travaux du comité restreint de suivi.
Dans cette perspective, la France pourrait s'engager à tout faire pour apporter la meilleure réponse dans le cadre d'une contribution européenne ou avec l'Union africaine.
À la veille, nous l'espérons tous, de la relance du processus électoral au Tchad, que l'ensemble de la communauté internationale encourage et soutiendra, il est indispensable que l'ombre de la disparition de Ibni Oumar Mahamat Saleh n'entache pas la bonne volonté des acteurs politiques et que la vérité sur sa disparition permette un nouveau départ au processus démocratique déjà bien engagé dans ce pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de me réjouir, comme vous l'avez fait, monsieur le ministre, du fait que la première proposition de résolution débattue aujourd'hui, en application du nouveau droit accordé par l'article 34-1 de la Constitution au Parlement, porte sur le respect de la personne humaine et la défense des droits de l'homme.
Cette question qui nous rassemble fait aussi partie des priorités que, dès le début de son mandat, le Président de la République a définies en matière de politique étrangère. Les faits sont là : la libération des infirmières bulgares détenues en Libye, soumises pendant de longues années à des traitements violents et dégradants ; les démarches constantes entreprises auprès des autorités colombiennes pour obtenir le retour d'Ingrid Betancourt auprès des siens ; la décision de maintenir l'existence d'un ambassadeur pour les droits de l'homme – je salue d'ailleurs la présence de son titulaire – dont la fonction, je le rappelle, créée il y a dix ans, permet à la France, « dont le message et la pratique dans le domaine des droits de l'homme sont tout particulièrement observés, attendus et écoutés », d'être dotée d'une capacité supplémentaire d'initiative et d'expression.
Voilà autant d'exemples de notre attachement à la défense des droits de l'homme.
Aujourd'hui, c'est du sort de l'opposant politique tchadien, M. Ibni Oumar Mahamat Saleh qu'il est question. Les faits ont été rappelés. Enlevé le 3 février 2008 avec deux autres personnalités de l'opposition tchadienne – qui, elles, ont réapparu quelque temps plus tard –, il n'a, depuis cette date, jamais été retrouvé.
On le sait, une commission d'enquête a été constituée par le Président Idriss Déby. La qualité et le sérieux des travaux qu'elle a effectués ont été salués et remarqués par tous les observateurs.
Cette commission a enquêté, d'une part, sur les affrontements violents qui ont eu lieu au Tchad entre la fin janvier et le début février 2008. Je tiens à ce stade à saluer le sang-froid et l'efficacité des personnels de notre ambassade de France à N'Djamena. Soucieux de l'évacuation de nos compatriotes, alors que nos diplomates se trouvaient sous le feu des tirs croisés des troupes gouvernementales et des rebelles tchadiens, il leur a été demandé d'intervenir pour le compte des ambassades de Chine, d'Algérie et de Russie. Excusez du peu !
Ces opérations d'évacuation nous rappellent l'extrême violence de ces journées au cours desquelles les combats ont fait dans la seule capitale 1 323 blessés, 730 morts, et ont donné lieu à de très graves actes de violence tels que des viols, pillages ou extorsions de fonds, ainsi qu'à des centaines de cas d'emprisonnement.
La commission d'enquête s'est, d'autre part, spécifiquement consacrée au cas d'Ibni Saleh sans pouvoir conclure à ce jour de manière certaine sur son sort. Elle a rendu ses conclusions en août 2008. Celles-ci sont sévères et sans complaisance pour les deux parties belligérantes, accusées d'avoir « commis des exactions constitutives de violation » du droit national et du droit international.
La commission a par ailleurs adressé des recommandations au gouvernement tchadien, lui demandant notamment de « poursuivre impérativement les recherches et de donner une suite judiciaire en vue de faire définitivement la lumière sur le cas de la disparition forcée de Ibni Oumar Mahamat Saleh » et « d'instituer un comité restreint de suivi au sein duquel la représentation de la communauté internationale sera assurée », en précisant que « ledit comité devra se réunir à intervalles réguliers en vue d'examiner les progrès accomplis ».
Ce sont ces deux exigences énoncées par la commission d'enquête qui fondent la démarche de nos collègues de l'opposition pour demander aux autorités françaises d'entamer des démarches pressantes auprès des autorités tchadiennes afin qu'elles se conforment aux obligations qui leur ont été fixées.
Je souscris personnellement à l'objet de cette résolution que je voterai, de même que les membres du groupe UMP. Au nom de quoi faudrait-il s'y opposer pour quiconque est attaché à la question des droits de l'homme ?

Il est en effet indispensable que les autorités tchadiennes agissent avec détermination, alors qu'elles ont actuellement tendance, semble-t-il, à délaisser ce dossier, selon les informations que notre commission des affaires étrangères a obtenues lors de l'audition de M. Bruno Foucher et de M. François Zimeray, respectivement ambassadeur de France au Tchad et ambassadeur pour les droits de l'homme.
La France, pour sa part, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, n'a jamais baissé la garde. Depuis le début de ces événements, notre pays s'est engagé activement. Il a fortement contribué à sensibiliser les autorités du Tchad sur la gravité des faits et appelé à la création de la commission d'enquête décidée par le Président Déby fin février, après la visite du Président de la République Nicolas Sarkozy le 27 février. La France a participé en tant qu'observateur à cette commission et a mis un expert à sa disposition.
Les démarches entreprises par les autorités françaises fin 2008 ont également contribué à la décision du gouvernement tchadien de déposer une plainte qui a déclenché une enquête judiciaire sur l'ensemble des cas de disparition, parmi lesquels celle de M. Ibni Saleh fait l'objet d'une instruction particulière. Les magistrats saisis du dossier ont demandé un délai supplémentaire de six mois et ne concluront leur instruction qu'en juin prochain.
On le voit, la France n'a pas été inactive, mais il est important de montrer qu'elle demeure attachée à la mise en application par les autorités tchadiennes de toutes les demandes de la commission d'enquête.
En adoptant cette résolution, notre assemblée envoie un message sans ambiguïté qui réaffirme l'importance accordée par la représentation nationale, d'une part, à la mise en place de l'État de droit qui passe par l'instauration et le renforcement du système judiciaire, d'autre part, à la défense des droits de l'homme.
Sachez par ailleurs que l'ambassadeur de France au Tchad s'est engagé devant les membres de la commission des affaires étrangères à faire part au Premier ministre tchadien, M. Nadingar, de l'intérêt que notre assemblée porte à ce dossier et de la discussion aujourd'hui même de ce projet de résolution.
Notre assemblée, mes chers collègues, avec l'avis favorable de la commission des affaires étrangères, a adopté le 12 juin 2008 le projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, dont l'objet est de prohiber les détentions secrètes, d'exiger l'information des familles sur le sort des détenus et d'instituer un mécanisme de surveillance, le comité des disparitions forcées, doté de pouvoirs d'enquête.
En adoptant la résolution dont nous discutons aujourd'hui, ce sont toutes ces victimes du crime de disparition forcée que nous entendons défendre à travers le cas de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh. C'est l'honneur de cette assemblée de le faire ; c'est aussi, monsieur le ministre, l'honneur de la France. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je partage votre sentiment sur la nécessité de justice et de vérité. Il faut en effet clarifier cette affaire. Cela étant, je voudrais préciser certains points.
Cette exigence de vérité doit être aussi une exigence de vérité historique. Vous demandez que la communauté internationale intervienne, non sur cette affaire, mais au Tchad en général, dont l'histoire est très compliquée et marquée par une succession de coups d'État à partir de M. Tonmbalbaye : il y a eu Goukouni Oueddeï, puis Hissène Habré et Idriss Déby. Ces coups d'État, très meurtriers, se sont succédé jusqu'en 2006. Depuis, les progrès de la démocratie sont visibles et, même si c'est facile par rapport à ce qui se passait avant, il faut le souligner.
Notre position s'explique parce que – vous l'avez dit – la géopolitique de ce pays est importante. Mais il ne faut pas oublier que son voisin envoie en permanence des groupes rebelles qui se livrent, à intervalles successifs, à des attaques armées sur le territoire. Nous devons, si nous tenons à la stabilité de l'ensemble, participer de cette stabilité. Il y a eu une intervention en 2006 : les avions français positionnés à N'Djamena ont tiré devant la colonne qui arrivait, comme d'habitude, d'un pays voisin. En 2008, nous ne sommes pas intervenus militairement. C'était déjà un changement considérable. Je le répète, nous ne sommes pas intervenus. L'armée française n'a tiré qu'une seule fois pour exfiltrer des ressortissants étrangers. Le courage de nos troupes a permis d'en faire sortir 1 600.
L'aéroport n'est pas à protéger puisqu'il n'y en a qu'un ! Une partie de l'aéroport n'a pas été attaquée. Un obus est tombé, les rebelles attaquaient et tiraient sur l'aéroport. Je vous signale qu'il s'agit de l'aéroport civil. C'est là aussi que les avions militaires tchadiens sont basés, pas à l'endroit que nous occupons avec l'opération Épervier, à côté, mais il y a une seule piste !

Cela ne veut-il pas dire que nous avons protégé les hélicoptères tchadiens ?
Non, absolument pas ! Les hélicoptères tchadiens n'étaient pas au même endroit. Ils étaient du côté tchadien ; cela n'a rien à voir ! On peut construire une autre piste, mais c'est une autre histoire !
Nous n'avons véritablement opéré à partir de cette base française que pour aller chercher les ressortissants étrangers, ce qui était très difficile. Puisque vous parlez d'intervention internationale, tous les pays ont salué le courage des soldats français.
Quant à l'intervention internationale, comme il y a des populations civiles sur le chemin des rebelles, la France a demandé à dix-sept pays européens de lancer l'opération EUFOR. Pendant un an, de 2008 à 2009, vous vous en souvenez, madame Hostalier, car vous avez rendu visite à nos troupes, il n'y a pas eu une seule attaque de djandjaouid, c'est-à-dire de milices qui, de l'autre côté, venaient semer la terreur parmi les populations civiles tchadiennes, notamment auprès des femmes et des enfants. Il y a eu un an de présence internationale. Nous pouvons demander à ces dix-sept pays et à l'Europe d'aller encore dans le même sens pour exiger vérité et justice sur cette affaire, qui n'est pas intervenue au même moment puisque l'opération EUFOR s'est déroulée de 2008 à 2009 et que nous avons passé la main, le jour dit, aux forces des Nations unies. Mais je vous assure que, dans toutes ces opérations, nous avons été très attentifs à protéger la population tchadienne.
Monsieur Muzeau, vous avez parlé de trente morts. C'est une mauvaise plaisanterie !
Le rapport de la commission d'enquête, qui est sérieux, fait état de 1 323 blessés et de 730 morts. Ce n'est pas la même chose !
Je vous prie de m'excuser, j'avais compris que vous parliez de trente morts. Je me souviens des ravages terribles subis par cette ville ; elle était complètement détruite. L'attaque avait été extraordinairement forte et aurait dû normalement triompher de l'ensemble des structures administratives et politiques.
C'était vraiment un chaos particulier, une terreur pour les populations. Cela n'excuse rien du tout, je ne suis pas en train de vous dire que c'était normal. Considérez toutefois, s'il vous plaît, ce qu'ont fait les Tchadiens pour se défendre contre des attaques rebelles répétitives qui viennent toujours du pays voisin. Je souhaite évidemment la paix. Il y a d'ailleurs eu, ces temps-ci, quelques signatures, ce qui représente un progrès.
Vous voulez que soit créé un comité de suivi avec une présence internationale. Comment l'obtenir ?

C'est l'article 11 des conclusions de la commission d'enquête, monsieur le ministre !
Certes, mais la commission d'enquête a été constituée dans un pays souverain. Il revient donc à son Gouvernement de décider s'il doit y avoir une présence internationale. Nous l'avons fait accepter pour la commission d'enquête, et si vous voulez que les Français agissent de même pour le comité de suivi, on peut essayer.
Exiger, non, mais suggérer, pourquoi pas ?
Je vous signale également, parce que nous devons aussi être quelque peu raisonnables, que l'accord du 13 août 2008 a prévu la représentation des partis de l'opposition. On compte ainsi quatre ministres, dont un est d'ailleurs du même parti que M. Saleh. Ce sont des progrès qu'il faut noter. Je suis toutefois tout à fait favorable à ce que l'on aille plus loin, si vous le souhaitez.
Vous ne pouvez pas dire que l'on ne fait rien, monsieur François Loncle ! Je viens de vous préciser que l'on est en train d'agir et que personne n'a autant insisté !
Si ce n'est pas clair, je vais vous le répéter : nous sommes le seul pays à avoir fait bouger la communauté internationale !
Ne parlez pas seulement de ce qui vous intéresse !
Je ne peux pas accepter d'entendre dire qu'on ne fait rien au Tchad ! Nous avons été les seuls à intervenir de façon extrêmement efficace. Vous l'avez d'ailleurs reconnu dans tous vos discours. Admettez-le maintenant également, s'il vous plaît !
Je suis en train de vous répondre : nous avons fait beaucoup et beaucoup plus que vous !

Je profiterai de cette explication de vote pour réagir.
Je tiens d'abord à remercier le président de notre commission, le président de l'Assemblée et le Gouvernement d'avoir permis que se tienne ce débat, à l'initiative du groupe socialiste. Il a été, je le crois, utile. Chacun s'est exprimé dans le respect des formes et sur le fond avec le souci de dégager des éléments d'information et de vérité. Restent, évidemment, des points qui méritent d'être approfondis, ce qui explique que nos derniers échanges aient parfois pu être un peu plus vifs.
Il est vrai, monsieur le ministre, que vous avez abordé une question délicate et que je n'ai pas traitée dans mon intervention afin de ne pas créer de confusion entre notre demande de mise en place d'un comité de suivi et les événements qui se sont déroulés les 2 et 3 février. Si l'arrestation de M. Saleh y est directement liée, la manière dont ils se sont déroulés mériterait bien des commentaires et bien des interventions.
Vous avez notamment évoqué les conditions dans lesquelles la France est, de ce point de vue, amenée à se situer. Comme vous, je veux naturellement rendre hommage au travail de nos diplomates et de nos soldats qui ont permis la protection et l'évacuation d'une partie des ressortissants. Le président de la commission l'a naturellement fait à raison. Il serait donc injuste de ne pas le souligner. Il faudra toutefois parallèlement, comme l'a précisé M. Muzeau, que l'Assemblée nationale sache dans quelles conditions la France est militairement présente au Tchad, quelles sont les actions qu'elle mène, quelles sont celles qu'elle soutient au titre de la logistique, quelles sont éventuellement les actions qu'elle permet ou qu'elle protège. J'ai évoqué la question des hélicoptères. Ces interrogations sont légitimes. Contrairement à nos voisins, nous ne disposons pas aujourd'hui, ce qui est anormal pour une démocratie avancée comme la nôtre et considérant notre Constitution, des éléments d'information permettant d'avoir communication de toutes les bases juridiques à partir desquelles votre ministère ou celui de la défense est amené à intervenir. Les seules communications à notre disposition sont l'accord de 1976 et le dispositif Épervier que nous connaissons de manière assez générale et assez vague, qui encadre très strictement nos interventions et ne permet pas toute une série d'actions comme celles que vous avez décrites.
De la même manière, nous pouvons nous interroger sur des faits comme la livraison d'armes par la Libye, que vous avez vous-même évoquée lors d'une interview, et qui pose question. Si je m'en tiens à la lettre des textes que nous connaissons, la France aurait dû faire preuve, face à cette situation, d'une totale neutralité. Or je constate que tel n'a pas été le cas.
Vous avez également évoqué les événements. J'ai naturellement bien compris qu'ils sont à prendre en compte. Je ne peux tout de même pas m'empêcher d'observer – et j'appelle l'attention de la représentation nationale sur ce point – que ces événements se sont produits évidemment à l'initiative, condamnable et condamnée par la communauté internationale et le Conseil de sécurité, des rebelles. La commission d'enquête a rappelé les exactions extrêmement graves auxquelles les rebelles s'étaient livrés, mais aussi les forces armées tchadiennes. Je n'aurai peut-être pas le temps d'évoquer les dispositions qui figurent dans le rapport, mais je vous invite véritablement à vous y reporter. Je ne crois pas que l'on puisse se féliciter, d'une manière ou d'une autre, des conclusions ici présentées.
Il est précisé que « les rebelles, aussi bien que les forces de défense et de sécurité, ont commis des exactions constitutives de violations tant des dispositions du droit national que de celles des instruments juridiques internationaux. À cet égard, l'armée tchadienne s'est rendue responsable notamment de l'utilisation [nous sommes en langage diplomatique] disproportionnée et indiscriminée de la force au cours des bombardements opérés par des hélicoptères contre des rebelles implantés, en violation du droit international humanitaire, dans des sites non militaires et parmi les populations civiles. »
À plusieurs reprises, l'action des forces armées tchadiennes a été mise en cause. Je rappelle que, par l'accord de 1976, nous avons la responsabilité de l'organisation et de la formation de l'armée tchadienne. Je ne sais pas si nous sommes défaillants en la matière, mais il est certain que la façon dont cette armée tchadienne s'est comportée dans ces circonstances ne prouve pas l'efficacité de notre intervention.
J'en viens plus directement à la disparition de M. Saleh. Vous avez indiqué tout ce qui a été accompli par la France. Je veux être totalement juste dans cette affaire et il n'y a pas d'intention polémique dans mon propos. Vous avez eu raison de rappeler que le Président de la République lui-même a demandé et obtenu la mise en place de cette commission d'enquête, laquelle a pu travailler dans des conditions jugées décentes par tous, après de nouvelles interventions de la France. C'est en partie grâce à la France qu'elle a pu travailler dans ces conditions. Néanmoins, depuis que les conclusions sont connues, les choses n'ont plus avancé.
Si je veux saluer, monsieur le ministre, pour reprendre vos termes, votre engagement en la matière, je ne peux pas en dire autant des résultats obtenus. Je suis forcé d'observer que, par rapport aux événements que vous avez évoqués, vous vous êtes montré, sans doute du fait des circonstances, plus efficace pour obtenir des informations et des élargissements dans d'autres situations. Quand je parle de vous, je vise la France de manière générale. Si je me réfère à une affaire contemporaine de celle dont nous parlons, il est clair que la France a été plus rapide à obtenir l'élargissement des membres de l'Arche de Zoé que des informations sur le sort de M. Saleh

Cela signifie que la France, lorsqu'elle exerce pleinement sa volonté politique, peut sans doute obtenir des résultats dans le sens souhaité.
Je conclurai d'un mot, monsieur le président, sur la résolution. Nous réclamons, là encore, l'application des dispositions et des conclusions de la commission d'enquête auxquelles le gouvernement tchadien s'était engagé pour une part à se soumettre. Il est très clairement précisé à la disposition n° 11 de ces recommandations, que vous connaissez, monsieur le ministre : « Aux fins de veiller à l'application des présentes recommandations, le Gouvernement est prié d'instituer un comité restreint de suivi au sein duquel la représentation de la communauté internationale sera assurée. » C'est donc cela que nous souhaitons voir mis en oeuvre. Nous vous demandons d'agir en ce sens. L'Assemblée nationale est unanime sur ce point. L'obtenir serait, à mon avis, la garantie qu'une fois l'instruction terminée et les procès engagés, nous puissions cesser les débats et éventuellement les polémiques sur ce sujet pour nous référer à des décisions de justice incontestables.
À défaut, monsieur le ministre, nous continuerons ce combat, car nous ne pouvons pas nous résigner à ce que, dans un pays où la France exerce une telle influence, un homme tel que M. Saleh ait pu disparaître au nez et à la barbe des autorités diplomatiques et militaires françaises !

Je vais mettre aux voix l'article unique de la proposition de résolution…

Je demande la parole pour expliquer le vote du groupe UMP, monsieur le président !

Vous ne l'avez pas demandé à temps, ma chère collègue. Je suis désolé, le vote est annoncé. Je ne peux vous donner la parole.
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de résolution.
(L'article unique de la proposition de résolution est adopté.)

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la parentalité (nos 1468, 2344).
La parole est à Mme Danielle Bousquet, rapporteure de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, mes chers collègues, il y a un mois, notre assemblée adoptait à l'unanimité – je tiens à nouveau à le souligner – une proposition de résolution visant à promouvoir l'harmonisation vers le haut des législations européennes applicables à l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette résolution invite le Gouvernement à présenter au Parlement les initiatives qu'il entend prendre pour mettre en oeuvre dans le droit national les dispositions législatives et réglementaires les plus avancées déjà prises dans les différents États membres de l'Union européenne.
Pour ma part, je suis convaincue que les parlementaires doivent, eux aussi, prendre des initiatives pour garantir aujourd'hui l'égalité entre les femmes et les hommes et favoriser une meilleure articulation des vies familiale et professionnelle pour les deux parents dans les familles. Cela conduit, à l'évidence, à mieux garantir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Nous voici au coeur du sujet puisque nous abordons, cet après-midi, l'examen de la proposition de loi relative à la modernisation du congé de maternité et aux conditions d'exercice de la parentalité. Certes, nous conduisons une politique familiale volontariste qui a permis de soutenir le taux de fécondité le plus élevé d'Europe et qui fait l'objet d'une attention vigilante de la part de nos concitoyens. Cependant, depuis quelques années, madame la secrétaire d'État, nous observons que les attentes et les modes de vie des Français ont changé. C'est ainsi que l'articulation entre vie familiale et professionnelle devient un enjeu majeur dans l'organisation de leurs vies. C'est la raison pour laquelle certains outils de la politique familiale doivent, à mon sens, être adaptés à ces évolutions. Aujourd'hui sans doute plus que jamais, l'arrivée d'un enfant dans une famille est loin de relever seulement de la sphère privée. C'est, au contraire, une question centrale en termes d'organisation de la société, surtout lorsque l'on en connaît les conséquences néfastes s'agissant de l'égalité entre les femmes et les hommes.
La façon dont la maternité est organisée aujourd'hui s'avère un élément clé du maintien des rôles établis et de l'organisation sociale. Certes, de nombreuses Françaises parviennent à concilier bébés et travail, mais au prix de grands écarts personnels : le temps partiel subi, le stress au travail, les rythmes épuisants, la non-implication dans la vie sociale et politique. Les frustrations sont nombreuses. Beaucoup de femmes n'ont d'autre choix que de renoncer à leur vie professionnelle. Les chiffres le montrent : entre vingt-cinq et quarante-neuf ans, âge central pour l'activité professionnelle, une femme sur cinq n'est pas dans l'emploi et la moitié de celles qui ont de jeunes enfants et qui ont mis fin à leur vie professionnelle nous disent qu'elles auraient souhaité continuer leur activité, mais que c'était impossible parce que trop difficile.
Selon les études récentes aussi, un nombre croissant d'hommes se dit prêt à participer à l'éducation des enfants. Certes, la création du congé de paternité par Ségolène Royal en 2001 a constitué, de ce point de vue, une avancée. Cela n'a malheureusement rien changé dans la répartition des tâches. Or c'est aujourd'hui un enjeu majeur que notre société soit en mesure de s'adapter pour permettre aux parents d'assurer à parts égales leurs responsabilités au lieu de continuer à contraindre les femmes à jongler au prix des nombreux sacrifices déjà évoqués.
À toutes ces nouvelles attentes, il est de notre intérêt de répondre pour plusieurs raisons. Je citerai tout d'abord celle du vieillissement de la population et de l'augmentation des dépenses de retraite induites, de même que la nécessité de consolider la croissance potentielle du pays. Cela signifie qu'il faut à la fois maintenir un taux de natalité élevé et améliorer le taux d'emploi des femmes. Faciliter cette articulation des vies familiale et professionnelle pour les hommes et les femmes est donc un impératif économique qui doit être pris au sérieux, sans quoi nous risquerions d'en arriver à la situation que connaissent d'autres pays européens où les femmes sont contraintes de choisir : soit elles continuent à travailler, soit elles ont des enfants.
Bien sûr, il existe aujourd'hui de nombreux leviers pour favoriser cette articulation, comme le développement des modes de garde, qui tente de pallier le manque criant de places de crèche, ou l'adaptation des conditions et des rythmes de travail des parents dans les entreprises. Mais nous avons choisi une troisième voie, celle qui se cale sur les initiatives européennes et nationales récentes.
La Commission européenne a en effet déposé une proposition de directive en octobre 2008, visant à allonger le congé de maternité et à améliorer la protection des femmes enceintes. Ce texte a déjà été adopté en première lecture par le Parlement européen, et la majorité des États membres se sont déclarés favorables à l'allongement du droit au congé de maternité de quatorze à dix-huit semaines.
Le Conseil a également adopté une directive relative au congé parental, l'allongeant et affirmant qu'une période doit être prise par le père et ne peut être transférable à la mère. Le Haut conseil de la famille a rendu un avis qui va dans ce sens.
Il y a donc des initiatives multiples, et je souhaite que nous avancions nous aussi sur ces questions.
Si nous lions congé de maternité, congé de paternité et congé parental d'éducation, c'est parce que les séparer, c'est rester sur une vision passéiste de la famille ne prenant en compte ni la coparentalité ni la coéducation. Or l'éducation doit être pensée de manière globale et impliquer à égalité les deux parents. L'approche que nous défendons est transversale.
Certains articles, je le regrette, ont été jugés irrecevable au titre de l'article 40 de notre Constitution.

Je souhaite néanmoins en présenter rapidement le contenu, car je suis convaincue que ce sont des débats centraux dans notre société. Nous ne pourrons continuer, madame la secrétaire d'État, à ne pas les traduire en actes et à faire comme si ce n'étaient pas de véritables demandes sociales.
L'article 1er propose un allongement du congé de maternité à vingt semaines. D'abord, cela correspond à la réalité vécue, les femmes prennent en moyenne 150 jours, si l'on ajoute au congé de maternité les congés pathologiques et une partie de leurs congés. Ensuite, vingt semaines, c'est la durée minimale qui a été proposée par l'Europe. Enfin, cet allongement permettrait aux femmes de mieux se remettre de leur accouchement.
L'article 2 propose l'allongement de l'interdiction d'emploi d'une femme enceinte ou ayant accouché, jusqu'à dix semaines.
Afin d'anticiper l'adoption de la directive européenne, l'article 3 prévoit que l'indemnité journalière de repos est complétée par l'employeur de façon que les salariées en congé de maternité perçoivent 100 % de leur salaire antérieur.
L'article 4 prévoit un alignement de la durée et des conditions d'indemnisation des femmes non salariées sur celles du régime général. Pour certaines femmes qui travaillent à temps partiel, la maternité devient un véritable handicap et elles ne peuvent prendre l'intégralité du congé. Elles doivent être indemnisées.
L'article 5 crée un congé d'accueil de l'enfant, mieux rémunéré et légèrement plus long – vingt et un jours au lieu de quatorze – que le congé de paternité qu'il a vocation à remplacer, en s'inspirant directement de certains exemples du nord de l'Europe. Une meilleure rémunération et la reconnaissance du congé d'accueil de l'enfant comme une période de travail effective permettront de vaincre certains obstacles en raison desquels les pères et les compagnons de la mère, puisque nous étendons cette possibilité au partenaire, ne prennent pas ce congé.
L'article 6 vise à créer un congé parental partagé, mieux rémunéré et adapté aux besoins des parents d'aujourd'hui. On se rend compte en effet que l'arrivée d'un enfant pèse infiniment plus sur les femmes que sur les hommes, en particulier sur les femmes les moins qualifiées. Mmes Tabarot et Clergeau, dans leurs rapports respectifs sur l'extension des modes de garde et sur la prestation d'accueil de la petite enfance, en appellent toutes deux, alors qu'elles n'ont pas la même couleur politique, à une réforme du congé parental dans le sens d'un partage plus équitable entre les femmes et les hommes. C'est également l'avis du Haut conseil de la famille dans le rapport qu'il a rendu récemment.
S'inspirant des exemples étrangers, notre proposition prévoit le partage du congé avec le second parent, en affirmant que la part de 20 % qui n'est pas prise par ce dernier est perdue. C'est très important d'affirmer ainsi notre volonté
C'est parce qu'il n'y avait pas de consensus sur la durée du congé parental que nous avions maintenu dans le texte initial une durée de trois ans, parce que nous ne voulions pas interférer avec le débat sur la volonté de donner une place à l'autre parent dans l'éducation des enfants. Je suis cependant convaincue, en m'appuyant sur mon expérience et sur les différents rapports qui nous ont été rendus, que ce sont des femmes en grande difficulté et de toute façon éloignées de l'emploi qui choisissent de prendre un long congé. Il est important que ce ne soit pas une trappe à pauvreté et un mirage qui les éloigne définitivement du monde du travail. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté un amendement visant à limiter le congé parental partagé à dix-huit mois, mais en le rémunérant beaucoup mieux, à hauteur de 80 %, avec le plafond de la sécurité sociale comme limite, du salaire antérieur. Nous avions aussi envisagé qu'une part de trois mois au minimum soit prise par l'autre parent.
En conclusion, un seul et unique principe a guidé la rédaction de ce texte : donner aux femmes et aux hommes la possibilité de vivre mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale sans subir la contrainte sociale de l'assignation des rôles. C'est au fond le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes qui doit nous animer dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité.
Madame Bousquet, nous voici de nouveau ensemble dans cet hémicycle autour d'un sujet qui touche à la promotion et à la défense du droit des femmes mais, je vous le dis d'emblée, si nous avons pu nous retrouver sur la proposition de résolution visant à promouvoir l'harmonisation des législations européennes applicables aux droits des femmes et nous rejoindre sur la proposition de loi sur les violences faites aux femmes, nous ne pourrons pas, je le regrette, nous accorder sur le texte que vous nous proposez aujourd'hui.
Telle qu'elle ressort de la commission des affaires sociales, cette proposition vise pour l'essentiel à garantir le maintien d'un salaire intégral aux femmes en congé de maternité. Elle prévoyait initialement d'allonger celui-ci et de créer un congé parental d'éducation alternatif à ceux qui existent actuellement, rémunéré à 80 % du salaire. Ces dispositions, d'un montant estimé à plus de 3 milliards d'euros,…
…se sont heurtées à l'article 40 de la Constitution.
Bien qu'elles poursuivent un objectif louable et partagé, celui de protéger les femmes et d'améliorer l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle, elles n'auraient de toute façon pas convaincu la majorité, tant elles s'éloignent des objectifs de notre politique familiale, qui fait de notre pays le champion d'Europe du taux de fécondité et du taux d'emploi des femmes.
Ces excellents résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils s'expliquent par une politique ambitieuse, même en période de crise, qui se traduit par différents éléments :
D'abord, de gros moyens en direction des familles : la France consacre plus de 88 milliards d'euros à sa politique familiale, près de 5 % de notre PIB, soit deux fois plus que la moyenne des pays européens ;
Une offre de modes de garde diversifiés, dont la qualité nous permet de nous classer au troisième rang des pays de l'OCDE ;
Des congés de maternité adaptés, qui permettent à la femme de prendre du temps pour son enfant et pour elle-même, sans s'éloigner trop longtemps de l'emploi. Ainsi, les femmes en congé de maternité perçoivent une indemnité journalière pendant seize semaines, vingt-six si c'est leur troisième enfant et jusqu'à trente-quatre en cas de naissances multiples. Afin de garantir leur libre choix, une allocation parentale mensuelle d'un montant de 552 euros, le complément de libre choix d'activité, est versée si l'un des deux parents cesse son activité pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans.
Notre priorité est claire : nous voulons permettre aux familles un meilleur partage des temps de vie en développant l'offre d'accueil des jeunes enfants. Nous répondons ainsi au souhait des familles, qui nous disent massivement, à plus de 70 % selon une enquête du CREDOC, qu'elles ont plus besoin de modes de garde que de nouvelles prestations financières.
Dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion que j'ai signée avec la CNAF en 2009, et conformément à la volonté du Président de la République, nous nous sommes engagés à créer d'ici à 2012 près de 200 000 places d'accueil supplémentaires.
Cela représente un effort inédit de plus de 1, 3 milliard d'euros.
La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui emprunte un chemin profondément différent…
…en créant des dispositifs qui sont séduisants de prime abord mais qui pourraient bien se retourner contre les femmes.
Vous proposez d'abord un allongement de seize à vingt semaines du congé de maternité pour les salariées. Comme nous l'avons déjà dit dans le cadre de la proposition de directive communautaire, et comme l'a d'ailleurs souligné un rapport du groupe UMP dont vous étiez coauteur, madame Boyer, nous ne sommes pas par principe opposés à un allongement. Les dispositifs existants sont cependant déjà très protecteurs, et les femmes peuvent, si elles le souhaitent ou si elles en ont besoin, interrompre leur activité pendant une durée bien supérieure à la durée légale du congé de maternité, trente-huit jours de plus en moyenne. Ne serait-il pas, en outre, prématuré de modifier le droit français sur ce point alors que le projet de directive est encore en discussion au Parlement européen et qu'il fait l'objet de nombreux amendements ? Je note également que cette proposition générerait une grosse dépense pour les finances sociales, estimée à plus de 400 millions d'euros. Or notre priorité est de créer des modes de garde.
Vous souhaitez par ailleurs que l'employeur assure un maintien intégral du salaire pendant ce congé. Sur ce point, qui relève largement de la compétence des conventions collectives, une consultation des partenaires sociaux s'imposerait. Je ne suis pas convaincue qu'elle soit bien accueillie, et je ne suis pas certaine non plus qu'à trop rigidifier et complexifier le droit existant, nous n'arrivions pas à un résultat opposé : l'éloignement du marché du travail et la stigmatisation des femmes enceintes, qui apparaîtraient non plus comme un atout mais comme un handicap coûteux.
Votre volonté d'aligner la durée du congé de maternité des indépendantes sur celui des salariées, là encore, me paraît prématurée compte tenu de la négociation en cours au niveau européen. Le projet de directive sur la protection sociale des indépendants et de leurs conjoints aidants comporte en effet un volet concernant la maternité. Alors que, dans la version initiale du projet de directive, la Commission européenne avait prévu un alignement de la durée du congé de maternité des non-salariées sur les salariées, les discussions sur ce texte au niveau européen ont conduit la Commission à accepter que ce ne soit pas le cas. Il s'agit de s'adapter aux besoins concrets et spécifiques de ces professions. Ainsi, la durée envisagée est de quatorze semaines, alors que le projet de directive est de dix-huit semaines.
En ce qui concerne l'indemnisation du congé de maternité, votre proposition est redondante avec les dispositifs en place. Il existe déjà dans la législation de la sécurité sociale une protection relative à la maternité pour les femmes exerçant une activité non salariée, incluant l'adoption.
Vous voudriez également créer en droit du travail un congé parental d'une durée de douze mois au minimum, dont au moins 20 % seraient réservés à l'autre parent, alors qu'il est aujourd'hui de douze mois au maximum. Ce nouveau congé poserait au moins deux problèmes : trop long, voire trop rigide, il ne permettrait pas de répondre aux aspirations de l'ensemble des parents ; de plus, cette nouvelle proposition serait en retrait par rapport au système actuel, puisque les deux parents peuvent bénéficier chacun d'un congé parental jusqu'aux trois ans de l'enfant.
Vous proposez également de créer un revenu de remplacement de 80 % du dernier salaire brut pendant ce congé. Cependant, le salaire net d'un salarié payé au SMIC mensuel, par exemple, correspond à 78,5 % du salaire brut. Cela signifierait donc qu'en congé parental, le parent toucherait une indemnité supérieure à son salaire net.
Enfin, l'estimation du coût de la création d'un congé parental indemnisé à 85 % du salaire net est de 2,3 milliards d'euros. Pour une indemnisation à 80 % du salaire brut, on peut donc estimer que la dépense supplémentaire serait supérieure à 3 milliards d'euros. Or nous avons un devoir de responsabilité envers les générations futures : le coût de cette mesure aurait une incidence financière extrêmement négative pour les comptes de la branche famille, déjà profondément affectés par la crise.
Nos échanges me font songer aux débats relancés par l'ouvrage d'Élisabeth Badinter. (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
Elle note que, pour l'instant, le modèle français de la maternité résiste bien, mais qu'il est menacé. Menacé justement par des positions qui considèrent le temps passé auprès de l'enfant comme une solution à tous les remèdes, au risque de voir les femmes renoncer à avoir des enfants – tant la pression sur leur rôle de mère sera forte – ou inversement de les voir renoncer à leur travail. Nous visons, quant à nous, une forme d'équilibre.
Nous avons engagé les mesures permettant d'envisager plus sereinement la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et mobilisé des moyens substantiels en période de crise. C'est cette politique familiale, qui nous est d'ailleurs enviée par de nombreux partenaires européens, et même au-delà, que le Gouvernement entend soutenir.
Pour l'ensemble des raisons que je viens d'exposer, le Gouvernement est donc défavorable à l'adoption de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, j'ai pris connaissance avec intérêt de la proposition de loi de ma collègue Danielle Bousquet, et ce d'autant plus que le groupe UMP et son président Jean-François Copé m'ont confié une mission sur la santé des femmes, que j'ai réalisée de mars à octobre 2009 avec deux autres collègues, Bérengère Poletti et Guénhaël Huet. Mme la secrétaire d'État l'a d'ailleurs rappelé et je l'en remercie. Je lui ai remis notre rapport ainsi qu'à Mme la ministre de la santé Roselyne Bachelot en octobre dernier.

Ce rapport n'a pas été un point final, mais une étape, puisque j'entends poursuivre mon travail sur la santé des femmes, sujet passionnant, loin des revendications partisanes et idéologiques mais surtout proche des femmes, qui méritent que l'on améliore leurs conditions dans tous les domaines, en particulier la santé.
Si j'ai souhaité intervenir aujourd'hui, c'est au regard de mon investissement personnel au cours de cette mission sur la santé des femmes, et sur la question précisément du congé de maternité.
Pour mémoire, comme Mme la secrétaire d'État vient de le rappeler, le congé de maternité est fixé à seize semaines pour le premier enfant, à seize semaines également pour le deuxième enfant et à vingt-quatre semaines pour le troisième enfant. Une proposition de directive européenne, introduite par Vladimir Spidla, commissaire européen aux affaires sociales, souhaite porter de quatorze à dix-huit semaines la durée minimale du congé de maternité dans toute l'Europe.
L'allongement du congé de maternité rencontre un certain nombre d'oppositions faisant valoir le risque d'accentuer la discrimination entre hommes et femmes dans leur progression professionnelle. En tant que mère de trois enfants qui ai toujours poursuivi une activité professionnelle, je vous assure que ces arguments méritent d'être pris en compte ; c'est une certitude.
En même temps, force est de constater que l'allongement de la durée du congé de maternité présente également un grand nombre d'effets bénéfiques tant il permet aux mamans d'établir un lien privilégié avec leurs enfants dans les premiers mois de la vie, considérés par différents pédiatres comme déterminants pour l'enfant. Il possède également l'avantage de promouvoir une prolongation de l'allaitement maternel en facilitant son installation ; c'est un sujet, monsieur le président de la commission, dont nous avons beaucoup discuté. Pour bien installer un allaitement durant les premières semaines, il faut au moins six semaines ; or c'est précisément à cette période que la mère commence à penser à la reprise de son activité professionnelle et envisage un sevrage en vue de sa reprise d'activité à la dixième semaine.
Je me suis donc réjouie que ce sujet vienne en débat devant notre assemblée. Mais en prenant connaissance de la proposition de loi de notre collègue Danielle Bousquet, j'ai été déçue, car je ne partage pas son point de vue et ne peux malheureusement donc pas soutenir ce texte. Je vous en donnerai brièvement les raisons.
La proposition d'allonger de quatre semaines la durée du congé de maternité entraînerait une augmentation des inégalités professionnelles, déjà persistantes, entre les hommes et les femmes, et accentuerait une discrimination en défaveur de ces dernières par rapport à leur carrière professionnelle. C'est ce que j'appelle une fausse bonne idée.
Vous le savez, et nous le déplorons : les emplois à temps partiel concernent majoritairement les femmes – 31 % contre 6 % pour les hommes ; celles-ci ont moins facilement accès aux postes importants – un cadre sur quatre est une femme – et perçoivent des salaires, pour des fonctions équivalentes, moins élevés que leurs homologues masculins, avec un écart de 19 % à 23 %.

Le chômage est également plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Le taux de chômage pour les femmes âgées de vingt-cinq à quarante-neuf ans était en 2007 de presque 8 %, contre 6 % pour les hommes de la même tranche d'âge. Le taux d'activité des femmes est encore inférieur à celui de leurs homologues masculins.
Tous ces chiffres montrent que votre proposition d'allongement de quatre semaines, chère collègue, n'est pas judicieuse actuellement, car nous pouvons craindre que cela éloigne encore davantage les femmes du marché du travail et nuise à leur progression professionnelle, ce qui irait contre leur intérêt ainsi que celui de leurs familles. J'ose espérer que ni vous ni moi ne poursuivons cet objectif.
N'oublions pas que, même si, en France, l'âge moyen des femmes à la naissance de leur premier enfant est passé à trente ans en 2009 – trente et un ans et demi à Paris –, ces maternités ne remettent pas en cause le taux de fécondité. Celui-ci reste, malgré la crise, l'un des plus forts d'Europe. Nous arrivons juste après l'Irlande. Aujourd'hui, quatre femmes sur dix ont des enfants, deux sur dix n'en ont qu'un, deux sur dix en ont trois, et elles ne sont qu'une sur dix à dépasser quatre enfants. La moyenne en France est tout de même satisfaisante au regard de l'Union européenne, puisque nous enregistrons 790 000 naissances en 2009.
Les femmes ont leurs enfants en même temps qu'elles construisent leur carrière et elles se retrouvent souvent seules à les élever. Ne les pénalisons pas trop et surtout ne mettons pas en péril leur avenir. Au lieu d'envisager de façon provocatrice et brutale un allongement du congé de maternité de quatre semaines sans aucune mesure d'accompagnement, il conviendrait, dans un contexte économique si difficile dont les femmes sont le plus victimes, d'engager une réflexion sur une meilleure harmonie entre activité professionnelle et maternité. C'est ce que nous préconisons dans le rapport sur la santé des femmes, dans lequel nous formulons quelques propositions ou plutôt pistes de réflexion.
Si nous avons proposé de réfléchir à un allongement du congé de maternité, j'ai cependant suggéré que cet allongement soit de deux semaines, comme la proposition de directive européenne. Le passage à dix-huit semaines de congé de maternité, soit douze semaines post-natales, permettrait de résoudre le problème de la garde du nourrisson lorsqu'il va en crèche, puisque ces établissements ne les acceptent qu'à partir du troisième mois, c'est-à-dire douze semaines, alors que le congé de maternité post-natal dure deux mois et demi, soit dix semaines.
Cet allongement pourrait également s'accompagner d'une liberté supplémentaire pour la femme : la liberté de reprendre, si elle le souhaite, son travail de façon anticipée à partir de la seizième semaine et selon des horaires aménagés définis avec son employeur dans le cadre des conventions collectives. En effet, il s'agit d'abord d'une question de pragmatisme et surtout de prise en compte de la nécessité de ne pas éloigner trop longtemps les femmes du travail à l'occasion de leur maternité, pour ne pas obérer leur avenir.
Je constate que la proposition de loi qui nous est soumise est loin d'avoir mesuré tous ces inconvénients.
Une autre proposition intéressante à explorer serait de rendre modulables entre les deux parents ces deux semaines supplémentaires. Il appartiendrait au couple d'en disposer comme il l'entend, en fonction de l'organisation professionnelle et familiale du ménage.
Je crois qu'en la matière, il faut être flexible et imaginatif. Il est important de repenser le congé de maternité en tenant compte des intérêts de l'enfant, de la mère, du père, mais également de l'employabilité des femmes et des discriminations dont elles sont encore victimes.
Les femmes françaises souhaitent de plus en plus conjuguer maternité et vie professionnelle. La solution ne peut être dans un allongement pur et simple du congé de maternité. Si l'on décide de l'allonger, il faudrait également l'aménager et surtout le financer. C'est ce que je propose dans le rapport précité.
Aujourd'hui, si une mère bénéficie de seize semaines de congé de maternité pour le premier comme pour le deuxième enfant, elle ne bénéficie en revanche que de vingt-quatre semaines pour le troisième. Cette situation mériterait d'être examinée et éventuellement d'évoluer car, vous en conviendrez, le passage de premier au deuxième enfant ne peut être traité comme la naissance d'un seul enfant.
Si les intentions de la proposition de loi de Danielle Bousquet sont au départ sûrement excellentes, l'enfer est pavé de bonnes intentions et je regrette de ne pouvoir y souscrire. La France n'est pas une île ; on ne peut proposer brutalement, dans un contexte de crise si profonde, un mois complet supplémentaire de congé de maternité sans aucune concertation avec les partenaires sociaux, les entreprises et les administrations, et surtout sans en discuter avec nos voisins européens pour parvenir à une harmonisation au sein de l'Europe tout en restant concurrentiels.

Je suis certaine que d'autres réponses, moins coûteuses pour notre système de protection sociale et surtout moins lourdes de conséquences négatives pour la vie des femmes et de leurs familles, peuvent être apportées. Elles permettraient de renforcer l'égalité hommes-femmes et d'améliorer les conditions parentales de nos concitoyens au moment où ils réalisent l'un des actes les plus beaux du monde : donner la vie et accueillir un enfant dans une famille.
Pour ma part, je souhaite que l'on ouvre une réflexion en profondeur sur ce sujet et je continuerai à me battre pour défendre mes positions et surtout tenter d'améliorer la vie des femmes, des Françaises, qui, en Europe, sont celles qui ont le taux de natalité le plus élevé, signe qu'en France une femme veut et peut avoir des enfants. À nous de faire des propositions pour qu'elles vivent avec encore plus de plaisir ce merveilleux moment. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, le 18 février dernier, nous nous sommes félicités de l'adoption à l'unanimité – une fois n'est pas coutume, même si cela s'est reproduit tout à l'heure – d'une résolution présentée par notre groupe et visant à promouvoir l'harmonisation par le haut des législations européennes applicables aux droits des femmes, suivant le principe de la clause de l'Européenne la plus favorisée.
Cela doit nous conduire à reconnaître que si la loi française peut parfois servir de référence européenne en matière de résultats des politiques familiales – cumul d'un bon taux d'activité des femmes et de l'un des premiers taux de fécondité –, elle est aussi largement perfectible en ce qui concerne l'arrivée d'un enfant et la conciliation de la vie familiale et professionnelle, comme l'a rappelé la rapporteure.
Ainsi, l'objet de notre proposition de loi est en quelque sorte de passer de la théorie à la pratique.
Nous y sommes d'ailleurs invités par l'Europe à la suite de l'adoption, le 8 mars, de la directive sur le congé parental, qui porte ce dernier de trois à quatre mois et qui établit le principe d'un mois non transférable entre parents ainsi qu'une négociation obligatoire avec l'employeur sur l'aménagement d'un horaire de travail au retour du congé parental.
La présente proposition de loi s'inscrit dans la lignée de ces initiatives européennes. Elle vise à garantir les droits des femmes et à favoriser leur accès à l'emploi, à favoriser un meilleur partage des tâches entre les genres, et à améliorer la conciliation des vies familiale et professionnelle.
Le débat que nous allons avoir aujourd'hui va être l'occasion de vous interroger, madame la secrétaire d'État, sur ce que vous comptez faire et nous offre surtout l'opportunité, même si de nombreux articles sont tombés sous le coup de l'article 40, de présenter nos propres propositions.
À cet égard, il s'agit tout d'abord d'allonger la durée du congé de maternité, la France se situant dans la moyenne basse en Europe. Notre proposition de loi vise à adapter notre législation à l'évolution du droit européen et à la réalité du congé de maternité. Nous proposons d'en augmenter la durée de seize à vingt semaines, avec le maintien intégral du salaire.
Deuxième proposition : allonger et élargir le congé parental. Guidés par cette même logique, et comme le préconise le rapport de notre collègue Marie-Françoise Clergeau sur la prestation d'accueil du jeune enfant, nous proposons un congé de paternité de quatorze jours consécutifs, que nous rebaptisons « congé d'accueil de l'enfant » pour élargir le champ des bénéficiaires à l'ensemble des conjoints, quel que soit leur sexe. En créant ce congé d'accueil de l'enfant et en ouvrant la possibilité d'en faire bénéficier la personne vivant maritalement avec la mère et impliquée dans l'éducation de l'enfant, ce texte contribue à l'évolution de notre législation pour l'adapter aux réalités actuelles des familles.
Enfin, il s'agit d'engager le débat sur la modernisation du congé parental d'éducation. Ce congé est très peu répandu chez les hommes ; il faut reconnaître que la faiblesse des contreparties financières représente un réel frein. Tandis que de nombreux pays européens, en particulier les pays nordiques, ont clairement décidé de valoriser le congé parental, en insistant sur la nécessité de le partager entre les deux parents, la France fait, là encore, figure de retardataire.
C'est pourquoi notre proposition de loi propose un congé parental pouvant durer non pas trois ans, comme dans le texte initial, mais, aux termes d'un amendement, dix-huit mois, congé mieux rémunéré à condition qu'il soit partagé entre les deux parents.
Au-delà des propositions contenues dans notre texte, son examen doit aussi ouvrir une réflexion sur la politique familiale s'articulant autour de trois axes.
Le premier axe est la reconnaissance des « nouveaux pères ». En tant que représentant de la gent masculine, je me dois d'insister sur l'importance de l'implication du père dans l'éducation de l'enfant. Autrefois cantonné à incarner le pater familias, symbole de l'autorité au sein de la famille, il est désormais présent au même titre que la mère pour gérer tous les aspects du quotidien. Parallèlement à la montée en puissance du travail des femmes – en 2008 près de 70 % des femmes appartenant à la population active exerçaient un emploi, contre 75 % des hommes –, le rôle des pères a effectivement évolué. Ceux que l'on a désormais coutume de qualifier de « nouveaux pères » s'investissent dans les soins apportés aux enfants dès les premiers jours.
Ces affirmations méritent néanmoins d'être relativisées. Plusieurs études ont démontré l'existence d'un décalage entre la conception du « nouveau père » et la conduite de ces hommes pour accomplir les tâches du quotidien. D'importantes différences sont observées quant à la nature des besognes accomplies. Et le partage des missions parentales n'est pas interprété de la même façon suivant que l'on se place du côté du père ou de la mère.
Toutefois, pour un père, trouver sa place n'est pas chose évidente. Si les pères ont toujours été physiquement présents, ils le sont désormais socialement, et c'est à la société de les encourager.
Le congé de paternité, crée en 2001 par Ségolène Royal, alors ministre de la famille, a été un pas décisif en ce sens. En incitant le père à rester avec son enfant et sa conjointe après l'accouchement, il développe le sentiment de paternité et l'implication du père dans le partage des tâches. Nos sociétés ont trop souvent sanctuarisé le lien exclusif entre la mère et son bébé en insistant, cela a été rappelé, sur l'importance de l'allaitement, balayant ainsi la présence du père dès les premiers instants de la vie de l'enfant. Or, à travers notre proposition de loi, nous tentons de corriger ce phénomène afin que le père soit impliqué à part entière.
Cela étant, tous les pères ne prennent pas leur congé de paternité – seulement deux tiers d'entre eux en avaient pris en 2004 –, et celui-ci ne représente que 4 % des congés parentaux. L'analyse de ces chiffres tend avant tout à mettre en exergue la persistance de stéréotypes dans la définition des rôles parentaux mais aussi les obstacles économiques qui doivent être levés.
D'où le second axe de réflexion : l'amélioration de l'indemnisation des congés familiaux. En effet, la rémunération est un facteur déterminant dans la prise du congé. La désaffection des pères et de certaines femmes pour le congé parental est principalement due à sa faible indemnisation. Une amélioration de celle-ci est donc indispensable. Elle doit s'inscrire dans une meilleure gestion des ressources humaines par le maintien des femmes dans la population active, quitte à en réduire la durée et à prévoir un accompagnement du retour à l'emploi. Je reconnais que la question du montant de l'indemnisation est délicate : si elle est trop basse – comme actuellement –, ou au contraire trop haute, elle tend, dans les deux cas, à éloigner les femmes du marché du travail. À ce titre, elle doit être plafonnée.
Troisième axe de réflexion : rapprocher les congés parentaux pour créer un droit à prendre du temps pour élever ses enfants. Un pays européen, la Suède, guidé par une véritable volonté de réduire le conflit entre travail et vie personnelle, propose un congé parental très souple qui se confond avec le congé de maternité et qui valorise la participation du père aux soins de l'enfant. Cette conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle engendre par ailleurs une diminution du nombre d'arrêts maladie, abaissant conséquemment les coûts des prestations sociales. Ainsi, je considère qu'il est primordial de rattacher la réforme du congé de paternité à celle du congé de maternité, mais aussi à celle du congé parental d'éducation. Je pense qu'il faudra à terme rapprocher ces différents congés, dans une sorte de congé familial ne se limitant pas à la petite enfance, attaché à chaque individu et, bien évidemment, abondé à chaque naissance. Un tel dispositif permettra de dégager, aux différents âges de la vie, du temps pour la solidarité familiale et pour l'éducation. Ce sera la meilleure solution pour promouvoir une implication paritaire des deux parents.
À ce sujet, je souhaite revenir sur la nécessaire évolution du rôle des hommes, mais aussi des femmes. D'un côté, il est encore difficile d'admettre qu'un père soit aussi qualifié qu'une mère pour s'occuper d'un nouveau-né, mais, de l'autre, comme le décrit Dominique Méda, si on est passé du modèle de « monsieur Gagnepain et madame Au Foyer », où l'homme est apporteur de revenus et la femme pourvoyeuse de soins, à un modèle où les deux sont apporteurs de revenus, c'est encore bien souvent la femme qui continue de porter l'essentiel des tâches domestiques et d'éducation.
Oui, c'est vrai.

Malgré l'augmentation des taux d'activité féminins, le déséquilibre persiste entre les genres dans la répartition entre temps professionnel et temps consacré aux activités domestiques et parentales. Il s'agit donc de mettre en oeuvre un modèle où deux apporteurs de revenus sont aussi deux apporteurs de soins. L'emploi des femmes est le seul moyen de garantir l'égalité des genres tout en assurant la croissance économique. Une femme qui travaille rapporte plus à la collectivité que ce que coûte la garde qui, par ailleurs, génère elle-même de l'emploi, et l'ensemble contribue donc à un meilleur équilibre de l'économie et des comptes sociaux.
Mais la question centrale qui demeure est celle de la prise en charge des soins aux jeunes enfants. Faut-il la déléguer à une structure extérieure au ménage ou mieux la partager entre les parents ? La première solution est la plus favorable à l'emploi des femmes et à l'emploi global – à condition de mettre en place les financements –, mais elle peut être négative pour le très jeune enfant, notamment s'il a moins d'un an, et frustrante pour les parents qui souhaitent, curieuse expression, « profiter de leurs enfants ».
Il ne s'agit pas d'opposer un modèle à l'autre ; bien au contraire, la solution passe par la diversité des réponses et des modes de garde, et vraisemblablement par la possibilité de les mixer : un congé de maternité sécurisé et rallongé, doublé d'un congé de paternité, suivi d'un congé parental amélioré et modernisé ou de l'accueil de l'enfant dans des structures professionnelles, structures qui doivent relever, à mon sens, d'un service public local, jusqu'à l'entrée en maternelle. Voilà le dispositif que nous proposons au travers de cette proposition de loi. Mais, comme l'indique l'avis du Haut conseil à la famille sollicité sur une éventuelle réforme du complément de libre choix d'activité, « quelle que soit l'option retenue, il y a un consensus sur la nécessité de faire porter les efforts sur les modes d'accueil des jeunes enfants, sur l'accompagnement vers l'emploi et sur les conditions de travail des parents ».
C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, nous sommes impatients, après des mois d'hésitations et d'atermoiements sur les principaux sujets concernant la famille, de connaître vos intentions. Comment comptez-vous tenir les promesses du Président de la République en termes de nombre de places d'accueil supplémentaires autrement que par un décret qui abaisse les normes d'encadrement et de qualité et qui suscite, vous le savez, une forte contestation des professionnels de la petite enfance ?

Comment pensez-vous engager le processus de transposition des directives européennes autrement qu'en dérégulant le secteur de la petite enfance ?

Envisagez-vous de mener une réforme du congé parental d'éducation. J'ai cru comprendre que non. Enfin, comment pensez-vous tenir la promesse de reconnaissance de toutes les familles sur laquelle vous vous êtes personnellement engagée ? Madame la secrétaire d'État, vous connaissez désormais nos propositions. Nous attendons vos réponses. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, le taux de natalité reste fort en France, mais il subit la même baisse structurelle que dans les autres pays d'Europe. Il n'est d'ailleurs pas anodin que des institutions européennes se soient emparées de ce problème. Remarquons également que pour de multiples raisons, l'âge de la maternité ne cesse de reculer, les femmes devenant désormais mère pour la première fois après l'âge de trente ans. Notre pays doit investir pour l'égalité des sexes, réduire les obstacles rencontrés par les femmes dans leur carrière professionnelle, sur laquelle la maternité a un impact négatif, à la différence de la paternité. Il est également nécessaire de s'appuyer sur les évolutions de la famille et d'agir pour réduire les inégalités qui perdurent à l'arrivée d'un enfant, à la fois entre les sexes et entre les catégories sociales.
Le rapport d'information du Sénat sur l'activité de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes pour l'année 2005-2006 souligne que « le modèle familial traditionnel, fondé sur un couple composé d'une femme et d'un homme unis par les liens du mariage et ayant des enfants communs, n'est certes pas contesté, mais ne constitue plus dans les faits le seul mode d'organisation de la vie familiale ». Familles monoparentales, familles recomposées, couples pacsés ou unions libres, les structures familiales se diversifient. Le droit doit évoluer avec elles, dans l'intérêt de tous, à commencer par celui des enfants.
L'ensemble des mesures proposées par le groupe SRC dans son texte initial constituait des avancées notoires. Il est extrêmement regrettable que le texte ait été vidé de sa substance pour des raisons financières, du fait de l'application couperet de l'article 40.

Il constituait indiscutablement un progrès puisqu'il ouvrait des droits pour les personnes qui n'existent pas aux yeux de la loi actuelle, mais qui pourtant assument un rôle prépondérant auprès des enfants ; il améliorait l'accueil du nouveau-né tout en garantissant la santé des mères, avec un allongement du congé de maternité de seize à vingt semaines et de la durée d'interdiction d'emploi de huit à dix semaines. De telles mesures auraient permis de réduire l'impact des activités professionnelles sur la santé, pour toutes les femmes puisque les non-salariées en auraient également bénéficié : en période prénatale afin d'éviter les naissances prématurées et préparer au mieux l'arrivée du bébé, mais également après l'accouchement, car il est prouvé que la période de récupération psychologique et physique dépasse largement la durée légale du congé de maternité, comme en témoigne notamment la prescription très fréquente par les professionnels de santé de congés dits « pathologiques », d'une durée moyenne de vingt et un jours. Quant à la création d'un congé d'accueil pour le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère ou la personne avec qui celle-ci a conclu un PACS, d'une durée de quatorze jours contre les onze jours du congé de paternité actuel, cela allait également dans le bon sens.
Ces deux dispositifs étaient d'autant plus intéressants qu'ils étaient couplés à une obligation pour les employeurs de verser à leurs salariés une indemnité compensatrice se cumulant aux indemnités journalières accordées par la sécurité sociale, permettant ainsi le maintien de leurs revenus. Il s'agit d'une mesure qui réduirait les obstacles matériels conduisant les hommes, notamment les jeunes en situation précaire, à renoncer au congé de paternité, qui instaurerait une égalité entre les femmes salariées – car les conventions collectives ne prévoient pas toujours le maintien de leur revenu – et qui améliorerait les conditions d'accueil de l'enfant puisque, il ne faut pas l'oublier, l'arrivée d'un enfant augmente considérablement les dépenses du ménage.
Nous sommes également favorables à ce que le temps passé à l'accueil et à l'éducation des enfants soit assimilé à du temps de travail effectif pour ne pas pénaliser les carrières et les retraites des parents, notamment des femmes. Car si les configurations familiales sont multiples, les inégalités demeurent, hélas ! dans la répartition des travaux familiaux et surtout dans l'évolution des carrières professionnelles. Cela explique que 83 % des femmes retraitées ont une pension inférieure au minimum vieillesse et que celle-ci est en moyenne de 38 % inférieure à celle des hommes.
Enfin, concernant le congé parental d'éducation, personne ne s'oppose à son existence. Le débat est ouvert sur sa durée, sur la possibilité de l'alternance entre le père et la mère, sur son caractère fractionnable ou non. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'aspiration première des parents est de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Selon le rapport de Mme Bousquet, « un tiers des parents déclare n'avoir pas eu le sentiment de choisir entre plusieurs modes de garde et d'avoir, en quelque sorte, été contraints d'arrêter de travailler pour garder eux-mêmes leurs enfants ». C'est un point incontournable, qui renvoie à la question cruciale du libre choix du mode de garde, malheureusement pas mis en oeuvre par le Gouvernement, et qui n'est pas traité dans ce texte.
Or, sans le développement de modes de garde collectifs et d'aménagements du temps de travail, le congé parental devient un moyen de pallier le manque d'offre de garde publique. Selon le rapport de Mme Tabarot, il manque encore 320 000 places en crèche pour les moins de trois ans. Les parents adressent pourtant au Gouvernement et à la représentation nationale des signaux clairs. D'une part, ils plébiscitent les modes de garde collectifs dans les études qualitatives puisque, selon l'étude de la Caisse nationale d'allocations familiales réalisée en novembre 2009 avec le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, la part de population estimant que les équipements ou les services collectifs sont préférables aux aides financières pour aider les familles est passée de 36 % à 65 % au cours des vingt dernières années, contre 50 % à 34 % pour les aides monétaires sous forme d'allocation. D'autre part, il faut noter que les parents se mobilisent, avec les professionnels, contre les réformes en cours remettant en cause la qualité de l'accueil dans le secteur de la petite enfance, comme le démontre le succès grandissant des actions menées par le collectif « Pas de bébé à la consigne ». Si les modes de garde collectifs obtiennent la préférence des familles, c'est tout simplement parce qu'ils garantissent un encadrement de qualité, avec des personnels formés et qualifiés, ce qui est essentiel pour le développement physique et la construction psychique des tout-petits.
Mais alors que la création d'un service public de la petite enfance était une promesse du candidat Sarkozy à l'élection présidentielle de 2007, madame la secrétaire d'État, avec le fameux « décret crèches », vous prévoyez de déréglementer le secteur de la petite enfance, en revoyant au rabais la formation des professionnelles et en faisant passer de dix à douze le nombre d'enfants dont elles auront la responsabilité. Vous choisissez également de renvoyer au secteur privé la prise en charge des jeunes enfants par vos choix de financement et en déréglementant toujours plus l'accueil par les assistantes maternelles, ainsi qu'en faisant entrer la petite enfance dans le champ d'application de la directive « Services ».
Ces choix sont inacceptables. Ils vont de pair avec le rejet par la majorité, en commission des affaires sociales, de tous les articles du texte que nous discutons, au motif qu'ils créeraient de nouvelles dépenses et de nouvelles charges pour les entreprises. Si nous ne nous faisons pas trop de soucis pour la situation financière des entreprises du CAC 40, nous avons bien sûr tous en tête le montant du déficit de la sécurité sociale, que vous laissez filer d'année en année,…

…sans jamais prendre l'argent où il est, sans jamais, par exemple, toucher au bouclier fiscal. Les mesures préconisées par ce texte, telles que le développement des crèches, sont bien plus pertinentes que le bouclier fiscal, la réduction de la TVA dans la restauration ou les dizaines de milliards d'exonérations de cotisations sociales patronales : l'impact de ces dispositions sur l'emploi et les salaires reste à prouver, comme le disait M. Séguin, mais leurs effets désastreux sur les finances publiques sont patents. Les mesures proposées permettraient de constituer des investissements pour l'avenir de notre société puisque les citoyennes et les citoyens qui travaillent tout en élevant leurs enfants créent des richesses, apportent des recettes fiscales et des cotisations sociales. J'ajoute qu'avec un fort taux de natalité et une conciliation des activités professionnelles avec la vie familiale, le débat sur le financement des retraites se poserait tout autrement.
Considérant les avancées qu'il contient, nous voterons ce texte. Mais nous insistons fortement pour le développement des modes de garde collectifs, garants de solutions attendues et d'efficacité réelle.

Madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, le sujet que nous abordons aujourd'hui – les différents congés liés à la naissance : congé maternité, congé paternité et congé parental d'éducation – présente à l'évidence un intérêt majeur. Il mérite toute l'attention du législateur et une approche particulièrement humaine et généreuse.
En préambule de votre proposition, madame la rapporteure, vous affirmez que la maternité reste un obstacle à une réelle égalité professionnelle. J'ai également noté dans votre intervention les mots que vous avez employés à propos de la maternité : conséquences néfastes, frustration, énorme sacrifice, handicap, etc. Ils m'ont particulièrement choquée. Quel dommage de ne la limiter qu'à cela !

J'affirme quant à moi que la maternité est avant tout une véritable chance. Le bonheur de porter un enfant, puis d'être mère, est inégalable.

Cela commande qu'on fasse tout pour aider les femmes dans leur épanouissement personnel, familial et professionnel.
Probablement et heureusement, la quasi-totalité de femmes partage cette idée…

…puisque la France peut s'enorgueillir d'une démographie dynamique.
Notre pays affiche de très bons indicateurs : un des meilleurs taux de natalité – légèrement supérieur à deux enfants par femme ; un taux d'activité des femmes élevé – quatre sur cinq travaillent – ; et une politique familiale développée puisque l'État lui consacre presque 5 % de son PIB, soit 88 milliards d'euros, ce qui nous classe ainsi en troisième position au sein de l'OCDE.
Après vous, madame la secrétaire d'État, je me permets de rappeler à nos collègues de l'opposition que le Gouvernement oeuvre dans ce domaine.
Partant de ce constat, et à l'instar de nombre de mes collègues, je suis totalement convaincue de l'importance d'une politique familiale ambitieuse et qui réponde aux exigences des évolutions de notre société.
Or si l'intention qui sous-tend votre proposition de loi peut paraître généreuse, voire louable, je crains malheureusement qu'elle ne réponde pas véritablement aux attentes des femmes.
Que nous demandent-elles ? Sûrement pas de rigidifier le dispositif des congés maternité et d'éloigner les femmes de l'emploi, encore moins en cette période de crise économique que nous traversons. Elles nous demandent plutôt d'apporter de la souplesse et une liberté de choix :pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle.

Nous menons une politique qui protège les femmes pendant et après leur grossesse, qui tient à faciliter le retour vers l'emploi des femmes après leur grossesse, qui offre des solutions de garde adaptées, qui promeut l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Près d'une femme sur deux prend un congé parental par défaut, faute d'avoir trouvé un mode de garde adapté. Faciliter la garde est une exigence et le Gouvernement ne s'y est pas trompé. Il apporte des réponses concrètes : 200 000 places de garde supplémentaires d'ici 2012…

Le Gouvernement a aussi étendu le congé maternité rémunéré aux femmes qui exercent des professions non salariées, aux femmes et aux conjointes collaboratrices des assurés relevant du régime social des indépendants et du régime agricole. Nous devons probablement aller encore plus loin, mais ceci est l'affaire de tous.
Les entreprises doivent s'impliquer davantage dans le développement de l'offre de garde. En revanche, je ne souscris pas à votre proposition de les amener à compléter le salaire de la salariée pendant son congé de maternité de vingt semaines, au-delà des 2 885 euros nets par mois versés par la sécurité sociale.
Il est évident que cette mesure, qui représenterait une charge très lourde pour les entreprises, serait totalement contre-productive. Elle nuirait à l'emploi des femmes et se retournerait contre la parité.
Dans ce secteur, il faudrait au contraire développer l'offre de garde, notamment par la création de crèches d'entreprises ou grâce au financement de berceaux, car c'est là une attente forte des salariés parents. Actuellement, seulement 2 % des entreprises proposent à leur salarié une place en crèche.

Notre rôle, s'il est bien de s'emparer de ce sujet, mérite qu'on le prenne en considération avec lucidité et responsabilité.
Lors des débats en commission, nous avons relevé le fait que vous ayez totalement occulté, madame la rapporteure, un aspect pourtant essentiel : le financement de la plupart de vos mesures.
Quelle crédibilité, dès lors, apporter à votre proposition de loi qui prône de nouvelles dépenses non chiffrées ? C'est un peu facile et contradictoire, vous en conviendrez, alors que dans le même temps, vous n'avez de cesse de nous reprocher les déficits publics et sociaux.

Permettre de profiter pleinement d'une naissance, moment merveilleux s'il en est, allonger la durée des congés liés à la naissance, étendre le champ des bénéficiaires et leur indemnisation… Comment ne pas partager votre analyse ?
Mais vous le savez, les sujets que vous développez font déjà l'objet de discussions et d'expertise, tant au niveau de la Commission européenne – proposition de modification de la directive de 1992 relative à la sécurité des femmes enceintes, accouchées et allaitantes – qu'au sein du Haut Conseil de la famille, chargé de mener une réforme globale du congé parental.
Notre collègue Michèle Tabarot a également rendu un rapport, en juillet 2008, qui proposait un nouveau congé, partagé entre les parents, mais aussi plus court et mieux rémunéré.
De même, le rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, la MECSS de juillet 2009, sur la prestation d'accueil du jeune enfant, estimait « souhaitable de parvenir [...] à un congé parental réformé, plus court, mieux indemnisé, partagé et souple ».
Dans la perspective d'une véritable modernisation des congés liés à la naissance, je suis donc plutôt favorable à ce que nous attendions le vote de la future directive européenne à ce sujet…

…et bien évidemment je ne voterai pas en faveur de la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui nous rappelle combien il reste encore beaucoup de chemin à parcourir sur la voie de l'égalité, pour les droits des femmes et notamment dans la conciliation entre vie personnelle et familiale et vie professionnelle.
Certains considèrent – et le disent – que la France a déjà une législation très protectrice, que le taux de natalité est élevé dans notre pays puisqu'il dépasse le seuil de 2,02 enfants par femme, ce qui justifierait de ne rien faire, de ne pas toucher à notre législation.
Pourtant, même en tenant compte de ces bons indicateurs, tout en reconnaissant révolution des politiques familiales, nous devons faire progresser notre droit pour diverses raisons : notre société évolue ; les structures familiales bougent ; la place des pères dans l'éducation des enfants change ; les femmes doivent pouvoir mieux concilier vie familiale et vie professionnelle ; nous devons offrir aux jeunes parents des réponses adaptées à leurs besoins.
La France ne dispose pas d'une législation des plus protectrices dans l'Union européenne. Il est de notre responsabilité d'y travailler, notamment après l'adoption à l'unanimité de la résolution tendant à promouvoir l'harmonisation vers le haut des législations européennes applicables aux droits des femmes. Nous avons donc l'occasion de mettre très vite en pratique cette résolution et de transformer les bonnes intentions en réalité concrète pour les femmes.
Nous allons donc voir aujourd'hui le degré de sincérité de celles et ceux qui, à l'unanimité, ont voté la résolution et qui ont là une occasion de la mettre en oeuvre.
J'ai quelques inquiétudes, je l'avoue, sur l'attitude de la majorité parlementaire : elle a déjà rejeté tous les articles en commission, faisant ainsi preuve d'une grande ouverture d'esprit…

Écartons par avance l'argument récurrent – et pour tout dire un peu lassant – avancé en commission : « Oui, mais ça va coûter de l'argent. » Certes, mais pas trois milliards d'euros comme vous le prétendez, madame la secrétaire d'État. Votre calcul a été établi sur une durée de congé éventuelle de trois ans et non de dix-huit mois comme nous le proposons.

Nous proposons aussi le plafonnement. Votre chiffre de trois milliards d'euros est donc erroné, permettez-moi de vous le dire.
Les mesures figurant dans cette proposition de loi vont coûter de l'argent car elles vont permettre à des familles, à de jeunes parents de mieux vivre leur parentalité, d'accueillir leur enfant dans de meilleures conditions. Il est des dépenses qui sont des investissements sur l'avenir ; favoriser la natalité c'est aussi faire le pari de l'avenir.
Si votre majorité manquait d'imagination, je vous suggère une piste pour dégager les marges budgétaires suffisantes : abrogez enfin le bouclier fiscal !
Ce texte propose donc de rallonger le congé de maternité de quatre semaines, le portant ainsi de seize à vingt semaines. Il s'agit bien d'améliorer encore la protection de la santé des femmes.
Cette nouvelle durée du congé de maternité va dans le sens des décisions du Parlement européen qui, le 23 février dernier, a adopté un rapport préconisant la création d'un congé de maternité de vingt semaines continues, intégralement rémunéré à hauteur du dernier salaire, dans tous les États membres.
D'ailleurs, madame la secrétaire d'État, je crois qu'au nom du Gouvernement, il y a quelques mois déjà, vous vous êtes déclarée favorable à cette évolution. J'espère que vous êtes toujours d'accord avec vous-même !
Ce rallongement du congé maternité est aussi une façon de mettre en cohérence notre droit avec une réalité : 70 % des femmes ont un congé maternité supérieur à seize semaines par le biais des arrêts de travail et congés thérapeutiques.
En toute cohérence, et en anticipant là encore l'évolution du droit européen, il nous est proposé de maintenir l'intégralité du salaire de la femme en congé de maternité.
L'article 5 du texte propose la création d'un congé d'accueil de l'enfant de deux semaines permettant au père, au conjoint ou à la personne vivant maritalement ou ayant conclu un PACS avec la mère, d'être présent auprès de la mère et de l'enfant.
Je défends cette proposition depuis de nombreuses années : en octobre 2006, j'ai déposé un amendement au PLFSS 2007, qui allait dans ce sens. Cette disposition a même été adoptée en commission des affaires sociales avant d'être bloquée par le Gouvernement. Je me souviens, madame la secrétaire d'État, que vous étiez des nôtres, lors de cette commission. Mais je connais votre point de vue personnel sur le sujet.
Il est temps, mes chers collègues, d'ouvrir les yeux sur l'évolution de notre société et de permettre à chacun, quels que soient ses choix de vie, de fonder une famille et de voir son couple reconnu comme une vraie famille.

La loi doit être modifiée et ne plus faire référence à un « congé de paternité ». Il faut créer un « congé d'accueil de l'enfant » ouvert à toutes les familles dans leur diversité, aux couples hétérosexuels comme homosexuels.

Ce texte contribuera concrètement à faire avancer l'égalité des droits. Je tiens à rappeler que, dès 2007, la HALDE s'est prononcée sur cette question.
Deux réclamantes, que je connais bien, ont saisi la HALDE, à la suite du refus d'attribution du congé de paternité à la naissance d'un enfant qu'elles élèvent ensemble. La HALDE a clairement relevé des disparités dans le bénéfice des prestations sociales entre les caisses d'allocations familiales et les caisses primaires d'assurance maladie.
En effet, à la naissance de l'enfant, la CAF a pris en compte la notion de « foyer fiscal » et n'a donc pas accordé l'allocation de parent isolé à la mère biologique. Les allocations familiales sont versées selon le taux accordé à un couple. En revanche, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le congé de paternité au motif que la réclamante n'est pas le père.
Le président de la HALDE a adressé au Premier ministre un courrier relatif aux disparités dans les conditions d'attribution des prestations sociales en lien avec l'éducation des enfants, aux couples de même sexe. Il a demandé que soit étendu le bénéfice du congé paternité aux couples homosexuels, au nom de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
Pourtant, trois ans après, rien n'a bougé ! La Cour de cassation vient de rejeter le recours d'Élodie et Karine. Elles vont poursuivre leur combat devant la Cour européenne des droits de l'homme pour l'égalité et faire reconnaître le droit des enfants à avoir deux parents, qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent.
Nous avons la responsabilité de faire évoluer le droit et de mieux prendre en considération les évolutions de notre société. Il n'est plus acceptable qu'un enfant élevé par un couple de même sexe n'ait pas les mêmes droits et avantages qu'un enfant élevé par un couple de sexe différent.

L'article 6 propose d'offrir aux parents la possibilité de prendre un congé parental d'éducation partagé. Comme plusieurs orateurs l'ont rappelé, cette préconisation a été adoptée à l'unanimité par la MECSS dans le rapport sur l'évaluation de la PAJE et elle fait consensus au Haut Conseil de la famille sur les notions de partage et de meilleure rémunération.
Il convient de souligner que la durée du congé parental indemnisé et les conditions de son attribution ont des conséquences importantes sur l'égalité entre les sexes en matière d'emploi et de répartition des tâches familiales.
Notre société évolue : j'en veux pour preuve le succès du congé paternité évoqué à l'instant, qui est pris par les deux tiers des pères. Les études récentes montrent que l'idée d'arrêter de travailler ou de réduire son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant progresse chez les pères. C'est l'objet de cette proposition : un congé plus court, mieux rémunéré, dont une partie serait partagée entre le père et la mère.
II s'agit ainsi de donner aux pères plus de droits et la possibilité de s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. Beaucoup sont demandeurs mais ne peuvent actuellement le faire. Cela permettrait une répartition plus équitable des tâches familiales entre les pères et les mères, ce qui constitue une condition indispensable pour une réelle égalité homme-femme dans tous les domaines.
C'est aussi le moyen de ne pas éloigner durablement les parents – les femmes en particulier – du marché de l'emploi.
Nous avons évoqué le partage du congé parental entre le père et la mère ; mais n'oublions pas la situation de très nombreuses familles monoparentales : les femmes qui élèvent seules leurs enfants doivent bénéficier des mêmes avantages.
Pour conclure, mes chers collègues, nous ne pouvons pas déconnecter nos discussions du jour de la question de l'offre d'accueil pour la petite enfance : à quoi servirait-il de favoriser la reprise du travail, d'évoquer une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle si aucune politique d'accueil ambitieuse de la petite enfance n'est menée ?
Disons-le : nous sommes très loin des 400 000 places en crèches promises par le candidat Sarkozy lors de la campagne présidentielle ! Nous sommes même loin des 200 000 places promises pour 2012 ! Je vous rappelle que nous sommes en 2010.

Je sais, mais il faut en général deux à trois ans avant qu'une mesure produise ses effets.

…mais cela ne m'empêche pas d'être concentrée sur mon propos !
Quel est donc, madame la secrétaire d'État, le nombre réel de places ouvertes annuellement ? Lorsqu'un équipement est réhabilité, les places sont comptabilisées en nouvelles places. Par ailleurs, des équipements ferment car trop vétustes ou plus adaptés. Enfin, depuis 2006, plus 150 000 places ont été supprimées pour l'accueil des enfants moins de trois ans dans les écoles maternelles ; autrement dit les besoins augmentent.
Ce qu'il nous faut connaître, madame la secrétaire d'État, c'est le solde net, positif ou négatif, des créations de places d'accueil pour la petite enfance.
Comme, je le sais, vous êtes consciente de ces difficultés, vous vous préparez à publier un décret portant sur les établissements d'accueil du jeune enfant, décret qui inquiète autant les professionnels que les familles. Vous proposez en effet de diminuer le nombre des professionnels les plus qualifiés, d'augmenter la capacité d'accueil de plus de 20 % de l'effectif habituel, et vous laissez libre le taux d'encadrement pour les jeunes de deux-trois ans dans les jardins d'éveil. Et je ne parle pas de la directive qui envisage une libéralisation des services d'accueil de la petite enfance.
Vous privilégiez la quantité au détriment de la qualité. Nous vous demandons de renoncer à ce décret, de garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants et de faire en sorte que l'école maternelle réponde aux attentes des parents qui souhaitent une scolarisation dans de bonnes conditions pour les 2-3 ans.

Il faut être cohérent : pour soutenir l'égalité des hommes et des femmes et encourager les femmes à travailler, il faut assurer aux parents des capacités d'accueil de qualité. Ce n'est pas ce que fait le Gouvernement, qui dégrade au contraire la qualité des modes d'accueil.

Mes chers collègues, ce texte est important, car il nous permet de faire progresser les droits des femmes, améliore la protection de la santé des femmes, fait avancer le droit à l'égalité et permet un meilleur équilibre au sein de la famille entre les parents. C'est donc avec conviction et détermination que je le voterai et que je vous appelle à l'adopter. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au moment où notre pays traverse une crise profonde, la famille constitue plus que jamais un pilier essentiel de l'équilibre social, un fondement de notre société. C'est en son sein que se transmettent des valeurs telles que l'autorité, l'affection ou le respect qui font de tout individu ce qu'il est.
Depuis toujours, notre majorité a soutenu la politique familiale ambitieuse et volontariste de notre pays, qui lui consacre chaque année 3,8 % de son produit intérieur brut, ce qui, en la matière, le place à la troisième place des pays de l'OCDE.
Le texte que l'on nous propose d'adopter aujourd'hui touche à un sujet essentiel puisque, à travers une modernisation du congé maternité, il traite de la santé des femmes, de l'égalité salariale et de la parentalité, autant de sujets qui nous tiennent tous à coeur. Toutefois, la proposition de loi du groupe SRC me semble à la fois prématurée et inadaptée.
Prématurée, car l'article 1er ayant pour objet de modifier le congé de maternité en le portant de seize à vingt semaines intervient deux mois avant l'examen d'une directive européenne qui vise à allonger le congé de maternité de quatorze à dix-huit semaines. Il ne nous paraît pas judicieux que notre assemblée délibère avant l'achèvement des travaux européens.
Inadaptée car, aussi généreuse soit-elle, cette proposition oublie deux aspects fondamentaux. Elle néglige, en premier lieu, la question du financement – mais c'est, je crois, une habitude chez nos collègues socialistes que d'oublier l'article 40 de la Constitution. La commission des finances a, de fait, déclaré irrecevables les articles 1er, 4, 5 et 6. L'allongement de la durée des congés maternité et paternité, la meilleure indemnisation des congés ainsi que l'extension du champ des bénéficiaires auraient un coût de plusieurs centaines de millions d'euros.
Certes, il existe une inégalité de traitement entre les femmes salariées et les femmes non salariées – artisans, commerçants, professions libérales –, les secondes étant moins bien indemnisées, même s'il faut noter que des avancées majeures ont été réalisées ces dernières années. Ce sera, madame la secrétaire d'État, une piste de réflexion à explorer.
Le coût de la réforme du congé parental d'éducation, telle que vous la proposez – il s'agit de passer à trente-six mois, et non pas simplement à dix-huit –, a été évalué à près de 2 milliards d'euros. La seule proposition de financement est un relèvement des droits sur l'alcool. Mes chers collègues, soyons sérieux. Si nous voulons maintenir un haut niveau de protection sociale et ne pas aggraver les déficits de la sécurité sociale, nous devons maîtriser les dépenses.
Le deuxième aspect – le plus important – est la réalité du pays dans lequel nous vivons. La France a un taux de fécondité parmi les plus élevés d'Europe, avec 2,02 enfants par femme en 2008. Dans le même temps, le taux d'emploi des femmes de vingt-cinq à cinquante ans n'a jamais été aussi élevé : il est aujourd'hui de 93,7 % selon l'INSEE, alors qu'il n'était que de 70 % en 1995 et de 81 % en 2004.
Ces deux phénomènes sont intimement liés, car, dans la majorité des pays occidentaux, plus le taux d'emploi des femmes est important, plus le taux de fécondité est élevé. Les femmes françaises sont des femmes actives et modernes, elles ne souhaitent pas être éloignées du monde de l'emploi, elles veulent pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle : notre devoir est de les accompagner dans leur démarche.
Les propositions que vous faites ne vont pas dans ce sens…

…et peuvent entraver l'emploi des femmes au lieu de le protéger. Ne pensez-vous pas que l'interdiction d'employer une femme pendant une période de dix semaines après son accouchement – au lieu de huit semaines – irait à l'encontre des libertés individuelles ?

Ne pensez-vous pas que demander à l'employeur une indemnité compensatrice si le salaire excède le plafond de la sécurité sociale puisse être un frein à l'embauche des femmes ? Ne pensez-vous pas, enfin, qu'il serait préférable de faire confiance aux partenaires sociaux pour négocier des accords conventionnels, plutôt que d'imposer par la loi de nouvelles contraintes ? Notre pays a besoin de souplesse, pas de rigidité.
J'en profite pour demander à Mme la secrétaire d'État le résultat des négociations sur l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle, demandées par le ministre du travail en décembre 2009.
Nous devons aider les familles en leur offrant la possibilité de choisir entre rester auprès de leur enfant et reprendre un travail. Aujourd'hui, pour certaines femmes, le choix est obligé, car il peut être difficile, pour un couple avec enfants, de vivre décemment avec un seul salaire, ou parce que les familles monoparentales représentent près d'une famille sur cinq et que, dans 80 % des cas, c'est la femme qui assure seule l'éducation des enfants. Je peux vous assurer que le retour à l'emploi est devenu pour elles plus qu'un choix, une nécessité.
Nous ne pouvons pas accepter que 46 % des femmes qui prennent un congé parental le fassent parce qu'elles n'ont pas trouvé de mode d'accueil adapté. C'est pour cela que nous soutenons pleinement le Gouvernement qui s'est engagé à créer 200 000 places supplémentaires d'ici à 2012…

…et je tiens à féliciter Mme la secrétaire d'État qui s'est mobilisée pour améliorer sensiblement l'offre de garde.
Je voudrais revenir sur trois dispositifs qui me paraissent particulièrement importants. Je pense tout d'abord aux 15 000 places d'accueil innovantes, notamment aux 1 500 places prévues dans le cadre du dispositif « Espoir Banlieues ». À ce sujet, je me félicite de l'ouverture, à Mantes-la-Jolie, dans ma circonscription, d'une crèche avec horaires atypiques, ouverte aux femmes en recherche d'emploi ou en formation, avec un accompagnement vers l'insertion professionnelle.
Je songe ensuite aux 10 000 places de crèches d'entreprise, créées grâce au crédit d'impôt famille qui a été augmenté de 25 à 50 %. Le Gouvernement ne doit pas être seul à relever ces défis. Les entreprises doivent aussi agir pour le bien-être de leurs salariés.
Enfin, j'évoquerai le regroupement des assistantes maternelles, dispositif que je connais bien puisqu'il est expérimenté à Mantes-la-Jolie depuis 2002. La priorité, c'est de donner le choix entre un congé parental et la reprise d'une activité dans les meilleures conditions possibles, voire un travail à temps partiel. Je considère pour ma part que le temps partiel choisi – je dis bien choisi, et non subi – offre au parent l'occasion de concilier au mieux vie familiale et vie professionnelle, et d'être présent auprès de son enfant en bas âge.
Le complément de libre choix d'activité est une réponse, mais il faut également envisager une réforme du congé parental, peut-être en laissant le choix aux parents entre un congé plus court mais mieux rémunéré ou un congé plus long mais moins rémunéré.

Le Haut Conseil de la famille n'a pu dégager un consensus sur cette réforme, mais je crois, madame la secrétaire d'État, que la concertation doit se poursuivre pour aboutir à une solution en adéquation avec l'évolution de notre société et les attentes des parents.
Permettez-moi de revenir un instant sur la famille. Je m'étonne que mes collègues socialistes aient voulu modifier le statut de la famille à la faveur de deux articles de cette proposition de loi sur la modernisation du congé de maternité. En effet, il s'agit d'ouvrir le droit au congé parental à la personne ayant conclu un PACS avec la mère de l'enfant. Au détour de ce texte, à demi-mot, est posée la question de l'homoparentalité.

Il s'agit là d'un vrai sujet de société, qui mérite un débat de fond, et non deux petits articles au détour d'une proposition de loi sur le congé de maternité.
Mes chers collègues, le groupe UMP ne votera pas cette proposition de loi, qui, je le redis, est prématurée et inadaptée. Au-delà de ses intentions apparemment très généreuses, elle n'est pas financée, elle constitue un frein pour l'accès à l'emploi pour les femmes, car elle impose aux entreprises de nouvelles charges financières qui, dans un contexte de crise, pourraient être pénalisantes. La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle passe aussi et surtout par un développement des modes de garde, par une facilitation du retour à l'emploi, par un volet formation et probablement par une évolution du projet parental. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Discussion générale

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à dix-neuf heures.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui doit être considérée comme un élément de l'évolution globale des droits accordés aux femmes, en l'occurrence aux mères et aux femmes en attente de le devenir.
La commission du droit des femmes et de l'égalité des genres du Parlement européen a adopté, le 23 février 2010, un rapport proposant d'étendre la durée du congé de maternité à vingt semaines continues et celle du congé de paternité à deux semaines continues.
À l'heure où nous tendons vers une harmonisation européenne en ce domaine, il est évident que nous devons adopter rapidement la même démarche. Nous proposons ainsi l'allongement de la durée légale du congé de maternité à vingt semaines au lieu des seize existantes : dix semaines pendant la période prénatale et dix semaines après l'accouchement.
Ne soyons pas dupes non plus : la très grande majorité des femmes s'arrête plus longtemps que les seize semaines légales, soit qu'elles se soient vu reconnaître une grossesse pathologique, soit qu'elles aient pris des congés supplémentaires après la naissance de l'enfant. C'est pourquoi il me paraîtrait tout à fait responsable de donner une dimension législative à des pratiques qui correspondent aux besoins de l'enfant et de sa mère après la naissance. L'article 2 vise ainsi à rendre obligatoire l'interdiction de travailler pendant dix semaines continues dont sept semaines après l'accouchement.
Par ailleurs, alors que la crise économique frappe toutes les catégories de Français, il est difficile d'entendre qu'aujourd'hui encore des jeunes mères peuvent être pénalisées financièrement dans le cadre d'un congé de maternité quand leurs employeurs ne sont pas engagés contractuellement à maintenir leur salaire. Trop d'inégalités subsistent. Il est grand temps d'introduire des mesures d'égalité pour toutes les mères, qu'elles soient salariées ou non. Cette lutte contre l'injustice de statut entre les catégories de salariées et entre salariées et non-salariées doit être prise en compte : c'est le sens même des articles 3 et 4 de cette proposition de loi.
Le congé de paternité, instauré en 2002, mérite également que l'on étudie ses possibilités d'évolution, tant dans sa définition que dans sa durée. C'est pourquoi nous vous proposons d'instaurer un congé d'accueil de l'enfant qui passerait de onze à quatorze jours, voire vingt et un en cas de naissances multiples, et qui répondrait pleinement à toutes les formes actuelles de parentalité. Il serait hypocrite de limiter au seul père pouvant justifier de la filiation le droit d'accueillir l'enfant alors que des situations différentes peuvent justifier une égalité de traitement.
Enfin, alors que l'on estime à quelque 350 000 le nombre de places d'accueil pour les jeunes enfants faisant aujourd'hui défaut sur notre territoire, ne devons-nous pas également faire évoluer les caractéristiques du congé parental ? À l'occasion des discussions des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et pour 2010, nous avons appelé de nos voeux une politique familiale plus ambitieuse, accompagnée de la mise en place d'un plan pluriannuel de création de crèches de nature à répondre aux besoins en matière d'accueil des jeunes enfants. Nous n'avons pas été entendus, ce que je déplore.
Il est important de créer des conditions d'exercice du congé parental qui ne pénalisent pas trop les parents dans leur vie sociale, familiale ou professionnelle. En ce sens, nous vous proposons d'instaurer un nouveau congé partagé. Il nous semble souhaitable qu'à la fois la mère et le père puissent participer à l'accompagnement dans cette période essentielle que sont les premiers mois, voire les premières années qui suivent l'arrivée de l'enfant au sein de la famille. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, sous le couvert d'intentions généreuses, la proposition de loi de nos collègues du groupe SRC visant à réformer les principaux congés liés à la naissance se heurte à des difficultés financières évidentes, déjà évoquées, mais aussi politiques et sociétales.
Nous avions pu nous retrouver sur la proposition de loi relative à la clause de l'Européenne la plus favorisée et celle relative aux violences faites aux femmes ; cela nous sera malheureusement plus difficile sur ce texte.

Je voudrais tout d'abord rappeler quelques points forts de notre politique familiale.
La France dispose à la fois de l'un des meilleurs taux de natalité, avec 2,02 enfants par femme, et d'un taux d'activité féminin élevé – 82 % des femmes âgées de vingt-cinq à cinquante ans vivant en couple. Cette double tendance est générale dans les pays occidentaux : plus le taux d'emploi des femmes est important, plus le taux de fécondité est élevé.
Notre pays consacre par ailleurs aujourd'hui 3,8 % de son PIB à la politique familiale, ce qui le place en troisième position au sein des pays de l'OCDE.
Si cette proposition pose une vraie question, celle de la réforme des différents congés liés à la naissance – congé de maternité, congé de paternité, congé parental d'éducation – elle propose une solution malheureusement beaucoup trop simpliste,…

… qui ne répond pas aux besoins réels : l'allongement de ces congés, l'extension du champ des bénéficiaires et l'accroissement de la prise en charge financière par la collectivité ou les entreprises.
Cette proposition de loi ne répond malheureusement pas aux attentes véritables des femmes.

Rien ne serait pire, sous le couvert d'intentions généreuses, de rigidifier le dispositif du congé maternité ou d'éloigner les femmes de l'emploi, en particulier en cette période de crise économique.
Laissons les femmes choisir en connaissance de cause si elles veulent ou non arrêter de travailler.

Plus que jamais, cette liberté de choix doit s'imposer : nous sommes là-dessus parfaitement d'accord.
Les salariées françaises bénéficient déjà d'un régime très protecteur en matière de congé de maternité puisqu'elles ont seize semaines de congés légaux et vingt-six semaines à partir du troisième enfant. Dans les faits, les femmes prennent même souvent un congé plus long que le minimum obligatoire.

Sept femmes sur dix bénéficient ainsi d'un congé pathologique de deux semaines accordé sur avis médical, qui vient donc s'ajouter au congé de maternité proprement dit. Ces congés viendront donc mécaniquement s'ajouter aux deux semaines supplémentaires que vous proposez. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Il ne faut pas croire en effet que les deux semaines de congés pathologiques disparaîtraient à la faveur de ce nouveau dispositif.

Pour ce qui est du déroulement du congé de maternité lui-même, la France propose une période obligatoire de repos prénatal protégeant la mère de la fatigue du travail et des transports afin, notamment, de limiter le nombre des naissances prématurées. Cela est indispensable et doit être préservé à tout prix. Mais ce congé de maternité se traduit parfois par une rupture dans un parcours professionnel.
Nous devons donc surtout offrir un véritable choix aux femmes et plus généralement aux familles, c'est-à-dire mieux les aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, leur proposer des solutions de garde adaptées et les aider à retrouver le chemin de l'emploi, après un congé parental notamment.
Nous devons également poursuivre nos efforts pour développer et diversifier l'offre en matière de garde d'enfants. Aujourd'hui près d'une femme sur deux – 46 % plus exactement – prend un congé parental par défaut, faute d'avoir trouvé un mode d'accueil adapté.
Je voudrais revenir un instant, madame la secrétaire d'État, sur l'article de la proposition visant à étendre aux femmes non-salariées le bénéfice du congé pour maternité rémunéré, afin qu'elles accèdent aux mêmes droits que les femmes salariées, point sur lequel vous nous avez apporté quelques éléments de réponse dans votre intervention préalable.
Le Gouvernement a pris des mesures en faveur des femmes exerçant des professions non salariées, je pense en particulier aux chefs d'entreprises, aux artisans et aux conjoints-collaborateurs. La loi de financement de la sécurité sociale de 2008 a prévu des dispositions, notamment celles relevant du régime social des indépendants qui bénéficient aujourd'hui d'indemnités journalières pendant quarante-quatre jours, durée qui peut être prolongée de trente jours, ainsi qu'une allocation forfaitaire de repos maternel à partir du septième mois de grossesse et quelques semaines après l'accouchement.
Cette même loi de financement a instauré plusieurs dispositions pour les femmes non-salariées de l'agriculture que le décret du 5 juin 2008 est venu préciser.
Enfin, pour les conjoints collaborateurs, il est prévu une indemnité journalière de remplacement, en cas de remplacement effectif.
Il nous faut néanmoins parvenir, madame la secrétaire d'État, à une véritable égalité de traitement entre les salariés et les non-salariés – j'aimerais avoir plus de précisions à ce sujet.
Cette proposition de loi, dont les mesures représentent un coût très important, n'est pas soutenable financièrement.

Son coût est équivalent à celui de la baisse de la TVA dans la restauration !

Si la question des moyens peut être posée, nous devons le faire avec le sens des responsabilités, compte tenu de l'ampleur de nos déficits sociaux. Si nous voulons consacrer davantage de moyens à notre politique familiale, pourquoi pas ? Encore faut-il savoir quelles autres dépenses nous consentons à réduire.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de rejeter cette proposition de loi, généreuse dans ses ambitions, mais insuffisante et inadaptée dans ses recommandations. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que nous sommes aujourd'hui réunis pour évoquer la modernisation d'un des éléments clés de notre politique familiale, à savoir le congé de maternité, je suis particulièrement heureuse de m'exprimer une nouvelle fois dans cet hémicycle sur ces questions qui touchent tant aux évolutions de notre société qu'à la place que nous souhaitons donner à la femme dans celle-ci.
C'est sous les auspices de l'Union européenne que nous devons placer les termes de notre débat. En effet, alors que les directives européennes sont le plus souvent le prétexte à un moins-disant social pour notre modèle d'État- providence en matière de politiques familiales, je crois que nous pouvons nous réjouir de l'adoption, le 23 février dernier, par la commission du droit des femmes et de l'égalité des genres du Parlement européen d'un rapport proposant que tous les pays membres créent un congé maternité de vingt semaines, rémunéré à hauteur du dernier salaire, et un congé paternité rémunéré de deux semaines continues.
Ce rapport de la commission du droit des femmes, n'intervient pas pour nous dans n'importe quel contexte puisque l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 18 février dernier, la proposition de loi relative à l'Européenne la plus favorisée qui consiste à harmoniser par le haut les législations en matière de droits des femmes.
Nous nous trouvons aujourd'hui à ce carrefour où les pays membres de l'Union européenne ont pris conscience que l'Europe pouvait et se devait d'être un « mieux-disant » social jusqu'à faire émerger, espérons-le, un État-providence européen qui pourrait donner sa cohérence à cette Europe politique que nous appelons de nos voeux.
Je voudrais d'emblée écarter l'un des arguments que l'on a pu lire ici et là contre cette proposition de loi. Il n'est pas acceptable d'affirmer que les mesures en faveur de la modernisation des congés maternité coûtent cher et que, du fait de la crise, de l'austérité que l'État se doit d'observer et d'un éventuel dumping social, nous ne pouvons nous permettre de telles dépenses. Certaines études ont, au contraire, clairement montré que plus le salariat est protégé, plus cela constitue un avantage concurrentiel important. En d'autres termes, et c'est presque un argument éculé aujourd'hui que de le dire, une politique sociale et familiale ambitieuse est une source de productivité pour un pays. Un modèle social fort, loin d'être une tare pour la France, peut au contraire constituer une de ses lignes de force.
L'esprit de cette proposition de loi se nourrit des changements qui affectent nos sociétés, lesquels constituent autant de défis pour le législateur.
Les femmes françaises ont un taux d'activité professionnelle en constante augmentation – même s'il y aurait beaucoup à dire sur les inégalités qui persistent entre les femmes et les hommes. Le taux d'emploi des femmes s'élevait déjà à 57,6 % pour l'année 2005. Le rapport de notre collègue et amie Danièle Bousquet montre que le souhait des Françaises et des Français est de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale.
Le retrait des femmes du marché du travail au moment où elles deviennent mères reste un retrait contraint, ce qui va parfaitement à l'encontre de notre préoccupation : aider les femmes dans leur autonomie et leur émancipation afin de parvenir à une plus grande égalité entre les deux sexes.
La deuxième mutation que nous pouvons observer concerne la volonté des hommes et leur souci croissant d'assumer l'éducation de leurs enfants et de partager avec leurs compagnes et épouses les contraintes qui y sont liées. Comme en atteste également le rapport de Danielle Bousquet, l'évolution des mentalités est palpable : 20 % des pères se disent prêts à interrompre leur activité professionnelle pendant au moins trois ans pour garder et éduquer leurs enfants.
Enfin, nous devons également prendre en compte dans notre réflexion la diversité des formes familiales : couples mariés ou non, concubinage, PACS, couples du même sexe.
Nous devons nous adapter à ces nouvelles structures familiales et non faire subir à nos concitoyens un conservatisme législatif. Notre assemblée a su prouver par le passé qu'elle pouvait se faire l'écho des préoccupations des Français et des évolutions de notre société sur les questions de politiques familiales.
Notre proposition de loi propose donc que le congé maternité passe à vingt semaines. Si l'on compare les pratiques des différents pays européens, on s'aperçoit que la France se situe dans la moyenne basse. L'augmentation du nombre de semaines de congé apparaît une nécessité, conforme aux recommandations du rapport évoqué précédemment, conforme à l'évolution des pratiques. Je suis particulièrement attachée à l'article 3 qui prévoit que le montant de l'indemnité journalière doit être égal au salaire journalier moyen des trois derniers mois dans la limite du plafond. L'avancée de cet article réside dans son caractère obligatoire qui prémunit les femmes d'une forme de précarité liée à la maternité.

L'article 5 permet la création d'un congé d'accueil de l'enfant et répond ainsi aux évolutions de notre société. Il ouvre la possibilité au père, mais aussi au conjoint ou compagnon de la mère, de s'impliquer dans l'éducation d'un enfant. Cet article vise également la reconnaissance des droits parentaux dans les couples homosexuels. En 2002, sous le gouvernement de Lionel Jospin et à l'initiative de Mme Royal, alors ministre déléguée à la famille, la mise en place du congé paternité avait constitué une avancée remarquable dans notre approche de la parentalité. Il me semble que notre Assemblée doit entériner les mutations permanentes de la parentalité, d'autant plus lorsque celles-ci se voient reconnues au niveau de l'Union européenne. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Je souhaite répondre à Mme la secrétaire d'État et à mes collègues de la majorité en présentant les fondements de notre proposition qui vise à porter à vingt semaines le congé de maternité.
Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard : il correspond à la durée effective des congés pris par les femmes lorsqu'elles ont un enfant : non seulement l'actuel congé de maternité est souvent prolongé par un congé pathologique, mais les femmes prennent trente-huit jours de leurs propres congés de l'année. Ce qui correspond à vingt semaines au total. Ajoutons que cela correspond à la durée minimum proposée par le Parlement européen dans le cadre de la discussion de la directive déposée par la Commission en 2008.
L'allongement de la durée du congé de maternité est assorti d'un allongement à dix semaines de l'interdiction d'emploi d'une femme enceinte ou ayant accouché.
Mme Boyer a indiqué que les femmes étaient très satisfaites du congé de maternité actuel. Si la règle actuelle est si merveilleuse qu'elle le pense, pourquoi alors 70 % des femmes prennent un congé pathologique et pourquoi elles prennent en moyenne un congé de cent cinquante jours, c'est-à-dire deux mois de plus que le congé légal ? Une enquête récente a montré que plus de 50 % des femmes demandent un allongement du congé de maternité. Ne nous cachons derrière de faux prétextes.
Madame la secrétaire d'État, je suis ravie d'entendre – mais je le savais déjà – que vous n'êtes pas opposée à un allongement de la durée du congé de maternité. J'espère que vos services ont anticipé la directive européenne et ses conséquences financières. J'aimerais savoir quelle position vous prendrez lorsque ce texte s'imposera.
Je ferai deux remarques sur le coût de nos propositions.
L'allongement de quatre semaines du congé de maternité coûterait tout au plus de 500 millions d'euros. Certes, la somme n'est pas négligeable ; mais si on la rapproche du coût de l'allégement de la TVA sur la restauration, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout des mêmes enveloppes. La santé des femmes est un objectif qui peut tous nous mobiliser.
Madame la secrétaire d'État, vous avez avancé tout à l'heure le chiffre de 3 milliards. Mais il correspond à trois ans et non à un an et demi. Nous avons donc proposé un congé plus court, plafonné au chiffre plafond de la sécurité sociale et non à 80 % du salaire de l'intéressée : deux modifications qui atténuent sans doute de manière assez substantielle l'appréciation chiffrée que vous avez portée. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Madame la rapporteure, ces 3 milliards correspondent bien au montant estimé de votre proposition initiale.
Mmes Dumoulin, Boyer, Vasseur et M. Lefrand ont expliqué à quel point ce texte posait problème aux femmes enceintes appelées à prendre leur congé de maternité. Je partage leur analyse.
Mme Clergeau s'est livrée à une étude sur les modes de garde nécessaires dans notre pays. Je lui rappelle que nous avons signé une convention avec la CNAF pour un montant de 1,3 milliard d'euros, qui permettra de développer 200 000 offres de gardes supplémentaires sur l'ensemble du territoire et de manière très diversifiée.
Mme Vasseur et Mme Dumoulin ont évoqué le regroupement des assistantes maternelles et l'extension de l'agrément de trois à quatre enfants. Nous avons également relevé le plafond du crédit d'impôt en le portant de 25 % à 50 % pour les entreprises, et nous avons créé des jardins d'éveil. À cet égard, madame Clergeau, je vous invite à vous rendre dans les jardins d'éveil des communes de gauche : je suis sûre que vous en reviendrez convaincue. Pour accompagner et développer notre taux de natalité qui est déjà le plus élevé de l'Union européenne, nous avons réellement multiplié les modes de garde.
Mme Quéré et M. Gille ont soutenu que notre pays se situait dans la moyenne basse en termes de congé de maternité, alors que nous sommes, au contraire, dans la moyenne haute. Certes, la Bulgarie, la République tchèque, l'Irlande, la Hongrie, la Slovaquie, le Royaume-Uni et l'Autriche sont devant nous…
Ces pays ont fait le choix d'une durée de congé de maternité plus importante que la nôtre, mais leur taux de natalité est nettement plus bas : cela tient tout simplement au fait qu'ils n'ont pas fait le choix d'un équilibre entre la durée du congé de maternité et l'activité des femmes.
Et pour ce qui est des rémunérations, la France se trouve résolument dans la moyenne haute : nous sommes parmi les pays qui compensent le mieux la perte de salaire.
Enfin, le collectif « Pas de bébés à la consigne » se livre à une véritable désinformation. Il est hors de question de modifier le taux d'encadrement des enfants. Je le répète ici : il y a bien un adulte pour cinq bébés et un adulte pour huit enfants qui marchent.
Il s'agit aussi de valoriser l'expérience en permettant au titulaire d'un CAP petite enfance ou d'un BEP petite enfance pouvant se prévaloir de trois années d'activité d'intégrer le personnel d'encadrement. Cette mesure était très demandée par les personnels de la petite enfance, mais également par les collectivités locales. Le décret en question a fait l'objet de plus d'une année de concertation avec l'ensemble des professionnels.
Nous avons aussi modulé le taux d'accueil d'enfants en surnombre. En période creuse, nous autorisons un accueil en surnombre, à la condition que le taux d'occupation ne dépasse pas 100 % en moyenne mensuelle. Ce faisant, là encore, nous répondons à une attente des collectivités locales comme des parents : ainsi, une femme peut-elle mettre son enfant dans une crèche de manière ponctuelle, pour répondre à un problème particulier – se rendre à un rendez-vous d'embauche par exemple.
Nous ne sommes pas favorables à cette proposition de loi. Nous ne pouvons pas nous retrouver sur tous les textes, c'est vrai, et je regrette tout comme vous, madame Clergeau ; comme je regrette de ne pas vous voir voter nos projets de loi plus souvent.
J'indique enfin, monsieur le président, qu'en vertu de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, et en application de l'article 96 du règlement de l'Assemblée nationale, le Gouvernement demande la réserve du vote sur les articles et les amendements en discussion.

J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n'a pas adopté de texte.
L'article 1er a été déclaré irrecevable par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

Cet amendement vise à prévoir, à l'occasion de l'entretien relatif à l'orientation professionnelle auquel les femmes ont droit lorsqu'elles reviennent de leur congé de maternité, l'obligation pour l'employeur d'évoquer par la même occasion l'éventuelle adaptation de leurs conditions et horaires de travail.
Les entreprises sont encore très en retrait sur les questions de politique familiale. Pourtant, en novembre dernier, le ministre du travail avait invité les partenaires sociaux à entamer une négociation afin de favoriser l'activité professionnelle des femmes en leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Or négociation n'a à ce jour absolument rien donné.
C'est principalement la présence d'enfants en bas âge qui pèse sur le taux d'activité des femmes : il tombe à moins de 60 % pour deux enfants et à un peu plus d'un tiers pour trois enfants ou plus. Du reste, lorsqu'elles travaillent, la moitié des mères de jeunes enfants le font à temps partiel, souvent de façon contrainte, sachant que la moitié des mères ayant cessé de travailler auraient souhaité continuer à travailler. Rappelons enfin que ce sont les femmes peu qualifiées et aux ressources les plus faibles qui sont le plus souvent écartées du marché du travail.
Certes, l'une des solutions peut résider dans l'augmentation des places de garde, mais cela ne saurait suffire : les nouvelles places se font attendre et les crèches d'entreprise sont insuffisamment aidées. Il faut adapter les horaires de travail et le rôle des employeurs est à cet égard irremplaçable. Nous devons impérativement engager les entreprises à négocier avec leurs salariés des adaptations de rythmes de travail : les deux parties ont à y gagner.
Si cet amendement procède d'une préoccupation légitime, l'initiative me semble néanmoins prématurée. Il faut laisser le processus d'adoption de la directive européenne aller jusqu'à son terme, pour en faire une transposition exhaustive. Ajoutons que les partenaires sociaux pourraient être invités à faire valoir leurs propres propositions sur le sujet. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je vous indique, monsieur le président, que je lève la réserve sur le vote des amendements et des articles de cette proposition de loi.

Si telle est votre volonté, madame la secrétaire d'État, nous allons passer au vote.
(L'amendement n° 1 n'est pas adopté.)

Les articles 4 à 6 ont été déclarés irrecevables par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

Je suis saisi d'un amendement n° 3 , portant article additionnel après l'article 9.
La parole est à Mme Danielle Bousquet.

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la situation très préoccupante des femmes, notamment les intermittentes du spectacle, qui alternent des périodes travaillées et non travaillées, et ne parviennent pas à remplir les conditions requises pour percevoir une indemnité journalière de repos lors de leur congé de maternité.
Au final, elles ont le droit d'avoir des enfants, mais pas celui de percevoir des indemnités, ce qui les oblige à reprendre très rapidement le travail. Si certaines souhaitent retrouver assez vite leur activité professionnelle, ce n'est pas forcément le choix de tout le monde.
Afin d'informer au mieux les parlementaires, l'amendement n° 3 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les conditions d'indemnisation du congé de maternité des femmes qui travaillent par intermittence, et ce avant le début de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Nous devons apporter un soutien à ces femmes parfois plongées dans des situations dramatiques. Avoir des enfants sans pouvoir prétendre à une aide financière pendant son congé est inacceptable en France.
Les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières pour les salariés intérimaires ou exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier et ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droit commun ont été assouplies par un décret du 27 mars 1993.
Ainsi, alors que, dans le droit commun, les salariés doivent avoir cotisé à hauteur de 1 015 fois le SMIC horaire au cours des six mois précédant le début de grossesse ou avoir effectué au moins deux cents heures de travail durant les trois mois précédant le début de grossesse, il est demandé aux salariés intérimaires exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier ou ne remplissant pas ces conditions, soit d'avoir cotisé à hauteur de 2 030 fois le SMIC horaire au cours de l'année précédant la grossesse, soit d'avoir travaillé au moins huit cents heures au cours de l'année précédant la grossesse.
Enfin, le montant des indemnités journalières est calculé, pour ces personnes, sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers.
La rédaction d'un rapport sur les conditions d'indemnisation du congé maternité des personnes travaillant par intermittence ne me paraît donc pas nécessaire. Avis défavorable.

Nous avons achevé l'examen des articles de la proposition de loi.
L'Assemblée ayant rejeté tous les articles de la proposition de loi ainsi que les articles additionnels, il n'y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la conférence des présidents.

Prochaine séance, mardi 30 mars à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Vote solennel sur la proposition de loi sur le droit de vote des étrangers ;
Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma