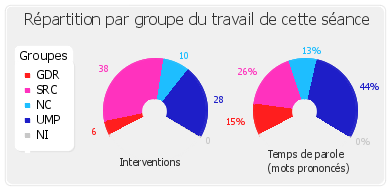Séance en hémicycle du 28 janvier 2010 à 15h00
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

L'ordre du jour appelle le débat sur la mobilité des patients. Je rappelle que ce débat est organisé à la demande de la commission des affaires européennes en application de l'article 48, alinéa 8, de notre règlement.
La parole est à M. Pierre Lequiller, président de la commission des affaires européennes.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c'est l'application pratique de trois des quatre libertés fondamentales sur lesquelles a été construit l'édifice du traité de Rome qui est en jeu dans la mobilité des patients, c'est-à-dire les soins transfrontaliers : la libre prestation de services, la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens. C'est donc un sujet plus vaste que l'appellation, courante mais réductrice, de « tourisme médical » ne le laisse supposer.
Il s'agit de répondre à la question suivante : où est-il légitime de se faire soigner ? Dans son pays ou dans l'un des autres États membres, selon son libre choix ? Cela fait débat.
Certes, la philosophie et les objectifs profonds de la construction européenne conduisent à permettre au patient de choisir librement ses prestataires de santé au sein du marché intérieur. Néanmoins, l'application pure et simple de ce principe n'est, en pratique, pas envisageable.
La dépense de santé n'est pas une dépense banale. Dans tous les pays européens, elle est prise en charge par les régimes de sécurité sociale, avec, par conséquent, un financement public ou, pour le moins, mutualisé. Il y a donc des équilibres financiers et des équilibres de solidarité à maîtriser et à préserver le mieux possible. En découle l'impératif d'une gestion rationnelle de l'offre de soins, notamment d'une planification des équipements les plus lourds, les équipements hospitaliers.
Ce financement collectif de la dépense de santé est un élément essentiel du modèle social européen. Aucun principe ne saurait le mettre en péril.
Historiquement, la question de la prise en charge des soins reçus par le patient hors de son État d'affiliation s'est posée très tôt. Dès la CECA, il a fallu prévoir la continuité des droits des salariés du charbon et de l'acier se déplaçant d'un pays à l'autre pour des motifs professionnels. Elle a été ultérieurement abordée par les textes européens de manière prudente et méthodique. Tout d'abord, les solutions ont été dégagées pour les salariés, centrées sur une logique professionnelle et fondées sur le principe de libre circulation des travailleurs. Ensuite, de manière progressive, il y a eu à la fois prise en compte des déplacements privés et extension à l'ensemble des catégories d'assurés sociaux.
Sur le fond, la solution dégagée par le règlement de coordination des régimes de sécurité sociale est très rationnelle. Elle repose sur la distinction fondamentale entre les soins inopinés, ceux qu'exige une dégradation imprévue de l'état de santé du patient lors d'un séjour à l'étranger, et les soins programmables. Les premiers sont systématiquement pris en charge ; les seconds ne le sont que sur autorisation préalable.
Cette solution avait a priori vocation à durer, d'autant que le règlement de coordination des régimes de sécurité sociale ne peut être modifié qu'à l'unanimité du Conseil et que le traité de Lisbonne n'a pas apporté de changement en la matière.
Tel n'a cependant pas été le cas. En 1998, dans les arrêts Kohll et Decker, le premier portant sur la lunetterie, le second sur les soins dentaires, la Cour de justice des communautés européennes a estimé que les patients ressortissants des États membres pouvaient faire valoir des droits qui leur sont directement reconnus par le traité de Rome. Elle a donc jugé qu'ils pouvaient, même sans autorisation préalable, obtenir remboursement de certaines dépenses de santé engagées à l'étranger, soit au titre de la libre circulation des biens, soit au titre de la libre prestation de services. La Cour a ultérieurement distingué, d'une part, les soins ambulatoires et les médicaments, dont le remboursement est de droit, sans autorisation préalable, et, d'autre part, les soins hospitaliers, dont le remboursement pouvait légitimement être soumis par les États membres à une telle autorisation.
Sur cette base, de nombreux contentieux ont été portés devant la Cour de Justice. Plusieurs arrêts ont été défavorables aux États membres. Il est significatif que les plus emblématiques d'entre eux concernent le National Health Service britannique, avec ses files d'attente, et le Luxembourg, entouré de grands pays disposant par définition d'une offre de soins plus large.
Même pour les tenants les plus enthousiastes du marché intérieur, la jurisprudence de la Cour n'a pas eu que des avantages. La Cour n'a pas invalidé les dispositions concernées du règlement de coordination des régimes de sécurité sociale, que les États membres ont souhaité conserver telles quelles lors de sa révision ; elle a développé, à côté et en parallèle, d'autres règles. Il en résulte une situation complexe avec deux corps de règles applicables : d'une part, le règlement de coordination et ses règlements d'application ; d'autre part, la jurisprudence. Ces règles sont partiellement contradictoires, notamment sur les montants remboursés.
Un nouveau texte est donc nécessaire pour codifier la jurisprudence, clarifier les choses et, au-delà, jeter les bases d'une coopération entre les États membres en matière de soins transfrontaliers. Tel est l'objet de la proposition de directive dont notre Assemblée est saisie.
C'est dans un esprit constructif, pour faire avancer l'Europe de la santé d'une manière adaptée, que la commission des affaires européennes et la commission des affaires sociales ont demandé plusieurs améliorations au texte proposé. Ce sont, madame la ministre, celles figurant dans la résolution sur l'application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers qui vous a été transmise.
Pour l'essentiel, elles se déclinent selon quatre orientations : une meilleure information des patients, notamment sur le droit applicable en cas de litige – celui du pays de soins et non celui de leur pays de résidence – et sur les frais restant à leur charge ; une plus grande autonomie des États membres, notamment pour être en mesure de contrôler tant les flux sortants que les flux entrants de patients nécessitant des soins hospitaliers ou spécialisés ; une prise en compte des attentes des Européens avec des initiatives pour déboucher à terme sur l'intégration des progrès de la télémédecine, sur un règlement facilité des litiges transfrontaliers et sur une carte européenne d'assurance maladie médicalisée permettant le transfert de données personnelles en toute sécurité ; une plus grande sécurité juridique, notamment avec un texte qui évite de prendre ses distances avec la jurisprudence de la Cour et ainsi de rendre la situation encore plus complexe qu'elle n'est en créant une « troisième voie ». La commission souhaite que l'ensemble des dispositions traitant des soins transfrontaliers soient, à terme, réintégrées dans un seul corps de règles, celui du règlement de coordination des régimes de sécurité sociale.
Depuis cette prise de position, les travaux ont avancé. Le Parlement européen s'est prononcé en avril 2009, et son rapporteur, M. John Bowis, a été remplacé par Mme Françoise Grossetête.
Sous présidence suédoise, deux propositions de compromis ont été faites. Aucune n'a cependant abouti, notamment la dernière, que la France, dans un esprit de conciliation, était pourtant prête à soutenir.
Sur le fond, il y a deux principaux sujets de blocage au sein du Conseil. Le premier d'entre eux, qui concerne d'ailleurs – mais pas seulement – l'Espagne, laquelle assure la présidence du Conseil, est la différenciation selon le statut – public, privé conventionné, privé non conventionné – de l'établissement prestataire. Certains États membres conservent, pour le dire de manière schématique, la vieille distinction suivant laquelle le public et le privé conventionné sont gratuits, et le privé non conventionné payant. Ils souhaitent une exclusion de ce dernier du champ de la directive. Cette démarche est juridiquement délicate, car elle peut être considérée comme créant une discrimination.
L'État membre d'affiliation des retraités fait également débat. Les États d'accueil, notamment l'Espagne, souhaitent une dérogation au règlement de coordination des régimes de sécurité sociale. Une telle mesure n'apparaît pas nécessairement justifiée.
En outre, deux autres questions sont apparues depuis la proposition initiale et l'examen de celle-ci par notre Parlement. D'une part, certains de nos partenaires, dont l'Allemagne, souhaitent fortement exclure les soins de longue durée, c'est-à-dire les soins de la dépendance ; ceux-ci sont pourtant inclus dans la coordination réglementaire. D'autre part, les dispositifs de collecte et d'allocation d'organes seraient également exclus et continueraient à relever du droit national ou d'une directive spécifique. Une telle exclusion est nécessaire pour la gestion des transplantations d'organes, qui relève de dispositifs nationaux coûteux, dans un contexte général de pénurie, d'autant que l'on peut prévoir en la matière des coopérations entre États sans pour autant créer, pour les patients, de droits à la mobilité transfrontalière.
Une telle situation soulève quatre questions. Tout d'abord, les aménagements demandés par l'Assemblée ont-ils pu être pris en compte et, si ce n'est pas le cas, pour quelles raisons ? Ensuite, quel est le point de vue du Gouvernement sur les sujets de blocage que je viens d'évoquer ? En outre, quelle base d'accord avec le Parlement européen le Gouvernement voit-il ? Enfin, compte tenu de ces difficultés, quel calendrier envisagez-vous, madame la ministre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Yves Bur, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, 3 % à 4 % des citoyens de l'Union européenne choisissent aujourd'hui de se faire soigner dans un autre État membre que le leur. Les soins transfrontaliers offrent donc à une Europe réputée trop distante une excellente occasion d'agir concrètement pour améliorer la situation des patients, d'autant qu'il est certain que cette tendance à la mobilité ne va que s'amplifier dans les années à venir.
En effet, les raisons de ce phénomène peuvent être multiples.
En tant qu'élu d'un département frontalier, je pense, tout d'abord, à ceux qui souhaitent bénéficier ainsi de soins dans de meilleurs délais. Pour prendre un cas concret que je connais bien, il faut six mois pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue à Strasbourg, alors qu'il ne faut qu'une quinzaine de jours à Kehl. Une meilleure expertise ou des tarifs avantageux attirent également les patients.
Quelles que soient ces raisons, recevoir des soins dans un autre État membre relève bien souvent, à l'heure actuelle, du parcours du combattant. Les difficultés à surmonter sont nombreuses, qu'il s'agisse de l'éloignement, de l'obstacle de la langue ou de la méconnaissance des systèmes sanitaires et juridiques, lesquels diffèrent d'un État à l'autre. Les habitants des régions frontalières y sont régulièrement confrontés.
Chaque jour, de nombreux Alsaciens choisissent de se faire soigner en Allemagne. Ils me font fréquemment part des blocages et des lenteurs administratives auxquels ils se heurtent et qui les font parfois renoncer au remboursement auquel ils ont pourtant droit. Il faut donc mettre rapidement fin à ces anomalies.
Tel est précisément l'objet de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Sur mon rapport et à la suite d'une initiative de notre collègue Daniel Fasquelle au sein de la commission des affaires européennes, la commission des affaires sociales a définitivement adopté, le 11 février dernier, une résolution sur cette proposition de directive.
Notre résolution constate que la proposition de directive comporte trois apports essentiels.
Elle présente tout d'abord le mérite – je le souligne – de procéder d'une démarche radicalement différente de celle qui avait présidé à l'élaboration de la directive dite Bolkestein. En effet, elle ne touche pas aux systèmes de soins nationaux, et elle ne concerne pas non plus la mobilité des professionnels de santé. Elle vise avant tout à faciliter l'exercice du droit des patients européens à recevoir des soins sur tout le territoire de l'Union. En outre, la méthode de concertation retenue par Mme Vassiliou, alors commissaire européenne à la santé, qui, avant d'entreprendre quoi que ce soit, a fait la tournée des capitales européennes, est exemplaire. Nous avons beaucoup apprécié le dialogue qui avait eu lieu avant que de premières propositions ne soient formulées.
Deuxième bénéfice de cette proposition de directive : Pierre Lequiller l'a rappelé, elle codifie, dans un cadre juridique clair et simplifié, la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes depuis 1998 – arrêts Kohll et Decker –, aux termes de laquelle les principes communautaires de libre circulation des biens et de libre prestation de services s'appliquent au domaine de la santé.
Enfin, elle respecte le principe de subsidiarité en affirmant la compétence nationale sur les questions d'organisation des soins de santé et de sécurité sociale. Elle précise les conditions dans lesquelles les patients peuvent se faire soigner dans un autre État membre et se faire rembourser, mais elle ne remet pas en cause le droit des États membres de définir les prestations qu'ils choisissent d'assurer. Le principe de l'autorisation préalable pour les soins hospitaliers est maintenu, ce qui garantit la capacité de régulation des États membres. L'intervention de 1'Union européenne se limite donc au renforcement de la coopération et de la coordination entre les États pour améliorer les synergies entre les différents systèmes de santé.
Cela étant, notre résolution avait également demandé des garanties supplémentaires. Car il faut d'abord aller plus loin dans la protection des patients, s'agissant plus spécialement de l'information sur le système de soins de l'État de traitement, qui ne leur est souvent pas familier. Il est par ailleurs essentiel que le patient puisse disposer, avant la délivrance des soins, d'éléments détaillés sur les conditions financières applicables dans ledit État.
Il faut également aller plus loin en ce qui concerne les droits du patient, tant pour l'autorisation des transferts de données médicales personnelles d'un État membre à un autre que pour les garanties en cas de complications ultérieures. Nous avions même estimé qu'il fallait réfléchir à la mise en place d'un mécanisme européen de règlement des litiges consécutifs à des soins de santé transfrontaliers, comprenant notamment un système de compensation financière.
Enfin, le développement des soins de santé transfrontaliers ne doit pas se faire au détriment des systèmes sociaux des États membres. La proposition de directive prévoit certes une clause de sauvegarde pour les soins hospitaliers et spécialisés : elle permet ainsi aux États membres de prévoir un dispositif d'autorisation préalable de prise en charge, afin de préserver la planification et la rationalisation des équipements sanitaires, mais aussi de ne pas menacer l'équilibre des régimes de sécurité sociale.
Nous avions cependant plaidé pour l'instauration d'une seconde clause de sauvegarde, toujours en matière de soins hospitaliers et spécialisés. Il s'agit ici de permettre aux prestataires de soins d'un État membre de faire face, dans le respect du principe d'égalité de traitement, à des flux trop importants de patients affiliés dans d'autres États membres.
Nous avons aussi souligné la nécessité de ne pas favoriser des transferts de personnels trop importants d'un État membre à un autre, car cela pourrait poser des problèmes aux pays récemment entrés dans l'Union. Une stricte égalité de traitement, en nuisant à l'accès aux équipements pour les ressortissants de l'État membre où sont délivrés des soins, pourrait engendrer un effet contraire à l'un des objectifs de la proposition, qui est de réduire les délais excessifs de délivrance des soins.
La discussion sur la proposition de directive, présentée en juillet 2008, avait bien progressé sous les présidences française, puis tchèque, dans des conditions globalement satisfaisantes par rapport aux objectifs que se fixait notre pays. La présidence suédoise espérait pouvoir obtenir un accord au sein du Conseil avant la fin de son mandat, mais la réunion du 1er décembre a fait apparaître une opposition au compromis qu'elle avait présenté, une minorité de blocage s'étant constituée autour de l'Espagne, alors même que celle-ci exerce désormais la présidence de l'Union. La définition de l'État membre d'affiliation fait en effet craindre une augmentation des dépenses pour les pays dont le système de santé est presque exclusivement de nature publique.
Le règlement de la question des soins transfrontaliers est donc retardé, la perspective d'adoption de la proposition de directive se trouvant ainsi repoussée de plusieurs mois. Or, plus que jamais, le souhait exprimé par notre assemblée et notre commission des affaires sociales dans sa résolution de février 2009 reste d'actualité, celui d'une amélioration de la vie quotidienne des patients, dans le respect des compétences et des systèmes de santé des État européens.
Avec Pierre Lequiller, président de la commission des affaires sociales, nous souhaitons voir ce dossier évoluer rapidement. Car nous devons une réponse concrète, immédiate et pragmatique à nos concitoyens qui entendent se faire soigner, pour des raisons de proximité, mais aussi de mobilité, à travers une Europe qui devient de plus en plus une entité sans frontières. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, force est de le constater, le processus de négociation du projet de directive portant sur les droits des patients et les soins de santé transfrontaliers a subi un important coup d'arrêt. En effet, le Conseil des ministres de la santé du 1er décembre dernier n'a pas réussi à adopter le projet d'accord politique proposé par la présidence suédoise. Je regrette profondément cet état de fait.
Comme vous le savez, la France a soutenu le compromis et a même très largement contribué à sa rédaction dans le cadre du trio présidentiel qui nous a unis aux Tchèques et aux Suédois pendant dix-huit mois. Mais, comme l'a rappelé Yves Bur, nous n'avons pas réussi à convaincre une minorité de blocage, soit six États, de la nécessité de nous rejoindre et de poursuivre le processus législatif dans le cadre d'une seconde lecture du Parlement et du Conseil. Il s'en est fallu de peu : en réalité, la minorité n'a tenu qu'à un seul État, et deux autres étaient très hésitants. Sur ce texte, la France s'est beaucoup engagée. Je me suis aussi personnellement beaucoup engagée. Les arguments étayant sa raison d'être demeurent et peuvent permettre au processus, à tout moment, de redémarrer. Je suis d'ailleurs convaincue que cela sera le cas.
Toute la question est de savoir quand et sur quelle base, alors que des contentieux subsistent devant la Cour de justice de l'Union européenne, dont un qui oppose la Commission européenne à la France sur la question de la légalité du principe de l'autorisation préalable pour l'accès à des soins coûteux dans un autre État.
Beaucoup dépendra, en 2010, du commissaire désigné, John Dalli, qui a exprimé tout son soutien au projet lors de son audition par le Parlement européen, il y a deux semaines. Beaucoup dépendra également des choix stratégiques de l'actuelle présidence espagnole de l'Union européenne, qui était, le mois dernier, à la tête de la minorité de blocage.
Enfin, j'ai la conviction que le Parlement européen et les parlements nationaux sauront, comme nous le faisons cet après-midi, se mobiliser en faveur de ce projet de régulation nécessaire pour les patients comme pour les États.
Le texte a été présenté le 2 juillet 2008 par le président Barroso dans le cadre du nouvel agenda social européen. En dix-huit mois de travail, des avancées considérables ont été obtenues. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail lors de la discussion, mais je ne doute pas que les rapporteurs auront à coeur de pointer les nombreux changements introduits dans le texte, changements qui vont dans le sens de la résolution que votre assemblée a adoptée le 11 février 2009. C'est là un constat important. En effet, j'ai tenu, en 2008, à rencontrer Daniel Fasquelle et Roland Ries, rapporteur au Sénat. J'ai constamment gardé à l'esprit les préoccupations des deux assemblées qui, finalement, ne divergeaient que peu de celles du Gouvernement. Permettez-moi d'en citer quelques-unes qui me semblent devoir être soulignées plus particulièrement.
Concernant l'autorisation préalable, le compromis rédigé par la présidence suédoise est identique à la version négociée sous présidence française. Après s'y être opposée pendant plus d'un an, la Commission européenne a fait un pas significatif en s'y ralliant le 1er décembre dernier. Notre premier objectif est donc atteint.
Par ailleurs, nous voulions laisser le droit national définir les soins hospitaliers et les soins spécialisés susceptibles de faire l'objet d'une autorisation préalable de prise en charge, compte tenu des spécificités du mode d'organisation de chaque pays. Là aussi, l'objectif est atteint.
Nous souhaitions prévenir tout risque d'une troisième voie de remboursement. Là encore, nous pouvons être satisfaits. La définition des soins figurant dans le texte issu de la présidence suédoise est un bon compromis entre le respect des compétences nationales et le souci de sécurité juridique.
Pour s'assurer qu'il n'y aura pas, via la directive, de conflit ni de contradiction avec le règlement de coordination de sécurité sociale, il a été décidé que, lorsque ses conditions seraient remplies, on appliquerait toujours en priorité les règles de remboursement contenues dans le règlement.
Sur l'idée de réserver aux États membres – et non à la Commission européenne – la faculté de fixer eux-mêmes les normes de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire, nous avons aussi obtenu gain de cause.
Vous aviez également exprimé le souhait que puisse être institué un mécanisme européen de règlement des éventuels litiges relatifs aux soins transfrontaliers, notamment sur le plan financier, pour éviter au patient d'avoir à mener une procédure dans un autre État membre, selon un droit qui ne lui est pas familier. Sur ce point, nous avons enregistré de notables progrès. La question a été abordée à travers l'article 10, consacré aux procédures régissant les soins de santé transfrontaliers. L'intérêt du rapprochement avec le règlement de sécurité sociale défendu par la France est précisément de permettre la mise en place de ce mécanisme.
Notre volonté commune était de prendre en compte les facultés et les futurs développements de la télémédecine, en ce qu'elle représente, à côté de la mobilité des patients et de celle des professionnels, une autre déclinaison du principe de la libre prestation de services. Nous avons aussi obtenu quelques avancées sur ce terrain, il est vrai, plus modestes. La santé en ligne trouve ainsi un premier point général d'ancrage dans la directive, et ce pour la première fois dans un texte législatif.
Plus largement, et au-delà du seul sujet, essentiel, de la télémédecine, c'est l'ensemble du chapitre IV de la directive qui a été largement transformé sous les présidences du trio franco-tchéco-suédois : il crée un cadre juridique facilitant le développement d'une coopération structurée entre États membres. Je pense notamment à la reconnaissance mutuelle des prescriptions – article 12 – et aux réseaux européens de références – article 13.
Ces points positifs étant acquis dans la version de la présidence suédoise, il demeure pourtant un point de blocage majeur, cause principale de l'échec du Conseil le 1er décembre dernier : la question de la place accordée aux prestataires privés. La minorité de blocage a persisté jusqu'au bout dans sa volonté d'exclure les prestataires privés du champ de la directive, en contradiction complète avec la jurisprudence de la Cour de justice, et au risque d'ouvrir la fameuse troisième voie de remboursement que nous refusons.
Mais, au-delà de cette seule question structurelle, il semble qu'une autre raison pourrait plus justement expliquer l'échec de décembre 2009. C'est la crainte plus conjoncturelle de l'impact budgétaire potentiel de la mobilité des patients pour des États qui n'appliquent pas aujourd'hui la jurisprudence de la Cour.
Avant de conclure, je voudrais vous faire partager trois convictions qui me tiennent à coeur et qui, en 2008, expliquaient mon choix de retenir le thème de l'Europe au service des patients et de leurs familles comme l'une des trois priorités de la présidence française de l'Union européenne.
Tout d'abord, nous ne devons pas opposer droits des patients et droits des États, comme le font encore trop souvent certains parlementaires européens.
L'autorisation préalable est un outil nécessaire pour la planification des États, mais en aucun cas elle ne saurait être considérée comme l'ennemie du patient. Elle est au contraire la garantie de son remboursement futur si sa demande est légitime. Ce texte est donc un texte social.
Ma deuxième conviction est que la mobilité des patients est marginale en Europe, et a vocation à le rester, avec moins de 1 % des soins. Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent : les patients veulent être soignés prioritairement à proximité de leurs lieux de vie.
La mobilité a donc vocation à se développer essentiellement pour les soins spécialisés. En 2008, l'impact des soins autorisés par des caisses primaires d'assurance maladie et effectués à l'étranger correspondait à 19,9 millions d'euros pour 3 650 personnes soignées. Sur ces 19,9 millions d'euros, les soins identifiés comme hospitaliers – et donc soumis à autorisation préalable – ne constituaient que 10,8 millions d'euros.
Enfin, ma troisième conviction est que la France doit conserver son attitude volontariste sur ce dossier. Si la mobilité des patients est un droit ouvert par le Traité, sa régulation organisée par un texte communautaire est une chance pour notre pays. Une régulation claire nous permettrait en effet de mieux anticiper certains flux et d'éviter ainsi le risque de files d'attentes. Mais, au-delà de cette stratégie préventive, cette mobilité peut être, pour nos structures hospitalières, privées comme publiques, l'occasion de rentabiliser des équipements lourds que d'autres pays ne peuvent pas ou ne veulent pas acquérir. Je pense aux Pet-Scan, aux IRM ou au Gamma Knife.
Si vous me le permettez, j'aimerais rappeler une évidence : nos hôpitaux, eux, ne risquent pas de se délocaliser ! Dès lors que les prestations sont bien tarifées et parfaitement facturées, il n'y a aucune raison que les soins espérés par des patients étrangers ne soient pas une chance pour le développement économique du secteur de la santé en France.
C'est pourquoi je suis en mesure d'apporter des précisions à la représentation nationale sur la tarification appliquée aux ressortissants communautaires. Appliquer une surcharge tarifaire spécifique aux patients relevant d'un autre régime d'assurance maladie européen serait évidemment contraire au droit communautaire et au principe de non-discrimination.
En revanche, le séjour d'un patient européen sert à financer non seulement les charges liées directement aux soins, mais également les missions de service public exercées par l'établissement et les frais de structures, ce qui est légitime. Le passage à la tarification à l'activité nous préserve donc bien du risque d'une sous-facturation qui ferait porter sur la solidarité nationale le coût de la mobilité des patients européens.
Comme vous pouvez le constater, les enjeux sont importants. Sur une question qui engage la qualité de vie de nos concitoyens, ne laissons pas le droit européen de la santé se construire de façon uniquement prudentielle. Les États et les parlementaires doivent décider dans l'intérêt des patients. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme viennent de le rappeler l'excellent président de la commission des affaires européennes et l'excellent rapporteur de la commission des affaires sociales, dont vous avez confirmé les propos, madame la ministre, ce débat est tout sauf anodin. Nous avons tous à l'esprit différents reportages ou articles traitant du « nomadisme » médical, certains évoquant même la notion de « tourisme médical ». Nous avons tous vu ces sujets sur des patients anglais se rendant dans les cliniques du Nord de la France pour des interventions déclarées non urgentes par un National Health Care britannique à bout de souffle. Et qui ne sait aujourd'hui que la Hongrie est la Mecque des prothèses dentaires ? Nous en avons tous conscience, la santé n'est pas un bien comme les autres et ne peut donc être traitée comme tel. C'est d'ailleurs pour cette raison – et vous l'avez rappelé, madame la ministre – que cette question a été exclue de la fameuse directive services et fait l'objet d'un traitement particulier. Il existe toutefois aussi les grands principes fondamentaux sur lesquels la construction européenne est fondée, dont la libre circulation des biens et des personnes.
C'est toute la difficulté de cette fameuse directive en matière de soins de santé transfrontaliers présentée par la Commission en juillet 2008. Cette proposition répond à l'impérieuse nécessité de définir un cadre légal clair régissant les soins transfrontaliers et la mobilité des patients à la suite de différents arrêts de la Cour européenne de justice : les arrêts Watts, entre autres. Elle doit permettre d'améliorer la coordination entre les États membres en matière de soins de santé transfrontaliers sans remettre en cause la liberté des États membres d'organiser leurs systèmes de santé respectifs.
Le président de la commission des affaires européennes a fort bien décrit le processus dans lequel nous sommes engagés depuis 2008, les différentes avancées, mais aussi les obstacles qui subsistent, telles la définition de l'État membre d'affiliation ou la place des prestataires privés non conventionnés dans le dispositif. Je ne reviendrai pas sur ces différents sujets, puisque, comme nous l'espérions, vous avez répondu à nos interrogations, madame la ministre. Il est en tout cas essentiel que nous puissions faire le point avec vous sur l'état d'avancement de cette question. Je rappelle que le groupe UMP s'en est saisi dès octobre 2008, le président Copé ayant reçu avec un certain nombre de nos collègues – dont Yves Bur – la commissaire européenne en charge de la santé, madame Vassiliou.
J'aimerais toutefois faire, ici, si vous me le permettez, un commentaire plus politique au sujet de cette directive. Je souhaite ainsi souligner l'importance de cette proposition pour les patients de l'Union européenne : ce n'est pas l'Europe « d'en haut », mais bien celle au service des citoyens européens qui se construit avec elle.

Nous sommes dans la réalité concrète que vivent nos concitoyens, donc loin des débats sur les institutions, les répartitions de compétences et de pouvoir. Cette directive a été intégrée dans l'agenda social européen, le fameux « paquet social » comprenant un ensemble de texte à caractère social. Mais c'est l'Europe de la proximité que nous appelons de nos voeux ! En effet, au-delà des questions complexes de prise en charge, de remboursements, cette directive insiste aussi sur les normes de qualité et de sécurité qui doivent s'appliquer aux États membres où les soins sont dispensés. C'est donc une avancée dont bénéficieront tous les patients européens. Je souhaite rappeler fortement que, malgré les difficultés que nous connaissons parfois, les Français, en matière de santé et de prise en charge, sont, et de loin, parmi les mieux lotis de l'Union européenne.

Notre pays dispose, en effet, d'une offre de soins très large, et une certaine ouverture à la clientèle étrangère peut être un atout pour la rentabilisation de nos équipements, à condition de parvenir à évaluer précisément le coût des soins ; c'est d'ailleurs une préconisation du rapport Attali. Force est de constater que la France est déjà le pays qui reçoit le plus de patients étrangers, loin devant les autres pays de l'Union européenne.
Mes chers collègues, pour conclure, je veux redire combien cette directive est importante pour nos concitoyens et assurer le Gouvernement de notre soutien dans sa complexe, mais nécessaire mise en oeuvre. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires européennes, monsieur le rapporteur Yves Bur, mes chers collègues, la mobilité du patient dans l'Union européenne est aujourd'hui un fait. Les différentes prestations proposées, les tarifs pratiqués, le suivi postopératoire sont autant d'éléments qui peuvent amener les citoyens d'un pays à aller se faire soigner dans un autre pays membre. Il faut souligner qu'il n'existe aucune évaluation fiable au niveau européen – et nous pourrions, monsieur Bur, reparler des 3 ou 4 % que vous venez d'évoquer – du nombre de patients concernés et des flux financiers réellement en jeu. Le développement de cette pratique devait amener l'Union européenne et l'ensemble de ses membres à encadrer des pratiques qui ne sont ni sans risques ni sans conséquences pour les patients et les systèmes assurantiels. De ce point de vue, on peut encore se satisfaire des diverses initiatives qui ont été prises par la Commission et le Parlement européen, ainsi que par les deux chambres du Parlement français. Si, comme cela vient d'être rappelé, les soins inopinés ne posent pas de problème particulier, de nombreuses questions demeurent au sujet des soins programmés. La proposition de directive opère en effet une sorte de codification de la jurisprudence de la Cour de justice, tout en réduisant encore les capacités de contrôle des États membres.
La principale de ces questions tourne autour de la décision que sera amené à prendre le Conseil de l'Europe en juin prochain. Lors du dernier débat sur le sujet, la situation de certains pays, dont le système assurantiel n'offrait pas de remboursement des soins délivrés par des médecins ou des structures non conventionnés, les avait amenés à refuser la directive proposée. Il nous semble donc important aujourd'hui que l'Europe, dans son ensemble, avance dans le sens d'une directive permettant d'unifier légalement la situation en prévenant toute inégalité d'accès aux soins – pas de médecine à deux vitesses suivant le pays où l'on réside – et en assurant la mise en place d'un certain nombre de garanties pour éviter toute mise en concurrence entre les pays : financement convenable de chaque système de santé des pays membres ; autorisation préalable sur le type de services ouverts ainsi que sur le niveau de remboursement accordé pour chaque État membre ; limitation de l'objet de la directive à la mobilité des patients et non à celle des professionnels de santé.
Dernière garantie de taille : l'assurance d'une réelle circulation des informations concernant les patients entre les pays concernés. Quand on sait la difficulté que nous rencontrons en France pour instaurer le dossier médical personnel, on ne peut que s'inquiéter de la mise en place d'une mesure similaire à l'échelle de l'Union. Mais, si ces garanties sont assurées, la directive offrira un niveau de garantie et d'accès aux soins digne de ce que l'on attend de l'Europe. Il est donc indispensable que tous les pays membres fassent pression afin que le Conseil qui se réunira au mois de juin parvienne à ce cadrage.
Néanmoins, en dehors de l'optimisme que nous affichons quant à la capacité de l'Union à s'entendre sur un texte de cette ampleur, il apparaît bon de souligner les limites qui ne doivent pas être franchies et qui avaient été rappelées par nos collègues sénateurs. Si la directive devait devenir un outil permettant aux plus libéraux de favoriser la libre circulation des services au détriment de la régulation publique, garante de l'accessibilité, de la qualité et de l'égalité devant les soins, nous ne pourrions que nous élever contre cette démarche.
Au passage, madame la ministre, je souhaiterais évoquer la stratégie développée par certains établissements de santé à but lucratif qui réservent un quota de lits pour recevoir des patients « très très » solvables de pays membres de l'Union européenne,…
Cela existe aussi dans les hôpitaux publics !

… voire hors de l'Union, et qui se font ainsi soigner à des prix prohibitifs dépassant l'entendement, permettant à ces établissements d'augmenter substantiellement leurs profits. Je ne veux pas vous faire de peine, madame Bachelot, mais la mise en application de la loi HPST, qui vend à la découpe les missions de service public de la santé, ne devrait guère remédier à cette situation inacceptable pour nos ressortissants.
Pour conclure, mes chers collègues, n'oublions pas que ce sujet de la mobilité des patients avait été exclu de la directive services pour être intégré à une directive « paquet social » parce qu'il avait été convenu que la santé n'était pas un bien marchand. Nous avons le devoir, aujourd'hui, de défendre cette vision solidaire sinon l'Europe sociale ne sera qu'un slogan.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, l'objet du débat qui nous est proposé sur la mobilité des patients fait écho à une directive de la Commission européenne, ainsi qu'à une résolution de notre commission des affaires européennes, adoptée voici un an.
La directive « relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers » construit un cadre juridique communautaire organisant le remboursement, par les États dits « d'affiliation », de soins prodigués aux patients dans un autre État membre de l'Union européenne. Or, contrairement à ce qui est annoncé, l'objectif premier n'est pas de garantir la continuité des soins ou le remboursement des patients, mais de mettre en place la libéralisation de ce secteur, alors que le Parlement européen avait sorti la santé de la directive Bolkestein, comme vient de le rappeler ma collègue. À partir du rapport Bowis, qui introduit la notion de « marché unique de la santé », la Commission européenne a construit son projet non pas sur le droit européen des patients, mais sur une base juridique relevant du marché intérieur.
Voilà qui en dit long sur la conception, qui prévaut en Europe, non seulement quant à la santé publique, mais quant à la démocratie en général. Après le passage en force du traité de Lisbonne, voici le retour de la directive « Services » dans un secteur vital, qui devrait être protégé de toute visée mercantile. Belle illustration de ce que l'on appelle le capitalisme autoritaire, qui ne sera, bien sûr, jamais moralisé !
Cette méthode, comme les ambitions politiques qu'elle révèle, vous oblige à sortir des secteurs entiers du champ d'application de cette directive. Elle contraint la commission des affaires européennes à brandir, dans sa résolution, le principe de subsidiarité pour garantir la préservation de l'offre de santé. En réalité, ce qui est en jeu n'est pas la liberté de circulation des patients, mais, avant tout, la libre prestation de services.
Par ailleurs, cette directive ne concerne qu'une minorité de patients : les plus aisés ! La réglementation portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit déjà le remboursement des soins inopinés dans tous les cas et de certains soins programmés, parfois après autorisation préalable, comme c'est le cas en France. Hormis quelques situations difficiles qui peuvent être réglées dans le cadre de l'actuelle coordination actuelle, qui est concerné par ces nouvelles dispositions ? Quel est le sens de la directive pour les citoyens les moins aisés ? Combien d'entre eux pourront avancer le paiement des soins et prendre à leur charge les frais de voyage et de logement ? Comme l'a déclaré ma collègue Gabi Zimmer, députée européenne, il s'agit plutôt ici de servir les intérêts de certains privilégiés, des jet-setters, qui pourront éviter les listes d'attente (Exclamations sur les bancs du groupe UMP) et aller faire leur shopping dans toute l'Europe en quête de services de santé !
Les députés communistes ne peuvent cautionner le financement du tourisme médical par la sécurité sociale, ni un texte qui confirme le renoncement de l'Union européenne et des gouvernements nationaux à miser sur des services publics, pourquoi pas européens, de proximité et de qualité pour tous. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Je voudrais d'abord remercier le rapporteur, Yves Bur, le président Lequiller ainsi que M. Bénisti, Mme Lemorton et M. Gosnat pour leurs interventions.
Franchement, monsieur Gosnat, votre vision est vraiment caricaturale, et je peux donc vous rassurer. Cette directive ne cherche pas à protéger les jet-setters, qui n'en ont d'ailleurs aucun besoin pour se faire soigner !
Yves Bur, qui vit dans une région frontalière, peut vous le dire : elle tend à protéger des personnes amenées à se faire soigner de l'autre côté de la frontière.
Il faut tout de même quitter les vieux schémas !
C'est une directive sociale et, si le rapport Van Lancker, qui excluait la santé de la directive « Services », a été voté, c'est grâce à moi qui étais la contre-rapporteure du groupe PPE. Sur ce sujet, je n'ai donc pas de leçon à recevoir et certainement pas de vous. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
Monsieur Lequiller, vous m'avez demandé quel était le calendrier de sortie de crise et quel accord était possible avec le Parlement européen. La réponse est entre les mains de la présidence espagnole, qui conserve la maîtrise du calendrier. Lors de la présentation de son travail, la ministre de la santé, Trinidad Jiménez, a été malmenée par notre rapporteure, Françoise Grossetête. Je ne peux dire si cela aura une influence, mais il me semble exclu que la présidence du Conseil néglige le Parlement européen.
Je serai à Madrid le 22 avril prochain, si Dieu me prête vie… (Rires.)
Je suis vaccinée ! En tout cas, si j'ai la grippe en Espagne, je pourrai être prise en charge, ce qui est tout de même intéressant…

Attention à la grippe espagnole ! (Sourires.)
Je me rendrai donc à l'invitation de Mme Jiménez. Ce sera bien entendu pour moi l'occasion de lui redire que je souhaite un accord politique au conseil EPPSSCO de juin prochain.
C'est à partir de cette base que nous pourrons enclencher le processus de rapprochement avec le Parlement. Il est exclu évidemment, ne rêvons pas, que ce soit possible dès la première lecture. C'est un scénario qui laisse ouverts tous les espoirs et, en particulier, une adoption du texte au Conseil de décembre 2010, sous présidence belge. C'est un bel objectif pour ma collègue et amie Laurette Onkelinx, la ministre belge de la santé.
Monsieur Lequiller, monsieur Bur, vous avez évoqué un texte unique, fusion de la directive et du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est une solution séduisante, à laquelle, je le sais, Daniel Fasquelle n'aurait pas été totalement défavorable, mais, si c'est séduisant, c'est aussi assez dangereux en pratique, car cela conduirait à renoncer à l'ensemble du chapitre IV sur la coopération sanitaire, impossible à insérer dans le règlement. Que les deux textes soient à terme, fondus en un seul, volontiers, mais, pour l'heure, le mieux serait l'ennemi du bien.
J'en viens à la seconde clause de sauvegarde. Il faut reconnaître que seuls quelques États membres ont soulevé cette question, la majorité d'entre eux pensant qu'il était inutile et même contreproductif d'ouvrir un second front. Ce fut la ligne de la France. Nous ne sommes pas hostiles à l'idée, mais nous voulions aider la présidence suédoise à obtenir un accord politique et nous ne souhaitions pas charger la barque. Nous sommes loin par ailleurs d'être privés de munitions sur ce volet. Le principe d'autorisation préalable, qui n'est plus conditionné, offre de réelles garanties de régulation. De plus, dans l'article 8.5, il y a une référence claire au maintien possible de dispositifs de gatekeeping ou demédecin référent, et l'on peut donc imposer aux patients européens de passer par cette étape. C'est une faculté donnée aux États, une garantie supplémentaire de la maîtrise des flux.
Vous avez ensuite abordé la question du règlement des litiges. Selon les dispositions inscrites dans le projet de directive, pour ce qui concerne toute décision administrative se rapportant au recours aux soins de santé transfrontaliers et au remboursement des frais, les États membres doivent mettre en place un dispositif permettant un réexamen administratif des décisions s'y rapportant, ainsi que les voies et les moyens de les contester devant le juge. L'État membre de traitement veille à ce que soient mis en place des systèmes permettant le dépôt de plainte et le traitement des demandes de réparation des préjudices éventuellement subis ainsi que des systèmes d'assurance professionnelle ou de garantie adaptés au niveau du risque.
De surcroît, le règlement n° 8832004 qui va entrer en vigueur le 1er mai 2010 en remplaçant le règlement n° 140871, et qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, met en place un nouvel instrument de gestion des litiges relatifs au remboursement des soins de santé. Je ne doute pas que chacun ici en connaît les attendus de façon fine…
Vous avez tous évoqué l'information des patients. C'est évidemment une condition nécessaire d'un bon accès aux soins. La directive définit des obligations qui portent sur la nature des informations nécessaires, la protection des données individuelles, la transformation d'informations préalables sur les droits et conditions de remboursement, l'accès aux dossiers médicaux. Cela implique la mise en place de points de contact nationaux pour assurer l'information des patients, cet accès étant facilité par le recours aux moyens électroniques. L'objectif est donc largement atteint par le texte du Conseil. Par ailleurs, l'information des patients fait également partie des obligations des États dans le cadre du règlement de coordination de sécurité sociale, dont les dispositions, bien entendu, s'appliquent par défaut.
Enfin, en ce qui concerne le système d'autorisation préalable, le projet insiste sur la nécessité d'avoir une information préalable claire de l'État d'affiliation sur le système d'autorisation préalable qu'il met en place pour certains soins à l'étranger, notamment les critères d'autorisation ou de refus.
Voilà les précisions que je voulais vous apporter pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je suis bien entendu à la disposition de l'Assemblée nationale pour toute information complémentaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

L'ordre du jour appelle le débat sur la non-discrimination.
Je rappelle que ce débat est organisé à la demande de la commission des affaires européennes, en application de l'article 48, alinéa 8, de notre règlement.
La parole est à M. Pierre Lequiller, président de la commission des affaires européennes.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État chargée des aînés, mes chers collègues, après la mobilité des patients, sujet de la vie quotidienne, cette séance de contrôle nous conduit à débattre à présent d'un autre aspect essentiel de la construction européenne auquel nos concitoyens sont très attachés, celui des valeurs.
Dès l'origine, la démarche communautaire ne s'est pas limitée à l'économie. Une dimension politique, philosophique et morale a été donnée au Marché commun. La démocratie et le principe d'égalité en ont été les pierres angulaires.
La lutte contre les discriminations, qui est l'un des volets du principe d'égalité, a donc été intégrée dans les traités. Dès 1957, le traité de Rome a rendu obligatoire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, égalité qui est d'ailleurs loin d'être atteinte. C'était à l'époque une approche révolutionnaire dans son principe, même si elle restait relativement timide car l'on ne s'attaquait pas directement à l'inégalité de traitement dont les femmes étaient les victimes dans les autres domaines, notamment en matière de droit civil. Peu à peu, ce principe de l'égal traitement s'est imposé pour tout ce qui concerne le travail et l'emploi, ainsi que la sécurité sociale.
Ensuite, en 1997, le traité d'Amsterdam a élargi l'approche initiale. Il a prévu de manière très générale, sans limitation de domaine, la lutte contre toutes les discriminations, quels qu'en soient les motifs : le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle.
Lors des deux négociations, celle du traité de Rome comme celle du traité d'Amsterdam, la France a été en première ligne pour obtenir de nos partenaires l'insertion de ces dispositions pour l'égalité de traitement.
Plusieurs directives sont intervenues pour mettre en application ces dispositions des traités.
Sur le plan du droit, le champ couvert est complet pour ce qui concerne l'emploi, et les textes interdisent également les discriminations les plus anciennement combattues, celles selon le sexe ou selon la race, dans les autres domaines : l'éducation, la protection sociale, l'accès aux biens et services.
Cette démarche de l'Europe est fondamentale, pertinente, même si certains États membres, comme la France, ont déjà pris des mesures nationales en la matière.
En effet, la lutte contre les discriminations doit continuer à faire l'objet d'une attention constante, tant au niveau européen qu'au niveau des États membres car, dans les faits, de fortes discriminations subsistent, et il faut rendre hommage à ceux qui les combattent, notamment la HALDE et les associations.
Il convient d'ailleurs à ce sujet de saluer l'actuelle présidence espagnole de l'Union européenne, qui a inscrit parmi ses toutes premières priorités la consolidation de l'Europe sociale, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes et la lutte contre la violence domestique, sujet sur lequel l'Espagne a d'ailleurs pris quelque avance sur les autres pays européens.
Venons-en au texte qui nous occupe directement aujourd'hui, dont notre assemblée s'est saisie, et qui a fait l'objet de la résolution transmise au Gouvernement : la proposition de directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle.
Une décennie après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, cette proposition de directive, présentée en juillet 2008, vise à compléter et à parachever le dispositif européen existant. Elle concerne l'accès aux biens et services, ainsi que l'éducation et les prestations sociales.
La résolution de l'Assemblée nationale adoptée à l'initiative de votre commission des affaires européennes puis de votre commission des lois soutient ce texte. Elle a relevé néanmoins quelques difficultés. Nous voulons, en effet, parvenir à une meilleure rédaction, à un texte offrant une plus grande sécurité juridique et des dispositions plus adaptées, notamment sur l'âge et le handicap. Nous voulons également assurer le plein respect des compétences des États membres, notamment dans les domaines touchant aux libertés publiques, à la laïcité et au droit civil.
La plus grande de ces difficultés avait été relevée dès l'origine, dès juillet 2008, par la délégation pour l'Union européenne, lors de l'examen de la proposition de directive, au titre de la subsidiarité et de la proportionnalité, sur le rapport de nos collègues Guy Geoffroy et Christophe Caresche. La COSAC avait, en effet, décidé de procéder sur ce texte à un test concerté, impliquant toutes les assemblées parlementaires nationales.
Cette difficulté concerne la laïcité. Il nous a semblé dès ce moment qu'elle devait faire l'objet d'une grande attention de notre part. Nous sommes en effet fortement attachés à notre modèle français de laïcité, qui repose, pour l'enseignement, sur le principe de la neutralité confessionnelle, mais, au niveau européen, cette approche française apparaît assez spécifique, voire isolée. Ainsi, certains États membres disposent d'enseignements confessionnels.
Il convient donc d'éviter en la matière toute disposition portant atteinte au principe de subsidiarité et pouvant impliquer un quelconque changement de nos équilibres nationaux actuels, notamment en fournissant matière à contentieux.
Au-delà du domaine de l'enseignement, il nous semble également essentiel de préserver plus largement le principe de laïcité lorsqu'il s'applique à l'accès aux biens et services, et en particulier aux services publics et aux soins médicaux.
De la même manière, les questions touchant au droit civil et à la procréation doivent continuer à être réglées au niveau national.
Par ailleurs, d'une manière plus précise, nous souhaitons que les dispositions liées à l'âge soient juridiquement sécurisées. Il convient notamment que la modulation des politiques publiques selon les âges de la vie reste possible au niveau national. Aucune solution purement européenne n'est d'ailleurs possible en la matière, ne serait-ce que parce que les pyramides des âges ne sont pas les mêmes dans les différents pays européens. La France, avec une population en croissance qui atteint 65 millions d'habitants et une natalité soutenue, présente un profil atypique par rapport aux autres États membres, notamment l'Allemagne.
La question du handicap doit également être mieux réglée. D'une part, il convient de mieux définir le handicap, en s'appuyant sur la convention des Nations unies. D'autre part, si la notion d'aménagement raisonnable est pertinente, elle reste à clarifier pour devenir opérationnelle.
Obtenir un résultat satisfaisant, sur la base de la résolution adoptée par notre assemblée, n'est pas nécessairement aisé et nous en sommes conscients. L'unanimité du Conseil est en effet nécessaire, et les choses n'ont pas encore abouti malgré un an et demi de négociations et un avis favorable du Parlement européen – avis au demeurant consultatif dans la mesure nous étions à l'époque sous le régime du traité de Nice.
Dans ces circonstances, les principales questions sont les suivantes.
Il y a tout d'abord, madame la secrétaire d'État, les questions qui concernent la procédure et le calendrier. Où en est-on dans l'élaboration d'un texte de compromis possible pour le Conseil ? Un accord politique vous semble-t-il possible à une échéance pas trop éloignée, ou l'opposition de l'un des nos principaux partenaires, l'Allemagne, risque-t-elle de se révéler définitive ?
Il y a ensuite les questions de fond. Tels qu'ils sont orientés, les travaux du Conseil devraient-ils donner satisfaction à l'Assemblée nationale et remplir les conditions posées par sa résolution pour que l'on puisse souscrire sans difficulté à la future directive ?
Il est essentiel de parvenir à un texte pleinement applicable et répondant parfaitement à ses objectifs. La future directive est attendue par de nombreux acteurs de la société civile. Comme je l'ai dit, il s'agit de nos valeurs européennes. L'Europe s'honore toujours à montrer qu'elle est à la pointe du combat contre les discriminations, et j'espère que nous aboutirons rapidement à la victoire. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Guy Geoffroy, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme le président Lequiller vient de le dire, la question de l'égalité de traitement et, en son sein, de la lutte contre les discriminations ne saurait étonner lorsque l'on est citoyen français et citoyen européen. Dès l'origine, c'est-à-dire dès 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec tout ce qu'elle allait produire comme effets au long des deux siècles qui suivirent, fut inscrit au fronton de nos édifices publics le terme d'« égalité », qui était l'écriture en grand de ce qu'il fallait décliner, secteur par secteur, comme notre pays a su le faire, notamment par le biais du préambule de la Constitution de 1946, toujours en vigueur et qui fonde le pacte social de notre République.
Au niveau de l'Europe, comme l'a également rappelé le président Lequiller, ce n'est pas non plus ces dernières années ou ces derniers mois que ces préoccupations se sont fait jour, car elles ont toujours trouvé place parmi les valeurs chères aux pères fondateurs de la Communauté économique européenne. Ces principes ont été reconnus dès le traité de Rome, à propos de l'égalité salariale.
Les décisions prises depuis lors, de manière accélérée à partir de 1975, avec un certain nombre de directives, puis à partir de 1997, avec le traité d'Amsterdam, n'ont pas modifié mais au contraire accentué cette volonté de développer nos pratiques en matière d'égalité de traitement et de lutte contre les discriminations.
C'est pourquoi, lorsque nous avons été saisis de cette proposition de résolution du 4 juillet 2008, nous avons d'emblée, d'abord au sein la commission des affaires européennes, avec notre collègue Christophe Caresche, puis au sein de la commission des lois, tenu à souligner à la fois l'importance de cette proposition de directive et ses limites.
Ce texte est important car il s'agit de parachever une oeuvre engagée depuis plus d'un demi-siècle et de combler un certain nombre de lacunes. Le rapport de la commission des affaires européennes présente d'ailleurs un tableau dans lequel nous récapitulons les secteurs qui étaient couverts par des dispositions en la matière et ceux qui le seront grâce à cette proposition de directive, afin de bien faire prendre conscience que l'ensemble du spectre de ces questions était traité ou en voie de l'être par les instances européennes.
Qu'avons-nous dit au sein des deux commissions et, plus particulièrement, puisque j'en suis le rapporteur, au sein de la commission des lois ? Nous avons considéré que ce texte devait être salué, mais également qu'un important travail de fond, à caractère technique, restait à réaliser, et en particulier qu'il fallait lever les incertitudes pesant sur certaines définitions comme sur certaines dispositions.
Il convient, tout d'abord, d'améliorer la rédaction et un certain nombre de définitions pour que le texte soit réellement applicable. Il faut en effet maintenir les correspondances entre les notions de droit européen et celles en vigueur dans le droit national, sachant – c'est un des travers de cette proposition de directive – que certains critères de discrimination retenus dans le cadre d'autres directives ne sont pas repris dans cette proposition avec les mêmes définitions ni, donc, les mêmes modalités de mise en oeuvre. Il faut tout mettre en cohérence, et ce d'autant plus que se pose la très importante question de la subsidiarité, c'est-à-dire de la bonne répartition des responsabilités entre l'Union et les États.
Il faudra en particulier – c'est ce que nous avons conclu – harmoniser la notion de harcèlement avec les définitions retenues dans les autres directives, et étendre cette définition à l'interdiction de la discrimination par association, en se fondant en particulier sur l'arrêt Coleman du 17 juillet 2008, qui ne pouvait évidemment pas être pris en considération à la date où la Commission a proposé cette directive.
Par ailleurs, le champ d'application de la directive doit être mieux délimité et établi de manière bien plus conforme aux traités.

Pour cela, il faut que la modification de l'actuelle rédaction prévoie l'interdiction de toute discrimination non pas simplement, comme c'est le cas aujourd'hui, en ce qui concerne la sécurité sociale, les soins de santé, les avantages sociaux, l'éducation, et autres, mais plutôt – ces questions relevant de la compétence des États – en mentionnant l'accès à ces prestations. C'est l'existence de différences d'accès injustifiées qui permet de caractériser la discrimination au plan juridique, et non les prestations en elles-mêmes. C'est ce que nous avons retenu dans notre projet de résolution.
Le troisième point concerne le respect du principe de subsidiarité. Pierre Lequiller y est revenu, et je souhaite y insister à mon tour. Pour nous, une préoccupation majeure concerne la laïcité. Notre pays a une conception de la laïcité qui lui est propre et à laquelle nous sommes profondément attachés.

Elle est pleinement protégée. Nous l'estimons et nous sommes sûrs d'avoir raison de l'estimer. Par le principe de subsidiarité, elle relève tout bonnement de notre pacte républicain.
En ce qui concerne le droit civil, et plus particulièrement le droit familial, l'adoption, la procréation, il faudra, dans le futur texte, que les principes soient mieux garantis, dans le respect de notre volonté et de notre identité sur ces sujets.
Il faudra également que le texte considère plus attentivement les interprétations qui pourraient en être faites à propos de l'interdiction de discrimination selon l'âge. Nous devrons éviter – passez-moi cette expression un peu triviale – de nous tirer une balle dans le pied. Le cadre du droit national doit être au contraire reconnu comme le cadre privilégié pour que soient prises en considération d'éventuelles discriminations selon l'âge. La directive reconnaît la possibilité de traitements différenciés selon l'âge sans que ceux-ci soient constitutifs de discriminations. Il faudrait peut-être l'affirmer plus clairement. Il est en tout cas important qu'il en soit fait état.
Je dirai deux mots des nécessaires clarifications des dispositions relatives au handicap. Comme Pierre Lequiller, j'insisterai sur la nécessité de recourir – cela ne devrait pas être très compliqué – aux vraies références, qui sont celles de la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, plutôt que de se perdre dans des définitions qui ne reposent sur aucune autre identité que celle de leurs auteurs, et qui diversifient par trop les notions et les définitions, finissant par poser problème.
Pour être applicable, le texte devra, après avoir été accepté par tous les États, conjuguer, d'une part, la nécessité d'être puissant aux plans philosophique et politique, au plan des valeurs, telles que nous voulons les faire vivre et telles que l'Europe les reconnaît, et, d'autre part, la précision et la minutie, de façon que ses dispositions trouvent la forme qui leur permettra de s'appliquer non seulement à l'outil européen, qui est l'outil de l'harmonisation, mais aussi à tous les outils nationaux. Sur ces sujets, l'outil national français, nous le savons, est un outil élaboré, car ces valeurs sont pour nous des valeurs fortes, historiques et définitives.
Il faut faire en sorte que le travail du Gouvernement, sur la base de notre propre travail, permette à cette nécessaire directive d'être meilleure, plus précise et plus puissante. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le deuxième débat que nous abordons aujourd'hui dans le cadre des débats demandés par la commission des affaires européennes nous conduit à aborder un sujet majeur et pourtant méconnu de la construction européenne : la lutte contre toutes formes de discrimination.
Comme tous les sujets qui touchent fondamentalement aux valeurs, cette question est complexe et renvoie à toute une série de questionnements moraux et philosophiques.
Les orateurs qui m'ont précédé à la tribune ont rappelé que 1'Europe s'est toujours construite autour de cette dimension politique, philosophique et morale. Les principes d'égalité et de démocratie ont été les fondements de cette édification. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement, sachant d'où nous venons ?
On mesure d'autant plus aujourd'hui l'extraordinaire modernité et clairvoyance des pères fondateurs de l'Europe qu'ils ont articulé la politique européenne sur ces principes. Quand on pense que l'égalité salariale entre les hommes et les femmes a été rendue obligatoire dès le traité de Rome ! Même si, encore aujourd'hui, le compte n'y est pas, je n'hésite pas à le dire : l'Europe s'est bâtie sur des concepts révolutionnaires pour son époque. À nous de nous en montrer digne aujourd'hui !
Que l'Union se préoccupe encore d'améliorer son vaste arsenal de lutte conte les discriminations ne doit pas nous surprendre car l'Europe est, à elle seule, l'exemple concret de ce que peuvent donner le respect et la compréhension de l'autre. C'est sur ces concepts qu'elle s'est construite autour d'un axe franco-allemand que bien peu – sinon quelques visionnaires – imaginaient possible ! Pendant de longues années, la protection contre les discriminations s'est exercée essentiellement dans le champ professionnel. L'article 13 du traité d'Amsterdam, en 1997, change la donne en prohibant la discrimination pour six motifs : le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle. À partir de cet article, trois directives ont été élaborées entre 2000 et 2004, couvrant intégralement le champ de l'emploi et du travail, mais non pas tout celui de la protection sociale, de la santé ni de l'éducation. C'est donc à quoi s'emploie la directive en discussion depuis juillet 2008.
Comme mes collègues qui se sont exprimés avant moi, je souhaite que vous fassiez, madame la secrétaire d'État, le point des négociations sur cette directive. Le rapporteur de la commission des lois, notre excellent collègue Guy Geoffroy, également corapporteur de la mission d'information, a rappelé les demandes d'évolution exprimées par nos deux commissions dans une proposition de résolution adoptée à la fin de l'année dernière. Ces préoccupations ont été aussi largement évoquées par nos collègues sénateurs. Pouvez-vous nous dire si elles seront prises en compte et si elles correspondent aux préoccupations du gouvernement français ? En outre, nous connaissons, pour les rencontrer souvent, les réticences de nos collègues allemands sur certains aspects de cette directive qu'ils perçoivent comme un frein possible à la reprise de la croissance. N'est-ce pas là un obstacle important, d'autant que l'unanimité est nécessaire pour adopter cette proposition de directive ?
Je m'interroge aussi, comme les derniers orateurs du débat précédent, sur la portée éventuelle d'un tel texte sur la question plus spécifique du handicap. Notre pays, il faut bien le reconnaître, n'est pas particulièrement en pointe, malgré les engagements pris, sur la question de l'accessibilité en particulier, sur laquelle la plupart de nos voisins européens ont fait des efforts bien plus considérables. Nous voyageons tous et nous pouvons le vérifier sans difficulté. Comment la France compte-t-elle traiter cet aspect de la directive, auquel nous ne pouvons que souscrire même si nous percevons les principales difficultés de sa mise en oeuvre ?
Mes chers collègues, la question de la non-discrimination est au coeur des valeurs de la République et de l'Union européenne. À ce titre, nous soutenons les initiatives qui iront dans le sens du renforcement de la non-discrimination, l'objectif étant évidemment qu'elles n'en restent pas au stade des grandes déclarations de principe, mais qu'elles soient pleinement applicables pour nos concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, la semaine passée, j'ai eu l'occasion, devant notre assemblée, de rappeler que les projets ou propositions de loi devaient prendre en compte pleinement et complètement le principe d'égalité des genres. On ne peut pas vouloir, un jour, instaurer l'équilibre dans la représentation des sexes au conseil d'administration des grandes entreprises par la loi – équilibre auquel nous souscrivons totalement –, et considérer, le lendemain, que la parité dans les assemblées politiques relève de la bonne volonté d'instances où des hommes décident s'il est opportun que les femmes puissent y accéder. Ce qui est très politique dans ces affaires-là, c'est justement l'absence de politique déterminée et continue visant à combattre un pouvoir exercé par un groupe sur un autre. Cela se traduit par des inégalités ; et il est apparu pendant longtemps que la régulation n'appartenait qu'à ceux qui dominaient et discriminaient. Ce qui est vrai pour l'égalité des genres l'est aussi en ce qui concerne les autres formes de discrimination.
À ce titre, la proposition de directive européenne visant à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances quelles que soient les convictions, la religion, le handicap, l'âge ou encore l'orientation sexuelle, actuellement en discussion devant les instances européennes, constitue une avancée importante même si elle est encore insuffisante. Ce texte complète d'autres directives visant à assurer l'égalité des sexes ou à lutter contre les discriminations fondées sur les races et les appartenances ethniques. Il a aussi pour objet l'égalité d'accès à la protection sociale, à l'éducation, à la fourniture de biens et de services communs ou commerciaux. C'est donc bien une avancée importante.
Le principe essentiel en démocratie est celui du débat. Les discriminations existantes sont aujourd'hui reconnues et débattues. Cela constitue déjà un premier acquis, car la reconnaissance publique est fondamentale dans ce domaine. Il faut qu'il soit suivi de mesures et de résultats. Chacun doit être reconnu comme individu, différent des autres mais non réductible à un seul de ses caractères ; ne plus être stigmatisé sur son lieu de travail, ni dans la sphère publique, ni dans la sphère privée. De plus, la dignité recherchée n'est pas seulement culturelle, elle est aussi matérielle.
Les progrès à atteindre par les États, tels que fixés par cette directive, sont d'une importance évidente. D'une part, le projet vise le traitement de la discrimination sans hiérarchie quant à l'origine de celle-ci, et, surtout en considérant que plusieurs facteurs de discrimination peuvent jouer. D'autre part, il entend rendre effectif le l'établissement de l'égalité, notamment en fixant des objectifs concrets en matière d'accès aux services, y compris financiers, et des prescriptions réglementaires en matière de transports, de bâtiments et de locaux, notamment pour les personnes handicapées. En tout état de cause, nous devrons veiller à faire jouer le principe de subsidiarité, affirmé dans l'article 6 du projet, s'il permet de garantir un niveau d'égalité réelle plus fort que celui fixé a minima par le texte.
Enfin, les dispositions des articles 7 et 8 de ce projet de directive, en ce qu'ils prévoient la possibilité de recours juridictionnels ouverts aux personnes discriminées et en ce qu'ils posent le principe de renversement de la charge de la preuve – avec une dérogation qui me paraît contestable pour l'accès aux services financiers –, constituent pour l'ensemble des Européens des droits nouveaux communs dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Reste que, comme tout progrès, ce texte ne constitue qu'une étape du chemin à parcourir.
En effet, s'il complète d'autres directives et se veut tourner vers la vie quotidienne, il laisse de côté le traitement de discriminations persistantes, notamment entre les genres, c'est-à-dire entre les femmes et les hommes. Cette discrimination n'est évidemment pas la seule, mais elle a la particularité de se conjuguer systématiquement à toutes les autres, et en cela elle les incarne toutes. Ainsi, lorsque le projet évoque l'interdiction de toute discrimination à l'égard de toute personne en matière de soins de santé, il retient une définition qui ne tient pas compte de la dimension sanitaire liée à la reproduction, et en particulier du droit d'accéder à l'interruption volontaire de grossesse.
Par ailleurs, l'entrée croissante de femmes dans le monde du travail ne s'accompagne pas d'une égalité des rémunérations. Cette inégalité, estimée en moyenne à 17 % en Europe, revient à obliger les femmes à travailler e un mois et demi de plus par an que les hommes pour obtenir la même rémunération. De plus, les femmes sont quatre fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel…

…et elles sont majoritaires dans des secteurs où les salaires sont plus faibles. J'ajoute qu'elles travaillent, à la maison, près de deux fois plus que les hommes !
Il est donc temps que la Commission, soutenue par le Conseil européen et par la France, fasse de nouvelles propositions visant à lutter contre des discriminations et des inégalités si habituelles que certains ne les voient plus !
À ce titre, une attention particulière devra être portée à la politique en faveur de la qualification des femmes et à celle visant à améliorer le congé de paternité et le partage du congé parental. De plus, des mesures concrètes devront être prises en faveur du développement des modes d'accueil et de développement des enfants les plus petits.
Pour terminer, si nous devons prêter une attention à toutes les lois, j'ajouterai, citant Périclès, que nous le devons « surtout à celles qui fournissent un appui aux victimes de l'injustice ». Et les travaux menés dans notre parlement, comme ceux menés au parlement européen à Bruxelles et Strasbourg, constituent des occasions de mener une politique de reconnaissance forte à l'égard de ceux qui sont victimes d'injustices aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, chers collègues, je veux d'abord observer que le débat auquel nous prenons part ne sera suivi d'aucun vote, ne s'appuie sur aucun texte, n'a donc aucune portée réelle. L'ordre du jour des parlementaires est régulièrement et artificiellement gonflé de discussions de ce type, dépourvues d'effet juridique, comme s'il n'y avait pas suffisamment de textes à examiner !
J'en viens néanmoins au débat lui-même.
Selon une enquête menée dans toute l'Union européenne, 15 % des Européens affirment avoir subi des discriminations, et trois Européens sur dix ont signalé avoir été témoins de discriminations au cours des douze derniers mois. Les ressortissants de l'Union considèrent que c'est un phénomène répandu dans leur pays, particulièrement s'agissant de l'orientation sexuelle – 51 % –, du handicap – 45 % –, de l'âge ou de la religion – 42 % dans les deux cas. Il y a donc un intérêt manifeste à voir mise en oeuvre une directive visant à interdire la discrimination dans des situations non couvertes par les règlements européens existants, à savoir le handicap, l'âge, la religion, la croyance et l'orientation sexuelle – en dehors de la sphère de l'emploi, domaine déjà réglementé par la législation antérieure.
Malheureusement, ce projet n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de libéralisme économique. Si l'Europe souhaitait vraiment lutter efficacement contre les discriminations, il faudrait que cesse impérativement sa politique de mise en concurrence des peuples européens. Car la première des discriminations, c'est celle qui oppose les salariés entre eux, celle qui met en concurrence un ouvrier des pays de l'Est payé 400 euros par mois et un ouvrier français qui peine à vivre dans son pays avec un SMIC de 1 000 euros, celle du traité de Lisbonne que bon nombre d'entre vous ont soutenu sur ces bancs.
Certes, cette directive va dans le bon sens, mais permettez-moi cependant d'émettre quelques réserves.
Tout d'abord, l'apport serait, pour notre pays, plus que marginal : sur de nombreux points, le projet est en deçà de la législation française – je pense notamment à l'exclusion du champ de la directive des locations opérées par les particuliers. On peut se demander de quelles avancées nous bénéficierions avec cette directive. Pourtant la situation française est loin d'être optimale : la HALDE a enregistré une augmentation de 25 % des saisines, principalement dans le domaine de l'emploi et du logement ; la grande majorité des cas de discrimination concerne l'origine ou le handicap ; bien loin de reculer, les discriminations ne cessent de s'accroître, et le débat sur l'identité nationale ou celui sur le port de la burqa n'amélioreront en rien la situation, bien au contraire.

Seconde réserve : le contenu de cette directive illustre parfaitement l'impasse dans laquelle se trouve l'Europe, incapable d'imposer, sur un sujet comme les discriminations, une harmonisation vers le haut. En effet, l'idée d'une directive d'harmonisation maximale a vite été abandonnée, laissant place à un consensus mou et à des décisions a minima. Je ne donnerai qu'un exemple : sous la pression du Royaume-Uni, la possibilité pour les écoles privées confessionnelles d'opérer des différences d'accès fondées sur la religion et les convictions a été maintenue.
Enfin, le principe de subsidiarité ôte beaucoup de portée à ce texte. Comment lutter, par exemple, contre la discrimination dont souffrent les homosexuels si la question des droits familiaux et maritaux est exclue du champ d'application de la réglementation ?
Si le projet de directive parachève l'élaboration d'une réglementation européenne sur la lutte contre les discriminations, il ne permet pas de faire émerger un socle commun suffisamment stable et volontariste.
Enfin, l'Europe ne saurait faire l'économie de directives fortes sur le droit des femmes, fondées sur la clause de la nation la plus favorisée, ainsi que l'a souvent demandé Mme Gisèle Halimi. Ce sera ma conclusion.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires européennes, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe Nouveau Centre se réjouit de la proposition de directive visant à rendre plus efficace l'application du principe d'égalité, qui, nous l'espérons, permettra aux différents États membres de progresser dans la lutte contre les discriminations.
Élargissement progressif du droit de vote, reconnaissance de l'égalité entre les femmes et les hommes : la France est depuis longtemps attachée au principe d'égalité. Elle en a fait l'un des trois principes fondateurs de notre République et l'a érigé au rang de principe à valeur constitutionnelle.
En Europe, la lutte contre les discriminations, initialement limitée au domaine salarial, s'est peu à peu étendue à toutes les formes de discrimination. La proposition de directive s'inscrit parfaitement dans cette perspective d'élargissement puisqu'elle prévoit une application très large du principe d'égalité de traitement.
Fidèle aux valeurs européennes, le groupe Nouveau Centre – auteur de l'amendement sur le CV anonyme – se réjouit de cette initiative, car il est désormais indispensable de compléter le dispositif communautaire de lutte contre les discriminations.
S'il assure aux citoyens une protection effective dans le champ professionnel, le dispositif demeure insuffisant en dehors de ce domaine.
En effet, de nombreux facteurs ne sont pas couverts par la législation européenne en matière d'éducation, de biens et services, mais également de protection sociale : la religion, le handicap, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle.
Par ailleurs, les niveaux actuels de protection contre les discriminations variant selon les État membres, une harmonisation minimale se révèle indispensable, et la proposition de la Commission européenne devrait représenter un nécessaire compromis.
Cependant, la directive doit rester pleinement respectueuse de la répartition des compétences entre le niveau européen et les États membres.
La laïcité, exception française, doit être protégée par le principe de subsidiarité, comme l'ont répété la plupart des intervenants. Elle fait référence à des éléments essentiels de notre conception des libertés publiques et de notre ordre constitutionnel qui doivent être préservés.
Pour cette raison, le droit des États d'interdire le port des signes religieux à l'école doit être clairement inscrit dans la proposition de directive.
La compétence nationale doit également être préservée concernant les établissements confessionnels. Les États doivent pouvoir admettre des différences de traitement fondées sur la religion pour l'accès à ces seuls établissements confessionnels.
Par ailleurs, nous considérons que les questions de droit civil doivent relever du seul niveau national.
Autre sujet auquel nous sommes attachés : la lutte contre la discrimination des personnes handicapées. Le respect des droits des personnes handicapées doit nécessairement impliquer le refus et la condamnation de toute forme de discrimination du handicap.
Les dispositions relatives au handicap doivent néanmoins être clarifiées et améliorées, afin d'assurer aux personnes handicapées la garantie d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé, à l'éducation ainsi qu'aux biens et services mis à la disposition du public.
Même si l'Union européenne s'est dotée d'un cadre juridique solide afin de lutter contre la discrimination, il faut assurer sa mise en oeuvre efficace sur le terrain.
Les discriminations fondées sur l'origine ethnique se sont multipliées ces dernières années. Il convient de combler le fossé existant entre les dispositions juridiques et leur application dans certains États membres.
La proposition de directive pourra, nous l'espérons, lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination, tout en apportant aux citoyens ainsi qu'aux entreprises la sécurité juridique dont ils ont besoin.
Je vous remercie.
chargée des aînés. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires européennes, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, la lutte contre les discriminations a constitué un axe fort de la présidence française de l'Union européenne en matière sociale.
Si nous voulons harmoniser notre marché intérieur, il nous faut aussi assurer l'égalité d'accès des citoyens européens au travail et à l'emploi, ainsi qu'à tous les domaines de la vie économique et sociale. Cela correspond à notre volonté de construire une Europe qui allie la compétitivité économique au progrès social.
La proposition de directive relative à la lutte contre les discriminations hors du champ de l'emploi, présentée par la Commission le 2 juillet 2008, permet de renforcer un arsenal juridique communautaire déjà très complet.
Comme vous l'avez exposé, monsieur le rapporteur, le texte que nous examinons aujourd'hui étend la protection contre les discriminations à d'autres domaines que l'emploi pour quatre motifs : les convictions ou la religion, l'âge, l'orientation sexuelle et le handicap.
Je tiens à remercier l'Assemblée nationale de son travail de grande qualité, qui nous permet de saisir pleinement tous les enjeux de cette proposition. Vous le savez, la France, est globalement favorable au principe de cette proposition de directive qui va dans le sens de l'effort entrepris au plan national par le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, notamment en faveur des personnes handicapées.
Toutefois, le Gouvernement estime que les travaux doivent se poursuivre sur ce texte, comme l'a exprimé la l'Assemblée nationale dans sa résolution du 20 décembre 2009.
Par rapport à ses voisins européens, la France est à la pointe de la lutte contre les discriminations. Cet engagement répond aux valeurs fondamentales de la République – l'égalité, la liberté et la laïcité –, issues de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et inscrites dans notre Constitution.
Notre politique de lutte contre les discriminations concerne tous les champs de la société, et je ne serai donc pas exhaustive.
Elle se traduit par des actions en faveur de l'égalité des chances : le Gouvernement a ainsi décidé, en novembre dernier, de prendre des mesures pour démocratiser l'accès aux grandes écoles et favoriser l'égalité des chances au travail.
Elle se traduit aussi par le chantier que le ministre du travail a engagé pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont la proposition de loi sur la représentation des femmes aux conseils d'administration – que vous avez votée la semaine dernière – constitue un aspect hautement symbolique.
En réponse à Mme Karamanli, je signale que la France poursuit son action volontariste dans ce domaine, sans que cela relève d'autres textes que celui dont nous discutons cet après-midi, qui comporte notamment des dispositions sur le genre.
Notre politique se traduit aussi par la décision de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une grande cause nationale en 2010.
Enfin, la lutte contre les discriminations constitue un aspect important de notre politique de la ville et du plan « Espoir banlieues ».
Examinons plus précisément les quatre motifs sur lesquels porte la proposition de directive.
Dans le domaine du handicap, la politique que nous conduisons en France est parmi les plus avancées d'Europe.
En réponse aux propos de M. Bénisti, je voudrais indiquer que la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a défini l'ambition de notre pays en ce domaine.
Notre politique du handicap vise à promouvoir l'autonomie et la dignité de la personne, comme l'a rappelé d'ailleurs le Président de la République, lors de la conférence nationale du handicap, en 2008.
Nous conduisons cette politique selon une double approche : améliorer l'accessibilité et apporter une compensation au plus près des besoins des personnes handicapées, afin de favoriser leur insertion dans tous les domaines de la vie économique et sociale.
Dans le domaine des discriminations liées à l'âge, notre politique cible à la fois les personnes âgées et les plus jeunes. La sécurité sociale comme les couvertures complémentaires s'efforcent de répondre au mieux aux besoins des différents âges de la vie.
Parmi les réponses apportées, je citerai la prise en charge de la prévention et des soins, la prestation d'accueil du jeune enfant et le développement des modes de garde – autant d'éléments majeurs de notre politique familiale. Mais je pense aussi aux différents dispositifs en faveur des personnes âgées, largement améliorés au cours des dernières années et que je continue de développer en qualité de secrétaire d'État aux aînés.
Nous prenons aussi en compte les discriminations dues à l'orientation sexuelle. Le pacte civil de solidarité, instauré en 1999, donne un statut aux couples de sexe différent comme aux couples de même sexe. Il a été modifié à plusieurs reprises afin de rapprocher ses effets de ceux du mariage, en termes de droits et d'obligations.
Concernant les discriminations liées à la religion, le principe de laïcité est une valeur fondamentale, située au coeur de l'identité républicaine et inscrite dans notre droit constitutionnel.
Notre pays a donc su prendre en compte ces quatre domaines importants de la lutte contre les discriminations.
Il est bon que la directive permette d'harmoniser les règles applicables en ces domaines aux vingt-sept États membres. Sa transposition contribuera à mettre en place un cadre communautaire cohérent en matière de lutte contre les discriminations. Cela constitue donc, je le crois, une avancée importante contribuant à renforcer le modèle social européen.
Plusieurs points restent cependant à éclaircir.
La résolution qui a été adoptée le 20 décembre 2009 sur ce texte, à l'initiative de Christophe Caresche et Guy Geffroy, fait cinq demandes pertinentes, qui correspondent à la position que la France a défendue à Bruxelles.
Première demande : mettre la notion de harcèlement en conformité avec d'autres directives et tenir compte de la notion de discrimination par association.
Les définitions du texte sont, bien entendu, au centre des discussions à Bruxelles, car tous les États membres souhaitent que les concepts utilisés soient précis et que la sécurité juridique soit garantie.
À la demande de plusieurs délégations, la définition du harcèlement a été revue dans le but de l'aligner sur les directives précédentes. Dans les dernières versions du texte, elle renvoie donc aux droits et pratiques nationaux.
La notion de discrimination par association, issue de la jurisprudence de la Cour a, quant à elle, été introduite dans le texte sur proposition de la présidence française, mais aucun consensus ne s'est encore dégagé sur ce point.
Deuxièmement, il s'agit de définir le champ d'application de la directive d'une manière plus conforme au traité, en précisant qu'elle s'applique à l'accès à tous les biens, services et prestations concernés, notamment l'accès à l'éducation.
Pendant sa présidence, la France a réalisé un travail important sur ce point, visant à limiter le périmètre du texte aux questions d'accès à la protection sociale, à l'éducation et aux biens et services, y compris le logement. Cette approche, qui est conforme aux demandes de l'Assemblée nationale, semble recueillir un large accord au sein du Conseil, à ce stade.
Troisièmement, au titre de la subsidiarité, il convient en particulier d'apporter les précisions nécessaires à la garantie du plein respect des compétences des États membres dans les domaines touchant aux libertés publiques, à la laïcité et au droit civil.
La France, ainsi que l'ensemble des pays, souhaite aboutir à un texte qui respecte les compétences des États membres. Comme cela n'est pas simple, il n'y a pas encore de consensus sur la manière d'y parvenir. Les discussions sur le champ d'application se poursuivent.
Les propositions de la présidence suédoise ont constitué un pas important dans la bonne direction, salué par l'ensemble des délégations, en excluant clairement certains domaines du champ d'application de la directive.
C'est un point sur lequel la France a particulièrement travaillé dès les premières phases de la négociation, durant la présidence française de l'Union européenne. Elle continue de rester vigilante, malgré les progrès enregistrés. Il est ainsi prévu, notamment, que « la directive est sans préjudice des mesures visant à autoriser ou interdire le port de symboles religieux », comme vient de le demander M. Vercamer.
Un autre point soulevé par la commission chargée des affaires européennes concerne les éventuelles interférences du projet de texte avec les questions de droit familial, comme l'adoption et le droit à la procréation.
En effet, l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 1er avril 2008, arrêt dit Tadao Maruko, a jugé que le principe de l'égalité de traitement s'applique dès lors que le droit interne reconnaît des formes de relations comme comparables au mariage.
L'exclusivité de la compétence nationale dans ces domaines doit donc être affirmée sans la moindre ambiguïté dans la directive. Tel est le cas, à ce stade, dans le projet de texte en discussion au Conseil.
Améliorer les dispositions relatives à l'interdiction des discriminations et moduler les politiques publiques selon les âges de la vie sont également des préoccupations du Gouvernement français, ainsi que d'autres États membres, en particulier les Pays-Bas et le Danemark.
Cinquième point : il convient d'assurer une meilleure cohérence avec le texte de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Ce souci est d'autant plus présent dans les débats que la Communauté européenne est partie prenante du texte de la Convention. Il faut néanmoins veiller, tant pour les personnes handicapées que pour les associations du secteur, à la lisibilité du message. Il y a en effet une différence de nature entre la Convention internationale et la directive européenne. La directive européenne doit être intégralement transposée en droit national : elle ne peut donc être calquée sur la Convention onusienne. Je pense qu'il est important, en revanche, de s'assurer de la cohérence de ces textes, et bien sûr de faire bon usage de ce qui a déjà été négocié lors de l'élaboration de la Convention de l'ONU, en reprenant, par exemple, certaines de ses formulations et de ses concepts.
Conformément à l'article 19 du nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui maintient l'exigence de l'unanimité, le Parlement européen sera étroitement associé à cette discussion, puisque son avis n'est plus simplement consultatif. La discussion au Conseil laisse entrevoir des avis très partagés, l'Allemagne ayant d'ores et déjà fait part de son hostilité au principe même du texte pendant une durée de cinq ans, comme l'a confirmé l'accord de coalition. Cette position augure mal d'un accord politique sous présidence espagnole, même si celle-ci a présenté un tel accord comme un objectif prioritaire.
La présidence espagnole a par ailleurs annoncé son intention de rendre publiques les modifications du texte qu'elle serait amenée à proposer, ce qui ne manquera pas de créer un climat propice au dialogue avec les ONG et le milieu associatif.
Quant au calendrier, monsieur le président Lequiller, nous souhaitons que la négociation aboutisse à un accord politique pendant la présidence espagnole, à condition, bien sûr, que ce ne soit pas au détriment de la qualité et de la solidité du texte.
Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les informations de contexte et les précisions que nous pouvons apporter sur les points importants qui ont attiré votre vigilance. J'espère qu'elles répondront à vos demandes, et attends vos contributions avec intérêt afin que nous avancions ensemble dans ce champ essentiel pour notre vivre ensemble, tant au plan national qu'européen. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

L'ordre du jour appelle le débat sur la mise en oeuvre du service minimum dans les transports.
L'organisation de ce débat ayant été demandée par le groupe Nouveau Centre, la parole est à M. Francis Vercamer, orateur de ce groupe.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, mes chers collègues, notre groupe a voulu appeler l'attention de la représentation nationale sur le service minimum, devenu une réalité le 1er janvier 2008 alors que, il y a quelques années, on prétendait sa mise en oeuvre impossible.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale répondait à une attente forte et ancienne des Français, puisque 70 % d'entre eux y étaient favorables, en particulier les plus modestes, qui sont souvent les plus pénalisés en cas de grève. Deux ans plus tard, il nous est donc apparu important de faire le point sur la mise en oeuvre effective de cette mesure.
Je rappelle tout d'abord que cette loi visait avant tout à concilier le droit de grève avec d'autres droits fondamentaux, eux aussi inscrits dans la Constitution : la continuité d'accès au service public, la liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'industrie, et enfin la liberté du travail.

La loi repose donc sur l'idée que, en renforçant le dialogue social dans les entreprises de transport, les grèves pourront être, pour une large part, évitées ; en cas de grève ou de perturbation prévisible du trafic, elle fixe le cadre dans lequel le service doit être organisé. Elle se voulait ainsi une réponse aux graves dysfonctionnements constatés dans les transports publics à l'occasion de mouvements de grève, et était, de ce point de vue, nécessaire.
Le premier volet de la loi fixait les conditions dans lesquelles les entreprises devaient, avant le 1er janvier 2008, négocier avec les organisations syndicales de salariés. Le deuxième volet prévoyait quant à lui la mise en oeuvre d'un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible des transports publics, ainsi que l'obligation, pour le salarié, de déclarer deux jours avant le début de la grève son intention d'y participer.
On note toutefois – et cela est important pour la suite – qu'aucune définition uniforme du service minimum n'a été retenue : cette définition varie selon les réalités du terrain, partant selon les mesures prises par les autorités de transport.
Le troisième volet, enfin, reconnaît le droit pour les usagers des transports publics d'être préalablement informés en cas de grève ou de perturbations prévisibles.
Six mois après sa promulgation, cette loi entrait en vigueur. Il est temps aujourd'hui, soit presque deux ans plus tard, d'en faire le bilan pour s'assurer de son effectivité et identifier les possibilités de l'améliorer. Un tel bilan a d'ailleurs été effectué en mars dernier par les députés Jacques Kossowski et Maxime Bono, dont le rapport faisait état d'une mise en oeuvre globalement satisfaisante, tant pour les mesures d'application prises par les entreprises de transport que pour le service assuré aux usagers et le dialogue social.
Il est vrai que les chiffres, sans les citer tous, appuient un tel constat : le nombre de journées perdues à la SNCF pour fait de grève en 2008 est le plus bas depuis quatre ans. À la RATP, le nombre de jours de grève par agent en 2008 était de 0,18. Enfin, en 2008, seuls 63 agents, sur un total de 3 051, n'ont pas respecté leur obligation légale de déclarer leur intention de faire grève.
Toutefois, on constate que cette loi comporte aussi un certain nombre de limites ; il convient de les souligner et d'en débattre. Des quais de gare ou des arrêts de bus surchargés, des clients laissés sans information qui attendent un train ou un bus qui ne viendra jamais : telle est la situation que nous voulions éviter, et qui s'est pourtant reproduite récemment, même si ce fut dans une moindre mesure qu'avant 2008. Voilà qui fait figure de paradoxe dans une France qui a pris le tournant de la modernité, à l'heure où le Grand Paris, par la reconfiguration de son réseau de transports, désenclave des territoires et des communautés,…

…et à l'heure où les usagers des services publics de transports deviennent de plus en plus des clients. Rappelons également, puisque la question du financement avait été débattue, que ce sont les mêmes usagers qui, par leurs impôts, financent ces entreprises.
Si l'exercice du droit de grève est légitime, certains excès sont de moins en moins bien supportés par nos concitoyens et entraînent une lassitude de l'opinion publique. Depuis plusieurs années, la population, toujours mieux informée, voit clairement que la grève n'est pas l'arme ultime des syndicats mais, souvent, le fait de corporatismes attachés à des intérêts catégoriels tirant leur force de négociation de leur capacité de nuisance collective.

Le service minimum doit, comme nous le voulions lorsque nous l'avons adopté, apporter une réponse concrète et pragmatique aux attentes quotidiennes de tous les Français, qu'ils soient Bretons ou Lorrains, qu'ils habitent Nice, Lille ou la région parisienne.

Le service minimum, en effet, ne concerne pas seulement l'Île-de-France, ni les seules SNCF et RATP : nous voulons qu'il soit appliqué sur tout le territoire national et concerne l'ensemble des opérateurs de transport, dans l'intérêt des usagers.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Je commencerai par souligner les problèmes liés aux grèves massives. Quelle lecture, madame la secrétaire d'État, peut-on faire du service minimum lorsque 90 à 95 % des personnels se mettent en grève, comme ce fut le cas au mois de décembre sur la ligne A du RER, grève qui fut la plus suivie depuis 1995 ? Quelle lecture faire du service minimum lorsqu'un train sur deux circule jusqu'à dix-neuf heures trente seulement, obligeant la plupart des usagers à avoir recours à leur voiture ensuite ? Quelle lecture peut-on faire d'un tel dispositif, à l'heure ou le débat sur le Grenelle II s'engage ?
Le Gouvernement ne devrait-il pas, en accord avec les syndicats, mettre en oeuvre une procédure applicable dans de telles circonstances, afin d'apporter une réponse appropriée et proportionnée pour éviter la paralysie du trafic ?
La difficulté est encore amplifiée à l'occasion des grèves de cinquante-neuf minutes ou des grèves spontanées, dites émotionnelles, déclenchées à la suite d'une agression : c'est d'ailleurs l'une des failles de la loi.
Enfin, la loi instaure un dialogue social qui préfigure les règles applicables en faveur des usagers. Mais où est le dialogue social lorsque, suite à la grève du RER A de décembre dernier, les responsables syndicaux avouent que la prolongation du mouvement est motivée par les élections syndicales ?

Le bilan, globalement positif, de l'application du texte ne signifie donc pas que tout va bien. On a d'ailleurs pu s'apercevoir, en décembre dernier, que les usagers avaient une perception toute différente lorsque le service public des transports subissait une grève. Même si la loi, telle qu'elle a été votée, est correctement appliquée, même si les salariés en ont compris le rôle et même si les usagers en apprécient les avantages, les circonstances ont révélé certaines limites.
La loi n'est donc pas suffisante pour garantir le droit constitutionnel de la liberté de circulation et d'accès aux services publics. Or, permettez-moi d'y insister, le respect dû aux usagers est constitutionnellement reconnu à travers la continuité du service public. Par ailleurs, ne l'oublions pas, la Constitution précise que le droit de grève s'exerce dans le cadre de la loi. Il ne s'exerce donc pas de manière uniforme, mais en fonction du domaine d'activités auquel il s'applique. Ainsi, en France, il existe un service minimum dans les établissements et les organismes de radiodiffusion et de télévision, les établissements détenant des matières nucléaires, le contrôle de la navigation aérienne et la santé. Pourquoi pas dans les transports terrestres, qui concernent quotidiennement des millions de personnes ?
Il ne s'agit pas de remettre en cause le droit de grève, mais de tenir compte des usagers du service public, que l'on ne peut marginaliser et laisser au bord des quais, d'autant plus qu'ils sont souvent les moins favorisés de nos concitoyens.
Nous proposons la mise en oeuvre d'un droit de réquisition, lequel, pour n'être pas frappé d'inconstitutionnalité, appelle une modification de la Constitution. En 1987, le Conseil constitutionnel a en effet considéré qu'il appartenait au législateur d'apporter au droit de grève les limitations nécessaires pour assurer la continuité du service public, et que « ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ». Il s'agit donc, mes chers collègues, de définir ce qui, à nos yeux, est indispensable pour nos concitoyens.
Parallèlement, et parce que le dialogue social n'en revêt pas moins une importance de tout premier ordre à nos yeux, nous proposons, sur la base des excellentes propositions contenues dans le rapport de M. Kossowski, que les mécanismes de dialogue social soient poussés plus avant. À cet effet, la création d'un observatoire des relations sociales dans les transports terrestres, appelé à faire un bilan de l'état du dialogue social dans notre pays, nous semble très opportune.
Par ailleurs, pour parer aux grèves émotionnelles et aux arrêts de travail immédiats, il est essentiel que l'amplification de la rumeur ne tienne pas lieu d'information, et que les agents victimes d'une agression soient pris en charge de la façon la plus efficace possible.

C'est là le seul moyen d'empêcher la réédition de ce qui s'est passé à la gare Saint-Lazare. Préparer du mieux possible les conducteurs à des situations tendues constitue également une piste intéressante.
Enfin et surtout, pour que les excellentes mesures déjà prises et appliquées sur l'ensemble du territoire soient homogènes, il est essentiel de continuer les négociations d'accords cadres dans les entreprises du secteur des transports, notamment celles du transport interurbain. Des négociations collectives doivent aussi être engagées dans toutes les entreprises qui relèvent du champ de la loi, afin que le service du retour soit aussi bien assuré que celui du matin : il y va du respect des usagers, qu'il n'est pas admissible d'abandonner au milieu du trajet.

Après avoir ainsi brossé quelques pistes d'amélioration, le groupe Nouveau Centre souhaite connaître la lecture du Gouvernement quant à la mise en oeuvre de la loi, et les possibilités d'amélioration qu'il envisage pour assurer le service minimum qu'il a promis à nos concitoyens.

Madame la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, si le sujet dont nous discutons ne laisse personne indifférent, je me réjouis que ce soit vous qui représentiez le Gouvernement lors de ce débat, tant il est vrai que les familles sont les premières concernées par ces grèves à répétition.
Après la grève importante que nous avons connue, avant les fêtes, sur la ligne A du RER, nous avons pu clairement mesurer l'impact considérable et néfaste de ces grèves, mais nous avons également pu apprécier le bénéfice de la loi de 2007 qui, en instaurant un service minimum dans les transports, a, malgré tout, permis à plus d'un million d'usagers franciliens de se déplacer quotidiennement, en dépit de nombreuses contraintes, pour rejoindre leur lieu de travail ou effectuer leurs achats de Noël.
Très emblématique du fait de son exceptionnelle longueur et de la forte mobilisation des personnels, cette grève a démontré que la loi de 2007 sur le service minimum ne remettait pas en cause le droit de grève, mais qu'elle a, au contraire, permis de rééquilibrer les forces en présence : d'un côté, les revendications – qui peuvent paraître à beaucoup légitimes – des agents de conduite et, de l'autre, le droit à la libre circulation des personnes. Cette loi a également apporté des avancées notables en matière de prévention des conflits, puisque, tout au long de l'année 2009, des négociations internes à la RATP ont eu lieu. Ce n'est donc qu'en tout dernier recours que les agents de conduite ont entamé cette grève.
Quelle évaluation peut-on faire de la loi de 2007 après deux années d'application ? Je dirai que cette évaluation est mitigée. D'un côté, plusieurs points positifs sont à relever, tels que l'application et la mise en oeuvre des outils destinés à favoriser le dialogue social et à prévenir les conflits, puis, au moment de la grève, à assurer enfin un service minimum, spécifiquement aux heures de pointe. En cela, nous ne pouvons qu'être satisfaits.
De l'autre, force est de constater qu'il faut maintenant aller plus loin. Tout d'abord, le texte atteint ses limites quand la totalité des conducteurs se mettent en grève. En effet, comment mettre en oeuvre le service minimum dans ces conditions ? En outre, il arrive que l'esprit de la loi soit détourné ; tel est le cas avec les grèves tournantes, les grèves surprises ou les mini-grèves de cinquante-neuf minutes et cinquante-neuf secondes.

Ajoutées aux autres dysfonctionnements, liés à la vétusté des matériels roulants ou aux accidents dans les rames, elles contribuent à créer des perturbations quasi quotidiennes et un climat de suspicion et de stress chez les usagers, qui ne sont jamais certains que leurs trains soient à l'heure et qu'ils pourront arriver à temps à leurs rendez-vous. En conséquence, ils sont de plus en plus nombreux à partir de chez eux une bonne demi-heure en avance, afin d'être certains d'arriver à l'heure sur leur lieu de travail. Cela n'est pas acceptable et ne peut plus durer.

En matière de prévention des conflits, il faudrait notamment réfléchir à la mise en place de processus complémentaires qui permettraient, pourquoi pas, à des médiateurs, d'intervenir bien en amont, afin d'éviter que les fils du dialogue ne se rompent, comme cela a été le cas lors de la dernière grève, qui a duré dix-huit jours.
Par ailleurs, il convient de faire en sorte que les transports en commun franciliens existants soient modernisés, que les trains soient remplacés, que les conducteurs soient plus nombreux si l'on augmente les fréquences et le nombre de rames et, surtout, que des moyens importants soient investis pour remédier aux nombreux problèmes inhérents aux matériels usagés ou défectueux, qui, pour certains, datent de plus de quarante ans. En effet, ne nous leurrons pas, mes chers collègues, la majorité des grèves dans les transports en commun ont d'abord pour origine des revendications liées à la modernisation des outils et des conditions de travail, bien avant les revendications salariales.
Ne serait-il pas temps de stopper ces sempiternels conflits politiques qui consistent à se renvoyer la balle d'un camp à l'autre, au détriment des millions de Franciliens qui utilisent quotidiennement ces transports ? Des investissements massifs doivent être faits par la région et le STIF afin de permettre aux transports existants de faire face à l'augmentation croissante du nombre d'utilisateurs, qui plus est, à un moment où tout est mis en oeuvre pour réduire les déplacements en voiture et limiter les émissions de gaz à effet de serre.
C'est pourquoi, je le répète, nous devons aller plus loin, non seulement pour faire respecter la loi sur le service minimum, pour renforcer les dispositifs de prévention des conflits et pour respecter les usagers, qui subissent ces désagréments, mais aussi pour avoir des transports en commun à la hauteur du nombre d'usagers et des perspectives de croissance de leur fréquentation, en somme : à la hauteur de notre région capitale et de notre pays. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe Nouveau Centre a souhaité que soit organisé, dans le cadre de son droit d'initiative parlementaire, un débat sur le service minimum dans les transports. La démarche est quelque peu singulière. En effet, de deux choses l'une : soit le groupe Nouveau Centre a des propositions à faire, auquel cas nous devrions en débattre, soit il accepte les conclusions des différents rapports parlementaires existants sur le sujet, et ce débat n'a que peu d'intérêt, sinon – et les premières interventions que nous avons entendues légitiment cette hypothèse – qu'il se déroule peu de temps avant les élections régionales. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Au reste, ouvrir à nouveau ce débat, c'est donner à nouveau la parole à ceux qui n'aspirent qu'à restreindre le droit de grève.

Pour illustrer cette crainte, je veux citer les propos hallucinants que le sénateur Serge Dassault a tenus au Sénat le 13 janvier dernier : « La grève est devenue un moyen de pression non seulement contre l'employeur, mais aussi contre le Gouvernement. C'est inadmissible. »

« Une grève a même débouché sur l'annulation de la loi sur le contrat premières embauches qui donnait une chance aux jeunes. Donner la pouvoir à la rue contre les parlementaires, c'est ouvrir la voie à l'anarchie et à la révolution. La grève devrait être interdite dans le public et sérieusement encadrée dans le privé. »

Tels sont les propos qui ont été prononcés lorsque le même débat s'est tenu au Sénat.

À ces propos, que je juge inquiétants – si certains s'y reconnaissent, je leur en laisse la responsabilité –, je préfère les conclusions du rapport d'information, me semble-t-il objectif, de Jacques Kossowski, député UMP, et de Maxime Bono, député socialiste, sur les conditions d'application de la loi de 2007. Ces derniers estiment que, en l'état actuel des choses, aucune initiative législative nouvelle n'est nécessaire, et nous souscrivons à cette analyse.
Une telle conclusion s'impose d'autant plus que, dès l'origine du débat, l'espace législatif était contraint par le respect de deux principes de valeur constitutionnelle : le droit de grève et la continuité du service public. Cette contrainte explique largement pourquoi la loi du 21 août 2007 n'est pas, en réalité, une loi sur le service minimum, mais bien une loi sur l'organisation optimale du service avec les personnels non grévistes. Au reste, l'expression « service minimum », qui est malheureusement souvent reprise dans les médias, est totalement absente tant du texte même de la loi que de son exposé des motifs.
Nous avions combattu l'opportunité et même la nécessité de cette loi. Je veux rappeler que, le 4 juillet 2006, M. Perben, alors ministre de l'équipement et des transports, soutenait devant notre assemblée que le recours à la loi n'était pas une priorité et que l'efficacité commandait de faire le choix de la négociation. Il reprenait ainsi les conclusions du rapport Mandelkern, qui, dès 2004, soulignait les limites juridiques d'une disposition législative au regard des principes constitutionnels.
L'aspiration des Français, des citoyens usagers, à la continuité des services publics de transport est légitime, et nous la partageons. Lorsque la grève trouve son origine dans un conflit propre à l'entreprise, elle est toujours le résultat d'un échec du dialogue social et l'usager a le sentiment d'en être la première victime.

C'est pourquoi, sans attendre la loi du 21 août 2007, les organisations syndicales et les entreprises ont élaboré, de manière responsable, des chartes de prévisibilité. Mme Anne-Marie Idrac, alors présidente de la SNCF, déclarait ainsi, dans le journal Le Monde du 13 avril 2007 : « Les contrats que nous avons passés avec les autorités organisatrices de transport prévoient la prévisibilité en cas de situation perturbée. Pour l'heure, je constate que cela s'améliore et que je privilégie le dialogue social et la négociation. Plus la part du dialogue social est importante, mieux cela marchera. »
Paradoxalement, c'est au moment où le nombre de jours de grève était historiquement le plus faible que la loi est intervenue. Lors de l'examen du projet de loi, le ministre a ainsi reconnu, devant la commission, que ce nombre avait été réduit de 90 % en dix ans.

À la SNCF, le premier trimestre 2007 correspondait au meilleur résultat depuis quinze ans, avec 0,13 jour par agent. À la RATP, les résultats étaient tout aussi remarquables, avec un chiffre inférieur à 0,4 jour par agent.

Ces résultats ne devaient rien au hasard, mais à la volonté de négocier des syndicats responsables et des directions d'entreprise.
Les résultats de l'année 2008 s'inscrivent tout autant dans la continuité de cette évolution que dans le bilan de la loi du 21 août 2007. En voulant organiser et encadrer le dialogue social, la loi a, du reste, abouti à créer des espaces d'incertitude qui peuvent se révéler contre-productifs. Ainsi, pour respecter la valeur constitutionnelle du droit de grève, la loi prévoit que seule la décision de ne pas faire grève est irréfragable. Autrement dit, un salarié qui s'est déclaré gréviste dans le délai de quarante-huit heures peut toujours renoncer à exercer ce droit et être présent à son poste. Le Conseil constitutionnel a même précisé, dans sa décision du 16 août 2007, qu'un salarié non gréviste dans un premier temps peut toujours rejoindre le mouvement, à la seule condition de respecter le délai de prévenance de quarante-huit heures. On cherche vainement dans ces complications des améliorations tangibles de la situation antérieure à la loi.
En outre, dès lors que le seul objectif constitutionnellement possible de ce texte était l'organisation optimale du service avec les agents non grévistes, il s'est heurté à la réalité quand le nombre de grévistes a atteint 90 % ou 100 % ; chacun a à l'esprit la dernière grève du RER A. Toutefois, est-il normal que, lors d'un conflit lié à la revendication d'une prime, l'absence de tout dialogue social sérieux aboutisse à de tels événements ? Comment la direction de l'entreprise a-t-elle pu, dans cette circonstance, n'avoir d'autres réponses que l'essoufflement de la grève, au détriment des salariés et des usagers ?
Parmi les difficultés, il convient également d'évoquer l'exercice du droit de retrait, notamment suite à l'agression d'un salarié. À tous ceux qui imaginent encore restreindre le droit de grève dans ces circonstances dramatiques, je rappelle que, dans un arrêt de 2008, la Cour de cassation a jugé que, tant que les agresseurs n'avaient pas été arrêtés, l'exercice collectif du droit de retrait ne pouvait être sanctionné. Cet arrêt me semble donc limiter les aspirations à modifier la loi qui ont été évoquées à cette tribune.
Personne, même en période électorale, ne peut s'ériger en défenseur labellisé des usagers. Faut-il rappeler que les retards ou les annulations de transport sont d'abord dus à des incidents mécaniques, à des aléas climatiques et à des événements dramatiques, comme les suicides sur les voies ?
En 2006, sur 6 043 incidents ayant entraîné une perturbation de trafic à la SNCF, 140 seulement provenaient de mouvements sociaux, soit 3 % du total. Faut-il rappeler les 16 000 postes supprimés à la SNCF depuis 2005 ? Faut-il rappeler les conclusions de l'audit indépendant sur l'état du réseau ferré national…

…qui mettait en exergue un processus de vieillissement très important du réseau classique, dont une part importante se dégrade continuellement, tandis que les prémisses d'une dégénérescence apparaissent ?
Si l'objet de ce débat est d'apporter des réponses aux inquiétudes des usagers, c'est d'abord à ces questions qu'il faut répondre, sans utiliser le dérivatif du prisme étroit d'un débat sur le service minimum. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la loi instituant un service minimum dans les transports a été votée en août 2007, en pleine trêve estivale. Xavier Bertrand nous présentait cette réforme comme une mesure de « justice sociale », de « renforcement du service public » et « d'encouragement au dialogue social ». À l'époque, nous dénoncions cette attaque sans précédent contre le droit de grève, et il aura d'ailleurs fallu très peu de temps pour que les réelles intentions de la majorité apparaissent au grand jour, par la voix du Président de la République. En juin 2008, devant des militants UMP en liesse, il déclarait : « Quand il y a une grève en France, on ne s'en rend plus compte ! » Le message ne pouvait être plus explicite et plus cynique : de la provocation pure et simple !
Certes, la loi du 27 août 2007 ne supprime pas le droit de grève, qui constitue un principe constitutionnel. Mais, pour éviter la censure du Conseil constitutionnel, le Gouvernement a mis en place toute une série de mesures fragilisant le salarié gréviste : la déclaration individuelle de grève, à l'article 5, l'allongement du préavis, le rappel pesant, à l'article 10, du non-paiement des jours de grève, comme si les salariés grévistes n'étaient pas les premiers à être affectés par les mouvements sociaux.
Cette loi a été l'un des premiers textes adoptés sous la treizième législature. D'autres ont suivi, renforçant chaque fois un peu plus l'attaque généralisée contre les libertés publiques. Criminalisation de l'action syndicale, prépondérance de la responsabilité individuelle dans les mouvements collectifs, arrestations nombreuses et violentes lors des manifestations – surtout quand le Président de la République est à proximité –, pour le Gouvernement, le gréviste n'est plus un citoyen en action, il est devenu un « délinquant social » !

Le débat d'aujourd'hui est un prétexte, à quelques semaines des régionales, pour enfoncer le clou. Le rapport d'Hervé Mariton préconise de pénaliser davantage les arrêts de travail de courte durée, d'interdire les nouveaux préavis pour des motifs de même objet, et d'imposer un préavis de soixante-douze heures pour les salariés désireux de réintégrer un mouvement. Une proposition de loi légalisant le recours à la réquisition en cas de grève a même été déposée.
Au moment de tirer le bilan, un constat s'impose. Ce n'est pas en contraignant le droit de grève qu'on encourage le dialogue social ! Bien au contraire, c'est en garantissant aux salariés des droits pour se défendre que l'on assure des négociations efficaces. La loi d'août 2007 ne favorise pas le dialogue social, comme en témoigne la grève du RER A de décembre dernier – mais il est vrai que nous n'avons pas la même interprétation des faits. Quand les directions se refusent à négocier, imposer le service minimum et rallonger le préavis de grève ne sert à rien.
Si vous pensez que je me trompe, madame la secrétaire d'État, si vous pensez que cette loi favorise le dialogue social, il faut le démontrer. Assurez-moi, par exemple, que la direction de la SNCF est disposée à prendre en compte les revendications de l'intersyndicale – très large – pour la grève du 3 février prochain ! Pouvez-vous affirmer que le Gouvernement entend ouvrir le débat sur les 3 600 suppressions de postes à la SNCF ? Si tel n'est pas le cas, alors c'est vous qui fermerez la porte et c'est vous qui porterez la responsabilité de la grève de mercredi prochain.
Enfin, le service minimum nous a été présenté comme une garantie inconditionnelle à la continuité du service public. Or, la garantie du service public, c'est avant tout des trains à l'heure, en nombre suffisant, et desservant tous les territoires, même les plus enclavés. Le rapport Kossowski-Bono sur « le renforcement du dialogue social » souligne que les grèves constituent une cause infime – 3 % - d'interruption du trafic. En revanche, 45 % des retards sur le réseau francilien sont dus à des causes externes – malveillance, accidents de personne – et 17 % à la défaillance des infrastructures.
Pour assurer la continuité du service public, il faut donc davantage d'agents dans les rames et d'investissements dans les infrastructures. Il faut que les transports soient rendus accessibles à tous par l'instauration d'un tarif unique de transport en Île-de-France, par le renforcement des tarifs spéciaux, notamment pour les familles nombreuses, par le maintien, enfin, de l'ensemble des lignes sur le territoire national – point sur lequel nous avons quelques raisons de nous inquiéter, une dégradation du réseau national étant annoncée. Voilà qui serait bien plus bénéfique aux services publics et aux usagers que la chasse aux grévistes à laquelle votre majorité s'emploie !
Tels doivent être le sens moderne d'un service public du transport et, à mon sens, la base incontournable du dialogue social.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est un homme en colère qui se présente à vous. Il ne s'agit pas que de ma propre colère : je porte également celle de centaines de milliers de nos concitoyens, pris en otages durant des jours de galère interminables en raison des grèves de la RATP, notamment sur la ligne A du RER.
Soyons francs : en temps ordinaire, le fonctionnement de la ligne A, c'est déjà la galère ! Cette situation est due au fait que le conseil régional a préféré, par exemple, financer le musée Salvador Allende au Chili, au détriment des investissements en région Île-de-France, qui constituent sa mission essentielle !

De tels propos sont scandaleux ! Ce n'est pas sérieux ! « À bas la culture », c'est cela ?

Je rejoins ici certaines critiques formulées par mon collègue Bénisti comme par certains députés de gauche : il est exact que la situation est d'abord le résultat d'un sous-investissement chronique de la région.

Un service garanti, ou minimum, est-il à la hauteur de la situation ? Le service minimum garantit, comme chacun le sait, 50 % du trafic, c'est-à-dire un train sur deux. C'est mieux que rien, mais c'est tout de même la galère au carré par rapport à la situation normale ! Je comprends la raison de la colère du peuple des usagers. Il est temps de prendre le taureau par les cornes : lorsqu'un droit constitutionnel, en l'occurrence le droit de grève, va à l'encontre d'autres droits constitutionnels, qu'il foule aux pieds – le droit d'aller et venir, le droit au travail, la liberté d'accès au service public, la liberté du commerce et de l'industrie…

…il doit être fermement et limitativement réglementé, conformément au préambule de la Constitution de 1946 – cité à cette tribune par notre collègue Vercamer –, repris en 1958, selon lequel le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
À ce titre, je rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 août 2007, a rappelé fermement que, si le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public » – un aspect que l'on semble oublier dans ce pays – « qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ». (« Très bien ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Je le dis avec fermeté : le service garanti ou minimum établi par la loi d'août 2007, même s'il constitue un progrès à mettre au crédit de ce gouvernement, n'est pas à la hauteur des enjeux des transports publics, notamment dans les grandes métropoles et en particulier en région parisienne. Nous devons avoir le courage d'affirmer la primauté de la continuité du service public sur toute autre considération, y compris le droit de grève. Les services publics des transports constituent, à mes yeux, la véritable artère sanguine de la cohésion sociale et nationale. En conséquence, je n'hésite pas à affirmer que je suis en faveur de l'interdiction du droit de grève dans les services de transports publics, une interdiction qui s'applique déjà à d'autres corps assurant des missions d'intérêt général, tels que la police, la magistrature, les pompiers, l'armée ou les transmissions.
Il va de soi qu'une telle disposition doit être accompagnée de mesures renforçant le dialogue social – je rejoins les critiques qui ont été formulées sur ce point –, un dialogue social qui doit être effectué en amont de tout conflit naissant.

En l'occurrence, madame la secrétaire d'État, lors du dernier conflit, certains, jusque dans nos rangs, ont émis quelques doutes sur la réalité de ce dialogue social. C'est pourquoi j'ai proposé qu'une commission d'enquête soit constituée, afin d'établir la réalité des responsabilités dans ce conflit, qui ne doit pas se répéter.
L'intangibilité du service public impose la fermeté, sans nul doute, mais elle commande également des investissements massifs pour améliorer un système obsolète, ainsi qu'un nécessaire dialogue social, effectué sous la tutelle d'un réel médiateur. L'art de la politique, madame la secrétaire d'État, c'est aussi l'art de la finesse, comme on le sait depuis Aristote. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est devenu une habitude pour la majorité : chaque fois que se pose un problème réel, on ouvre un débat sur un sujet périphérique, de manière à faire oublier les responsabilités…

…du Gouvernement. L'activisme remplace ainsi l'efficacité, et la recherche de vraies solutions est reléguée au second plan.
Le débat qui nous réunit aujourd'hui en est un bon exemple. Quelques semaines après la grève du RER A, et à quelques mois des élections régionales, ce débat sur le service minimum vise surtout, me semble-t-il, à susciter la polémique sur l'exercice du droit de grève, ce qui permet ainsi de mieux esquiver tout débat sur l'organisation des transports collectifs en Île-de-France.

Ce n'est pas la première manoeuvre politicienne venant de la droite autour de ce mouvement social. On se souvient des propos de Mme Pécresse qui, pendant la grève des conducteurs du RER A au mois de décembre, critiquait la gestion du conflit par Jean-Paul Huchon. (« Elle avait raison ! » sur les bancs du groupe UMP.) Comme si le président de la région pouvait régler les problèmes de rémunération entre des agents et la direction d'une entreprise publique, contrôlée à 100 % par l'État !

Mes chers collègues, veuillez avoir la délicatesse d'écouter l'orateur !

C'est plutôt l'attitude du président de la RATP – d'ailleurs soutenu par l'Élysée – qui a poussé au durcissement du conflit, sans qu'il soit tenu compte des conséquences pour les usagers, qu'il faudrait interroger.
La grève est toujours le constat d'un échec pour toutes les parties en présence. Elle n'est pas la cause d'un problème, mais sa conséquence. S'acharner, comme vous le faites, à vouloir la faire disparaître du paysage sans chercher à résoudre les problèmes qui en sont à l'origine, c'est comme chercher à faire tomber la fièvre d'un patient sans traiter la maladie. Surtout, vous oubliez que la responsabilité d'un mouvement social n'appartient pas qu'aux agents qui y participent, mais aussi aux directions d'entreprises qui n'ont pas su, ou pas voulu, agir en amont pour éviter que le conflit ne s'envenime.

Analyser les dysfonctionnements des transports, en particulier des transports franciliens, par le seul angle de la grève, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette.

Ce dont les usagers souffrent quotidiennement, comme tout le monde le reconnaît, ce sont des retards à répétition, de la saturation des rames, du manque de fiabilité d'un certain nombre de lignes.

Par rapport à la galère quotidienne, les grèves ne constituent qu'une cause infime d'interruption du trafic, comme l'a reconnu le président de la RATP lors d'une audition à l'Assemblée sur ce sujet.

À la RATP, on a compté 0,18 jour de grève par agent en 2008. Quelle débauche d'énergie, de lois, de débats, de discours, d'annonces, pour des chiffres aussi peu élevés !

Mais il est vrai que les quais bondés les jours de grève sont bien plus médiatiques que les mêmes quais, tout aussi bondés, les jours où le service fonctionne normalement !

Savez-vous par exemple que, pour le seul mois de janvier 2009, le taux d'annulation et de retard des rames sur le RER B s'est élevé à 25 % ? Savez-vous que, pour cette même période, ce taux était de 33 % sur le RER D ? Ce n'est pas la grève qui a forcé les usagers à attendre leur train dans le froid, mais l'état du réseau…

…et je n'ai pas le souvenir qu'un débat parlementaire ait été organisé à l'époque pour s'en offusquer.
Ne soyons pas dupes de cette manoeuvre et parlons enfin du vrai sujet : l'état du réseau de transports,…

…et en particulier celui du réseau francilien, puisque c'est celui que vous ciblez le plus, me semble-t-il.
Quand la région a repris la présidence du Syndicat des transports d'Île-de-France en 2006, le réseau qu'elle a récupéré était dans un état déplorable. Depuis de nombreuses années, l'État, qui le gérait jusqu'à cette date, n'avait pas fait les investissements nécessaires pour entretenir les infrastructures et le matériel. Aucun projet d'importance n'avait été financé depuis les RER dans les années soixante-dix et quatre-vingt.
Savez-vous, mes chers collègues, que le nombre de RER et de trains de banlieue en Île-de-France est équivalent au nombre de TER circulant dans toutes les régions françaises ?

C'est la raison principale des dysfonctionnements quotidiens qui exaspèrent aujourd'hui nos concitoyens.
Plusieurs lignes de métro ont atteint un taux de charge supérieur à 90 % de la capacité offerte, voire à 95 % pour trois d'entre elles. La ligne 13, pour l'amélioration de laquelle je me bats depuis que je suis députée, en est l'exemple le plus criant, puisque son taux de charge atteint par endroits 111 % de sa capacité. C'est dire l'ampleur de la tâche qui s'est présentée aux collectivités locales !
En réponse à ce défi, les élus locaux ont pris leurs responsabilités pour pallier les défaillances du Gouvernement ;…

…ils ont augmenté leur budget pour les transports de 60 % ces trois dernières années. Sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, il y a ceux qui multiplient les effets d'annonce et ceux qui agissent. Les collectivités locales d'Île-de-France gérées par la gauche font définitivement partie de la seconde catégorie.
Qu'a fait le Gouvernement pendant ce temps ? Il a continué à se désengager. Avez-vous remarqué, chers collègues, que les lois de finances que vous avez votées depuis 2002 ont entraîné une baisse de 48 % des sommes consacrées aux transports franciliens ?

Savez-vous que le tramway des maréchaux à Paris est le seul tramway de France…

…à être financé uniquement par deux collectivités locales – la ville de Paris et la région ?

Les habitants de la région parisienne ont-ils moins le droit de bénéficier de transports en commun performants que ceux de Marseille ou de Bordeaux ? Si le Gouvernement se fait le héraut de l'écologie, il devrait d'autant plus accompagner les collectivités pour les aider à investir dans les transports en commun.
Le plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France, porté par la région et la totalité des huit départements franciliens – qui, autant que je sache, ne sont pas tous dirigés par la gauche ! –…

…donne la priorité à des projets concrets et attendus : la désaturation de la ligne 13, le prolongement de la ligne 14, la modernisation des RER,…

…le prolongement du RER E – EOLE – jusqu'à La Défense, la rocade Arc Express, qui permettra enfin de voyager de banlieue à banlieue sans avoir à passer par Paris,…

…mais aussi les tramways en grande couronne pour desservir des territoires qui ont été délaissés pendant de trop nombreuses années.
Ce plan de 18,6 milliards d'euros a été présenté au ministre de l'écologie, M. Jean-Louis Borloo, par le président de la région et par les présidents des conseils généraux en juillet 2008. Un an et demi plus tard, le Gouvernement n'a toujours pas débloqué un euro pour soutenir ces projets !

Pourtant, ce ne sont pas les promesses qui manquent. Le 29 avril dernier, le Président de la République a ainsi annoncé 35 milliards d'euros pour financer les transports en Île-de-France. Puis Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, a été chargé de trouver de nouvelles ressources financières. Cela devait se traduire, selon la lettre de mission du Premier ministre, soit dans la loi de finances pour 2010, soit dans la loi sur le Grand Paris. Or, à ce jour, il n'y a toujours pas un euro inscrit, pas plus d'ailleurs que dans le plan de relance et dans le grand emprunt. Pas un euro !

Quant au Grand Huit de M. Blanc, il est estimé – et ce n'est qu'une estimation ! – à 21 milliards d'euros.

Si le Gouvernement s'attardait moins sur des projets pharaoniques et daignait engager un partenariat avec les collectivités, grâce à la somme demandée – 5 milliards d'euros – les voyageurs verraient sans doute leurs conditions de transport s'améliorer grandement et, surtout, rapidement. Il en irait de même des conditions de travail des conducteurs.

Je profite d'ailleurs de l'occasion pour interroger le Gouvernement sur la cohérence des propos que tiennent ses membres. En effet, Christian Blanc a expliqué pendant tout le débat à l'Assemblée sur le projet de loi du Grand Paris, et la semaine dernière encore devant une commission du Sénat qui l'auditionnait, que l'État prendrait entièrement à sa charge le coût du Grand Huit.

Or, jeudi dernier, la ministre de l'enseignement supérieur, Mme Valérie Pécresse, a annoncé que, si elle gagnait les prochaines élections régionales, le Grand Huit serait financé par un partenariat public-privé et que la région contribuerait à hauteur de 300 millions d'euros par an.
Alors, qui croire, si les membres du Gouvernement ne disent pas la même chose quant aux moyens de financer les transports publics, alors même que, en attendant, concrètement, il n'y a toujours pas un euro ? Je ne sais vraiment pas, mes chers collègues, comment nos concitoyens d'Île-de-France vont pouvoir continuer à prendre les transports publics.

Quand la région aura la même couleur politique que le Gouvernement, ça ira mieux !

Comment pouvez-vous dire, monsieur Myard, que les dysfonctionnements quotidiens subis par les usagers des transports publics sont le fait des grèves, ce qui est une façon d'insinuer que les salariés sont les premiers responsables ? À mon avis, vous vous trompez de cible.
Quel est donc l'objectif du présent débat ? S'agit-il de remettre en cause la loi de 2007 sur le service minimum ?

Nous vous avions pourtant avertis, à l'époque, qu'elle ne réglerait pas le problème.

Si nous voulons exiger un service minimum dans les transports en commun, alors il faut investir au maximum,…

Très bien ! Les députés UMP en restent cois : même M. Myard ne sait plus quoi dire – c'est bien la première fois ! (Sourires.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, le service minimum dans les transports publics a été un sujet souvent – trop souvent d'ailleurs – d'actualité.
Grâce à la majorité élue en 2007 et à la mise en oeuvre du programme présidentiel, la question a bien évolué.

Mais que veut dire « minimum » ? Selon John Pawson, « le minimum pourrait être défini comme la perfection qu'atteint un objet lorsqu'il n'est plus possible de l'améliorer par soustraction ». (Sourires.)

Alors, oui, nous pouvons toujours espérer tendre vers la perfection. Reconnaissons néanmoins que nous pouvons encore améliorer la situation. N'exagérons rien, mais les transports publics et les aléas matériels, temporels et structurels qu'ils peuvent causer nous ont amenés, nous parlementaires, à adopter le 2 août 2007 une loi relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Ce texte comporte deux volets principaux : l'un consacré à la prévention des conflits dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transports terrestres,…

…et l'autre traitant de l'organisation du service en cas de grève ou d'autres perturbations prévisibles du trafic.
Comme je l'ai indiqué précédemment, des éléments positifs ont – bien heureusement – résulté de la promulgation de cette loi. Reconnaissons tout de même que l'instauration de ce service minimum, voulu par le Président de la République, a limité les perturbations et a surtout garanti la mise en place d'un service minimum dans les transports aux heures de pointe. Rappelons qu'en 1995 – pour prendre un exemple typique de ce qui se passait avant – l'Île-de-France avait été totalement paralysée du 24 novembre au 15 décembre.

Cela avait non seulement un impact sur les usagers et leur patience, mais aussi des conséquences non négligeables au niveau économique, sans oublier l'emploi, qui était lui aussi touché.
La loi a au moins le mérite de garantir aux usagers, qui sont les premiers touchés par les mouvements sociaux, un minimum de service. Néanmoins, cela n'est pas entièrement satisfaisant.
En effet, c'est au niveau de l'organisation même des grèves et des perturbations qu'elles entraînent qu'il faut travailler à améliorer le dispositif. On ne peut pas tolérer un tel désordre et une telle désorganisation pour les usagers franciliens des transports publics. Ne soyons pas naïfs : en France, quand il y a une grève, tout le monde s'en aperçoit, ou plutôt personne ne peut l'ignorer ! (Sourires.)
Attachons-nous donc à corriger une faille de notre législation qui me semble une ineptie : le recours aux fameuses « mini-grèves » tournantes de cinquante-neuf minutes, par lesquelles les syndicalistes ont réussi à contourner et à neutraliser la législation existante. Guillaume Pépy, président de la SNCF, en est lui aussi conscient. Il estime en effet que « le temps est venu de revoir les règles qui autorisent à la SNCF des grèves reconductibles d'une heure ». Notre collègue Hervé Mariton suggère à juste titre une refonte du texte.
À l'évidence, ce débat est utile, il devait avoir lieu et il nous faut agir sans tarder. Des solutions existent, qui pourraient corriger la loi et rendre le service minimum plus efficace. Trois mécanismes correcteurs me semblent constituer une bonne base pour notre réflexion législative. Certes, ils sont radicaux, mais auraient au moins l'avantage d'atteindre le but premier, qui est de garantir un réel service minimum dans les transports, de sorte que personne ne s'aperçoive de l'existence de grèves.
Le premier serait l'application du principe du trentième indivisible, en vigueur dans toute la fonction publique : en cas d'arrêt de travail durant une fraction quelconque de la journée, une retenue d'une journée entière est opérée sur le salaire de l'agent gréviste.
D'autre part, on rendrait illégal le dépôt de préavis couvrant plusieurs modalités de grève. Il faudrait aussi empêcher des salariés d'entrer dans un conflit, puis de le quitter et ensuite d'y revenir.
Enfin, il faudrait encadrer le droit de retrait utilisé de façon collective.

Certains de nos collègues, telle Mme Lepetit, considèrent qu'une moyenne de 0,13 jour de grève par agent à la SNCF, cela n'est pas si grave. Mais, si l'on considère qu'il y a 238 000 agents à la SNCF, cette moyenne représente en réalité 31 000 jours de grève par an, c'est-à-dire, en moyenne, 84 salariés en grève chaque jour. Quand on sait qu'il suffit qu'une trentaine de conducteurs se mettent en grève pour bloquer une ligne de RER ou de métro, on se doit de manier ces chiffres avec prudence.
Il n'est nullement question de mettre en cause le droit grève : c'est un droit fondamental, garanti par la Constitution, mais c'est aussi un droit encadré et limité, ainsi que le stipule le septième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. »
Utilisateur quotidien des transports en commun, je côtoie régulièrement des passagers qui, dans l'ensemble, sont satisfaits de cette avancée. Je note néanmoins que, les jours où les grèves sont très suivies, les transports se doivent d'être mieux organisés, de manière à occasionner une gêne minimale. Ce principe pourrait déjà être appliqué pour la grève prévue mercredi prochain dans les transports de la région parisienne.
Dans l'intérêt de tous et pour tous – aussi bien pour les salariés, dont les revendications seraient mieux structurées et obtiendraient de meilleurs résultats, que pour les usagers qui, ne l'oublions pas, paient un titre de transport –, pour que chacun puisse exercer des droits et libertés qui nous sont si chers et que notre Constitution consacre, je vous propose la formule suivante : liberté de grève pour les uns, liberté d'aller et venir pour les autres. Je souhaite donc que nous puissions réajuster la loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le débat sur la mise en oeuvre du service minimum nous amène à dresser un bilan de la loi du 21 août 2007.
Ce texte, dont j'avais été le rapporteur, avait pour ambition de concilier deux principes de valeur constitutionnelle – le droit de grève et la continuité du service public –, notamment grâce à une meilleure prévisibilité de la mise en place d'une desserte prioritaire, en fonction des effectifs disponibles. À cette fin, la loi devait contribuer au développement du dialogue social au sein des entreprises dans les transports terrestres.
Deux ans et demi après l'adoption du texte, je considère que son application est globalement satisfaisante, comme je l'avais d'ailleurs déjà écrit en mars 2009 avec mon collègue socialiste Maxime Bono dans un rapport d'information intitulé : Le Renforcement du dialogue social : clef de voûte de la continuité du service public.
Nous avions auditionné toutes les parties prenantes, syndicats et direction, sur cette question. La plupart de nos interlocuteurs reconnaissaient que la loi avait un effet positif sur le dialogue social et la conflictualité.

Elle a même renforcé les acquis des accords précédemment conclus entre les partenaires sociaux, notamment au sein de la SNCF et de la RATP.
De plus, la loi constitue une avancée favorable pour les usagers, tant en termes d'information que de circulation des moyens de transport. Ainsi, pour ne citer qu'un seul chiffre, le nombre de journées perdues à la SNCF pour fait de grève en 2008 a été le plus bas depuis quatre ans. À la RATP, le nombre de jours de grève par agent en 2008 était de 0,18 – cela a été dit tout à l'heure.
Je prends un autre exemple : la journée de grève nationale interprofessionnelle du 29 janvier 2009 a montré que le dispositif législatif fonctionnait. Les perturbations pour l'usager sont en effet demeurées limitées.
Ce bilan positif ne saurait nous faire oublier les événements de la gare Saint-Lazare au mois de janvier 2009, ou encore la grève du RER A du 10 au 24 décembre dernier. Dans ces cas précis, il convient de reconnaître les limites de la loi de 2007. En effet, en cas de grève massive – nous l'avions d'ailleurs dit –, le dispositif législatif n'instaure pas un service minimum stricto sensu.

Un véritable service minimum impliquerait en effet l'usage du droit de réquisition, ce qui ne me semble ni praticable ni souhaitable. Dans une période de crise, si la mesure de réquisition n'est pas acceptée par des grévistes, pourrait-on prendre le risque d'avoir recours à la force ? Favoriser le dialogue social me paraît plus judicieux et plus efficace.
Dans le cas de la grève du RER A du mois de décembre dernier, la loi de 2007 a également eu des effets positifs – même si je comprends le désarroi des usagers attendant les rames dans des conditions météorologiques éprouvantes. Malgré un taux de grévistes de 90 à 95 %, la RATP a pu assurer 60 % de la circulation des rames aux heures de pointe, permettant ainsi à une majorité d'usagers d'effectuer leur trajet journalier entre leur lieu de travail et leur domicile. La Régie, dirigée par Pierre Mongin, a su s'adapter, tant en termes d'organisation du trafic qu'en termes d'information préalable des usagers. Il est illusoire de penser qu'il aurait été possible d'avoir un service faiblement perturbé avec un nombre de grévistes aussi important – à moins de limiter drastiquement le droit de grève, ce qui serait contraire à la Constitution.

Je ne suis donc pas favorable, dans l'immédiat, à une modification de la loi. Ce serait prendre le risque de remettre en cause tous ces acquis, sans forcément y gagner quoi que ce soit. Le cadre juridique est aujourd'hui efficace ; il favorise la négociation ; préservons-le.
En revanche, des mesures pourraient être prises afin d'améliorer encore la situation. Maxime Bono et moi-même avions formulé dans notre rapport d'information plusieurs propositions qui demeurent d'actualité.
D'abord, nous proposions la création d'un observatoire des relations sociales dans les transports terrestres, doté de tous les pouvoirs d'investigation nécessaires, et appelé à faire un bilan de l'état du dialogue social en France. Tierce partie, il procéderait à un examen impartial de la situation dans les entreprises et ne serait en aucune manière obligé de répondre aux sollicitations ; il ne serait ainsi pas pris dans d'éventuels conflits.

Nous proposions ensuite de renforcer le dialogue social sur la sécurité : ce serait le meilleur moyen d'éviter les grèves émotionnelles, comme celle de Saint-Lazare. Il est notamment essentiel que l'information exacte soit diffusée en temps réel à tous les agents concernés, afin d'éviter que la rumeur ne tienne lieu d'information.
Il faut ensuite assurer la prise en charge la plus efficace possible des agents victimes d'une agression, et préparer autant que possible les conducteurs à des situations tendues. Il convient d'accentuer le rôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Nous proposions encore que des négociations collectives soient engagées dans toutes les entreprises relevant du champ de la loi, en vue de faire en sorte que, lorsque le service du matin a été assuré, celui du soir le soit aussi.
Notre quatrième proposition consistait à inviter les partenaires sociaux à interdire par voie conventionnelle tout nouveau préavis de grève, quels qu'en soient le motif ou l'origine, avant l'expiration des négociations engagées sur un précédent préavis.
Notre cinquième proposition est de poursuivre activement la politique de décentralisation et de déconcentration du pouvoir, notamment à la SNCF, de manière à rapprocher le management du terrain.
Nous proposions enfin de développer, en accord avec tous les acteurs, des indicateurs permettant de mesurer l'application de la loi sur le long terme. Le Parlement pourrait ainsi assurer un suivi annuel de cette application.
Je tiens à souligner pour conclure l'importance des investissements dans les réseaux de transport et le matériel – vous en avez parlé, mes chers collègues.

Nombre de dysfonctionnements du trafic sont en effet dus à des incidents techniques. L'État, la SNCF, la RATP et les régions font des efforts, je le sais, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut moderniser les outils de transport : les relations entre les salariés, les directions et les usagers n'en seront que meilleurs, pour le plus grand bénéfice de la continuité de ce service public. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

La parole est à Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, je vous demande tout d'abord de bien vouloir excuser M. Xavier Darcos qui est aujourd'hui en déplacement ministériel en province.
Je tiens à remercier très sincèrement le groupe centriste, et en particulier vous, monsieur Vercamer, pour avoir proposé ce débat qui porte sur l'une des premières grandes réformes du quinquennat.
Le service minimum dans les transports était – faut-il le rappeler ? – un engagement du Président de la République pour répondre à une attente forte et légitime des Français. J'entends ce que vous dites, monsieur Myard – et vous le dites avec la passion qui vous anime toujours – sur le ras-le-bol…
…de certains usagers. Mais, monsieur le député, depuis combien d'années parlait-on, sans agir, du service minimum ? Nous, nous l'avons fait.
C'est d'ailleurs l'une des premières mesures que nous avons adoptée.
Dès son installation, le Gouvernement auquel j'appartiens a fait voter la loi du 21 août 2007, relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, afin de garantir aux usagers, en cas de grève, un service réduit mais opérationnel et prévisible. M. Kossowski en était le rapporteur.
Il fallait trouver le bon équilibre entre deux principes constitutionnels : le respect du droit de grève ; la continuité du service public. Et nous l'avons trouvé – j'oserai dire à vous entendre : ne vous en déplaise, monsieur Vidalies. Vous avez, comme d'autres intervenants d'ailleurs, évoqué les élections régionales. De nombreuses régions se sont engagées dans la mise en oeuvre du plan transport. Mais ce n'est pas le cas de toutes : dans une dizaine de régions, les préfets se sont substitués au conseil régional, qui n'a pas validé les plans ; ceux-ci ont été approuvés par arrêté. Je peux citer l'Auvergne, la Basse-Normandie, la Bourgogne, le Centre, Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, la Picardie, et Poitou-Charentes.
Dans le Limousin, le plan est en cours de délibération pour validation.
De manière générale, on peut observer que les préfets ont utilisé leur droit de substitution ou prévoyaient de le faire lorsque les enjeux de transports sont importants à l'échelle locale. Cinq régions sont concernées : Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes.
L'État a donné aux régions les moyens d'agir en faveur des voyageurs et des clients.
Au regard des services que nous devons aux usagers, je trouve regrettable de vous entendre, monsieur Vidalies, qualifier de « prisme étroit » le service minimum.

Je me suis efforcé de modérer mes propos. (Sourires sur les bancs du groupe SRC.)
En renforçant le dialogue social dans les entreprises de transport, la loi – comme vous l'avez souligné, monsieur Bénisti – vise d'abord à prévenir les conflits par la discussion et la négociation. Madame Lepetit, reconnaissez-le : nous traitons la fièvre et la maladie.
En cas de grève ou, de manière plus générale, de perturbation prévisible du trafic, elle fixe le cadre dans lequel le service de transport public doit être organisé pour continuer à remplir sa mission.
Elle poursuit ainsi trois objectifs complémentaires : tout d'abord, prévenir les conflits par le dialogue – monsieur Bénisti, je note d'ailleurs votre idée d'étendre le processus de prévention des conflits par la médiation : ce qui existe dans les transports doit d'ailleurs inspirer d'autres secteurs, d'autres entreprises, pour limiter les conflits, comme savent le faire nos amis québécois avec la médiation préventive.
La loi vise ensuite à mieux organiser le service des transports publics en cas de grève, en permettant de connaître précisément le nombre des grévistes et des non-grévistes. Monsieur Calméjane, la jurisprudence du Conseil constitutionnel limite les réponses que l'on peut apporter aux grèves de cinquante-neuf minutes ; mais une décision du Conseil d'État datant du mois de novembre 2009 réduit, en revanche, les possibilités ouvertes par ces grèves.
La loi vise enfin – et c'est fondamental – à donner aux usagers toutes les informations nécessaires sur l'état du service en cas de perturbation.
Sur ces trois objectifs, cette loi, qui s'applique aux entreprises de transport urbain, à la SNCF, à la RATP et aux 170 adhérentes à l'UTP, a montré son utilité et son efficacité.
Monsieur Gosnat, je voudrais préciser que, à la SNCF, 90 % des démarches de concertation immédiate, prévues par la loi, ont permis de désamorcer des conflits ; ce chiffre est de 88 % à la RATP.
Certains se sont déclarés choqués de voir rappeler dans la loi que, lorsqu'on est en grève, on ne travaille pas et que, lorsqu'on ne travaille pas, on n'est pas payé : ce sont pourtant de simples principes de bon sens, et il n'est pas mauvais de les rappeler.
Parlons de cette loi. Sa première innovation, c'est d'instituer de façon préventive une procédure de concertation préalable à tout préavis de grève, afin de favoriser le dialogue et la recherche d'une solution négociée : 80 % des entreprises de transports publics urbains l'appliquent, ce qui a permis d'éviter un dépôt du préavis de grève dans 40 % des cas depuis la publication de la loi.
À la RATP, on comptait en moyenne 180 préavis de grève chaque année depuis 2003. Ce nombre a été divisé par trois en 2008 : il y a eu 59 préavis.
Pour 2009, le nombre de préavis s'établissait à 80 à la fin du mois de novembre avant la grève sur la ligne A du RER, sur laquelle je reviendrai. À la SNCF, le nombre de préavis de grève déposés en 2009 est en baisse de 30 % par rapport au premier semestre 2007. Le dispositif fonctionne également au niveau local, où le nombre de journées de grève en 2009 a été divisé par deux par rapport à 2007.
La deuxième grande innovation de cette loi, c'est d'imposer que l'exercice individuel du droit de grève fasse l'objet d'une déclaration individuelle d'intention. Cette mesure permet de connaître les effectifs de grévistes et les personnels disponibles dans un délai suffisant pour permettre à l'entreprise de transport de s'organiser en conséquence : il s'agit là du volet « prévisibilité » et « continuité » de la loi, qui a montré son utilité pour organiser au mieux le service.
Le troisième volet de la loi, le volet informatif, vise à donner aux usagers une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré en cas de perturbation.
L'entreprise de transport doit, à cet effet, élaborer un plan d'information des voyageurs, qui doit être rendu public. Les usagers peuvent donc connaître, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation prévisible, l'état du service qui sera assuré.
Ainsi, lors des grandes grèves nationales des 22 mai 2008 et 29 janvier 2009, la SNCF a assuré le service annoncé. À la RATP, sur les vingt-cinq grèves recensées en 2009, le plan de transport a été mis en place dix-neuf fois. Le service aux heures de pointe a été, dans dix-sept cas, supérieur à 50 %, ce qui est donc conforme à l'engagement de service.
Dans les six cas où la RATP a été jugée responsable de l'absence de mise en place d'un service minimum, les clients ont bénéficié du remboursement prévu par l'article 9 de la loi. Cette indemnisation a représenté un montant non négligeable, de l'ordre de 2 millions d'euros.
Madame Lepetit, la ligne A du réseau RER transporte, comme vous le savez, environ 1 million de voyageurs par jour. Il en résulte des problèmes de capacité, pour lesquels des investissements ont été décidés, sous l'impulsion du Gouvernement.
Ces décisions se traduiront par la mise en service de matériel roulant plus performant et de plus grande capacité à partir de 2011. L'investissement au titre du plan de relance du Gouvernement s'est élevé, en 2009, à 450 millions d'euros sur le réseau RATP.
Je rappelle que, du 10 au 24 décembre 2009, les grévistes ont représenté de 90 à 95 % des effectifs journaliers mobilisés sur la ligne A où travaillent 300 conducteurs sur les 500 affectés à la ligne.
La substitution des personnels de maîtrise et d'encadrement aux conducteurs grévistes a cependant permis d'assurer environ 60 % des circulations aux heures de pointe jusqu'au 24 décembre.
La RATP a particulièrement bien respecté ses engagements avec le STIF. Ses résultats vont au-delà de ses obligations contractuelles.
En dehors de l'Île-de-France, les autorités organisatrices de transports se sont également impliquées dans la mise en oeuvre de la loi. Je regrette, comme vous, que de nombreuses régions aient refusé de le faire pour des raisons purement politiciennes.
Deux ans après son entrée en vigueur, la loi a donc largement répondu aux objectifs du législateur : prévenir les conflits et organiser les services de transports terrestres en cas de grève, sans entraver l'exercice de ce droit légitime.
C'est le même esprit qui a présidé à la mise en place du service minimum d'accueil à l'école primaire.
Que ce soit à l'école ou dans les transports, le service minimum est donc une avancée majeure pour nos concitoyens et un signe de maturité de notre dialogue social.
Le débat de ce jour nous permettra sans doute de continuer à échanger sur les points qui restent l'objet de discussions. Le Gouvernement a pris connaissance avec attention du rapport d'information sur l'application de la loi du 21 août 2007 de vos collègues Jacques Kossowski et Maxime Bono. Ces derniers relèvent que, au terme d'une année d'application, cette loi a atteint ses objectifs, et le Gouvernement se félicite de cette analyse.
Certaines de leurs propositions ouvrent des pistes intéressantes, et c'est l'occasion pour moi de revenir sur plusieurs points.
La loi sur le service minimum d'accueil dans les transports a pu susciter des incompréhensions, certains en attendant des effets qu'elle ne pouvait produire : si 100 % des agents exercent leur droit de grève, il est clair qu'aucun service ne peut être assuré.
À ceux qui veulent limiter les conditions d'exercice du droit de grève, je rappellerai que le droit de grève étant un droit constitutionnellement garanti, il convient d'être prudent avant d'envisager toute mesure qui pourrait remettre en cause l'équilibre que nous avons trouvé.
La diminution du nombre de préavis et de grèves apparaît aujourd'hui comme une conséquence remarquable de l'amélioration du dialogue social dans les entreprises. C'est d'abord ce dialogue qu'il appartient aux entreprises de développer. Lors de la grève de la ligne A notamment, un meilleur dialogue aurait sans doute empêché quatorze jours de grève. Il importe donc que tous les acteurs prennent leurs responsabilités.
S'agissant de la réquisition que vous avez évoquée, monsieur Vercamer, je rappelle qu'il s'agit d'un mode opératoire que l'on ne peut utiliser que dans des circonstances exceptionnellement graves, par exemple en temps de guerre.
En dehors de ces situations extrêmes, un tel dispositif pourrait être considéré comme une entrave au droit de grève et déclaré de fait inconstitutionnel.
Enfin, monsieur Vercamer, vous avez fort justement souligné l'importance de la négociation collective. Je note que les entreprises qui entrent dans le champ de la loi de 2007 sont toutes, aujourd'hui, couvertes par des accords collectifs, de branche ou d'entreprise, et ceci grâce à la dynamique créée par ce texte.
Mesdames et messieurs les députés, la loi du 21 août 2007 doit pouvoir produire tous ses effets. Si le Gouvernement, pour sa part, n'envisage pas de la modifier dans l'immédiat, il est disposé à échanger avec vous, je le répète, sur tous les points que vous souhaiteriez examiner en vue d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers en période de perturbation du trafic, dans le respect de nos principes constitutionnels.
Ainsi, nous trouvons intéressante l'idée qui consisterait à confier au Groupement des autorités responsables des transports une mission afin qu'il propose, après examen des systèmes existants et échange avec les entreprises, une série d'indicateurs communs aux prestataires de transports urbains permettant le suivi des conflits collectifs dans les transports. Voilà une des pistes sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble.
Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, je remercie l'ensemble des orateurs de leurs interventions et M. Vercamer d'avoir bien voulu être à l'origine de ce débat. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

Prochaine séance, mardi 2 février à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Projet de loi organique et projet de loi relatifs à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
Projet de loi de finances rectificative pour 2010.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma