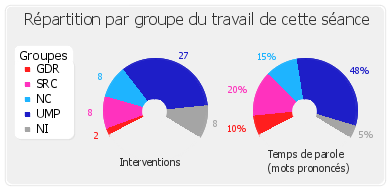Séance en hémicycle du 24 octobre 2011 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à seize heures.)

Le 25 septembre 2011, ont été élus sénateurs M. François Calvet, M. Michel Delebarre, Mme Odette Duriez, Mme Jacqueline Farreyrol, M. Pierre Frogier, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Grosdidier, M. Jean-Claude Lenoir, M. Jean-Claude Leroy, M. Alain Néri, Mme Sophie Primas et M. André Vallini. Leur mandat a pris effet à compter du 1er octobre 2011.
M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre l'informant qu'aucune requête n'a été déposée contre ces élections dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
En conséquence, en application de l'article LO 137 du code électoral, il est pris acte de la vacance de leurs sièges de députés.


Nous en venons, dans les conditions arrêtées par la Conférence des présidents, à l'article 30 relatif à l'évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne.
La parole est à M. Jean Leonetti, ministre chargé des affaires européennes.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires européennes, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, dans le contexte très particulier des jours qui viennent pour l'avenir de l'Europe, j'ai l'honneur de présenter devant vous l'article 30 du projet de loi de finances. Cet article unique fixe, vous le savez, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget européen.
La contribution française au budget de l'Union européenne est évaluée à 18,878 milliards d'euros pour 2012. Ce montant est en augmentation par rapport à l'année dernière puisque la prévision d'exécution du prélèvement sur recettes pour 2011 s'établit à 18,2 milliards d'euros.
Ce montant est le prix, nécessaire, que nous acceptons de payer pour que la France et l'Europe soient au rendez-vous du XXIe siècle, pour que l'Europe soit un véritable moteur, qu'elle soit à la fois une Europe qui nous protège et une Europe qui nous projette. Je pense par exemple à Galileo, qui a enregistré un beau succès avec le lancement réussi depuis Kourou. Je pense à la préservation de notre politique agricole commune.
Je pense encore à l'industrialisation et à l'énergie. Tout cela dans un budget où les solidarités doivent être affirmées prioritairement.
Ce projet d'avenir repose sur des bases raisonnables qui doivent renvoyer à l'harmonie que nous devons trouver avec les budgets nationaux.
Je comprends la position des députés nationaux et celle des députés européens devant la perplexité que peut provoquer cette discussion. Disons-le clairement, le régime actuel des ressources propres de l'Union s'essouffle et les pressions des États pour obtenir des « retours nationaux » jouent un rôle capital, voire délétère dans les négociations. Nous savons tous pourtant combien ce concept de « retour national » est ambigu, sujet à discussion, parfois même entrave à l'ambition. Je l'ai encore perçu lors des échanges entre parlementaires nationaux et européens qui ont eu lieu à Bruxelles la semaine dernière au sujet du prochain cadre financier 2014-2020.
Pour en revenir à 2012 et à la contribution française, le montant du prélèvement communautaire est, vous le savez, calculé sur la base de la position du Conseil. La négociation du budget européen pour l'année prochaine est actuellement en cours.
Pour reprendre les principales positions, la Commission a présenté un projet de budget qui affichait, par rapport au budget de 2011, une croissance de 3,7 % des crédits d'engagement et de 4,9 % des crédits de paiement. Nous avons indiqué que la hausse proposée des crédits était, à nos yeux, inacceptable. Le Conseil, quant à lui, a adopté en juillet sa position sur le projet. Il s'est prononcé en faveur d'une limitation de la progression des crédits à 2,02 % par rapport à l'année dernière. Les efforts de maîtrise des dépenses sont donc renforcés par rapport à 2011, tout en assurant, bien sûr, un financement adéquat des politiques de l'Union mais aussi un budget au plus près des besoins réels.
J'insiste sur ce point : le budget 2012, tel que revu par le Conseil, et qui sert de base à la contribution française que nous discutons aujourd'hui, est un réel budget d'action, ambitieux, centré sur des besoins réels en crédits de paiement, en fonction des prévisions d'exécution de chaque rubrique. Ainsi, les crédits en faveur de la politique de cohésion augmenteront, très significativement, de 5,2 % par rapport à 2011.
Il appartient désormais au Parlement européen d'arrêter sa position, ce qu'il devrait faire le 26 octobre. Nous attendons qu'il fasse preuve d'un esprit d'ambition et de responsabilité, dans le contexte difficile que connaissent les finances publiques de tous les Etats membres.
Comme vous le savez, le prélèvement sur recettes, bien qu'il retrace des recettes collectées pour le compte de l'Union européenne, est inclus depuis 2008 dans la norme des dépenses de l'Etat. Ce principe, couplé à la règle de progression dite « zéro valeur » et à la hausse de la contribution française au budget européen, implique une discipline forte sur les autres postes de dépense nationaux. Le gouvernement français en est pleinement conscient. C'est la raison pour laquelle il défend, constamment, la maîtrise des dépenses et la bonne gestion financière dans les instances européennes, comme il le fait au niveau national. Le budget européen ne peut s'exonérer des efforts budgétaires qui pèsent sur nos budgets nationaux. C'est le message très ferme que j'ai adressé à mes interlocuteurs de la Commission et du Parlement dans cette négociation, tant pour le budget 2012 que dans le cadre des perspectives financières 2014-2020.
Lors de la négociation du budget pour 2011, les autorités françaises s'étaient fortement impliquées dans les discussions budgétaires européennes. Le Président lui-même avait signé une lettre appelée « Lettre des 12 » affirmant que le budget européen pour 2011 ne pouvait excéder 2,91 % d'augmentation. C'est le chiffre qui a été retenu. Le gouvernement français fait preuve de la même détermination cette année, en faisant valoir à la fois le montant des dépenses et l'indispensable amélioration de la qualité et de l'efficience de la dépense communautaire. Dépenser mieux est souvent plus intelligent que dépenser plus.
Permettez-moi d'évoquer enfin la question du financement de préadhésion. J'ai pris connaissance des amendements relatifs à la Turquie. À cet égard, je redis la position française, fixée par le Président de la République : la Turquie, aux yeux de la France, n'a pas vocation à entrer dans l'Union européenne.
La Turquie a cependant été reconnue comme candidate à l'entrée dans l'Union européenne en 1999 par le Conseil européen. Mais la reconnaissance du statut de pays candidat est une chose ; l'adhésion en est une autre. Notre position est claire : les négociations actuellement engagées avec la Turquie doivent aboutir à un partenariat privilégié et non à une adhésion pleine et entière. Nous avons donc refusé l'ouverture des chapitres de négociation qui mèneraient à l'adhésion.
Je ne peux, pour cette raison, appuyer les amendements qui ont été déposés. Comme pour les autres pays auxquels a été reconnu le statut de candidat à l'Union européenne, la Turquie bénéficie d'un programme d'aide financé sur le budget communautaire. Encore une fois, ces crédits attribués à la Turquie par l'Union européenne ne préjugent en rien de l'issue des négociations. Bien qu'élevés – 4,873 milliards d'euros pour la période 2007-2013 –, ces moyens financiers sont à la mesure de la taille de ce pays, de son importance stratégique et de la densité exceptionnelle des relations entre l'Union européenne et la Turquie, fondées sur une coopération de près de cinquante ans.
Ce grand pays est absolument indispensable dans les équilibres qui sont en jeu aujourd'hui, en particulier au regard de l'évolution des printemps arabes. La réussite de cette coopération est dans l'intérêt de l'Union européenne. Elle est aussi dans l'intérêt de la France. Cela justifie pleinement un soutien financier de la part de l'Union européenne, notamment pour aider la Turquie à moderniser ses infrastructures, pour en faire un véritable interlocuteur de la France et de l'Union européenne, et pour qu'elle puisse se rapprocher des normes européennes, du point de vue tant économique que sociétal ou politique.
Telles sont, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, les quelques éléments que je souhaitais relever concernant le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne pour l'année 2012.
Sur cette base, le Gouvernement a l'honneur de vous demander d'approuver l'article 30 du projet de loi de finances.

La parole est à M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat autour du prélèvement européen s'inscrit cette année dans un contexte très particulier : les chefs d'État et de Gouvernement de la zone euro se sont réunis hier et se réunissent à nouveau après-demain pour tenter de trouver une solution à la grave crise des dettes publiques que nous subissons. Plutôt que d'évoquer comme tous les ans le prélèvement sur recettes au travers de considérations budgétaires, je profiterai donc de ces quelques minutes pour faire rapidement le point sur la mise en place du dispositif de stabilisation financière de la zone euro.
Les fondements de la crise sont de deux ordres : d'une part, ils tiennent aux déficits des finances publiques, et sont donc d'ordre budgétaire ; d'autre part, et c'est plus préoccupant, ces déficits budgétaires reflètent, en réalité, les déficits de compétitivité de certaines économies de la zone euro, qui se sont hélas accrus depuis la mise en place de l'euro.
On voit bien que si nous ne parvenons pas à résorber ces déficits à la fois de finances publiques et de compétitivité, nous ne trouverons pas de solution durable.
Lorsque, il y a trois ans, la crise financière a frappé les économies privées, constatant que les États étaient partout appelés à la rescousse, y compris dans les paradis de l'intervention libérale, beaucoup d'entre nous se doutaient qu'après cette crise de la dette privée surviendrait la crise de la dette publique. Et cette dernière frappe, comme toujours, les plus vulnérables. C'est ainsi qu'un mouvement de défiance à l'égard des dettes souveraines s'est développé depuis deux ans, mouvement que nous n'avions pas connu de façon aussi systématique dans l'histoire économique des dernières décennies.
Ce mouvement de défiance est alimenté par la très rapide hausse des endettements publics, certes dans les économies les plus fragiles, mais également dans les économies aux finances publiques très solides, comme l'Allemagne où le taux d'endettement public a progressé très fortement. Hélas ! face à cet endettement public, les perspectives de croissance sont, du fait de la crise, faibles. Et nous nous demandons comment opérer les remboursements.
Par ailleurs, la crise montre à quel point les États de la zone euro sont interdépendants entre eux et comment chacun des États dépend du système financier. C'est ainsi que surgissent les interrogations sur le risque de contagion et d'effet domino.
Dès le printemps 2010, le Fonds européen de stabilité financière a été mis en place, pour permettre aux économies les plus vulnérables de faire face à des problèmes de souveraineté, à travers le remboursement de leur dette publique et la possibilité de se refinancer.
Au mois de mai 2010, en loi de finances rectificative, la France apporte à ce fonds une garantie de 111 milliards d'euros, mais, un an plus tard, en juin 2011, elle est obligée de porter sa garantie, comme l'Allemagne d'ailleurs, à 159 milliards. Nous nous sommes rendu compte en effet que ce fonds, chargé d'intervenir pour financer des pays en difficulté, avait besoin de garanties de refinancement et qu'il ne les obtiendrait à de bonnes conditions, des conditions triple A, que s'il était garanti lui-même par des pays triple A. Cela explique que notre pays, ainsi que l'Allemagne et les autres pays triple A, aient dû s'engager pour des montants beaucoup plus importants que prévu. Aujourd'hui, la capacité totale d'engagement du fonds atteint à 440 milliards d'euros.
Après l'accord du 21 juillet 2011, une énième loi de finances rectificative – décidément, le rapporteur général ne chôme pas, jamais on n'en a eu autant, une tous les deux mois –– celle du mois de septembre, qui a permis de traiter également d'autres sujets, plus franco-français, en matière de recettes, a été l'occasion d'autoriser l'État français, car il faut dorénavant une autorisation parlementaire, à élargir le champ des garanties qu'il est susceptible de donner au Fonds européen de stabilité financière. Ce fonds a maintenant trois possibilités d'action qui n'étaient pas prévues au départ : il peut intervenir sur les marchés secondaires pour y acheter de la dette ; il peut intervenir pour la recapitalisation de banques, si nécessaire, par des moyens qui ne sont pas encore définis – nous y verrons peut-être plus clair mercredi ; enfin, il peut intervenir de façon préventive, en faveur d'États qui ne sont pas directement en difficulté.
On voit à quel point le Fonds européen de stabilité financière va jouer, et joue déjà, un rôle crucial. Il n'est pas étonnant, dans ce contexte, qu'il faille beaucoup de temps pour se mettre d'accord sur ses modalités d'intervention : c'est ce que j'explique régulièrement à ceux qui se demandent pourquoi le processus de décision prend autant de temps.
Nous savons pertinemment que les 440 milliards d'euros – dont 300 restent effectivement mobilisables ne serait-ce que parce que l'aide à la Grèce en a directement mobilisé une partie substantielle – ne seraient pas à la hauteur si jamais un grand pays de la zone euro connaissait de grosses difficultés. Le relais a d'ailleurs dû être pris ces derniers mois par la Banque centrale européenne, laquelle a été conduite à acquérir pour plusieurs dizaines de milliards, entre 100 et 150, de dettes souveraines sur le second marché.
Dès lors, beaucoup de personnes se demandent s'il faut ou non faire tourner la planche à billets – les Américains emploient un terme beaucoup plus policé, quantitative easing. La Réserve fédérale alimente aujourd'hui la couverture des déficits américains, et la Banque d'Angleterre effectue exactement les mêmes opérations. La Banque centrale européenne refuse catégoriquement d'agir en ce sens, étant entendu qu'elle intervient déjà sur les marchés secondaires, ce qui n'est pas rien. Je pense que nous avons raison de rester sur cette ligne, mais j'attends avec impatience, moi aussi, les résultats de mercredi pour connaître la technique financière qui nous permettra de potentialiser, de dynamiser, les 300 milliards du Fonds européen de stabilité financière qui restent aujourd'hui disponibles.
L'objectif est évidemment de rééquilibrer les comptes. La logique de ce qui est mis en place, par exemple, à l'égard de la Grèce, c'est de donner du temps et de rendre les choses possibles. Lorsque, en janvier 2010, Christine Lagarde avait évoqué, devant la commission des finances, les premières perspectives de garantie, nous avions été plusieurs, de toutes sensibilités politiques, à lui demander si elle était sûre que ce plan serait suffisant. Ne fallait-il pas d'ores et déjà envisager une restructuration de la dette grecque ? L'histoire financière depuis un siècle montre que, lorsque des pays ont connu des périodes extrêmement difficiles – la Grèce elle-même a fait deux fois faillite –, leur sauvetage est toujours passé par une restructuration de leur dette. Certes, il est très difficile ensuite de faire à nouveau appel aux marchés financiers car ceux-ci ont perdu confiance. Mais, malheureusement, ce qui était une interrogation de beaucoup d'entre nous dès janvier 2010 s'avère aujourd'hui puisqu'un nouvel accord semble avoir été obtenu. Celui du 21 juillet avait prévu un abandon de la dette grecque de l'ordre de 21 % mais, si j'en crois les journaux – peut-être monsieur le ministre, allez-vous nous donner des informations plus précises –, ce seraient plutôt 50 %, voire 60 % de la dette qui seraient restructurés.
Cette mesure doit permettre d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Les échéances de remboursement de la dette souveraine grecque, qui s'élève à 160 % du PIB, sont, dans ce plan, à peu près assurées jusqu'en l'an 2020. Le temps ainsi accordé devra être mis à profit pour rééquilibrer les comptes.
Mais au-delà se pose, à mon sens, la seule vraie question : peut-on réellement rééquilibrer les comptes si on ne rééquilibre pas la compétitivité du pays ? L'histoire montre que les pays qui ont traversé de grandes difficultés ont souvent rééquilibré leur compétitivité en jouant sur l'arme monétaire. Dès lors, beaucoup s'interrogent. Pour ma part, je pense que le fait de lui donner une visibilité vraiment longue, d'abandonner une part substantielle de sa dette, doit créer pour la Grèce les conditions d'un retour à l'équilibre tout en restant dans l'euro. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que nous devons rechercher. Il n'existe pas d'alternative.
Pour terminer, je voudrais, monsieur le ministre, vous poser deux questions.
Les années précédentes, parler du prélèvement sur recettes en faveur de l'Union européenne permettait d'évoquer la question du retour pour la France, en termes de politique agricole ou en faveur des politiques structurelles. Aujourd'hui, on sent bien qu'il va probablement falloir utiliser davantage que par le passé les dépenses communautaires pour aider un certain nombre de pays à s'en sortir. Quel retour reste possible pour notre pays ?
Cette préoccupation est accentuée par le fait que, dans le cadre des rééquilibrages budgétaires nécessaires d'un certain nombre de pays, les dépenses publiques nationales de ces pays devront être réduites. Ne faudra-t-il pas que le budget de l'Union européenne vienne compenser, vienne pallier cette défaillance, cette réduction de dépenses nationales ?
Bref, nous sommes vraiment dans un contexte très différent de celui que nous avons pu connaître ces dernières années et je voulais vous faire part, monsieur le ministre, de ces quelques préoccupations à l'occasion de l'examen de l'article 30.

La parole est à M. Pierre Moscovici, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire pour les affaires européennes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des affaires européennes, chers collègues, jamais, cela vient d'être dit, les questions budgétaires et financières ne sont restées aussi longtemps au premier plan de l'ordre du jour du ou plutôt des Conseils européens puisque nous voguons d'un Conseil de sauvetage de l'euro à l'autre, avec des résultats qui dépérissent à peine censés être opérationnels. Il y a du Pénélope dans ce processus : l'ouvrage n'avance pas suffisamment et est recommencé tous les jours.

Je regrette que les dirigeants européens du moment aient pu perdre du temps tout en souhaitant que des solutions structurelles soient enfin dégagées cette semaine.
Sur fond de crise de la dette, notre débat annuel sur le prélèvement européen nous rappelle à point nommé que la solidarité entre les États membres de l'Union européenne peut, et doit, s'établir aussi par des transferts financiers, même s'il convient bien évidemment d'être attentif à leur montant et à leur incidence sur le budget national, en particulier alors que nous devrons trouver de nouvelles ressources pour tenir les engagements européens de maîtrise des déficits de la France. On sent bien qu'il y a dans l'air on ne sait quel nouveau plan de rigueur ou ajustement budgétaire dès lors que les perspectives de croissance font désormais défaut.
Le projet de budget de la Commission pour 2012 présente une hausse significative des crédits par rapport à 2011 : environ 4,9 %. Le Gouvernement estime que cette progression ne saurait fonder l'estimation du besoin de financement de l'Union en 2012 ; elle est en effet apparue inacceptable pour beaucoup d'États membres. Le Conseil, lors de l'adoption de sa position sur le projet de budget, l'a réduite à 2 %. Le besoin de financement de l'Union en 2012 est dès lors estimé, dans la proposition qui nous est faite sur la base de la position du Conseil, à 129 milliards d'euros.
Pour 2011, le prélèvement sur recettes, inférieur de 4 millions d'euros à sa prévision en loi de finances initiale, est évalué à 18,2 milliards d'euros. Si on suit la position du Conseil, pour 2012, le prélèvement serait évalué à 18,9 milliards d'euros. Cela ferait de la France le deuxième contributeur net au budget européen, pour un montant légèrement supérieur à 5 milliards d'euros.
À l'heure où il faut chercher partout des économies dans le projet de loi de finances pour 2012, il serait certes facile pour certains de penser que le prélèvement européen est trop élevé et qu'il pourrait donc constituer une commode variable d'ajustement. Mais la vérité, c'est que les modes de calcul de ce prélèvement sont automatiques et découlent de nos engagements européens, et surtout que l'Union européenne n'est pour rien dans la situation actuelle de nos finances publiques – bien au contraire, aurais-je tendance à dire, sous bénéfice d'inventaire.
Pendant des années, le sport national français a consisté à blâmer l'Europe pour les contraintes – le carcan, disait-on – qu'elle imposait à la politique budgétaire des États membres. Chaque dérogation au pacte de stabilité, chaque manquement aux principes de Maastricht étaient présentés comme une victoire conquise de haute lutte, sans qu'ils soient pour autant suivis de retombées économiques tangibles ou probantes.
J'étais à votre place il y a quelques années, monsieur le ministre,et j'ai toujours considéré que les principes européens étaient avant tout des principes de bon sens. En effet – et Gilles Carrez n'a rien dit d'autre – le désendettement est un principe élémentaire : être trop endetté empêche d'investir, notamment dans les services publics. Je regrette ainsi, comme nous tous, que le service de la dette soit le premier budget de l'État devant l'éducation nationale ; mieux vaudrait en effet payer des enseignants et des formations que des intérêts.
Ces principes de bon sens n'étaient donc que le prix à payer pour avancer, et il convient d'y revenir aujourd'hui. En tenant les critères de Maastricht, les États membres restaient à distance respectable de cette zone dangereuse où les grands équilibres macroéconomiques peuvent être mis en doute par les gestionnaires de fonds d'investissement, par les agences de notation financière, dont on voit aujourd'hui la puissance, mais aussi par tous les épargnants soucieux de trouver un placement sûr pour leurs économies.
Nous aurions tort d'imputer à l'Europe la responsabilité de nos propres errements. Ne rejetons pas sur elle aujourd'hui le fardeau des efforts à fournir dans notre propre pays ; il faut au contraire voter ce prélèvement.
Ce qui manque en revanche cruellement dans les éléments que vous avez produits, monsieur le ministre, c'est une certaine idée de l'Europe. Où est la stratégie proposée par le Gouvernement au-delà de ce prélèvement ? Il semble que sa seule préoccupation soit de garantir que ni les dépenses de l'Union européenne ni les contributions des États membres n'augmentent. C'est fort bien en cette période, mais où est la vision de ce que devrait être le budget européen ? J'ai sur ce point trois idées à vous soumettre.
En premier lieu, nous devons enfin doter l'Union européenne d'une nouvelle ressource propre. L'impôt européen est une Arlésienne, un serpent de mer qui s'est trop longtemps mordu la queue. Cet impôt européen, il faut désormais le faire, et nous disposons, avec la taxe sur les transactions financières européennes, d'une réelle perspective. Voilà le vrai moyen d'augmenter les capacités d'intervention du budget européen.
Nous devons ensuite, pour la période 2014-2020, clairement afficher l'objectif que le budget de l'Union européenne soit le vecteur privilégié de soutien aux pays périphériques. On connaît la situation de la Grèce et du Portugal, mais soyons clairs : l'austérité ne peut pas être une perspective. Ces pays ont un problème de positionnement économique, qui doit être résolu pour retrouver le chemin de la croissance à terme. C'est à cela que doivent servir les transferts.
Je pense enfin que deux postes de dépenses devraient être des priorités plus clairement affichées des futures perspectives financières.
Le budget européen renforcé doit se muer en budget d'intervention au service de la croissance. C'est pour cette raison que l'investissement, les grands projets européens et la recherche devraient constituer l'axe le plus important des nouvelles perspectives financières. Faisons demain un budget tourné vers le futur et non un budget conservateur du passé.
Par ailleurs, dans la situation actuelle de crise financière, je m'inquiète réellement que davantage de moyens ne soient pas prévus pour les agences de supervision financière récemment créées. En effet, on ne pourra efficacement réguler les marchés qu'au niveau européen, et doter ces institutions de beaucoup plus de moyens est donc absolument prioritaire dans le contexte actuel. J'aimerais connaître, monsieur le ministre, votre point de vue sur cette question. J'en profite au passage pour dire que, sans partager vos vues sur la Turquie, j'approuve la sagesse qui consiste à respecter nos engagements et à repousser les amendements qui tendent à les méconnaître.
La maîtrise des dépenses est donc également nécessaire au niveau européen, mais il faut un débat et une vision beaucoup plus large. Je pense que des efforts peuvent être faits pour rationaliser le budget de l'Union.
Plus que notre débat sur le prélèvement européen, c'est la discussion qui s'est engagée au niveau de l'Union sur les perspectives financières 2014-2020 qui fournit le cadre approprié pour mener à bien cette entreprise. Pour que l'Assemblée nationale y participe de manière utile et efficace, je propose qu'une démarche commune soit engagée avec d'autres parlements nationaux, par exemple avec le Bundestag, qui vote l'autre importante contribution nette au budget européen. Dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, que j'ai pour ma part approuvé, c'est la seule voie pour peser vraiment sur le niveau du prélèvement dont nous débattons aujourd'hui, ou plutôt que nous constatons a posteriori. Cette coopération indispensable prolongerait également les efforts déjà accomplis sur le volet des recettes. La rationalisation budgétaire ne saurait en effet se limiter aux dépenses de l'Union européenne.
Le 14 juin 2011, nous avons adopté à l'unanimité moins deux voix une résolution relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en Europe. Qui ne peut se réjouir de voir cette initiative trouver un écho dans la récente proposition de la Commission européenne d'instaurer un impôt européen sur les transactions financières ? Selon ses propres estimations, et sur des hypothèses de taux très faibles, cet impôt européen pourrait rapporter jusqu'à 57 milliards d'euros par an.
Il est urgent que l'Union européenne dispose d'un levier pour agir tant sur ses ressources propres que sur le comportement des marchés. S'ils savent coopérer, les parlements nationaux pourront, quant à eux, peser sur la fixation du montant exact de cette contribution européenne. Ainsi, ils pourront enfin agir, eux aussi, et non plus seulement débattre ou feindre de débattre sur le niveau du prélèvement national, que bien évidemment, au nom de la commission des finances, j'appelle à approuver.

La parole est à M. Roland Blum, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères a émis, le 19 octobre dernier, un avis favorable à l'adoption de l'article 30 du projet de loi de finances pour 2012, support du prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. Les débats au sein de la commission n'ont pas été moins intenses cette année que les précédentes.
Le montant du prélèvement pour 2012 est évalué à 18,9 milliards d'euros, en progression de 3,5 % par rapport à la prévision d'exécution du prélèvement pour le budget 2011. Cette évaluation repose notamment sur l'hypothèse d'un budget européen conforme à la position du Conseil, prévoyant une progression des crédits de paiement de 2,02 %, très inférieure à la proposition initiale de la Commission. Cette dernière prévoit en effet une progression de 4,9 %. Or la nouvelle procédure budgétaire qui s'applique depuis cette année ne garantit en rien le dénouement. L'an passé, le Parlement européen s'était rallié à la position du Conseil sous réserve de contreparties, mais il s'agissait d'accepter une progression à 2,91 % ; depuis lors les positions se sont exacerbées.
La Commission européenne et le Parlement estiment que l'Union européenne doit remplir ses engagements de paiement, se donner les moyens de mettre en oeuvre la stratégie Europe 2020 et, plus généralement, qu'elle a un rôle à jouer pour soutenir la demande et stimuler la croissance en période de crise. Le Conseil considère pour sa part qu'il n'est pas raisonnable, en période d'austérité budgétaire, d'envisager une forte progression des dépenses européennes.
L'équilibre est délicat, alors que débutent les négociations pour le prochain cadre financier pluriannuel pour l'après-2013. Or, on ne peut demander tout et son contraire au budget européen : exiger une réduction des contributions nationales et « maximiser les retours », pour reprendre cette formule peu élégante.
La France commence à se trouver prise dans cet étau. Le total des ressources propres qu'elle devrait mettre à la disposition du budget européen en 2012 est estimé à 20,6 milliards d'euros, soit 16,4 % du total du budget communautaire. Le montant de la contribution française a ainsi été multiplié en valeur par cinq entre 1982 et 2012. Son solde net est en dégradation tendancielle sous l'effet de l'élargissement de 2004 et de la modération des dépenses agricoles. Notre pays est le deuxième contributeur net, avec un solde négatif de l'ordre de 5 milliards d'euros.
Je souhaite cependant que la France, tout en défendant lucidement ses intérêts, ne se rallie pas à une logique comptable qu'elle a toujours critiquée, mais assume au contraire le rôle moteur qu'elle a avec l'Allemagne, y compris en termes de contribution, pour peser sur les orientations et l'efficacité de la dépense.
Ces débats entre croissance et rigueur, solidarité et préservation des intérêts se retrouvent aujourd'hui à l'échelle du traitement de la crise que traverse l'Union économique et monétaire, thème que j'ai choisi cette année pour la seconde partie de mon rapport et qui fait sens en loi de finances.
Il y a près de deux ans, les États de l'Union européenne ont dû faire face à l'augmentation brutale de leur dette publique, sous l'effet combiné de la récession, des plans de relance et, le cas échéant, du sauvetage des banques. Les taux de marché sur les emprunts publics ont alors commencé à diverger, rendant problématique la situation du Portugal, de l'Irlande, de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. Ce qui est devenu « la crise grecque » est un cas particulier dans cet ensemble, puisqu'elle a été déclenchée par la révélation de la réalité des finances publiques de la Grèce, résultat d'une gestion défaillante depuis l'entrée dans l'euro.
Les pays de la zone euro ont affirmé leur solidarité et sont intervenus, au travers d'un premier, puis d'un second plan d'aide à la Grèce, et par la création d'un mécanisme temporaire de stabilisation, incluant un fonds européen que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de pérenniser. Ces interventions sont conditionnées par des programmes d'assainissement budgétaire et d'adaptation de la structure productive, déterminés par la troïka Commission, BCE et FMI.
La réussite du second plan d'aide à la Grèce a été fortement mise en doute depuis son adoption. Ces craintes contaminent toute la zone euro avec des mouvements spéculatifs sur d'autres dettes souveraines, notamment italienne et espagnole, et une fragilisation des créanciers exposés à la dette grecque et surtout à la dette des autres États sous pression. Pour les États forts de la zone euro, le risque est de voir leur propre note dégradée par les agences de notation et le coût de leur endettement augmenter, ce qui serait catastrophique pour l'assistance financière qu'ils garantissent.
Comment assurer l'efficacité de la réponse européenne et ramener la raison sur les marchés ? Il convient d'abord que le programme de réformes grec soit mis en oeuvre. Le gouvernement grec a fait voter des réformes législatives substantielles et sa détermination est forte, malgré l'absence de consensus dans la classe politique, un coût social élevé et une mise en oeuvre parfois délicate en termes de capacités politiques, réglementaires et administratives.
Une assistance technique européenne est mobilisée, et il faut aussi examiner les propositions formulées pour faciliter les privatisations. L'objectif de déficit ne sera pas tenu, nous le savons. Un ajustement du plan semble inévitable, mais cela ne doit pas être de nature à décrédibiliser l'action conduite.
Or la crédibilité du plan de sortie de crise ne dépend pas que du gouvernement grec. Il apparaît d'abord nécessaire que de fausses bonnes idées soient ostensiblement écartées.
La première est évidemment celle de la sortie de la Grèce de l'euro. Elle serait dramatique pour la Grèce : elle ne résoudrait pas sa situation budgétaire, les agents y sont endettés en euros et la période transitoire avant réintroduction de la drachme serait chaotique. Mais ce serait aussi une catastrophe pour les autres États de la zone euro et au-delà. Outre son coût politique, cette sortie créerait un précédent et livrerait les autres États fragiles à une spéculation funeste, dont les effets seraient incontrôlables.
La deuxième fausse bonne idée est que l'efficacité du Fonds européen de stabilité financière nécessite des engagements quintuplés. Les montants sont déjà colossaux, les garanties du fonds ont été renforcées et ses compétences élargies. Une augmentation doit jouer sur les effets de levier.
La troisième fausse bonne idée est d'appeler à une intervention plus active de la BCE. Au-delà des questions juridiques, des moyens ont été mis en place pour aboutir à des effets équivalents : la BCE est intervenue sur les marchés secondaires, et les États membres ont doté le Fonds européen de la capacité de racheter de la dette. De plus, la crédibilité de l'euro doit être défendue, puisque la monnaie sera demain l'actif sûr, ce que ne seront plus les dettes souveraines.
La dernière fausse bonne idée concerne les euro-obligations, outil à terme très intéressant, mais sans vertu curative. Elles seraient d'ailleurs émises à des taux qui fragiliseraient l'assistance européenne.
Ces options écartées, concentrons-nous sur les possibles réponses. L'impératif d'efficacité qui s'impose à tous les États de la zone euro conduit à retenir cinq orientations : renforcer la discipline dans la communication, qui a fait cruellement défaut ; imposer à tous une gestion rigoureuse des finances publiques ; redimensionner suffisamment les plans pour éviter des réajustements anxiogènes ; soutenir ouvertement le secteur bancaire afin de limiter les effets de contagion de la crise, même si la recapitalisation systématique n'a pas de sens ; enfin, stimuler la croissance pour accélérer la sortie de crise, à l'opposé d'une logique punitive. La baisse des taux de prêt y participe, comme l'assistance à l'absorption des fonds structurels, avec un cofinancement par le budget européen relevé jusqu'à 95 %. Un financement des investissements via un emprunt européen, les project bonds, est aussi à étudier.
Si la priorité est de résoudre la crise, les États doivent s'atteler à traiter les dysfonctionnements de l'Union économique et monétaire, qui en sont la véritable cause. La gouvernance économique européenne était caractérisée par une régulation budgétaire assez faible exercée par les pairs, une coordination molle des politiques nationales au travers d'objectifs non contraignants et des politiques redistributives assurées par un maigre budget européen. Cette gouvernance a perdu sa crédibilité. Le renforcement de l'intégration économique européenne est en marche avec la pérennisation du Fonds européen en Mécanisme européen de stabilité, créé par un traité signé le 11 juillet 2011 ; la réforme en cours de la surveillance budgétaire pour l'élargir aux fondamentaux économiques et renforcer la discipline ; la création d'un « Pacte pour l'euro plus » qui consiste à décliner des mesures concrètes pour renforcer la convergence économique et sociale en faveur d'une plus grande compétitivité. On peut discuter du contenu de ces mesures mais il s'agit d'un changement de méthode majeur.
La France et l'Allemagne semblent décidées à aller plus loin. La question posée est celle du gouvernement économique. C'est une question institutionnelle, notamment pour assurer un nouvel équilibre entre l'intergouvernementalisme, qui a montré ses limites, et la méthode communautaire. Mais il s'agit surtout d'une question de contenu : souhaite-t-on organiser une union économique de transferts budgétaires ?
La spécialisation productive des économies composant la zone euro explique en partie les déséquilibres. Les pays périphériques sont en situation de déficit commercial structurel et s'endettent pour financer leur activité. Ces déficits qui profitent aux États forts pourraient être financés par ces derniers, leur permettant de préserver leurs débouchés commerciaux, la stabilité de leurs établissements financiers ainsi que la pérennité de la construction européenne. Ces transferts seraient naturellement conditionnés par des exigences fortes en matière de finances publiques et de compétitivité. Ira-t-on aussi loin ?
Il existe un lien direct entre la crise que traverse l'Union économique et monétaire et la question du budget européen. Cette union économique sera-t-elle une union budgétaire, ou assurera-t-on une gestion des déséquilibres internes sans passer par la fédéralisation ? C'est en laissant ouverte cette question que je vous propose d'approuver le prélèvement européen pour 2012, lequel alimentera un budget européen que l'on peut qualifier d'attente, tant son rôle est aujourd'hui en débat.

La parole est à M. Pierre Lequiller, président de la commission des affaires européennes.

Un mot d'abord, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur l'étape cruciale que nous vivons pour l'Europe. Grâce en particulier à la forte impulsion du Président de la République et de la Chancelière Angela Merkel, les échanges et les décisions prises ces trois derniers jours ont permis d'avancer sensiblement sur un ensemble de sujets clés, en particulier la recapitalisation des banques et la gestion de la crise grecque – déblocage d'une nouvelle tranche d'aide de 8 milliards d'euros, participation accrue du secteur privé, probablement à hauteur de 50 %, et perspective d'un impact plus important du Fonds européen de stabilité financière. Je salue l'énergie avec laquelle le Président de la République défend ces positions.
M. Moscovici ironisait à l'instant sur les efforts perpétuels consentis en particulier par la France et l'Allemagne. Je rappelle que nous ne pourrions pas renforcer l'impact du Fonds européen de stabilité financière si, comme les socialistes ici même, nous n'avions pas voté en faveur de ce fonds.
Nous formons le voeu, monsieur le ministre, que le sommet de mercredi – à vingt-sept et à dix-sept – aboutisse à un plan d'ensemble à la hauteur des enjeux, notamment sur le nécessaire renforcement du gouvernement économique européen et le pilotage de la zone euro.
J'en viens à ce qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui, le budget européen.
Comme l'ont indiqué les orateurs précédents, le budget européen, qui est obligatoirement équilibré selon les traités, est de taille modeste et n'augmentera sans doute guère dans les prochaines années, compte tenu de la stricte discipline budgétaire à laquelle doivent se plier la quasi-totalité des vingt-sept États membres.
Pour l'année 2012, les États membres ont, dans le cadre du Conseil, donné leur accord sur un projet de budget de 129 milliards d'euros en crédits de paiement, en augmentation de 2,02 % par rapport au budget 2011. Le Parlement européen se prononcera sur ce projet après-demain, certainement dans le sens d'une augmentation plus substantielle, et c'est à l'issue de la procédure de conciliation entre Conseil et Parlement que les montants définitifs seront fixés.
Je ne rappellerai pas ici les montants cités précédemment et je me contenterai de souligner que la France a obtenu de ses partenaires que les « coupes » par rapport aux propositions initiales de la Commission européenne n'affectent pas principalement les crédits de la PAC, qui seraient maintenus à l'euro près, mais plutôt les programmes des autres rubriques dont le taux d'exécution des années précédentes est le moins satisfaisant. La France et ses partenaires ont également convenu que les dépenses administratives de l'Union doivent supporter une limitation équivalente à celle des dépenses administratives nationales.
Bien qu'il ne représente qu'environ 1 % de la richesse de l'Union – les dépenses publiques nationales en représentent environ la moitié –, le budget européen est néanmoins un instrument important, qui rend tangible la valeur ajoutée de la construction européenne.
En France, nos entreprises, nos régions, nos citoyens, ont ainsi bénéficié de plus de 13 milliards d'euros de dépenses du budget européen en 2009, au titre de la politique agricole commune certes, en premier lieu, mais aussi des fonds structurels ou du programme-cadre pour la recherche, par exemple.
Le budget européen apporte sa contribution au dispositif de réponse à la crise que nous traversons.
Le Mécanisme européen de stabilité financière, qui peut aller jusqu'à 60 milliards d'euros et permet à la Commission européenne d'emprunter sur les marchés au bénéfice d'États de la zone euro en grave difficulté financière, représente le tiers des programmes de soutien à l'Irlande et au Portugal, les deux autres sources de financement étant le Fonds européen de stabilité financière et les prêts du FMI.
Les dépenses au titre des fonds structurels, du Fonds de cohésion et du Fonds européen pour la pêche seront accélérées dans les pays de l'Union bénéficiant d'un programme d'aide financière, qu'ils soient ou non membres de la zone euro : Grèce, Portugal, Irlande, Hongrie, Roumanie et Lettonie.
Cependant, le budget européen n'a pas pour seule utilité, en ces circonstances, de répondre aux urgences. Il a vocation à être un « levier » pour rendre possibles des dépenses d'avenir, ainsi que l'a dit Roland Blum, des investissements dont l'intérêt économique dépasse les frontières d'un État membre. C'est un instrument du « gouvernement économique européen », associé au renforcement de la coordination des politiques économiques.
Il est essentiel que ce levier soit mieux articulé avec les budgets nationaux, au service de la réalisation de la stratégie UE 2020. C'est seulement ainsi que cette nouvelle stratégie partagée de développement économique, environnemental et social que s'est donnée l'Europe, pourra être plus effective que feue la stratégie de Lisbonne. Le « semestre européen », qui fonctionne déjà, doit être l'instrument de cette coordination.
La crise très grave que l'Europe traverse et la négociation qui s'ouvre dans le cadre budgétaire pluriannuel pour 2014-2020, dont a excellemment parlé notre rapporteur général, amènent à s'interroger sur ce que nous voulons faire du budget de l'Union, et au-delà, sur l'Europe que nous voulons bâtir.
Avec le traité de Lisbonne et les nombreuses actions qu'elle mène sur son territoire mais aussi en direction de pays tiers, l'Europe a pris des engagements contraignants envers ses citoyens et le monde.
Au sein de l'Union, les réseaux transeuropéens de transport et d'énergie, les programmes favorisant la mobilité des étudiants et des chercheurs, le volet « développement rural » de la PAC, toutes ces avancées très sensibles sont portées par les fonds provenant du budget de l'Union européenne et cofinancées par les budgets nationaux et des financements privés, de nombreuses opérations étant de surcroît rendues possibles par les prêts de la Banque européenne d'investissement.
Le rôle de levier pour les investissements d'avenir que joue déjà le budget européen, pourrait être considérablement accru par d'autres dispositifs de dimension et d'ambition européenne.
Dans cet esprit, je souhaiterais en premier lieu, monsieur le ministre, que l'on s'engage dans une démarche de mutualisation européenne progressive d'un certain nombre de politiques nationales, en s'efforçant d'en faire un instrument de mise en oeuvre de la stratégie UE 2020. Nous pourrions ainsi adopter cette démarche de mutualisation pour l'effort de recherche, en commençant par une action franco-allemande – je crois savoir que des initiatives sont prises – mais qui aurait vocation à s'étendre ensuite à d'autres partenaires européens : pourquoi pas une coopération renforcée en avant-garde entre les pays qui veulent et peuvent le faire ?
Je souhaiterais, dans le même esprit, que nous réfléchissions au financement d'investissements européens d'envergure, sous la forme d'obligations spécifiquement consacrées à ces projets.
En effet, pour que la croissance, non seulement redémarre, mais revienne dans l'ensemble des pays de l'Union, de grands projets doivent mobiliser les énergies. Ni les États pris séparément, ni la BEI, ni le budget de l'Union, ne peuvent mobiliser les montants nécessaires pour améliorer les infrastructures existantes, en créer de nouvelles, donner une impulsion décisive aux énergies renouvelables. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de mutualiser.
Ainsi, on éviterait d'exacerber encore, par des discussions hasardeuses sur la taille du futur budget de l'Union, les argumentaires traditionnels des États, que vous avez déplorés, monsieur le ministre, sur le « juste retour ». Ces financements nouveaux pourront former un nouvel élément du gouvernement économique européen.
Il est essentiel de rechercher de nouvelles ressources propres et je me félicite que le combat mené depuis longtemps, bien avant d'ailleurs qu'on n'adopte ce projet à la quasi-unanimité dans cet hémicycle, par le Président de la République et Mme Merkel, pour promouvoir la taxe sur les transactions financières au sein de l'Europe et du G20 ait progressé. Je me félicite également des positions très nettes qu'ont arrêtées la Chancelière et le Président de la République à l'encontre des pays récalcitrants comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis.
Là aussi, je souhaite que nous progressions rapidement. Merci, monsieur le ministre, de nous préciser où nous en sommes. Quel est l'état des forces en faveur de cette taxe sur les transactions financières, au sein de l'Union et du G20 ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Nous allons à présent entendre les porte-parole des groupes.
La parole est à Mme Pascale Gruny, pour le groupe UMP.

Nous sommes appelés à nous prononcer, comme chaque année, sur le montant du prélèvement opéré sur les recettes du budget de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne.
Permettez-moi tout d'abord, mes chers collègues, de regretter vivement le choix du groupe socialiste de s'abstenir lors du vote sur le prélèvement européen en commission des affaires étrangères, la semaine dernière. Le parti socialiste ne s'honore pas de cette position dans la situation critique que nous traversons. Mais étant de nature optimiste, je ne désespère pas qu'un jour il soit capable de dépasser le seul combat politicien et entre enfin dans une posture responsable.
Responsable comme le parti socialiste espagnol qui a voté la règle d'or main dans la main avec le parti populaire.
Responsable comme le SPD allemand qui ne s'est pas posé de question lorsqu'il s'est agi de voter avec la CDU en faveur du Fonds de solidarité il y a quelques semaines.
En attendant ce jour qui viendra peut-être, le groupe UMP, profondément européen, considère que la participation de la France au budget de l'Union n'est pas négociable. Nous ne pouvons pas nous permettre, en cette période de turbulences pour l'Union et ses États membres, d'envoyer le moindre message de défiance à nos partenaires. Ainsi, le montant du prélèvement européen pour 2012, qui devrait s'élever à 18,9 milliards d'euros, permettra à notre pays de maintenir sa contribution à l'effort collectif.
Comme d'habitude, les plus sceptiques diront que le montant de la contribution française aura été multiplié par 5 en valeur entre 1982 et 2012, que la France est le deuxième contributeur net de l'Union, avec un solde négatif de l'ordre de 5 milliards d'euros, ou encore que le solde agricole de la France devrait devenir négatif à compter de 2012. Tout cela est juste. Mais le rôle de notre pays en Europe est particulier.
La France ne doit pas s'enfermer dans une logique purement comptable. Elle doit bien sûr défendre ses intérêts, mais elle doit aussi faire primer la logique de solidarité. Ce que nous donnons aux États d'Europe de l'Est, nous le récupérons à un moment ou à un autre. Cessons de raisonner franco-français alors que notre économie et celles de nos voisins sont étroitement imbriquées. La prime à la casse payée par le contribuable allemand a largement servi à acheter des Logan, c'est-à-dire à distribuer des salaires en Roumanie et des dividendes en France. Les fonds régionaux dont bénéficient les pays du Sud et de l'Est reviennent, à plus de 70 %, sous forme de contrats de travaux et de fournitures à l'industrie du Nord, dont la nôtre. Être solidaire des États de l'Est, c'est leur permettre de rattraper leur retard et de mettre fin, à moyen terme, aux délocalisations d'entreprises intra-européennes qui asphyxient notre économie depuis trop longtemps.
Notre débat intervient dans un contexte particulier, et ce pour trois raisons.
La première est qu'il se tient entre deux Conseils européens cruciaux pour l'avenir de l'Union européenne. Celui qui s'est tenu hier a donné des signes encourageants. Chaque pays a fait preuve de responsabilité, conscient que l'avenir de l'Europe est en jeu. Je fais confiance à la ténacité du Président de la République pour vaincre les dernières résistances d'ici à mercredi soir. Seule une réponse forte permettra de rétablir durablement la confiance.
La deuxième raison tient au fait que notre débat intervient alors que se déroulent les négociations du futur cadre financier pluriannuel post-2013. À cet égard, la proposition de la Commission européenne est globalement satisfaisante pour la France, notamment sur deux points qui nous sont chers : la correction britannique – puisqu'elle prévoit la suppression de tous les rabais – et la PAC, qui serait stabilisée en termes nominaux.
La troisième raison, enfin, est que nous parlons du prélèvement européen alors que le budget de l'Union pour 2012 est encore en discussion. La position finale du Parlement sera en effet votée après-demain, sachant que la procédure de conciliation qui aura ensuite lieu entre le Parlement et le Conseil devrait aboutir à un compromis en novembre.
Je salue l'attitude lucide et responsable du Parlement européen, qui a reconnu que le contexte économique et la situation très lourdement contrainte des finances publiques excluaient toute augmentation significative du budget européen. Mais cette position ne doit pas occulter l'indispensable débat sur le financement de ce budget, c'est-à-dire sur le volet des recettes. Les parlements nationaux devront s'en saisir.
Ce n'est un secret pour personne, le budget européen est devenu prisonnier des budgets nationaux. Il n'est en effet plus financé par des ressources propres, mais par des contributions nationales. Or ces contributions, qui avaient été imaginées en 1984 comme complémentaires et provisoires, représentent aujourd'hui 85 % des ressources. Ce système n'est plus tenable. Il est devenu, au fil du temps, illisible et antidémocratique. Les rabais et corrections, les rabais sur le rabais, l'obsession des États pour le juste retour au détriment de l'intérêt européen, tout cela dénature chaque année la discussion budgétaire, en exacerbant toujours plus les égoïsmes budgétaires nationaux.
La crise a définitivement discrédité ce système, en révélant l'impasse, le cercle vicieux où se trouve enfermé le budget européen : la crise de la dette a rendu les États membres incapables d'augmenter leur contribution. Du coup, l'Union ne peut plus disposer des crédits suffisants pour l'ensemble de ses politiques.
Les exemples sont légion, qu'il s'agisse des difficultés rencontrées pour trouver les financements nécessaires à Galileo, aux réseaux transeuropéens ou encore aux nouvelles compétences de l'Union instaurées par le traité de Lisbonne, telles que la politique extérieure, les migrations, l'énergie, le spatial ou le sport – sans parler de l'ambitieuse stratégie « Europe 2020 », dont les objectifs appellent des crédits substantiels.
Il faut donc engager un débat sur la manière d'assurer efficacement et autrement le financement des politiques européennes à moyen terme. La vraie question n'est plus de savoir comment économiser sur le budget européen, mais plutôt comment donner à l'Union européenne les moyens de remplir correctement ses missions.
Les citoyens ne retrouveront confiance en l'Europe que si nous parvenons à créer un système équitable, transparent, et qui démontre l'irremplaçable valeur ajoutée de l'Europe dans notre vie quotidienne. Il n'est pas question de plaider, dans les circonstances actuelles, pour un doublement ou un triplement en volume du budget européen. Un tel projet serait voué à l'échec et irait à l'encontre de l'assainissement des finances publiques nationales exigé par nos engagements européens. Ce qui est urgent et indispensable, c'est l'introduction d'une véritable ressource propre, clairement identifiable par les citoyens, pour réduire la dépendance du budget européen vis-à-vis des contributions nationales. La création de ressources propres pour l'Union ne figure-t-elle pas dans les traités européens depuis 1957 ?
La taxe sur les transactions financières, proposée par la Commission européenne et défendue par certains pays européens, comme la France, est une piste intéressante. Partiellement versée au budget européen, cette somme permettrait à l'Union de respecter ses engagements pour relever les défis mondiaux posés par le développement et le changement climatique, par exemple. Avec la part qu'ils tireraient de ces recettes, les pays membres seraient mieux à même d'assainir leurs finances et d'investir dans la croissance et dans l'emploi, ce qui est en fin de compte l'une des préoccupations majeures des Européens. Prenons conscience que chaque euro qui ira au budget européen allégera d'autant le fardeau qui pèse sur notre budget national.
En attendant l'instauration d'une telle taxe, je tiens à saluer les progrès importants qui ont été réalisés concernant le renforcement de la coordination des budgets nationaux – le fameux semestre européen. Certains croyaient qu'il allait remettre en cause la souveraineté budgétaire et fiscale des parlements nationaux. Il n'en a rien été. Ce dispositif a été imaginé pour nous permettre de mieux travailler ensemble pour dépenser mieux.
C'est en se concertant davantage que l'on pourra réaliser des économies d'échelle, en évitant les doublons entre budget européen et budgets nationaux ou entre budgets des États membres. C'est en mutualisant les moyens que l'on pourra atteindre une masse critique pour les projets d'avenir. Nous l'avons fait pour Airbus, Ariane et Galileo. Faisons-le pour l'aide au développement, la recherche et l'innovation, ou encore la politique industrielle.
Aussi notre assemblée doit-elle, mes chers collègues, s'impliquer pleinement dans toutes ces initiatives qui sont cruciales pour donner une nouvelle impulsion et une crédibilité renouvelée à l'Union européenne. Notre avenir ne se décide plus seulement à Paris, mais il ne doit pas se décider à Bruxelles sans nous. C'est ensemble, avec nos partenaires européens, que nous devons faire les grands choix politiques qui conditionneront l'avenir de la France.
Le groupe UMP votera l'article 30 et apportera son soutien aux propositions qui nous sont présentées. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais décevoir Mme Gruny. J'en suis d'autant plus désolé que je partage, pour l'essentiel, son argumentation, mais elle peut comprendre que, s'il n'y a pas de désaccord de fond entre nous, s'abstenir, lorsqu'on est dans l'opposition, n'est déjà pas neutre. Mais, surtout, nous attendons un peu plus du gouvernement français.
Avant d'en venir au budget européen, qu'il me soit d'abord permis de dire quelques mots du Conseil européen puisque nous en sommes à la mi-temps. Ce Conseil – c'est une innovation – se déroule en effet en deux étapes, la prochaine, que nous espérons conclusive, ne devant avoir lieu qu'après que Mme Merkel sera revenue, mercredi matin, du Bundestag, après y avoir présenté devant la commission du budget, afin d'en recueillir l'assentiment, les conclusions – provisoires donc – de la première étape. Ce rappel souligne d'ailleurs par contraste le sort réservé aux députés français, qui n'auront pas le privilège des députés allemands d'entendre le Premier ministre rapporter, devant la commission des finances par exemple, les négociations en cours au sein du Conseil.

Vous oubliez que le ministre chargé des affaires européennes nous accueille demain matin.
Je ne suis pas, il est vrai, le Premier ministre. (Sourires.)

Certains n'hésitent cependant pas à caricaturer le système allemand au prétexte que, pour la diplomatie allemande, le fait que Mme Merkel ne puisse décider seule serait peut-être une forme de faiblesse. Je n'en suis pas certain pour ma part. Que la Chancelière puisse s'appuyer sur les parlementaires du Bundestag, n'est-ce pas aussi une force ? Peut-être devrions-nous y réfléchir pour nous-mêmes. En effet, qu'il s'agisse, pour le Parlement, d'intérioriser certaines positions ou, pour le Gouvernement, d'être mandaté par les parlementaires, peut-être serait-il de bonne méthode que les échanges entre nous soient plus nombreux et plus fructueux.
S'agissant du Conseil lui-même, deux nouvelles semblent se dessiner, l'une bonne, l'autre – peut-être – mauvaise.
La bonne nouvelle est que l'Europe est en train de prendre la mesure de la crise grecque après l'avoir longtemps sous-estimée, notamment lors du Conseil du 21 juillet. Manifestement, l'Europe a pris conscience de l'ampleur de la crise et de la nécessité d'y répondre au niveau adéquat. Des décisions vont être prises, en particulier sur ce plan. On ne peut que s'en féliciter.
La mauvaise nouvelle est que deux propositions avancées par la France, toujours pour régler cette crise, ont d'ores et déjà été écartées après s'être heurtées au refus allemand.
La première était de permettre au Fonds de stabilité d'être directement financé par la BCE. À cet égard, l'affirmation claire par l'Allemagne de son refus de monétiser la dette européenne n'est pas sans conséquences.
D'abord, elle instille le doute quant à l'action de la BCE dans les semaines qui viennent. Nous le savons, en effet, cette institution a, notamment cet été, soutenu directement les dettes italienne et espagnole, certes sans le dire, mais en conduisant, semble-t-il, une action déterminée dans ce domaine. Si, dans les semaines qui viennent, une telle action devenait impossible, les conséquences pourraient évidemment être lourdes.
Plus généralement, ensuite, la monétisation de la dette, et donc – disons-le clairement – une politique monétaire plus accommodante, était une perspective qui pouvait être positive pour les États européens. Il y a d'ailleurs une incompréhension de la part d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, à ne pas voir cette arme monétaire utilisée pour essayer de soutenir l'économie et les finances.
La seconde proposition à avoir, semble-t-il, été rejetée, tenait au recours au Fonds européen de stabilité financière pour le financement direct de la recapitalisation des banques. Là aussi d'éventuelles difficultés pourraient apparaître puisque, s'il y avait besoin de fonds publics, cela passerait d'abord par les budgets nationaux – en tout cas en dernier ressort puisque cette possibilité existe –, ce qui, notamment pour la France, signifierait un alourdissement de la charge de ses finances publiques.
Loin de nous l'idée de nous réjouir de cette double déconvenue. Au-delà en effet de nos différences partisanes, une position française existe, qu'il faut défendre et dont l'opposition – pour répondre encore une fois à ce qui a été dit précédemment – se sent également comptable. Aussi, dans la période que nous traversons, une certaine solidarité doit-elle être de mise, même s'il est légitime de s'interroger sur la stratégie adoptée et sur la manière dont sont conduites les négociations.
Il n'y a pas à se réjouir car il est probable que le « bricolage » autour du Fonds de stabilité qui tiendra lieu de proposition ne fera pas illusion.

« Bricolage » n'est pas le bon terme ; parlons plutôt de créativité. (Sourires.)

En tout état de cause, je ne suis pas certain que cette « créativité » suffise pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Nous savons tous que les discussions sur le budget européen pour 2012 et sur les perspectives pour 2013-2020 seront extrêmement difficiles. Dans son rapport pour avis, M. Blum ne cache d'ailleurs pas une certaine forme de pessimisme. Il est clair que les tensions sur les dettes souveraines ne vont pas pousser les États à se prononcer spontanément pour une augmentation de leur contribution au budget européen. On peut même considérer que cette contribution risque de constituer une sorte de variable d'ajustement.
Dans ce contexte, je veux insister sur trois points.
D'abord, il me semble nécessaire de reconnaître l'utilité du budget européen, particulièrement en ce moment. En période de crise et de contraction budgétaire, le budget européen constitue en effet un élément indispensable de la relance économique. Un engagement avait d'ailleurs été pris en ce sens par les États membres lors du lancement de la stratégie « Europe 2020 ». Nous devons préserver cette perspective et cette capacité de relance.
Ensuite, il faut de la clarté de la part des États. On ne peut pas d'un côté demander le maintien, voire l'augmentation, des dépenses du budget européen et, de l'autre, refuser le maintien, voire l'augmentation, de ses recettes. Malheureusement, ce double discours est trop souvent tenu par certains États. Le Parlement européen ne s'y est pas trompé en demandant aux États membres qui suggèrent des réductions de recettes de s'exprimer publiquement pour s'expliquer et pour indiquer clairement les priorités du projet politique de l'Union qui peuvent être différées ou définitivement abandonnées. Cela me semble être de bonne méthode pour faire cesser leur double discours.
Enfin, il faut impérativement réformer le budget européen et augmenter ses ressources propres.
Il faut en finir avec les exonérations et rabais en tout genre négociés par les États au fil du temps, qui rendent illisibles le système de contribution nationale. Il faut faire avec le budget européen ce que nous devrions faire avec notre propre budget : supprimer les niches fiscales. (Sourires.)
Contrairement à l'évolution récente qui a vu baisser la part des ressources propres – notamment celle liée à la TVA –, il faut également augmenter les ressources propres et en trouver de nouvelles. Cette évolution assurerait une certaine pérennité au budget européen qui pourrait ainsi être mis à l'abri des tractations entre États. En conséquence nous soutenons la création d'une taxe sur les transactions financières, et nous souhaitons qu'elle soit affectée pour partie au budget européen, comme le propose la Commission européenne.
Pour l'heure, nous nous abstiendrons sur l'article 30 relatif au prélèvement européen car nous considérons que la position française pourrait être plus dynamique. Vous comprendrez toutefois qu'il s'agit d'une abstention positive. (Sourires.)

La parole est à M. François Asensi, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la discussion sur l'article 30 et le prélèvement sur recettes est aujourd'hui presque anecdotique eu égard à la crise profonde que traverse l'Union européenne. Elle est en effet au pied du mur. La crise financière fait rage et les gouvernements européens apparaissent comme terriblement dépassés.
Le sommet européen d'hier en est la preuve éclatante. Les dirigeants des États membres ne proposent qu'une solution : mettre en oeuvre les éternelles recettes libérales qui nous ont déjà conduits à la crise. Des plans d'austérité d'une violence inouïe se succèdent ainsi à travers toute l'Europe, conjuguant baisse des salaires, réduction des services publics, relèvement de l'âge de départ à la retraite et privatisations.
Les conséquences sont brutales pour les citoyens européens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : selon Eurostat, en 2010, 23 millions d'entre eux sont au chômage, et 80 millions de personnes vivent dans l'Union sous le seuil de pauvreté. La précarité ne cesse d'augmenter et l'angoisse de l'avenir grandit, notamment chez les jeunes, qui se considèrent de plus en plus comme une génération sacrifiée.
Ces attaques contre le socle social européen, au demeurant si insuffisant, sont totalement inacceptables.
Au nom des députés communistes et républicains, je tiens à exprimer toute ma solidarité aux peuples grecs, espagnols, portugais. Je tiens aussi à exprimer mon soutien à tous les « indignés » qui manifestent contre les plans d'austérité, à tous ceux qui réclament une démocratie réelle contre un modèle social qui voit les États plier sous la férule des marchés.
Monsieur le ministre, en ce moment de crise, quel est le message de la France au sein de l'Union européenne ? Quelle est l'action de notre pays pour faire vivre l'idée européenne ? Que fait le Gouvernement pour que le vieux continent redevienne une communauté politique de progrès et d'espoir ?
Lors de l'éclatement de la crise financière en 2008, les gouvernements européens avaient promis de mettre la finance au pas. Ces voeux pieux n'ont jamais été réalisés. Les banques et les agences de notation continuent de spéculer en toute impunité sur les dettes souveraines. La Grèce, mais aussi l'Espagne, le Portugal ou l'Italie sont dans l'oeil du cyclone — la faute en est notamment à la spéculation qui a fait bondir les taux d'intérêt à plus de 20 % pour la Grèce.
Chaque année, en France, près de 50 milliards d'euros sont alloués au remboursement des intérêts de la dette. C'est absurde en soi, car les contribuables nourrissent ainsi les financiers. C'est de surcroît intolérable en l'occurrence, quand on sait que les États européens ont soutenu les banques à hauteur de 1 700 milliards d'euros après la crise de 2008. En effet, depuis 2008, ils ont pris en charge la dette privée des banques, fruit de pratiques spéculatives, sans aucune contrepartie. Comment expliquer autrement la crise de la dette ? Le scandale de Dexia illustre bien ce système financier ubuesque.
L'Union européenne a une grande responsabilité dans cette crise. Elle s'est faite complice d'un néolibéralisme sauvage qui fait prévaloir les intérêts des marchés financiers. La construction européenne, ce bel idéal, a été dévoyée par les traités successifs. L'Europe est allée dans le sens de la dérégulation à outrance et elle n'a pas su résoudre son déficit démocratique.
L'indépendance absolue de la Banque centrale européenne et l'obligation faite aux États d'emprunter auprès des marchés financiers se sont avérées catastrophiques. Les dogmes du laisser-faire et de la concurrence libre et non faussée, gravés dans le marbre des traités de Maastricht et de Lisbonne, n'ont pas apporté la prospérité tant vantée par les économistes néolibéraux. Bien au contraire, les États sont aujourd'hui surendettés, dans l'incapacité totale de relancer la croissance et l'emploi, et confrontés à un renforcement des inégalités insupportable.
Le budget de l'Union européenne est marqué du sceau de ce libéralisme qui a mené l'Europe politique dans l'impasse. Il réduit à la portion congrue l'intervention publique et sacrifie les politiques en faveur de l'emploi et des solidarités. En un mot, c'est un budget de renoncement.
Ce budget stagne, en hausse de seulement 2 %. La contribution française reste stable : elle s'élève à 18,8 milliards d'euros. Avec un budget représentant seulement 1 % du PIB de l'ensemble des États, comment pourrions-nous faire face aux défis immenses nés de la crise ?
Au-delà du montant total, l'affectation des crédits appelle certaines critiques.
Les efforts consentis pour relancer l'économie et amortir les conséquences de la crise sont clairement insuffisants. Symbole de cette Europe libérale, les crédits du programme européen d'aide aux plus démunis baissent drastiquement, passant de 480 à 113 millions d'euros ! C'est l'Europe du chacun pour soi qui triomphe.
Monsieur le ministre, si d'aventure la Grande-Bretagne et l'Allemagne maintenaient leur diktat en ce domaine, la France se substituerait-elle à ce plan pour permettre à quatre millions de nos concitoyens de continuer à vivre grâce à la solidarité ? Des associations caritatives comme le Secours populaire, le Secours catholique ou les Restos du coeur ont besoin de ce programme. Il est vraiment scandaleux d'avoir supprimé une grande partie de cette aide alimentaire alors que les stocks et les surplus existent.
Je note que les 50 milliards d'euros destinés aux fonds structurels sont largement insuffisants tant les inégalités se creusent aux quatre coins de l'Europe. Il faut faire plus pour intégrer les régions restées en marge de la croissance, qui souffrent de graves problèmes sociaux, comme ce fut le cas avec l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande, faute de quoi la construction européenne restera fondée sur un château de cartes social et économique.
Par ailleurs, ce budget privilégie une fois de plus la lutte contre l'immigration au détriment de la promotion des droits de l'homme et de la citoyenneté européenne.
Les fonds alloués pour bâtir une Europe forteresse sont en forte augmentation, avec une hausse de 17 % à hauteur de 1,3 milliard d'euros. La France a d'ailleurs insisté pour que le budget du programme « Gestion des flux migratoires » soit augmenté sensiblement. Dans le même temps, les crédits destinés à la citoyenneté, à la jeunesse et à la culture sont en chute libre puisqu'ils diminuent de 22 %.
Je ne me reconnais pas dans cette Europe qui se referme de plus en plus sur elle-même, avec un traitement de l'immigration inhumain et inadapté. Je pense au projet de mur à la frontière gréco-turque, aux centres de rétention, au drame de ces migrants fuyant le conflit libyen, à qui l'on refuse désespérément d'accorder le droit d'asile.
Enfin, l'enveloppe allouée à la politique étrangère de l'Union européenne absorbe 9 milliards d'euros. Mais, monsieur le ministre, quelle est la vision du monde prônée par la diplomatie européenne ? Quel est l'avenir de la défense européenne, plus que jamais arrimée à l'OTAN ? Autant de questions qui se bousculent, alors que la diplomatie européenne s'est montrée absente lors des révolutions arabes et qu'elle refuse de reconnaître l'État palestinien – j'ai bien parlé de la diplomatie européenne et non des positions de la France.
Lors des débats sur le traité constitutionnel européen de 2005 et au moment de l'adoption de son ersatz, le traité de Lisbonne, nous avions mis en garde contre l'impasse d'une Europe au service des marchés. Les peuples s'étaient prononcés pour une autre Europe, sociale, protectrice, démocratique. Ils n'ont pas été écoutés. Leur choix souverain a été bafoué par les gouvernements en place, toutes tendances politiques confondues.
Pourtant, les propositions que nous avions alors avancées sont plus que jamais d'actualité. À mesure que la crise progresse, leur mise en oeuvre devient chaque jour plus indispensable pour sauver le continent du marasme économique et du désastre social.
Quelles sont ces propositions ?
Nous demandons la renégociation des traités européens pour mettre fin au déni démocratique et rompre avec les politiques libérales. Pendant des années, les fondés de pouvoir du capitalisme financier ont prétendu que toute renégociation était impossible ; ils la jugent désormais incontournable.
Nous proposons de mettre la Banque centrale européenne au service des peuples en lui donnant pour objectif de soutenir l'emploi, les salaires et le développement durable, et en lui permettant également d'accorder des prêts aux États.
Nous voulons garantir les services publics en revenant sur le dogme de la concurrence libre et non faussée.
Nous soutenons une harmonisation par le haut des politiques sociales et fiscales avec l'instauration d'un salaire minimum européen.
Nous demandons l'instauration immédiate d'une taxe sur les transactions financières pour lutter contre la pauvreté et limiter la spéculation, comme nous le proposons depuis plusieurs années. Cette taxe pourrait rapporter près de 100 milliards d'euros par an.
Il faut enfin mettre en place une fiscalité aux frontières de l'Europe pour protéger nos emplois et notre système social du dumping des pays émergents. Il ne s'agit pas de fermer les frontières ou de limiter les échanges mais de refuser la loi de la jungle actuelle du libre-échangisme.
La mondialisation doit être une chance pour l'humanité, à la condition de la mettre au service du développement social et écologique de la planète et de ses sept milliards d'habitants.
Députés communistes, républicains, citoyens et du parti de gauche, nous portons ces propositions. Nous continuerons à lutter pour une réforme démocratique et sociale des institutions européennes, pour que la construction européenne se mette au service des peuples français et européens.
Le budget de l'Union européenne ne s'inscrit résolument pas dans cet objectif. Voilà pourquoi nous voterons contre le prélèvement communautaire inscrit dans le projet de loi de finances pour 2012.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'heure où se décident à Bruxelles les conditions du sauvetage de la zone euro, le débat sur la participation de la France au budget de l'Union européenne prend, cette année, une dimension toute particulière. Au-delà de la crise et de la restructuration de la dette grecque, le véritable enjeu de ces prochains jours est bien le fonctionnement de la zone euro et de l'Europe. Recapitalisation des banques européennes, effort supplémentaire pour la Grèce, renforcement du Fonds européen de solidarité financière : ces mesures ne pourront suffire si elles ne sont pas accompagnées d'une remise en cause profonde de l'architecture des institutions européennes car, à travers la crise de l'euro, c'est bien toute l'Europe qui est en cause.
Aussi, ce débat sur le prélèvement européen est-il pour nous l'occasion de rappeler quel avenir nous entendons donner au budget de l'Union européenne et, plus largement, quelle Europe nous souhaitons construire.
Indéniablement, la monnaie unique nous aura protégés des dangers de l'inflation et elle aura créé les conditions de la stabilité monétaire à l'intérieur du marché unique. Il n'en demeure pas moins que la construction européenne n'est pas allée assez loin.
Les députés centristes l'affirment depuis longtemps : si nous voulons sauver l'euro, un fédéralisme économique et budgétaire s'impose, car une monnaie sans politique économique et financière fédérale est vouée à l'échec. Nous devons donc mettre en oeuvre une gouvernance économique et budgétaire commune au sein de la zone euro. En effet, l'Europe a réellement besoin d'une politique économique fondée sur la régulation publique du système bancaire et sur le volontarisme économique à l'égard des tiers. À cet égard, nous ne pouvons qu'encourager l'évolution des opinions, qui semblent peu à peu adhérer à l'idée d'une gouvernance économique.
Afin de remédier aux dysfonctionnements des mécanismes budgétaires européens, la mise en oeuvre d'un fédéralisme budgétaire doit se traduire par l'élargissement des pouvoirs du Parlement européen et aboutir à l'instauration d'une véritable fiscalité européenne. Les actuelles ressources propres de l'Union – essentiellement les droits de douane et quelques taxes – représentent une part très faible de son budget. Si nous voulons qu'elle devienne une puissance économique européenne, nous devons permettre à l'Europe de lever des impôts et des emprunts dans le respect de la règle d'or, c'est-à-dire exclusivement pour financer des dépenses d'investissement.
Souvenez-vous, mes chers collègues, de la charte de Jean sans Terre qui, en 1215, posa les fondements de la démocratie de notre Europe et dont nous pouvons encore, à bien des égards, nous inspirer : « Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume. » En d'autres termes, un parlement n'en est véritablement un que s'il peut lever l'impôt. C'est, du reste, ainsi que sont nés la plupart des parlements, y compris le nôtre. Plus récemment, la CECA présentait à sa création un modèle budgétaire cohérent, dont les dépenses étaient financées par un impôt qu'elle percevait directement. Ce n'est que plus tard que ce modèle a été dévoyé et que les ressources de l'Union ont pris la forme d'impôts collectés par les États pour être reversés à Bruxelles.
Basé sur des agrégats statistiques dépourvus de liens avec les priorités politiques de l'Union, le système de financement actuel de celle-ci semble avoir atteint ses limites. Les ressources propres traditionnelles, notamment les droits de douane, qui constituent le seul prélèvement véritablement européen, correspondent à une très faible part du financement de l'Union – ne serait-ce que parce qu'ils ont été considérablement réduits au cours des dernières années –, l'essentiel de ce financement étant assuré par des contributions nationales proportionnelles au revenu national brut de chaque pays membre. À l'image de l'Europe, redevenue la somme des intérêts des États, le budget de l'Union européenne n'est plus que la somme de vingt-sept contributions nationales.
Cette année encore, le budget européen, qui finance les dépenses des politiques communes européennes, se situe autour de 1 % du revenu national brut de l'Union européenne en crédits de paiement et de 1,05 % du revenu national brut de l'Union en crédits d'engagement. Reconnaissons-le, ce chiffre est bien trop modeste.
Ainsi, nous devons en finir avec l'Europe des États et concevoir la nouvelle Europe sur une base fédérale.
En premier lieu, nous pourrions permettre au Parlement européen de fixer un taux de TVA additionnel, sans toutefois alourdir la charge fiscale globale qui pèse sur les contribuables européens. Cette prérogative pourrait être facilement instituée, puisque cet impôt existe dans tous les pays membres et que son assiette a été harmonisée. Le Parlement européen voterait alors un taux de TVA européen pour financer le budget de l'Union, taux auquel chaque pays ajouterait celui qu'il souhaite.
Cette mesure présenterait l'avantage de créer un lien direct entre le financement du budget de l'Union et les citoyens. Au demeurant, un taux communautaire de 1 % serait suffisant pour couvrir environ la moitié des besoins de financement du budget de l'Union. En outre, à défaut de permettre une meilleure prévision des recettes du budget de l'Union, une telle mesure lui donnerait davantage de réactivité, augmenterait considérablement ses marges de manoeuvre, sans pour autant alourdir la pression fiscale sur les contribuables européens, et représenterait une avancée significative vers une plus grande convergence fiscale européenne.
Par ailleurs, comme chacun sait, que nous votions le prélèvement européen ou non, il s'applique. Notre vote n'a donc aucune portée autre que politique. Vos prédécesseurs, monsieur le ministre, nous ont toujours expliqué que les traités ne nous donnaient pas le droit de modifier ce prélèvement, ne serait que d'un million. Si notre vote est inutile, que dire du Parlement européen, en dépit de l'évolution des traités ? Il s'agit là d'un véritable déni de démocratie.
En second lieu, étant donné le caractère collectif des problèmes environnementaux, notamment de la question du changement climatique, une taxe carbone européenne pourrait constituer un excellent instrument de financement du budget de l'Union.
Enfin, l'introduction d'une taxe sur les transactions financières serait également, sous certaines réserves – car une telle taxe n'aurait de sens que si elle était internationalisée –, un moyen de doter l'Union européenne de ressources propres. Il est clair, en effet, que la crise que nous traversons est en partie due aux pratiques spéculatives, aux prises de risque inconsidérées du secteur financier et, plus généralement, au surendettement de nombreux États et de beaucoup de ménages dans une partie des pays de l'Union. La Commission européenne a d'ailleurs déposé une proposition de directive pour la création d'une telle taxe le 28 septembre dernier.
À ce stade de la procédure budgétaire européenne, le total des ressources propres que la France devrait mettre à disposition du budget européen en 2012 serait de 18,9 milliards d'euros, soit 16,4 % des contributions des États, ce qui fait de notre pays le deuxième contributeur net. S'il est légitime que la France contribue à la solidarité européenne, nous refusons néanmoins de financer l'adhésion turque à l'Union. En effet, comme cela a été rappelé en commission, nous sommes favorables à l'association de la Turquie à l'Union européenne, mais défavorables à son adhésion. Ainsi, nous jugeons raisonnable et cohérent de proposer une réduction de près de 148 millions d'euros de la contribution française au budget communautaire, soit le montant à verser à la Turquie au titre de l'aide financière de préadhésion pour 2012.
Mes chers collègues, il est tout simplement temps pour l'Europe de sortir du système des contributions nationales, car la mise en place d'une Europe forte et unie passera inévitablement par un remodelage des fondements de son système de financement.
En attendant, le groupe Nouveau Centre votera en faveur du prélèvement européen.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je vais tenter de répondre brièvement aux questions qui m'ont été posées.
Selon M. le ministre Moscovici, nous irions tantôt trop vite, tantôt trop lentement. Telle Pénélope, nous ferions et déferions l'ouvrage dans l'attente d'on ne sait quoi. Mais Pénélope sait parfaitement qui elle attend, et je dirai que nous sommes plutôt dans la situation d'Ulysse, qui doit surmonter tant d'obstacles pour atteindre son but : rentrer chez lui. Notre but, notre chez nous, c'est l'Europe. Je renvoie ainsi M. Moscovici à la réponse apportée par M. Caresche. Lorsque ce dernier estime que le parlement allemand a plus de pouvoirs que le parlement français, il réhabilite le débat que nous avons aujourd'hui. L'Union européenne est composée de vingt-sept démocraties qui débattent et décident, et il me paraît logique que le temps des démocraties soit plus long que celui des spéculateurs.
J'en viens au Conseil européen, bien que ce ne soit pas le thème de notre débat. Vous savez quels en sont les grands objectifs. Demain, je recevrai, à la demande de Pierre Lequiller, l'ensemble des parlementaires qui le souhaiteront, afin d'évoquer les sujets qui sont sur la table, dans cette période intermédiaire qui doit prendre fin avec les décisions qui interviendront mercredi. Parmi ces sujets, figurent la restructuration de la dette grecque et l'hypothèse de porter la décote de 21,5 %, librement acceptée par le système bancaire, à un taux compris entre 40 % et 60 %.
Se pose également la question de la recapitalisation des banques, dont nous avons beaucoup débattu. Monsieur Asensi, les États n'ont pas apporté d'argent aux banques sans compter. Je rappelle, d'une part, qu'ils sont intervenus pour protéger les personnes qui avaient déposé leur argent dans ces banques, et en aucun cas les actionnaires, et, d'autre part, qu'ils ont obtenu, en contrepartie de leur aide, un juste retour financier. Cette fois, la recapitalisation des banques doit se faire à partir de leurs fonds propres, ce qui implique une diminution des dividendes versés aux actionnaires. Sous cette forme, elle permettra à la fois de protéger les épargnants et de solliciter les actionnaires, qui tirent bénéfice des périodes fastes et doivent contribuer dans les périodes plus difficiles.
S'agissant du Fonds européen de stabilité financière, Gilles Carrez et plusieurs d'entre vous se sont demandé comment nous pourrions lui donner une force de levier plus importante. L'adossement à la BCE est peu orthodoxe, il faut le reconnaître, et la France ne le considère pas comme une solution obligatoire ; elle ne s'arc-boutera pas sur cette position. Il existe d'autres moyens ; la contribution du Fonds monétaire international est une des hypothèses à envisager.
Par ailleurs, le gouvernement économique européen que le Président de la République a appelé de ses voeux doit résulter d'une certaine mutualisation de nos économies et d'une harmonisation de nos fiscalités. Il s'agit en fait d'une forme de fédéralisme économique – appelons les choses par leur nom –, dans l'intérêt de l'ensemble des États membres.
Quant à la taxe sur les transactions financières, elle nous ramène au débat sur le budget de l'Union. Je partage votre frustration, celle de parlementaires qui votent un prélèvement européen sans en avoir défini l'objectif, tout en tenant, dans un certain nombre de pays, à ce principe malsain du retour « euro pour euro ». Si nous voulons que le budget européen soit fort, il faut d'abord définir le projet qu'il porte, et non réfléchir au projet dans le cadre du budget. Pour autant – et je remercie M. Caresche et Mme Gruny de l'avoir rappelé –, on ne peut imaginer un budget européen en progression quand celui de l'ensemble des États membres est en diminution. On ne saurait prôner le laxisme d'un côté et la sévérité de l'autre.
Néanmoins – et c'est le débat qui porte sur la période 2014-2020 –, si nous ne pouvons dépenser beaucoup plus, nous pouvons dépenser mieux. À ce sujet, deux pistes se dessinent. La première concerne la taxation sur les transactions financières. Oui, il faut que l'Union ait des ressources propres. Dans le cas contraire, quelle frustration, en effet, pour les députés européens, qui se retrouvent face à un budget entièrement contraint, dépourvu de ressources dynamiques, incapable de poursuivre des objectifs ciblés et de produire de la croissance ! J'ajoute que ces ressources propres mettraient fin –c'est la deuxième piste que j'évoquais – à la politique du retour. En effet, la France plaide en faveur de la disparition du chèque britannique, d'autant que d'autres chèques pourraient s'y ajouter si celui-ci était considéré comme intouchable.
Vers quels objectifs doit tendre ce budget ? M. Blum et M. Lequiller l'ont dit : ce doit être un budget de croissance. Force est de constater que l'argent dépensé dans les fonds structurels ou les plans de cohésion n'a pas été forcément utilisé, dans des pays comme la Grèce ou le Portugal, pour leur permettre d'affronter une situation donnée. La crise de l'euro et de l'Europe est une crise de la dette souveraine d'un certain nombre de pays « tranquillisés » par l'existence de l'euro, une inflation totalement contrôlée et la possibilité de s'endetter excessivement au regard de leurs ressources propres.
L'Europe de demain est une Europe de la croissance et de la recherche, une Europe qui cherche à mutualiser les moyens : dans la compétition mondiale à laquelle nous sommes confrontés – une compétition qui ne cessera pas, car nous ne fermerons pas nos frontières –, nous devrons poursuivre un double objectif de réciprocité et de compétitivité.
Il me semble donc que, demain, le budget européen devra s'asseoir davantage sur des ressources propres, donner plus de responsabilités au Parlement européen et plus de dynamique aux relations entre les parlements nationaux des États membres et le Parlement européen, afin de mettre en oeuvre une politique de croissance plutôt qu'une politique distributive.
Je me félicite que le Président de la République prenne part aux actions menées collectivement en ce sens. Certains donnent l'exemple de la Suède, qui a tenté, il y a quelques années, de mettre en place une taxation sur les transactions financières, avant de devoir y renoncer. Mais je rappelle que cette taxation était de 1 % ! Les propositions actuelles sont, elles, fondées sur une assiette la plus large possible, avec un taux le plus faible possible. Un taux de l'ordre de 0,05 %, par exemple, permettrait la mise en place d'un système à la fois efficace et indolore – car il n'entraînerait pas de modifications des places bancaires européennes. Même si, on le sait, Londres n'a pas l'intention d'accepter ce projet, il suffirait que la zone euro en accepte le principe pour qu'un premier pas soit fait en direction de ce que le Président de la République appelle « une obligation morale, politique et économique ».
Il est bien normal que les marchés financiers, qui ont été l'un des éléments constitutifs de la crise que nous traversons, soient aussi l'un des éléments contributifs de l'apaisement de cette crise. Par ailleurs, il est également normal que nous cherchions à doter l'Europe de ressources propres, qui ne soient pas totalement dépendantes, comme c'est le cas aujourd'hui, de la contribution des États.
Je veux dire à M. Mallié, qui n'était pas présent lorsque notre débat a commencé, que l'argument invoqué par M. de Courson au sujet de la contribution française aux crédits européens en vue de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne me paraît tout à fait convaincant.

Il est bien difficile de savoir ce que pense le Gouvernement, monsieur le ministre !
Pas du tout ! À l'instar du Président de la République, le gouvernement français a clairement affirmé que la Turquie n'avait pas vocation à entrer dans l'Europe. Cela étant, le Gouvernement dit aussi que la Turquie a vocation à être un partenaire privilégié. Dans cette optique, il est logique que nous avancions vers une contribution : si, je le rappelle, nous n'avons ouvert aucun chapitre permettant l'adhésion, nous avons ouvert tous les chapitres permettant une harmonisation des relations entre la Turquie et l'Union européenne, des échanges commerciaux et une évolution sociale, démocratique et politique de nature à permettre à la Turquie de devenir un partenaire incontournable dans la période que nous traversons.
Nous ne chercherons donc pas à ouvrir les chapitres relatifs à l'adhésion de la Turquie. En revanche, il est normal que l'Union européenne entretienne, avec ses grands partenaires que sont la Turquie, les pays concernés par le partenariat oriental et par le partenariat du Sud, une politique de contribution, accordée en contrepartie de progrès économiques, politiques et démocratiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

En conclusion de ce débat sur le prélèvement européen, nous en venons à l'article 30, qui en fixe le montant évaluatif.

Je suis saisi d'un amendement n° 83.
La parole est à M. Daniel Garrigue.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement n° 83 est un amendement de pure forme. Afin d'éviter que le non-respect du principe de la représentation nationale par les organisateurs de ce débat n'interdise l'expression des députés non inscrits, je ferai quelques brèves remarques.
Je veux d'abord regretter qu'il ait fallu tant de mois pour admettre qu'il n'y avait pas d'autre solution qu'une restructuration pour régler le problème de la dette grecque. Celle-ci aurait dû être décidée dès le départ et accompagnée d'exigences fortes à l'égard de la Grèce, mais aussi d'une solidarité active des Européens, étant précisé que l'on ne sauvegardera pas l'euro sans que cela nous coûte un minimum. Une telle attitude basée sur l'anticipation aurait dissuadé la spéculation bien plus efficacement que la crainte, dans laquelle on nous a maintenus, d'un prétendu défaut grec.
Au-delà, ce sont l'organisation et la régulation des marchés financiers qui demeurent fondamentaux, car c'est en agissant sur ces points que nous pourrons réduire – dans tous les sens du terme – le temps des spéculateurs. Je vous demande, monsieur le ministre, où en est la mise à jour de la directive épargne, à laquelle le Luxembourg continue de se soustraire. Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer quand auront lieu la transposition de la directive AIFM sur les fonds alternatifs et la mise en chantier de la directive MIFID sur les marchés financiers, indispensables si nous voulons lutter efficacement contre les spéculations ? Enfin, après avoir dénoncé si vivement les paradis fiscaux, comment pouvons-nous accepter aujourd'hui que l'attitude de nos partenaires à l'égard de la directive MIFID revienne à pactiser ouvertement avec la Suisse ?

Monsieur le ministre, l'Europe exige une vision et une ambition. Elle exige une stratégie financière, commerciale, industrielle et dans le domaine de la recherche. C'est de cela que nous aurions aimé vous entendre parler.

Mon cher collègue, voudriez-vous présenter conjointement votre amendement n° 84 – à moins que vous ne considériez l'avoir déjà défendu ?

C'est un amendement portant sur un sujet complètement différent, monsieur le président, et je le défendrai donc séparément. Comme je l'ai expliqué, l'amendement n° 83 est un amendement de pure forme ayant pour objet de me permettre de m'exprimer, puisque les députés non inscrits ne disposent d'aucun temps de parole dans un débat aussi important que celui relatif au prélèvement européen. C'est là une situation pour le moins surprenante, que je vous demande de rapporter au bureau de l'Assemblée nationale.

Je le retire évidemment, monsieur le président, puisqu'il n'avait d'autre objet que de me permettre de m'exprimer,…

…mais je regrette tout de même que M. le ministre n'ait pas apporté de réponse aux questions que je lui ai posées, car cela pouvait intéresser l'ensemble de notre assemblée.
(L'amendement n° 83 est retiré.)

Vous avez maintenant la parole, monsieur Garrigue, pour défendre votre amendement n° 84.

Il a pour objet d'affirmer la position du Parlement sur la question du plan européen d'aide aux plus démunis – le PEAD –, étant précisé que je ne conteste pas le travail accompli sur ce dossier par le ministre de l'agriculture, Bruno Le Maire, ni celui accompli par la Commission européenne, afin de trouver une solution échappant à la sanction de la Cour de la justice. Je rappelle que ce plan concerne 18 millions de personnes et que les fonds nécessaires à son fonctionnement, de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros, sont disponibles.
Il me paraît important que nous montrions à la minorité d'États tentant de bloquer ce programme que l'aspiration générale, au sein de l'Union européenne, est celle d'une Europe ouverte, disposée à faire face à la totalité des enjeux, aussi bien économiques que sociaux.

La commission est défavorable à cet amendement, qui a trait à une question ayant vocation à être réglée dans le cadre des discussions entre le Parlement européen et la Commission.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. On ne peut pas intervenir, dans le cadre de la contribution nationale au budget européen, sur l'affectation des recettes ou des dépenses. Les pays de la minorité de blocage, notamment la République tchèque et le Danemark, s'appuient sur un arrêt de la Cour européenne de justice, qui a estimé cette année que le PEAD avait dévié de son objectif initial de redistribution des excédents agricoles.
Comme vous le savez, Bruno Le Maire et moi-même avons contacté nos homologues au sujet de ce dossier. Pour le moment, nous n'avons pas encore réussi à faire aboutir notre démarche. Cependant, je rappelle que le Président de la République a considéré que l'aide aux plus démunis était une obligation pour l'Europe, et je ne doute pas que, dans l'hypothèse où nous nous trouverions dans une impasse au niveau européen, la France prendrait ses responsabilités.

Je suis sensible à l'amendement de notre collègue Garrigue. Voudrions-nous donner l'image d'une Europe totalement technocratique, qui ne veut rien savoir des difficultés sociales, que nous ne nous y prendrions pas autrement – il faut toutefois reconnaître que le Gouvernement n'y est pour rien et qu'il se bat, comme l'a rappelé M. le ministre, pour que les Tchèques et les Allemands reviennent sur leur position. Dans la mesure où le PEAD a fonctionné pendant des années, l'intelligence de ceux qui l'ont conçu doit pouvoir être à nouveau mise à contribution, cette fois pour le maintenir, en dépit de la décision de justice sur laquelle s'appuie la minorité de blocage.
J'insiste sur le fait que les sommes en question ne représentent qu'un faible pourcentage du budget européen, et qu'il paraît donc bien mesquin de se disputer à ce sujet. Avant que nous ne passions au vote, pourriez-vous nous éclairer, monsieur le ministre, sur l'idée – que vous semblez suggérer – d'une éventuelle substitution de l'État français à l'Union européenne en cas de défaillance de celle-ci ?
Monsieur de Courson, je ne peux m'engager au nom de l'État sur une question relevant en partie de la compétence du Parlement. Nous en sommes encore au stade des discussions : M. le Premier ministre est intervenu auprès du Premier ministre de la République tchèque et de la Chancelière allemande ; de son côté, le Président de la République a également évoqué le problème avec Angela Merkel. Nous avons étudié la possibilité de maintenir le montant initial de l'aide en proposant d'utiliser deux budgets différents, l'un pour la PAC, l'autre pour la solidarité – en vain pour le moment, car nous n'avons pas encore réussi à lever la minorité de blocage.
Je précise qu'en Allemagne l'aide aux plus démunis relève de la responsabilité des Länder, qui comprennent mal, étant peu bénéficiaires du dispositif, que nous n'appliquions pas sans réserves la décision rendue par la Cour de justice : ils sont favorables à une renationalisation de l'aide, conformément à cette décision. Pour notre part, nous souhaitons que l'Union européenne continue à assumer l'aide aux plus démunis dans les deux années qui viennent, c'est-à-dire en attendant les nouvelles orientations du PEAD pour les années 2014 à 2020, et continuerons à nous battre afin d'obtenir la levée de la minorité de blocage.
Dans l'hypothèse où nous ne parviendrions pas à faire valoir notre position, je n'imagine pas, à titre personnel, que le gouvernement français puisse abandonner les plus démunis dans la période de crise que nous traversons. Je souhaite de tout coeur que nous parvenions à sortir les discussions de l'impasse, mais si cela se révélait impossible, je pense que le Gouvernement prendrait ses responsabilités.

Je rappelle qu'il s'agit là d'une affaire extrêmement sérieuse, qui concerne un grand nombre de personnes en France et dans l'ensemble de l'Union européenne. Nous avons voté une réforme du règlement de notre assemblée, permettant de déposer des résolutions, notamment sur les projets, propositions ou documents de nature européenne. Cette procédure, relativement lourde, est mise en oeuvre assez rarement. Ma proposition, qui s'apparente à une résolution de cette nature, ne me paraît pas susceptible d'affecter gravement les mécanismes budgétaires européens – contrairement à ce que vous semblez sous-entendre, monsieur le ministre. Son adoption constituerait une occasion d'exprimer, sur un problème grave, notre position vis-à-vis d'un petit nombre d'États qui n'ont pas compris que l'Europe est un tout, et que nous devons avancer ensemble.

Je voterai l'amendement de M. Garrigue, et je me félicite que M. le ministre ait finalement répondu à la question que je lui avais posée sur la position qu'adopterait la France en cas de maintien, par la Commission européenne, de sa position sur ce point. Je le remercie de sa réponse, même s'il a attendu, pour la donner, que M. de Courson lui pose à son tour la même question.
Loin de moi l'idée, monsieur Asensi, de vous écarter. Dans ma réponse, je m'exprimais au sujet d'un amendement. Je vous associe bien volontiers à cette préoccupation qui, je crois vous l'avoir expliqué de manière tout à fait claire, est majeure pour le Gouvernement. La mission qu'a donnée le Président de la République au Premier ministre et à l'ensemble des ministres concernés est d'arriver à trouver une solution.

Oui, monsieur le président, je le maintiens.
(L'amendement n° 84 n'est pas adopté.)

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 95 et 204.
La parole est à M. Richard Mallié, pour présenter l'amendement n° 95.

Avant toute chose, je tiens à souligner, au nom de mes collègues cosignataires de cet amendement – nous sommes près d'une cinquantaine – notre soutien le plus fort à la Turquie et au peuple turc suite au terrible séisme qui a frappé ce pays hier matin.

Il est de notre devoir d'aider le peuple turc dans cette situation. Mais il est aussi de notre devoir de respecter ce pays et de mettre fin à une certaine hypocrisie européenne.
En effet, chaque année – et vous allez me dire, à cet égard, que mon amendement est devenu traditionnel, mais cela ne m'empêche pas d'y revenir –, la France verse indirectement à la Turquie près de 130 millions d'euros en vue de son adhésion à l'Union européenne,…

…soit 887 millions d'euros sur sept ans entre 2007 et 2013. Il s'agit bien de crédits de préadhésion : c'est comme cela que les présente le budget européen.
Tous les sondages réalisés en France – mais c'est aussi le cas en Turquie maintenant – vont dans le même sens : oui à un partenariat privilégié, non à une adhésion.

Il faut dire qu'en ce moment les sondages ne sont pas très favorables non plus à l'UMP !

C'est pourquoi, avec Claude Bodin, Patrice Calméjane et une cinquantaine de nos collègues,…

…nous avons déposé un amendement de cohérence visant à supprimer ces crédits. De plus, la Cour des comptes européenne épingle chaque année ce pays car il ne réalise qu'une faible partie des objectifs assignés à ces crédits.
À l'heure même où notre État et nos collectivités territoriales font des économies, comme on l'entend répéter depuis le début de l'examen de ce projet de loi de finances, il est nécessaire de mettre fin à cette incohérence politique et budgétaire. Il est important de dire et de répéter que l'Assemblée nationale française n'est pas une simple chambre d'enregistrement concernant le budget européen.
L'adoption de nos amendements serait un signal fort envoyé à la Commission européenne de Bruxelles. Cela lui montrerait que l'Assemblée nationale dispose d'une profonde conviction à ce sujet et qu'elle a toute légitimité à l'exprimer publiquement.
Je sais, monsieur le ministre, que la technocratie française, main dans la main avec la technocratie européenne,…

…vous a préparé un argumentaire tendant à montrer que je dis n'importe quoi. Mais vous ne m'empêcherez pas de voir dans ce problème, comme l'électorat et le peuple français, une certaine incohérence politique. C'est la raison pour laquelle je pense que vous donnerez un avis favorable à cet amendement.
(M. Marc Le Fur remplace M. Louis Giscard d'Estaing au fauteuil de la présidence.)

La parole est à M. Charles de Courson, pour présenter l'amendement n° 204.

Le groupe Nouveau Centre n'a jamais été favorable à l'adhésion de la Turquie. Nous souhaitons que ce pays reçoive le statut d'État associé.
Cela fait plusieurs années que nous déposons des amendements similaires, qui ne sont pas du tout contre la Turquie. Il s'agit d'avoir un message clair à l'égard des responsables et du peuple turcs, en leur disant qu'une association est possible et intéressante tant pour l'Union que pour la Turquie, mais qu'il n'y aura pas d'adhésion.
En effet, mes chers collègues, que voulons-nous ? Est-ce une Europe politique, un fédéralisme européen ? Si la réponse est oui, la Turquie ne doit pas adhérer.
Si l'on considère au contraire l'Union européenne comme une zone de libre-échange, aucun problème, que la Turquie adhère. En ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que l'Union soit une zone de libre-échange. Nous n'avons pas une conception anglaise de la construction européenne.

C'est pour cela, mais aussi pour d'autres raisons, liées à l'histoire – cela fait partie de l'identité des peuples –, et aux valeurs que nous portons, que nous nous opposons à l'entrée de la Turquie. Le rôle qu'y joue l'armée, par exemple, n'est pas acceptable dans une démocratie européenne ; mais on pourrait développer bien d'autres arguments encore.
Voilà pourquoi nous défendons cette idée, à temps et à contretemps. Nous pensons que, depuis 1963, on trompe la Turquie en lui faisant croire qu'elle va adhérer à l'Union européenne, alors que ce n'est pas la bonne solution, ni pour elle ni pour l'Union.

La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

Cela fait très longtemps que je défends, à titre personnel, la position qui vient d'être exprimée par M. de Courson sur l'entrée de la Turquie dans l'Union.
J'ai toujours considéré que, pour des raisons d'efficacité de l'Europe, les frontières de l'Union européenne doivent aller jusqu'aux Balkans. Après, il faut s'arrêter.
Il n'est déjà pas facile de faire fonctionner L'Europe à vingt-sept. Nous voulons l'Europe politique. À cet égard, l'entrée de la Turquie – au-delà de tous les problèmes qui se posent, que ce soit avec Chypre ou au regard de la condition de la femme –, me paraît totalement invraisemblable. Ce pays compte en effet 80 millions d'habitants. Il aurait donc la prépondérance, en nombre de députés comme à l'intérieur du Conseil européen.
Cela dit, ce n'est pas la première année que nous avons ce débat. Vous savez donc ce que je vais vous répondre.

Contrairement à ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de l'amendement n° 95, ce qui est proposé ne me paraît pas cohérent avec la politique européenne de la France, conduite par le Président de la République, à l'égard des négociations de l'Union européenne avec la Turquie.
L'adoption de cet amendement signifierait inévitablement, aux yeux de nos partenaires turcs et européens, que la France veut interrompre non seulement l'aide à la Turquie, destinée à rapprocher celle-ci de l'Union européenne,…

…mais aussi la négociation. Or ce n'est pas la politique de la France exprimée par le Président de la République.
La France se prononce pour que les négociations aboutissent à un partenariat privilégié, comme l'a dit tout à l'heure M. le ministre, et non à une adhésion ; elle est en faveur de l'ouverture de trente chapitres de la négociation sur trente-cinq. Elle s'oppose seulement à l'ouverture de cinq chapitres directement liés à l'adhésion.
La position de la France est donc très claire. Nous avons même fait acter par le Conseil Affaires générales du 10 décembre 2007 la suppression du terme « adhésion » pour qualifier la négociation. Mais la France souhaite maintenir l'aide et progresser dans la négociation pour parvenir à un rapprochement plus étroit que l'union douanière adoptée en 1995 sous présidence française de l'Union européenne.
Nous ne voulons pas de la Turquie dans l'Europe, mais il ne peut être question d'humilier ce grand pays ami, qui participe notamment au G20 en qualité de dix-septième économie mondiale. Ce serait contraire à la politique de la France d'adopter cet amendement.
Monsieur Mallié, je n'ai pas changé d'opinion. Lorsque je siégeais à côté de vous, j'avais dit clairement, et pour les mêmes raisons que celles exposées par M. Lequiller, que l'Europe s'affaiblirait si elle s'élargissait au point de ne plus être qu'une zone de libre-échange. C'est en effet là une conception britannique de l'Europe, alors que la nôtre est celle d'une Europe avec des frontières – j'ose le mot. Ces frontières sont géographiquement et historiquement connues. À l'intérieur de ces frontières, il est nécessaire d'aller vers un approfondissement. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des limites que la personne qui est à l'extérieur doit être considérée comme un adversaire ou un ennemi. Au contraire, nous lui reconnaissons cette différence.
J'ai évoqué tout à l'heure le partenariat sud que la France souhaite développer. Aujourd'hui, de l'argent est débloqué par l'Union européenne pour les pays du printemps arabe. Néanmoins, il n'y a aucune ambiguïté : la France n'a jamais dit à la Libye, à la Tunisie ou à l'Égypte qu'elles avaient vocation à entrer dans l'Union européenne. De la même façon, il existe un partenariat oriental avec de grands pays comme l'Ukraine, avec lequel nous essayons, en contrepartie d'efforts en matière d'État de droit et de respect des règles démocratiques, d'avancer vers des possibilités de relations commerciales, voire un libre-échange.
On le voit bien : l'Europe n'est pas isolée dans le monde. Elle a autour d'elle des espaces sur lesquels elle doit s'appuyer et avec lesquels elle doit dialoguer et commercer. En même temps, elle doit développer une politique étrangère, qui commence à être mise en oeuvre grâce au Traité de Lisbonne. Dans cette politique, la Turquie sera un partenaire indispensable pour les négociations, par exemple au Moyen-Orient. Nous avons besoin d'un partenaire qui, sans être destiné à entrer dans l'Union européenne, nous est indispensable pour créer une zone d'apaisement dans ce que le Président de la République appelait de ses voeux, à savoir l'Union pour la Méditerranée. Les ouvertures qui ont lieu aujourd'hui se font donc en vue, non d'une adhésion, mais d'une association. À cet égard, le président Lequiller a raison de rappeler que nous avons fait changer le mot.
Par ailleurs, sur le plan technique, on ne peut pas décider comme vous le proposez l'affectation ou la non-affectation d'une partie des ressources que vote aujourd'hui le Parlement.
Les choses sont claires et il n'y a pas d'ambiguïté. Nous ne conduisons pas la Turquie dans une impasse. La position de la France est sans équivoque. De la même façon, j'ai récemment redit en Pologne aux Ukrainiens et aux Biélorusses, dans le cadre du partenariat oriental, que les échanges que nous avons et les moyens que l'Europe peut mettre à leur disposition ne sont pas un préambule à une adhésion.
L'extension de l'Europe, ça suffit ! Comme l'a très bien dit le président Lequiller, elle doit se limiter à la zone des Balkans. L'Europe est une faiseuse de paix. Nous avons dit à nos amis serbes, qui sont désormais candidats avec l'appui de la France, en échange d'un dialogue renouvelé avec le Kosovo, et à nos amis croates, qui arrivent au bout du processus d'entrée dans l'Union européenne, que l'adhésion est un gage de paix, de sécurité et de prospérité. Cela suppose aussi de respecter l'État de droit et les droits de l'homme. La construction de l'Europe, c'est ça. Voilà pourquoi, en dehors des pays des Balkans, la France n'est pas favorable à l'entrée d'un quelconque pays dans l'Union européenne.
Il faut donc bien comprendre cette contribution comme un prélude à une association, à un partenariat, et non à une adhésion. Je suis très clair ici, de même que l'est la France vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires. En effet, à l'intérieur de l'Union européenne, elle tient exactement le même langage que celui que je viens de tenir devant vous.

Ce n'est pas parce que je suis défavorable, tout comme vous, à l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne que je considère qu'il faut donner aux Turcs l'impression que nous les laissons sur le bord de la route, surtout après la catastrophe dont ils ont été victimes hier.
J'ai participé il y a quelques semaines à un séminaire organisé à Istanbul par l'Institut du Bosphore sur la place de la Turquie dans ses relations avec l'Europe, sur son rôle au Proche et au Moyen-Orient – que vient de rappeler M. le ministre – et sur ses initiatives à l'occasion des révolutions arabes.
Avec un taux de croissance de 10 % par an, des exportations vers l'Union européenne représentant 48 % de son commerce, un équilibre budgétaire que les pays européens lui envient, la Turquie est un partenaire très important de l'Europe et de la France, qui, je le rappelle, est son cinquième partenaire économique. Des chantiers communs franco-turcs pourraient s'ouvrir et se concrétiser, par exemple pour la reconstruction de la Libye.
La Turquie peut aussi jouer un rôle important de médiation avec des pays de la région : la Syrie, l'Irak, l'Iran. Le poids, l'influence de la Turquie dans le conflit israélo-palestinien pourront, me semble-t-il, soutenir utilement la reconnaissance d'un État palestinien.
Je souhaite également, à l'inverse, que la Turquie trouve enfin des solutions pacifiques aux problèmes kurde et chypriote.
Pour toutes ces raisons, je pense qu'il ne faut pas donner aux Turcs l'impression de chipoter sur notre aide.

Cet amendement, c'est vrai, n'est pas très bienvenu au moment où la Turquie connaît à nouveau une catastrophe qui fera sans doute de très nombreuses victimes.
S'il s'agit, avec cet amendement, de faire passer un message aux autorités turques, alors je veux rassurer M. de Courson et M. Mallié : ce message est bien passé. La Turquie a bien compris la position de la France quant à son éventuelle entrée dans l'Union européenne ; cette position a d'ailleurs provoqué, je le dis en passant, un affaiblissement préoccupant de la position de la France auprès d'un pays avec qui nous avons entretenu des liens historiques, et auprès d'une population qui aime la France, mais qui se désespère d'une position aussi catégorique et aussi systématique.
Mais je ne crois pas, honnêtement, que M. Mallié ait eu en tête de faire passer un message aux autorités turques ; il a en tête de faire passer un message à certains de ses électeurs. Il pourra rentrer dans sa circonscription avec le sentiment du devoir accompli.
On ne doit pas, je crois, traiter ces problèmes de relations internationales à partir des revendications de certaines communautés, même si ces revendications sont légitimes.
Nous croyons, nous, qu'il faut poursuivre les négociations avec la Turquie, et pas seulement dans la perspective d'un partenariat, mais dans celle d'une adhésion.

Il ne s'agit pas de trancher cette question aujourd'hui. Mais ces négociations doivent demeurer ouvertes, y compris dans la perspective d'une adhésion. Fidèles à ce qui est depuis longtemps la position du parti socialiste, nous voterons contre ces amendements.

Je voulais d'abord dire à M. Caresche que le parti socialiste n'est pas seul à exprimer cette position. C'était, je le rappelle, celle de la France depuis le général de Gaulle !

Les amendements présentés me paraissent tout à fait regrettables, quand on pense à nos engagements, quand on pense à ce pays dont nous mesurons les évolutions considérables – évolution économique, cela a été dit, mais aussi démocratique. La Turquie sert aujourd'hui de modèle aux pays qui ont la chance de connaître le printemps arabe ; elle a sur eux beaucoup d'influence. C'est un pays qui, aujourd'hui, s'affirme par une politique étrangère indépendante – une indépendance comme celle que la France affirmait encore il y a quelques années, et dont nous aimerions tant qu'elle l'affirme à nouveau !
Il y a un processus : il doit être mené à son terme ; il faut le respecter. L'interrompre, ce serait envoyer à la Turquie le pire des messages. Ce n'est pas parce que le Président de la République adresse un message déplorable que le Parlement doit s'associer à cette attitude. (Murmures sur les bancs du groupe UMP.)

Il s'agissait, à l'occasion de ce débat – et ces occasions sont rares –, de montrer que notre position est claire. Il ne s'agit évidemment pas de réduire les aides à la Turquie, bien au contraire !
Monsieur le ministre, vous nous avez dit qu'on ne parlait plus de préadhésion mais de « préassociation ». Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien le terme employé dans les documents budgétaires de l'Union ? Si tel est le cas, je retire immédiatement mon amendement, qui n'a pas pour objectif ce que certains essayent de lui faire dire !

Monsieur Garrigue, il faut vivre avec votre temps : nous sommes au XXIe siècle. Je vous donne simplement une information : l'an dernier, Istanbul était capitale européenne de la culture ; pour l'exposition consacrée à Topkapi, il y avait deux files : l'une pour les Européens, où l'on payait l'entrée vingt euros ; l'autre pour les Turcs, où l'on payait vingt centimes.
Monsieur le ministre, j'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai entendu ce qu'ont dit les uns et les autres ; j'ai noté avec satisfaction que la gauche est toujours favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Vous affirmez, monsieur Caresche, que je voudrais faire plaisir à mon électorat.

Oh, de ce côté-là, nous n'avons pas de leçons à recevoir ! M. Montebourg, avec sa démondialisation, faisait plaisir à l'extrême gauche comme à l'extrême droite : c'est vraiment le grand écart.

Mais peu importe.
Je voudrais simplement répéter ce qu'a dit Charles de Courson : pourquoi y a-t-il, depuis 2007, des crédits de préadhésion ? Je n'ai toujours pas reçu de réponse à cette question ! Tout le monde me dit que la France est contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, mais on continue à donner de l'argent au titre de la préadhésion ! J'estime donc, monsieur Lequiller, ne pas avoir reçu de réponse sur ce point.

En revanche, je voudrais poser une question simple : croyez-vous vraiment qu'aujourd'hui la France a les moyens de dépenser ces crédits ? Si c'est le cas, je n'ai rien compris à ce projet de loi de finances.

Et je n'ai rien compris non plus à ce qu'on dit nos gouvernants, le Premier ministre, le ministre des finances, la ministre du budget.
Avons-nous encore les moyens ? Alors que nous demandons à nos concitoyens de se serrer la ceinture, on continue à donner de l'argent à la Turquie – mais la Turquie, elle, en a-t-elle besoin ? À écouter M. Pinte, pas du tout ! Il nous parle de 10 % de croissance, d'exportations.
Si la Turquie n'a pas besoin de cet argent, et que nous n'avons pas les moyens de le lui donner, le problème est simple. Nous voterons cet amendement.

Pour évoquer les relations de la France avec la Sublime Porte, on peut, effectivement, remonter à Louis XIV, voire à François Ier.
Ou à Jean sans Terre, comme M. de Courson !

Je proposais seulement de remonter jusqu'à Jacques Chirac ! (Sourires sur les bancs du groupe SRC.)

Le vrai sujet, ce n'est pas celui des considérations électorales locales : on peut, je crois, faire crédit à chacun de nos collègues d'une vision un peu plus haute des intérêts de notre pays et des problèmes politiques.

Le sujet, c'est celui de l'élargissement de l'Europe. Or, aujourd'hui, on voit les difficultés dans lesquelles l'Europe est empêtrée du fait d'un élargissement rapide – et qui devait d'ailleurs l'être – à ceux dont le seul tort était d'être du mauvais côté du Mur, mais qui posent aujourd'hui d'immenses problèmes de gouvernance.

Aujourd'hui, nous devons nous demander s'il faut continuer à élargir l'Europe en intégrant un pays de 80 millions d'habitants, et qui plus est un pays qui a sans doute, dans l'organisation politique du monde, un rôle à jouer différent de celui qu'il jouerait en intégrant l'Union européenne. La question est là, et il faudra, monsieur le ministre, que les documents budgétaires de l'Union soient clarifiés.

Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut envoyer à la Turquie un signal négatif, compte tenu de son rôle de partenaire commercial, mais aussi de son rôle politique au sein de l'Union pour la Méditerranée, au sein de l'espace méditerranéen, ou dans les relations avec certaines républiques turcophones d'Asie centrale.
Mais il serait souhaitable, sans voter ces amendements, d'obtenir cette clarification tant attendue. Elle ne pourra pas, nous le savons bien, venir d'une décision française : une décision communautaire est nécessaire. Mais nous devons pouvoir être certains que ce débat, comme le Président de la République l'a souhaité, continuera ; au-delà du périmètre de l'Europe, il faudra aussi évaluer, d'ailleurs, le périmètre des relations privilégiées que doit entretenir l'Europe avec l'Afrique, avec la Turquie, avec la Russie – dont on parle trop peu, mais qui est sans doute le partenaire économique le plus important pour l'avenir du continent européen.

Le moins qu'on puisse dire, monsieur le ministre, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation parfaitement ambiguë.
Cette ambiguïté devient tout à fait insupportable pour toutes celles et tous ceux qui considèrent qu'il est de notre intérêt de tisser des coopérations et des liens étroits avec ceux qui sont aux portes de l'Europe, et notamment avec la Turquie, qui de temps immémoriaux a été un indispensable trait d'union avec des régions du monde qui sont instables, et qui posent à l'Europe de véritables problèmes, en particulier de sécurité.
Vous nous demandez aujourd'hui de voter des crédits qui figurent dans une ligne de préadhésion. Plusieurs d'entre nous pensent que si cette ligne de crédits était affectée à un budget qui ne soit pas un budget de préadhésion, mais de renforcement de la coopération avec cette région du monde, il n'y aurait aucune difficulté.
Je m'exprime ici à titre personnel sur ces deux amendements. Vos explications doivent nous permettre de sortir de cette ambiguïté en nous expliquant clairement où est la difficulté – peut-être avec l'Allemagne, ou avec la Grande-Bretagne, qui ne partagent peut-être pas notre conviction sur ce point. Si c'est le cas, je serai favorable au rejet de cet amendement.
Mais si, l'année prochaine, ceux qui siégeront encore sur ces bancs…

Vous n'avez pas l'air bien sûr de vous, pour l'année prochaine ! (Sourires.)

…posent encore les mêmes questions, dans les mêmes circonstances, c'est l'Europe et sa sécurité qui pâtiront de votre refus de sortir de cette ambiguïté extrêmement préjudiciable à ce que nous croyons et à ce que nous pensons de l'Europe.
Il n'y a pas d'ambiguïté, mais passage d'un monde à un autre. N'est-ce pas là la définition d'une crise ?
Nous devons considérer l'Europe telle qu'elle était, et l'Europe telle qu'elle doit devenir : la crise, c'est ce passage d'un modèle qui s'efface à un modèle qui se construit.
Ne vous paraît-il pas logique, aujourd'hui, de réfléchir à cette démocratie qu'évoquait M. Caresche à juste titre, et qui doit permettre, parce que le traité de Lisbonne le permet, que certains pays de la zone euro, dont l'Allemagne et la France, avancent un peu plus vite pour régler des problèmes qui leur sont spécifiques ?
Ne pensez-vous pas que l'Europe a été, pendant longtemps, naïve, pensant que le simple fait de rentrer dans l'Union européenne apportait la prospérité et que le simple fait d'adopter la monnaie européenne apportait aux peuples une qualité de vie, pensant que la Grèce pouvait devenir prospère alors que, nous le voyons aujourd'hui, ses exportations sont très limitées, son économie peu développée, son organisation administrative très faible ?
Ne pensez-vous pas que nous devons passer de cette Europe naïve à une Europe réaliste, et que cette Europe réaliste est faite de solidarités entre les peuples – car l'Europe est solidaire de la Grèce – mais aussi de discipline budgétaire, discipline indispensable pour que chacun ait confiance en l'autre ? Dans cette Europe réaliste, l'Allemagne, la France peuvent se porter caution pour d'autres peuples, mais ceux-ci doivent faire l'effort budgétaire nécessaire.
Ne pensez-vous pas qu'après avoir cru que le simple élargissement de l'Europe toujours continué était une fin en soi, vient le moment de se poser la question des frontières, et de constater que ces frontières résultent de notre histoire, de notre géographie, mais aussi de notre projet, qui est plus un projet d'approfondissement que d'élargissement ? Ne devons-nous pas nous demander plutôt comment avancer vers cette Europe qui protège les peuples, tout leur apportant des progrès grâce à des projets comme Galileo ou ITER ?
Cette Europe-là a donné sa parole. Certes, monsieur Mallié et monsieur Blanc, vous n'étiez pas encore là en 1999…
…mais pensez-vous vraiment que la décision qui a été prise alors ne concerne pas ceux qui siègent ici aujourd'hui ?
Je reviens de Serbie, dont la France soutient la candidature. Mais nous avons bien expliqué que ce n'est pas son évolution qui lui donnait le statut de candidate et qu'elle ne pourra pas adhérer à l'Union européenne tant qu'elle n'aura pas fait la paix avec ses voisins, et notamment retrouvé le dialogue avec le territoire du Kosovo.
Le statut de candidat d'un pays entraîne-t-il obligatoirement son entrée dans l'Union européenne ? Les traités répondent par la négative, et la France a clairement indiqué, par la voix du Président de la République, que la Turquie n'avait pas vocation à entrer dans l'Union européenne.
Cependant, on le voit bien, le monde bouge sur le plan géopolitique, et le printemps arabe auquel nous assistons actuellement montre qu'un certain nombre de peuples n'ont pas le choix qu'entre l'islamisme rétrograde et la dictature brutale. Nous devons les accompagner dans une autre voie, celle de la démocratie. C'est l'action qu'a menée le Président de la République en Libye avec nos partenaires européens, et c'est ce que nous faisons en Tunisie et en Égypte.
L'Union pour la Méditerranée commence à s'imprimer dans les esprits parce que l'Europe considère l'Afrique autrement, et qu'elle l'accompagne avec respect vers le modèle démocratique. Cela modifie nos relations avec l'ensemble de nos partenaires, nos partenaires orientaux comme ceux du sud.
Faut-il donner de l'argent à ces partenaires ? La réponse est oui. Faut-il que le terme de préadhésion soit biffé sur les éléments antérieurs ? Cela ne dépend pas que de la France, vous l'avez vous-même constaté. L'Allemagne est plus réticente que notre pays à ce sujet. Quant à la Grande-Bretagne, elle est favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
Je ne peux vous rappeler ici que la position française, qui a été clairement exprimée par le Président de la République et par tous les membres du Gouvernement. Une partie de la contribution que vous votez aujourd'hui ira à la Turquie, une autre à l'Égypte, une autre à la Tunisie, une autre à l'Ukraine, et c'est bien ainsi. Cela veut dire que l'Europe est forte parce qu'elle oblige, dans un échange donnant-donnant, l'ensemble des peuples qui sont autour d'elle à commercer avec elle tout en progressant dans la voie de l'État de droit et de la démocratie.
Faut-il rompre brutalement pour un problème de sémantique qui lèverait je ne sais quelle ambiguïté ? Je ne le crois pas. Aujourd'hui, la position de la France est claire, vous savez que nous n'avons ouvert aucun chapitre et que nous n'en ouvrirons aucun permettant l'adhésion de ce pays à l'Union européenne.
Je ne pense pas que mes propos soient empreints d'ambiguïté, même si les termes sont hérités d'un passé que nous assumons parce que nous sommes fidèles aux traités. Mais notre position a un peu changé compte tenu de la construction européenne, de la crise qu'elle traverse, du problème des frontières et de l'Union pour la Méditerranée, grande ambition développée par le Président de la République.

Je retire l'amendement n° 204.
(L'amendement n° 204 est retiré.)
(L'amendement n° 95 n'est pas adopté.)
(L'article 30 est adopté.)

Le débat sur le prélèvement européen et l'article 30 étant achevé, nous poursuivons l'examen de la première partie.

Je suis saisi d'un amendement n° 301, portant article additionnel après l'article 30.
La parole est à M. Jean Mallot.

La loi de finances de 2011 a instauré un forfait d'accès à l'aide médicale d'État, un droit annuel d'un montant de 30 euros par bénéficiaire majeur. L'amendement n° 301 vise à supprimer cette mesure scandaleuse.
D'abord, parce qu'elle a vu l'UMP chasser sur les terres du Front national en ciblant les étrangers, cause de tous nos malheurs, malades, profiteurs, voire fraudeurs selon les auteurs de cette mesure.
Ensuite, parce que le Gouvernement a volontairement caché à l'époque un rapport de l'IGAS et de l'IGF qui montrait la réalité des choses, notamment que l'AME est utile et qu'elle ne fait pas l'objet de fraudes particulières. Le rapport concluait que l'instauration d'un droit d'accès était inopportune.
Par ailleurs, parce qu'elle est injuste. Je rappelle que, pour bénéficier de l'aide médicale d'État, il faut être titulaire d'un revenu mensuel inférieur à 634 euros, ce qui ne représente pas grand-chose.
Enfin, parce qu'elle est aberrante sur le plan sanitaire. Une étude, publiée récemment par Médecins du monde, a conclu que cette mesure est injuste, coûteuse et dangereuse. Parmi les personnes interrogées, 55 % des bénéficiaires potentiels de l'AME déclarent que cette taxe leur posera un problème de financement, un tiers se déclarent prêts à surmonter malgré tout ce problème pour demander l'AME. Ces personnes disposent d'un revenu médian, après paiement du logement et de la nourriture, de 100 euros. En outre, les témoignages montrent que ces familles ont d'ores et déjà choisi de ne faire bénéficier de l'AME que l'adulte malade, ne pouvant payer pour chaque membre de la famille.
Les retards de prise en charge qui en découlent sont évidemment préjudiciables. La démonstration est ainsi faite – c'est d'ailleurs ce que nous avions dit l'année dernière lors de la discussion sur l'instauration de cette taxe – que cette mesure fait obstacle à l'accès aux soins, qui est pourtant un droit fondamental universel reconnu par tous les textes internationaux.

La parole est à Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.
Même avis.
(L'amendement n° 301 n'est pas adopté.)

Monsieur le président, je demande une courte suspension de séance, afin d'examiner l'amendement du Gouvernement concernant l'article d'équilibre.
Après l'article 30

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)

Je suis saisi d'un amendement n° 447 du Gouvernement.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à traduire dans l'équilibre budgétaire l'ensemble des votes de l'Assemblée intervenus au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2012.
Plusieurs séries de mesures ont été adoptées et permettent une amélioration du déficit budgétaire de près de 1,5 milliard d'euros.
Il s'agit tout d'abord de la mise en oeuvre du plan d'économies supplémentaires d'un milliard d'euros annoncé par le Premier ministre le 24 août dernier.
Ce plan se décline en trois volets : d'abord, le plafonnement des taxes affectées aux opérateurs de l'État et les prélèvements ponctuels sur fonds de roulement, adoptés par l'Assemblée, réaffectent à l'État 194 millions d'euros de recettes ; ensuite, le Gouvernement propose de diminuer de 606 millions d'euros le plafond des dépenses du budget général – ces économies supplémentaires sur les opérateurs, pour 122 millions d'euros, et sur les ministères, pour 484 millions d'euros, seront réparties à l'occasion de l'examen de la seconde partie du projet ; enfin, les collectivités territoriales contribuent à hauteur de 200 millions d'euros par application d'un schéma juste et équilibré, prévoyant notamment la reconduction de la DGF à son niveau de 2011.
Ces mesures conduisent à une amélioration du solde d'un milliard d'euros en 2012 : il s'agit d'un effort substantiel d'économies qui nous place en deçà de la norme « zéro valeur » et constitue un effort sans précédent de maîtrise de la dépense.
Comme l'avait annoncé le Premier ministre, le dispositif du bonus-malus concernant l'automobile sera ramené à l'équilibre financier en 2012 grâce, d'une part, à l'augmentation des recettes de malus et, d'autre part, à une révision à la baisse du barème du bonus, qui sera effectuée par voie réglementaire.
Ces mesures de redressement conduisent à une amélioration du solde budgétaire de 112 millions d'euros.
À la demande de la commission, le mécanisme actuel de gestion du dispositif, un compte de concours financier, a été remplacé par un compte d'affectation spéciale, consacrant l'objectif d'équilibre de ce dispositif bonus-malus
Plusieurs amendements de majoration des recettes ont été adoptés par l'Assemblée dans le but d'assurer le financement d'un nouveau dispositif de réduction du coût du travail permanent dans l'agriculture.
Il s'agit du doublement de la taxe sur les boissons sucrées, qui rapportera 120 millions d'euros, de la création d'une taxe portant sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse pour 35 millions d'euros, enfin de l'augmentation du tarif applicable au fioul domestique utilisé comme carburant diesel à usage professionnel pour 80 millions d'euros.
Constatant ces recettes supplémentaires, le Gouvernement propose d'en tirer les conséquences en majorant le plafond des dépenses de l'État de 200 milliards d'euros, afin d'assurer la prise en charge par l'État du coût de la mesure.
Cette opération de baisse du coût du travail agricole est intégralement financée – c'est fondamental – et elle permet même une amélioration du solde du budget de l'État de 25 millions d'euros.
Enfin, les autres recettes de l'État sont améliorées de 314 millions d'euros par l'adoption des amendements suivants.
Les amendements nos 42 et 304 abaissent le seuil de taxation de la contribution sur les hauts revenus à 250 000 euros, en instaurant par ailleurs un taux progressif, et améliorent ainsi son rendement de 200 millions d'euros.
Les amendements nos 46, 126 et 153 suppriment l'abattement supplémentaire de 15 % par année de détention au titre des plus-values sur les ventes de chevaux de course ou de sport : 2 millions d'euros de recettes supplémentaires.
Les amendements nos 46 et 418 précisent le régime de taxation des plus-values immobilières des résidences secondaires. Ces aménagements portent sur les cas particuliers pour lesquels les propriétaires d'une résidence secondaire ne sont pas propriétaires de leur résidence principale : pour des raisons d'équité, une exonération sera possible si le produit de la cession est affecté en tout ou partie à l'acquisition d'une résidence principale. En compensation de cet assouplissement, l'assiette du droit d'enregistrement applicable lors de la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière est modifiée, afin d'éviter les effets d'évasion fiscale. Ces deux mesures améliorent globalement les recettes de 62 millions d'euros.
L'amendement n° 45 supprime, quant à lui, l'abattement de 40 % sur l'impôt sur le revenu pour les personnes détenant des actions de sociétés d'investissement immobilier cotées, ce qui rapporte 50 millions d'euros en 2012.
En conclusion, l'ensemble des amendements adoptés par votre assemblée conduit à une amélioration de près de 1,5 milliard d'euros du déficit budgétaire prévisionnel de l'État, qui est ramené à 80,3 milliards d'euros.
Nous sécurisons donc, grâce à votre travail, mesdames et messieurs les parlementaires, notre objectif intangible de réduction du déficit public, en augmentant les recettes mais aussi en mettant en oeuvre les engagements du 24 août, c'est-à-dire la réduction d'un milliard d'euros des dépenses de l'État et des collectivités locales.
Je remercie le rapporteur général pour le travail qu'il a effectué sur cette première partie de la loi de finances. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Merci, madame la ministre, de l'appréciation que vous avez bien voulu porter sur le travail des députés. Elle est, chers collègues, tout à fait justifiée. C'est la première fois, depuis 2002, qu'à l'issue de l'examen en première partie, nous réduisons le déficit de 1,451 milliard. L'an dernier, nous étions parvenus à une réduction de près de 900 millions. Mais, lors des belles années où les problèmes de finances publiques étaient moins présents, il y avait en général plutôt une détérioration du solde à l'issue de la première partie. Je me réjouis donc vraiment que nous améliorions le solde de façon substantielle. Et vous noterez que c'est largement au-delà du milliard, parce qu'il a fallu intégrer, dans cette discussion, le milliard d'euros qui résultait de l'engagement pris par le Premier ministre le 24 août dernier, et qui n'avait pas été intégré dans le projet de loi de finances du Gouvernement.
Je rappelle que ce milliard est obtenu, d'une part, en réduisant un certain nombre de prélèvements sur recettes, en récupérant la trésorerie d'un certain nombre d'opérateurs, et d'autre part, pour le solde, qui est de 600 millions d'euros, par une réduction du plafond de dépenses, qui, elle, sera discutée en seconde partie, lorsque nous examinerons les différents budgets.
Ce que je vous propose, c'est de reprendre l'amendement du Gouvernement et de revoir très rapidement les chiffres. Cela permettra de récapituler tout le travail que nous avons fait la semaine dernière.
En matière de recettes fiscales, je commence par la majoration d'impôt sur le revenu de 164 millions d'euros. Elle correspond aux 200 millions d'euros supplémentaires de la contribution exceptionnelle, auxquels s'ajoutent les 50 millions d'euros d'augmentation de l'impôt sur le revenu au titre des dividendes sur les sociétés d'investissement immobilier cotées. C'est une proposition que j'avait faite avec le président de la commission des finances, et que vous avez bien voulu adopter. Mais cette majoration correspond, d'autre part, en négatif, à l'amendement que nous avons adopté afin de tempérer la réforme des plus-values immobilières, notamment pour les jeunes ménages, qui ne sont pas en état d'être propriétaires de leur résidence principale, ou encore pour les ménages qui sont, comme c'est fréquemment le cas, dans une situation de mobilité professionnelle, ce qui ne permet pas forcément d'être propriétaire de sa résidence principale.

Cela fait donc 200, plus 50, moins 86 : 164 millions.
Ensuite, je passe rapidement. Les 7 millions, c'est la taxe sur les locaux à usage de bureaux. Il s'agit de la taxe dont le produit sert à financer la Société du Grand Paris. Puisque celle-ci a, pour le moment, une trésorerie importante, nous récupérons 7 millions. C'est l'un des premiers exemples de prélèvements sur les opérateurs.
Les 70 millions d'euros, c'est un ensemble de recettes que l'on prélève sur les opérateurs, en particulier le Centre national du cinéma.
Les 80 millions d'euros, c'est la taxe intérieure de consommation, l'ex-TIPP. Vous vous en souvenez parfaitement, c'est le gage que nous avons apporté en complément de la taxe sur les boissons sucrées, afin de financer la mesure de baisse des cotisations sociales patronales pour le travail salarié agricole. Nous avons diminué l'exonération de TIC pour le gazole destiné aux véhicules agricoles et de travaux publics.
Les 150 millions de recettes supplémentaires résultent de la majoration des droits d'enregistrement des sociétés civiles immobilières. À l'occasion de ventes de biens immobiliers sous forme de SCI, il était devenu usuel que des montages inscrivent des sommes en compte courant au passif de la pseudo-dette, afin de diminuer la valeur prise en compte pour le calcul des droits d'enregistrements.
Ensuite, nous avons 5 millions de prélèvements sur un opérateur, en l'occurrence le PMU, ainsi que 2 millions au titre du CNDS.
Les 165 millions méritent que l'on s'y attarde un instant. Ils correspondent à trois choses. D'abord, le doublement de la taxe sur les boissons sucrées. Vous savez qu'elle rapportait 120 millions, qui continuent d'aller à la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous l'avons doublée pour porter son produit à 240 millions, soit une augmentation des recettes de 120 millions. Ensuite, nous avons élargi l'assiette, en créant au passage une deuxième taxe, d'un même montant, qui rapporte 35 millions. Enfin, diverses taxes ont un produit de 10 millions. D'où ce total de 165 millions.
Je passe sur les dividendes INPI. Et nous arrivons aux collectivités locales. Là aussi, quelques mots d'explication. Nous devions trouver un milliard. Pour cela, il a été décidé que l'État réduirait les dotations aux collectivités locales, au prorata de ce qu'elles représentent dans son budget. Elles représentent à peu près 20 % du budget de l'État. Il fallait donc, pour trouver ce milliard d'euros, réduire ces dotations de 200 millions. On en a ici une première trace, avec les 32 millions que l'État va s'approprier sur l'augmentation, d'environ 50 millions, des amendes de police en 2012. C'est regrettable mais, comme je l'ai expliqué vendredi, nous avons essayé de trouver des mesures qui ne constituent pas des diminutions pour les collectivités locales, mais représentent de moindres augmentations, afin que soit vraiment garanti le socle des dotations 2011.
Les 96,8 millions, ce sont des prélèvements sur les fonds de roulement d'un certain nombre d'organismes qui, pour leur malheur, avaient des fonds de roulement assez abondants. Il y a notamment l'ONEMA, ainsi que l'Agence nationale des titres sécurisés.
La minoration du prélèvement sur recettes lié à la DGF pour les départements et les régions correspond à 77 millions d'euros. Il nous a paru légitime que, comme pour les communes et les intercommunalités, la DGF n'augmente pas. Mais elle ne diminue pas non plus. On reconduit très exactement, pour les communes, les départements et les régions, la DGF à son niveau de 2011.
Nous avons ensuite de petites choses : la suppression de la compensation aux communes du produit de la taxe sur les jeux automatiques, couramment appelée « taxe sur les flippers » – 9 millions ; le non-abondement supplémentaire, parce qu'il n'en a pas besoin, du fonds de solidarité des collectivités touchées par des catastrophes naturelles – 20 millions ; la non-majoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Sur ce point, j'insiste sur le fait que les FDPTP seront reconduits à leurs montants exacts de 2011, avec la même répartition. Chaque département, par exemple la Savoie, monsieur Bouvard, peut compter en 2012 sur le même montant qu'en 2011.

À l'euro près, du moins je l'espère.
Nous passons ensuite au bonus-malus. Les 234 millions, c'est l'inscription de la totalité de la recette malus automobile dans un nouveau compte. Vous vous souvenez que nous avions adopté en commission l'amendement de notre collègue Mariton, qui supprimait le compte de concours financier bonus-malus, parce que ce compte, depuis sa création il y a quatre ans, a toujours été en déséquilibre. Et le déséquilibre cumulé représente 1,2 milliard. Il a donc été décidé qu'à partir de 2012 il devrait y avoir un strict équilibre entre le malus et le bonus automobile. D'où la transformation de ce compte de concours financier, qui pouvait être en déséquilibre, en compte d'affectation spéciale, qui lui, au sens de la LOLF, doit obligatoirement être équilibré. Ainsi, on transfère la recette de malus, qui était prévue à 200 millions. Mais comme nous avons également voté un dispositif de petite augmentation du malus, cela nous donne 234 millions. Évidemment, en contrepartie, on supprime les 200 millions de l'ancien compte, qui lui-même disparaît.
Tout cela nous donne le tableau de ressources et de charges que vous avez sous les yeux. Le solde général est de 80,321 milliards. Il est donc en baisse de 1,451 milliard par rapport à la prévision initiale, qui était, vous vous en souvenez, de 81,8 milliards environ.
Le dernier tableau, c'est le tableau de ressources. Grâce à la LOLF, nous avons dorénavant un tableau des ressources et des emplois qui est extrêmement utile.

Il permet de voir comment on finance le déficit, comment vont se répartir les emprunts entre ceux à long, moyen et court termes. Vous observerez que, du fait que le besoin de financement est réduit de 1,5 milliard, la seule modification porte sur la variation de l'endettement à court terme des bons du Trésor. Cette variation est de moins 2,6 milliards, alors qu'elle était, dans le projet de loi de finances initial, de moins 1,1 milliard.
Je pense, mes chers collègues, que nous avons vraiment fait du très bon travail la semaine dernière. Je tiens à vous remercier pour l'esprit de responsabilité dont chacun a fait preuve. Je sais que ce n'était pas toujours facile, y compris, d'ailleurs, pour le Gouvernement. Chacun a fait preuve d'un esprit constructif. En réduisant de 1,5 milliard le déficit dès ce premier examen – ce qui ne préjuge pas de ce qui se passera dans les semaines qui vont suivre –, nous allons dans le sens d'une histoire qui s'accélère, s'agissant des évolutions budgétaires.
Je voudrais redire à quel point il est absolument essentiel pour notre pays de respecter son engagement de réduction du déficit 2011. Parce que, avant 2012, il y a 2011. Le budget 2011 sera définitivement connu, par les données Eurostat, en février ou mars prochain. Nous améliorons la crédibilité des prévisions 2012 avec cette réduction du déficit, mais nous serons d'autant plus solides pour nos prévisions 2012 que nous serons en état de prouver que nos engagements 2011 ont été respectés. Le respect de cette trajectoire de réduction de nos déficits, c'est vraiment la meilleure manière pour nous de conserver nos excellentes conditions de financement. Le besoin de financement reste très élevé, autour de 180 ou 200 milliards d'euros, entre le déficit à couvrir et la dette qui vient à échéance, et qu'il faut refinancer. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Mes chers collègues, voici le début du commencement d'une révolution culturelle.
C'est vrai !

C'est le dix-neuvième budget que je discute. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais assez de dépenses, et si l'on pouvait réduire les recettes, on le faisait !
Le fait de réduire de 1,45 milliard le déficit est un petit progrès. Petit, parce que nous sommes encore à 80,3 milliards d'euros de déficit. Il faudrait faire quatre fois plus, soit 6 milliards d'économies sur le budget de l'État, et 3 à 4 milliards sur la loi de financement de la sécurité sociale. Sinon, nous ne tiendrons pas nos objectifs de réduction des déficits.
En effet, nous avions prévu 2 % de croissance dans le projet de budget 2011. Le Gouvernement a réduit cette prévision à 1,75 %. Mais nous n'atteindrons pas ce chiffre, la croissance sera plus proche de 1,4 % ou 1,5 %, nous allons perdre 0,2 % ou 0,3 % de croissance. Ce n'est pas énorme mais, pour l'année prochaine, nous avions une hypothèse de départ de 2,25 %, le Gouvernement l'a réajustée à 1,75 %, et les prévisions continuent de baisser. Il y a trois mois, la moyenne des conjoncturistes prévoyait une croissance de 1,2 % ; maintenant elle s'établit à 0,9 %. Sur les années 2011-2012, c'est donc au moins un point de croissance que nous pourrions perdre.
Un point de croissance, c'est 20 milliards d'euros de PIB, qui représentent 8 à 9 milliards de pertes de recettes pour l'État et la sécurité sociale. L'effort de 1,5 milliard est donc significatif au regard des huit milliards que nous sommes susceptibles de perdre, mais il faut aller beaucoup plus loin.
Madame la ministre, il est hélas probable que mon amendement tombera, puisque l'amendement du Gouvernement sera mis aux voix avant le mien, et qu'il sera vraisemblablement adopté.
Je le crains !

Mais cet amendement était un signe pour nous inciter à aller beaucoup plus loin. Nous avons formulé des propositions : 5 milliards d'économies par une réduction généralisée sur les quatre cents niches ; 3 milliards sur les exonérations de charges sociales patronales, et ainsi de suite. Il doit être possible de dégager au moins un milliard sur la réduction dite « Fillon », en l'appliquant aux salaires inférieurs ou égaux à 1,5 fois le SMIC, contre 1,6 aujourd'hui. Pour ceux qui étaient présents à l'époque, je rappelle que nous avions baissé cette valeur de 1,7 fois le SMIC à 1,6 ; et il ne s'était rien passé de grave.
Il est peut-être aussi possible d'aller plus loin dans les économies sur les collectivités territoriales. Les 200 millions de réduction ont été obtenus avec beaucoup d'habileté par le rapporteur général, par ailleurs président du Comité des finances locales, et donc l'un des meilleurs connaisseurs de l'immense tuyauterie des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Comme il nous l'a expliqué, c'est essentiellement sur des augmentations que ces économies ont été réalisées.
Mais il faudra aller plus loin ; les questions qui se posent sont : quand ? Et à quel niveau ?
S'agissant du niveau des économies à réaliser, nous avons économisé 1,5 milliard, il faudrait économiser, je le répète, 4,5 milliards supplémentaires sur le budget de l'État, et 2 à 3 milliards sur le budget de la sécurité sociale, afin d'économiser au total 8 à 9 milliards d'euros, et ainsi de tenir nos engagements.
Et quand allons-nous décider de telles économies ? Si nous avons déposé cet amendement sur l'article 31 c'est qu'il nous semble qu'il faut le faire maintenant. Une fois que nous aurons voté la deuxième partie, le texte ira au Sénat. Tout le monde sait ce qui va s'y passer : le budget sera repoussé. En commission mixte paritaire, il y aura constat de désaccord, comme nous le faisions lorsque nous, ainsi que le Sénat, étions dans l'opposition. Et ensuite ? Allons-nous rediscuter de cela en deuxième lecture ? Nous serons alors au début du mois de décembre, une quarantaine de jours se seront écoulés.
J'attire donc l'attention du Gouvernement : il faut incontestablement aller plus loin, et je ne dis pas cela de gaieté de coeur mais, si nous voulons être crédibles, il faut regarder les choses en face.
Avant que nous ne votions l'amendement, je voudrais que la ministre nous éclaire sur les réflexions du Gouvernement. Les rumeurs courent Paris : pourriez-vous nous éclairer sur la suite du calendrier et l'ampleur des efforts à réaliser au-delà de cette économie de 1,5 milliard ?
Monsieur de Courson, nous sommes aujourd'hui dans une période de turbulences économiques et financières qui nous donnent très peu de visibilité sur l'avenir. Vous le savez, le Gouvernement est totalement réaliste, et il sera totalement sincère, comme il l'a été le 24 août : alors que la croissance du deuxième trimestre s'est avérée très faible, il a décidé de revoir ses prévisions de croissance et le Premier ministre a présenté aux Français un plan d'efforts supplémentaires de douze milliards d'euros pour sécuriser notre trajectoire de réduction des déficits. C'est pour nous un engagement intangible : nous réduirons nos déficits à 5,7 % en 2011, et à 4,5 % en 2012, pour atteindre 3 % en 2013. Chacune des étapes est cruciale, et c'est pourquoi le Premier ministre a réagi dès le coeur de l'été.
Nous avons réagi vite, avec sang-froid, avec lucidité, et avec finesse. Deux rendez-vous internationaux seront déterminants. L'un, de préparation, s'est tenu hier. L'autre se tiendra mercredi. Ces rendez-vous sont cruciaux pour l'Europe et pour la zone euro. Il s'agit de sauver la Grèce ; de renforcer le système bancaire européen ; de mettre sur pied un outil de financement de l'Union européenne permettant de combattre les spéculations et d'empêcher les risques de se propager dans l'Union européenne : le Fonds européen de stabilité financière ; et il s'agit enfin de renforcer la gouvernance économique de la zone euro, y compris peut-être en changeant les traités constitutifs de l'Union européenne.
Vous vous imaginez donc bien que les perspectives économiques de l'Europe seront différentes en fonction du succès du rendez-vous de mercredi. Attendons mercredi : au vu de la situation de l'Europe et de la zone euro, nous connaîtrons les indicateurs économiques qui concernent notre pays. Nous serons parfaitement sincères, je le répète, et s'il y a des efforts supplémentaires à faire, s'il faut réviser la prévision de croissance, nous le ferons et nous proposerons les efforts supplémentaires aux Français. Mais cela ne se fera pas dans la précipitation, mais avec sang-froid, et avec un dosage de mesures conforme à notre volonté de réduire les déficits et de soutenir l'emploi en France. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Comme tous mes collègues, je ne peux qu'être sensible à ce discours de responsabilité, et votre ton, madame la ministre, ne peut que toucher tous les parlementaires.
Mais vous avez utilisé le mot « sincérité », qui m'a amené à demander la parole à notre président de séance. Votre budget est fondé sur une prévision de croissance de 1,75 % pour l'année prochaine. Je ne sais pas qui y croit encore, probablement même pas vous. Au-delà de la valeur, notamment constitutionnelle, attachée au terme de sincérité, cette prévision n'est pas neutre. En effet, elle entraîne des recettes spontanées que l'État ne constatera pas si la croissance n'est pas de 1,75 %, mais de 1 %, voire moins.
Vous nous indiquez que vous vous adapterez. Peut-être faudrait-il s'adapter plus tôt et plus vite. À moins que vous n'espériez encore, pour l'année prochaine, une croissance de 1,75 %, je ne vous conseille pas de vous exprimer de la sorte dans cet hémicycle ; vous pouvez naturellement dire ce que vous voulez, mais autant nous avons apprécié la gravité de votre ton, autant nous douterions de votre sincérité si vous nous expliquiez qu'une prévision de 1,75 % vous paraît encore atteignable. Nous savons tous qu'il n'en est rien.
J'attire donc votre attention sur la question de la sincérité de la loi de finances. Il y a des connotations politiques derrière ce mot : on croit ou on ne croit pas un gouvernement et sa majorité ; mais il y a aussi une connotation constitutionnelle.
À ce jour, le Conseil constitutionnel n'a jamais censuré le moindre budget pour insincérité, et ce n'est pas faute d'occasions pour le faire, sous tous les gouvernements. Mais je ne suis pas sûr qu'une prévision de croissance ait été considérée comme aussi douteuse, y compris par des membres du Gouvernement. Des déclarations gouvernementales indiquent en effet clairement que la croissance de 1,75 % espérée l'année prochaine ne sera pas celle que nous constaterons.
Je ne vous demande donc pas davantage de précisions sur le calendrier, je comprends que la situation est extrêmement délicate à gérer, et il est hors de question d'ajouter de la confusion à la difficulté, mais convenez qu'il est troublant que vous vous apprêtiez à demander à l'Assemblée nationale le vote d'un budget fondé sur une hypothèse de croissance à laquelle en réalité plus personne ne croit.
(L'amendement n° 447 du Gouvernement est adopté.)

En conséquence, les amendements nos 208, 96 et 205 tombent.
(L'article 31 et l'état A annexé, amendés, sont adoptés.)

Nous avons terminé l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2012.
La Conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 auraient lieu le mardi 25 octobre, après les questions au Gouvernement.

Prochaine séance, mardi 25 octobre à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Vote solennel de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 ;
Discussion du texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011 ;
Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)
Le directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Nicolas Véron