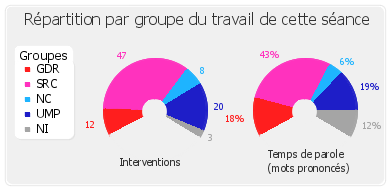Séance en hémicycle du 20 octobre 2009 à 21h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)


J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5, du règlement.
La parole est à M. Jérôme Cahuzac.

Madame la présidente, monsieur le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, monsieur le président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, mes chers collègues, le budget que nous examinons s'inscrit dans un triple contexte. En effet, il y a d'abord un contexte de crise, que les orateurs de la séance précédente ont abondamment rappelé. Ensuite, il y a le contexte futur du grand emprunt, qui rend l'examen de ce budget étrange puisque nous savons que ce n'est pas à cette occasion que nous traiterons de ces dépenses d'avenir, alors que c'est en principe toujours le cas. Enfin, il y a le contexte très particulier, bien qu'il n'ait pas encore été évoqué, de la moitié de la mandature du Président de la République – comme de la représentation nationale d'ailleurs. Ce contexte de mi-mandature amène légitimement les uns et les autres, en particulier l'opposition, à s'interroger sur le respect des engagements pris et des promesses faites par celui qui, à l'époque, n'était encore que candidat à l'élection présidentielle.
Je ne dirai qu'un mot du contexte de crise puisque vous, monsieur le ministre, ainsi que Mme Lagarde, le président de la commission des finances et le rapporteur général l'avez déjà abondamment évoqué. Quand on replace le projet de loi de finances dans ce contexte de crise, il faut éviter les simplifications hasardeuses et reconnaître ce qui a été fait quand cela correspondait à l'intérêt général. À cet égard, au moment où éclatait la crise financière la plus violente depuis la deuxième guerre mondiale, il fallait une réaction coordonnée, collective et puissante. Il faut reconnaître aux autorités des différents pays européens, notamment aux autorités françaises, qu'elles ont su mesurer la gravité de la crise, et, sous présidence française, d'avoir permis une telle réaction. Ne pas le reconnaître serait injuste, et cette injustice amoindrirait les critiques que l'on peut par ailleurs porter à la politique budgétaire du Gouvernement. Car si nous n'avons pas voté contre le plan de sauvetage de notre secteur bancaire et financier, nous ne l'avons pas non plus approuvé, pour des raisons dont l'année écoulée démontrent qu'elles étaient pertinentes. Je veux rappeler qu'elles étaient ces raisons.
Tout d'abord, nous estimions que s'il y avait une véritable urgence à rétablir les banques dans les responsabilités majeures qui sont les leurs dans le financement de l'économie, il y avait aussi une urgence économique et sociale, que ce plan-là ne traitait pas.
La deuxième raison pour laquelle nous n'avons pas voté ce plan, c'est qu'il nous a semblé qu'autant via la Société de financement de l'économie française que via la Société des prises de participation de l'État, les choix qui avaient été faits n'étaient pas les meilleurs possible.
Dans le cadre de la SFEF, c'est plus de 260 milliards d'euros que l'État s'était engagé à mobiliser pour garantir les actifs des banques – 93 milliards ont effectivement été engagés. Il s'agit de fonds levés avec la garantie de l'État et servant à refinancer les prêts bancaires avec en contrepartie, de la part des banques, des collatéraux, c'est-à-dire des actifs apportés en garantie. Or nul ne connaît la nature exacte et pas davantage la qualité des collatéraux garantissant ces 93 milliards d'euros de fonds publics. C'est un risque majeur qui a été pris à l'époque que de procéder ainsi. Aujourd'hui encore, nul ne sait si ces collatéraux sont de nature à gager les 93 milliards ou si tout ou partie de cette somme – vraisemblablement une partie – devra s'ajouter au stock de dettes déjà considérable que notre pays a constitué, qu'il s'agisse de la dette de notre système de protection sociale ou de la dette de l'État. C'est la première erreur commise, et elle persiste. En un an, un contrôle indépendant n'a porté que sur 1,2 milliard d'euros, soit une infime partie des 93 milliards. Certes, ce contrôle n'a rien révélé susceptible d'inquiéter quant à la nature des garanties apportées par les banques, mais comment affirmer qu'aucune inquiétude n'apparaissant à l'examen de 1,2 milliard d'euros, il faudrait n'en avoir aucune pour la somme entière ?
Je ne crois pas qu'il soit légitime d'écarter cette critique d'un simple revers de la main, d'autant que Eurostat estime que cette dette de 93 milliards, qui représente tout de même 5,4 % du PIB, doit s'ajouter au stock de dettes du pays. Le poids de notre dette s'alourdirait alors subitement de façon considérable. Or, comme l'a très justement fait remarquer le président de la commission des finances, en cas d'alourdissement subit et brutal de la dette publique française, c'est son financement qui finirait par poser problème : 0,1 point de spread de dégradation, c'est un milliard d'euros d'intérêts en plus. Je ne crois pas que nos finances publiques résisteraient durablement à un alourdissement brutal de 5,4 points de PIB du poids de la dette. C'est pourtant le risque que nous courons. Telle est la première critique.
La deuxième concerne la Société des prises de participation de l'État. Déjà, à l'époque, nous vous avions demandé, monsieur le ministre, non pas de vous contenter de prêts supersubordonnés ou d'actions préférentielles, mais bien d'entrer en bonne et due forme dans le capital des entreprises bancaires concernées. Certes, y entrer immédiatement était difficile, mais nous savons tous qu'il existe des moyens financiers et juridiques qui auraient permis de répondre à l'urgence tout en garantissant l'entrée de l'État au capital des banques. Or après une première tranche de 10,5 milliards d'euros de prêts supersubordonnés, puis une quinzaine de milliards d'euros d'actions préférentielles, qu'en est-il ? Certes, nous obtenons le remboursement des premiers et probablement la vente des seconds, avec toutefois une plus-value plafonnée à 20 %. Mais ni les prêts supersubordonnés ni les actions préférentielles ne donne à l'État un droit de vote ou la possibilité de désigner un représentant au conseil d'administration. En outre, l'échange avec des actions ordinaires n'est pas permis. Ce n'est pas la meilleure façon de protéger et de défendre les intérêts patrimoniaux de l'État. Celui-ci est présent au capital de la BNP pour 15,2 % et à celui de la Société Générale pour 7,2 %. Or, et c'est bien ce qui est choquant, de tels niveaux de participation, tout à fait considérables dans le capitalisme moderne, ne lui donnent ni droit de vote, ni droit de transformer ses titres en actions normales, ni droit aux bénéfices maintenant que l'action de ces entreprises est en train de se réévaluer.
À cet égard, nous avons clairement une divergence, Mme Lagarde ayant utilisé des termes à la fois impropres et inappropriés. Car parler de boursicotage quand il s'agit de 5 milliards, 10 milliards ou 15 milliards d'euros, est évidemment inadapté. Boursicoter, ce n'est pas manipuler de telles sommes. Quant à appeler « spéculer » le fait d'entrer dans le capital d'une entreprise pour ensuite, pour la seule défense des intérêts patrimoniaux de l'État, réaliser une plus-value dont son budget aurait bien besoin, c'est tout à fait scandaleux. De plus, c'est tenter de couvrir d'une justification morale ce qui, en fait, fut une erreur de gestion et une faute politique. Oui, notre budget, mes chers collègues, aurait bien eu besoin d'une plus-value de cession – je rappelle que l'État a déjà réalisé ce type d'opération. Personne ne suggérait qu'il reste de façon durable au capital de ces entreprises.

En revanche, il était normal, après que l'État et les contribuables eurent pris tous les risques, qu'ils puissent en tirer un certain bénéfice. Le président de la commission des finances a rappelé que le gouvernement de la Confédération helvétique, qui n'est tout de même pas animé d'un esprit collectiviste acharné, après avoir aidé UBS à hauteur de 5 milliards de francs suisses, en a tiré une plus-value de un milliard de francs suisses pour son propre compte, c'est-à-dire celui des contribuables. Cette rentabilité de 20 % n'était pas inenvisageable s'agissant des établissements bancaires de notre pays. Sachant que les prêts supersubordonnés et les actions préférentielles ont été souscrits pour un montant de l'ordre de 25 milliards d'euros, un taux de rentabilité de 20 % aurait donné 5 milliards d'euros.

Reconnaissez, monsieur le ministre, qu'une recette exceptionnelle de 5 milliards d'euros dans la présentation de votre budget n'aurait pas fait mauvaise effet. Vous êtes obligé de vous en passer car vous avez commis, je le répète, une erreur de gestion. Nous sommes dans notre rôle en la dénonçant. Vous êtes dans le vôtre en prétendant qu'il ne fallait point faire autrement. Le débat parlementaire sert à éclairer nos concitoyens. Ensuite, ce sera à eux de juger.
Nous pouvons considérer que la résolution de la crise financière est en bonne voie, mais cela ne règle en rien la crise économique et sociale que nous traversons. De ce point de vue aussi, ce budget est décevant. On en attendait beaucoup plus pour gérer la crise et la sortie de crise, mais aussi eu égard aux promesses, pas si lointaines, d'un candidat qui avait su, à l'occasion de sa campagne et après son élection, faire naître enthousiasme et confiance. Mes chers collègues de la majorité, chacun sait qu'à l'enthousiasme et à la confiance ont succédé le désenchantement, parfois même la colère si j'en juge par l'attitude et les demandes des agriculteurs, qu'il s'agisse des actifs ou des retraités, qui, une fois encore, ont été grugés par vos promesses. À ce désenchantement et à cette colère que répondez-vous ? Je ne le vois guère dans ce budget, monsieur le ministre des comptes publics. De cela aussi, les députés qui approuvent la politique du Gouvernement auront à rendre compte.
En effet, ce qui marque ce budget, c'est un déficit record, historique, l'enkystement d'injustices sociales, l'improvisation, l'amateurisme et un peu de désinvolture dans la présentation du projet de réforme de la taxe professionnelle ; c'est aussi beaucoup de faux-semblants avec la taxe carbone ; enfin, c'est une traite sur le futur avec un éventuel grand emprunt qui traitera des dépenses d'avenir le jour où le Gouvernement consentira à saisir le Parlement. Aujourd'hui, mes chers collègues, discutent et traitent du grand emprunt des citoyens certes responsables, mais qui ne sont pas élus de la nation, quand d'évidence ce rôle appartient d'abord et avant tout à la représentation nationale, et donc bien évidemment aux députés lorsque ceux-ci discutent du budget de la nation.
Vous le voyez, les qualificatifs que j'ai employés augurent mal du jugement que nous porterons sur ce budget aux déficits historiques : 8,2 % du PIB cette année, 8,5 % l'année prochaine ; 141 milliards en exécution en 2009, 116 milliards prévus en 2010. Les chiffres sont particulièrement inquiétants. Je rappelle qu'en 2001, le stock de dettes représentait un peu moins de 57 % du PIB, alors qu'à la fin de l'année 2010, il atteindra au moins 84 % du PIB. Tout cela montre la dégradation de nos finances publiques et devrait conduire à un vrai débat, et non pas à une caricature de discussion dont j'ai parfois eu le sentiment en vous écoutant, monsieur le ministre, qu'elle vous semblait préférable. Il ne s'agit pas de discuter la nécessité d'engager l'argent public pour traiter la crise. Tous les gouvernements du monde ont laissé filer leur déficit budgétaire, et, en France, tout autre gouvernement aurait, lui aussi, et probablement sous vos critiques, laisser filer le déficit budgétaire.
La question n'est donc pas de savoir s'il fallait ou pas laisser filer les déficits pour financer les plans de relance. Il fallait des plans de relance et donc, pour cela, il fallait alourdir la dette. Si nous vous critiquons, ce n'est pas parce que les déficits de l'État s'aggravent du fait de la crise, mais parce qu'auparavant, à la suite de mesures que ni la crise ni quoi que ce soit d'autre ne vous imposait de prendre, vous avez opéré des baisses de recettes pour l'État qui ont pesé lourdement lorsque précisément la crise s'est installée.
Le rapport de Gilles Carrez est éclairant sur ce point. J'engage les collègues que cela pourrait intéresser à se pencher sur les quinze ou vingt premières pages de ce rapport où il est expliqué que, depuis l'an 2000, les gouvernements successifs ont procédé à une centaine de milliards d'euros de baisse de recettes pour l'État et la sécurité sociale.
Nous devons y prendre notre part puisque les premières baisses de l'impôt sur le revenu et de la TVA furent opérées sous l'autorité du Gouvernement de Lionel Jospin. Ensuite les choses se sont emballées, c'est le moins que l'on puisse dire ! Si les deux premières mesures ont pesé et pèsent encore, ce sont surtout les suivantes qui ont supprimé des recettes qui font cruellement défaut actuellement et expliquent pour partie le déficit considérable auquel nous avons à faire face.
Certes, monsieur le ministre, la crise joue son rôle dans la baisse des recettes fiscales qui a frappé notre pays, mais ce que vous appeliez vous-même les baisses volontaristes d'impôt en joue un également. En gros, entre 40 et 45 % de la baisse des recettes fiscales proviennent des politiques que vous avez délibérément menées avant même que la crise ne fût là et n'impose quoi que ce soit : les baisses d'impôts opérées en 2006 sous le Gouvernement de Dominique de Villepin, la baisse de la TVA, le paquet fiscal.
On pourrait multiplier les exemples puisque depuis 2002, comme chacun sait, la dépense fiscale – les niches – ont augmenté de 25 milliards d'euros, passant de 50 milliards d'euros à 75 milliards d'euros. Notre État n'a plus les moyens de cette politique fiscale, monsieur le ministre. Nous en sommes tous convaincus.
Certains estiment que ces déficits ont une finalité – j'ignore si tel est votre cas, monsieur le ministre. En libéraux que vous avez toujours été et n'avez jamais cessé d'être, vous pensez que diminuer les ressources de l'État sans que la dépense publique ne baisse pour autant à due concurrence, cela revient forcément, à un moment ou à un autre, à pratiquer des coupes claires soit dans les services de l'État, soit dans les services de protection sociale, soit – ce que l'on peut craindre dans un proche avenir – dans les collectivités locales.
Vous êtes effectivement arrivé à vos fins et deux chiffres prouvent à quel point la situation est grave : nous en sommes à plus de 56 % du PIB de dépenses publiques pour des prélèvements obligatoires qui sont passés, en un an, de 42,7 % à 40,7 %. D'ailleurs, comme M. le Premier ministre il y a une quinzaine de jours, vous vous êtes réjoui de cette baisse des prélèvements obligatoires, indiquant que cette promesse-là aussi serait tenue par le Gouvernement, après avoir été faite par le candidat Nicolas Sarkozy.
Il ne faut quand même pas exagérer, mes chers collègues ! Nous savons tous que cette baisse des prélèvements obligatoires qui est intervenue entre 2008 et 2009 ne doit rigoureusement rien à des mesures que vous auriez pu prendre et tout à la crise. C'est l'impôt sur les sociétés qui, pour l'essentiel, explique cette baisse des prélèvements obligatoires, laquelle se parachève avec la décision extrêmement contestable de la baisse de la TVA dans la restauration.
Cette baisse de recette fiscale relève beaucoup plus du caprice d'un homme que de la volonté délibérée et consciente d'un Gouvernement et de sa majorité. Certains peuvent le dire ici quand d'autres doivent se contenter de le penser. En le déclarant à cette tribune, je crois ne pas beaucoup me tromper.
Cette baisse des prélèvements obligatoires ne doit donc rien à une quelconque politique menée et tout à la crise, pour le coup. Quoi qu'il en soit, entre la dépense publique – 56 % du PIB – et les prélèvements obligatoires – 40 %, du PIB –, il y a seize points d'écart. Mes chers collègues, le déficit de notre pays réside dans ces seize points d'écart.
En dépit de vos efforts, monsieur le ministre, je ne vois pas comment vous pourriez réduire la dépense publique à due concurrence des réductions des recettes fiscale auxquelles vous avez procédé – avec constance, je dois le reconnaître – depuis maintenant deux ans et demi que vous êtes ministre des comptes publics. En réalité le mouvement est engagé depuis 2002, depuis que cette majorité préside aux destinées du pays.
Ce déficit, mes chers collègues, il faudra bien envisager un jour la manière de l'apurer. Dans ce projet de loi de finances, dans les propos de M. Woerth ou ceux de Mme Lagarde, rien ne nous permet de comprendre la manière dont vous envisagez cette réduction.
Vous nous parlez de la croissance qui sera de 0,7 % l'année prochaine, le Premier ministre annonçant pour sa part un taux de 1 %. En 2007, avec une croissance du PIB de 2,4 %, l'État a continué à s'endetter. Les déficits ne se résorberont donc pas en 2010 ni au cours des années suivantes, car il faudrait pour cela une croissance beaucoup plus forte que celle que même les plus optimistes d'entre vous n'osent imaginer. La croissance ne suffira donc pas, tout en étant nécessaire. Nous l'appelons tous de nos voeux, même si, contrairement à vous, nous pensons que les politiques menées la préparent plutôt mal.
La croissance ne suffisant pas – et vous en avez conscience –, vous évoquez la fameuse réduction de la dépense publique, en citant en exemple la révision générale des politiques publiques, la RGPP.
Citons quelques chiffres éclairants. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre avait indiqué que 20 milliards d'euros seraient économisés durant la totalité de la mandature. Quand à vous, monsieur le ministre, vous avez indiqué que sept à huit milliards d'euros seraient économisés au titre de la RGPP, et pas un milliard de plus.

C'est certainement une bonne chose, encore que je voudrais modérer l'enthousiasme de certains. Si le non-remplacement du départ à la retraite d'un fonctionnaire sur deux permet d'économiser trois milliards d'euros sur la mandature, c'est exactement la dépense à laquelle vous avez consenti pour diminuer la TVA dans la restauration. Bref : avec une seule mesure et d'un seul coup, vous avez annulé la moitié d'efforts considérables !
En effet, nous sommes convaincus que réduire la dépense publique de sept à huit milliards d'euros en cinq ans – la durée d'une mandature – demande des efforts considérables. Ah, il vous faut certainement en tenir des réunions, monsieur le ministre ! Il faut en mobiliser des agents de la fonction publique d'État ! Il en faut des arbitrages, des notes, des expertises. Tout cela pour économiser sept à huit milliards d'euros dont la moitié s'en va dans une seule mesure : la baisse de la TVA sur la restauration qui, je le répète, fut décidée à la suite d'un caprice – l'actuel chef de l'État voulait démontrer qu'il faisait mieux que son prédécesseur, comme si la compétition continuait entre eux, pour le plus grand malheur de nos finances publiques et, je le crains, de notre pays.
La révision générale des politiques publiques ne suffira pas à réduire les déficits, monsieur le ministre. Quand on voit vos efforts pour parvenir à économiser huit milliards d'euros, comment considérer l'engagement du Président de la République à propos du grand emprunt, qui serait gagé sur une réduction de la dépense publique à due concurrence de son montant ? Ce n'est absolument pas vraisemblable.
Promettre 30, 50, voire 100 milliards d'euros – le chiffre a été prononcé à Versailles – de grand emprunt et un montant équivalent de réduction de la dépense publique, c'est tout simplement irréaliste, et faire prendre aux parlementaires des vessies pour des lanternes. Ce n'est évidemment pas ainsi que les choses se passeront.
Puisque ni la croissance ni la réduction de la dépense publique n'y suffiront, reste l'inflation. Il ne faut pas compter sur l'inflation, mes chers collègues. La Commission européenne a placé certains États sous surveillance, en déclenchant des procédures de déficit excessif. C'est la procédure qui précède, comme chaque fois, la remontée des taux de la Banque centrale européenne.
Ces taux vont remonter, provoquant un effet absolument redoutable dans la structure de notre dette puisque – le rapporteur général l'a parfaitement expliqué – nous avons fini de rembourser des emprunts à moyen et long terme en empruntant sur du court terme. Ce sont ces taux-là qui vont remonter.
Nous allons subir un alourdissement du service de la dette qui sera totalement insupportable, toutes choses égales par ailleurs : il pourrait atteindre 20 milliards d'euros en 2013, et on peut craindre qu'il ne soit plus important encore et à une échéance plus brève, ce que je ne souhaite naturellement pas. Cependant, puisque gouverner c'est prévoir, je trouve surprenant que ce projet de budget n'envisage en rien cette hypothèse certes funeste pour le pays, mais néanmoins non irréaliste.
La croissance ne suffira pas ; la réduction de la dépense publique ne suffira pas ; nous ne pouvons pas compter sur l'inflation. En outre, que je sache, dans des pays modernes et des organisations mondiales telles que les nôtres, la répudiation de la dette ne se fait pas. La dernière fois, il s'agissait des emprunts russes. Je vois mal le président Sarkozy répudier la dette du pays.
Quelle est la conséquence de tout cela ? Il faudra que les impôts y pourvoient. C'est le deuxième débat auquel nous devons nous prêter, là encore sans caricature. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut de la croissance ou des impôts. Il faudra la croissance et des impôts, monsieur le ministre. Faire croire que nous voulons des impôts au risque de tuer la croissance serait aussi caricatural que si nous pensions que, sincèrement, vous imaginiez que la croissance au cours des quatre à cinq ans à venir suffira à rembourser les dizaines de milliards d'euros que le Gouvernement auquel vous appartenez emprunte maintenant et avec constance chaque année depuis 2007.
Parce que nous sommes convaincus qu'il faudra les deux – la croissance et les impôts –, nous estimons qu'il existe un préalable : la justice fiscale. Sans cela, nos concitoyens n'accepteront pas de prélèvements supplémentaires qui, pourtant, seront nécessaires pour que notre pays puisse apurer ses comptes publics. À défaut, comme le dit la Cour des comptes, la dette deviendra incontrôlable, ce qui compromettra toute politique publique, quel que soit le Gouvernement qui voudrait la mettre en oeuvre.
Apurer les comptes publics par les impôts, en espérant la croissance et en ayant, au préalable, réduit l'enkystement de l'injustice fiscale, suppose que vous preniez certaines mesures courageuses : il vous faudra revenir sur des dispositions que vous avez adoptées dans l'enthousiasme de l'été 2007. Toutes les majorités ont connu ces enthousiasmes durant l'été suivant une victoire politique ; toutes en sont revenues.
Il faudra revenir sur ce qu'on a appelé le paquet fiscal de l'été 2007 pour une raison très simple : il est injuste et inefficace. Cette année, les heures supplémentaires ont coûté trois milliards d'euros. Il n'y a pas plus d'heures supplémentaires effectuées ; il y en a même plutôt moins. Imaginez que le nombre d'heures supplémentaires est à peu près le même cette année avec une récession de 2,25 % qu'en 2007 avec une croissance de 2,4 % !
Les entreprises dont les salariés bénéficient d'heures supplémentaires défiscalisées et désocialisées et celles qui sollicitent l'État pour indemniser le chômage partiel sont les mêmes. L'État paie deux fois : pour les heures supplémentaires et pour le chômage partiel, alors qu'incontestablement une partie du chômage partiel est évidemment due aux heures supplémentaires. Cette politique de Gribouille coûte trop cher pour être maintenue.
Il en va de même pour les mesures relatives aux successions qui coûteront deux milliards d'euros cette année, alors qu'objectivement notre économie n'en tire que peu ou pas de bénéfices.
Quant à la déductibilité des intérêts d'emprunt pour les primo-accédants, on sait désormais – analyse de la Cour des comptes à l'appui – qu'elle n'est qu'une subvention déguisée aux banques, dont ne profitent en rien les primo-accédants.
Enfin, il y a ce fameux bouclier fiscal qui n'est pas la mesure la plus onéreuse mais la plus symbolique. Sur ce sujet, je trouve votre position étonnante, monsieur le ministre, et les propos du Président de la République peu crédibles.
À supposer que l'un de nos concitoyens, protégé par votre bouclier fiscal, paie une taxe carbone supérieure à la restitution forfaitaire que vous avez consentie. Estimez-vous, monsieur le ministre, que le bouclier fiscal sera écorné pour autant ?
Vous avez parlé des comptes de la sécurité sociale et nous savons que vous avez l'intention de taxer les retraites chapeaux. Si le responsable d'une banque, par ailleurs bénéficiaire du bouclier fiscal, se voit attribuer une retraite chapeau. Celle-ci pourra-t-elle taxée ou bien son bénéficiaire sera-t-il protégé par le bouclier fiscal ?
Ces seuls exemples démontrent que vous ne pourrez pas conserver le bouclier fiscal en l'état, chers collègues de la majorité. D'une certaine manière, le ministre des comptes publics vous indique bien la marche à suivre. Il sait que l'existence du bouclier fiscal empêche d'augmenter les impôts. Tant que le bouclier fiscal existe, toute augmentation des impôts serait perçue comme injuste et illégitime par nos concitoyens.
Madame la ministre de l'économie, monsieur le ministre, vous avez donc le choix : soit vous vous reniez sur le bouclier fiscal et vous apurez les comptes, soit vous restez sur vos positions actuelles…

…en faisant courir un risque à nos finances publiques, celui de l'emballement de la dette que la Cour des comptes a parfaitement démontré. Vous ne sortirez pas de cette équation, et vous pouvez compter sur nous pour vous la rappeler chaque fois que l'occasion se présentera…

… car c'est notre rôle d'opposant que de le faire.
D'autres orateurs s'exprimeront abondamment sur la réforme de la taxe professionnelle et sur la taxe carbone, mais j'en dirai un mot pour conclure. Objectivement, on peut résumer ainsi la réforme de la taxe professionnelle : un peu d'improvisation, pas mal d'amateurisme et beaucoup de désinvolture dans la façon dont le Parlement fut saisi de ce projet.
Les erreurs commises, bien connues, ont vicié le projet gouvernemental. Nous étions favorables, conformément aux préconisations du rapport de MM. Balligand et Laffineur, à un allégement des charges pour les entreprises industrielles, mais n'en voyions pas l'intérêt, pas plus que nous ne le voyons aujourd'hui, pour les entreprises de services, qu'il s'agisse des banques, des compagnies d'assurance ou de la grande et moyenne distribution. Ces entreprises-là, mes chers collègues, ne font en effet courir aucun risque de délocalisation à leurs salariés. Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous avez étendu cette mesure à leur profit. Voilà ce qui déséquilibre financièrement ce projet de loi de finances.
Enfin, qui trop embrasse mal étreint. Votre volonté de spécialiser les impôts locaux a conduit le rapporteur général – ce qui est une première sous la Ve République – à réécrire intégralement un article du projet de loi de finances, lequel faisait quand même, excusez du peu, soixante-deux pages.

…et j'espère que l'ensemble de la représentation nationale y sera sensible.
Le débat n'est donc pas de savoir si l'on veut ou non réformer la taxe professionnelle. Un consensus s'était en effet dégagé au sein de la commission des finances sur la nécessité d'une telle réforme, mais sur la base du rapport « transpartisan » de Jean-Pierre Balligand et Marc Laffineur. Vous avez voulu vous en exonérer pour aider des entreprises qui n'en ont pas besoin et pour spécialiser les impôts locaux, malgré l'absence d'études et de simulations sur le sujet. Ces deux erreurs doivent être corrigées ; j'espère qu'elles le seront par la représentation nationale, et pas seulement par le Sénat – à qui, nous le savons, le Gouvernement souhaite donner le beau rôle en laissant croire que les députés n'ont pas conscience des enjeux territoriaux.

Un dernier mot, madame la présidente, sur ce faux-semblant qu'est la taxe carbone. Celle-ci serait la vingt-troisième taxe, chers collègues de la majorité, que vous adopteriez depuis 2007. Cette mesure doit être mise en regard de la baisse des prélèvements obligatoires, dont j'ai montré ce qu'il fallait penser. En réalité, les impôts ne diminuent pas, et les taxes s'accumulent. Votre imagination est décidément très grande, puisque vous vous apprêtez à taxer le carbone après avoir taxé les poissons, les crustacés et les mollusques.
J'espère enfin que nous aurons un vrai débat sur le grand emprunt ; nous estimons en tout cas que la révision du paquet fiscal et de la baisse de TVA octroyée à la restauration, ainsi que la taxation exceptionnelle des bénéfices des banques – car elles en font –, rapporteraient entre 10 et 15 milliards d'euros et permettraient sans doute d'éviter un nouveau grand emprunt, c'est-à-dire des impôts supplémentaires pour les générations futures ; faute de quoi nous pourrons considérer que la majorité du Président Nicolas Sarkozy les aura spoliées. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)

La parole est à M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Avant de demander à la majorité de rejeter, dans son infinie sagesse, la motion de rejet préalable, je souhaite répondre à Gilles Carrez et à Didier Migaud.
Je partage largement l'analyse de Gilles Carrez sur l'état de nos finances publiques et la nécessité de maîtriser les dépenses. Nous savons tous, d'ailleurs, qu'il est plus facile de le dire dans cette enceinte que de le faire. Nous avons clairement montré notre volonté en ce domaine, notamment avec le respect de l'ONDAM, ce dont il n'y a pas lieu de se glorifier mais de se réjouir. Par ailleurs, les dépenses publiques ont crû de 1 % en volume, contre 2,1 % en moyenne par le passé.
Nous devons débattre de l'inclusion de la dépense publique locale dans la dépense publique générale, puisque la première entre dans les critères de déficit public définis par le traité de Maastricht. C'est donc chaque augmentation de dépense qui doit être discutée, quels que soient ceux qui l'engagent.
Je souscris également, monsieur le rapporteur général, à l'impératif de lucidité que vous avez évoqué. Nous sommes lucides sur la situation actuelle et mettons en oeuvre les moyens d'y remédier ; mais nous ne partageons pas les solutions préconisées notamment par les députés de gauche.
Nous sommes bien sûr tout à fait d'accord sur l'exigence de rentabilité, pour « l'entreprise France », de cette dépense d'avenir qu'est le grand emprunt : cette rentabilité, nous devons la démontrer et en discuter. J'ai conscience que la dette est importante, et M. le rapporteur général a eu raison d'appeler à nouveau notre attention sur le sujet. Mais, il faut le rappeler car les Français ne le savent pas toujours, cette dette, bien que très élevée, est en moyenne inférieure à celle de certains de nos partenaires de l'OCDE ou de l'Union européenne. Christine Lagarde et moi avons beaucoup eu recours aux comparaisons internationales, car elles posent des repères. Nous n'y puisons aucun motif de nous satisfaire ou de nous rassurer ; mais, dans un monde ouvert, il est utile de nous situer par rapport à d'autres pays. Dans vos propres collectivités, ne regardez-vous pas vous-mêmes où en est la ville, le département ou la région d'à côté ?
Quant à l'Allemagne, seul sujet de convergence entre le rapporteur général et le président de la commission, son déficit, selon les différents instituts et les prévisions du Gouvernement, ne diminuera pas l'an prochain ; il augmentera même un peu. Parmi les recettes, assez spectaculaires, récemment mises en oeuvre pour réduire les déficits publics, figure par exemple le gel des retraites pendant plusieurs années : est-ce une bonne idée aux yeux du parti socialiste ?
Va pour le gel des retraites des Allemands, me direz-vous ; mais pour celles des Français ? Je ne suis pas sûr que vous soyez du même avis. (« C'est M. Carrez qui en a parlé ! » sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
Notre débat sur le plan de relance, monsieur le président de la commission, ne date pas d'hier. Vous avez critiqué ce plan et suggéré que nous nous étions trompés, tant sur le volume des dépenses que sur les orientations. Je considère pour ma part que ce n'est pas le cas, et ce pour deux raisons. Il est vrai que les transferts sociaux ont permis le maintien de la consommation, mais ils ont augmenté en 2009 de 6 %, contre 2 % auparavant, soit trois fois plus vite. Quelle en est la raison ?
Cette augmentation, monsieur Brard, ne doit en effet rien au Saint-Esprit : elle tient à la volonté du Gouvernement de soutenir les Français les plus fragiles via les principales prestations sociales. Nous avons eu raison d'insister aussi sur l'investissement : on en voit les bénéfices pour les collectivités, l'État et les entreprises.
En revanche, monsieur le président de la commission, ni vous ni votre groupe n'avez proposé grand-chose, sinon d'augmenter les impôts de 10 milliards…
…en revenant sur les droits de succession, la défiscalisation des heures supplémentaires, le bouclier fiscal ou la baisse de la TVA pour les restaurateurs. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Je respecte toutes les convictions, mais ce ne sont pas les nôtres.
Certes, les comptes sociaux ont été équilibrés dans les années 2000, mais ils l'ont été sans que vous ne preniez aucune décision pour cela. (Mêmes mouvements.)
En l'occurrence, la seule décision à prendre aujourd'hui est de diminuer la dépense. Vous avez bénéficié d'une croissance tout à fait exceptionnelle, ce dont je vous félicite (Mêmes mouvements),…
…mais vous n'avez pas réduit les dépenses de la sécurité sociale, alors que le contexte aurait dû vous y engager. En 2000 et en 2001, l'ONDAM a ainsi progressé de 5,6 %, et celui de 2002, que vous aviez préparé, de 7,1 %. Voilà la réalité ! Vous auriez dû, comme vous le demandait l'opposition de l'époque, profiter de ces années de vaches grasses en termes de recettes pour mieux canaliser les dépenses de l'assurance maladie. Que cette réalité vous déplaise est une chose, mais c'est ainsi.

Un déficit de 30 milliards d'euros pour la sécurité sociale en 2010 : voilà la réalité !
Quant à la TVA réduite pour la restauration, monsieur Cahuzac, elle n'est pas le caprice d'un homme mais le respect d'un engagement politique pris devant les Français par le Président de la République précédent et par le Président de la République actuel lors de sa campagne électorale. Ne pas adopter cette mesure alors que s'ouvrait sa possibilité juridique eût consisté à renier des engagements et à briser la confiance de nos concitoyens dans l'action politique. Or la répudiation des engagements, chers députés socialistes, n'est pas plus envisageable que celle de la dette.
Vous parliez, monsieur Cahuzac, du culte des libéraux pour les déficits ; mais je n'en suis pas un, et n'ai donc aucun culte en ce domaine. J'imagine d'ailleurs que Christine Lagarde ne partage pas non plus cette idée. Nous sommes, plus simplement, extraordinairement mobilisés dans un contexte très difficile. L'augmentation des impôts, comme celle de la dépense ou sa maîtrise, à vous entendre, ne suffiraient jamais : en somme, selon vous, rien ne fonctionne. Mais il n'y a pas de fatalité, et les recettes que nous proposons peuvent apporter des solutions.
Il n'y a pas davantage de désinvolture sur la taxe professionnelle, à moins de considérer qu'interroger le Parlement est désinvolte – ce qui, passez-moi l'expression, est un peu gonflé.
Le Gouvernement ne propose rien d'autre au Parlement que de modifier le projet s'il le souhaite. La commission des finances, et notamment son rapporteur général Gilles Carrez, ont travaillé de façon remarquable pour trouver des solutions avec le Gouvernement. Un tel dialogue entre l'exécutif et le législatif est tout sauf de la désinvolture.
Au fond, monsieur Cahuzac, quand les impôts baissent, vous n'êtes pas content, et quand nous créons des taxes – puisque vous nous reprochez d'en avoir créé vingt-trois – non plus. Bref, j'invite l'Assemblée à rejeter la présente motion. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Nous en venons aux explications de vote sur la motion de rejet préalable.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que chaque orateur dispose de deux minutes.
La parole est à M. Dominique Baert, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Madame la présidente, madame la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'intervention de notre talentueux collègue Jérôme Cahuzac a bien montré que l'injustice était au coeur du projet de loi de finances pour 2010.

La première injustice est pour les générations futures, tant l'État s'enfonce, année après année, dans les déficits. La réalité des chiffres est là, dure, brutale et abyssale : en trésorerie, le Gouvernement emprunte à court terme autant que ce qu'il dépense.
La crise de liquidités est à tout instant possible, et la spirale du surendettement est enclenchée. Pour les cadeaux fiscaux octroyés aux plus riches et aux entreprises, le Gouvernement est cigale ; mais, les Français doivent le savoir, les dépenses d'aujourd'hui cachent les impôts de demain, lesquels seront à la mesure des déficits actuels, c'est-à-dire lourds et de surcroît indirects, donc injustes.
L'injustice est aussi dans les 100 000 emplois publics détruits depuis 2007, à commencer par ceux de l'État. Le premier plan social de France, c'est le Gouvernement et sa majorité qui le conduisent.
Injustice encore, et surtout, par les mesures fiscales de ce projet de budget. Tout d'abord, vous gonflez les cadeaux aux entreprises et à leur profitabilité, et ce au détriment de finances publiques déjà exsangues. Aux 2,4 milliards d'euros de baisse de la TVA de la restauration, vous ajoutez 12 milliards d'euros, avec la suppression de la taxe professionnelle, et 700 millions d'euros, avec la suppression de l'impôt forfaitaire annuel. Vous chargez vraiment la barque ! En matière d'impôts, les ménages paient, et les entreprises s'allègent.
Injustice, surtout, avec le refus de revenir sur le bouclier fiscal, qu'un collègue de la majorité qualifiait la semaine dernière de « super niche fiscal » et dont un autre reconnaissait qu'il était un « paradis fiscal à domicile ». Avec ce bouclier fiscal, vous avez fait de notre pays un lieu de défiscalisation pour les revenus les plus élevés, des contribuables aisés de certains quartiers recevant de l'administration fiscale des chèques de plus de 150 000 euros. Face aux déficits et alors même que les recettes fiscales s'effondrent, est-ce tolérable ? Non ! Est-ce juste ? Franchement, non ! Tout cela doit être sanctionné. C'est pourquoi…

… le groupe socialiste, radical et citoyen votera avec conviction en faveur de cette motion. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Je voudrais cependant appuyer de toutes nos forces, qui ne sont pourtant pas sans limites, les propos, tout à fait brillants, cela a déjà été dit, de Jérôme Cahuzac.
Je déplore, monsieur le ministre, la trivialité dans laquelle vous sombrez. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) Dans trois siècles, on se souviendra certainement de Molière, mais on aura oublié Sarkozy depuis longtemps ! Lorsque je vous entends, je songe à Albert Simon, qui donnait les prévisions météorologiques sur France Inter. Comment faisait-il donc ? Il regardait sa grenouille dans son bocal, après quoi il expliquait aux auditeurs le temps qu'il allait faire. Vous faites la même chose.
L'an dernier, monsieur le ministre du budget, madame la ministre de l'économie, vous aviez prévu un déficit de 55 milliards d'euros. Voici qu'il atteint le montant de 141 milliards d'euros ! Pour l'an prochain, vous prévoyez un déficit de 116 milliards d'euros. Faites les comptes : nous dépasserons, si je procède de manière plus scientifique qu'Albert Simon et en me fondant sur l'expérience qui est la nôtre, le montant de 200 milliards d'euros.
Pour leur part, les transferts sociaux constituent un excellent indicateur de la nocivité de votre politique. S'il faut effectivement consentir, aujourd'hui, des transferts sociaux, c'est parce que vous appauvrissez les Français. Dans nos quartiers, nous sommes confrontés à la misère et au désespoir. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Qui se frotte les mains ? Les membres de la Fédération bancaire française, pour lesquels vous avez les yeux de Chimène et qui, égoïstes, ne savent pas toujours vous remercier comme vous le souhaiteriez !
Vous avez dit, monsieur le ministre, que vous ne reviendriez pas sur les diminutions d'impôt…

Je termine, madame la présidente.
Lorsque nous reviendrons (Exclamations sur les bancs du groupe UMP), nous reviendrons sur les diminutions d'impôts, nous ferons payer les privilégiés et nous donnerons du pouvoir d'achat pour relancer l'économie, comme cela se fit en 1997. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)

La parole est à M. Jérôme Chartier, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

J'ai bien entendu ce qu'a dit tout à l'heure M. Cahuzac mais je songe aussi aux propos tenus par M. Migaud. Il disait que nous aurions, dans cet hémicycle, un débat de qualité, même s'il allait, certes, porter sur un projet de loi de finances difficile. Effectivement, personne n'est heureux de savoir que le déficit s'élève à 116 milliards d'euros, et chacun sait pourquoi nous parvenons à un tel montant.
C'est pourquoi, lorsque j'entends l'orateur du groupe socialiste prononcer les mots « désinvolture », « amateurisme » et « caricature », …

… je ne retrouve pas – pardonnez-moi – les termes employés par Didier Migaud. Je voudrais que nous ayons un débat sérieux et construit, non un débat fait de chiffres lancés à la volée.
J'entends, par exemple, que, selon le rapport de Gilles Carrez, les recettes n'auraient pas progressé depuis l'an 2000. Prenons donc ce rapport. En page 85, j'y lis que le montant de la TVA nette affectée au budget général, qui était de 104 milliards d'euros en 2000, s'élève à 129 milliards d'euros en 2008. Cela ne progresse-t-il donc pas ? En page 77, je lis, cette fois, que le montant de l'impôt sur le revenu est passé de 53 milliards d'euros en 2000 à 59 milliards d'euros en 2008. Où donc les recettes ne progressent-elles pas ? Il est vrai qu'il faut poursuivre la lecture du rapport au-delà de la vingtième page. En page 80, enfin, je lis que le produit de l'impôt sur les sociétés est passé, entre 2000 et 2008, de 37 milliards d'euros à 49 milliards d'euros.
De même, lorsque j'entends que la taxe carbone est la vingt-troisième que nous allons voter, je me demande où sont les vingt-deux taxes précédentes.
Soyons donc précis. Soyons sérieux. Si vous voulez du sérieux et de la précision, je peux d'ailleurs vous fournir le chiffre de 14,4 %. De quoi s'agit-il ? C'est simplement le taux d'augmentation des salaires, entre 2008 et 2009, dans toutes les régions gérées par les socialistes. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

N'importe quoi !
(La motion de rejet préalable, mise aux voix, n'est pas adoptée.)

Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 58 du règlement de l'Assemblée nationale.
On nous a beaucoup fait travailler, au cours des derniers mois, sur la revalorisation du rôle du Parlement et sur l'organisation de nos travaux ; les temps de parole ont ainsi été plafonnés à deux minutes car l'opposition, paraît-il, parlait trop. Or que constatons-nous ? Le projet de loi de finances est débattu dans cet hémicycle au moment même où la commission des affaires sociales – je m'exprime sous le contrôle du président Méhaignerie – examine le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous ne pouvons pas travailler sur les deux sujets en même temps ! C'est impossible ! Je mets quiconque au défi de contredire l'affirmation selon laquelle un député normalement constitué pourrait s'intéresser au projet de loi de financement de la sécurité sociale sans s'intéresser au projet de loi de finances. Il existe un lien évident entre les deux textes, mais nous ne pouvons travailler en même temps sur les deux.
Par ailleurs, quelle plus belle incitation à l'absentéisme que l'organisation des deux discussions en parallèle ? Ceux qui nous regardent se demandent où sont les députés. Ils sont en commission des affaires sociales, en train d'examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ces méthodes de travail ne sont pas admissibles. Je pense que, au lieu de ne penser qu'à minuter le temps de parole de l'opposition, vous feriez mieux d'organiser ces travaux de manière qu'ils puissent être de qualité. Nous ne pouvons travailler plus longtemps dans de telles conditions.
Je vous demande, madame la présidente, de transmettre cette demande à M. le président de l'Assemblée nationale, pour que la conférence des présidents organise nos travaux de telle sorte que nous puissions suivre tous ces textes également importants. Ce n'est pas impossible, c'est même assez simple. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

J'ai bien entendu votre réclamation, monsieur Mallot. Je la transmettrai bien évidemment au président.
Pour autant, en tant que parlementaire très expérimenté, vous savez, comme beaucoup d'entre nous, que c'est la Constitution qui fixe les délais d'examen tant du projet de loi de finances que du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous procédons ainsi.

Et le retard du Gouvernement ? Vous ne pouvez pas répondre n'importe quoi !

Franchement, madame la présidente, vous ne pouvez pas répondre ce que vous avez répondu : vous ne pouvez pas prétendre que c'est la Constitution qui conduit à introduire des conditions de travail totalement dégradées, pour ne pas dire dégradantes pour le Parlement et sa crédibilité !
On s'interroge sur l'absence des députés. On pourrait imaginer qu'ils ne s'intéressent pas à l'examen du projet de loi de finances. Cependant, en même temps que se tiennent un débat et un vote importants, est examinée en commission l'autre loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale. Ne me dites pas que cela résulte de la Constitution !

Dans le prolongement de ce que je disais ce matin en conférence des présidents et dont M. le président de l'Assemblée nationale, absent, avait été informé, je demande que l'on se penche sérieusement, au cours des prochaines semaines, sur les conditions de travail de l'Assemblée nationale. On pourra dire tout ce que l'on voudra, vanter les mérites de la révision constitutionnelle donnant des droits au Parlement et parler d'un « hyper Parlement », je ne vois rien de tel ! Je constate, au contraire, chaque semaine, une dégradation des conditions de travail, tandis que l'antiparlementarisme gagne du terrain. Or cette façon de travailler ne peut que faciliter la montée de l'antiparlementarisme, dégradante pour la démocratie.
C'est donc un problème sérieux que M. Mallot a soulevé. On ne peut y répondre en se prévalant de la Constitution.
J'espère bien, madame la présidente, que vous transmettrez cette demande au président Accoyer. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur Ayrault, je vous répète ce que j'ai dit à M. Mallot : je transmettrai, bien évidemment, votre demande au président Accoyer…

Si vous le voulez bien, monsieur Emmanuelli, je termine mon propos.
Je transmettrai votre demande, monsieur Ayrault, mais, vous le savez comme moi, des délais sont fixés. Ces projets de loi doivent donc être votés avant la fin de l'année, et ils doivent également être examinés par le Sénat.

Le Gouvernement est en retard ! Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, ne parlez pas !

Je voudrais préciser à MM. Mallot et Ayrault que ce n'est pas la première fois que des débats en séance publique se tiennent en même temps que des débats en commission. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
En outre, Rome ne s'est pas faite en un jour. La réforme des institutions visant évidemment à une meilleure organisation des travaux de l'Assemblée, je suis certain, monsieur Ayrault, que vous serez entendu. Cela dit, si vous êtes si intéressé que cela par l'examen du projet de loi de finances en séance publique, je suis sûr que l'on vous verra dans cet hémicycle jusque samedi pour participer aux débats, séances de nuit comprises. Vous pourrez ainsi montrer à l'Assemblée nationale tout votre intérêt. (Protestations sur les bancs du groupe SRC.)

Ce que vous avez dit, monsieur Chartier, est inadmissible.
On nous a vanté une réforme donnant de nouveaux droits au Parlement, mais je les cherche en vain. Je constate, en revanche, un mépris de l'opposition, auquel vous-même avez contribué jeudi dernier. Je ne vous ai pas vu, alors, débattre avec nous.
Vous prétendez sans cesse que l'opposition n'aurait rien à proposer. Nous avons pourtant passé une journée complète à faire des propositions, et vous avez refusé le débat ! Où est donc l'amélioration des droits du Parlement ? Je crois, franchement, que vous faites fausse route. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) La situation est dégradante pour l'Assemblée nationale, et nous avons eu raison de voter contre votre révision constitutionnelle, qui n'était tout simplement que du vent !

Nous retournons en commission ! Nous reviendrons pour le vote ! (M. Mallot et d'autres députés du groupe SRC quittent l'hémicycle.)

Je ne m'exprimerai que quelques instants, pour insister sur un point important, avant de repartir en commission.
S'agissant de ces projets d'« amélioration » du travail parlementaire, je voudrais souligner que les citoyens nous observent. Ce soir, ne sachant pas que de nombreux parlementaires sont en commission, ils portent sur nous un regard très négatif.
Je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est passé jeudi. Les personnes présentes dans les tribunes du public ne comprenaient rien à ce qu'elles voyaient : en nombre de présents, l'opposition était largement majoritaire, dans un hémicycle à moitié vide, où ne siégeaient que quatre députés du groupe UMP. Voilà qui donnait une très mauvaise image du Parlement ! Il faut donc que nous nous penchions très sérieusement sur l'organisation de ses prochains travaux.

Monsieur Roy, il a été répondu au président Ayrault que le problème survenu jeudi dernier, auquel vous faites allusion, serait examiné en conférence des présidents, en présence du président Accoyer. Je pense donc que le débat sur le sujet est clos.

J'ai reçu de M. Jean-Claude Sandrier et des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6, du règlement.
La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

Je voudrais mettre mon grain de sel dans le débat qui vient d'avoir lieu. Si nous sommes dans la situation présente, c'est de la faute du Gouvernement ! Nul n'est besoin d'être très ancien sur ces bancs pour se rappeler que la discussion du projet de loi de finances commençait naguère quinze jours plus tôt. Cependant, sous la houlette de Sa Majesté impériale, le Gouvernement est en proie à l'agitation du 1er janvier au 31 décembre, même si son rendement est faible et son efficacité aléatoire et incertaine. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation tout à fait désagréable.
Nous sommes réunis pour discuter le projet de loi de finances pour l'an prochain. Cela a été amplement démontré, la situation de nos finances publiques, la préparation et la discussion du PLF et du PLFSS pour 2010 sont marquées par les effets dévastateurs pour nos concitoyens de la crise du capitalisme financiarisé et mondialisé dans laquelle ce dernier a plongé le monde – pas seulement les États-Unis. Ce capitalisme dont Nicolas Sarkozy, discours après discours, G 20 après G 20, nous annonce sans relâche la moralisation prochaine, comme s'il y croyait !
En outre, depuis quelques semaines, on voit à nouveau s'agiter les théoriciens de l'économie libérale, qui n'ont que le mot « reprise » à la bouche, confortés dans leur vision dogmatique par la hausse des cours de la Bourse et le redémarrage des profits de grandes entreprises, tout particulièrement des banques, ce qui suffit à les enchanter.
En revanche, nos compatriotes ne voient poindre aucune amélioration de leur quotidien et nos finances publiques et sociales sont naufragées parce que vous les avez siphonnées.
Cette fausse sortie de crise est dangereuse et entraîne ceux qui n'attendaient que cela sur la voie du laxisme et du retour aux errements de naguère. N'insistons pas sur les rodomontades habituelles du Président de la République qui a claironné, dès avant le G 20 de Pittsburgh : « Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé ». Après le sommet, il a ajouté – je le cite encore, et ce pour la troisième fois ! – que « le monde s'était doté d'une nouvelle instance de pilotage de l'économie mondiale ». « Nous avons décidé », a-t-il encore déclaré « de faire du G 20, dont les membres représentent 85 % du PIB mondial, l'instance principale de coordination économique. »
Le G 20, structure autoproclamée qui n'a pas d'existence juridique, ne tire donc sa légitimité ni des peuples ni du droit international, mais, d'après Nicolas Sarkozy, du volume des produits intérieurs bruts de ses membres. Les vieilles erreurs sont toujours là, particulièrement avec le culte du PIB comme étalon suprême de la qualité d'un État.
Les impasses et les faux-semblants du G 20 de Pittsburgh ont pourtant été analysés et soulignés par des économistes. Dans le supplément économique du Monde du 6 octobre dernier, M. Paul Jorion, commentant la formule du G 20 appelant à « tourner la page d'une ère d'irresponsabilité » écrit : « Irresponsabilité de qui ? Qu'il s'agisse des dirigeants des banques ou des politiques, chacun demeure à son poste. S'il s'agit bien d'irresponsabilité, les mêmes irresponsables sont toujours aux commandes. »
Le même économiste évoque ensuite un autre voeu pieux du G 20 : « Veiller à ce que nos systèmes de régulation des banques et des autres établissements financiers contiennent les excès qui ont conduit à la crise ». Et il questionne fort justement : « Sont-ce les excès de ce système qui ont conduit à la crise ou ne sont-ce pas plutôt les principes qui constituent son essence même, comme la recherche du profit immédiat ? »
Voilà une question intéressante. Vous allez être étonnés, mes chers collègues, mais le Président de la République, dont je parle pour la quatrième fois , se pique maintenant de philosophie – on ne peut s'empêcher de penser au Bourgeois gentilhomme de Molière – et il parle même de « transcendance ». Personne n'a eu la cruauté de lui demander d'écrire sur un papier ce que cela voulait dire. Pourtant, on aurait dû !
Avouez, madame la ministre, monsieur le ministre, que les questions posées par Paul Jorion sont tout à fait pertinentes. Je pense que les gens qui dirigent notre État confondent…

Si, ma chère collègue, je vous l'assure ! Vous connaissez sans doute l'histoire du doigt et de la lune… L'imbécile regarde le doigt au lieu de regarder la lune ! Sauf que les gens qui nous dirigent ne sont pas des imbéciles…C'est un crime prémédité, non un acte commis par inadvertance ou sans intention.
Vous savez ce que vous faites, mesdames et messieurs de la majorité. Vous êtes ici et ceux que vous représentez sont là-bas, à la tête des grands groupes. Ils s'appellent M. Lombard, M. Carlos Ghosn, M. Beaudoin Prot… On pourrait égrener bien des noms encore, comme un chapelet. Je vous renvoie, mes chers collègues, à la lecture de Challenges ou de Capital, où vous apprendrez tout sur ces gens qui sont coupables de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
François Bourguignon, directeur de l'École d'économie de Paris, n'est pas moins critique et pointe, notamment dans Les Échos du 6 octobre, le fait que : « Enfin, une croissance mondiale forte, à un rythme comparable à l'avant-crise, est clairement non soutenable du fait de la contrainte environnementale, et en particulier du réchauffement climatique. » Vous avez parlé de « verdissement » et, en l'occurrence, vous avez dit la vérité. En réalité, votre politique s'est ripolinée en vert, ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Donc, c'est vrai, vous allez verdir, comme verdit M. Cohn-Bendit, c'est-à-dire que vous ne changez rien ! Nos compatriotes ont cela présent à l'esprit et même sous le nez, car telle est la réalité quotidienne à laquelle ils sont confrontés.
François Bourguignon ajoute : « La réaffirmation de leur volonté de lutter contre ce fléau par les membres du G 20 n'est pas suffisante. ». À cet égard, la France n'est nullement exemplaire et la taxe carbone apparaît pour ce qu'elle est dans la stratégie présidentielle : à défaut de piéger du carbone, elle est un piètre leurre destiné à piéger quelques voix écologistes aux élections régionales. En revanche, c'est seulement de haute lutte que nous avons obtenu que le sommet de Copenhague sur le climat soit précédé d'un débat dans cet hémicycle.
Pour en terminer, provisoirement, avec le G 20 de Pittsburgh, la déclaration a mentionné la mise à l'étude de l'idée de taxer les activités spéculatives, ce qui évoque la taxe Tobin. Cette taxe constitue pourtant un sujet de débat déjà ancien, en particulier dans notre hémicycle. Dès 1999, nous étions plusieurs parlementaires de gauche à proposer cette mesure dont l'objet était, et est plus que jamais, de contribuer à la régulation des mouvements de capitaux volatils susceptibles, selon nous, de déstabiliser le système monétaire et financier international. Nous avions raison. En janvier 2000, le Parlement européen en a débattu. En 2001, le principe de la taxe a été adopté dans la loi de finances, mais sans taux. Nous proposons donc un amendement pour activer enfin la taxe Tobin qui sommeille dans le code général des impôts, depuis 2001, faute de s'être vu fixer un taux pour s'appliquer.
Vous ne pourrez pas nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec cet amendement, puisque c'est le Président de la République lui-même qui en a parlé…
C'est maintenant la quatrième ou la cinquième fois que vous citez le Président de la République !

Oui, cela fait cinq fois que je le cite, et vous n'avez pas fini de l'entendre.
Vous allez bientôt entrer au Gouvernement, monsieur Brard…

Vous, vous ne le citez que lorsque cela vous arrange. Moi, je prends le texte en entier ! Je ne vous parlerai pas du français massacré de la conférence de presse à Pittsburgh, parce qu'il y aurait de quoi faire une thèse ! J'évoquerai simplement ce qu'il a dit. À Pittsburgh, le Président de la République a déclaré : « On a mis le paquet ». Vous voyez cela d'ici, n'est-ce pas ? Vous imaginez le visage, avec la tête mobile et les jambes faisant écho à la tête – pas à l'esprit ! Il a donc déclaré : « On a mis le paquet sur la régulation monétaire, financière et économique. » Puis, il a ajouté : « Une Organisation mondiale de l'environnement, c'est un principe qui est aujourd'hui quasiment retenu ». Le Président de la République connaît la valeur des adverbes et il sait fort bien que, dans le langage de la politique internationale, l'adverbe « quasiment » est synonyme de « négation ».
Je comprends la prudence de M. Woerth qui se garde de citer le Président de la République ! Quant à vous, madame Lagarde, vous êtes une femme de grande qualité, personne ne le nie dans cet hémicycle. (Sourires et exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Pourquoi ne serais-je pas aimable avec Mme Lagarde ? C'est une adversaire politique. Cela étant, elle n'a pas encore l'expérience d'Éric Woerth. Voilà pourquoi elle se laisse aller à citer le Président de la République, sans mesurer à quel point cela peut nuire à ses démonstrations ! (Sourires.) Je vois qu'Arlette Grosskost approuve mon propos, ce en quoi elle a tout à fait raison ! (Même mouvement.)
Le Président de la République propose que l'on s'en remette à la taxe Tobin, même s'il ne restitue pas l'idée à celui qui en fut à l'origine. Mais vous aurez l'occasion de donner votre approbation à l'un de nos amendements.
Un des principaux problèmes du système financier international est que les banques peuvent prendre tous les risques pour décupler leurs profits, puisque l'État et, derrière lui, le contribuable sont les assureurs de dernier ressort des risques pris par le secteur bancaire, y compris dans leurs aspects les plus spéculatifs. C'est tellement vrai que le président de la Hong-Kong and Shanghai Banking Company – l'ai-je bien prononcé, madame Lagarde ? (Sourires) –, l'une des plus grandes banques mondiales, a présenté des excuses concernant le comportement des banques dans les causes de la crise. Quand verra-t-on M. Milhaud ou M. Pérol venir ici en robe de bure demander pardon à la représentation nationale pour le préjudice causé au peuple de France ?
Monsieur Woerth, vous nous faites voyager. Cela étant, ici, nous faisons du surplace, même en voyageant avec vous ! Autrefois, vous nous emmeniez à Moscou. Maintenant, les voyages s'arrêtent à Berlin, à Amsterdam et à Bruxelles. Avouez que cela manque un peu d'imagination ! L'efficacité vous fait défaut. Il vous manque la culture de Stakhanov : vous seriez bien meilleur ! Vous avez encore des marges de progression, je vous l'assure ! (Sourires sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
La révélation par la presse, cet été, de la constitution discrète par la BNP Paribas, d'une provision pour le versement de bonus, principalement à ses opérateurs de salles de marché d'instruments financiers, à hauteur de deux milliards d'euros, puis d'un, mais pour un semestre, démontre que les pratiques spéculatives sont déjà reparties de plus belle dans les banques. Un journaliste a demandé à Pittsburgh au Président de la République – que je cite pour la sixième fois – si les règles qui ont été adoptées empêcheraient de décider de nouveaux milliards d'euros de bonus. Écoutez bien ce que je vais dire, vous constaterez que vous n'êtes pas venus pour rien, ce soir ! Voici ce que le Président de la République a répondu : « Les règles adoptées sont très claires : elles empêcheraient de le faire en un coup et obligeraient à le faire en trois. » N'est-ce pas formidable ? C'est le texte officiel de l'Élysée, madame Lagarde, non une traduction de mon cru !
Le Président de la République dit la vérité quand il parle aux journalistes à l'étranger, c'est-à-dire : « N'ayez pas peur, rien n'est changé ! » « Les règles sont claires. », a-t-il affirmé. Cela continue comme avant, et c'est précisément ce dont nous ne voulons pas.
Les banquiers français vont très bien, puisque ce sont ceux qui arnaquent leurs clients avec le plus d'efficacité ! Je ne parlerai pas des assurances qu'ils font payer à leurs clients – et les souvenirs de Didier Migaud vont immédiatement émerger – pour les rembourser de la fraude dont ils sont les victimes, puisque le Parlement a voté un texte, sous le gouvernement Jospin, qui oblige les banquiers à rembourser sur leurs deniers sans avoir à contracter d'assurance. C'est bien de l'argent mal acquis ! Cela ne se limite pas aux assurances. La BNP, par exemple, a encaissé des aides de l'État qu'elle a remboursées dans les conditions qui ont été dites. Mais savez-vous que, d'après la Commission européenne, les banquiers français sont, dans le langage européen, parmi les plus « performants ». Ils arrivent, en effet, à facturer en moyenne 154 euros de frais à leurs clients contre 27 euros en Bulgarie. Vous me répondrez qu'on ne peut établir de comparaison avec la Bulgarie, très éloignée de vos bases arrière, monsieur Woerth. Prenons alors l'exemple des Pays-Bas qui facturent les frais 46 euros. Ainsi, à prestations de services identiques, nos banquiers réalisent donc un profit presque quatre fois supérieur. Voilà où est l'arnaque ! Une émission de télévision se charge de débusquer toutes ces arnaques. En voilà une dont il n'a jamais été question. Et ce sont nos concitoyens qui paient !
Dans ce contexte, pour la septième fois en moins d'un an, Nicolas Sarkozy – encore lui ! –…
Cela fait huit fois que vous l'évoquez !

Je vous ai battue puisque vous, vous atteignez ce chiffre en ajoutant Dominique Strauss-Kahn et Michel Rocard. Je n'ai pas besoin, quant à moi, d'aller chercher des supplétifs. Il me suffit de l'original, madame la ministre !
Fin août, Nicolas Sarkozy a reçu les banquiers à l'Élysée apparemment pour les rabrouer, s'agissant de la rémunération des dirigeants de banques et des opérateurs de salles de marché. Mais tous les discours ronflants du Président, ses déclarations triomphalistes lors des G 20 et les prestations télévisées des ministres ne parviennent pas à dissimuler la soumission des dirigeants de la droite à la haute finance ! C'est plus que de la soumission, c'est un dévouement aveugle, c'est de la servilité. En effet, vous êtes idéologiquement complètement imbibés ! Dès que vous voyez le Veau d'or, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire une génuflexion ! (Sourires.) Eh oui ! C'est ainsi ! Vous êtes faits comme cela et, hélas, c'est vous qui, pour l'instant, dirigez le pays ! Vous le savez, vous avez déjà beaucoup dégradé la situation et vous nous emmenez à la catastrophe.
Les nouvelles « mesurettes » que le Président de la République a présentées aux banquiers censés abandonner leurs mauvaises habitudes visent simplement à calmer l'opinion. Comme l'analyse très clairement Simon Gleeson du cabinet Clifford Chance : Ce que Sarkozy fait, c'est se plier à la pression de son électorat tout en envoyant un message codé aux banquiers français leur signifiant « Ne vous inquiétez pas. » Tel est bien le rôle de Nicolas Sarkozy. Il est le fakir assis sur les clous, en l'occurrence les Français. Il leur dit : « Dormez, je le veux ! » Et quand le sommeil commence à s'installer, la tête de trois-quarts, que dit-il aux banquiers ? « Vous pouvez continuer, ils dorment ! » Eh bien, nous sommes là pour dire aux Français : « Ouvrez les yeux ! Parce que, pendant qu'il vous berce avec des histoires à dormir debout, ce sont vos comptes en banque qui sont vidés, vos économies qui sont pillées. Et après, vous ne savez plus comment terminer le mois ! » (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Contrairement à vous, chers collègues, vos électeurs constatent que la fin du mois commence de plus en plus souvent le 10 ou le 12 ! C'est anormal dans un pays riche comme le nôtre !
L'augmentation des encours de prêts au secteur non financier n'a progressé que de 2,3 % en août, après 2,7 % en juillet et 3,5 % en juin. Les crédits de trésorerie ont encore chuté de 16,4 % en août. En voilà des chiffres, monsieur Woerth, vous qui les aimez ! L'objectif fixé aux banques d'une augmentation des crédits de 3 à 4 % pour l'année 2009 devient de plus en plus irréaliste, en dépit des promesses maintes fois réitérées des banquiers. Savez-vous pourquoi les objectifs ne seront pas tenus ? Cela ne tient pas qu'à la mauvaise volonté. C'est aussi le résultat d'une situation économique tellement désastreuse que la demande diminue également du côté des entreprises – vous ne pourrez pas me démentir.
Comme l'a déclaré récemment Hector Sants, chargé du contrôle de la City de Londres, à propos des bonus : « Si les politiciens estiment qu'il s'agit d'un problème, c'est à eux de le régler en utilisant les outils appropriés comme la fiscalité. » Dans cette perspective, madame la ministre, monsieur le ministre, nous allons vous proposer des amendements portant à 95 % l'imposition des bonus et des rémunérations des dirigeants d'entreprise qui touchent des pactoles.
Nous ne faisons que mettre en forme une proposition de Nicolas Sarkozy. En septembre 2008 à Toulon, il avait promis une nouvelle législation avant Noël 2008. Rappelez-vous, chers collègues, vous qui l'idolâtrez, et qui apprenez ses textes par coeur, comme d'autres apprenaient le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Un an de retard est pris et la preuve est maintenant apportée qu'il a confondu Noël avec la Saint-Glinglin. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) Nous sommes là pour boucher les trous de mémoire du Président de la République.
Au-delà de la question des niveaux de rémunérations et des bonus de toute nature attribués aux dirigeants des banques et aux opérateurs de salles de marché, les responsables politiques que nous sommes ne pourront pas faire longtemps l'économie d'une interrogation détaillée et sans complaisance sur la légitimité d'une série d'instruments financiers dont le négoce spéculatif alimente aujourd'hui principalement les profits des banques. La déréglementation systématique à laquelle ont procédé les États et l'Union européenne en matière financière et bancaire, la mondialisation totale des échanges financiers, la multiplication des paradis fiscaux et bancaires, les possibilités technologiques de transactions ultrarapides, l'utilisation de modèles mathématiques sophistiqués pour occulter le risque, le crédit abondant et peu cher, l'inefficacité des agences de notation, le tout couronné par la légitimation idéologique de l'argent facile par la pensée unique ultralibérale, ont ouvert le champ de tous les possibles en matière de spéculations de toutes sortes.
Par exemple, les variations brutales des cours des matières premières résultent désormais pour l'essentiel, c'est avéré, de mouvements spéculatifs et non du jeu de l'offre et de la demande. Ainsi, quand le baril de pétrole a dépassé les 140 dollars, les spécialistes de l'énergie expliquaient que le prix réel de marché se situait aux alentours de 60 dollars, le reste résultant des spéculations qui frappent aussi les matières premières alimentaires, créant des situations d'insolvabilité des consommateurs, débouchant sur des émeutes de la faim.
Un certain nombre de collègues – douze sénateurs et douze députés – participent à ce que les journalistes appellent le « G 24 ». Lorsque nous fûmes invités pour un déjeuner, rendu célèbre à cause de M. Zapatero et d'Henri Emmanuelli, que nous a dit alors le Président de la République ? Madame la ministre, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous n'étiez pas là et que le Président de la République ne partage pas ses secrets avec vous. Il nous a confié qu'il poserait la question d'une régulation du prix des matières premières pour que soient fixées des valeurs plancher. Or j'ai lu le communiqué final du sommet de Pittsburgh et le compte rendu de la conférence de presse du Président de la République. Je n'ai rien trouvé en la matière. Il s'agissait de propos de table destinés aux députés et aux sénateurs, avec l'espoir qu'ils seraient répétés aux journalistes et qu'ainsi la bonne nouvelle, comme on dit dans les textes sacrés, allait se répandre et rayonner par elle-même. (Sourires.)

Non, votre dieu, c'est le Veau d'or, je vous l'ai dit ! Ne remerciez pas Dieu et ne mettez pas l'Église dans un lieu qui doit rester laïc, chers collègues ! (Sourires.)
Vous voyez bien que vous êtes responsables, puisque vous soutenez ces politiques. Comme l'argent ne tombe pas du ciel, les sommes captées par la spéculation sont nécessairement payées par d'autres, les consommateurs, en premier lieu, mais aussi les petits épargnants, les petits actionnaires, les retraités modestes, nos concitoyens qui survivent avec des minima sociaux, le tout dans ce qui a été appelé une économie de casino, dans laquelle ceux qui perdent le plus sont ceux qui n'ont même pas les moyens de jouer. Ce sont là des mécanismes de spoliation qui n'ont aucune légitimité, une forme extraordinaire de violence sociale, et l'alibi de la création de « valeur » pour les actionnaires – un de vos concepts les plus inappropriés, madame Lagarde, que vous utilisez le plus volontiers – n'y change rien. Ce caractère parasitaire a été décrit par Lord Adair Turner, président du gendarme boursier anglais, avec le tact qui sied à la fonction d'un gentleman britannique. Il dit ainsi que : « Des pans du système financier, comme les instruments de taux, le trading, les produits dérivés et de couverture, et certaines facettes de la gestion d'actifs et du trading actions ont grossi à tel point que leur taille n'est plus socialement responsable ». Logiquement, Lord Turner a proposé, comme remède, une taxation des transactions financières n'ayant pas de contrepartie en termes de biens ou de services. Immédiatement, la British Banker's Association a agité le spectre d'une « fuite des activités à l'étranger », soit le même argument qu'utilisent Nicolas Sarkozy et Christine Lagarde pour la France, lorsque nous proposons de taxer un peu plus les profits financiers. Pourtant, madame la ministre, nous avons fait voter, en commission des finances, sur proposition de son président, un excellent amendement. S'il l'a été, c'est parce que des collègues de l'UMP rencontrent régulièrement leurs électeurs et les écoutent. Hélas, la plupart d'entre vous tiennent ici un rôle de figurant ! Vous devez porter ces aspirations à mieux vivre qui viennent des profondeurs de notre pays. Il s'agit essentiellement du partage des richesses, question qui n'est pas nouvelle. Si vous le voulez, madame Lagarde, je possède quelques exemplaires du Capital…

… je vous en dédicacerai un, puisque l'auteur n'est plus de ce monde. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)

Je revendique ma filiation spirituelle avec ce grand intellectuel qui a développé des concepts qui produisent toujours leur effet éclairant, pour peu qu'on veuille justement bien condescendre à réfléchir sur ce qui fait aujourd'hui le fond des lois économiques à l'origine des injustices et de la crise que nous vivons. En effet, et vous le savez parfaitement, madame Lagarde, les subprimes, s'ils sont un effet aggravant, ne sont pas la source de la crise, c'est la répartition des richesses, donc ce qui va au travail d'un côté et ce qui va à la rémunération du capital, de l'autre, qui est à l'origine du problème. Comme le capital a une soif inextinguible, il faut toujours plus ! Quand le socle productif se réduit, on débouche dans ces errements de la spéculation dans lesquels les banques sont reparties, et que vous n'encadrez pas. L'affaire des bonus n'est que l'arbre qui cache la forêt ! Les bonus sont fondamentalement immoraux, mais ils n'expliquent pas la crise.

Ce qui l'explique, c'est l'inégalité des richesses.
Afin qu'on vous expose tout cela, mes chers collègues, nous devons retourner en commission car vous avez la tête un peu dure, même devant les arguments les plus convaincants. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

La parole est à Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Vous avez centré l'essentiel de vos propos, monsieur Brard, sur le rôle joué par la France dans l'ensemble des négociations qui ont eu lieu au cours des quinze derniers mois et en particulier sur le G 20. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que, si la France, en qualité de présidente de l'Union européenne, n'avait pas joué un rôle moteur, avec des propositions concrètes, notamment sur l'encadrement des bonus (Exclamations sur les bancs du groupe SRC),…
…les capitaux propres des banques, les agences de notation, la coordination de la supervision, nous n'en serions pas là, tout simplement parce que le système financier aurait couru à sa perte. Je voudrais donc au moins que l'on reconnaisse le rôle joué par la France à l'initiative du Président de la République pour remettre le système sur ses pieds et proposer un véritable dispositif de supervision et de régulation.
Le Président de la République aurait fait référence, lors d'un déjeuner auquel vous avez eu le privilège de participer (Exclamations sur les bancs du groupe UMP),…
…à la nécessité d'encadrer le prix des matières premières et de prévoir peut-être un prix plancher, et vous avez cherché avec attention dans le communiqué du G 20 s'il existait une quelconque référence à ce sujet.
Je vous engage à vérifier à nouveau puisque le communiqué contient effectivement un paragraphe relatif aux cours des matières premières, qui va beaucoup plus loin, parce qu'il est bien plus important encore de travailler sur la régulation des instruments financiers fondés sur les matières premières que sur les matières premières seulement. J'ai commencé à constituer un groupe de réflexion afin que nous puissions avoir pour le prochain G 20 des propositions très spécifiques sur l'encadrement des instruments financiers ayant pour sous-jacents les matières premières, qui permettent effectivement bien souvent d'alimenter la spéculation contre laquelle nous nous élevons.
Monsieur le président de la commission des finances, tout ce qui a trait à l'encadrement des banques, à leur mode de fonctionnement, à la taxation qu'on leur impose n'aura d'effet sans introduire de discrimination à l'égard de nos acteurs nationaux que si c'est prévu au moins au niveau régional et de préférence au niveau international.
On a cité ici ou là l'exemple de la Belgique. Je vous invite à nouveau à regarder exactement ce qui s'y passe. Ce n'est pas du tout une taxation, ce n'est pas du tout un nouveau mécanisme, c'est simplement l'application par anticipation d'une directive européenne que nous avons fait voter sous présidence française pour augmenter la garantie des dépôts. C'est l'un des ministres du gouvernement belge qui propose d'introduire une telle mesure pour la période de l'année 2010 pour des raisons politiques qui lui appartiennent.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Gordon Brown a bien précisé qu'il n'était pas question de mettre en place une quelconque taxation qui serait préjudiciable aux banques britanniques. En bon responsable du gouvernement britannique travailliste qu'il dirige,…
…il propose au contraire que l'on exige d'un certain nombre de banques qui ne respecteraient pas l'encadrement prévu par les accords passés à Pittsburgh qu'elles aient davantage de capitaux propres.
Il faut donc faire très attention à la manière dont on utilise tel ou tel instrument de fiscalité pour que cela ne porte pas préjudice à nos acteurs. Je persiste à dire qu'ils se sont bien comportés dans la période de crise et qu'ils ont tenté de répondre aux demandes qui leur étaient faites dans des circonstances économiques difficiles, je ne le conteste pas, pour essayer d'augmenter le financement de l'économie, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises et les collectivités locales.
Monsieur Cahuzac, les 93 milliards déposés en collatéral auprès de la Société de financement de l'économie française étaient éligibles au refinancement de la Banque centrale. Il n'y a pas d'équivoque à avoir, d'autant plus que la Cour de comptes n'a pas du tout conclu que c'étaient des collatéraux particulièrement à risque.
Bref, ces 93 milliards sont des actifs éligibles au refinancement de la Banque centrale, avec un contrôle de la Cour des comptes et sous la vérification du Crédit foncier de France.

Dans les explications de vote, la parole est à M. François de Rugy, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

S'il y a une motion de renvoi en commission qui est justifiée, c'est bien celle-ci car des zones d'ombre demeurent alors que nous commençons la discussion de ce projet de budget, et je prendrai simplement deux exemples, la taxe professionnelle et ce que l'on appelle le grand emprunt.
Tout à l'heure, nous avons évoqué le respect des obligations constitutionnelles pour l'examen du budget, mais les délais concernant les études d'impact sur la réforme de la taxe professionnelle n'ont pas été respectés, c'est notre rapporteur général, Gilles Carrez, qui l'a souligné. Nous pouvons d'ailleurs saluer son travail. Il a pointé les effets pervers du projet gouvernemental de réforme de la taxe professionnelle et essayé tant bien que mal de corriger certains d'entre eux mais on voit bien qu'il aurait fallu poursuivre la discussion et aller beaucoup plus loin.
Deuxième point, le grand emprunt. C'est une sorte de projet de budget à tiroirs que vous nous présentez. Il y a en effet le déficit prévu, et l'on sait que, souvent, malheureusement, il n'est pas respecté, mais il faut y ajouter cet emprunt. C'est d'ailleurs plus une lubie de M. Guaino, suivi par le Président de la République. Les deux anciens Premiers ministres qui ont été mandatés pour réfléchir aux dépenses qui pourraient être financées ainsi s'évertuent surtout, depuis qu'ils ont été nommés, à tempérer les ardeurs et à dire qu'il ne faudrait pas que cet emprunt soit trop important. Cela prouve le peu de confiance qu'ils ont dans cette procédure, et montre surtout le danger qu'il y aurait à ajouter au déficit du budget de l'État que nous examinons ce déficit supplémentaire. Le Gouvernement devrait donc être beaucoup plus clair sur ce grand emprunt puisque M. Guaino, lui, continue à parler de 100 milliards d'euros.
Il est temps d'arrêter cette sorte de course vers l'abîme budgétaire et il ne serait pas inutile que la commission, qui a travaillé à marche forcée, se réunisse à nouveau pour examiner ce projet de budget tronqué.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Cette motion de renvoi, excellemment défendue par Jean-Pierre Brard, trouve un écho favorable parmi les membres du groupe SRC.
La dégradation des comptes publics résulte d'un accroissement de la dette par une baisse contestable des recettes, on l'a vu avec la TVA sur la restauration, on le voit avec une réforme de la taxe professionnelle non financée à hauteur de 11,7 milliards, et je n'évoquerai pas le problème des niches fiscales sur lesquelles nous aurions pu revenir.
Tout le monde s'accorde à dire que la fiscalité locale était devenue obsolète. Oui, il faut réformer la fiscalité des entreprises et donc la taxe professionnelle. Oui, il faut prévoir des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités locales. Nous nous étonnons que le Gouvernement ait inversé le débat et que nous soyons amenés à débattre de la fiscalité locale avant la réforme de l'organisation et des compétences territoriales.
Une réforme d'une telle ampleur sans simulation ni étude d'impact est inconcevable et génère incertitude et incompréhension. Si nous apprécions bien l'effet de la suppression de la taxe professionnelle sur les entreprises, nous n'en mesurons que faiblement l'impact sur les ménages et les collectivités territoriales. Vous évoquez une année blanche pour les collectivités locales sans apporter de réponse sur le dynamisme des ressources transférées. Vous souhaitez que les collectivités territoriales dépensent moins mais cela serait plus facile si l'État respectait ses propres compétences et ne faisait pas appel aux financements croisés.
Vous n'apportez par ailleurs aucune réponse sur une vraie péréquation des ressources afin d'éviter que les départements, par exemple, ne soient asphyxiés par des dépenses de solidarité sur lesquelles n'existe aucune marge de manoeuvre.
Je n'évoquerai pas non plus le débat inachevé en commission des finances sur la taxe carbone.
Bref, nous devrions revenir en commission pour évoquer ces nombreux dossiers. Comme l'ont dit excellemment le président de la commission des finances, Jérôme Cahuzac ou M. Brard à l'instant, nous n'avons pas suffisamment examiné ce projet de loi. Le groupe SRC votera donc la motion de renvoi en commission afin de préciser les points qui n'ont pas encore été éclairés.

La parole est à M. Jérôme Chartier, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

M. de Rugy et M. Carcenac ne manquent pas d'humour parce que, s'il y a une motion de renvoi en commission qui n'est particulièrement pas justifiée, c'est bien celle qu'a défendue M. Brard. Peu importe finalement, on sait bien que l'on présente une telle motion beaucoup plus pour s'exprimer que pour renvoyer un texte en commission.
Plutôt que de répondre aux envolées lyriques et bilingues de M. Brard, puisqu'il est devenu bilingue,…

…je voudrais revenir sur l'essentiel de ses propos qui, finalement, concernaient le G 20.
Il y a un an, le G 20 n'existait pas mais, sur les sujets financiers, la France, l'Europe, ne peuvent plus agir seules. Même le G 8 était une structure qui ne convenait plus et il fallait passer à la vitesse supérieure.
Nicolas Sarkozy, alors Président de l'Union européenne, a pris l'initiative de rassembler le G 20 pour en faire un lieu non seulement de discussion mais aussi de proposition, et surtout pour avancer dans des domaines économiques et financiers. On l'a vu à plusieurs reprises, les négociations ont été âpres – Christine Lagarde en a parlé tout à l'heure. Mais on observe après Pittsburgh que les initiatives prises par la France sont payantes.

Chacun sait que les réformes ne vont pas se faire en un jour.
M. Migaud a suggéré d'instituer une taxation supplémentaire sur les profits des banques. Prendre une telle décision, seuls, en l'absence totale de discussions, est-ce oui ou non préjudiciable au secteur bancaire français implanté en France ? Bien sûr, et il y a autre chose à faire. Demander par exemple aux établissements bancaires de contribuer au système de régulation monté à leur profit : voilà une proposition très astucieuse et très opportune qui pourrait peut-être, je réfléchis à haute voix, rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros par an.
Pourrions-nous aller plus loin ? Sans doute mais, l'initiative de Nicolas Sarkozy l'a prouvé, on ne peut plus agir seul en matière économique et financière. La finance, c'est maintenant un domaine mondial. Réfléchissons donc, avant de prendre une initiative, à ce qui est juste en termes de concurrence mondiale des marchés financiers.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention Jean-Pierre Brard qui, une fois de plus, avec le talent qu'on lui connaît, a su captiver son auditoire mais, il va être déçu, il ne m'a pas convaincu.

Je ne voterai donc pas la motion de renvoi en commission.
Il est d'ailleurs plus disert dans l'hémicycle qu'il ne l'est à la table du Président de la République. Lorsque le G 24 s'est réuni, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le côtoyer, je l'ai trouvé moins cinglant sur les banques et sur les propositions faites dans le cadre du G 20. Vous avez donc beaucoup de chance, mes chers collègues, puisqu'il vous en dit beaucoup plus qu'il ne le fait dans les lieux de décision. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Seulement, j'aurais aimé entendre les propositions de Jean-Pierre Brard sur la réforme territoriale (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP), sur le plan de relance, sur la fiscalité locale ou encore sur la fiscalité verte.
Je tiens à ce que le Parlement joue pleinement son rôle. Il va d'ailleurs s'y employer dès à présent en entamant la discussion générale. Aussi ne quittons pas l'hémicycle et examinons sans tarder ce projet de loi de finances pour 2010 : il est grand temps !

Ce n'était en effet pas très glorieux !
(La motion de renvoi en commission, mise aux voix, n'est pas adoptée.)

Nous allons entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.
Je vous rappelle que les porte-parole des groupes interviendront demain après-midi après les questions au Gouvernement.
La parole est à M. Philippe Vigier.

Madame la présidente, madame et monsieur les ministres, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, nous nous accorderons au moins sur la gravité de la crise. Chacun a conscience, pour l'avoir exprimé à sa façon, qu'elle est la plus grave de l'histoire récente.
L'action entreprise par le Gouvernement français sur le plan national mais aussi, en tant que force de proposition, sur le plan européen et même, à l'issue du G 20, au plan mondial, représente un travail considérable et une avancée sans précédent. Cela démontre que l'action politique a un sens et qu'il nous revient de bâtir la régulation.
Or nous nous trouvons au coeur d'une crise économique et sociale particulièrement grave, je l'ai dit, sur fond de déficits publics abyssaux. Cette situation n'est pas nouvelle puisqu'elle dure depuis 1981. Sur tous ces bancs, tout le monde a sa part de responsabilité : aucun budget n'a été voté en équilibre pendant cette période. Ce déséquilibre s'est fortement accentué entre 2008 et 2009 du fait des mesures de relance – indispensables – prises par le Gouvernement, mais aussi à cause de la très forte diminution des recettes, en particulier de celles produites par l'impôt sur les sociétés, passées de 39 milliards à 19 milliards d'euros.
Il était donc important pour nous que le Gouvernement emploie autant d'énergie pour enrayer les conséquences désastreuses de cette triple crise, notamment sur l'emploi. Cependant, en aucun cas nous ne devons prendre la crise pour un alibi qui nous permettrait de jeter un voile sur nos déficits structurels, bien au contraire. En cette période de crise accrue, est-il indispensable de rappeler le caractère insoutenable, à terme, de cette situation ?
C'est donc une réforme globale qu'il convient de mener ; d'où notre incessant message sur le nécessaire plafonnement des niches fiscales, l'indispensable optimisation des niches sociales, sans pour autant laisser filer nos dépenses, ce qui est pourtant le cas cette année, monsieur le ministre ; d'où, également, notre message sur la poursuite de la réorganisation de l'État entamée avec la RGPP.
Charles de Courson évoquera le contexte macroéconomique et nos propositions pour enrayer les déficits. Il reviendra à Nicolas Perruchot d'insister sur la mise en oeuvre de la taxe carbone que je préfère appeler « fiscalité verte ». Pour ma part, madame et monsieur les ministres, je concentrerai mon propos sur la réforme des collectivités territoriales qui sont, on le sait, le premier investisseur public et qui représentent près de 70 milliards d'euros dans le budget de l'État.
En ce qui concerne la suppression de la taxe professionnelle, je ne pense pas qu'il faille crier au scandale. Finissons-en avec les craintes injustifiées : cette réforme est nécessaire. Le président Mitterrand, certains s'en souviennent, qualifiait déjà cet impôt de « stupide ». Personne n'a eu le courage d'achever la taxe professionnelle, quasi morte. C'est vous, à gauche, qui avez fait en sorte que le tabouret qui reposait sur trois pieds n'en ait plus que deux, quand vous avez, avec Dominique Strauss-Kahn, supprimé la part salaires de ladite taxe.
Dans le contexte de crise actuel, faut-il soutenir nos entreprises ? La suppression de la taxe professionnelle n'est-elle pas le meilleur outil anti-délocalisation ? Au Nouveau Centre, nous pensons que oui. Cette réforme doit être équilibrée afin que l'immense majorité des entreprises puisse en bénéficier.
Je salue, monsieur le rapporteur général, le travail considérable réalisé pendant plusieurs mois par nos collègues de la commission des finances, quelle que soit leur sensibilité politique, qu'il s'agisse de Jean-Pierre Balligand ou de Marc Laffineur.
Il faut tomber les faux nez : l'autonomie financière n'est plus au rendez-vous. Il y a treize ans, 75 % du budget des régions provenaient de recettes propres ; ce taux est tombé aujourd'hui à 25 ou 30 %. On voit bien que nos collectivités ne vivent plus que de perfusions, de dotations de l'État.
La copie du Gouvernement n'était pas satisfaisante. À ceux qui s'indignaient tout à l'heure du rôle effacé du Parlement, le travail de Gilles Carrez constitue la meilleure réponse : en réécrivant l'article 2 du projet, il montre que les députés sont à même d'apporter une véritable contribution. La réécriture de cet article a en effet permis d'aboutir à une solution acceptable en ce qui concerne le financement du bloc communes-intercommunalités.
Le Nouveau Centre soutient qu'il faut maintenir le lien entre le territoire et l'entreprise. Cette idée ne figurait pas dans le texte gouvernemental. Aussi sommes-nous satisfaits de ce que le texte – qu'il faudra donc voter – prévoie qu'une partie de la cotisation complémentaire, qui est une cotisation dynamique, soit affectée au bloc communes-intercommunalités. Nous pensons toutefois qu'il faudra aller encore plus loin que les 20 % envisagés, à savoir 35 % – nous présenterons des amendements en ce sens – puisque ledit bloc réalise la majeure partie des investissements dans le domaine économique. Ce sont les communautés de communes, les agglomérations qui portent les investissements, qui ont pris des risques financiers pour les prochaines années.
J'ajoute que le modèle proposé par le Gouvernement, qui prévoit une taxation sur la valeur ajoutée à partir de 500 000 euros, n'est pas satisfaisant et constitue même une anomalie susceptible de provoquer un effet d'aubaine, des entreprises se filialisant, par ailleurs, pour échapper à cette taxation. Nous proposerons de revenir à une imposition plus basse – à partir de 150 000 euros, comme c'était le cas pour la taxe professionnelle –, et de lisser le taux à 1,5 % pour que la recette soit la même et plus justement répartie.
En revanche, nous proposons un réhaussement de l'abattement de 1 000 à 2 000 euros avec élargissement de ses bénéficiaires pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros. Les entreprises seront moins pénalisées, on ne déplorera pas de filialisations et l'impôt sera plus juste.
Enfin, il existe le problème des titulaires des entreprises en bénéfices non-commerciaux qui pourront être taxés jusqu'à trois fois plus que les entreprises en bénéfices industriels et commerciaux. Nous déposerons un amendement afin de rétablir ce dispositif.
Le second sujet majeur dont je souhaite vous entretenir concerne l'autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales. Tocqueville disait que la liberté communale était une chose rare et fragile. Nous devons en être les garants. Depuis plus de vingt ans, nous prenons le chemin inverse puisque notre système est perfusé par dotations, pratique qui présente vraiment un risque pour les régions et les départements.
Nous proposons par conséquent l'instauration d'une taxe additionnelle à la CSG pour les départements et les régions, seul impôt véritablement moderne et juste. Il s'agit de compenser la nouvelle répartition de cotisations complémentaires. Ainsi, abaisser le taux de la CSG nationale de 7,5 à 5,3 % pour affecter 1,2 point aux départements et un point aux régions, constitue le gage d'une ressource dynamique. Cette CSG serait bien sûr encadrée pour éviter les dérives constatées dans les régions socialistes où le taux de la TIPP a été élevé au maximum, comme dans la région Centre ; je parle en connaissance de cause.

À tous les conservateurs, monsieur Emmanuelli, qui considèrent que cet impôt est anticonstitutionnel, je réponds que c'est faux. L'autonomie fiscale des collectivités territoriales, c'est la responsabilisation des élus. Nous y croyons et il nous appartient, dans les différentes collectivités, de conduire, grâce à l'impôt levé, les actions pour lesquelles les électeurs nous ont choisis.
Pour ce qui concerne la mise en oeuvre d'une péréquation dans les territoires, elle est indispensable. La fracture des territoires est devant nous. Dans les territoires les plus dynamiques, il faut absolument qu'une partie de l'accroissement de la cotisation complémentaire soit affectée aux territoires les plus faibles.
Nous proposerons donc une péréquation à la fois sur la cotisation complémentaire et sur les droits de mutation.

Si cette réforme ne doit pas être le fruit d'une politique à géométrie variable, elle n'en doit pas moins prévoir des clauses de revoyure. Dans les semaines à venir, nous connaîtrons les disparités pour les différentes collectivités territoriales.
Je regrette, et il faut comprendre les réticences des élus locaux, les vieux démons tels que l'augmentation des conventions collectives dans le cadre des SDIS, le glissement vieillesse technicité, le RSA,…

…le RMI non-compensé, l'APA, autant de décisions prises par les gouvernements successifs qui ont laissé les élus locaux se débrouiller.
Aussi avons-nous la volonté de rebâtir un nouveau pacte entre l'État les collectivités territoriales. Vous ne pouvez pas leur demander davantage d'efforts sans changer les règles de fonctionnement de l'État.
Je regrette également que l'on entame la réforme de la fiscalité locale, notamment de la taxe professionnelle, sans disposer de simulations financières, non plus que de réformes des bases. Il est dommage de réformer la taxe professionnelle avant de réformer les collectivités territoriales. Je comprends néanmoins l'urgence de soutenir le tissu économique, d'où notre appui à l'action du Gouvernement.
Nous traversons une crise économique qui marquera l'histoire contemporaine. Les chiffres astronomiques de pertes et de dettes mettent en danger nos entreprises, nos emplois, notre système de solidarité nationale et nos finances publiques : État, sécurité sociale, collectivités territoriales. Ce danger appelle des mesures correctrices de notre part à tous. Il convient d'assouplir le bouclier fiscal pour renforcer la justice fiscale,…

…mais aussi d'assurer une réforme équilibrée de la fiscalité locale pour permettre à nos collectivités d'assurer correctement leurs missions.
Enfin, il conviendra de garder à l'esprit, au cours des prochains jours, l'importance de la relation entre le dynamisme économique de nos collectivités et notre capacité à développer une croissance durable et juste.

Pour terminer, je souligne qu'il nous appartient à tous de concevoir une architecture plus efficace au service du dynamisme de notre pays, afin de retrouver le chemin du désendettement, de la croissance et de l'emploi pour le plus grand nombre.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2010, dont nous débutons la discussion en séance, porte la marque de la plus grave crise économique que le monde ait traversée depuis 1929, mais elle est aussi porteuse de l'intervention volontariste de l'État pour en limiter les effets sur nos concitoyens, nos entreprises et pour préparer la reprise.
La marque de la crise, ce sont des recettes fiscales qui restent à un niveau bas, même si la situation s'améliore par rapport à 2009, pour atteindre 252 milliards d'euros, chiffre toutefois toujours inférieur à celui de 2008, qui était de 265 milliards.
L'intervention volontariste de l'État, c'est le prolongement des mesures de relance afin de ne pas déstabiliser une économie convalescente. Ainsi, 4,1 milliards d'euros sont consacrés à ces mesures, avec notamment la prolongation des aides à la filière automobile et le remboursement du crédit d'impôt recherche aux entreprises, cela dans l'année.
Ce budget s'inscrit donc dans la continuité d'une politique qui a fait ses preuves en permettant à la France de mieux résister que ses partenaires, avec une réduction de 3,5 points de croissance depuis 2007 contre 7 points pour les pays de l'OCDE, et un retour de la croissance dès le deuxième trimestre 2009, nous plaçant en tête de l'Union européenne.
Vous avez souligné, madame la ministre, et je vous en remercie, le rôle joué dans la lutte contre la crise par la Caisse des dépôts et consignations. Vous avez noté sa réactivité, rappelé la mobilisation des ressources des fonds d'épargne dans les projets de logement, autour des reprises de VEFA, mais aussi dans le rechargement des prêts OSEO et dans le financement des infrastructures.
Je rappelle, pour l'avenir, l'importance du niveau de liquidité des fonds d'épargne dont l'utilité a été démontrée à cette occasion et j'insiste sur le fait qu'il faudra nous montrer attentifs aux engagements hors bilan souscrits par ces mêmes fonds d'épargne au moment où nous devrons sortir du dispositif transitoire, s'agissant de la centralisation des ressources du Livret A et du Livret de développement durable.
Le choix de la relance par l'investissement, avec des mesures équilibrées pour la consommation, a privilégié des mesures non récurrentes, réversibles. C'est de mon point de vue, du point de vue de l'économie mais aussi du point de vue du déficit budgétaire, un bon choix.
En effet, même si son déficit enregistre pour 2010 une importante diminution – 25 milliards d'euros –, le budget de l'État n'en affiche pas moins un déficit très lourd : 116 milliards d'euros. L'importance de ce chiffre doit nous rendre attentifs aux causes conjoncturelles du déficit, d'une part, et à ses causes structurelles, d'autre part.
C'est sur cette part structurelle, autour de 40 % du déficit prévisionnel, que doivent porter nos efforts de maîtrise des dépenses si nous voulons parvenir au redressement des comptes publics dans la durée.
Je soutiens donc sans hésitation les mesures de réduction des effectifs de l'État – ils avaient considérablement augmenté au cours de la dernière décennie malgré la décentralisation de compétences entières en direction des collectivités locales –, avec la reconduction de la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite, qui permettra d'économiser 33 749 postes, mais seulement de stabiliser en valeur absolue le poids des salaires et des pensions au sein du budget. De même, je soutiens la poursuite de la révision générale des politiques publiques, qui commence à porter ses fruits.
L'équilibre du budget, c'est aussi la protection des recettes. Nous devons continuer – le rapporteur général l'a dit avant moi – à porter une attention particulière à l'évolution de la dépense fiscale, qui mine les recettes de l'État. Certes, nous avons une mesure nouvelle : l'objectif de dépenses fiscales, fixé à 74,8 milliards pour 2010, soit 72,2 milliards hors restitution anticipée du crédit d'impôt recherche. Cela va dans le bon sens. Néanmoins c'est plus que les 70,5 milliards de 2009.
Des mesures positives ont été prises, dont le plafonnement des niches, qui est utile par rapport à la dépense fiscale et qui va dans le sens de l'équité entre contribuables, puisqu'il évite que les plus aisés puissent, par ce biais, s'exonérer de l'impôt sur le revenu.
Des mesures de contrôle ont été prises, avec, d'une part, l'obligation de gager toute dépense fiscale supplémentaire par des suppressions ou diminutions de dépenses semblables et, d'autre part, la fixation d'un objectif de dépenses fiscales, innovation qu'il convient encore une fois de saluer.
Au regard de l'enjeu, il faut cependant aller plus loin, avec une évaluation systématique des niches, permettant de mesurer l'efficacité de la dépense fiscale par rapport à son efficacité économique, et de prendre les mesures d'ajustement qui s'imposent, notamment pour les niches les plus dynamiques. Là encore, je ne peux que soutenir les mesures qui consistent à revisiter l'ensemble des dispositifs ayant trait aux économies d'énergie et à l'habitat. Il est normal que l'on s'interroge sur ces mesures, vu le délai de retour sur investissement pour les particuliers. Un ajustement me semble logique ; cela se traduit d'ailleurs dans les choix qui ont été opérés dans cette loi de finances, quand on subventionne au travers de la dépense fiscale quelqu'un qui met un insert dans sa cheminée, par exemple. Cela ne contribue en rien à l'industrialisation d'une filière économique, et le retour d'investissement est déjà très important pour celui qui fait ce type de dépense.
De même, je soutiens les mesures visant à mieux prendre en compte les problèmes environnementaux dans les différentes niches.
La maîtrise de la dépense publique passe aussi, au-delà de telle ou telle mesure de réduction, par l'élaboration d'une véritable comptabilité analytique, permettant une évaluation des coûts, monsieur le ministre des comptes publics. Avec le déploiement de CHORUS, une importante réforme des systèmes d'information est mise en oeuvre en ce sens, mais elle n'est pas sans soulever certaines interrogations. Sur le fond, celles-ci portent notamment sur la possibilité réelle de basculer dans une véritable comptabilité analytique, dont on nous a dit qu'elle était « pour plus tard », alors qu'elle permet pourtant un véritable contrôle de gestion, sans nécessiter de ressaisie ou de retraitement au niveau des ministères. Ces interrogations portent également sur les modalités d'intégration dans CHORUS des budgets des opérateurs de l'État. Elles portent aussi, de façon très concrète, sur le retour sur investissement du projet lui-même.
L'évolution du déficit pose inévitablement la question de l'endettement, porté par la crise à des niveaux inconnus jusque-là. Il n'y a pas d'impact majeur sur la qualité de la signature française, qui n'est pas altérée. En effet, notre endettement, s'il est très supérieur aux ratios européens, comme dans vingt des vingt-sept pays de l'Union, reste à un niveau admissible si on le compare à celui de l'Allemagne ou des États-Unis, qui est voisin du nôtre, ou à celui de l'Italie ou du Japon, qui est supérieur. Cette situation altère d'autant moins notre signature que la France reste un pays d'épargne importante, ce qui rassure évidemment les prêteurs.
Ce niveau d'endettement doit cependant attirer toute notre attention, puisqu'il ne s'agit de rien moins que d'un report de dépenses, donc de fiscalité, sur les générations futures. Il soulève deux interrogations.
La première porte sur la structure de la dette, qui a été transformée, puisqu'elle comporte aujourd'hui davantage de dette à court terme, c'est-à-dire composée de produits plus réactifs aux variations de taux. Nous avons pu faire des économies – 4,5 milliards – sur les intérêts de la dette en 2009, mais qu'en sera-t-il dans un ou deux ans, quand les taux d'intérêt vont commencer à remonter ?
Par ailleurs, quand l'État est amené à s'endetter, il ne faudrait pas qu'à sa dette propre s'ajoute celle des opérateurs. C'est ma seconde interrogation. C'est pourquoi je proposerai, au travers de différents amendements, que nous puissions avoir, parmi les documents qui nous sont remis à l'occasion des lois de finances et des lois de règlement, le stock de dettes des opérateurs.
Je suis également amené à m'interroger, monsieur le ministre des comptes publics, sur le fait qu'un certain nombre d'opérateurs se mettent à accorder des garanties en dehors du budget de l'État. Si nous avons souhaité que les garanties puissent être inscrites dans la loi de finances, c'était pour éviter ce type de comportement. J'ai découvert il y a quelques semaines que RFF, dans des projets de PPP, s'apprêtait à accorder des garanties. Je suis très étonné de cette pratique.
Avant de conclure, je veux évoquer un point précis qui a fait polémique à la commission des finances et dans les médias.
Certains établissements financiers ont pu être mis en cause dans la crise. Gravement fragilisés, leur défaut aurait pu être catastrophique pour l'économie. L'intervention de l'État, avec la Société de prises de participation de l'État et la Société de financement de l'économie française, a permis de les conforter et ainsi, avec l'appui du Médiateur du crédit, de relancer à travers eux le financement de l'économie via le redémarrage de la distribution du crédit. Ce redémarrage a également été renforcé par les différents fonds qui ont pu être mis en place au sein du FSI, comme le fonds de modernisation des équipementiers ou le fonds de consolidation. Cela a permis de sauver de nombreuses PME.
Toutefois les banques, à l'avenir, vont être confrontées – et vous l'avez vécu en direct, madame la ministre, puisque vous avez été un acteur majeur dans cette affaire – au problème du niveau des fonds propres, surtout si l'Europe capitule devant les exigences des Américains. En l'absence de régulation sur le continent américain, on a bien compris que la solution était de remonter le niveau des fonds propres. Alors que les banques françaises, bien que l'ayant déjà fait, sont susceptibles d'avoir besoin de l'augmenter davantage encore, je crois que ce n'est pas le moment d'amputer une partie de leurs ressources et de fragiliser par là même la distribution du crédit demain, surtout au travers d'une disposition qui sera lue, inévitablement, comme une mesure rétroactive.
Cette situation n'a rien à voir avec celle que j'ai soutenue, en son temps, en demandant une taxation supplémentaire sur Total, qui avait fait de superbénéfices liés à de la spéculation sur les stocks de pétrole. La situation des banques n'est malheureusement pas aussi florissante que l'était celle du groupe Total il y a quelques années.

Je conclus, madame la présidente.
Madame la ministre, monsieur le ministre, votre budget va incontestablement dans le bon sens. Parce qu'il poursuit le soutien à l'économie face à la crise, tout en maintenant l'effort de maîtrise des dépenses publiques, et aussi parce qu'il continue les réformes, en particulier deux réformes importantes : celle de la taxe professionnelle, avec un allégement de charges important pour l'industrie, et celle de la fiscalité verte, que nous mettons enfin en place et qui peut apporter, demain, une protection aux frontières pour l'industrie française face au dumping écologique. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la ministre, monsieur le ministre, tout à l'heure M. Chartier souhaitait que la discussion soit constructive. Cela n'a pas toujours été le cas depuis l'ouverture de ce débat, mais celui-ci nous a quand même ménagé quelques bons moments. J'ai ainsi trouvé plaisant que vous nous expliquiez qu'aucun gouvernement n'avait mieux géré que vous les dépenses sociales, au moment où vous affichez 30 milliards d'euros de déficit pour les régimes sociaux. Comme si vous aviez oublié qu'il fut une époque, pas si lointaine, où ces régimes étaient à l'équilibre. Nous expliquer que quand on a 30 milliards d'euros de déficit, c'est mieux que quand on était à l'équilibre, c'est nous offrir un bon moment dans la discussion budgétaire !
On peut recommencer !

Je n'en doute pas, car je ne doute pas que l'on puisse dire n'importe quoi en permanence !
Vous nous avez offert un deuxième bon moment quand vous nous avez expliqué que vous aviez réalisé des économies en supprimant 100 000 postes de fonctionnaire, et que cela représentait 3 milliards d'euros. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ? Vous avez oublié de préciser que ces 3 milliards d'euros, vous les avez gâchés par une baisse inutile de la TVA dans la restauration, qui, si j'en crois M. Novelli, a créé 6 000 emplois. Vous conviendrez que vous avez perdu au passage 94 000 emplois pour rien.

Vous avez appelé cela de la bonne gestion, j'ai quand même du mal à y croire. Je ne sais pas dans quel système comptable vous vous inscrivez, ou de quel système vous vous inspirez, mais avouez qu'il est difficile de prendre cela au sérieux.
De la même manière, madame la ministre, je vous remercie, moi qui vous lis toujours avec beaucoup d'attention, d'avoir trouvé que j'étais ridicule.
Non !

Si ! C'est ce que vous avez dit dans Les Échos hier. Vous avez en effet indiqué que la proposition qui consistait à prendre des participations dans les banques au lieu de leur fournir ces titres qui les ont sauvées sans entraîner aucune dilution du capital, sans aucune contrepartie en termes de pouvoir dans l'entreprise, était ridicule. Nous, nous vous avions suggéré, souvenez-vous, de prendre des parts dans leur capital. Si vous l'aviez fait, vous vous trouveriez aujourd'hui à la tête de plus-values potentielles – je dis bien potentielles – qui seraient assez élevées.
Lorsque l'on défend les contribuables, on est ridicule, mais quand on défend les bénéfices potentiels des actionnaires, on est responsable ! C'est là que nous divergeons totalement. Moi, je pense qu'un ministre de la République est responsable quand il défend d'abord les intérêts de l'État, ceux des contribuables, bref, ceux du pays, et non pas ceux des actionnaires des banques, qui, que vous le vouliez ou non, se retrouvent aujourd'hui bénéficiaires de plus-values potentielles importantes que vous n'avez pas su saisir.
C'était votre choix, mais ne venez pas, en plus, nous expliquer que c'était un bon choix, que c'était de la grande gestion financière. Non, c'était une mauvaise affaire financière. Lorsque le système bancaire est en difficulté, il recourt à la garantie publique. Et là, le risque est public. Lorsqu'il y a des plus-values importantes, en revanche, c'est pour les actionnaires.
Vous nous dites, monsieur le ministre, que vous ne nous comprenez pas. Je comprends que vous ne nous compreniez pas. Manifestement, nous n'avons pas du tout les mêmes paradigmes.
S'agissant du déficit, je n'ai pas entendu un de mes collègues vous reprocher à grands cris son montant. Il est cependant surréaliste que vous continuiez, avec un tel déficit, à nous expliquer qu'il ne faut pas créer des recettes. Tout à l'heure, Mme Lagarde nous a expliqué, si j'ai bien compris, que nous faisions l'admiration du monde, au G20. Je pense que nous ne ferons pas l'admiration du monde si nous expliquons que nous creusons les déficits – peut-être pour de très bonnes raisons – mais que le problème des recettes ne se pose pas.
Le Président de la République dit qu'il n'a pas été élu pour créer de nouveaux impôts. J'entends bien, mais il n'a pas été élu non plus pour créer des déficits abyssaux ! Il va bien falloir qu'à un moment donné vous preniez la mesure de la réalité des finances publiques. C'est ce à quoi vous encourageait, indirectement et intelligemment, M. le rapporteur général dans son intervention de cet après-midi. Il ne disait rien d'autre, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons applaudi.

Si nous avions dû faire face à la crise sous présidence de Mme Royal, je ne sais pas où nous en serions !

Monsieur Bouvard, il me semble que, avant la crise, nous étions déjà en déficit de plus de 45 milliards d'euros. Cela ne vous a pas échappé. Et l'année précédente aussi. Et celle d'avant aussi ! À moins que vous perdiez vos lunettes quand vos amis gouvernent, cela n'a pas pu vous échapper. La crise a aggravé les choses, oui, mais nous n'étions déjà pas en bon état.
Je ne reviendrai pas sur les comparaisons avec l'Allemagne, parce que je pense que, malheureusement, ce pays reviendra à des comptes publics assainis bien avant nous.
Vous avez cru bon, monsieur le ministre, d'interpeller le groupe socialiste alors qu'en fait vous répondiez à M. Carrez. Vous nous avez fait le coup de la chatte du boulanger.
Non !

Si, si ! Parce que c'est lui, tout à l'heure, qui vous a expliqué qu'il faudrait quand même quelques recettes face à ces déficits. Or vous avez répondu en substance : « Les socialistes, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on baisse les impôts, ils ne veulent pas qu'on fasse du déficit. » Non, nous ne vous avons pas demandé de baisser les impôts. Nous ne vous avons pas demandé la loi TEPA. Nous ne vous avons pas demandé le bouclier fiscal. Nous ne vous avons pas demandé de favoriser les heures supplémentaires par rapport aux heures normales. Nous ne vous avons pas demandé toute une série de dispositions qui posent problème.
La rétrospective de ces dispositions depuis 2002 ne laisse pas d'inquiéter. En effet, avec constance sous les gouvernements de M. Raffarin puis de M. de Villepin et aujourd'hui de M. Fillon, la droite française a poursuivi une politique fiscale méthodique qui consiste à faire de la redistribution à l'envers. En réalité, vous avez mené une politique fiscale qu'en d'autres temps on aurait qualifiée de classe, mais aujourd'hui, plus justement, de caste. À bien y regarder, depuis 2002, sur 30 milliards d'euros de baisses d'impôts, 20 milliards ont bénéficié aux 10 % de contribuables les plus aisés de ce pays. C'est énorme !
Si vous entendez résorber les déficits actuels en continuant ce genre de politique, on peut craindre que ne surviennent un jour de très sérieux problèmes sociaux. Au passage, je vous trouve très optimistes d'affirmer que la crise économique est derrière nous. Dans mon département – M. Chartier n'est plus là, mais j'aurais pu lui expliquer pourquoi la fiscalité y est plus basse que dans le département voisin dirigé par l'UMP –, je vois arriver à l'horizon quelques petites catastrophes qui ne vont pas être faciles à gérer.
Non, la crise économique n'est pas totalement derrière nous, il s'en faut de beaucoup. En revanche, la crise sociale est devant nous. À la différence de notre pays, l'Allemagne a beaucoup misé, dans son plan de relance, sur l'emploi.

C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le chômage y augmente beaucoup moins vite que chez nous, sans doute aussi la raison pour laquelle ils retrouveront un niveau d'emploi cohérent quand nous serons toujours en train d'enregistrer des pertes d'emplois, même si, comme vous le dites souvent de façon formidable, madame la ministre, la hausse de la baisse ou la baisse de la hausse – on s'y perd – ralentit.
Ces 30 milliards de baisses d'impôts, dont 20 milliards sont allés aux contribuables les plus riches, sont passés par la baisse de l'impôt sur la fortune, les allégements des droits de mutation et de succession, les prélèvements forfaitaires libératoires sur les dividendes, la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et la baisse de l'impôt sur le revenu. Cette dernière a été de 11 milliards et 70 % ont profité à 20 % des foyers les plus aisés, alors que les 10 % les plus pauvres, eux, n'ont bénéficié que d'une baisse de 2 %. Cela devrait tout de même vous interpeller !
Cette redistribution à l'envers a été financée par des prélèvements équivalents sur les classes moyennes. C'est là que l'on retrouve la fiscalité locale, qui est passée de 4,9 % à 5,8 % du PIB mais, pour bien en comprendre les raisons, il faut préciser que l'État a transféré 34 milliards d'euros de charges !

S'il est vrai que, au départ, la compensation a été faite – mais pas à l'euro près, comme l'a prétendu M. Copé –, par la suite, la dynamique des dépenses ne l'a pas permis. Dans mon département, par exemple, j'en suis à 42 millions d'euros pour un budget de 500 millions.
Vous avez donc tout fait à l'envers, et c'est ce qui nous préoccupe. Vous allez demander des sacrifices aux Français, vous allez leur demander à nouveau des efforts, mais, face à l'injustice de la situation fiscale que vous avez créée, à certaines situations scandaleuses – par exemple des gens qui, encaissant 300 000 euros de revenus non taxables par le fisc, bénéficient du remboursement de la moitié de leurs impôts locaux –, nous allons dresser, tout au long de ce trimestre, un bilan que nous rendrons public au début de l'année prochaine. Vous aurez alors quelques difficultés à recueillir l'accord des Françaises et des Français. En tout cas, vous n'aurez pas celui du groupe socialiste. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous entamons le débat sur le projet de budget pour 2010, nous sommes, à quelques semaines près, à mi-mandat pour le Président de la République, mais aussi pour les députés que nous sommes.
Nous sommes aussi à un moment charnière de la crise qui s'est déclenchée il y a tout juste un an. Si certains indicateurs peuvent laisser penser qu'une timide reprise de l'activité économique se fait sentir, nous voyons, dans les territoires dont nous sommes les élus, que le chômage continue à augmenter et que de très nombreuses entreprises sont encore en grande difficulté.
J'étais encore, voilà quelques jours, avec les salariés de l'établissement Alcatel de Nantes-Orvault : ils ont appris en même temps que le deuxième trimestre de 2009 a été le premier bénéficiaire depuis onze trimestres pour leur groupe et qu'ils vont subir un nouveau plan de réduction des effectifs. Je crains que ce ne soit malheureusement un exemple très représentatif de beaucoup d'entreprises installées en France, quel que soit leur secteur d'activité. De ce point de vue, je vous le dis franchement, madame, monsieur les ministres, le satisfecit que vous vous accordez sur le prétendu succès de vos divers plans de relance me semble manquer quelque peu de décence, en tout cas d'humilité.
Je ne veux pas dire par là que toutes les mesures que vous avez prises auraient été inutiles et inefficaces, mais ayons l'humilité de reconnaître que l'état de notre économie tient à beaucoup de facteurs que nous sommes malheureusement loin de maîtriser. Ayons l'humilité de reconnaître que les facteurs de crise sont toujours là et que les effets de la crise se font toujours durement ressentir pour les salariés, les chômeurs, mais aussi les entrepreneurs.
Ce sur quoi nous pourrions peut-être tomber d'accord, c'est que le moment est venu de faire le point, voire le bilan, sur la politique que vous menez depuis deux ans et demi et sur les mesures à prendre pour sortir durablement de la crise. Il me paraît d'autant plus important de s'arrêter quelques instants sur l'articulation entre ce bilan et les perspectives à court et moyen terme qu'un élément pèse chaque jour un peu plus sur le contexte économique, donc sur nos décisions : je veux parler de l'explosion du déficit budgétaire et de la dette. Après des prévisions sans cesse revues à la hausse pour 2009, le déficit pour 2010 devait atteindre 116 milliards d'euros. Vous évoquez aujourd'hui plus de 140 milliards, sans savoir ce qu'il en sera réellement à la fin de l'année.
Ces sommes astronomiques viennent grossir la dette. Elles arrivent à des niveaux jamais atteints dans l'histoire de la République française, ni en valeur absolue ni en pourcentage du produit intérieur brut. Il est bien loin le temps où l'on se référait aux critères dits de Maastricht. Toutefois là n'est pas le plus grave. Le plus grave, les Français le savent bien, c'est qu'il faudra bien rembourser un jour cette dette. Le plus grave, ils le savent aussi, c'est que ce sera à eux de payer. Pour nous, écologistes, cette façon d'accabler les générations futures est inacceptable, d'autant que l'on tire déjà, en quelque sorte, des droits de créances sur elles en amenuisant chaque jour un peu plus les ressources naturelles. Du point de vue écologique, cela pose un problème moral. Vous comprendrez à cet égard que nous soyons totalement opposés au grand emprunt et à tout le cinéma que MM. Guaino et Sarkozy font autour.
Pour tenter d'expliquer, de justifier même, déficit et accumulation de dette, vous allez nous dire qu'il y a eu, avec le plan de relance, des dépenses exceptionnelles, et avec le ralentissement de l'activité économique, des pertes de recettes fiscales. Tout cela est vrai, mais si vous faisiez vraiment une présentation honnête de la situation aux Français, vous diriez aussi que le déficit avait déjà fortement augmenté en 2007 et en 2008, avant le déclenchement de la crise, que cette dérive des comptes de la nation était directement imputable aux nombreux cadeaux fiscaux que vous avez votés depuis deux ans et demi envers et contre toute logique économique et sociale.
Si vous faisiez oeuvre de vérité, vous n'oublieriez pas de dire que la dette avait déjà explosé sous les effets cumulés des sept années de majorité UMP depuis 2002, bien avant la crise, et même en période de croissance de l'activité.
Si vous étiez tout à fait honnêtes, vous pourriez même tempérer mon propos en disant que la situation s'est légèrement améliorée sous l'impulsion d'un Premier ministre nommé Dominique de Villepin. Or il y a des noms qu'il ne vous est plus permis de prononcer, sauf pour les désigner à la vindicte comme coupables. En la matière, ils ne l'étaient pas !
Contrairement à une autre idée reçue que vous ressassez, la dette publique n'a pas continuellement augmenté depuis 1981. Entre 1997 et 2000, le gouvernement de gauche de Lionel Jospin avait eu le courage et l'intelligence d'entamer une politique de désendettement. On se souvient que, à l'époque, cette stratégie mise en oeuvre par Dominique Strauss-Kahn avait été férocement dénoncée par le Président de la République Jacques Chirac, qui n'avait pas hésité à parler de cagnotte. Étrange conception de ce mot, quand on sait qu'il ne s'agissait que de réduire le déficit annuel et l'endettement, et qu'on était encore loin, très loin, d'avoir supprimé l'un et l'autre.
Ces petits rappels historiques, pour récents qu'ils soient, sont importants en ce qu'ils montrent qu'il n'y a nulle fatalité en la matière. Au-delà des phénomènes exceptionnels qui, par définition, ne durent pas, la situation budgétaire est le résultat direct de la politique budgétaire et fiscale mise en oeuvre par un gouvernement et votée par le Parlement.
Rappelons qu'en dehors de tout contexte de crise, vous avez fait adopter, dès juillet 2007, pour un coût annuel de près de 15 milliards d'euros, le paquet fiscal, sans la moindre étude transparente et pragmatique sur ses effets économiques. S'agissant des effets sociaux, ils sont négatifs puisque les inégalités et le sentiment d'injustice qui découlent de ces cadeaux fiscaux ne font qu'augmenter. Quant aux effets sur l'emploi, ils sont aussi négatifs puisque la seule mesure d'ampleur vise à encourager les heures supplémentaires, ce qui est complètement à contretemps en période de récession.
Le comble de l'irresponsabilité économique et fiscale, qui confine à l'indécence politique et sociale, a été atteint avec cet incroyable cadeau de 2,5 milliards d'euros aux établissements de restauration décidé cette année. La perte pour les finances publiques est indéniable quand les effets économiques et sociaux – je ne parle même pas des effets environnementaux – sont évidemment invisibles.
Pour couronner le tout, il y a cette promesse faite par le Président de la République un soir à la télévision, qui doit maintenant être mise en oeuvre à marche forcée : la suppression de la taxe professionnelle. La confusion est à son comble. D'abord, parce qu'il ne s'agit pas d'une véritable suppression : comment l'auriez-vous financée ? Ensuite, parce que, faute d'avoir pris le temps de mesurer l'impact à la fois sur les entreprises et sur les collectivités locales, on nage en pleine incertitude. Ce qui est sûr, c'est que votre choix de mise en oeuvre aura un coût pour 2010 de plus de 10 milliards d'euros, à la charge du budget de l'État.
Ce qui est tout aussi sûr, c'est qu'il n'y aura pas de miracle : si l'on veut baisser les prélèvements pour les entreprises tout en garantissant un même montant de ressources pour les collectivités locales, ce seront les ménages qui paieront la différence. C'est le non-dit de votre réforme, mais cela en sera la conséquence inéluctable. Arrêtez de parler de baisse des impôts quand votre choix est en fait de les augmenter en en faisant porter le chapeau aux élus locaux !
Ne croyez pas que je sois en train de défendre le statu quo en matière de fiscalité locale. Je suis même de ceux qui pensent que le système est doublement injuste. Les impôts locaux des Français sont loin de correspondre à leur situation de revenu ou d'habitation réelle. Songez, par exemple, qu'il vaut mieux avoir une place de parking dans sa maison plutôt qu'une chambre de plus, autrement dit mieux vaut avoir une pièce pour chacun de ses véhicules que pour chacun de ses enfants ! C'était une anecdote en passant.
Le système creuse aussi les injustices entre collectivités locales, donc entre territoires et cela est directement lié à la taxe professionnelle.
Sans vouloir aborder un sujet qui a légitimement suscité la polémique, reconnaissons que si le département des Hauts- de-Seine est très richement doté, ce n'est pas du fait de sa politique : c'est parce que l'État a décidé d'y installer La Défense il y a quelques décennies et cela sur fonds publics nationaux. S'il l'avait fait en Seine-Saint-Denis, la situation de ce département, nous le savons, ne serait absolument pas la même qu'aujourd'hui.
Le comble, c'est que votre réforme au lieu de corriger ces injustices, les aggrave. La démonstration de notre rapporteur général du budget en commission a été, à cet égard, magistrale. J'espère, monsieur le ministre, qu'il vous a transmis son exposé. J'y suis d'autant plus sensible qu'il avait choisi d'illustrer concrètement son propos en prenant l'exemple de mon département : la Loire-Atlantique. Sa conclusion était sans appel. Avec votre réforme, une communauté d'agglomération comme celle de Saint-Nazaire allait perdre près de la moitié de ses ressources tirées de la taxe professionnelle quand celle, voisine, de La Baule allait voir les siennes doubler. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous parler de la situation sociale comparée de ces deux agglomérations.
Pour ce qui nous concerne, nous faisons un choix clair, assumé devant les Français : les entreprises, toutes les entreprises, doivent contribuer aux ressources des collectivités locales, comme elles doivent contribuer au budget national.
Nos conceptions écologistes nous y amènent peut-être plus que tout autre : comment accepter que des territoires accueillent des activités, y compris des activités productrices, génératrices de nuisances, sans qu'ils puissent percevoir une contribution qui leur permette de faire vivre leur territoire en atténuant ces nuisances pour leurs habitants ? Comment ne pas voir aussi que les inégalités territoriales notamment celles issues d'héritages historiques – j'en ai donné un exemple tout à l'heure – sur lesquels les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire, créent des déséquilibres écologiques ?
Notre conception de la fiscalité locale repose sur deux principes : tout le monde contribue – et donc pas seulement les ménages – et la péréquation territoriale doit jouer sur des critères objectifs. Cela relève plutôt pour nous de la réforme territoriale, mais, comme vous avez choisi de mettre la charrue devant les boeufs en réformant à la va-vite la taxe professionnelle avant de débattre de la réforme territoriale, nous sommes obligés d'en dire un mot maintenant.
Je précise d'ailleurs que les Verts ne sont pas davantage partisans du statu quo sur l'organisation des collectivités locales. Nous n'acceptons pas le procès en conservatisme qui est fait à la gauche puisque la dernière grande réforme territoriale date de 1999 avec l'avènement des inter-communalités. Au passage, cela s'est fait avec une réforme importante de la taxe professionnelle puisque la plupart des agglomérations nées à l'époque se sont dotées d'une taxe professionnelle unique, ce qui était souvent une petite révolution. C'était en tout cas un outil concret et efficace de solidarité entre habitants de communes ayant de grandes disparités de recettes de taxe professionnelle. En outre cela a eu un effet bénéfique de lutte contre la concurrence stérile entre communes voisines, concurrence qui avait souvent des conséquences désastreuses, notamment écologiques, en matière d'aménagement du territoire dans une même agglomération, dans un même bassin de vie. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est un point d'appui qui montre qu'il est possible de marier efficacité économique, écologie et solidarité.
Vous l'avez compris : nous croyons que la première chose à faire n'est pas d'augmenter les impôts mais, au contraire, de réintroduire de la justice fiscale. Ce n'est d'ailleurs pas faire de la politique politicienne que de le dire. Toutes les sensibilités de l'opposition le soulignent bien sûr, mais cela va beaucoup plus loin. Nos propositions font leur chemin au sein même de votre majorité : un jour c'est le Nouveau Centre qui, par la voix de notre collègue Charles de Courson, propose de réduire les niches fiscales. Un autre jour, ce sont deux présidents de commissions de l'Assemblée, MM. Méhaignerie et Warsmann, qui vous invitent à revenir sur le bouclier fiscal, au moins partiellement, ou qui proposent, comme nous le faisions, il y a quelques mois, la création d'une tranche supérieure d'impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus. Même M. Arthuis, président de la commission des finances du Sénat, demande la suppression du bouclier fiscal.
Puisque vous avez toujours été sourds à nos propositions, écoutez au moins les voix qui s'élèvent au sein de l'UMP. Acceptez, monsieur le ministre, l'amendement de notre président de commission, Didier Migaud, sur la taxation exceptionnelle des bénéfices des banques, au niveau d'ailleurs modeste de 10 %. Là aussi, ce ne serait que justice. Là aussi, cela a été voté à la commission des finances, parce que des députés UMP ont eu le courage de se joindre aux députés de l'opposition.
Le Premier ministre nous avait invités au début de la crise, il y a un an, à l'union nationale. Nous n'en avions d'ailleurs pas rejeté totalement l'idée puisque nous ne nous étions pas opposés aux mesures d'urgence de sauvetage du système de financement de l'économie. Vous aviez pourtant systématiquement refusé nos propositions de bon sens comme la présence de l'État au sein des conseils d'administration des banques.
Vous avez, monsieur le ministre, l'occasion de traduire en actes cette volonté d'union nationale. Si, pour une fois, cette union, au-delà des clivages partisans, se faisait sur le terrain de la responsabilité budgétaire et de la justice fiscale, ne serait-ce pas un signe encourageant pour les Français en ces temps de crise ? Vous avez fait quelques pas dans le sens de la fiscalité écologique, avec la taxe carbone ; j'y reviendrai dans le débat car nous avons de nombreux amendements à ce sujet et j'espère que vous en accepterez un certain nombre, sans quoi le dispositif sera incomplet et pour tout dire bancal. Vous avez enfin repris l'idée, que je crois avoir été le premier à défendre ici même dès juillet 2007, de conditionner à des critères de performance énergétique les avantages fiscaux pour les investissements immobiliers.
Nous vous appelons à faire des pas supplémentaires. Ne restez pas droit dans vos bottes, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

Madame la présidente, mes chers collègues, année après année, je suis intervenu dans le débat budgétaire depuis 2002. J'ai malheureusement toujours péché par excès d'optimisme. Ainsi j'avais, dès le 16 octobre 2007, ici même, souligné l'effet dramatique qu'aurait sur le ralentissement de nos économies européennes la crise financière qui avait éclaté quatre mois plus tôt aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais j'en étais encore, le 21 octobre 2008, à évaluer le déficit pour 2009 en indiquant qu'il se situerait « très largement au-delà de 60 ou 65 milliards d'euros » ! C'est dire à quel point j'ai péché par optimisme.
Quelques semaines après, à l'École nationale d'administration, j'avais indiqué qu'il fallait s'attendre à 80 milliards d'euros. J'étais encore d'un optimisme béat.
En juin 2008, je disais ici que «plutôt que de se cramponner à des prévisions de croissance auxquelles nul ne peut croire dans un monde en crise, l'une des plus graves depuis cinquante ans », il fallait tenir le langage de la vérité comptable. Cet optimisme était toujours relativement excessif.
Je voudrais essayer, ce soir, d'être un peu plus réaliste.
Franchement, nous ne pourrons commencer à parler de la crise au passé que lorsque nous aurons, dans le monde entier, réglé trois problèmes : le déséquilibre structurel des balances de paiements courants, le rôle du dollar, la résorption dans les comptes des banques des actifs liquides que je préfère appeler les actifs virtuels.
Or, aujourd'hui, si la question des déséquilibres structurels des balances des paiements a commencé à être abordée pour la toute première fois au dernier G 20, rien n'a été décidé ni entrepris dans ce domaine, à part quelques vagues pétitions de principe. La résorption des actifs virtuels des banques reste très partielle malgré des injections de fonds publics en provenance des banques centrales et des États, qui, au niveau mondial, représentent des milliers de milliards de dollars. Je rappelle d'ailleurs que des banques font régulièrement faillite, en particulier aux États-Unis. Il y en a eu environ quatre-vingt-dix, et ce ne sont pas de petits établissements bancaires.
Le dollar amorce une courbe descendante, de plus en plus inquiétante, que rien ni personne ne pourra arrêter. Contrairement à une idée reçue, cette chute, si elle peut constituer un avantage compétitif pour les États-Unis, est une véritable catastrophe pour l'économie mondiale.
Nous ne pouvons prévoir, en tout cas en Europe, qu'une longue période de croissance très molle, sans exclure la possibilité d'une nouvelle crise financière, extrêmement violente, qui affectera cette fois-ci la sphère financière publique.
J'ajoute que le retour parfaitement illusoire et artificiel à une certaine rentabilité dans les banques, grâce à des injections massives de liquidités quasi gratuites et sans que cela se traduise par une relance de l'économie réelle sur la base d'une reprise du crédit, est extrêmement mal ressenti par les opinions publiques, qui voient le chômage s'aggraver, l'économie du quotidien s'étioler, ce qui rend toute reprise illusoire.
Dans un tel contexte, nous devons tous admettre l'extrême difficulté à présenter un budget et aussi à en débattre. Peut-être faudra-t-il un jour que nous essayons un peu plus de nous accorder sur une analyse commune des questions financières globales, ce qui devrait être possible en France. C'est d'ailleurs le cas très largement dans la plupart des pays comparables et, à cet égard, je dois dire, une fois n'est pas coutume, que je partage la philosophie exprimée par Mme Lagarde dans un récent article du Financial Times, où elle remarque essentiellement que nous n'avons fait que la moitié du chemin et que nous devons, non pas revenir en arrière, mais avancer pour construire un avenir financier meilleur et plus sûr.
La question budgétaire fondamentale est de savoir ce qui est indispensable, à court, moyen et long terme, et ce qui est soutenable à court terme, c'est-à-dire pour les trois prochains exercices.
Le soutien à la conjoncture est incontournable ; c'est une évidence. On ne peut aujourd'hui réduire de manière significative nos déficits si l'on n'engrange pas un peu de retour de croissance. C'est ce que vous faites, puisque vous essayez de maintenir une relance globale du soutien à la conjoncture.
Dans le même temps les collectivités locales vont – si l'on va jusqu'au bout de la logique de ce budget en termes de dotations de compensation et de fiscalité – marquer un recul sensible de leurs investissements, lesquels représentent les deux tiers voire les trois quarts de l'investissement public en France. Par conséquent, ce que l'on va donner d'une main pour activer la relance ou, en tout cas, pour continuer à soutenir la conjoncture, on va le retirer de l'autre.
Nous n'en sommes pas à la fin de la crise, pas même au commencement de la fin de la crise, parce que la crise financière elle-même est très loin d'être terminée et qu'une crise financière gravissime peut encore éclater à tout moment dans ce que j'appelle la sphère financière publique, celle des déficits des États, du gonflement des bilans des banques centrales et de la folle accumulation de liquidités spéculatives libellées en dollars dans un système monétaire international qui échappe largement à tout contrôle et qui constitue aujourd'hui la plus vaste des bulles financières de l'histoire. Je crois que c'est malheureusement le constat que l'on peut faire aujourd'hui.

Madame la ministre de l'économie, monsieur le ministre du budget, vous nous présentez un budget en pleine crise. On peut se féliciter que cette crise ait été particulièrement bien gérée, d'abord par le Président de la République, le Premier ministre et le Gouvernement.

Je crois que tout le monde le reconnaît. (Protestations sur les bancs du groupe SRC.)
Lorsque le Président de la République était président de l'Europe, l'action qu'il a menée a fait que, pour la première fois, l'Europe a eu une réaction commune, notamment pour le sauvetage des banques.

L'action du Président de la République a permis de mettre en place le sommet de Washington. Si le G 20 est apparu, c'est grâce à l'action du Président de la République. Tous le reconnaissent dans le monde. Il n'y a que l'opposition française pour nier l'évidence. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Néanmoins, je ne vous cacherai pas que les déficits de ce budget sont inquiétants pour nous tous, même si, en plein milieu de la crise, il n'est pas possible d'avoir un budget sans un tel déficit. Il faudra, je crois, dans les semaines, dans les mois qui viennent, avoir un vrai débat et une vraie stratégie pour lutter, comme le font beaucoup de pays européens, contre les déficits qui gangrèneront notre économie si nous n'y faisons pas face.

Je vais aborder la réforme de la taxe professionnelle.
Madame la ministre, je tiens à vous remercier. En effet, cela fait un an que la commission des finances travaille sur la réforme de la taxe professionnelle. J'entends le président du groupe socialiste dire que tout cela est fait dans la précipitation ; qu'il faut reculer. Ceux qui ne veulent jamais de réformes affirment toujours que ce n'est pas le moment ; que l'on verra dans un an et qu'il faudra le faire au moment de la réforme des collectivités locales. Bref, il ne faut jamais faire de réformes !
Grâce à votre action, madame la ministre, et à celle de vos services, nous avons pu travailler ensemble pour la réforme de cette taxe professionnelle, qui était attendue depuis plus de vingt ans. De réformes en réformettes, tout le monde s'accordait à dire que c'était l'impôt le plus imbécile qui pénalisait nos entreprises, leur compétitivité ainsi que leurs investissements ; bref, un facteur de délocalisation extrêmement important.
La réforme de la taxe professionnelle tant attendue est une très bonne nouvelle d'abord pour nos entreprises. Pour l'année 2010, cela représentera un peu plus de 10 milliards d'euros d'économies, ce qui permettra aux entreprises, dans la deuxième phase du plan de relance, d'être plus compétitives, de lutter contre le chômage et les délocalisations ainsi que d'avoir des perspectives d'embauche.
Cette réforme est également une bonne nouvelle pour les collectivités locales. Ce qui restait de la taxe professionnelle, il faut bien le reconnaître, n'était pas une ressource dynamique. Or les collectivités locales ont besoin d'avoir des perspectives. En donnant une partie de valeur ajoutée et une partie de contribution locale d'activité, cette réforme permettra de redynamiser les collectivités locales.
Avec votre accord, madame la ministre, la commission des finances a réécrit une partie du texte du Gouvernement. Parce que nous croyons au développement économique, il nous a paru extrêmement important de restaurer le lien entre les entreprises et les territoires. Si la contribution locale d'activité est liée au territoire, elle ne représente que 20 % de l'ancienne taxe professionnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons transféré une partie de ce qui proviendra de la valeur ajoutée aux territoires. Sans abaissement du barème, les territoires ruraux seraient extrêmement défavorisés.
Comment cela se passe-t-il concrètement sur nos territoires ?
Si l'on trouve de nombreuses entreprises dans les territoires ruraux, c'est grâce à la ténacité des maires et des présidents d'intercommunalités qui se sont battus et qui ont investi. Dans mon département, des intercommunalités et des communes vendent des terrains industriels en dessous du prix de revient pour avoir des activités et des emplois sur leur territoire. Il est évident qu'il faut un retour sur investissement. Or vous savez, madame la ministre, que des entreprises de plus de 20 millions ou de 50 millions de chiffre d'affaires qui paient 1,5 % de la valeur ajoutée, il n'y en a pas beaucoup. Je vous invite à revenir sur le terrain, dans mon département, pour en faire le constat.
Là où il y a cinquante entreprises avec un million de chiffre d'affaires chacune, il n'y aura aucun retour sur les investissements pour tenter d'attirer des entreprises.

Telle est la logique qui a prévalu à la commission des finances.
En revanche, je me réjouis du transfert d'impôts dynamiques. La TSCA a été transférée aux départements. Si, dans un premier temps, elle a eu des effets bénéfiques, ce ne fut pas le cas par la suite. En revanche, pour l'État, ce fut positif, avec 4,7 % de hausse ces cinq dernières années. L'État ayant décidé de transférer l'ensemble, ce sera un impôt dynamique pour les départements et l'on ne peut que s'en féliciter.
Qu'est-ce que la valeur ajoutée, sinon l'augmentation du PIB ? On ne peut pas espérer mieux comme dynamique. Certains objectent que la taxe professionnelle avait, à une certaine époque, un rendement supérieur au PIB. Là résidait le problème. Avec un impôt qui rapporte plus que le PIB, il ne faut pas sortir de l'ENA pour comprendre que cela ne peut pas durer. C'est la raison pour laquelle, l'abolition de la taxe professionnelle s'impose.

Un mot, madame la présidente, sur les droits de mutation qui ont eu un effet extrêmement favorable sur les collectivités locales.
En dix ans, ils sont, en effet, passés de 3,5 milliards d'euros à 7 milliards d'euros pour les départements. J'ai déposé un amendement qui s'inscrit dans la complémentarité de la réforme de la taxe professionnelle. Qu'on le veuille ou non, l'abolition de cette taxe peut pénaliser les territoires ruraux.

Je ne reviens pas sur la dynamique qui est naturelle pour ceux qui se sont battus. Si, dans un département, on obtient le double de l'inflation, la moitié va à un fonds de péréquation pour aider les départements qui ont des rendements inférieurs.

Vous avez, madame la ministre, présenté un très bon budget et il va sans dire que nous le voterons. Je vous invite cependant à réfléchir à la réforme de la taxe professionnelle et à vous pencher sur la proposition de la commission des finances qui a fourni un bon travail. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Marc Laffineur a abordé la réforme de la taxe professionnelle. Au nom du groupe socialiste, je ne traiterai que ce thème.
Réformer un tel impôt n'est pas une mince affaire dans la mesure où celui-ci représente tout de même plus de 35 milliards d'euros de recettes dont 9 milliards sont payés par l'État au titre de dégrèvements multiples. Je rappelle que la réforme Strauss-Kahn en avait retiré la part salaires. Il devenait nécessaire de modifier cet impôt car la partie EBM – équipements et biens mobiliers – est devenue prépondérante du fait de la suppression de la part salaires. L'impôt a été de plus en plus dynamique sur la base de la modernisation de l'outil de production.
Je souhaite mettre les choses en perspective : d'où venons-nous et où voulons-nous aller en la matière ?
La réforme de 1975, qui a beaucoup à voir avec celle d'aujourd'hui, souhaitait avantager deux catégories : les commerçants et les artisans, en supprimant la patente. Cela a bien fonctionné, mais en infléchissant immédiatement le processus. En retirant le pas-de-porte, M. Chirac, à l'époque Premier ministre, a fait porter le poids de l'impôt sur l'industrie.

L'industrie qui disposait de la masse salariale investissait massivement. Bien entendu, c'est elle qui a supporté la grande charge de cet impôt.
J'ai travaillé avec vous, madame la ministre, ainsi qu'avec vos services, Gilles Carrez, Didier Migaud et Marc Laffineur. On ne peut guère prétendre que le représentant de l'opposition que je suis n'a pas joué le jeu car il en allait de l'intérêt de la collectivité nationale.
Je fais d'abord observer que nous sommes un contexte analogue à celui de 1975. Vous voulez avantager – et le Président de la République l'a dit – toutes les entreprises. Selon vous, il ne doit pas y avoir de perdants. L'objectif est louable et vous avez beaucoup de mérite.
Si l'on veut – et votre souci est partagé et compris par mes collègues du groupe socialiste – se préoccuper du monde industriel, il faut ne pas qu'il subisse un impôt économique local pénalisant par trop l'industrie. L'on peut donc essayer d'avancer avec des solutions de substitution.
La valeur locative foncière que l'on retrouvera dans la cotisation locale d'activité représente 20 %, comme vient de le rappeler Marc Laffineur, de la taxe professionnelle d'hier. Cela donnera une base géographique à la localisation de l'entreprise, mais ce n'est pas suffisant. La valeur ajoutée sur laquelle nous avions travaillé et que vous avez reprise dans le texte, a d'abord été réservée à la région et au département. Les élus – maires et responsables d'intercommunalité – ont voulu en avoir une partie. Vous avez donc proposé la contribution complémentaire. Nous pouvons trouver un accord sur ce point.
En revanche, je suis en total désaccord sur l'assiette qui doit être, selon moi, la plus large possible parce qu'on doit, à tout prix, éviter un système d'assistanat pour les collectivités. Il ne faut pas non plus que ce soient des dotations d'État, car elles ne pourront pas être pérennes. On le voit avec la DGF ; si l'on retire le FCTVA, on est à 0,6 %. Ce n'est pas une catastrophe, mais les niveaux sont déjà bas.
Dès que nous serons sortis de la crise, Bruxelles nous demandera de faire des efforts. Or vous ne disposerez pas de moyens significatifs pour répondre à cette demande. Plus il y aura de dotations en lieu et place de l'impôt, pire ce sera pour les collectivités locales.

Ce sera également très mauvais pour les déficits publics de l'État. Nous n'avons pas voulu, à la commission des finances, entrer dans cette mécanique qui pourrait, certes, satisfaire certains élus locaux, mais certainement pas les élus nationaux que nous sommes. Du point de vue de la pérennité du dispositif pour les collectivités, cela n'est pas satisfaisant non plus. Nous avons donc considéré qu'il était raisonnable de s'enfermer le moins possible dans un système de dotations d'État.

L'assiette doit être large et ne pas se contenter des 7,6 millions de chiffre d'affaire pris en compte dans la taxe professionnelle.
Je ne vais pas refaire l'histoire de la taxe professionnelle. Je rappelle simplement que, malheureusement, dès 1977, le gouvernement de M. Barre, qui faisait suite à celui de M. Chirac, a dû prendre des dispositions pour l'amender, puisque plusieurs entreprises, en particulier industrielles, étaient surtaxées. À un moment de cette histoire, on a introduit la valeur ajoutée à 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires était supérieur à 7,6 millions d'euros.
Or, si l'on allège considérablement le secteur industriel – tel est le parti pris du texte, et on ne saurait, une fois encore, le critiquer –, il faut faire en sorte que les entreprises qui ne contribuaient pas de manière importante au lien territorial y participent davantage. Il ne faut donc pas dire qu'il ne peut y avoir que des gagnants dans cette affaire ; c'est une ineptie.

Dire cela revient à dire qu'il y aura de grands perdants : les collectivités locales. (Approbations sur les bancs du groupe SRC.)
Il faut donc reconnaître, de manière responsable, que l'on allège le secteur industriel parce qu'il est soumis à la mondialisation et, bien évidemment, aux délocalisations.

Cependant soyons responsables, et non outranciers : cela signifie aussi que les taux – auxquels je vais venir après avoir évoqué l'assiette – doivent être raisonnables…

…, mais sur une base large. Voilà toute la philosophie qui doit nous inspirer.
Entrons quelques instants dans les détails techniques.
Que se passe-t-il si l'on applique au niveau intercommunal la cotisation à la valeur ajoutée ? Marc Laffineur vient d'en parler, mais, au-delà du seul monde rural, il en va de même de nombreuses villes moyennes en France : allez donc trouver des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'euros dans des villes de 50 000 à 70 000 habitants ! Le système graduel que vous avez inscrit à l'article 2 du « bleu » tel qu'il a été présenté évite certes de faire trop de perdants ; mais, si vous descendez la valeur ajoutée, cela revient à ne rien descendre du tout, puisque le chiffre d'affaires de la majorité des entreprises atteint 15, 20 ou 30 millions au maximum, seul celui d'établissements très importants dépassant 50 millions.
Prenons-y donc garde : à trop vouloir bien faire, on ne redescendra rien du tout. S'agissant du produit fiscal qui sera redescendu au titre de la cotisation complémentaire, fondée sur la valeur ajoutée, les agrégats, qui sont possibles aux niveaux régional et départemental – ce que montrent les simulations –, le seront d'autant moins que l'on descendra, en particulier si l'on descend au niveau intercommunal, sauf à élargir l'assiette.

Deuxièmement, nous avons fait des simulations ; certains bassins d'emploi sont fortement industriels.
Je n'aime pas parler de mon département, car nous ne siégeons pas ici en tant qu'élus locaux. Je citerai donc l'exemple de mon collègue Michel Delebarre, maire de Dunkerque et président d'une communauté urbaine où doivent être localisées des activités lourdes, porteuses de retombées de type Seveso, et dont le produit va chuter de plus de 50 %.

Ce n'est pas scandaleux, mais, dans ce cas, l'assiette doit être large et le débit puissant, pour permettre une véritable péréquation. Sinon, il s'agira d'un système de dotation. Nous devons y être très attentifs.
Dans ce pays de Gaulois, on a déjà vu, dans les communautés concernées par la TPU, des communes refuser d'avoir des activités chez elles…

…parce que cela était sale, puait, faisait du bruit et gênait les habitants. On connaît déjà cette forme d'égoïsme qui consiste à se défausser sur les autres.

Je le dis un peu solennellement : il faut des retombées fiscales réelles pour les communautés et les communes, qu'elles soient de droite ou de gauche, qui acceptent d'accueillir des usines chimiques…

Je reprends l'exemple de Dunkerque, où un port méthanier est en cours de réalisation. Cela ne représente que cinquante emplois, mais ce n'est pas négligeable en termes stratégiques. L'absence de lien fiscal, de production de richesse réelle, entraînera l'abandon de ces activités par les collectivités. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur divers bancs du groupe UMP.)

Troisièmement, madame la ministre, il ne doit pas y avoir de dotation fiscale. Pour expliquer ce que cela signifie, je vais de nouveau entrer dans les détails techniques, mais vous m'avez déjà compris.
La contribution à la valeur ajoutée est globalisée au niveau national. Il faudra du reste, si possible, adopter des amendements permettant d'intégrer les filiales au bilan consolidé à partir de 50 %. Notre rapporteur général a appliqué la mesure aux filiales à 95 %, mais allez trouver des filiales à 95 % ! Cela fait déjà un peu d'argent ; mais, disons le entre nous, il faudra aller jusqu'à 50 % : plus le produit sera élevé, mieux cela vaudra pour effectuer la péréquation.
Toutefois il est essentiel qu'il ne s'agisse pas d'une dotation fiscale, c'est-à-dire que le produit, une fois établi au niveau national, ne soit pas réaffecté de manière en quelque sorte anonyme, sans lien véritable avec la création de richesse. Je sais que vos services, pour des raisons purement techniques, considèrent que ce serait plus facile : on consolide au niveau national, puis on réaffecte selon un critère de population, d'effectifs, de superficie occupée, peu importe, mais il s'agit déjà d'une dissociation d'avec la responsabilité locale.

Cela va de pair avec mon affirmation selon laquelle nous devons être attentifs à conserver ce lien indéfectible entre la création de richesse et l'entreprise, non sans en profiter pour alimenter la péréquation. C'est là mon grand reproche : le texte tel qu'il a été préparé, y compris avec les amendements du rapporteur général, prévoit une péréquation pour la contribution à la valeur ajoutée aux niveaux régional et départemental, mais non en deçà.

Or les disparités entre agglomérations, entre communautés, sont considérables. Il existe ainsi des communautés de communes situées en milieu rural, composées de villes moyennes ou de petites villes, mais qui incluent de gros établissements industriels. Ces communautés vont s'effondrer, faute d'accueillir suffisamment de sièges de sociétés et de sociétés tertiaires.
Nous devons donc nous doter d'emblée d'un système de péréquation. On peut certes envisager de l'instaurer a posteriori, mais je me méfie beaucoup de cette possibilité, car, dans notre pays, nous créons des impôts sans jamais nous doter du système de péréquation correspondant, à la différence des Allemands, qui ont inscrit dans leur loi organique leur système de répartition et de péréquation. Nous devrions donc établir ce système dès la création du nouvel impôt. Une fois encore, il existe aux niveaux régional et départemental, mais non intercommunal ; nous devons nous en soucier aujourd'hui au lieu de l'inventer dans quelques années, au moment où nous connaîtrons une véritable déferlante.

Je termine, madame la présidente.
Je prononce cette intervention au nom de mon groupe ; on peut stigmatiser l'opposition, mais je vous assure que le groupe socialiste a travaillé sur cette question, qui passionne tous les élus. Et encore, ici, avez-vous affaire à des gens calmes ! (Sourires.) Notre système est en effet bicaméral, et ceux qui sont réputés sages ne seront peut-être pas les plus sages. (Sourires.)

Voilà pourquoi nous devons tenter de construire un dispositif suffisamment solide pour les territoires et pour assurer le lien entre création de richesse et territoire, entre disparition de la taxe professionnelle et péréquation car des écarts absolument colossaux vont se faire jour.
Je voulais vous dire tout cela avec une certaine modération, mais aussi avec une grande fermeté.

En effet si les choses ne se passent pas correctement, notre pays connaîtra un joli bazar ! Je l'ai dit quelque peu solennellement à mes collègues en commission des finances : ce ne sera pas tous les jours dimanche pour ceux qui auront accepté certaines mesures sans les modifier. Nous devons être intransigeants, même si cela demande un peu plus de temps. Ce n'est pas grave ; l'important est de tenter de parvenir à une solution juste et équitable. Or, à l'heure actuelle, les collectivités peuvent être assurées du fait que la solution retenue n'est ni juste ni équitable.
Il faut donc continuer de travailler dans le sens initié par la commission des finances. Tout membre de l'opposition que je sois, je ne me plains pas du travail qui a été effectué, mais je pense qu'il faut aller plus loin pour éviter des désagréments majeurs. Cette réforme doit être une réussite pour l'industrie, mais tout le monde ne peut pas en sortir gagnant ; il doit aussi y avoir des perdants. C'est en assumant ce discours et en s'occupant des ressources des collectivités que l'on parviendra à un équilibre entre la production de richesse et la vie de nos collectivités. (Applaudissements sur tous les bancs.)

Madame la présidente, mes chers collègues, je consacrerai le temps qui m'est imparti à une intervention générale.
Une fois de plus, madame la ministre, votre budget est favorable aux possédants, au détriment des petites gens. Le déficit public de cette année 2009 atteint un niveau record de 141 milliards d'euros, contre 56 milliards en 2008 ; mais nous avons entendu notre collègue Marc Laffineur : tout va très bien, et les riches de ce pays peuvent continuer à bénéficier de toutes les aides et exonérations fiscales possibles, instaurées par le Président de la République pour satisfaire sa clientèle.
Il n'est pas question pour vous de remettre en cause le bouclier fiscal, si coûteux en période de crise et si scandaleux socialement. Vous nous l'avez du reste répété cet après-midi. En revanche, vous en êtes réduite à grappiller des sommes de façon indécente, en supprimant l'exonération partielle d'impôt sur le revenu sur les indemnités de départ volontaire à la retraite, ou en prévoyant, par le subterfuge d'un amendement, d'imposer les indemnités journalières des accidentés du travail ; vous avez également défendu à nouveau cette dernière mesure au cours de l'après-midi.
Pendant ce temps, les rentiers se portent bien et la fameuse valeur travail est renvoyée aux oubliettes : bouclier fiscal, baisses de l'impôt sur la fortune, allégement des droits de mutation et de succession qui fait que, aujourd'hui, 90 % des héritiers en ligne directe n'ont plus à payer de droits de succession. Cette politique fiscale est une immense injustice sociale qui ne contribue à favoriser que les familles d'héritiers, au mépris de tout le discours sur le mérite républicain.
La France est la championne des niches fiscales : on en dénombre 464, qui permettent aux contribuables, en général les plus aisés, d'économiser jusqu'à 70 milliards d'euros.
Étant donné l'importance de la fiscalité indirecte – TVA, TIPP – et des impôts sociaux proportionnels – CSG, CRDS –, les prélèvements sont toujours aussi peu progressifs. Vous avez vidé de sa substance le seul impôt progressif, l'impôt sur le revenu : passé de 3,2 % à 2,6 % du PIB, il ne représente plus que 15 % des recettes fiscales, contre près de 30 % en moyenne dans les autres pays de l'OCDE. La tranche supérieure du barème de l'impôt sur le revenu n'est plus que de 40 %. Sur les 11 milliards d'euros par an que représentent les réductions d'impôt décidés par les gouvernements de droite, 70 % profitent aux 20 % des foyers les plus aisés.
Venons-en à la fiscalité écologique.
Oui, la planète est désormais en état d'urgence. Le changement climatique dû aux émissions de gaz à effets de serre liées aux activités humaines met en danger la vie sur terre. Face à cette situation, il ne suffît pas, comme le propose le Gouvernement, de repeindre en vert le capitalisme et de faire de la taxe carbone l'alpha et l'oméga de la fiscalité écologique.
Telle qu'elle est conçue, la taxe carbone sera injuste socialement et inefficace du point de vue environnemental, puisque les entreprises les plus émettrices de CO2 ne la paieront pas. L'énergie électrique en est exclue, ce qui crée ainsi un effet d'aubaine pour la filière nucléaire. Cette taxe va concerner des dépenses contraintes des ménages, sans proposer de modes de chauffage et de déplacement alternatifs. Elle sera même payée par les locataires, qui ne choisissent pourtant pas leur mode de chauffage.
De plus, le mécanisme de redistribution est un leurre social puisqu'il n'est soumis à aucun critère de revenu.
Dans le même temps, le Gouvernement accumule les non-sens écologiques : libéralisation de l'énergie et du rail, fermeture ou privatisation des services publics de proximité, ouverture des commerces le dimanche et augmentation subséquente des déplacements, plan de relance favorable aux autoroutes et au transport aérien.
Pour marquer une logique radicalement différente en matière de fiscalité écologique, j'ai déposé avec les députés du Parti de gauche une proposition de loi pour une autre fiscalité écologique afin de mettre en débat des propositions à la hauteur de l'urgence écologique. J'en reprendrai l'essentiel sous forme d'amendements au cours de l'examen des articles du projet de loi de finances ; ainsi vous ne pourrez plus prétendre que nous ne faisons pas de propositions.
Parmi les efforts supplémentaires à accomplir, il importe de durcir le dispositif du bonus-malus automobile ainsi que de supprimer le super bonus pour les véhicules électriques individuels qui ne sont aucunement des voitures propres. Vingt nouveaux réacteurs nucléaires seraient en effet nécessaires pour une substitution totale du parc automobile actuel. De plus, les batteries adéquates ne peuvent être produites qu'en surexploitant les réserves mondiales de lithium dont l'extraction requiert une très grande quantité d'eau.
Je proposerai également d'abroger les niches fiscales néfastes pour l'environnement, qui incitent au mésusage des ressources.
Le grand écart des disparités de revenus est non seulement à l'origine de profondes inégalités sociales mais également la cause du renforcement d'une classe de riches, gaspillant et détruisant par des consommations de loisir de luxe les ressources de notre pauvre planète. Force est de constater que cet imaginaire de consommations somptuaires fondé sur le « toujours plus » contamine toute la société en faisant des habitudes de consommation des plus aisés un modèle de la réussite.
Notre proposition prévoit, en outre, la création d'un revenu maximal autorisé, fixé à hauteur de vingt fois le revenu médian annuel, soit 352 000 euros selon les derniers chiffres de l'INSEE.
Cette mesure s'articule avec l'abrogation du bouclier fiscal, l'instauration d'un salaire maximum à hauteur de vingt fois le salaire minimum, ainsi qu'avec un nouveau barème de l'impôt sur le revenu passant par la création de neuf nouvelles tranches d'imposition destinée à garantir la progressivité de l'impôt jusqu'à la tranche de 100 %.
Nous considérons que la fiscalité ne peut, à elle seule, modifier l'ensemble des comportements les plus destructeurs des éco-systèmes. De même, la lutte contre l'effet de serre ne peut se réduire à la somme des modifications de comportements individuels. Seule une volonté politique permettra de rompre de manière décisive avec le système.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget pour 2010 n'est pas un budget comme les autres puisqu'il nous conduit à remodeler en profondeur la fiscalité locale de notre pays.
Il procède par raccroc, partant d'une louable intention : personne ne peut raisonnablement récuser le bien-fondé d'une réforme qui vise à remettre en cause un impôt, la taxe professionnelle, dont l'assiette pénalise les investissements productifs de nos entreprises.
Cette suppression prend certes place parmi les trop rares instruments de lutte contre les délocalisations industrielles, mais elle ne saurait se substituer aux protections indispensables à mettre en place face aux concurrences commerciales et monétaires déloyales.
La question de la fiscalité locale est abordée de biais, à partir de la nécessité de compenser le manque à gagner résultant pour les collectivités de la suppression de la taxe professionnelle. Le projet du Gouvernement a été élaboré en prenant trop exclusivement en compte le point de vue des investissements des entreprises et pas suffisamment celui des investissements des collectivités territoriales, alors que ces deux éléments sont intimement liés. Il appartient donc au Parlement de corriger ce déséquilibre en clarifiant les termes du débat.
La réforme sera un succès si elle allège la charge des entreprises sans porter atteinte au dynamisme de l'investissement des collectivités territoriales, dont la taxe professionnelle a été depuis plus de trente ans le principal carburant. La réforme sera en revanche un échec si l'allégement apporté aux entreprises doit être payé par un affaissement de l'investissement local, dû à des recettes fiscales moins évolutives sur lesquelles les élus n'auraient pratiquement plus de marge de manoeuvre.
Il serait paradoxal qu'une réforme destinée à favoriser notre développement économique ait pour conséquence un ralentissement du niveau des investissements locaux indispensables pour accompagner et conforter ce développement.
Respecter l'autonomie et la responsabilité fiscale des collectivités locales signifie que la taxe professionnelle ne doit pas être remplacée par des impôts dont les collectivités ne maîtriseraient ni les taux ni l'assiette. La part des recettes dont les collectivités ont la maîtrise ne doit pas baisser.
Cela implique également que l'on ne substitue pas l'octroi de dotations budgétaires nationales à l'exercice des responsabilités fiscales locales. Il faut proscrire le retour à une logique de dotations qui transformerait les collectivités territoriales en établissements publics.
Cela implique ensuite que la nouvelle cotisation complémentaire retienne une approche territorialisée de la valeur ajoutée. Cela ne serait toutefois pas suffisant. Pour que celle-ci ne fonctionne pas comme une dotation, chaque collectivité devra pouvoir en moduler le taux, peut-être à l'intérieur d'une fourchette, mais en disposant dans tous les cas d'une marge de manoeuvre suffisante.
Cela implique encore que l'assiette retenue ne pénalise pas les territoires dont le tissu économique est essentiellement constitué de PME, notamment dans les zones rurales. Pourquoi ne pas prévoir une part majorée en faveur des départements ruraux et des petites communes ?
Dans l'exercice de réécriture auquel s'est livrée la commission des finances, le souci de réaffirmer le lien indispensable entre l'entreprise et le territoire l'a conduite à proposer le transfert aux communes et intercommunalités de 20 % de la cotisation complémentaire. Cette part est entièrement prélevée sur celle que le projet gouvernemental attribuait aux départements, sans qu'il soit touché à la part régionale. On ne comprend d'ailleurs pas très bien pourquoi. Il faut conserver la possibilité de faire évoluer ces ratios entre collectivités en fonction du résultat des simulations.
S'il est indispensable que les communes et les communautés de communes disposent d'une ressource dynamique – elles sont en première ligne en matière de développement économique et doivent être fiscalement incitées à poursuivre leurs efforts –, il est essentiel que le transfert opéré à leur profit n'ait pas pour conséquence de casser la capacité d'initiative des départements. Ceux-ci jouent en effet un rôle déterminant dans le développement économique par leurs aides à l'immobilier d'entreprise, aux zones d'activité, aux projets industriels innovants versées au titre de leurs responsabilités en matière de dessertes routières et de l'action qu'ils mènent à travers les comités d'expansion.
La loi devra donc retenir des recettes compensatrices ayant le même dynamisme que celles qu'elle transfère en laissant aux départements une véritable marge de manoeuvre.
Ce débat est difficile parce que nous devons nous prononcer sur une réforme aux conséquences très lourdes sans disposer de toutes les simulations qui nous permettraient d'en apprécier les effets avec suffisamment de précision. Nous devons donc conserver le maximum de souplesse et de pragmatisme pour adapter, en profondeur s'il le faut, le dispositif au cours de l'année 2010, avant son entrée en vigueur, en fonction des simulations dont nous disposerons.
Nous devons également fixer une clause de rendez-vous après la mise en application de la réforme pour nous assurer que celle-ci réponde bien, dans les faits, au double objectif d'alléger les charges des entreprises et de garder intacte la capacité d'investissement des collectivités territoriales.

Un budget volontariste. un budget écologique, deux raisons, madame la ministre, monsieur le ministre, de soutenir le projet de loi de finances que vous nous proposez. Pour autant, tout est-il parfait ? Non, bien sûr. Deux sujets au moins méritent une attention toute particulière : les risques qui s'attachent à l'augmentation de la dette ; l'incidence de la fiscalité sur la compétitivité de nos entreprises.
Le déficit serait moins préoccupant s'il était uniquement français. Or il est mondial. Pour endiguer la crise, tous les pays du monde ont pratiqué une politique de relance, c'est-à-dire de déficit, si bien que s'est constituée sur l'ensemble de la planète une immense dette qu'il faudra bien résorber. Pour le moment, loin de se résorber, cette bulle continue à grossir, portant en elle un risque majeur, celui de faire douter un jour les investisseurs de la solvabilité des États. Ce risque n'est pas immédiat, mais qu'en sera-t-il demain ? Si le doute s'installait, s'ensuivrait une crise plus redoutable encore que celle que nous traversons aujourd'hui : remontée brutale des taux d'intérêt sur les obligations d'État, raréfaction du crédit, récession généralisée. Cette crise de confiance, je le crains, n'est pas une hypothèse d'école.
La notation de pays comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande, la Norvège n'a-t-elle pas d'ores et déjà été revue à la baisse ? Que dire de la crise de l'Islande ou la Californie ? Et comment interpréter la récente remontée des cours de l'or, phénomène dont on sait qu'il est souvent annonciateur de crises obligataires ?
Si je crois nécessaire d'évoquer ce sujet, ce n'est pas pour jouer les Cassandre, mais afin que chacun dans cet hémicycle mesure que jamais il n'a été aussi important ni aussi urgent d'assainir nos finances publiques. Pour ce faire, il faut non pas reprendre l'escalade des impôts mais traquer les dépenses qui ne concourent pas directement à la reprise économique, dépenses de fonctionnement le plus souvent, mais aussi parfois dépenses d'investissement.
L'exercice est difficile, nous le savons tous. Néanmoins madame la ministre, monsieur le ministre, s'il est un domaine dans lequel nous devons, collectivement, faire mieux, c'est bien celui-ci.
C'est à cet exercice que nous sommes appelés dans la préparation non seulement du budget 2010 mais aussi de la loi de financement de la sécurité sociale et, plus tard, de la réforme territoriale, tant il est vrai que réforme de l'État, réforme des collectivités territoriales et réforme de la protection sociale sont indissolublement liées.
Ma seconde observation concerne la fiscalité des entreprises.
Bravo au Président de la République et au Gouvernement pour la suppression de la taxe professionnelle. Tout le monde en parlait. Personne ne l'avait fait. Encore faut-il veiller à ce qu'une autre taxe, la taxe carbone, ne vienne pas, à terme, compromettre dans les secteurs les plus consommateurs d'énergie les gains tirés de la suppression de la taxe professionnelle.
Le réchauffement climatique, les menaces qu'il comporte pour l'équilibre de la planète, les engagements pris par la France à Kyoto, ceux du candidat Nicolas Sarkozy et de ses concurrents lors de la campagne présidentielle, tout militait pour la création de la taxe carbone. Cette taxe, il faut le rappeler, sera intégralement compensée aux ménages comme aux entreprises. Elle a donc pour objet non pas de renflouer les caisses de l'État mais de changer nos comportements en matière de consommation d'énergie « carbonée ».
Cette taxe existe dans les pays scandinaves depuis plus de quinze ans. Si elle n'y a compromis ni la croissance ni l'emploi, c'est parce qu'elle s'est accompagnée dans la durée de mesures incitatives pour les entreprises les plus consommatrices et les plus exposées à la concurrence internationale. Le dispositif que nous propose le Gouvernement va dans ce sens : des mesures particulières d'exonération ou d'atténuation sont prises en faveur de l'agriculture, de la pêche, des transports de passagers ou de marchandises. Il faut, bien entendu, s'en féliciter.
Ce dispositif soulève toutefois trois questions.
Premièrement, qu'en sera-t-il dans la durée ? La taxe carbone est compensée aujourd'hui et devra l'être demain. Mais une chose est de trouver des exonérations adaptées sur la base d'un tarif de 17 euros la tonne de C0 2, autre chose sera de le faire lorsque ce tarif approchera les 100 euros la tonne, niveau qui devrait être atteint en 2030. La réflexion sur l'adaptation de la fiscalité des entreprises et des ménages n'est pas achevée.
Deuxièmement, qu'en sera-t-il de l'harmonisation européenne ? La création de la taxe carbone n'est pas une mesure ponctuelle mais l'amorce d'une réorientation profonde de notre fiscalité afin qu'elle porte moins sur la production et davantage sur la pollution. S'agissant d'une évolution de fond, il serait plus que souhaitable qu'elle fasse l'objet d'une véritable harmonisation à l'échelle de l'Union européenne. La France, lors de sa présidence, s'y était essayée. Elle n'a pas réussi. Espérons que la réunion de Copenhague sera l'occasion de faire converger nos positions.
Troisièmement, qu'en sera-t-il de l'application de la taxe carbone aux frontières extérieures de l'Europe ? L'enjeu est majeur : c'est celui de l'égalité des conditions de concurrence avec notamment les États-Unis et les pays émergents. Il est clair que si l'Europe sait se montrer plus vertueuse, elle sera mieux armée pour faire valoir ses intérêts.
Lutte contre la crise, poursuite des réformes, préparation de l'après-crise, c'est ce triptyque qui guide le Gouvernement et inspire sa majorité. Madame la ministre, monsieur le ministre, mes encouragements vous accompagnent. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame, monsieur les ministres, votre projet de budget est suffisamment solide pour que nous le soutenions et le votions. Il y a ce que nous y voyons mais aussi ce que j'aurais aimé y voir dans le contexte de crise actuelle.
La crise pose la grave question de la place des banques et du secteur financier dans notre économie, notre système financier et nos finances publiques, celle du partage de la valeur et de la part de l'impôt. Il ne faudra pas évacuer trop rapidement le débat engagé sur le niveau de l'impôt sur les sociétés que les banques doivent acquitter, car il s'agit du partage de la valeur et du financement de la garantie que l'État devra apporter aux banques.
J'aurais souhaité également y voir plus clair sur l'évolution des relations de nos finances publiques par rapport à celle de nos partenaires européens. Le pacte de stabilité est mort. Quel est le nouveau calendrier pour une éventuelle nouvelle convergence ?
Nos déficits ont été multipliés par quatre en trois ans. Sommes-nous à la hauteur de ce que nous pouvions attendre de la révision générale des politiques publiques ? Le cap est-il suivi, l'ambition est-elle maintenue ? Les tableaux de bord sont-ils là qui permettent aujourd'hui et qui permettront demain à la RGPP ou à d'autres initiatives de cette nature de nous aider à diminuer nos déficits ?
Si le Gouvernement est attentif à l'endettement de notre pays, il est curieux de constater que, depuis que le débat budgétaire est engagé, le Parlement en impose la conscience au Gouvernement. S'il est bon que les parlementaires, qu'ils soient de gauche ou de droite, soient attentifs à la gravité de la dette de notre pays, il eût été plus sain et plus heureux pour l'avenir que le Gouvernement en prît toute sa part de lui-même et donnât à cette question toute l'importance qu'elle mérite.
Quant au grand emprunt, ce sera d'abord une contribution supplémentaire et une grande dette. Reste à en déterminer les critères, à fixer la rentabilité économique et sociale des dépenses qu'il financera et à démontrer le caractère d'avenir de ces dépenses. Une dépense d'avenir, c'est une dépense dont la réalisation procure les effets qui permettent le remboursement de la dépense. Hors de cela point de salut. Or, au vu des discussions que nous avons pu avoir, il ne me paraît pas acquis d'avance que l'exécutif s'en tiendra à cette définition rigoureuse, mais j'espère que vous me démentirez, madame la ministre.
La taxe carbone n'est pas une mauvaise idée, mais on a quelque peu gâché la matière en ne l'intégrant pas dans une vraie perspective de fiscalité écologique. La fiscalité écologique peut être utile, puissante, intelligente. Il convient d'engager un débat, de proposer des orientations. La taxe carbone pouvait être un exemple intéressant, mais elle devait s'intégrer dans un ensemble.
Quant à la réforme de la taxe professionnelle, je défends un certain nombre de propositions formulées par notre rapporteur général. Comme beaucoup d'autres, je considère qu'il n'aurait pas été indigne que la réforme de la taxe carbone intervienne après celle des collectivités locales. Il est quelque peu curieux, en effet, de réformer d'abord l'impôt puis de s'attaquer à la réforme de la décentralisation.

Enfin, je considère qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à maintenir le bouclier fiscal aujourd'hui. Mesurons le poids de ce symbole.
Symbole encore que celui de la baisse de la TVA sur la restauration, symbole de constance, mais à quel prix ? Je souhaite que les symboles ne nous épuisent pas, et que nous puissions sans cesse vérifier que le budget que nous allons voter sert un projet politique qui nous rassemble. (Applaudissements sur divers bancs du groupe UMP.)

Madame, monsieur les ministres, le présent projet de loi des finances est examiné par notre assemblée dans une atmosphère lourde : lourde face aux mécomptes de la nation – déficits, dette, chômage – ; lourde pour la justice fiscale puisque, depuis 2002, les baisses d'impôts s'élèvent à 30 milliards d'euros pour les plus aisés et seulement à 3 milliards d'euros pour les ménages les plus modestes ; lourde enfin pour les collectivités territoriales accusées de mauvaise gestion par le Gouvernement, médaille d'or du cynisme politique quand on connaît 1'état des comptes publics.
Les collectivités sont promises à l'asphyxie financière avec la disparition de la taxe professionnelle, puis réduites en poussière par la réforme territoriale, enfin éliminées par évaporation selon la volonté du Président de la République, un président qui ne tolère qu'un seul pouvoir, le sien.
Le Gouvernement ne sait pas où il va conduire le pays mais il y va. La plupart des élus, de droite comme de gauche savent, eux, que l'on va vers le chaos. Souvenez-vous : cinq ans seulement avant ce coup de barre jacobin, M. Raffarin présentait l'acte II de la décentralisation comme la mère des réformes. Doit-on attendre de l'ancien Premier ministre qu'il dépose plainte pour infanticide ?
Les concepteurs d'une telle France à venir, recentralisée à outrance et privée de ses repères de proximité, font semblant de croire aux vertus des financements croisés à supprimer, des clauses de compétence générale à proscrire et des bataillons d'élus à éliminer. À cet égard, c'est avec gourmandise que j'attends 1'accueil qui sera fait à ce texte par nos collègues du Sénat.
Je m'exprime ici à la fois en défenseur des collectivités territoriales assiégées et violentées par les armées bonapartistes, et au nom des citoyens qui ont choisi de vivre dans les zones rurales ou de montagne, qui ne se reconnaissent ni dans la forme d'ostracisme dans laquelle les tient le pouvoir central, ni dans le projet de loi de finances pour 2010.
La France rurale, la France de la montagne souffrent. Avant de me rendre dans les Hautes-Alpes au congrès de l'ANEM, je souhaite appeler votre attention sur trois sujets pour lesquels j'ai déposé des amendements.
Le premier concerne les ressources pour les collectivités issues des équipements hydrauliques, à relier à la disparition de la taxe professionnelle.
Je trouve inadapté de réserver les taxes au-delà d'une production de 50 mégawatts. Dans mon département de l'Ariège qui fait partie des châteaux d'eau du pays, quatre barrages hydrauliques seraient éligibles. Est-ce justifié au regard de l'apport en ressource en eau de ce territoire et de la volonté exprimée par M. Borloo d'augmenter la production hydraulique ? La réponse est non.
Le deuxième a trait aux compensations pour les citoyens des zones excentrées au titre de la taxe carbone qui est une bonne mesure et un mauvais impôt.
À cet égard le Gouvernement n'a pas fait les bons arbitrages. Le paramétrage de votre taxe est socialement injuste et écologiquement inefficace, comme mon collègue Jean Launay l'a déjà démontré la semaine dernière.
La fiscalité est l'un des outils qui doit nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixé en termes de sobriété énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Encore faut-il que l'outil soit adapté et que la progressivité du signal prix soit en adéquation avec les moyens contributifs des usagers par rapport à leurs lieux de résidence. Mon amendement abondant le crédit d'impôt pour ceux qui vont payer plus pour travailler loin, a été repoussé de justesse en commission des finances mais celui, excellent aussi, de Michel Bouvard a eu plus de chance, à la condition bien sûr qu'il soit voté prochainement dans l'hémicycle, sans que les ministres ne s'y opposent.
Monsieur le ministre, je vous invite à la raison, à l'équité, et à plus de cohérence au regard des objectifs visés vis-à-vis des citoyens qui ont choisi de vivre à la campagne.
Ma troisième remarque concerne l'encadrement des projets de résidences de tourisme en zones de revitalisation rurale appelant à déductions fiscales.
Je souhaite que vous teniez vos engagements pris ici même le 19 mars dernier après que j'aie, sur votre suggestion, retiré l'un de mes amendements justifié par la nécessité de remettre de l'ordre dans l'application de la loi Demessine. Il faut conserver ce dispositif d'incitation mais en l'encadrant en amont au niveau des promoteurs et des gestionnaires et en le sécurisant en aval pour les investisseurs particuliers.
Aujourd'hui, notre commission des finances a accepté l'un de mes amendements visant à ne pas infliger une ultime sanction aux acheteurs déjà victimes de fausses promesses et de vrais retours d'impôts. Je reconnais là l'intérêt manifesté à ma démarche par le président de la commission, Didier Migaud, et le rapporteur général, Gilles Carrez.
En conclusion, je regrette de ne pouvoir passer la semaine avec vous dans cet hémicycle pour cause de congrès des montagnards, mais je veux croire en votre parole de ministre ici et d'alpiniste là-haut. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine séance.

Prochaine séance, mercredi 21 octobre à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 21 octobre 2009, à une heure dix.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma