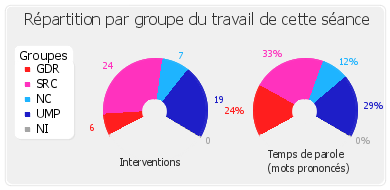Séance en hémicycle du 2 février 2012 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

L'ordre du jour appelle le débat sur les partenariats public-privé, organisé à l'initiative du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
La parole est à M. Roland Muzeau.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues – il y en a quand même quelques-uns ! –, les députés du Front de gauche et ultramarins ont pris l'initiative du présent débat sur les partenariats public-privé dans le cadre de cette semaine de contrôle de l'action du Gouvernement. Ce nouveau type de contrat administratif permet aux pouvoirs publics de confier à des sociétés privées une activité globale de financement, de conception, de construction, d'entretien, de maintenance, d'exploitation, de gestion de projets étatiques, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public.
Le Président Nicolas Sarkozy s'est employé à les généraliser et à les systématiser dans son offensive de privatisation de l'action publique, au nom de l'efficacité, de la réduction des coûts, de la nécessaire modernisation de la commande publique.
Parce qu'il fallait, tout en prétendant alléger la dette publique, muscler un plan de relance au ventre mou, permettre aux majors du BTP de s'affranchir des règles de la concurrence et de capter 15 % des 150 milliards d'euros annuels de commandes publiques, la loi du 28 juillet 2008 a banalisé ce type de contrat.
La commande passée était claire. L'instrument devait « trouve[r] pleinement sa place dans la commande publique, et non plus [être] un simple outil d'exception » selon les termes de Mme Christine Lagarde, alors ministre de l'économie et des finances.
Faisant fi des recommandations antérieures de la Cour des comptes, laquelle, se fondant sur deux exemples qui concernent, l'un, le pôle renseignement du ministère de 1'intérieur et, l'autre, le centre des archives diplomatiques du ministère des affaires étrangères, appelait déjà à la prudence vis-à-vis de ces projets qui « consistent à aller chercher des tiers financeurs et à bâtir des usines à gaz, en oubliant que celui qui emprunte pour le compte de l'État le fait à un coût plus élevé » et choisissant d'ignorer l'inquiétude de son président Philippe Séguin, qui dénonçait la « myopie coûteuse » de l'État en la matière, comme sa recommandation d'une « réflexion approfondie sur l'intérêt réel de ces formules innovantes », faisant également abstraction des fortes réserves d'interprétation émises, en 2003, par le Conseil constitutionnel, qui rappelait que ces contrats dérogatoires au droit commun de la commande publique devaient être réservés à des projets d'une complexité particulière et justifiés par un critère d'urgence, la majorité a accepté d'assouplir l'ordonnance du 17 juin 2004 au point de la dénaturer. Quels qu'aient pu être les obstacles constitutionnels, les interrogations et les réticences, voire les oppositions, vous les avez tous balayés pour atteindre votre objectif : placer la procédure de ces contrats parmi les modalités de droit commun de la commande publique afin d'offrir aux fonds privés la construction d'infrastructures publiques.
Les doutes et les critiques exprimés alors, y compris au sein de votre majorité, auraient pourtant dû vous inciter à davantage de prudence, notamment pour des raisons financières.
Votre collègue du Nouveau Centre, Charles de Courson, n'a pas cessé de plaider en ce sens : « Ne laissons pas croire que cette solution représente le nec plus ultra et qu'elle n'entraîne pas d'endettement indirect. Les contrats de partenariat reposent dans leur principe même sur un transfert des risques aux opérateurs privés. L'externalisation des risques a néanmoins ses limites, dès lors que ce n'est pas l'usager qui assure le financement du contrat mais, de manière prédominante, le contribuable », disait-il, en insistant sur « le risque lié à la déconsolidation de la dette liée à l'investissement public ».
Je me souviens être intervenu en 2008, au sein de cet hémicycle, pour exposer, sans ambiguïté, notre refus de vous suivre sur cette voie idéologique dangereuse et irresponsable. Depuis lors, la doctrine administrative a conforté mes arguments : ce texte est tout sauf neutre idéologiquement. François Lichère, professeur de droit public relève en octobre, dans la revue Contrats et marchés publics, que « ces contrats ne se contentent pas d'offrir aux personnes publiques une nouvelle technique contractuelle mais traduisent certainement un choix politique. Le gouvernement actuel assigna même à la réforme de l'ordonnance une fonction proprement politique : elle devait largement prendre part à la relance de l'économie souhaitée à la suite de la crise des subprimes. » Sans se prononcer sur « le point de savoir si cet objectif immédiat risque ou non d'être rempli », cet auteur fait « simplement remarquer que c'est sans doute beaucoup attendre d'un contrat public qui doit demeurer, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une exception ».
Échaudé par les marchés d'entreprises de travaux publics, les trop fameux METP des lycées lancés en Île-de-France par l'ancienne majorité de droite, dont le bilan témoigne d'une dérive financière exorbitante, je vous confiais ne pas croire à la possibilité que ces sociétés privées, pour qui efficacité est forcement synonyme d'une rentabilité maximale, soient mieux à même de satisfaire l'intérêt général et d'atteindre les objectifs de qualité et d'efficacité économique. J'insistais sur les risques que les partenariats public-privé ne se révèlent bien plus onéreux que les projets équivalents directement financés et réalisés par la collectivité publique, puisque le versement de loyers au privé durant vingt ou trente ans revient in fine à payer plusieurs fois le coût initial de l'équipement. Je disais alors : « N'encourt-on pas toutefois le risque que, par-delà les avantages budgétaires que présente la méthode sur le court terme, le coût des redevances à payer aux opérateurs privés ne vienne sur le long terme sérieusement entamer les marges de manoeuvre des acteurs publics, au détriment des contribuables ? »
Je vous faisais part de mes réticences à voir reporter la charge des PPP sur les générations futures.
Rappelant l'exemple du métro de Londres, éclairant sur les conséquences que peut avoir le développement de ce type de contrat, je vous interrogeais sur les voies de sortie quand l'opérateur est défaillant.
Nous continuons aujourd'hui à combattre le principe même de ces contrats qui dépossèdent la puissance publique des responsabilités qui lui incombent en matière de maîtrise d'ouvrage et qui pénalisent aussi gravement les PME, vouées à devenir les simples sous-traitantes de groupes monopolistiques privés qui les étranglent.
Les faits nous donnent raison. Votre réforme n'a pas permis une amélioration de la qualité de gestion, du service et des coûts. Sur le long terme, les contrats de partenariat n'ont pas fait la preuve de leur efficience économique par rapport à la délégation de service public ou à l'appel d'offres classique.
Malgré cela et, nonobstant la multiplication, depuis lors, des articles relatant les difficultés soulevées par la transposition des dispositions relatives aux contrats de partenariat de l'État dans le champ des contrats de partenariat des collectivités, difficultés liées à la différence de fonctionnement des institutions nationales et locales, le cadre législatif et réglementaire n'a pas été amélioré.
Aveuglé par ses objectifs d'opportunité moins économique que politique, le Gouvernement a persévéré, accéléré même, pour faire des PPP l'Eldorado de la commande publique. Pour tous les grands travaux, hôpitaux, lignes ferroviaires à grande vitesse, stades, prisons, universités, Grand Paris, futur ministère de la défense, l'État et les collectivités ont privilégié ce partenariat avec les acteurs privés. La folie a gagné du terrain.
Le résultat nous le connaissons : 2011 sera une année record. Le marché français des PPP s'est hissé au tout premier rang européen, se félicite François Bergère, directeur de la mission d'appui aux PPP, la MAPPP. Selon la banque d'investissement de l'Union européenne, la France totaliserait près de 70 % des PPP signés en Europe.
Dans le même temps, la réalité de vos échecs scandaleux en la matière, les dangers résultant de cette gabegie financière commencent à s'imposer. Pour le zoo de Vincennes, le muséum devra verser des loyers de 12,25 millions d'euros chaque année, plus de 306 millions d'euros sur vingt-cinq ans, soit plus de deux fois l'investissement total.
Pour le fameux pentagone à la française dont le coût est évalué à 745 millions d'euros, la charge financière de l'État s'élèvera à plus de 3,5 milliards d'euros en vingt-sept ans. Des voix de plus en plus nombreuses dénoncent cette myopie coûteuse de l'État, la bombe à retardement des PPP, cette machine à masquer la dette et à goinfrer les Bouygues, Eiffage et autres.
Vous devriez être plus attentifs à ces arguments, à ces chiffres d'autant plus intolérables qu'ils s'inscrivent dans le contexte lourd de la question de la dette publique, du déficit public, de l'hyper-austérité prescrite au plus grand nombre et de la chasse à la fraude sociale. Difficile d'expliquer votre légèreté en matière de maniement des deniers publics s'agissant de cet outil juridique.
Votre ami Jean Arthuis, ancien ministre des finances, a récemment qualifié ces partenariats de « fuite en avant qu'on ne pourrait plus contrôler ».
Et pour cause, le Parlement est totalement dépossédé d'informations, faute de bilan retraçant globalement les projets engagés, réalisés ou à venir, évaluant l'ampleur de leur coût global, présent comme futur, et leur impact sur la dette.
Nous n'avons aucun droit de regard sur les engagements financiers considérables liés aux PPP. Selon les données disponibles sur le site de la MAPPP, en termes de montant d'investissement initial, les contrats de partenariat de l'État sont les plus importants. Cent contrats auraient été signés depuis 2004. La facture pourrait s'élever à 60 milliards d'euros d'ici à 2020, dont 15 milliards d'euros pour la seule année 2011.
Le Parlement n'a pas autorité pour intervenir sur ces investissements, ni son mot à dire sur les surcoûts préjudiciables à la collectivité.
Pour contrôler cette fuite en avant, Jean Arthuis préconise que ces contrats soient « inscrits clairement dans les projets de loi de finances annuels, avec l'état exact des investissements, pour permettre d'avoir un meilleur contrôle et surtout de réintroduire des arbitrages sur des sommes colossales qui impactent l'avenir. »
À défaut d'envisager de faire marche arrière sur ces contrats, d'accepter d'en réévaluer l'opportunité et l'efficacité, êtes-vous prêts, comme M. Arthuis par exemple, a minima à ces solutions favorisant la transparence et le contrôle ?
Un rapport parlementaire vient de rappeler l'importance du suivi et du pilotage du contrat, piloté par Bouygues Construction, pour la construction du futur ministère de la défense. Le Gouvernement est-il disposé à transmettre le contrat final de partenariat aux députés, qui veulent légitimement avoir accès aux termes de celui-ci, afin de mener à bien leur mission de contrôle ?
Opportunité, coûts, délais, efficacité : combien de temps encore allez-vous rester ainsi, droits dans vos bottes, à masquer les ombres au tableau et à nous mépriser ?
Prenons le cas du PPP de l'hôpital Sud Francilien qui tourne au cauchemar.
« C'est l'illustration de ce qu'il convient effectivement de ne pas faire : l'application dogmatique de ces fameux PPP dans des domaines aussi inappropriés que celui de la construction d'un hôpital public. » Ce point de vue du conseiller général Bruno Piriou, qui, dès l'origine de cette folle aventure, n'a cessé d'alerter l'opinion publique, de s'opposer, de mobiliser, je souhaite vous le faire partager.
Lundi 24 janvier, plus de quatre ans après les premiers travaux, le centre hospitalier Sud Francilien construit par le groupe privé Eiffage a enfin ouvert ses portes.
Ce fleuron de votre politique hospitalière, le plus grand chantier hospitalier de France réalisé en partenariat public-privé sur la période 2006-2011, pour un investissement initial de 344 millions d'euros, aurait dû accueillir les personnels des deux hôpitaux de Corbeil et d'Evry et les patients de ce bassin de vie, depuis avril 2011.
Mais les 8 000 malfaçons relevées lors de la réception du chantier début 2011 – des réserves classiques, selon le constructeur spécialiste de viaduc ; anecdotiques, comme des éclats de peinture, aux dires de Xavier Bertrand ; cocasses et inadaptées aux besoins des personnels médicaux, comme ces bras articulés de blocs opératoires qui ne peuvent se croiser ; plus graves, tel le système de sécurité hors normes ; voire dangereuses pour la sécurité des patients – et la polémique qui a suivi afin de savoir qui devait supporter les 100 millions d'euros de rallonge exigés par le constructeur, ont bouleversé le scénario idyllique.
La polémique a commencé à enfler. Et pour cause, le loyer devant être payé par l'État, dès 2011, et durant trente ans pour qu'il devienne propriétaire de la structure, réévalué de 29 millions d'euros à plus de 40 millions d'euros annuel, tombait quand même chaque mois dans la poche d'Eiffage alors que l'hôpital restait vide et non opérationnel.
Dans le même temps, pour tenir le budget, l'agence régionale de santé continuait d'exiger des restrictions budgétaires inacceptables – 2 millions d'euros d'économies, soit l'équivalent de la suppression de 160 postes –, occasionnant la démission du directeur, la mobilisation des syndicats, des praticiens hospitaliers, des personnels soignants et administratifs, et des usagers.
En octobre dernier, à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2012, dans un souci de transparence, ma collègue Jacqueline Fraysse a questionné le Gouvernement sur cette opération tournant à la catastrophe financière et sanitaire.
Xavier Bertrand nous assurait alors de sa volonté d'ouvrir l'hôpital dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. J'ose penser qu'aujourd'hui les conditions optimales sont garanties pour les personnels comme pour les patients, mais j'en doute.
Si l'on peut comprendre la volonté de son directeur par intérim de rendre cet outil propre à sa destination, il ne faudrait pas que d'autres impératifs aient prévalu. Je pense à la situation financière de l'hôpital, largement plombée. D'aucuns, dont le docteur Henri Lelièvre, à la tête de l'association « Sauvons notre hôpital public », considérent probable le risque de cessation de paiement.
Les syndicats font encore état de réserves et dénoncent une rentrée aux forceps dans le nouvel établissement. L'ouverture n'épuise pas le débat, loin s'en faut.
Cela ne nous dispense pas de revenir sur les conditions politiques et administratives ayant présidé au choix d'un tel contrat de PPP. Le conseil d'administration du centre hospitalier Sud Francilien, alors présidé par monsieur Dassault, l'État et l'agence régionale de santé d'Île-de-France, autorités de tutelle, ont délibérément renoncé à défendre l'intérêt général en acceptant une telle formule juridique.
En l'espèce, le contrat est un échec, dans la mesure où il n'a pas permis de réaliser cet établissement plus vite et à moindre coût, bien au contraire.
Le rapport de septembre 2010 de la chambre régionale des comptes est sans appel. Le projet est jugé surdimensionné et très coûteux. Le bail emphytéotique hospitalier est qualifié de « formule juridique contraignante et financièrement aléatoire ».
Rigoureuse, la chambre régionale des comptes avance des chiffres et déclare : « Le montant annuel du loyer versé au constructeur à compter de 2011 s'élèvera à 38,8 millions d'euros par an, durant trente ans, abondé aux deux tiers par l'État. » Elle précise : « Le coût final de l'opération s'établirait à 1,188 milliard d'euros. »
Sa conclusion est redoutable : « Ce choix paraît donc très onéreux pour l'établissement. Le recours à une maîtrise d'ouvrage publique financée par l'emprunt aurait été une solution moins coûteuse – 757 millions d'euros –, moins hasardeuse et surtout davantage maîtrisable par l'établissement. »
Pourquoi, dans ces conditions, ne pas avoir sérieusement envisagé de dénoncer ce bail emphytéotique hospitalier ?
Cette solution de sortie du PPP votée en juin dernier par le conseil de surveillance de l'hôpital favorable au retour à un montage public, plébiscitée par la population consultée par référendum sur l'initiative des élus locaux du Front de gauche, a-t-elle fait l'objet d'une mission de l'inspection générale des finances ? Le Gouvernement a-t-il mis son veto à un tel scénario ?
Sur les modalités financières, Xavier Bertrand déclarait dans cet hémicycle ne pas avoir « l'intention de laisser pendant des années, voire des décennies, cet établissement se débrouiller avec des déficits qui seraient dus à sa conception même. »
Par-delà ces déclarations de bonnes intentions, il est désormais temps que la représentation nationale soit informée de l'état d'avancement du dossier, des possibilités juridiques de casser un tel contrat, comme des conséquences financières.
Le dernier PLFSS fixant un ONDAM revu à la baisse exige de gros efforts d'économies sur les hôpitaux publics alors qu'ils sont déjà asphyxiés.

Je termine, monsieur le président, et je vous remercie de votre gentillesse.
Il est également de notre responsabilité d'expertiser les difficultés soulevées par cette procédure dérogatoire au droit commun de la commande publique et de nous interroger sur l'opportunité de son application dans le champ de la santé publique.
Xavier Bertrand, lui-même, se demande si le bail emphytéotique hospitalier est vraiment adapté. « Je connais peu d'exemples, dit-il, d'hôpitaux pour lesquels les délais et les budgets n'ont pas été dépassés, entre le moment de la conception et de leur ouverture. Pourquoi ? Parce que, la procédure étant assez lourde, au cours de la construction, lorsqu'une nouvelle technologie apparaît ou que les soignants font des suggestions de réaménagement, on le fait sans hésiter, et les concepteurs ont entièrement raison de le faire, ajoute-t-il. Mais si vous êtes, vous-même donneur d'ordre c'est plus simple qu'au sein d'une coopération public-privé. » Il fait bien de l'ajouter.
Il est urgent de savoir si ces baux peuvent intégrer la spécificité hospitalière et s'ils sont compatibles avec la gestion d'un hôpital public. Mais là n'est pas le seul sujet.
Sans exclusive, ouvrons le débat sur l'opportunité du choix d'un PPP dans ce domaine. Exigeons la communication des termes du contrat actuel, y compris dans ses éléments financiers, pour en expertiser le coût réel et les surcoûts.
Allons jusqu'au bout du sujet en abordant toutes les solutions, y compris la sortie du PPP. C'est le sens, monsieur le ministre, monsieur le président, de la demande de commission d'enquête que les députés communistes, républicains, citoyens et du parti de gauche déposeront dans les prochains jours.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, faut-il que les idéologies – le terme a été prononcé à l'instant – soient profondément ancrées dans nos esprits pour que les partenariats public-privé deviennent l'enjeu non pas d'une réflexion sereine sur la gestion administrative, mais d'un débat de caractère politique et donc souvent passionnel sur les rapports entre les services publics et le monde de l'argent ?
Car, au-delà des effets de tribune, de quoi s'agit-il réellement ? Il s'agit de savoir comment la sphère publique – État, collectivités territoriales, hôpitaux – pourra satisfaire les besoins de nos concitoyens qui, dans tous les domaines, restent importants – équipements de transport, de santé, de sécurité –, alors que la ressource publique se fait de plus en plus rare.
La France est la championne d'Europe des prélèvements obligatoires. La part de la dépense publique dans le PIB y dépasse de près de dix points le chiffre de l'Allemagne, où pourtant les services rendus à la population ne sont pas moindres.

Et nous savons tous que pour redresser nos comptes, il nous faudra comprimer le volume de la dépense publique.

Dans ces conditions, il est clair que si l'administration veut continuer à assumer elle-même le financement de l'investissement et la gestion des équipements publics, elle ne pourra le faire qu'au prix d'un ralentissement de ses programmes, avec les conséquences que l'on sait sur la satisfaction des besoins des usagers, sur l'activité des entreprises et sur le niveau de l'emploi.
Cette constatation n'a rien d'idéologique, elle procède tout simplement de l'évidence.
Il faudra donc trouver des financements ailleurs, c'est-à-dire dans un partenariat avec les entreprises. Il nous faut par conséquent nous interroger sur l'efficacité et sur le coût des partenariats public-privé. La seule question que, d'un point de vue purement pragmatique, nous devons nous poser, est celle de savoir si les partenariats public-privé sont efficaces ou s'ils ne le sont pas.

À cette question, il n'y a pas de réponse unique. La situation est différente selon les pays. Là où le public et le privé ont une tradition de travail en commun, c'est en général un succès ; là où ils se regardent comme chien et chat, c'est évidemment plus difficile.
En clair, ça marche plutôt bien en Angleterre ; ça marche moins bien en France, où les partenariats public-privé sont à la fois plus rares …

…et souvent trop coûteux pour la collectivité. Alors que faut-il faire ? Jeter les partenariats public-privé aux orties ?

Ou voir comment faire pour qu'ils fonctionnent mieux ?
Le seul fait de poser la question en ces termes fait naître une suspicion, celle de vouloir que la sphère publique y recoure d'une manière aveugle et systématique.
Je tiens à le dire très clairement : à mes yeux, l'objectif ne doit pas être celui-là, il doit être de créer les conditions pour que l'administration ait un vrai choix entre deux modes différents de financement et de gestion.
Pour que ce choix soit réel, il faut, me semble-t-il, que deux conditions soient réunies.
Première condition : l'administration doit s'interroger systématiquement pour savoir s'il est plus favorable aux usagers et aux contribuables qu'elle investisse et gère elle-même ou qu'au contraire, elle délègue à des entreprises professionnelles.
J'ai été surpris des termes dans lesquels la Cour des comptes a formulé l'une des recommandations de son rapport de 2006 sur la gestion des prisons. La recommandation n° 4 est ainsi rédigée : « L'administration doit expliciter son incapacité à réaliser le projet. »
Dire les choses de cette manière, c'est considérer que la maîtrise d'ouvrage public devrait être la règle et que le recours au privé est nécessairement la marque d'une impossibilité, voire d'un échec.
Lorsque le recours au partenariat public-privé est regardé comme le résultat d'un empêchement ou d'un renoncement, il ne faut pas s'étonner que la négociation conduise à un accord déséquilibré, à un fonctionnement passif et à un contrôle défaillant.
Si l'on ne veut pas que l'administration délègue des responsabilités publiques, il faut le dire clairement. Mais si on l'accepte, il faut obtenir que cette délégation de gestion soit regardée, au même titre que la maîtrise d'ouvrage publique, comme un mode de gestion normal, c'est-à-dire fondé sur un accord équilibré, assorti d'un suivi régulier et d'un contrôle rigoureux.

Il ne s'agit pas de faire de cadeau à qui que ce soit. Il s'agit d'assurer au mieux la prise en compte de l'intérêt public.
La deuxième condition de succès, c'est la qualité de la négociation avec le partenaire privé.
Depuis les origines de l'État, l'administration française a une tradition régalienne : elle décide, elle ne négocie pas. Tout, dans notre droit public – le code des marchés publics, le statut général de la fonction publique et le droit fiscal – procède d'une conception unilatérale des modes de décision.
Il n'est donc pas surprenant que l'administration française montre tant de réticence à entrer dans le processus de la négociation. Elle n'est, du reste, pas la seule. Le monde de l'entreprise n'a-t-il pas bien du mal à associer les partenaires sociaux aux décisions économiques ? Le monde politique n'a-t-il pas bien des difficultés à faire vivre une démocratie apaisée ?
Il reste que, dans tous les domaines, le seul moyen d'éviter les déchirements, c'est le recours à la négociation. Encore faut-il y être préparé. Si j'avais une suggestion à formuler, ce serait que, pour tous les partenariats public-privé dont les charges récurrentes seraient jugées trop élevées, la manière dont la négociation a été conduite soit passée au peigne fin.
Il ne s'agirait pas de pointer du doigt les négociateurs défaillants, mais de voir comment et pourquoi, à un moment donné de la discussion, l'administration a été conduite à accepter de financer des charges qui n'étaient pas justifiées. Est-ce le fait d'une priorité délibérément donnée au court terme sur le long terme ? Est-ce une défaillance dans les calculs prévisionnels ? Est-ce l'insuffisant engagement des négociateurs ?

En toute hypothèse, le débat sur les rapports entre la sphère publique et l'entreprise privée fait apparaître d'une manière criante l'urgence qui s'attache à la construction d'une relation nouvelle entre l'administration et le secteur privé.
Il ne s'agirait pas de nier qu'il existe une opposition d'intérêt entre le service public et l'entreprise privée, comme il existe une opposition d'intérêt entre deux négociateurs privés ou même entre deux négociateurs publics. Mais comment accepter que cette opposition soit regardée comme étant, dans tous les cas, définitive et insurmontable ?
Lorsque les programmes de formation des agents de la fonction publique de l'État et des fonctions publiques territoriale et hospitalière donneront la place qui convient à l'approche de la négociation, un grand pas en avant aura été fait. Et tout le monde y gagnera. C'est cela qu'il serait utile de travailler, loin de toute passion, de toute polémique et de toute idéologie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous devons saluer l'initiative du groupe GDR qui nous permet de discuter aujourd'hui des contrats de partenariat public-privé. C'est, me semble-t-il, la deuxième fois dans cette législature que nous avons l'occasion d'en débattre dans cet hémicycle. Nous avons en effet légiféré en juillet 2008 pour réformer une ordonnance de 2004 qui organisait ce type de dispositif.
Les contrats de partenariat public-privé, initialement conçus comme des contrats administratifs dérogatoires au droit commun de la commande publique, sont devenus, en réalité, des outils presque usuels.
Ils le sont dorénavant au même titre que les marchés publics et les délégations de service public, et ce, alors même que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est beaucoup plus réservée. En vérité, nous arrivons à ce que souhaitaient le législateur et sa majorité quand, il y a quatre ans, nous avons réformé l'ordonnance de juin 2004.
Vous souhaitiez une augmentation conséquente du nombre de contrats de partenariat signés ; vous y êtes arrivés. Nous vous avions, à l'époque, mis en garde contre ce que nous considérions comme étant le risque d'un recours systématique et irraisonné au partenariat public-privé. Nous vous avions alors rappelé la décision du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel qui limitait ces dispositifs « à des situations répondant à des motifs d'intérêt général ».
Trois conditions, rappelées par le Conseil, devaient en effet être réunies pour permettre un PPP : la « complexité » de l'opération envisagée, son « urgence » et, depuis la loi de 2008, le bilan économique plus favorable. Je rappelle que l'ordonnance de 2004 prévoit la réalisation d'une évaluation préalable qui doit établir si une de ces conditions d'éligibilité au moins est présente.
Or en pratique, on constate que le recours au contrat de partenariat est plus souvent le produit du volontarisme d'un ministre qu'un examen précis des conditions d'éligibilité que je viens d'évoquer.
En effet, comme cela a été rappelé tout à l'heure, le marché français des PPP est au tout premier rang européen. Les PPP signés cette année devraient dépasser 6 milliards d'investissements et ils sont, pour l'essentiel, le fait de l'État, les collectivités n'y ayant recours que pour moins du quart du volume total.
À l'évidence, le contrat de partenariat est devenu un formidable levier, non seulement de financement, mais surtout d'accélération des délais de livraison des ouvrages publics. La tentation est alors grande de sacrifier l'intérêt général à la satisfaction d'intérêts particuliers de court terme.
Ce dévoiement est préoccupant.
Utilisé à mauvais escient et pour de mauvaises raisons, le contrat de partenariat peut avoir des effets dévastateurs : l'endettement devient rapidement excessif, la rigidité budgétaire guette et le coût des projets explose. Bref, le recours immodéré à cette facilité comptable qu'est parfois le PPP conduit à la gabegie budgétaire.
Mais l'objet de mon propos, aujourd'hui, n'est pas de revenir sur les critiques que nous avions déjà formulées en 2008, au moment du vote de la loi relative aux contrats de partenariat. Leur actualité se vérifie et les déboires récents de l'Hôpital Sud Francilien ou du projet de construction du Pentagone à la française devraient inviter les thuriféraires du PPP à davantage de circonspection.
Je voudrais plutôt appeler à la tempérance et inviter à revenir aux principes fondateurs de l'ordonnance de 2004, aujourd'hui largement oubliés.
Ce débat est l'occasion d'appeler l'attention du Gouvernement sur deux domaines particuliers : la sécurité et la justice.
Dans le premier, celui de la sécurité, le ministère de l'intérieur, via la préfecture de police de Paris, a adjugé le 8 juillet 2010 dernier, un contrat de partenariat portant sur la mise en place d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance – cela reste un système de vidéo ! – pour la ville de Paris. Les finances publiques ont été engagées pour plus de seize années et pour un montant total qui avoisine les 130 millions d'euros.
Quand on regarde le contrat de partenariat que j'ai demandé à la préfecture de police de Paris, on observe que les conditions dans lesquelles la préfecture de police a mené la négociation de ce contrat ont été peu transparentes – je fais là référence à ce qu'a évoqué Michel Diefenbacher. Et l'association des autres services de l'État, notamment la Direction de l'évaluation de la performance des affaires financières et immobilières – la DEPAFI – a été bien trop discrète.
Au final, le ministère n'aura qu'une maîtrise bien trop faible de ce projet, pourtant majeur. Aussi, à bien des égards, ce contrat de partenariat est tout à fait symptomatique des dérives que nous dénonçons et des craintes que nous formulons.
En matière de justice, je voudrais appeler votre attention, monsieur le ministre, sur la question des prisons.
Depuis plusieurs années, le ministère de la justice a fait le choix de recourir à ce mode de financement, ce qui se traduit par une augmentation incessante de la part des loyers désormais dus par l'État
De 2009 à aujourd'hui, le coût des loyers a augmenté de 86 %. En 2012, 51 % des places de prison seront gérées par un partenaire privé. Et les loyers passeront de 80 millions de crédits de paiement en 2011 à 114 millions en 2012, soit une augmentation de 42 % en un an. Pour la gestion déléguée, ils passeront de 291 à 295 millions en 2012, soit 14 % de l'ensemble des crédits de paiement de l'administration pénitentiaire.

Ainsi, par exemple, les prisons de Lille et de Réau, qui sont des usines carcérales, condamnées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté et qui accueillent 800 détenus, le groupe Bouygues s'est vu confier, non seulement la construction – ce qui est certes son métier –, mais aussi l'exploitation, la maintenance des bâtiments, la restauration, la blanchisserie, et même, à ma grande surprise, le transfert des détenus !

Le noyau dur des missions régaliennes de l'État est atteint. Nous sommes, dans ce cas, bien loin du principe cardinal mentionné à l'article XII de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en vertu duquel « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique », non une délégation au privé, notamment à l'intérieur de nos établissements.
En parallèle, évidemment, dans son rapport d'octobre 2011 sur la situation pénitentiaire – rapport que vous ne pouvez pas ignorer, monsieur le ministre –, la Cour des comptes a souligné, en premier lieu, l'insuffisance des évaluations préalables prévues par la loi et l'étrangeté des motifs avancés pour recourir aux PPP.
Alors que le Gouvernement justifie son choix par le constat de la surpopulation carcérale, la Cour des comptes relève que si « l'insuffisante capacité d'accueil des prisons est une difficulté majeure, la démonstration que cette difficulté soit le résultat d'une incapacité de l'administration à la résoudre sans le recours aux PPP ne paraît pas avérée ».

Elle ajoute, concernant le critère de complexité : « il apparaît que, face à la complexité réelle et croissante des projets pénitentiaires, l'administration a privilégié la « solution de facilité » qui consiste à externaliser cette complexité, sans préjudice du coût de cette prestation ».
De plus, si elle estime la qualité du service fourni globalement satisfaisante, la cour prend soin d'ajouter que « la qualité incontestable de la gestion privée ne disqualifie pas pour autant la gestion publique ».
À cela s'ajoutent les problèmes de rigidité budgétaire que j'ai évoqués. La Cour souligne que « la dépense PPP permet de différer et d'étaler sur trente ans le coût d'investissements lourds dont la dette des engagements n'avait pas, jusqu'en 2009, à être consolidée dans le passif de l'État. Mais si cette dette est désormais consolidée, les difficultés de lisibilité comptable des opérations, quant à elles, demeurent ».
Une fois ce constat posé, je ne veux pourtant pas sombrer dans la facilité qui serait de conclure à l'inefficacité intrinsèque de cet outil de la commande publique qu'est le contrat de partenariat. Il n'est, en fait, qu'un simple outil dont l'usage est aujourd'hui dévoyé.
Il faut donc rappeler la règle de droit.
II n'est écrit nulle part, et certes pas dans l'ordonnance de 2004, qu'il faut passer en force sur certains projets, quitte à fermer les yeux sur des évaluations préalables qui émettraient des réserves.
Il n'est écrit nulle part non plus dans ce texte qu'il faut distordre la concurrence au point d'écarter les PME des contrats de construction de nos prisons pour ne traiter, au risque d'être soupçonné de collusions d'intérêts, qu'avec les mêmes trois géants du BTP, en situation d'oligopole.
Il n'est écrit nulle part, enfin, que l'État doit être un piètre négociateur et laisser le privé décider à sa place, lors de la phase de dialogue compétitif.
Parce qu'il s'agit pour l'essentiel de l'État, la responsabilité de ce gouvernement est engagée. C'est vous qui n'avez eu de cesse depuis plusieurs années de banaliser un outil juridique qui devait rester exceptionnel. C'est vous qui avez massivement recours aux PPP pour mieux éviter d'avoir à assumer vos propres obligations, notamment en matière de santé ou dans le domaine pénitentiaire.
Pour nous, comme le prévoit la loi, le contrat de partenariat ne doit intervenir que dans des cas d'exception, pour lesquels les autres modes de contractualisation du droit de la commande publique ne permettent pas de préserver au mieux l'intérêt général. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je regrette comme vous que cette discussion sur les partenariats public-privé n'intéresse pas plus de cinq députés…
Cela étant, je remercie Roland Muzeau d'avoir pris l'initiative de ce débat.
Étant le troisième orateur, je salue la qualité des propos des deux intervenants qui m'ont précédé.

Monsieur Urvoas, nous avons évoqué ce sujet il y a peu, le 22 mars 2011, lors de l'examen d'un texte visant à permettre la construction des stades chargés d'accueillir l'Euro 2016. Grâce à ce texte, qui a été adopté à une voix près, venant du Nouveau Centre, nous avons pu débloquer un dossier et trouver une solution, à travers le partenariat public-privé, pour construire les enceintes sportives qui permettront à notre pays d'accueillir la Coupe d'Europe.
Je me souviens des réticences, des interrogations et de l'hostilité d'un certain nombre de nos collègues et de la satisfaction des maires accueillant les enceintes sportives grâce à ce texte. C'est la preuve qu'il y a quelquefois des discours dans cet hémicycle et une appréciation différente sur le terrain.
Pour autant, le débat que vous avez lancé, cher collègue, est important. Nous sommes dans une conjoncture difficile. L'État, qui n'a pas les moyens d'assurer un certain nombre d'investissements, a recours aux partenariats public-privé. Il s'avère, monsieur le ministre, que j'ai l'honneur d'être le rapporteur d'un certain nombre de textes sur l'éthique et, notamment, sur la corruption. Le recours aux partenariats public-privé ne doit pas être un moyen de se détourner de la règle, donc du droit de la concurrence. Pour ma part, je ne vois aucune objection à ce que vous posiez le problème, monsieur Muzeau. Vous avez cité Jean Arthuis et Charles de Courson. Vous connaissez l'engagement de ces deux spécialistes sur ces questions. Ils se ont, eux aussi, en leur temps, interrogés.
En 2011, nous comptions 104 partenariats public-privé, représentant plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements. Vous avez rappelé qu'en 2002, la loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure avait institué les PPP afin d'édifier des équipements de sécurité tels que les commissariats ou, comme l'a précisé mon collègue Urvoas, les prisons. C'est heureux parce que, sans cela, nous connaîtrions aujourd'hui un déficit de places de prison ne permettant pas à l'État d'assurer une de ses fonctions régaliennes. Je rappellerai à M. Urvoas, que c'est le groupe Nouveau Centre qui, voici deux semaines, lorsque le Gouvernement a proposé un plan de création de 20 000 places de prison, a souhaité que le recours aux partenariats public-privé laisse toutefois une place à nos petites et moyennes entreprises. Je vous réitère cette demande, monsieur le ministre : réfléchissons, lors de la réalisation de ces investissements d'envergure, à la place qu'il convient de réserver à des groupes de taille moyenne qui font la richesse de notre tissu industriel.
Monsieur le ministre, les partenariats public-privé sont des outils qui ont fait leurs preuves.
J'évoquerai la dernière grande réalisation : la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. La discussion a porté sur les droits de péage, s'agissant notamment d'une société présente dans le tour de table. Mais je ne pourrais en parler dans le laps de temps qui m'est imparti.
Il convient de rappeler la philosophie des PPP. L'État recourt à ces partenariats lorsqu'il ne peut pas assurer un projet complexe et coûteux. Quel doit être le statut de l'actuelle mission d'appui aux PPP, compte tenu de l'importance qu'ont pris ces partenariats public-privé ? Cette question doit être posée dans un débat de cette nature. Vos interrogations sont légitimes, monsieur Muzeau, et elles sont partagées : notre collègue de l'UMP ne s'intéresse, en effet, pas moins que vous aux deniers publics.
Je vous poserai donc, monsieur le ministre, au nom du groupe que j'ai l'honneur de représenter à cette tribune, une première question. Vous proposez, à défaut, une commission d'enquête. Ne pensez-vous pas qu'une mission d'information serait largement suffisante ?

Ne pourrait-on pas se pencher sur le statut de cette mission, en faire une agence d'appui aux côtés des collectivités et de l'État et exiger, en plus de la complexité d'urgence, qu'il y ait une réglementation, une traçabilité et un cahier des charges, afin que soit respecté pour l'investissement public le caractère éthique, que nous partageons tous ?
Je vous ferai, par ailleurs, quelques suggestions pour que ce débat présente quelque intérêt pour le Gouvernement.
Les partenariats public-privé doivent, on le sait, concilier des exigences a priori antinomiques. M. Muzeau a laissé entendre qu'ils étaient favorables aux intérêts des partenaires privés, alors que nous avons entendu, de l'autre côté de l'hémicycle, qu'ils pouvaient, en fait, assurer la primauté de l'intérêt général. Cet équilibre est-il assuré ? La loi du 22 juillet 2008 a modifié l'ordonnance du 17 juin 2004. Dans le cadre du contrat de partenariat, la tâche des prestataires est très étendue puisque peuvent leur être confiées des missions aussi diverses que le financement des investissements, la construction d'ouvrages et la maintenance et l'exploitation. C'est ce qui apparaît comme une dérive par rapport à l'ordonnance de 2004.

Les interrogations, monsieur le ministre, ne sont pas sans intérêt. S'agissait-il bien, à l'origine, de toutes ces missions ? On peut se poser des questions. Il incombe à l'Etat, et cette majorité, au moins, l'a bien compris, de trouver les sources de financement des investissements que le pays attend, pour les concevoir, les construire, les maintenir et les exploiter. Il convient de mieux vérifier les objectifs de réalisation et la gestion. Je vous pose donc une deuxième question : comment peut-on éviter toute dérive ?
Enfin, les prévisions de taux de croissance annoncées par le Premier ministre sont, en dépit de tous nos efforts, relativement inquiétantes. Il est donc essentiel, dans la conjoncture que nous connaissons, de relancer l'investissement.
Je terminerai mon propos par une suggestion, car tel est l'esprit du Nouveau Centre. Vous n'avez, en effet, pas manqué de remarquer tout au long de cette législature, qu'au-delà d'un soutien, nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édification de la loi. L'État a des moyens. Il est actionnaire par le biais de la Caisse des dépôts et du Fonds stratégique d'investissement, outil nouveau voté par cette majorité à la demande du Président de la République. Il a pris une part du capital dans un certain nombre de groupes industriels primordiaux pour l'économie nationale. Comment faire pour continuer à donner de l'importance aux PPP tout en répondant aux préoccupations légitimes posées par ce débat ? L'État actionnaire, ne pourrait-il pas faire des partenariats public-privé institutionnalisés un outil lui permettant de garder la main sur un certain nombre d'investissements, illustration des fonctions régaliennes de l'État ? Un certain nombre d'entre nous est, en effet, attaché à ce que l'État ait un droit de regard …

…sur le devenir de ces investissements. Il ne doit pas s'agir uniquement d'un transfert à des grands groupes aussi importants, compétents et remarquables soient-ils.
Il ne me reste qu'une minute, je ne ferais donc pas le calcul de ce que coûtent les partenariats public-privé. Nous avons parlé des prisons, nous pourrions citer d'autres exemples.
Monsieur le ministre, l'État doit conforter son ambition industrielle, son rôle d'investisseur. Nous devons avoir à l'avenir, grâce à la modification du statut de la mission d'appui aux partenariats public-privé et grâce au rôle de l'État actionnaire, non pas de simples partenariats public-privé, mais des partenariats public-privé institutionnalisés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la qualité des interventions des orateurs, qui se sont exprimés au cours de cette discussion très librement et sans passion, honore notre assemblée. Il est vrai qu'il faut remercier M. Muzeau et son groupe d'être à l'initiative de ce débat particulièrement intéressant.
De nombreuses observations ont été faites. Je tiens, pour ma part, à prendre l'exemple d'un PPP : celui qui nous intéresse en ce moment et que nos collaborateurs appellent le « Balardgone ». C'est le type même du partenariat public-privé ruineux.
Ce projet a pour objet le regroupement des administrations. Il est présenté de la façon suivante : Ce serait une mesure de rationalisation des soutiens grâce à la concentration géographique ; une mesure d'optimisation du fonctionnement du ministère par regroupement physique de tous les échelons de décision autour du ministre ; une mesure budgétaire positive, dit-on, grâce à la revente des emprises libérées qui n'est pas une certitude. Le projet Balard est donc, aujourd'hui, une mesure emblématique de la RGPP défense.
S'agissant du contenu, prenons d'abord les bâtiments. Le projet de regroupement prévoit de rassembler 10 000 personnes sur le nouveau site de Balard. Mais cette simple formulation est factuellement fausse. En effet, le site de Balard se composera en réalité de trois emprises : la parcelle est, déjà occupée par la cité de l'air – ; la parcelle ouest sur laquelle sera construit un bâtiment neuf pouvant accueillir environ 5 000 personnes ; la corne ouest, qui sera isolée de la parcelle ouest et où seront construits et exploités par Bouygues des immeubles de bureaux. Autrement dit, le projet Balard porte sur la construction d'un immeuble devant accueillir 5 000 personnes et non 10 000, puisque la moitié des 10 000 serait accueillie dans des immeubles qui existent déjà. Cela remet très singulièrement en perspective le coût de l'opération par tête.
Au projet de construction s'ajoute un projet de services associés : l'entretien et la maintenance des infrastructures, de la voirie, des espaces verts ; le nettoyage, la restauration, l'hébergement, la blanchisserie, le mobilier ; l'énergie, les fluides.
Quelle est la solution retenue ? Le choix d'un « contrat de partenariat » a été annoncé en même temps que le projet. Il n'est donc pas possible de dire qu'une solution de maîtrise d'oeuvre publique a été étudiée. L'étude préalable s'est d'ailleurs entièrement inscrite dans cette optique sans sérieusement tenter de comparer le PPP et une maîtrise d'ouvrage publique. Elle a simplement considéré que le ministère de la défense ne disposait pas des capacités internes de conduite d'un projet comme Balard et qu'il fallait donc recourir à un partenariat. Ce faisant, l'enquête a occulté le fait que l'État aurait pu mobiliser en son sein les ressources techniques nécessaires, disponibles dans d'autres ministères. Pour le reste, l'étude considère comme acquis le PPP et le justifie a posteriori. La justification principale est la complexité du projet. Les orateurs précédents l'ont évoquée. Malheureusement, l'étude préalable ne démontre pas que la complexité technique du projet dépasse les capacités de l'État de le conduire. En réalité, il en a conduit d'autres. Elle décrit longuement la complexité juridique et financière du projet, mais n'apporte pas de démonstration en la matière non plus.
Quel en est le coût ? C'est fondamental. Le projet court sur une durée de trente ans – 2011-2041 – dont trois ans de construction et vingt-sept ans d'exploitation. Les coûts d'exploitation seront périodiquement renégociables. Le coût total du projet est de 3,5 milliards d'euros hors taxes, soit 4,2 milliards d'euros toutes taxes comprises. La valorisation de la corne Ouest abaissera ce total de 574 millions d'euros sur la période. Le projet « coeur » s'élèvera pour le partenaire privé à 1,8 milliard, dont 750 millions d'euros de frais financiers. Le ministère de la défense versera une redevance annuelle de 130 millions d'euros hors taxes, décomposée comme suit : immobilier pour 45 millions, les systèmes d'information pour 28 millions ; l'entretien pour 29 millions et les services pour 28 millions. Au total, il est frappant de constater le déséquilibre entre l'investissement du partenaire privé et le coût final pour le partenaire public. Aucune étude n'a pu démontrer précisément que le coût final aurait été plus élevé sous maîtrise d'ouvrage publique. Les calculs réalisés par l'étude préalable l'affirment, mais uniquement en affectant un coefficient d'optimisation « optimiste » au projet de partenariat.
En l'état, force est de constater que le projet Balard se révèle coûteux alors qu'il est présenté comme une économie par rapport à l'existant. C'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé Philippe Nauche dans son rapport sur les crédits du ministère de la défense.
Dans ce cas, la mission d'appui à la réalisation des PPP n'a pas joué son rôle d'organisme expert. Elle s'est contentée de reprendre les affirmations de l'étude préalable. Elle ne lève aucune des incertitudes, notamment sur la pertinence du coefficient d'optimisation retenu. Ce coefficient est pourtant la principale justification du caractère théoriquement favorable, financièrement, du montage.
Bref, faute d'avoir été conçu après une étude comparative digne de ce nom, le projet Balard est très coûteux et porteur d'incertitudes.
De la procédure suivie, on peut tirer plusieurs leçons :
Le contrat de partenariat était présenté comme une souplesse. Or, faute d'une définition précise des besoins de l'État, il enferme le partenaire public dans une grande rigidité, et ce pour trois décennies ;
L'État ne s'est pas doté des moyens de pilotage d'un tel projet. Cette lacune sera forcément à son détriment ;
Le projet Balard n'a pas fait l'objet d'une comparaison à périmètre égal avec d'autres montages ;
L'étude préalable n'a pas étudié d'alternative et ne présente donc aucune comparaison réelle ;
L'État n'a pas prévu de faire appel à des moyens de contrôle externe en cours de contrat.
En fait, le projet Balard ne concerne ni une infrastructure productive comme peut l'être un laboratoire de recherches, qui innerve l'économie, ni une infrastructure rentabilisable par l'exploitation comme une ligne TGV, ni un équipement vital comme un CHU. Il ne présente objectivement aucune urgence. La justification de son existence, particulièrement à 4,2 milliards d'euros, n'apparaît pas clairement.
Ne faut-il donc pas limiter les PPP aux infrastructures productives, et, comme l'ont proposé certains de mes collègues, de manière exceptionnelle ? On a beaucoup parlé des emprunts toxiques. Ce partenariat ne sera-t-il pas dans certains cas toxique ? N'entraînera-t-il pas une forte augmentation des charges de fonctionnement pour les collectivités qui y font appel ou pour l'État ? A-t-on des précisions sur le remboursement du FCTVA ? Ce n'est pas d'une grande clarté. On peut aussi regretter le manque de contrôle juridique et surtout technique. Il n'y a pas de véritable suivi technique dans une réalisation comme Balard.
Il serait peut-être bon d'instaurer un contrôle préventif. Peut-on laisser les collectivités, les communes, les communautés de communes, les départements même dans certains cas, s'engager dans des partenariats public-privé qui entraîneront plus tard des dépenses supplémentaires ? La Cour des comptes pour l'État, les chambres régionales ou les trésoriers payeurs généraux ne devraient-ils pas pouvoir contrôler de façon préventive, et éventuellement censurer parce que, parfois, ce n'est pas raisonnable ?
On sent que, de toute façon, on va vers une augmentation de la pression fiscale. On pourrait donc instituer une obligation de prévoir afin que, dans une municipalité, l'instigateur soit beaucoup plus responsable.
Nous ne pouvons pas, par les temps qui courent, continuer ainsi, surtout au moment où l'on parle de la règle d'or, qui est sans doute nécessaire. Pourquoi pas une règle d'or préventive pour les PPP ? Nous ne pouvons pas non plus hypothéquer à souhait l'avenir de l'État, des collectivités, des départements, des communes et des communautés de communes, et, je rejoins tout à fait M. Hunault, il serait bon de créer une commission d'enquête.

C'est le minimum, mais nous pourrions aller plus loin et travailler ensemble, comme nous savons le faire dans cette assemblée, pour que les PPP n'aient pas de retombées trop négatives à l'avenir. Je crains qu'il n'y ait des dérives, vous le craignez aussi, tant dans la majorité que dans l'opposition. Une grande prudence est nécessaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, je remercie les différents orateurs qui sont intervenus, d'abord Roland Muzeau puisque c'est à l'initiative de son groupe que ce débat a lieu, Michel Diefenbacher, grand spécialiste des questions que nous abordons cet après-midi, Jean-Jacques Urvoas, Michel Hunault, qui a fait une proposition sur laquelle je reviendrai en conclusion, et Daniel Boisserie.
Je souhaite exposer devant vous, au nom de François Baroin et de moi-même, le bilan et les perspectives des partenariats public-privé, et préciser la place de ce mécanisme innovant comme outil de gestion publique et de développement économique, pour les collectivités comme pour l'État.
Au travers de l'alliance du secteur public et du secteur privé, c'est à mes yeux la question de l'utilisation à bon escient de cet outil d'efficacité économique, au service de l'intérêt général, qui doit être posée.
Ce débat intervient un peu plus de sept ans après la création de cet outil par l'ordonnance de juin 2004, et un peu plus de trois ans après l'adoption de nouvelles mesures législatives destinées à faciliter l'usage des PPP, trois ans aussi après le déclenchement d'une crise mondiale dont les effets se font encore sentir.
L'action du Gouvernement consiste d'abord à mieux réguler le recours aux PPP pour le rendre plus transparent et plus sûr.
La démarche d'amélioration de l'encadrement des PPP engagée par le Gouvernement s'inscrit dans une dynamique européenne et internationale de modernisation de la gestion publique. La quasi-totalité des vingt-sept pays membres de l'Union européenne sont désormais engagés dans la voie des PPP. La Commission européenne comme la BEI en ont fait un outil de leur politique d'investissement en infrastructures destinées à connecter et unifier physiquement le marché intérieur européen.
Le développement des PPP depuis sept ans indique que les acteurs publics peuvent tirer bénéfice des modes de gestion privée. Ces contrats ont pour objet de faire appel à l'initiative et au financement privés pour faire naître des équipements nouveaux ou assurer la mise à disposition de services destinés à assister les autorités administratives dans l'exercice de leurs missions. Dans ce cadre, les entreprises proposent une prestation globale qu'elles effectuent initialement à leurs frais, et dont elles maîtrisent les coûts parce qu'elles sont responsables à la fois de la conception, de la construction et de la maintenance sur la durée. Ce type d'outil oblige les entités publiques à penser les projets en coût global d'utilisation, à long terme, sur toute la durée de vie de l'équipement.
Le contrat de partenariat n'est pas pour autant un mode ordinaire de la commande publique. Son utilisation est encadrée de manière très précise par des textes législatifs et réglementaires. La loi du 28 juillet 2008 a permis d'instaurer un cadre renforcé, clarifié et sécurisé du recours au PPP en France. Elle ajoute une nouvelle voie d'accès aux contrats de partenariat : le bilan économique et financier, au-delà des critères de l'urgence et de la complexité.
En France, cette famille recouvre les contrats globaux comprenant nécessairement au moins trois éléments : le financement, qui peut n'être que partiel, d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public ; la construction ou la transformation des ouvrages ou des équipements, ainsi que tout ou partie de leur conception, le cas échéant ; leur entretien etou leur maintenance, etou leur exploitation, etou leur gestion.
La famille des PPP recouvre plusieurs outils juridiques, développés en France depuis une dizaine d'années : le bail emphytéotique hospitalier, le BEH, depuis l'ordonnance de 2003, le bail emphytéotique administratif, le BEA, et, depuis l'ordonnance de juin 2004, le contrat de partenariat, le CP, qui, en tant qu'outil transversal ouvert à tous les niveaux de collectivités publiques et à toutes les problématiques sectorielles, en constitue la forme la plus aboutie et la plus encadrée, aujourd'hui largement prédominante en volume. C'est au contrat de partenariat que je me référerai pour l'essentiel dans la suite de mon intervention.
Le marché du PPP a généré 18 milliards d'euros d'investissement depuis 2002, dont près de 12 milliards correspondant à 120 contrats signés pour le seul contrat de partenariat. Cela reste peu en chiffres absolus, comme en pourcentage de la commande publique, qui est autour de 90 milliards d'euros par an, mais ce n'est pas négligeable au regard de la jeunesse de cet outil. La perception par certains du PPP comme vecteur de privatisation rampante a d'ailleurs très largement disparu : de nombreuses collectivités, de la majorité ou de l'opposition, de Lille à Paris, ont ainsi désormais adopté ce nouvel outil.
L'une des originalités du PPP à la française, si on le compare à ses homologues étrangers, c'est qu'il concerne aussi bien des projets nécessitant un investissement limité, comme en témoignent les nombreux contrats relatifs à l'éclairage public passés par des collectivités, que des projets d'infrastructures majeurs, comme des lignes ferroviaires à grande vitesse.
Les PPP ne sont d'ailleurs pas dévolus aux seuls grands groupes du BTP : des entreprises de taille moyenne ou même des PME ont su s'organiser et se grouper pour remporter de nombreux contrats de taille plus modeste, et j'ai compris que c'était une préoccupation partagée sur tous les bancs. Elles interviennent également en tant que sous-traitantes des grands groupes.
L'ordonnance instituant les contrats de partenariat est d'ailleurs l'un des rares textes relatifs à la commande publique qui fait obligation d'introduire la part du contrat confiée à des PME comme critère obligatoire pour le choix du titulaire de celui-ci.
On peut noter un certain nombre d'avantages déterminants d'un PPP sur le plan microéconomique : le respect du coût global du projet sur la durée de vie, grâce à une meilleure intégration des phases du projet, conception, construction, exploitation, maintenance ;
…la tenue des délais de réalisation, ce qui accroît l'utilité socio-économique du projet ; un dialogue compétitif, contrairement à l'appel d'offres, ce qui permet de tirer le maximum d'innovation et de créativité du secteur privé ; une garantie contractuelle de bon entretien à long terme du patrimoine concerné, alors qu'il faut admettre qu'il s'agit d'une faiblesse chronique s'agissant de la gestion du patrimoine immobilier de l'État ;…
…une meilleure qualité de service grâce à la rémunération à la performance. Le contrat de partenariat se révèle être un outil bien adapté à la mise en oeuvre de contrats de performance énergétique, essentiels à la concrétisation des engagements du Grenelle de l'environnement. Cela doit permettre de « surcompenser » le coût accru du financement et la rémunération du partenaire privé.
Il existe également des avantages sur le plan macroéconomique, notamment le préfinancement privé pour un lancement plus rapide de projets – c'est un accélérateur d'investissement public –,…
…la disparition des phénomènes de stop-and-go liés aux contingences budgétaires, grâce à la contractualisation, le fait que la puissance publique puisse se concentrer désormais sur la définition du service à fournir plus que sur les spécifications techniques de l'ouvrage censé fournir ce service, et que le secteur public conserve le contrôle sur ses services externalisés et ait un devoir d'évaluation permanente.
Ces qualités doivent permettre d'améliorer l'offre de services au meilleur coût pour le citoyen.
Cela suppose une révolution culturelle pour les clients publics, qui doivent apprendre à faire faire plutôt que faire eux-mêmes, à acheter un service, une disponibilité plutôt qu'un ouvrage – c'est justifié par la nécessité de recentrer leurs ressources internes sur le coeur de métier des services publics qu'ils exercent –, mais aussi à raisonner en mode « développement durable » – coût complet sur la durée de vie –, et enfin à évaluer systématiquement les risques ex ante.
Néanmoins, il existe des inconvénients, reconnaissons-le. Le contrat de partenariat reste un outil complexe dans la durée, d'où l'exigence d'une évaluation préalable et l'intervention de l'organisme expert la MAPPP pour s'assurer que le contrat ne modifie pas l'utilité socio-économique d'un projet, qui demeure évidemment un préalable. De même, le CP s'ajoute, sans les remplacer, aux autres formes de commande publique, qui gardent leur pertinence dans certaines situations. Le CP ne doit pas non plus être vu comme un moyen de débudgétiser le financement ou de déconsolider la dette publique. Cette tentation, qui, reconnaissons-le, a pu exister, n'est d'ailleurs plus possible au vu des dernières évolutions réglementaires et normatives.
Il y a, d'autre part, des cas où les PPP ne sont clairement pas appropriés ; le recours au PPP ne peut et ne doit pas être systématique. On l'a vu, l'exigence d'évaluation préalable et le recours au dialogue compétitif font que la procédure d'ensemble du PPP est perçue comme complexe et lourde. Dans cette optique, les petits projets à caractère simple, où la dimension entretien-maintenance est limitée, donc également le potentiel d'optimisation de sa gestion technique, ne sont pas, pensons-nous, à traiter en PPP.
Par ailleurs, il est évident que la crise a eu un impact mécanique sur le financement privé des grands projets publics, avec un assèchement des sources de liquidité, le renchérissement des conditions de financement privé par rapport au public, et un raccourcissement des durées de financement offertes.
Au-delà des difficultés de financement bancaire, d'autres facteurs sont susceptibles de limiter le recours aux contrats de partenariat, notamment les problèmes de solvabilité à terme et de rigidification budgétaire que peut entraîner le recours massif au PPP pour des collectivités sous contrainte budgétaire croissante.
Ces évolutions rendent d'autant plus nécessaire l'évaluation d'un bilan qui, me semble-t-il, est favorable au PPP. Elles doivent conduire à une sélectivité accrue, à la fois dans le choix en amont des projets à engager et dans le choix du contrat de partenariat par rapport aux modes traditionnels de la commande publique. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de veiller scrupuleusement à cette sélectivité.
(M. Jean Mallot remplace M. Jean-Christophe Lagarde au fauteuil de la présidence.)
Le PPP est un outil qui commence à faire ses preuves lorsque l'investissement public doit être réalisé rapidement en fonction d'une échéance rapprochée. Ainsi, il n'est pas surprenant que le programme de construction de stades, indispensable pour être au rendez-vous de l'Euro 2016 de football, cité, je crois, par Michel Hunault, soit pour l'essentiel réalisé en PPP, à Lille, à Nice – je le dis en présence du député-maire de cette ville –, à Marseille ou à Bordeaux. Il en va de même des programmes de collèges dans des départements ayant à faire face à un problème de démographie scolaire, comme le Loiret ou la Moselle, programmes pour lesquels les contrats de partenariat ont permis de gagner une, voire plusieurs rentrées scolaires.
La nouveauté relative des PPP ne permet pas encore d'avoir une vision suffisamment étayée de leur efficacité de long terme. Cependant, les premiers retours d'expérience montrent que la tenue des délais de réalisation est avérée pour des projets qui, s'ils avaient été réalisés en maîtrise d'ouvrage publique, auraient été exposés à un risque de délai certain, avec des surcoûts inévitables en conséquence. C'est le cas, par exemple, du théâtre de Perpignan, avec Jean Nouvel pour concepteur, ou encore des prisons.
En termes sectoriels, le contrat de partenariat est particulièrement utilisé pour l'éclairage public, la réalisation et la gestion de grands équipements sportifs, de bâtiments à usage culturel, d'enseignement, de recherche – je pense notamment au plan Campus –, ou dans le secteur judiciaire-pénitentiaire – j'ai déjà cité le programme de prisons. Il apparaît également approprié aux projets d'efficience énergétique, comme support des contrats de performance énergétique.
Enfin, en tant que ministre en charge de l'économie numérique, je pense que le PPP est un outil au potentiel encore insuffisamment exploité pour les projets de TIC, qui sont des projets à risque élevé. Il y a là un impact opérationnel à attendre du PPP, d'autant que, contrairement aux autres domaines d'application du contrat de partenariat, ces projets font apparaître un investissement de départ, donc un surcoût de financement, limité au regard du service rendu en aval.
Les opérations à ce jour restent limitées ; je pense par exemple à l'écotaxe poids lourds, au système de transmission sol-train GSM-R, aux systèmes d'information dédiés au transport multimodal, sans oublier les projets de déploiement de haut débit en zone rurale. On peut penser qu'il serait utile d'étudier la piste des contrats de partenariat dans certains domaines, par exemple pour combler le retard des systèmes d'information de production de soins dans le domaine hospitalier ou celui de l'équipement des lycées et collèges en espaces numériques de travail. De tels projets pourraient trouver une solution rapide et économique avec le recours au contrat de partenariat.
Je voudrais terminer cette présentation par une mise en perspective, en observant les expériences étrangères. La montée en puissance de la France en 2011, conjuguée au ralentissement du marché britannique, longtemps leader avec le programme PFI, Private Finance Initiative, lancé dès 1992, fait que le marché français du PPP représente, d'après les chiffres du Centre européen d'expertise des PPP, rattaché à la Banque européenne d'investissement, plus des deux tiers en volume du marché européen en 2011.
L'expérience française combine un dispositif législatif très encadré, contrairement au PFI britannique, ainsi qu'une procédure d'attribution exigeante, et s'appuie sur un écosystème complet et très concurrentiel du côté des acteurs privés : du bureau d'études techniques au fonds d'investissement, en passant par les constructeurs, les exploitants de services aux collectivités et les banques de financement.
Elle suscite un intérêt croissant à l'étranger, en Europe comme auprès des pays émergents. C'est pourquoi l'axe PPP a été identifié par les pouvoirs publics comme un axe de coopération avec les pays étrangers, tant dans une perspective d'aide au développement de leurs infrastructures que de promotion des intérêts de la filière française du PPP.
En conclusion, le partenariat public-privé est un moyen utile pour soutenir l'activité du secteur des travaux publics et les milliers de PME et TPE concernées. Il permet de contribuer au renforcement et à la modernisation de nos infrastructures, qui sont l'un de nos atouts majeurs de compétitivité et d'attractivité, comme le soulignent toutes les entreprises, françaises ou étrangères. Il contribue également à rendre de meilleurs services à tous nos concitoyens, sur tous nos territoires.
Bien sûr, il peut faire l'objet d'améliorations. M. Michel Hunault nous dit qu'il faut améliorer le fonctionnement des PPP et l'information à leur sujet. Il a raison et c'est un objectif que le Gouvernement partage. En même temps, impliquer la CDC et le FSI paraît un peu délicat. La priorité du FSI est de contribuer au développement de nos PME-PMI les plus prometteuses. Mais ce travail de réflexion est en effet nécessaire, et je vais demander aux services de l'État compétents d'y contribuer, en travaillant avec vous, monsieur le député, sur les pistes que vous avez citées.
Naturellement, les PPP, strictement encadrés par les textes, n'ont de sens que s'ils sont réellement le meilleur moyen d'atteindre les objectifs poursuivis, que j'ai essayé d'énumérer. Ils n'ont de sens que si les évaluations préalables permettent de confirmer qu'ils présentent un bilan favorable pour les finances publiques au regard des autres modes de réalisation envisageables. Ils n'ont de sens, enfin, que s'ils comportent des garanties suffisantes, s'agissant du partage des risques entre la personne publique et le partenaire privé. C'est ce à quoi l'État veille et doit continuer de veiller. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Jean-Christophe Lagarde.)

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de MM. Christian Estrosi,Jean-Pierre Abelin, Jean Auclair et plusieurs de leurs collègues visant à développer le « Fabriqué en France » et à déterminer la notion d'origine des produits (no 4026).

Je n'aurais jamais pensé, en 2009-2010, lorsque j'occupais votre place, monsieur le ministre de l'industrie, et que nous considérions, avec le Président de la République, que le « fabriqué en France » était une priorité à mettre en oeuvre après tant d'années de lâcheté dans notre pays où, pendant près de trente ans, les gouvernements, de gauche comme de droite, n'avaient cessé de considérer que l'avenir de l'emploi dans notre pays devait se tourner vers les services, vers la finance, vers l'économie virtuelle, que lancer l'idée du « fabriqué en France » et de la réindustrialisation par la production dans notre pays serait aujourd'hui le leitmotiv de tant de candidats qui ne cessent de parler de produire en France, de fabriquer en France, de made in France, et pour le moins d'acheter français. Dorénavant tout le monde en parle, alors que certains d'entre nous étaient traités à l'époque d'affreux protectionnistes ; mais tout cela n'a pas débuté cette année, c'est un constat : entre 1998 et 2008 – vous le savez, monsieur le ministre, il faut toujours rappeler les dates –, nous avons perdu 500 000 emplois industriels.

Ces 550 000 emplois, nous les avons perdus entre 1998 et 2008, telle est la réalité et la conséquence des politiques qui ont été conduites pendant tant d'années par tant de gouvernements différents (Exclamations sur les bancs du groupe SRC), qui n'avaient pas pour priorité une grande politique industrielle.
C'est ce qui m'a conduit à ouvrir un grand débat avec les états généraux de l'industrie – je salue l'action d'Yves Jégo, parmi nous aujourd'hui, qui avait conduit dans ce cadre une mission sur le « fabriqué en France » –, au cours desquels près de 5 000 personnes dans les régions, des partenaires sociaux, des entrepreneurs, l'ensemble des acteurs des filières, à travers 250 ateliers, se sont exprimés, et vingt-trois mesures en sont issues. Dix-neuf mesures étaient déjà mises en oeuvre en novembre 2010 : je citerai la prime à la réindustrialisation, qui a permis par exemple la relocalisation dans l'Oise de la fonderie Loiselet – que vous connaissez bien, monsieur le ministre –, mais je pourrais en citer bien d'autres, tels les Skis Rossignol, le Coq Sportif, Atoll, CMOI, 3S Photonics, l'entreprise Geneviève Lethu dans la Marne. L'Observatoire du « fabriqué en France » a publié en juillet 2010 une étude mesurant combien la part de composants français dans les produits assemblés en France avait chuté au cours des dix années précédentes, ce qui expliquait en grande partie la perte de 550 000 emplois industriels. À ce propos, monsieur le ministre, je vous remercie de m'avoir répondu par écrit que, dans le prolongement de cette étude de l'Observatoire, vous publieriez prochainement son analyse pour 2011. Nous nous étions engagés à publier ses chiffres tous les ans. Je pense aussi au comité stratégique de filière, qui exigeait qu'entre donneurs d'ordres et sous-traitants les relations soient plus vertueuses, les grands groupes ayant eu trop tendance à faire appel à des PME et à des productions extérieures à nos frontières. Je pense également à des mesures qui n'ont pas encore été mises en oeuvre mais qui ont été décidées, la vingt-et-unième étant la banque de l'industrie publique, dont le Président de la République a rappelé dimanche dernier qu'elle serait prochainement mise en place,…

…ainsi qu'au livret épargne industrie dont l'objectif est de faire bouger une part de l'épargne des Français, positionnée sur l'assurance-vie pour près de 2 500 milliards d'euros, vers une politique soutenant l'innovation industrielle et donc les grands enjeux d'avenir. Ce que je présente aujourd'hui, cosigné par 180 députés de la majorité, n'est que la suite logique de tout cela. Au moment où le Président de la République propose une taxe antidélocalisation pour que les produits d'importation dans notre pays soient davantage concurrencés par nos propres productions, cette proposition de résolution est un outil de plus que nous souhaitons placer dans l'ensemble de cette panoplie.
Pourquoi ai-je voulu, avec mes collègues, déposer cette proposition de résolution ?
Ce n'est pas parce que le « fabriqué en France » est tendance, ce n'est pas pour succomber aux phénomènes de mode, mais parce que la période difficile que nous traversons exige que nous ne soyons plus à l'heure du rafistolage. J'ai pu constater hier encore, alors que j'organisais une table ronde avec le secrétaire général de Force Ouvrière, le vice-président de la CGPME et un certain nombre de chefs d'entreprise tournés vers le produire en France, à quel point ceux-ci étaient en attente d'une protection par un label « origine France », à quel point ils avaient envie d'agir encore et toujours plus pour valoriser le fabriqué en France. Le PDG de la fonderie Loiselet nous a ainsi expliqué que cette résolution, si elle est suivie d'effets au niveau européen, lui permettra demain d'embaucher 30 % à 40 % de salariés de plus. Oui, mes chers collègues, sachez que les plaques en fonte que nous imposons dans la plupart de nos collectivités à travers la commande publique sont fabriquées en Inde ; mais, dans ce pays, elles sont marquées made in India, alors que dans nos rues il n'y a rien d'inscrit dessus. Aucun de nos concitoyens ne s'en émeut parce qu'ils n'ont pas du tout le sentiment, de ce fait, que les plaques ont été produites en Inde. Si demain, il y a une obligation impérative d'inscrire le label d'origine, je crois que cela changera beaucoup de comportements à l'égard d'un grand nombre de PME et d'industries françaises, même en termes de commandes publiques de la part des collectivités.
Il est donc grand temps de repenser notre système afin de définir un nouveau modèle qui nous conduira vers un développement durable. Et ce nouveau modèle doit se fonder sur le « fabriqué en France ».
Le constat des états généraux de l'industrie était limpide : recul de la France dans les exportations européennes, perte d'influence et de rayonnement dans les filières les plus stratégiques. Certes, nous avons commencé à redresser la barre puisque, après une chute de plus de 25 % entre 2007 et 2009, nous avons fait progresser la production industrielle de 10 % en pleine crise… Mais cela ne suffit pas ! Chacun peut comparer les écarts de compétitivité avec l'Allemagne, qui représente près de 30 % des exportations européennes alors qu'aujourd'hui, avec les pertes que nous avons enregistrées, nous n'en sommes malheureusement qu'à 12 %.
Afin de retrouver la diversité de notre tissu industriel et notre identité face à la mondialisation, le seul chemin viable est celui de la production. Les Français attendent des réponses concrètes. Aujourd'hui, 72 % d'entre eux se disent prêts, même à un coût légèrement supérieur, à favoriser à l'achat un produit dès lors qu'il est labellisé « fabriqué en France ». Bien sûr, cela s'explique d'abord par l'attrait de la qualité de nos produits, mais en achetant du « fabriqué en France », les consommateurs soutiennent les entreprises françaises et favorisent leur compétitivité, et donc forcément leur essor. Ils savent qu'après trente ans de politique de droite comme de gauche qui a délaissé la production, il est grand temps de réindustrialiser notre pays. On a trop souvent dit à nos enfants que le bleu de travail était sale !
Par ailleurs, il est important de comprendre que la question de la réindustrialisation ne peut se résoudre qu'au niveau européen. Nous devons convaincre ceux qui tentent de faire croire aux Français qu'ils sont les chantres du fabriqué en France simplement parce qu'ils sautent sur leur chaise en criant :« Produire français ! Produire français ! » que la seule voie pour y arriver est au niveau de l'Union européenne et qu'il faut donc envoyer un signal aux instances européennes.
Notre proposition de résolution a donc deux objectifs.
Elle vise, d'une part, à rendre obligatoire le marquage de l'origine sur tous les produits, alimentaires et non alimentaires, sans que la Cour de justice de l'Union européenne puisse l'empêcher en ayant une interprétation trop restrictive du principe de libre circulation contenu dans les traités européens. En effet, s'il est déjà possible d'apposer librement la mention « Fabriqué en France » sur un produit, personne ne peut contester que les règles pour vérifier la sincérité de cette mention sont trompeuses pour le consommateur.
D'autre part, elle propose de revoir complètement la notion d'origine définie actuellement par le code des douanes communautaires. Cette notion permet aujourd'hui, pour n'importe quel fabricant d'objets de décoration, d'acheter par exemple une assiette de porcelaine en Chine, d'y laisser une trace, une petite griffure, ce qui lui permet d'inscrire dessus made in France,…

…et le tour est joué : il peut concurrencer allègrement une assiette de porcelaine de Limoges, cela en toute légalité. Ce n'est pas acceptable.

Afin que nos concitoyens puissent choisir en toute transparence, je prône donc un étiquetage systématique et précis des produits. Peu de biens produits sur notre sol comportent 100 % de composants français. Par exemple, la plupart des Renault assemblées en France – il n'y en a d'ailleurs que 23 % contre près de 45 % de Peugeot et de Citroën – ne comportent que 35 % à 40 % de composants qui viennent de PME et d'équipementiers français, ce qui signifie que la part de production de Renault en France n'est que de 6 % à 7 %. Voilà une réalité qui n'est plus acceptable ! C'est pourquoi je souhaite que l'information pour le client soit claire et complète en indiquant par l'étiquetage le pourcentage lié à chaque pays de production. Si la proportion de « fabriqué en France » atteint au moins 55 %, la mention en toutes lettres pourra être apposée en haut de l'étiquette. Les États-Unis, l'Australie, le Canada et bien d'autres pays utilisent déjà cette méthode. Elle souligne la différence entre les produits réellement fabriqués sur notre territoire et ceux qui ne sont que conçus ou assemblés ici.
Nous disposons de tous les atouts nécessaires à la concrétisation de nos talents à chaque étape du processus, de l'idée première qui germe dans un esprit imaginatif jusqu'à la mise sur le marché de l'article finalisé. Lorsque les entreprises s'appliquent à défendre notre patrimoine, nos ouvriers, nos techniciens, nos ingénieurs, nos agriculteurs, il est normal qu'elles puissent mettre en avant ce patriotisme économique et en récolter les fruits !

Monsieur Estrosi, je vous remercie de vous acheminer vers votre conclusion.

Le « fabriqué en France » est un argument de promotion commerciale, aussi bien sur notre sol qu'à l'étranger. Je propose d'ailleurs dans cette résolution que l'Union Européenne puisse réfléchir à un label « fabriqué dans l'Union européenne », que l'on pourrait apposer à côté de celui de l'origine nationale. La promotion du « fabriqué en France » n'est pas synonyme de repli sur soi et de refus des évolutions du monde ; au contraire, elle équivaut à chercher à tirer le meilleur parti de la mondialisation, qui peut se transformer en atout, à la condition qu'elle soit équilibrée, comme dans l'aéronautique, les industries de santé, le ferroviaire ou l'agroalimentaire.
C'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que je vous demande de soutenir cette proposition de résolution. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur Estrosi, un million de chômeurs de plus en cinq ans, 750 000 emplois industriels perdus en dix ans, dont 450 000 sous la présidence de Nicolas Sarkozy : le cadre est fixé, le bilan est très lourd, et il est normal que ce sujet soit la préoccupation principale de nos concitoyens.
La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui part d'une bonne intention : développer le « fabriqué en France » et déterminer la notion d'origine des produits. Le groupe SRC ne s'y opposera pas. Pour atteindre cet objectif, son auteur, Christian Estrosi, souhaite que les instances européennes admettent que le marquage de l'origine des produits, intracommunautaire ou extracommunautaire, soit compatible avec le principe de libre circulation des marchandises.
Il propose que l'Europe adopte un nouveau règlement pour rendre obligatoire le signalement de l'origine géographique de tous les produits. On a du mal à comprendre que cette idée n'ait pas été défendue plus tôt par le Gouvernement, y compris, cher Christian Estrosi, à l'époque où vous y exerciez de grandes responsabilités.
Cela aurait été possible, par exemple, dans le cadre de la proposition de règlement européen sur « l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers ». Ce texte, qui comporte certains progrès, précise que « l'importation ou la mise sur le marché de marchandises fait l'objet d'un marquage de l'origine » utilisant les termes « fabriqué en » ou en anglais « made in ». J'avoue moins bien parler l'anglais que vous, monsieur le ministre.
Adoptée en première lecture au Parlement européen en octobre 2010, à une large majorité, elle s'applique aux produits industriels de consommation finale provenant des pays hors Union européenne, sauf la pêche, l'aquaculture et les denrées alimentaires, qui obéissent à des règles spécifiques. La proposition de règlement européen mentionne aussi que « dès à présent, dans l'Union, de nombreuses entreprises font volontairement usage du marquage de l'origine. »
Cette proposition européenne précise qu'il existe « un certain nombre de possibilités de marquage de l'origine pourvu qu'un certain nombre de règles soient appliquées : le respect des règles d'origine non préférentielles, le caractère non obligatoire de l'indication d'origine, qui doit se faire sur une base volontaire, et le fait que le marquage national ne soit pas plus indulgent que celui réservé aux produits importés. »
L'exposé des motifs de la proposition de Christian Estrosi et ses collègues se réfère à une étude nationale du CREDOC publiée en 2010, selon laquelle 64 % des sondés étaient prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France.
Mais un autre sondage, publié par l'IFOP en décembre 2011, c'est-à-dire après le dépôt de cette proposition de résolution, constate que 76 % des consommateurs français donnent la priorité à la qualité du produit et 70 % à son prix, lors de l'achat. Il est vrai que la marque du Président du pouvoir d'achat, celui qui augmente tous les trois mois la TVA, a fait long feu. Enfin, le même sondage relève que seulement 15 % des consommateurs déclarent prendre en compte le pays de fabrication du produit dans leur choix.
Nous ne nous opposerons pas à votre texte, dont nous partageons l'intention,…

…mais il sonne comme un aveu d'impuissance face à la désindustrialisation accélérée de notre pays.
Dans l'agence de voyages présidentielle, de nombreuses destinations proposent des allers sans retours : Gandrange chez ArcelorMittal, SeaFrance dans le Pas-de-Calais, M-Real dans l'Eure et les chemins de Saint-Jacques d'Areva ou de PSA. Ces allers sans retours marquent le pas des 450 000 emplois industriels perdus depuis cinq ans.
Certes, on peut visiter Sallanches trouvant la destination d'un aller avec retour, symbole d'une relocalisation. Mais les dirigeants et les salariés de l'entreprise Rossignol ne doivent qu'à eux-mêmes cette nouvelle heureuse : une vingtaine d'emplois créés sur un effectif de 200 personnes. Notons cependant que les salariés étaient trois fois plus nombreux au début des années 2000.
Le Président ne nous avait pas dit que le « gagner plus » ne concernerait que la finance et les banques, et il ne nous avait pas annoncé l'allongement de la liste des chômeurs.
L'industrie ne représente plus que 13 % de la valeur ajoutée dans notre pays, contre le double en Allemagne. Le déficit du commerce extérieur est abyssal – 75 milliards d'euros – alors que l'Allemagne affiche un excédent de 150 milliards d'euros.
Les Français s'interrogent : une autre politique était-elle possible, une autre voie est-elle encore possible ? Notre débat doit contribuer à répondre à cette interrogation anxieuse et légitime. Il ne suffit pas de constater et de critiquer.

Regardons d'abord le reste du monde.
La mondialisation des échanges orchestrée par les multinationales, avec pour viatique le consensus de Washington, véritable code de bonne conduite libérale, n'a pas empêché des États, même les plus libéraux, de construire de véritables stratégies de puissance : ici, fortes commandes publiques favorisant les entreprises nationales ; là, prix de l'énergie subventionné ; ailleurs, constitution de pools financiers et industriels soutenus discrètement ou ouvertement par les États.
Comme le rappelle Jean-Louis Levet dans son excellent livre Pas d'avenir sans industrie, la puissance publique américaine est un acteur engagé très interventionniste. L'Allemagne, dont les industriels savent jouer groupés, combine à long terme des mesures nationales verticales et des politiques structurelles sectorielles et régionales : une sorte de « ni vu ni connu, je t'embrouille » pour la Commission européenne.

Les offensives commerciales à l'exportation sont puissantes et coordonnées, ce qui nous manque.
La Suède, par exemple, ne parle jamais de la quasi-absence de taxe sur l'énergie vendue aux industriels. Le Japon et la Chine, voire de plus petits pays comme l'Irlande, Israël et la Finlande, démontrent la stratégie de puissance que chaque État volontariste peut mettre en place dans un contexte de mondialisation.
Ces exemples ne font que mettre en évidence les non-dits industriels de l'Union européenne – une des zones du monde à la plus faible croissance – et l'absence criante d'un État stratège et développeur en France.

Je reconnais que les états généraux de l'industrie, organisés par le ministère, ont porté des attentes fortes et ont réalisé des diagnostics justes. Mais la mise en musique de la partition stratégique attend toujours son compositeur et son chef d'orchestre.

Cher Christian Estrosi, vous avez fait brutalement les frais d'un changement de cap présidentiel. Votre proposition rappelle avec nostalgie votre idée de créer un observatoire du « fabriqué en France » et apparaît comme une séance de rattrapage, alors que la défense de l'industrie devient un thème central de la campagne présidentielle.
« Il est temps de changer de modèle », disiez-vous tout à l'heure. Pour ma part, je déplore la fermeture de nombreuses filières dans l'enseignement technique. Il me revient donc la responsabilité de vous convaincre qu'une autre voie est possible pour retrouver de l'élan et assumer les engagements d'un État stratège.
Voilà ce que sera le patriotisme industriel de François Hollande…

…dans le cadre de son pacte productif global.
Tout d'abord, nous créerons une véritable banque publique d'investissement, une idée qui semble aussi faire son chemin à l'UMP, ce qui est peut-être le syndrome du copier-coller français. Les fonds régionaux de cette banque publique favoriseront le développement des PME. Les régions, pivots de l'animation économique, pourront prendre des participations dans les entreprises stratégiques pour le développement local et la compétitivité de la France.
Une partie des financements sera orientée vers l'économie sociale et solidaire, et les PME seront une priorité. L'épargne des Français sera mobilisée via la création d'un « livret d'épargne industrie » dont le produit sera entièrement dédié au financement des PME et des entreprises innovantes.

Cher collègue Myard, cette formule neutralise la spéculation et mobilise tout le pays pour la réindustrialisation.
Pour cela, le plafond du livret de développement durable sera doublé, c'est-à-dire porté de 6 000 euros à 12 000 euros. Les PME, les TPE, les artisans et les commerçants auront dans chaque région un interlocuteur unique.
La mobilisation du crédit ou la moralisation de la sous-traitance ont parfois besoin de médiateurs, vous en savez quelque chose, monsieur le ministre. Le développement et la réindustrialisation ont besoin d'interlocuteurs proches, compétents et disponibles.
Le crédit d'impôt recherche sera rendu plus accessible aux PME et TPE ; l'accès à la commande publique leur sera facilité. Les aides publiques et les allégements fiscaux seront strictement orientés vers les entreprises qui investiront effectivement sur notre territoire, qui y localiseront leur activité et seront offensives à l'exportation.
À cet effet, la fiscalité locale des entreprises sera modulée en fonction des investissements réalisés. Ce sera en quelque sorte du gagnant-gagnant au service de l'emploi. En parallèle, dans le cadre d'un contrat spécifique avec les grandes entreprises françaises, un mouvement de relocalisation de leurs usines sera engagé. Les entreprises qui se délocalisent devront, elles, rembourser les aides publiques reçues, c'est bien le moins.
Une distinction sera faite entre les bénéfices réinvestis et les bénéfices distribués aux actionnaires. Trois taux d'imposition sur les sociétés seront mis en place : 35 % pour les grandes, 30 % pour les petites et moyennes, 15 % pour les très petites. Actuellement, les petites payent plus que les grandes.

Il sera mis fin aux tergiversations qui entravent, quoi que vous annonciez, monsieur le ministre, le développement vital de l'économie numérique Nous le ferons en organisant avec les collectivités locales et l'industrie la couverture intégrale de la France en très haut débit avant dix ans. Je parle bien d'organiser et non pas d'inciter.
Le statut public des entreprises détenues majoritairement par l'État – EDF, SNCF, La Poste – sera préservé pour conforter les missions de service public, qui ont subi tellement de fragilisations et de démantèlements depuis dix ans. La dégradation de la situation des populations les plus fragiles nous impose d'obtenir de nos partenaires européens la consolidation de ces missions par l'adoption d'une directive sur la protection des services publics, un engagement auquel la droite a renoncé.
Dans les banques, les activités utiles à l'investissement et à l'emploi seront séparées des activités spéculatives. Il faut protéger la gestion en bon père de famille, qui sert l'économie réelle, des extravagances de l'économie de casino, qui tourne parfois à la roulette russe.

En Europe, nous défendrons un budget de croissance – et non pas d'austérité – au service de l'emploi et des grands projets d'avenir, afin de créer de nouveaux outils financiers pour lancer des programmes industriels innovants, notamment dans les domaines des technologies vertes et des transports de marchandises ferroviaires. Et nous militerons auprès de nos partenaires – il est temps ! – pour une véritable Europe de l'énergie.

Enfin, nous proposerons autre chose qu'on label pour installer une nouvelle politique commerciale et pour faire obstacle à toute forme de concurrence déloyale. En fixant des règles strictes de réciprocité en matière sociale et environnementale, et avec l'instauration d'une contribution climat-énergie aux frontières de l'Europe, nous pourrons impulser une stratégie offensive et lucide.
L'industrie et ses salariés – les techniciens, les ingénieurs et les chercheurs – attendent une mobilisation totale. Leur compétence, leur créativité et leur esprit d'entreprise méritent que nous nous battions pour dépasser les représentations archaïques et méprisantes qui en font une activité manufacturière aliénante et polluante.
Selon La Bruyère, « il n'y a au monde que deux manières de s'élever, ou par sa propre industrie, ou par l'imbécillité des autres. » Quant à nous, avec François Hollande, nous ferons le pari de l'industrie !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, grâce à l'initiative heureuse de notre collègue Christian Estrosi, nous examinons une proposition de résolution que j'ai eu l'honneur de cosigner avec plusieurs collègues du Nouveau Centre et 180 parlementaires, et dont l'objet est d'une grande actualité.
Tous les programmes des candidats annoncés à la fonction présidentielle sont étiquetés « made in France ». Celui dont François Brottes vient de faire l'exégèse est même purement « made in France », tant il est peu exportable,…

…tout comme les 35 heures, qui ont constitué un échec patent en matière d'exportation.
Mais le « fabriqué en France » répond aussi à une attente de nos concitoyens en matière de mode de consommation et de patriotisme économique. En effet, la marque France est plébiscitée par les Français et devient de plus en plus un critère d'achat. Malgré la crise, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à se dire prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué en France : 75 % contre 44 % il y a cinq ans, selon les enquêtes d'opinion.
Si le prix demeure le principal critère de choix pour une large majorité d'entre eux, l'origine et les conditions de fabrication apparaissent comme des éléments de plus en plus déterminants. Cette évolution est la conséquence directe d'une prise de conscience : par temps de crise économique, ils sont devenus extrêmement sensibles aux critères éthiques tel que le fait d'acheter français pour soutenir l'emploi local, les savoir-faire, notre artisanat et notre industrie.
Le "fabriqué en France" pourrait être une façon de garantir au consommateur qu'il contribue à la bonne santé de l'économie nationale, qu'il favorise le maintien des activités productives en France et, par conséquent, qu'il limite les risques de délocalisations et de dumping social grâce à son acte d'achat, qui devient en quelque sorte un geste citoyen.
Ne nous trompons pas de débat : la mondialisation est un processus historique intangible et aussi un facteur de progrès pour l'humanité si l'on se réfère à la globalisation des échanges culturels ou de l'information. Certes séduisante, l'idée de démondialisation n'est qu'un concept intellectuel de salon qui ne résiste pas aux faits.
Dans ce contexte, le consommateur est de plus en plus exigeant en ce qui concerne l'origine des produits qu'il achète. Dans notre pays, une quarantaine de produits et une quinzaine de marques possèdent un véritable label France, mais de nombreux labels existent sur le marché. La faiblesse de l'arsenal juridique explique les dérives auxquelles notre collègue Christian Estrosi a fait référence dans son intervention. En théorie, la loi actuelle garantit contre ces pratiques, mais en réalité son détournement conduit aux dérives constatées concernant des produits assemblés en France.
Dans sa définition actuelle, le "fabriqué en France" s'appuie sur des critères trop complexes et son usage est difficile à contrôler. Ces faiblesses se traduisent par de nombreux détournements aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'exportation.
La multiplication des marquages nuit doublement : à la transparence souhaitée par les consommateurs ; aux savoir-faire de l'artisanat et de l'industrie, qui n'arrivent pas à se distinguer dans un cadre concurrentiel.
Pour les députés du groupe Nouveau Centre, la loi doit accorder une place plus large à la richesse des savoir-faire et des productions artisanales et industrielles de notre pays. Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs a marqué une première étape en la matière ; nous aurons du reste l'occasion d'en reparler, monsieur le ministre, puisque le texte sera prochainement examiné en seconde lecture par l'Assemblée nationale.
Actuellement, la réglementation est lacunaire, en France et en Europe, comme en témoigne le cas des couteaux de Laguiole et du savon de Marseille. Le marquage des produits est un enjeu pour un nombre croissant d'entreprises, qu'elles souhaitent produire en France afin de bénéficier d'une production de qualité – et de l'image afférente – sur le marché, ou qu'elles entendent bénéficier, hélas ! de façon abusive, voire frauduleuse, de ce marqueur.
Comme cela est si bien rappelé dans la proposition de résolution, la détermination de l'origine est un enjeu douanier et commercial qui ne fait l'objet d'aucune harmonisation au niveau international ou européen. La législation communautaire a développé des règles douanières spécifiques concernant l'identification de l'origine, mais elles sont trop complexes et trop anciennes au regard des pratiques actuelles dans les échanges commerciaux mondiaux. Ainsi, non seulement l'étiquetage de l'origine des produits n'est pas obligatoire, mais la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes permet même que des législations nationales mettent en place des marquages facultatifs. Faute d'une base juridique européenne, le « fabriqué en » ou le « made in » est donc non défini, facultatif et difficilement contrôlable. Mais ne soyons pas pessimistes, car le Parlement européen a relancé ses travaux sur le « made in » en décembre dernier, et nous pouvons espérer qu'ils porteront leurs fruits.
Nos voisins italiens et suisses procèdent également à la réforme de leurs labels d'origine respectifs. Nous assistons donc à un mouvement général en faveur de la promotion et de la reconnaissance des savoir-faire, qu'il faut encourager. La présente proposition de résolution demande ainsi au Parlement européen et à l'ensemble des instances européennes que le marquage de l'origine des produits soit intégré au marché commun et qu'une réglementation soit imposée. Nous ne pouvons que nous féliciter d'une telle initiative.
J'ajoute que la proposition de résolution s'inscrit dans la droite ligne du rapport rendu récemment par notre collègue Yves Jégo, que nous avions salué, car il invite les autorités européennes à aller de l'avant pour rendre obligatoire le marquage de l'origine des produits vendus dans l'Union européenne. Je veux néanmoins insister sur un point : ce marquage, une fois imposé, devra être promu sur les marchés tiers. C'est un enjeu extrêmement important pour celles de nos entreprises qui travaillent à l'export. En effet, la plupart des grands concurrents et partenaires commerciaux de l'Union européenne – qu'il s'agisse des États-Unis, du Japon ou de la Chine – ont rendu obligatoire le marquage de l'origine des produits commercialisés sur leur territoire. Ces pays s'efforcent également de promouvoir à l'étranger leur propre « made in », en raison de l'atout commercial qu'il représente, avec une puissance de frappe bien supérieure à celle dont nous disposons pour le moment. Monsieur le ministre, nous devons faire de même.
En conclusion, les députés du groupe centriste voteront avec enthousiasme et détermination en faveur de l'adoption de cette résolution. (Applaudissements sur les bancs des groupes NC et UMP.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après avoir lu cette proposition de résolution, j'ai tenté de comprendre le sens de la démarche qui a conduit à son dépôt. Naïveté ? Hypocrisie ? Révélation divine ? Schizophrénie ? Ce texte est-il « un brimborion hétéroclite, détail perdu d'un ensemble tronqué », pour citer Alexandre Vialatte ? S'agit-il d'un os à ronger ?
Connaissant le nom des cosignataires, tous membres de la majorité présidentielle, je penche plutôt pour un petit coup politique destiné à tenter de faire passer la pilule de dix années d'abandon industriel. Une industrie laminée par dix ans de laisser-faire, avec, à la clé, plus de 700 000 emplois industriels perdus. Une industrie laissée pendant dix ans à l'appétit insatiable des financiers, sans que jamais le Gouvernement y trouve à redire.
Voilà pourtant que, soudainement, la thématique du « produire français » revient sur le devant de la scène. Soigneusement présentée en bel objet de campagne électorale, elle doit cristalliser toutes les attentes.
Au-delà des intentions qui ont conduit au dépôt de ce texte – et que nous pouvons tous partager –, force est de constater que la nécessité, pour le pays, de restaurer une véritable capacité industrielle a été terriblement compromise par la politique de la majorité. Je me souviens des discours gouvernementaux qui, notamment en 2007, exaltaient le tertiaire et les services, présentés comme les nouveaux secteurs porteurs, et les politiques d'externalisation des grands groupes. Cette politique a, certes, été très efficace en termes de croissance financière et de niches de profit, mais elle a été désastreuse pour l'emploi et le tissu des PME dans nos territoires.
Est-il besoin de rappeler les beaux discours que le Président de la République, lorsqu'il n'était que ministre des finances, a tenus sur la production nationale, à l'intention des salariés d'Alstom, de Facom – qui, depuis, a délocalisé – ou de Sediver, qui a été liquidée ? Quant aux envolées du ministre candidat à Gandrange, en 2007, nous en connaissons tous la conclusion. Remarquable réussite du « Fabriqué en France » !
Et que dire des salariés de Fralib, qui ne souhaitent qu'une chose, pouvoir « produire français », mais qui ne trouvent manifestement pas un appui suffisant auprès du Gouvernement pour faire reculer une transnationale comme Unilever qui, en dépit d'une santé financière florissante, a fait le choix de la délocalisation pour engranger toujours plus de profit.
Que dire d'Arkema, né de la réorganisation de la branche chimie de Total, puis vendu, en novembre 2011, à un aventurier de la finance et qui fait aujourd'hui l'objet d'un plan social déguisé concernant 1 780 salariés en France ?
Que dire des 1 650 licenciements de la Comareg-Hebdoprint ?
Que dire des 305 salariés Merck-Organon, à Eragny-sur-Epte, dont les activités de production d'insuline sont indispensables à l'indépendance de la France en matière de traitement des malades du diabète ?
Que dire de M-Real, seule entreprise de France à produire des ramettes de papier, et de ses 330 salariés dans l'attente d'une solution industrielle ?
Que dire des 114 salariés d'Hélio-Corbeil? Des 140 salariés de Preciturn, à Thiers, et de tant d'autres ?
Les discours sont une chose, mais les chiffres sont têtus. Chers collègues de la majorité, les mots peuvent nous unir ; les actes nous divisent.
L'industrie ne représente plus en France que 13 % de la création de richesses, contre 18 % au début de la décennie. En trente ans, la France est passée de 5,3 millions d'emplois industriels à 3,4 millions. L'an dernier, 72 000 emplois ont encore été supprimés.
Je vous invite à méditer cette phrase de Bossuet : « Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences de faits dont ils chérissent les causes. »
La proposition de résolution ne concerne pas uniquement l'industrie ; son exposé des motifs fait également une large place à la question de l'origine des produits agricoles. Là encore, cela prête à sourire. En effet, depuis cinq ans, chaque fois qu'un projet de loi relatif à l'agriculture a été examiné, j'ai défendu, par voie d'amendement, l'obligation de faire figurer leur origine sur l'ensemble des produits alimentaires, y compris les produits transformés ; chaque fois, je me suis heurté au refus de la majorité et du Gouvernement.
Il y a quelques semaines encore, lors de l'examen du projet de loi sur le renforcement des droits, de la protection et de l'information des consommateurs, j'ai défendu cette exigence, précisant que la loi portant modernisation de l'agriculture et de la pêche avait introduit la possibilité de faire figurer l'indication du pays d'origine pour les produits agricoles et alimentaires et pour les produits de la mer, à l'état brut ou transformé, mais que cette disposition facultative n'avait pas trouvé de traduction réglementaire pour l'ensemble des produits concernés. Or cette obligation permettrait aux producteurs français d'être assurés de l'indication de l'origine de leur production ; nous disposerions ainsi d'un levier contre la spéculation sur les produits alimentaires. Las ! le rapporteur et le ministre m'ont répondu que ma proposition « heurtait de plein fouet le principe de libre circulation des marchandises, au coeur du marché unique européen », que « la règle qui prévaut est le principe de non-discrimination et que si nous […] adoptions [cet amendement], nous aurions un texte contraire au droit européen, donc illégal et inapplicable. » Et le rapporteur d'ajouter : « Malheureusement, l'instauration d'une obligation générale est contraire au droit communautaire. »

Aussi, je m'interroge. Quelle peut-être la légitimité d'une proposition de résolution comme celle que vous nous soumettez après un tel massacre industriel et après votre refus constant, tout au long de la législature, de porter le fer quand l'occasion s'en présentait ? (Exclamations sur les bancs des groupes UMP et NC.)
Toutefois, je ne vous cacherai pas que ce texte m'a procuré un réel plaisir, celui d'avoir eu en quelque sorte raison avant tout le monde. À ce propos, dois-je rappeler que le « Produisons français ! » fut, dès le début des années 1980, un axe majeur des propositions du PCF, qui, fit alors l'objet de procès à répétition en chauvinisme, en xénophobie et en obsessions patriotardes, et qui fut définitivement condamné en tant qu'analphabète de la mondialisation ? Quel retournement de conscience pour tous ceux qui nous raillaient, à l'époque ! Seraient-ils soudainement devenus – quelle horreur ! – plus communistes que les communistes ?
J'ai le même sentiment lorsque je vous entends vous ériger en bons élèves, demandant que la Commission européenne reconnaisse que le marquage de l'origine des produits n'est pas incompatible avec le principe de libre circulation et ne constitue donc pas une entrave aux échanges. Depuis des années, en tant que député de Thiers, j'ai multiplié, à la demande de la fédération française de la coutellerie, les interventions auprès du Gouvernement pour obtenir le marquage d'origine des produits de la coutellerie. Pas une fois nous n'avons eu le sentiment d'être écoutés ni, a fortiori, accompagnés.
Voilà que me reviennent en mémoire les arguments utilisés, en 2005, en faveur du « oui » au référendum sur le traité constitutionnel européen, lequel ne visait qu'à imposer partout, quelles qu'en soient les conséquences pour les activités industrielles et agricoles de nos pays, le respect du sacro-saint principe de la concurrence libre et non faussée. Chers collègues de la majorité, n'étiez-vous pas, à l'époque, d'ardents défenseurs de ce traité ?

Ne louiez-vous pas les joies et les mérites de la libéralisation et de la déréglementation ? Toujours est-il que, contrairement à nous, vous avez essuyé le refus légitime et éclairé du peuple, dont vous vous êtes empressés, en 2007, de bafouer le vote, en adoptant le traité de Lisbonne aux forceps, dans un superbe exercice de renoncement à nos principes républicains.
Défendre le « produire français », ce n'est pas sauter sur sa chaise comme un cabri, en criant : « produire français ! produire français ! ».

Ce n'est pas non plus se positionner, à coups de bas salaires et de dérégulation, sur des marchés éphémères à haut taux de profit, âprement disputés.
Défendre le « produire français », c'est d'abord reconstituer un véritable appareil productif, un maillage de PME et de grandes entreprises en coopération. Oui : en coopération, plutôt que soumis au diktat de la rentabilité financière imposé par les actionnaires des grands groupes et les exigences des marchés financiers, qui étranglent les entreprises sous-traitantes, comme nous le constatons tous dans nos territoires.
Pour défendre le « produire français », il faut développer et rétablir le potentiel industriel dans l'ensemble de nos territoires. Il nous faut reconstruire un tissu industriel diversifié, parce que notre pays compte encore des savoir-faire nombreux. À cette fin, il est indispensable de revoir fondamentalement la politique de nos institutions bancaires, en imposant aux banques le financement, à des taux d'intérêt faibles, de projets favorables à la création d'emplois, à la formation et aux investissements productifs et novateurs. Je ne compte plus les chefs d'entreprise, de PME ou de TPE, qui me disent qu'ils ne tiennent plus, à cause de taux d'intérêt qui dépassent aujourd'hui 6 %, voire 8 %, et encore : quand les banques veulent bien leur accorder ces prêts !
Nous devons également moduler l'impôt sur les sociétés et le taux des cotisations sociales, afin d'inciter les entreprises à développer la valeur ajoutée, les salaires et l'emploi, en pénalisant les entreprises qui délocalisent, qui développent leurs placements financiers ou prennent prétexte des nouvelles technologies pour supprimer des emplois et dégrader les conditions de travail.
Par ailleurs, nous avons besoin d'une politique ambitieuse en matière de recherche fondamentale et appliquée, qui ait d'autres objectifs que le profit à court terme. Pour ce faire, une politique de formation et de qualification, donc de hausse des salaires, est nécessaire. Bref : le contraire de la politique d'austérité de Nicolas Sarkozy.
Pour produire français et acheter français, il faut du pouvoir d'achat : il faut donc augmenter les salaires.
Ce sont ces propositions indispensables que le Front de gauche avance pour favoriser de façon concrète le redressement industriel dont notre pays a besoin. Mes chers collègues de la majorité, vous comprendrez qu'au regard de votre passif dans ce domaine – et il est lourd – et de l'absence de mesures fortes accompagnant vos louables intentions,…

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, parce que les crises sont d'implacables révélateurs des atouts et des faiblesses de nos économies, elles nous obligent à regarder en face les vérités qui, en d'autres temps plus cléments, dérangent les conservatismes en tous genres et nous font craindre le changement. Nous osons aujourd'hui aborder les tabous d'hier, et l'examen de votre résolution, cher Christian Estrosi, illustre cette prise de conscience, comme le débat tout aussi salutaire sur la compétitivité de l'économie française.
Aujourd'hui, la priorité pour la France, ce n'est pas l'inscription de la laïcité dans la Constitution ou le vote des immigrés ; ce n'est pas de détricoter à grand frais une réforme des retraites salutaire et, in fine, acceptée par les Français. La priorité pour la France, c'est de retrouver une croissance soutenue et durable, qui permette à notre pays de dépasser les chiffres de 1 % à 1,5 % de croissance moyenne constatés sur la dernière décennie – une croissance qui n'a pu être générée que par le soutien constant du moteur de la consommation alimenté par les déficits publics et la dette accumulée.
Aujourd'hui, notre ardente obligation, c'est de redonner de la compétitivité au « site France », qui semble en perte de vitesse dans nombre de secteurs où, pourtant, notre tissu industriel reste performant. J'en veux pour preuve les difficultés de notre industrie automobile, qui recule alors que les constructeurs allemands progressent toujours. J'en veux pour preuve celles que rencontre l'agroalimentaire, un secteur de pointe de notre économie, qui se voit concurrencer en France même par les producteurs allemands.
Il est donc indispensable de stopper la dégradation de notre compétitivité par rapport à notre voisin allemand, mais aussi de prendre conscience que nos efforts risquent d'être confrontés à ceux de nos partenaires européens engagés dans une course à la compétitivité pour sortir de la récession et du marasme économique dans lequel les a plongés la crise de l'euro. L'Italie de M. Monti ne vient-elle pas de supprimer 450 textes législatifs qui constituaient un carcan, une entrave à la compétitivité de ses entreprises ? Il est donc urgent de remettre le made in France en situation d'être concurrentiel sur le marché unique européen, car notre modèle économique et social ne pourra survivre si notre économie n'est plus compétitive.
Bien sûr, la compétitivité du made in France dépendra des coûts de production, ce dont nous aurons l'occasion de débattre lors du collectif budgétaire qui instaurera une TVA-compétitivité pour inverser le cours de cette dégradation mortelle pour l'emploi. Nous n'ignorons pas qu'elle dépend aussi de la perception qualité-coût évoquée par certains d'entre nous, donc de notre capacité d'innovation. Le pari du grand emprunt, si critiqué par nos collègues de gauche, est le levier de l'investissement dans la recherche et l'innovation, condition préalable au redressement industriel.

De même, je crois beaucoup à la politique des filières que Christian Estrosi a initiée dans son mandat ministériel. Au nombre de douze, les comités stratégiques de filière permettent aux acteurs industriels de définir ensemble les enjeux pour leur secteur et les moyens à mettre en oeuvre pour remuscler l'économie de la filière. J'en veux pour preuve la prise de conscience qui s'est opérée pour redonner confiance à la filière « industries et technologies de santé », qui recrée des emplois industriels alors qu'elle en perd dans le marketing. Ce secteur, trop stigmatisé par la crise du Mediator, demeure pourtant un secteur clé pour le futur et doit rester attractif pour tous les acteurs, multinationales et start-up, qui attendent beaucoup d'un approfondissement de cette stratégie de filière. Ainsi, les acteurs économiques de la filière témoignent que le made in France est aussi un moyen essentiel pour l'essor d'un « écosystème » où la croissance des uns vient appuyer le développement des autres, de la start-up au champion mondial.
Cette proposition de résolution s'inscrit dans la prise de conscience que nous devons défendre et promouvoir cette France de l'industrie qui est aujourd'hui, à l'instar du plan pour le général de Gaulle, une ardente obligation. Comme l'a répété récemment le Président de la République, un pays qui laisse filer son industrie ne tardera pas à voir les services suivre l'exode industriel.
Promouvoir le made in France, c'est à la fois un devoir d'information que nous devons aux consommateurs-citoyens, un devoir de transparence s'agissant de l'origine des produits achetés, mais aussi une manière de reconquérir la fierté du savoir-faire industriel et artisanal français. Pourquoi une telle fierté devrait-elle rester l'exclusivité du made in Germany ?
Cette proposition fait donc partie d'un dessein politique global pour redonner à l'industrie le rôle moteur qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Il faudra néanmoins assouplir les rigidités que le modèle économique et social français fait peser sur nos entreprises. Oui, mes chers collègues, le débat sur la compétitivité du site France est bien la priorité des priorités pour notre pays, dont dépendra le retour à une croissance plus forte et durable au service des Français. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, M. Estrosi fait figurer une citation de Virgile en exergue de son rapport : « Heureux qui peut savoir l'origine des choses ». Hélas, il ne suffit pas de convoquer Virgile pour donner de l'authenticité à une démarche, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour faire une bonne politique, il ne suffit pas d'un texte susceptible de recueillir l'adhésion de tous pour gommer, comme l'ont dit M. Brottes et M. Chassaigne, cinq ou dix ans d'échec.
Enfin, monsieur Estrosi, il ne suffit pas de pouvoir se prévaloir d'une bonne réputation en tant qu'ancien ministre de l'industrie pour nous faire oublier que ce projet de résolution est une bien modeste réponse aux préoccupations des Français, aux fortes propositions de François Hollande ou – je suis député des Pyrénées-Atlantiques – aux approximations et slogans de François Bayrou.
Vous souhaitez que le marquage de l'origine des produits intra- ou extra-communautaires soit compatible avec le principe de libre circulation et ne constitue pas une entrave aux échanges. En fait, il s'agit essentiellement d'étendre à l'ensemble des produits le marquage existant déjà pour la plupart des produits alimentaires.

Vous nous rappelez, fort justement, la législation nationale et européenne – les articles 28 et 29 du traité de Rome, la résolution du Parlement européen du 6 juillet 2011 –, et évoquez l'affaire dite « Buy Irish », incontestablement interprétée de façon négative par l'Union européenne, ainsi que les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes.
Vous avez raison pour la logique dont semble être imprégnée l'Union européenne. C'est, d'une part, une lecture romantique du traité de Rome qui exclut ce type de marquage pour les produits intra-communautaires et, d'autre part, une lecture libérale et marxiste qui l'exclut pour les produits extra-communautaires. Jamais, dans l'histoire de nos civilisations, une communauté n'a été aussi perméable que l'Union européenne ; à l'heure actuelle, aucun territoire dans le monde n'est aussi accessible qu'elle aux produits étrangers.
Des tentatives multiples ont été faites, y compris dans l'espace européen, pour détourner les choses. Il suffit de voir les publicités, notamment des voitures allemandes, pour comprendre qu'un certain nombre d'acteurs de la vie économique se sont engagés dans un processus de dénaturation des principes qui, jusqu'à présent, régissaient les produits européens. De même, les exceptions et les dérogations se sont multipliées, donnant lieu à de multiples interprétations, donc à des contentieux. Il n'est pas inutile de mettre un peu d'ordre dans tout cela et, sur ce point, nous pouvons vous rejoindre.
Cependant, votre proposition de résolution demande à être travaillée davantage. Vous évoquez l'interpénétration des industries dans la constitution d'un produit et avez cité, à ce propos, l'exemple de Renault, qui assemble 23 % de ses véhicules en France. L'exemple de la porcelaine de Limoges, quelque peu contesté par notre collègue André Chassaigne, est somme toute caricatural. Comment distinguer un produit français, quand il fait appel à des pièces et des sous-traitants multiples et étrangers ? Vous évoquez la législation européenne, monsieur Estrosi. Or cette législation est contestée – et souvent détournée – par les acteurs économiques outre-Atlantique, ce qui donne lieu, là aussi, à une multiplication des contentieux. Comme on le voit, il y a matière à travailler pour faire progresser la réflexion sur le fond même de votre résolution.
Cette proposition de résolution peut se concevoir comme l'un des éléments de la « seconde chance » de la politique menée par M. Sarkozy, par le biais d'une justification de la forte désindustrialisation à laquelle nous avons assisté au cours des cinq dernières années. Le commerce extérieur s'est soldé par 8 milliards d'euros d'excédent en 2002, 14 milliards d'euros de déficit en 2007 et 75 milliards d'euros de déficit fin 2011, alors que – je le rappelle, même si l'évocation de ce chiffre nous fait tous souffrir – la balance commerciale de l'Allemagne est excédentaire de 150 milliards d'euros.
Pour ce qui est de l'emploi industriel, nous avons perdu 750 000 emplois depuis 2002 – 350 000 depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en 2007.

Par ailleurs, 900 usines ont été fermées en trois ans, dont 400 en 2009 et 200 en 2011. La baisse de l'attractivité française se mesure aussi par le montant des investissements directs étrangers en France, qui ont baissé de 12 % en deux ans.

C'est un fait, la culture industrielle a perdu pied dans notre pays. La formation est en baisse alors que, chacun le sait, il y a fréquemment inadéquation entre l'offre et la demande en matière d'emploi. Aujourd'hui, des secteurs entiers de formation aux métiers de l'industrie ne comptent pratiquement plus aucun élève ! L'acceptabilité de l'usine, de l'entreprise et du risque constitue, aujourd'hui, une donnée qu'il faut prendre en compte. Vous avez pourtant supprimé la taxe professionnelle alors que nombre d'industriels – je pense à ceux de ma région, notamment dans le secteur de la chimie – estiment que l'un des éléments de l'acceptabilité résidait dans la contrepartie fiscale territorialisée.
Tel est le bilan de cinq années de sarkozysme en matière industrielle, le bilan d'une politique qui a échoué.
Je conclurai en évoquant un dossier dont ni vous, monsieur Estrosi, ni vous, monsieur le ministre, n'avez eu à connaître. Je veux parler de l'usine Celanese de Pardies, dans les Pyrénées-Atlantiques, la seule usine d'Europe à fabriquer de l'acide acétique. Il y a cinq ans, cette usine qui gagnait beaucoup d'argent a été vendue à un groupe américain.

Ce groupe américain a, durant cinq ans, développé l'outil de production afin de gagner des parts de marché. Pris comme référence dans le monde entier, l'établissement a distribué des bénéfices d'un montant significatif à ses salariés, quelques mois seulement avant sa fermeture par le groupe propriétaire – qui s'est empressé d'ouvrir de nouvelles unités en Chine et en Arabie Saoudite. À l'époque, M. Wauquiez s'était rendu sur le site de Pradies pour tenir des propos rassurants, comme il le fait actuellement sur le site de l'usine Lejaby : selon lui, le Gouvernement devait tout arranger. Mme Buffet avait même reçu une lettre de Nicolas Sarkozy, qu'elle m'a communiquée et dont je vous lis un extrait : « Je suis très attentif au devenir du site, dont je connais l'importance pour le tissu industriel et l'emploi. Il me paraît essentiel de convaincre la direction américaine du groupe Celanese de travailler sur une solution de cession plutôt que de fermeture de ce site. J'ai demandé à Christine Lagarde et à Luc Chatel d'agir en ce sens. »
Trois ans plus tard, nous avons pour spectacle une usine démolie, sans que l'État ait fait le moindre geste pour la sauver. Le repreneur que nous avions trouvé a été exclu des discussions avec Bercy et le Gouvernement, qui ne se sont finalement pas opposés à la volonté du groupe américain Celanese de mettre fin à la production d'acide acétique en France. La convention de conversion, concernant 354 salariés, a mobilisé un million d'euros – dont 300 000 ont été récupérés par le groupe Altedia, chargé de mettre en oeuvre ladite convention.

Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des centaines de salariés à la recherche d'un emploi. Les sols sont gravement pollués – à tel point qu'il existe, à proximité de l'usine, une zone de plusieurs dizaines d'hectares surnommée « la zone à cancer ». Depuis trois ans, rien n'a été fait par l'État sur ce territoire, malgré la destruction de 354 emplois directs et 400 emplois indirects. J'appelle votre attention sur ce dossier, monsieur le ministre, afin que l'État s'engage, durant les quelques mois restant avant la fin de la législature, à examiner tout ce qui peut être fait, au moins en matière de dépollution des sols.

François Brottes a évoqué les propositions de François Hollande concernant les banques, le ralentissement de la croissance du crédit et les problèmes de trésorerie induits par le resserrement des conditions d'octroi du crédit en fin d'année 2011. Ces difficultés nous placent dans une situation particulière ; des mesures urgentes doivent être prises et François Hollande s'est engagé à ce sujet.
Au-delà de ces questions, ce qui est en jeu, c'est la mise en place d'une politique décentralisée en matière industrielle. Il ne faut pas non plus, monsieur le ministre, se précipiter pour annoncer les nouvelles, comme l'a fait l'Élysée au mois de décembre, dans Le Figaro, à propos de la création de 2 500 emplois grâce à l'installation d'une usine de la société Toray dans ma circonscription. Or l'annonce officielle interviendra – du moins je l'espère – dans quelques jours, avec une différence d'au moins un zéro par rapport à ce qui a été publié : sans doute était-ce une faute de frappe… De plus, l'industriel n'avait même pas été prévenu de la diffusion de la nouvelle.
À l'approche de l'échéance présidentielle, vous créez un tourbillon médiatique pour essayer de justifier dix années de passivité et, pour parler plus précisément des cinq dernières années, d'échec. La proposition de résolution présentée par M. Estrosi relève sans doute, je le répète, d'une démarche individuelle tout à fait sincère, mais elle participe de ce brouillard dont le Gouvernement veut entourer le sujet pour tenter de minimiser ses responsabilités.
Puisque vous avez cité Virgile, monsieur Estrosi, je m'y référerai à mon tour : « Il est trop tard pour délibérer quand l'ennemi est aux portes. » Nous attendrons donc le changement pour agir.

Monsieur Habib, quand l'ennemi est aux portes, on se bat et on ne se rend jamais !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution dont nous débattons aujourd'hui, qui tend à développer le « fabriqué en France » et à déterminer la notion d'origine des produits ne relève pas en soi d'une leçon de géographie, mais est bien au coeur de l'avenir industriel de notre pays.
Osons le dire avec force : ce qui est en jeu, c'est l'impérieuse nécessité du retour d'une politique industrielle en France et en Europe. Il y a quelques années, j'avais demandé au commissaire européen chargé de l'industrie, M. Verheugen, de nationalité allemande, si le concept de politique industrielle était un gros mot pour la Commission. Après un moment d'hésitation, il me confia que les choses progressaient. Ah bon ?
Force est de constater que cette notion – et surtout son application – est toujours en devenir et que, pour Bruxelles, elle se limite à la nécessité d'éliminer le plus possible les obstacles au développement des entreprises. C'est la fameuse règle du jeu équitable, soit, en anglais – puisque, paraît-il, on parle cette langue même à cette tribune –, le level playing field, cher aux ultralibéraux.
Or nos concurrents hors d'Europe pratiquent sans vergogne une politique industrielle active. Aux États-Unis, en Chine et en Inde, le contrôle des investissements est de règle. À propos de ce que vous disiez, monsieur Habib, je vous rappelle que, depuis l'adoption d'un certain nombre de traités européens, que vous avez favorisés, nous ne disposons plus d'instruments similaires. De même, au Canada, en Chine et même parfois aux États-Unis, il est obligatoire pour les entreprises de répondre de manière conjointe aux appels d'offres. Partout, enfin, se rencontrent des manipulations et du dumping en tout genre : économique, social et monétaire.
En Europe même, certains de nos partenaires jouent la carte nationale. C'est ainsi que l'Allemagne dispose d'un concept qui est stratégique dans toute sa politique industrielle : le Standort Deustschland, c'est-à-dire un accord tacite entre le gouvernement, le patronat, les syndicats, le monde universitaire et les chercheurs pour privilégier le site de production Allemagne, de façon à garder les centres de décision et les laboratoires. On délocalise le boulon de 16 en Tchéquie, mais on garde la production à haute valeur ajoutée en Allemagne !
Cessons donc d'être naïfs et donnons-nous les moyens de notre politique : finis coronat opus, dirais-je, puisque nous sommes dans les citations. Comme vous le savez, c'est du saint Augustin. (Sourires.) La fin justifie les moyens et, en l'occurrence, la fin, ce sont nos emplois, notre système social et, en définitive, notre indépendance et notre souveraineté.
Dans mon rapport de juin 2011 sur le caractère impératif de la politique industrielle, dont je vous recommande la lecture – comme vous le savez, monsieur le ministre, on n'est jamais mieux servi et défendu que par soi-même –, j'ai proposé une vingtaine de mesures. Je souhaite insister ici sur celles qui me paraissent primordiales.
Tout d'abord, au niveau national, il faut retrouver un véritable ministre de l'industrie qui ne soit pas inféodé aux comptables de Bercy. Il lui appartient d'être l'homme de l'industrie, de recréer une véritable prospective nationale pour déterminer les secteurs d'avenir, grâce à un conseil stratégique de l'avenir industriel. Il s'agit, en quelque sorte, de retrouver la prospective et le plan,…

…sans pour autant, je vous l'accorde, retomber dans le Gosplan. Il faut que cette prospective unisse l'ensemble des acteurs.
Au niveau européen, ensuite, on n'échappera pas à une modification des traités mettant sur un pied d'égalité la politique industrielle et le droit de la concurrence. En effet, la politique industrielle est dramatiquement absente des traités. Elle figure seulement dans l'un d'entre eux, à l'article 173 du titre XVII, et encore, sous l'angle du laisser-faire, c'est-à-dire l'environnement favorable aux entreprises, ce qui est totalement insuffisant face aux aides directes de nos concurrents.
À cet égard, il n'est pas admissible que la Direction générale de la concurrence fasse la pluie et le beau temps. Ses décisions doivent pouvoir faire l'objet d'un appel devant le Conseil des ministres, et ce de manière rapide, pour réformer ses décisions, car l'économie ne peut pas attendre la décision du tribunal, voire de la Cour de justice, qui prend plus de deux ans, comme on l'a vu dans l'affaire Schneider-Legrand.
Cette nouvelle politique industrielle doit prendre en compte des aides directes pour la recherche, le développement et la restructuration des entreprises. De la même manière, elle doit développer des champions nationaux et européens. Le marché de référence, aujourd'hui, est non pas l'isthme étroit de l'Europe, mais la planète tout entière.
Je terminerai en évoquant la question monétaire, qui est au centre de la crise actuelle. La surévaluation de l'euro nous a coûté très cher, car si nos exportations sont passées de 5,4 % à 3,1 % des exportations mondiales, ce n'est pas simplement, monsieur le ministre, parce que nos PME n'ont pas la taille adéquate : elles avaient la même taille en l'an 2000 ! Que l'on ne vienne donc pas nous dire que ce n'est pas dû à la cherté de l'euro. Je rappelle que M. Gallois lui-même dit que, lorsque l'euro prend 10 centimes par rapport au dollar, il perd 950 millions de résultat net. C'est ainsi que l'euro a étranglé l'économie française : notre industrie est beaucoup plus sensible à cette cherté et au taux externe que ne l'est l'industrie allemande.
Un dernier point…

…pour conclure, monsieur le président. Je voudrais souligner la nécessité de la monétisation de la dette, afin d'aider les États pour l'investissement.
C'est au prix de ces réformes nécessaires que la France et l'Europe redeviendront des puissances industrielles et que les salariés resteront des salariés consommateurs au lieu de devenir des chômeurs de moins en moins consommateurs ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux apporter moi aussi mon soutien à la proposition de résolution de Christian Estrosi, qui vise à interpeller l'Union européenne pour lui demander d'avancer plus vite dans sa politique de marquage des produits.
L'Europe a déjà fait quelques progrès, puisqu'elle a rendu obligatoire le marquage de certains produits alimentaires – les fruits et légumes –, des médicaments et des huiles d'olive. Mais elle s'est arrêtée au milieu du chemin. Je crois, comme Christian Estrosi, qu'il faut que nous puissions plaider ensemble, de la façon la plus consensuelle possible, pour que cette politique de marquage avance. C'est un gage de transparence et de traçabilité ; c'est une information qu'exige le consommateur et qui peut lui permettre d'arbitrer librement en fonction, non seulement de la marque et du prix du produit, mais aussi de son origine. Derrière l'origine se cachent beaucoup d'informations sociales, sanitaires, économiques et environnementales, qui doivent permettre au consommateur de jouer pleinement son rôle dans l'économie.
Je regrette pour ma part que l'opposition ait voulu transformer cette discussion en un débat pré-présidentiel. La perte des emplois industriels ne frappe pas seulement la France et cette question est lancinante dans notre pays depuis bien longtemps. Elle mériterait, à supposer que cela fût possible, de dégager des lignes de convergence, de créer un consensus. Au lieu de cela, j'ai entendu des discours incohérents : vous plaidez d'un côté en faveur de la compétitivité de nos entreprises et, de l'autre, vous proposez, par exemple, de renchérir le prix de l'électricité en supprimant l'atout que constitue notre industrie nucléaire, ou encore d'assommer d'impôts les entrepreneurs. Il y a là des incohérences auxquelles on peut donner cours sur les tréteaux de la campagne présidentielle, mais qui ne sont pas à la hauteur de ces enjeux qui devraient nous rassembler, car ce sont des enjeux industriels majeurs pour notre pays et pour l'Europe.
Vous le savez, le Président de la République m'a confié, il y a maintenant plus de deux ans, une mission à ce sujet – comme quoi celui-ci n'est pas apparu au moment des échéances électorales ! Le Gouvernement et le chef de l'État y travaillent depuis bien longtemps, pour mettre en oeuvre des dispositifs qui, s'additionnant les uns aux autres, forment une politique ambitieuse en ce domaine.
Cette mission a abouti à un rapport qui va dans le même sens que ce qui figure dans la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui et que je ne peux donc qu'approuver. Elle a aussi été à l'origine de la création par des entreprises du label « origine France garantie », qui vise à travailler sur ce qui constitue la difficulté du sujet – je l'ai entendu dans la bouche de Christian Estrosi comme chez de nombreux orateurs –, c'est-à-dire la détermination de critères pour définir l'origine de produits qui, compte tenu de l'éclatement des modes de production, présentent un caractère multiple. D'ici quelques semaines, nous aurons un cadre de référence qui pourra servir, y compris aux autorités européennes, à définir une nouvelle législation, plus exigeante et plus technique, pour établir ce qu'est l'origine d'un produit et faire en sorte qu'elle soit fondée sur des études et des moyens techniques incontestables.
Ce label doit permettre, de façon totalement volontaire et donc en parfaite cohérence avec la législation européenne, aux entreprises qui le souhaitent de s'en emparer pour afficher les couleurs de notre pays. C'est, me semble-t-il, un service qu'on peut leur rendre. D'ailleurs, ce label est très attendu, puisque plus de 500 entreprises sont inscrites sur la liste d'attente de l'organisme certificateur. C'est dire si le sujet était d'importance !
Mais il ne faut pas, évidemment, réduire la politique industrielle et le « fabriqué en France » à un simple label d'information du consommateur, même si celui-ci est important. On ne peut que se réjouir des décisions prises par le Gouvernement suite aux états généraux de l'industrie organisés par Christian Estrosi, de même que de la politique qui est mise en oeuvre précisément pour travailler dans la durée et ouvrir une vraie perspective industrielle à notre pays.
Cela passe notamment par une diminution du coût du travail. J'ai entendu certains se plaindre du départ des entreprises en raison du coût du travail. Ceux-là feraient bien d'approuver les mesures visant à diminuer ce coût et les dispositions prises en faveur de la compétitivité de nos entreprises, pour faire en sorte que le « fabriqué en France » soit, non pas un slogan de campagne électorale, mais une politique inscrite dans la durée et, si possible – permettez-moi de plaider dans ce sens en conclusion –, consensuelle. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)

La discussion générale est close.
La parole est à M. Éric Besson, ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, la défense et la promotion du « fabriqué en France » sont parmi les priorités du Gouvernement. Le Président de la République l'a encore rappelé lors de son déplacement en Haute-Savoie, en décembre, chez le fabricant de skis Rossignol, qui a récemment rapatrié toute une gamme de produits de l'Asie vers la France.
Je veux remercier mon prédécesseur, Christian Estrosi, auteur de cette proposition de résolution, de nous permettre de débattre aujourd'hui du « fabriqué en France ». Je salue la cohérence de son action au bénéfice de l'industrie française : comme cela a été rappelé à juste titre, il a été à l'initiative des états généraux de l'industrie, de la conférence nationale de l'industrie, des comités stratégiques de filière ou encore des aides à la réindustrialisation. En suscitant ce débat, il témoigne à nouveau de son engagement permanent pour l'industrie française.
Ce débat a permis à plusieurs orateurs de s'exprimer, notamment à François Brottes. Je le sais compétent et non sectaire. Donc, à trois mois de l'élection présidentielle, je lui pardonnerai et nous lui pardonnerons aisément d'avoir laissé au vestiaire ces grandes qualités pour revêtir aujourd'hui, exceptionnellement, son costume caricatural.
Il a fait semblant d'oublier tout ce qui a été fait pour l'industrie, et longue est la liste des contrevérités qu'il a dites.
Il a parfois fait des propositions qui correspondent très exactement à des réalisations concrètes, actuelles du Gouvernement. En définitive, peut-être faut-il y voir davantage un hommage que des propositions.
Il a été silencieux sur certains sujets, mais son débit exceptionnellement rapide de la fin lui a cependant permis de prononcer les mots – je crois l'avoir capté, mais c'était tellement bref : « politique énergétique européenne ».
Le Journal officiel dira si je me suis trompé, monsieur Brottes, mais je comprends que le propos ait été aussi allusif, car mieux vaut ne pas parler de la politique énergétique française que vous et vos amis suggérez. En effet, comme le disait à l'instant Yves Jégo, il est vrai que passer un accord avec les écologistes aux termes duquel vous fermeriez en treize ans vingt-quatre réacteurs nucléaires sur cinquante-huit…
…et démantèleriez la filière du retraitement, ne peut qu'aboutir à une augmentation très forte, que nous allons essayer de chiffrer très précisément dans les jours à venir, du prix de l'électricité payé par nos industriels, et notamment par les électro-intensifs. Je comprends donc aisément que vous ayez choisi de ne consacrer que deux mots, rapidement jetés, à ce projet, en y ajoutant l'adjectif « européen » !
Je veux aussi dire à François Brottes et David Habib qu'en matière de politique industrielle ils ont sans doute oublié la suppression de la taxe professionnelle, qui a conduit à 2 milliards de gain pour l'industrie chaque année ; le triplement du crédit d'impôt recherche, qui représente plus de 4 milliards d'euros par an ; les pôles de compétitivité, qui ont permis de financer plus de 6 milliards d'euros de projets publics et privés de R&D.
Sans oublier la création du Fonds stratégique d'investissement, qui a investi plus de 4 milliards depuis 2008, et les 35 milliards des investissements d'avenir, dont 17 milliards bénéficient à l'industrie et à la recherche.
Je citerai encore la création de la Conférence nationale sur l'industrie et les douze comités stratégiques de filière ; les aides à la réindustrialisation ;…
…la Banque de l'industrie, qui existe déjà dans les faits et qui sera consacrée prochainement par le Président de la République.
Pour toutes ces initiatives, pour tous ces milliards dédiés à l'industrie, sans doute avons-nous eu votre soutien moral, mais force est de constater que nous n'avons pas eu vos votes !
Je remercie Pascal Brindeau de son soutien et de ses propos très intéressants. Il a pointé, à juste raison, le problème de la multiplication des labels, officiels ou privés, sur le « produire en France ». Il faudra en effet veiller à apporter davantage de clarté pour éviter chez le consommateur toute confusion entre les différents labels. Yves Jégo l'avait d'ailleurs souligné dans son rapport.
André Chassaigne a commencé par une très jolie citation d'Alexandre Vialatte, cher à son coeur et à sa région auvergnate.
C'est aussi un clin d'oeil personnel, parce qu'il sait qu'Alexandre Vialatte était mon parrain. Mais en dépit de son érudition et de son humour, il se trompait lui aussi de temps en temps. Une de ses chroniques les plus célèbres s'intitule L'éléphant est irréfutable. Je suis bien placé pour savoir que l'éléphant n'est pas irréfutable. (Rires.)
André Chassaigne a également cité Bossuet mais ne nous a pas dit ce que pense Dieu de ceux qui chérissent les erreurs de diagnostic,…
…parce que la mondialisation est une donnée, pas un dogme. Vous connaissez le mot de Tony Blair qui dit qu'elle est « un risque pour les peuples immobiles et une opportunité pour les peuples en mouvement ».
À vous écouter, monsieur Chassaigne, on se demandait parfois si vous parliez bien de notre pays, c'est-à-dire du deuxième exportateur européen et du cinquième exportateur mondial.
Vous avez parlé des restructurations. Je n'en disconviens pas, mon équipe et moi-même passons l'essentiel de notre temps en ce moment à travailler sur des dossiers de restructuration. Mais en un an, 600 usines se sont ouvertes ou ont créé de nouveaux emplois : 600 créations ou extensions d'usine. Dans le même temps, c'est vrai, parce que la crise est là, parce qu'il y a eu cette crise financière qui a engendré une crise économique, des entreprises restructurent ou perdent des emplois. Mais soyez beau joueur, et reconnaissez qu'à côté des difficultés, grâce à l'action de l'État et du Gouvernement, des emplois sont aussi sauvés tous les jours !
Vous citiez Lejaby : une solution a été trouvée pour l'ensemble des sites du groupe et des salariés.
Je pense également au dossier Mory, le transporteur routier, dans lequel, grâce à l'action du ministère de l'industrie 5 000 emplois ont été sauvés en 2011.
Je pense au CIRI, qui effectue un travail extraordinaire et a permis de sauvegarder 100 000 emplois cette année.
Je pense au travail de la médiation du crédit, de la médiation de la sous-traitance. On peut estimer que ce sont à peu près 700 000 emplois qui ont été sauvés.
Yves Bur a mis, à juste titre, l'accent sur ce que doit être l'objectif fondamental de ce « produire en France » : le gain de parts de marché. Comme d'autres l'ont dit, le « produire en France » n'est pas une mode. C'est une véritable stratégie industrielle qui s'inscrit dans la stratégie plus large de compétitivité que nous menons depuis 2007, et que le Président de la République a rappelée fortement dimanche soir en indiquant l'orientation qu'il entendait lui donner.
David Habib a dressé un portrait quelque peu singulier de la situation, notamment quand il a évoqué la perméabilité de l'Europe et de la France aux produits étrangers. Je ne veux pas dire que tout est faux, mais pour ne pas biaiser cette réalité, il faut malgré tout rappeler deux données. D'une part, les deux tiers des échanges de la France se font à l'intérieur de l'Union européenne et 80 % à l'intérieur des pays de l'OCDE. D'autre part, à l'égard des pays émergents, même si le grand public n'en a pas conscience, notre solde en matière industrielle reste positif : nous ne perdons pas d'argent dans nos échanges industriels avec les pays émergents.
Vous avez souligné, monsieur Habib, que nous faisions souvent la comparaison avec l'Allemagne. C'est exact, mais le « produire en France » vise justement à donner une image de marque renforcée aux produits français, de même que les produits allemands bénéficient d'une image de fiabilité et de robustesse, qualités qui leur sont généralement prêtées.
L'image de l'industrie, vous avez raison, doit être rehaussée. C'est à cette fin que le Gouvernement et mon prédécesseur avaient imaginé la Semaine de l'industrie : 1 500 événements l'année dernière dans toute la France et 5 000 participants. Nous allons réitérer l'exercice. Vous hochez la tête, monsieur Habib, mais à voir le nombre d'étudiants et de lycéens qui sont venus se renseigner, qui sont entrés dans des entreprises et ont compris ce que l'industrie pouvait leur offrir comme métiers, alors qu'elle véhicule souvent, malheureusement, une image sale ou dégradée, il est certain que c'était une initiative très importante et qu'il fallait lancer.
Sur le dossier Celanese, je vous dis sincèrement que je ne suis pas capable de vous répondre à l'instant. J'ai noté vos préoccupations concernant les risques environnementaux sur le site. Avec l'aide de mon équipe, je vous apporterai très rapidement des éléments de réponse et, si des actions doivent être menées, elles le seront.
Jacques Myard qui parle au moins trois langues, comme nous avons pu le constater à la tribune…
…a souligné à juste titre les difficultés que nous rencontrons parfois avec les règles communautaires. La politique industrielle a, en effet, été longtemps reléguée derrière la politique dite « de libre concurrence ». Mais vous avez raison de dire, monsieur Myard, que le concept de « politique industrielle européenne » n'est plus tabou, que le mot n'est plus un gros mot.
Cependant, elle progresse encore trop lentement, même si nous avons maintenant des alliés en place. Le vice-président de la Commission européenne en charge des questions industrielles, Antonio Tajani, est un allié et Michel Barnier, dans son domaine de compétence, réalise un travail remarquable. Mais il est vrai qu'il nous faut convaincre.
Il reste que, sur tous les sujets que vous avez abordés – et je suis prêt, à titre personnel, à partager plusieurs de vos analyses –, la France est un fer de lance. Nous n'arrivons pas toujours à entraîner, mais nous sommes toujours à la pointe. C'est vrai également en matière de réciprocité. C'est le Président de la République qui, lors de chaque Conseil européen consacré à ces questions, parle de ce que doit être la réciprocité, que nous devons imposer non pas parce que nous craignons la concurrence, mais parce que nous voulons qu'elle soit juste et non faussée.
Pour en revenir à notre débat, je considère que le « produire en France » est en effet un sujet important.
Les entreprises prennent davantage conscience, jour après jour, de l'intérêt de produire en France, où la main d'oeuvre est qualifiée et compétente, où les infrastructures sont bonnes, où la demande de produits de qualité est forte. Les chiffres en témoignent, que ce soient ceux des investissements industriels – Christian Estrosi le soulignait à juste titre – avec le dispositif des aides à la réindustrialisation, grâce auquel vingt projets ont été soutenus depuis un an, représentant 344 millions d'euros d'investissements et 1 525 emplois créés à terme. Ou que ce soient tout simplement les chiffres de créations d'usines : aujourd'hui, en France, une usine se crée ou est étendue chaque jour.
Je prends l'exemple de Peugeot, dont on a parfois critiqué telle ou telle action, qui a investi 150 millions d'euros sur le site de Poissy et recruté 700 salariés en CDI pour la production de la 208, ou encore celui de Toyota, qui a investi 125 millions d'euros dans la production de la Yaris 3 à Valenciennes.
La bataille pour le « produire en France » se joue aussi, vous l'avez dit les uns et les autres, au niveau européen : d'une part, avec le brevet européen unique, pour lequel nous nous battons afin de protéger, mieux et à moindre coût, nos innovations dites « made in France » ; d'autre part, en exigeant la réciprocité dans les échanges commerciaux. Nos industriels doivent pouvoir concourir aux marchés publics des pays tiers. À défaut, les entreprises de ces mêmes pays tiers ne devraient pas pouvoir concourir aux marchés publics européens. C'est l'enjeu de la nouvelle législation que j'évoquais il y a un instant, que Michel Barnier et le commissaire européen au commerce présenteront le 16 mars prochain pour doter enfin l'Europe d'un vrai mécanisme de réciprocité.
On avance, monsieur Myard. Peut-être trop lentement, mais on avance.
Du côté des consommateurs, de nombreux sondages montrent que les Français considèrent qu'il est important d'acheter français. La proposition de résolution souligne ainsi, selon une récente étude du CREDOC, que 64 % des Français sont prêts à acheter un produit fabriqué en France, alors même que des produits similaires importés, moins chers, sont disponibles. Cette proportion était de 44 % en 2005. C'est la tendance qu'il faut noter. Cette étude du CREDOC montre que même les ménages les plus modestes sont touchés par cette tendance.
Il existe donc une vraie demande, partagée, tant du côté des entreprises que du côté des consommateurs, pour le « produire en France ».
Dans ce cadre, le Gouvernement n'a pas attendu pour agir. Il mène une action résolue pour promouvoir le « fabriqué en France ».
Depuis la remise du rapport d'Yves Jégo au Président de la République, le Gouvernement s'est employé sans relâche à mettre en oeuvre ses recommandations. Plusieurs mesures ont d'ores et déjà été prises, ou sont sur le point de l'être.
Au plan national, comme le Gouvernement l'avait annoncé, une concertation avec les industriels a été engagée sur le « fabriqué en France », dans le cadre du Comité stratégique de la filière des industries des biens de consommation, qui sont les entreprises les plus directement concernées. Cette concertation a vocation à être élargie à d'autres secteurs, comme les industries de la mode et du luxe, les industries agroalimentaires ou les industries de santé.
Le label « origine France garantie », lancé par Yves Jégo dans le cadre de son association Pro France, rencontre un succès significatif. Au 31 décembre 2011, environ quarante produits bénéficiaient de ce label, dont la notoriété est croissante, et nombre d'entreprises sont en cours de labellisation de leurs produits. Je me félicite, et je félicite surtout son auteur, du succès rencontré par cette initiative, qui montre l'intérêt des entreprises mais aussi celui des consommateurs pour une plus grande transparence et une meilleure information. Mes services suivent avec attention le développement de ce label qui devrait entrer dans une phase de déploiement à grande échelle à partir de 2012.
La recommandation issue du rapport d'Yves Jégo concernant l'extension des indications géographiques aux produits industriels, pour identifier de manière efficace les savoir-faire de nos régions, comme la porcelaine de Limoges, a été prise en compte dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, actuellement en discussion devant le Parlement. Là aussi, l'initiative est d'ores et déjà lancée.
La Commission européenne devrait à son tour proposer un texte qui permettra d'étendre cette protection à l'ensemble du territoire européen, après une étude d'impact qui devrait se dérouler en 2013.
Je rappelle également l'initiative de mon collègue Frédéric Lefebvre, l'opération « France savoir-faire », dont le but est de faire connaître aux entreprises industrielles l'ensemble des mesures qui leur permettent de distinguer leurs produits aux yeux des consommateurs.
Enfin, la carte d'identité des produits, prônée par Yves Jégo dans son rapport, devrait connaître de nouveaux développements très prochainement. Cette initiative permettra de développer la traçabilité des produits, de renforcer leur sécurité et de mieux informer sur l'ensemble de leurs caractéristiques, y compris leur lieu de fabrication.
L'objectif est simple : inciter les consommateurs à prendre en compte d'autres critères que le prix – le prix est bien sûr un critère important mais ce n'est pas le seul. Le Président de la République a d'ailleurs demandé au Conseil national de la consommation de se saisir du sujet, afin d'élaborer des recommandations sur la mise en oeuvre concrète de cette carte d'identité. Le CNC remettra ses conclusions à la fin du premier trimestre.
Sans attendre, le ministère de l'industrie lancera, avant la fin du mois de février, un appel à projets sur la carte d'identité des produits, afin d'inciter les entreprises, fabricants et distributeurs, et plus particulièrement les PME, à collaborer dans le sens d'une plus grande transparence aux yeux des consommateurs.
Vous le voyez, beaucoup a d'ores et déjà été fait !
Concernant cette proposition de résolution, je crois qu'elle propose des dispositifs parfois difficiles à appliquer, mais qu'elle ouvre aussi des pistes de réflexion très intéressantes.
Le Gouvernement est déterminé à aller plus loin encore pour le « produire en France », notamment en mettant en place des initiatives au niveau européen. En cela, la proposition de résolution de Christian Estrosi est une première étape importante vers une évolution des principes communautaires en matière de marquage de l'origine.
Vous le savez, le débat sur le marquage d'origine des produits rencontre des difficultés. La jurisprudence communautaire considère que ce marquage à l'intérieur de l'Europe serait contraire au principe de libre circulation des produits dans l'Union européenne. Cette jurisprudence empêche systématiquement les initiatives nationales, nombreuses – nous ne sommes pas les seuls –, qui pourraient être prises sur ce point.
De nombreux pays ont tenté ces dernières années de mettre en place des mesures nationales, montrant que la réflexion menée par Christian Estrosi est partagée en Europe, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en Grèce, pour ne citer que ces trois exemples.
De son côté, le Parlement européen a voté, en 2010, une résolution demandant à la Commission de prendre toutes les initiatives nécessaires à ce sujet. La proposition de résolution qui est aujourd'hui soumise au débat va donc très clairement dans le bon sens.
Le premier point de ce texte, qui vise à rappeler que l'indication du pays de production d'origine des produits n'est pas synonyme de repli sur soi et de refus des évolutions du monde, est fondamental.
Toute initiative nationale en ce domaine est aujourd'hui vécue par certains au niveau européen comme une forme de protectionnisme, incompatible avec le principe fondateur de l'Europe de libre circulation des produits. Il faut, vous l'avez dit les uns et les autres, combattre cette idée. Le marquage d'origine des produits est surtout synonyme d'une meilleure information et d'une plus grande transparence vis-à-vis des consommateurs, qui en sont demandeurs. Aujourd'hui, au nom du principe de libre circulation des produits, cette transparence leur est de fait refusée. Cela n'est pas acceptable, et le Gouvernement est donc pleinement favorable au premier point de votre résolution.
Le deuxième point consiste à demander à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil de l'Union, de reconnaître que le marquage de l'origine ne constitue pas une entrave aux échanges. Il s'agit en particulier de faire évoluer la position actuelle de la Commission européenne qui, en dehors des produits agroalimentaires, s'oppose systématiquement à tous les dispositifs nationaux de marquage d'origine, y compris volontaires. Le Gouvernement est également favorable à cette seconde proposition, même si je veux attirer votre attention sur l'ampleur de la tâche. Vous le savez d'ailleurs. Christian Estrosi par exemple, qui m'a précédé dans ces fonctions, sait combien changer les esprits au sein des institutions européennes relève d'une évolution culturelle qui prendra du temps.
Nous nous y employons, je le disais à l'instant, pour la réciprocité, pour la politique industrielle européenne, pour les pôles de compétitivité, avec, encore une fois, l'appui du commissaire Tajani. Mais, parfois, des arguments d'ordre juridique, d'aucuns diraient des arguties, nous sont opposés. Ainsi, selon certains, c'est le traité de l'Union européenne lui-même qu'il faudrait modifier pour y inscrire ce principe d'information et de transparence vis-à-vis du consommateur et faire du marquage d'origine un atout pour nos produits plutôt qu'un symbole de protectionnisme.
Néanmoins, les difficultés que rencontrera la mise en oeuvre concrète de cette résolution ne doivent pas nous empêcher d'exprimer une volonté politique, et le Gouvernement, j'y insiste, est favorable également au deuxième point de la résolution.
Le troisième point a pour objet de demander à la Commission européenne d'adopter un règlement rendant obligatoire pour l'ensemble des produits, qu'ils soient intracommunautaires ou extracommunautaires, le marquage de l'origine.
Depuis le début des discussions au niveau européen, la France est favorable à l'obligation du marquage de l'origine, à condition bien sûr que ce marquage soit pragmatique, facilement applicable et ait un coût raisonnable pour les entreprises et les autorités de contrôle.
Cela étant, rendre obligatoire le marquage d'origine est une question qui divise fortement les acteurs. Elle divise les États-membres de l'Union, qui n'ont jamais pu trouver de consensus à ce sujet. Elle divise également, avouons-le, les entreprises : plusieurs fédérations professionnelles sont opposées à cette obligation.
Pour sortir de ces divisions, toutes les initiatives nouvelles sont à considérer, et la présidence polonaise sortante de l'Union a elle-même écrit à la Commission pour indiquer que le seul moyen de débloquer le dialogue au sein du Conseil était d'apporter des éléments nouveaux.
La proposition de Christian Estrosi, qui s'inspire elle-même de la recommandation d'Yves Jégo visant à imposer le marquage à tous les produits mis sur le marché au lieu des seuls produits importés, est une manière intéressante et constructive de relancer le débat.
Mais il faut être conscient que cette résolution, qui concerne tous les produits, alimentaires et non-alimentaires, intracommunautaires et extracommunautaires, sera sans doute jugée par un certain nombre de nos partenaires encore trop ambitieuse pour recueillir un consensus. Une démarche similaire, chacun s'en souvient, avait déjà échoué au niveau européen en 2003, ce qui avait conduit le projet de règlement à évoluer vers un marquage des seuls produits importés.
Une approche progressive, fondée sur une démarche volontaire, et limitée à une liste de produits bien définie et évolutive, aurait sans doute, aux yeux de certains experts qui connaissent bien les arcanes de Bruxelles, plus de chances de succès. Vous le voyez, nous partageons l'objectif, tout en nous interrogeant sur l'approche qui aurait le plus de chances d'être couronnée de succès.
Le quatrième point de ce texte vise à inciter les institutions européennes à réviser la notion d'origine des produits en privilégiant la logique de production industrielle et de transparence vis-à-vis des consommateurs.
Le Gouvernement partage votre souci de privilégier la notion de production au sein de l'Union européenne. Trop longtemps, l'Union n'a tenu compte que de la protection du consommateur et d'une conception orthodoxe, si je puis dire, de la concurrence. Nous sommes d'accord avec vous, il faudra veiller, dans l'ensemble des négociations européennes et internationales, à prendre en compte la dimension productive, et le marquage d'origine doit en faire partie.
Le cinquième et dernier point de la résolution introduit le marquage made in UE dans le débat, et invite la Commission à réfléchir à l'éventualité d'un tel marquage.
Je tiens tout d'abord à rappeler que ce marquage est déjà possible, et utilisé par les entreprises. Jusqu'à présent, les fédérations professionnelles n'ont pas exprimé de demande particulière concernant un tel marquage, à l'exception des industries de santé qui y seraient favorables.
L'apposition de ce marquage, surtout s'il est accolé au marquage national, demande certainement à être étudiée, en particulier pour que l'ensemble soit clair et lisible pour le consommateur, déjà confronté à des étiquettes surchargées. Si le débat est nécessaire, il porte donc plutôt sur les techniques de marquage et ne relève sans doute pas du même niveau politique que les points précédents de ce texte.
Au final, je veux souligner la forte ambition de cette proposition de résolution, sur un sujet techniquement complexe mais qui se situe au plus près des préoccupations quotidiennes des consommateurs.
Le Gouvernement tient à saluer la contribution de cette proposition au nécessaire débat qui doit se tenir non seulement en France, ce que nous faisons, mais également au sein de l'Union européenne. Nous nous inscrivons parfaitement dans l'esprit de cette proposition, qui va dans le sens d'une plus grande transparence vis-à-vis du consommateur et d'une meilleure valorisation de la qualité des produits.
Même si plusieurs des points de cette résolution apparaissent difficilement praticables, soit du point de vue technique, soit surtout parce qu'il faut que nous arrivions à convaincre nos partenaires, et si, de ce fait, ils relèvent d'un « idéal » vers lequel il faut tendre, il y a en même temps une nécessité absolue d'aller dans cette direction. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable à l'adoption de ce texte.
J'indique par ailleurs à Christian Estrosi, qui s'est inquiété à juste titre des suites de l'Observatoire du Fabriqué en France, que ses travaux ont été très récemment publiés pour l'année 2010 et qu'ils sont désormais accessibles sur le site internet du ministère – je lui en transmettrai une copie.
Ayant exprimé ces quelques interrogations ou réserves, je veux, au moment de conclure, saluer l'auteur de cette proposition de résolution et vous dire à nouveau, messieurs les députés, que le Gouvernement y est favorable. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Je mets aux voix la proposition de résolution.
(La proposition de résolution est adoptée.)

Prochaine séance, lundi 6 février à vingt et une heures trente :
Discussion de la proposition de loi relative au régime de responsabilité civile des sportifs.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures dix.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Nicolas Véron