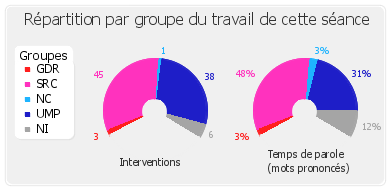Séance en hémicycle du 19 novembre 2009 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues relative au droit de finir sa vie dans la dignité (nos 1960 rectifié, 2065).
La parole est à M. Manuel Valls, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Madame la présidente, madame la ministre de la santé et des sports, mes chers collègues, « la mort joue à cache-cache avec la conscience : où je suis, la mort n'est pas ; et quand la mort est là, c'est moi qui n'y suis plus », écrivait Vladimir Jankélévitch. Expérience insaisissable par les vivants, la mort exige d'eux qu'ils l'appréhendent toujours avec prudence. Depuis des millénaires, cette seconde impalpable entre le pas encore et le jamais plus ouvre aux hommes un abîme de conjectures.
En la matière, les certitudes hâtives et les affirmations péremptoires doivent donc êtres mises en doute. Les invectives et les rodomontades, d'où qu'elles viennent, trahissent l'ignorance. Pour nous, législateurs, il est tout particulièrement difficile d'appréhender cette question, car elle nous confronte à la finitude, sinon à la vanité des entreprises humaines : nous préférons d'habitude concevoir notre rôle dans l'affirmation de la volonté plutôt que dans la reconnaissance de l'inéluctable.
Ainsi la question de la fin de vie des malades a-t-elle été longtemps traitée en creux par le droit français ; il a fallu attendre la loi du 22 avril 2005 pour marquer une heureuse évolution. Cette loi, qui couronnait la démarche engagée par les lois du 9 juin 1999 et du 4 mars 2002, a permis de légaliser ce qu'il est convenu d'appeler le « laisser mourir » en reconnaissant au patient et au médecin la possibilité d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Considérée par les uns comme une dérogation exceptionnelle et présentée par les autres comme une liberté minimale, la loi du 22 avril 2005 a atteint un point d'équilibre qui lui valut d'être alors votée à l'unanimité.
Au printemps 2008, notre collègue Jean Leonetti, avec quatre autres collègues, a été désigné à la tête d'une mission parlementaire pour évaluer la loi qui porte son nom. Rendu à la fin de l'année dernière, le rapport de sa mission contient vingt recommandations tendant à améliorer la mise en oeuvre de la loi sans en changer l'équilibre. Or, si chacun reconnaît que les dispositions de cette loi mériteraient d'être mieux connues des malades et du personnel médical, il n'en reste pas moins qu'elles demeurent insuffisantes pour certaines personnes en phase terminale. La généralisation du recours aux soins palliatifs, en faveur de laquelle tout doit être fait compte tenu des faiblesses de l'offre à ce jour, ne répondra jamais, en effet, aux souffrances et aux demandes de tous les malades.
Dans quelques cas, heureusement rares, les douleurs des patients restent rebelles à toutes les sédations ; dans d'autres, beaucoup plus fréquents, les malades refusent d'être abrutis par les médicaments sédatifs au moment de partir. Ils préfèrent – et c'est là leur ultime volonté – quitter leurs proches en restant capables de les reconnaître et de les appeler par leur nom. Dans tous ces cas, les médecins sont aujourd'hui laissés seuls face à leur conscience et à la détresse des patients et de leur famille. Les uns s'interdisent jusqu'au bout le geste libérateur ; les autres finissent par céder aux demandes réitérées de mourir.
Dans une pétition publiée par Le Nouvel Observateur en mars 2007, plus de 2 000 soignants ont ainsi reconnu avoir « en conscience aidé médicalement des patients à mourir ». Il appartient alors aux juges, au hasard des dénonciations et des révélations, de dire le droit, au cas par cas, pour condamner les uns et acquitter les autres.
Non, mes chers collègues, il n'est pas possible que le législateur se démette de sa responsabilité. C'est pourquoi des députés de tous bords ont déjà déposé de nombreuses propositions de loi tendant à légaliser l'euthanasie : je pense notamment à celles de Laurent Fabius, de Jean-Paul Dupré, de Germinal Peiro, d'Yves Cochet ou d'Henriette Martinez. Pour la première fois de notre histoire parlementaire, grâce à l'initiative du groupe socialiste, l'une d'elles, qui a fait l'objet d'un très long travail, est inscrite à notre ordre du jour. Elle repose sur trois principes.
Le premier de ces principes est le refus de l'hypocrisie. Le principal argument des opposants à l'euthanasie est d'affirmer le caractère inviolable de certains interdits. Pourtant, l'euthanasie est en réalité, et depuis longtemps, une pratique courante dans de nombreux centres de soins. On estime ainsi que plusieurs milliers de malades bénéficient chaque année d'une aide à mourir. Dans la grande majorité des cas, cette violation de l'interdit est jugée avec mansuétude par le corps judiciaire. Le seul enjeu est donc de savoir si la loi doit reconnaître la réalité ou s'en tenir à un affichage hypocrite de principes. Or, en l'espèce, l'hypocrisie paraît d'autant moins acceptable – même s'il faut en débattre – qu'elle est inscrite au coeur même du dispositif légal.
La loi du 22 avril 2005 prétend en effet établir un subtil distinguo entre « laisser mourir » et « faire mourir ». Convaincante sur le papier, cette distinction ne résiste pas à l'épreuve des faits. Pour lutter contre les douleurs de certains patients, les médecins sont parfois obligés d'utiliser ce qu'il est convenu d'appeler une « sédation terminale ». Dans ces circonstances, quoi que l'on veuille bien en dire, les médecins éteignent simultanément, dans un même geste, les souffrances et la vie du malade.
En dehors de ces cas extrêmes, la loi du 22 avril 2005 autorise des pratiques assimilées, par des autorités prestigieuses comme le Pape, à des aides actives à mourir : je pense notamment à l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation dont un rapport du Conseil d'État a établi clairement qu'il ressort des dispositions de la loi.
Contrairement à ce que d'aucuns voudraient croire, la frontière entre « laisser mourir » et « faire mourir » n'est pas étanche, mais poreuse. Dans des circonstances où tout est relatif et question d'interprétation, il est vain d'opposer le caractère absolu de l'interdit « Tu ne tueras point », dont la force normative est, de fait, inopérante. La seule manière d'éviter les dérives est d'admettre enfin la réalité pour mieux l'encadrer ; tel est justement l'un des objectifs de la présente proposition de loi.
Le deuxième principe de notre texte est la conséquence de ce refus de l'hypocrisie : trop longtemps les non-dits ont été le prix à payer pour le consensus à tout prix. La majorité des députés socialistes est aujourd'hui convaincue qu'elle doit désormais afficher clairement ses objectifs. Nous avons examiné toutes les pistes, et notamment celle proposée par Gaëtan Gorce de « l'exception d'euthanasie ». Le souci de ménager la conscience de chacun en avançant pas à pas est compréhensible ; mais cette démarche ne correspond plus aux besoins ni aux attentes. Toutes les enquêtes d'opinion réalisées sur le sujet montrent en effet qu'une forte majorité de nos concitoyens attend une légalisation globale de l'euthanasie.
Par ailleurs, ces indispensables évolutions, loin de s'opposer au développement des soins palliatifs, les accompagnent. Au Pays-Bas et en Belgique, les décisions médicales visant à abréger la vie n'ont pas entravé les pratiques de soins palliatifs ; elles ont surtout été prises dans le cadre des soins multidisciplinaires.
Plutôt que de chercher un consensus impossible, les signataires du présent texte préfèrent revendiquer leur différence en affirmant le principe d'un droit général à l'euthanasie, d'une véritable aide active à mourir. Ils ne craignent pas d'assumer ainsi la confrontation noble de deux définitions de la dignité humaine.
Pour les opposants à l'euthanasie, la dignité est une dimension inhérente à la vie humaine. Quelles que soient les conditions d'existence d'un individu, sa dignité reste inaltérable et s'impose à lui-même. Il n'est jamais libre d'en juger. À l'inverse, pour les partisans de l'euthanasie, la dignité est une propriété dépendant de la qualité de vie. Elle ne s'appuie sur aucune forme de transcendance et laisse chaque individu en mesure de l'apprécier pour lui-même.
C'est sur la base de cette dernière définition que notre proposition de loi fait référence à la fin de la vie dans la dignité. Sa prétention n'est pas – loin s'en faut – de définir les critères d'une mort digne. Elle est seulement de permettre à chaque individu d'en être le seul juge, lorsque les affres de la maladie dépassent un seuil intolérable.
Le troisième et dernier principe de notre texte découle directement de ce choix. Il vise à créer, dans le cadre de la loi et dans la conformité à nos valeurs, un droit nouveau pour l'individu.
Strictement limité aux personnes majeures, en phase avancée ou terminale d'une maladie grave et incurable – c'est l'article 1 –, ce droit évite tout risque de dérive vers l'assistance automatique au suicide. Il prévoit la consultation d'au moins quatre médecins chargés de vérifier à la fois l'état du malade et le caractère libre et éclairé de sa demande – c'est l'article 2.
Si les patients sont hors d'état d'exprimer leur volonté, ils peuvent néanmoins bénéficier de cette aide, sous réserve d'en avoir exprimé le souhait au préalable, dans des directives anticipées – ce sont les articles 3 et 4.
Une commission régionale de contrôle s'assure, a posteriori, du respect de ces garanties – article 5 – et une clause de conscience permet à tout médecin de refuser son concours – article 6.
Encadré de la sorte, le droit à mourir dans la dignité s'intègre pleinement dans nos valeurs. Il est, d'abord, conforme à la liberté, car il met chaque individu en mesure de choisir la fin qu'il souhaite. Il est utile, en outre, à l'égalité de nos concitoyens, car il n'est pas acceptable que le bénéfice d'une aide active à mourir dépende – comme c'est le cas aujourd'hui, et là est la véritable inégalité –, de la chance ou des moyens du malade. Il est conforme, enfin, à la fraternité, car il permet de rassembler, au moment ultime, celui qui part et ceux qui restent.
Dans une tribune publiée le 19 novembre 1979, il y a trente ans jour pour jour – belle coïncidence –, l'écrivain Michel Lee Landa réclamait la reconnaissance du droit de mourir. La polémique suscitée par ce texte permit alors l'ouverture d'un large débat public et entraîna la création de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité – dont je salue les membres présents dans les tribunes de cet hémicycle.
Trente ans plus tard, alors que les évolutions sociales tendent à éteindre les passions sur ce sujet, il est temps que le législateur consacre enfin ce nouveau droit de l'homme du xxie siècle. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)

La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, chacun en convient, la loi du 22 avril 2005, cher Jean Leonetti, a constitué une avancée considérable dans le débat sur la fin de vie – et vous en convenez, monsieur le rapporteur. Faut-il aujourd'hui, comme vous le suggérez, « franchir un nouveau pas » ? Quel est ce « pas » que vous évoquez ? Quel est ce « franchissement » que vous justifiez au nom du principe de dignité ? Est-ce un progrès ou la transgression d'une limite ?
En vérité, la proposition que vous défendez bouleverse et met en péril les fondements de l'éthique qui, depuis l'origine de la médecine, irrigue sa pratique : cette éthique qui nous enjoint d'être attentifs à la souffrance du prochain, de lui porter secours, de répondre à sa détresse par des gestes de vie ; cette éthique qui proscrit l'obstination déraisonnable, mais qui interdit au médecin, conformément au code de déontologie, de provoquer délibérément la mort.
L'entrée dans une phase avancée d'une maladie oblige médecins et soignants à entendre et à respecter la volonté des patients. Cette obligation renforce le droit des malades, rappelle au médecin leur devoir sans leur conférer pour autant un nouveau droit : celui de mettre fin à la vie du patient.
Il s'agit là d'un des principes irréfragables régissant l'éthique médicale : la mort peut être une conséquence, mais ne peut en aucun cas procéder d'un projet auquel le corps médical serait associé. La loi sur la fin de vie incorpore ces valeurs.
Le droit ne saurait sans entrer en contradiction avec lui-même, sans trahir ni oublier ses fondements éthiques, admettre, à titre d'option, la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté. La coexistence de dispositions aussi contradictoires en leur principe serait incohérente. Peut-on justifier, au nom du libre choix individuel, une telle contorsion du droit, une telle distorsion de l'éthique médicale, une telle plasticité des principes ?
Sans doute, le respect de l'autonomie du sujet constitue la pierre de touche permettant d'évaluer le bien-fondé de toute disposition concernant les malades en fin de vie. Or l'autonomie n'est pas garantie par la fausse possibilité d'un choix entre la mort et une insupportable souffrance. Précisément, l'autonomie suppose la réversibilité toujours possible du choix.
C'est en ce sens que les soins prodigués aux malades en fin de vie ont d'abord pour effet et pour fonction de libérer les patients de la souffrance qui aliène. C'est en ce sens que le geste médical se trouve ici placé au service de l'autonomie.
Le droit des malades et des personnes en fin de vie trouve ainsi son fondement dans cet impératif toujours difficile à satisfaire : reconnaître une liberté au moment même où la diminution de notre puissance paraît plutôt impliquer, presque mécaniquement, la tentation de la tutelle.
Il est essentiel, quand tout paraît basculer, de préserver jusqu'au bout les conditions d'un colloque singulier, permettant de recueillir la volonté des malades dont, concrètement, l'expression peut varier, voire se contredire, d'une heure à l'autre, notamment en fonction de l'intensité de la douleur physique et de la souffrance morale. Ne pas admettre ces moments où la volonté de se battre succède à la lassitude, c'est méconnaître la réalité de la maladie et la complexité de la personne humaine.
Comment répondre à la détresse qui peut rendre la mort désirable ? Comment répondre à l'expression d'un désarroi irrémédiable ? Cette question abrupte, qui pourrait ne pas l'entendre ? Quel médecin, aux côtés d'un patient entraîné dans le gouffre de la dépression, ne se l'est pas posée ? Comment libérer un être du tourment qui l'anéantit ?
Il ne s'agit pas d'abréger la vie, mais d'affranchir la personne en fin de vie de la souffrance qui enferme. La pratique palliative trouve là l'essentiel de sa raison d'être. Ce n'est pas la vie qui aliène, mais d'abord la douleur, dont il faut libérer le patient. Au stade terminal, ou avancé, d'une affection grave et incurable, l'exigence de liberté s'impose jusqu'au bout. Les soins palliatifs, se déployant dans des gestes de vie, sont une assistance à la liberté. Cette liberté est le bien le plus précieux qui fonde notre dignité, cette dignité toujours invoquée mais trop souvent trahie dans ses principes.
Répondre à une demande de mort, prétendument aider, reviendrait à réduire une personne à un être enfermé dans la douleur. Les personnels soignants, dans des situations dramatiques, se trouvent souvent placés devant des cas de conscience. Ce qu'il est convenu d'appeler le double effet peut alors constituer une réponse légitime et, je voudrais le souligner ici, la seule qui soit recevable au regard des exigences spécifiques du soin.
La différence entre le bien d'une intention – apaiser la souffrance – et le mal d'une conséquence non voulue – la mort comme effet indirect possible – permet de distinguer nettement ce qui relève de l'euthanasie et ce qui relève des justes moyens de lutte contre la douleur.
À cet égard, l'expression consacrée de « laisser mourir » n'est pas sans équivoque. En l'opposant à l'« aide active à mourir », on laisse trop souvent entendre, très malencontreusement, qu'à l'action s'oppose le délaissement.
C'est ignorer la réalité de la pratique : les soins palliatifs, dont il convient de diffuser et non de contredire la pratique, impliquent une présence exigeante dans l'accompagnement.
Alors pourquoi rechercher ailleurs des réponses aux questions que nous nous posons, dans des pays qui souvent, d'ailleurs, veulent désormais s'inspirer davantage de notre démarche, raisonnée, équilibrée, exigeante ?
Il est des douleurs insupportables. Nul ne le nie. Nul ne peut y être insensible. La question est de savoir si une évolution de la loi pourrait permettre de mieux gérer ces cas exceptionnels. Or la loi ne peut, par destination, définir que des principes. Ce qui est exception ressort de l'espèce, non du genre. Comment la loi pourrait-elle, en effet, définir dans leur singularité radicale, irréductible à toute anticipation abstraite, les cas exceptionnels ? À supposer qu'on soit capable de rédiger une telle loi, les médecins auront toujours à trancher, dans chaque cas singulier soumis à leur appréciation. La médecine est toujours l'épreuve d'un cas de conscience, dans des situations exceptionnelles où l'humanité doit prévaloir, et aucun des arguments que vous nous avez apportés, monsieur Valls, ne permet de surmonter ces principes. Vous parlez du refus de l'hypocrisie, en affirmant que, puisque l'euthanasie est pratiquée, il faudrait la légaliser. Quelle singulière conception du droit. Vous dites que l'opinion publique attend cette légalisation. Quel curieux argument. Selon ce principe, il aurait donc fallu rétablir la peine de mort, puisque l'opinion publique la réclamait. (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR. – « Elle a raison ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Vous parlez d'un droit nouveau pour l'individu. Mais n'est-ce pas plutôt un devoir insupportable pour le médecin ?
Parce que la loi Leonetti est porteuse de cette conception de l'humain et de la médecine, nous souhaitons aujourd'hui favoriser davantage son application effective. Ainsi, nous ne saurions prendre le risque de contrarier le développement de la culture des soins palliatifs dans notre pays, en légalisant des pratiques contraires aux principes que nous venons d'énoncer, aux principes qui structurent la loi et qui fondent une éthique de la vulnérabilité digne d'être défendue.
Au moment où le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 se met en place, au moment où viennent d'être créées six nouvelles unités de soins palliatifs, au moment où la formation des bénévoles et des gardes-malades s'amplifie et où celle des soignants intègre enfin un enseignement spécifique, l'heure n'est pas venue d'entraver le développement d'un projet déterminé par une éthique de la vie, soucieuse de respecter jusqu'au bout la liberté du sujet.
C'est cette éthique qui structure notre engagement en faveur des soins palliatifs. La vie d'autrui n'est à la disposition de personne. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC. – « À la disposition de soi-même ! » sur les bancs du groupe SRC.)
Un député du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. En fait, ce que dit Mme la ministre, c'est que la vie est à la disposition de Dieu !

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Danièle Hoffman-Rispal.

Madame la ministre, nous sommes d'accord : il ne faut pas relâcher nos efforts pour développer les soins palliatifs. L'exposé des motifs de notre proposition de loi le rappelle très clairement. Mais les soins palliatifs ne sont pas contradictoires avec le choix de mourir dans la dignité : ils en sont complémentaires.
Cette question de la fin de vie s'est déjà trouvée au coeur de nombreux débats parlementaires. Ils furent très souvent suscités par des séquences médiatiques nées d'émotions fort légitimes.
Comme notre rapporteur vient de le rappeler, nos discussions trouvent leur source dans une tribune de Michel Lee Anda, sobrement intitulée Un droit, parue il y trente ans jour pour jour dans un grand journal du soir.
Bien sûr, des progrès ont été enregistrés depuis l'adoption de la loi du 22 avril 2005, nous l'avons tous dit, mais nous sommes nombreux à penser qu'il serait raisonnable d'aller plus loin dans la reconnaissance de ce droit à finir sa vie dans la dignité. Certains que cela permettra des échanges dépassionnés, nous souhaitons discuter de l'opportunité d'inscrire ce nouveau droit dans la législation française, loin des passions déchaînées par des épisodes aussi récents que pénibles, dont beaucoup ont critiqué l'instrumentalisation.
Selon nous, la nécessité d'une nouvelle loi trouve sa justification à la fois dans la recherche d'une plus grande liberté et dans celle d'une plus grande égalité : une plus grande liberté pour les malades qui recherchent un complément au refus des traitements – possibilité ouverte par la loi du 22 avril 2005, ce qui constitue déjà un premier pas – et une auto-délivrance ; une plus grande égalité entre les malades, qui ne disposent pas tous, notamment, de la même connaissance, des mêmes moyens financiers ou des mêmes contacts médicaux. Quand certains ont la possibilité – on le sait bien – de choisir l'aide active à mourir, que ce soit en faisant appel à des médecins proches et compréhensifs ou en se rendant à l'étranger, d'autres se voient malheureusement refuser cette aide qu'ils réclament.
Les opposants à notre texte lui reprochent d'encourager des dérives infinies dans la banalisation de la mort.

L'adoption d'un nouveau texte permettrait, bien au contraire, d'encadrer les pratiques de l'aide active à mourir. Les nombreuses auditions menées par notre commission et nos expériences respectives de parlementaires nous renseignent sur la pratique actuelle. S'il est difficile d'estimer le nombre exact d'euthanasies illégales effectuées en France en raison de leur clandestinité, les nombreuses déclarations de médecins à ce sujet – citons par exemple Léon Schwartzenberg – attestent de son importance. Une meilleure définition des situations dans lesquelles l'aide active à mourir est acceptable devrait aboutir à une diminution du nombre total d'euthanasies, comme cela a été constaté aux Pays-Bas.
Puisque nous en sommes à la discussion générale de notre texte, je souhaiterais aussi revenir sur une perception, à mon sens erronée. Certains de ses détracteurs craignent que ceux qui le défendent ne s'orientent vers une suppression des plus vulnérables à travers l'euthanasie. Je tiens à les rassurer : ce texte prévoit simplement que les personnes touchées par une affection grave et incurable,…

…infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et jugée insupportable, et qui en sont demandeuses, puissent bénéficier d'une aide active à mourir. Ceux qui connaissent mes combats en faveur de l'autonomie de tous pourront témoigner que je n'imaginerais pas un seul instant qu'on puisse forcer la main aux plus faibles. A l'inverse, je pense qu'il faut savoir respecter – j'y insiste – la volonté des malades.
En relisant un très beau texte de notre collègue sénateur Michel Dreyfus-Schmidt, qui nous a quittés récemment et dont je salue les combats, j'ai retrouvé une citation de Rousseau qui résume admirablement mon point de vue : « Nos sophistes regardent la vie comme une chose qui n'est pas à nous parce qu'elle nous a été donnée, mais c'est précisément parce qu'elle nous a été donnée qu'elle est à nous. » (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)

Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi sera-t-elle l'aboutissement d'une succession de rendez-vous plus ou moins réussis mais au goût d'inachevé ? C'était la question que je me posais en écrivant le texte de mon intervention ; après avoir écouté la ministre, je doute que nous puissions avoir ce débat franc, sans arrière-pensées.
Un député UMP. C'est très bien ainsi !

En 1999 – puisque vous parlez beaucoup des soins palliatifs –, c'est avec Gilberte Marin-Moscovitz que j'ai déposé la proposition de loi généralisant les soins palliatifs, improprement appelée depuis lors loi Kouchner. Je concluais en précisant que c'était un premier pas, avec la prise en charge de la souffrance physique, mais que cela ne devrait pas nous faire oublier les souffrances psychologiques et existentielles. Je souhaitais déjà que nous ouvrions le débat sur le droit de chacun à déterminer les conditions de sa fin de vie.
Aujourd'hui, nos concitoyens sont prêts à engager le débat au fond sur le droit de mourir dans la dignité mais le législateur que nous sommes n'a encore jamais véritablement osé. Comme souvent, nous sommes en retard sur la société et les moeurs.
Le second rendez-vous fut la loi dite Léonetti, dont tant se félicitent mais qui n'est, à mes yeux, qu'une étape ; cette loi a été écrite pour protéger les médecins, en reconnaissant la pratique de l'orthothanasie. C'était nécessaire ; cela demeure insuffisant.
Considérant que vous ne pouviez éluder le débat indéfiniment, puisque nos concitoyens sont prêts à le mener, je vous avais donné un nouveau rendez-vous et, en 2001, puis en 2003, j'ai déposé deux propositions visant à instituer le droit de mourir dans la dignité. Je considérais que le temps était venu de franchir le pas et d'accorder aux femmes et aux hommes cette dernière liberté, celle de choisir sa fin de vie ; sans doute espérais-je trop.
Dix ans plus tard, le débat s'ouvre. Sera-t-il le vrai débat sans arrière-pensée que nous attendons, que notre société attend ? Je continue maintenant d'en douter.
Dans notre pays, l'approche de la mort est, encore de nos jours, un domaine où ce qui peut rester de liberté et de droits à la personne n'est que très insuffisamment reconnu. Aujourd'hui encore, le suicide, qui reste la première cause de décès chez les 30-39 ans, est très souvent analysé comme une faiblesse psychologique. Celle-ci est mise en exergue par les opposants à cette aide au suicide. Pour eux, la demande de fin de vie est en elle-même tellement absurde qu'elle ne peut être que le fruit d'un esprit malade. La demande de fin de vie est, pour eux, le produit d'un mental diminué. La personne devient, à ce titre, non plus un citoyen doté de droits mais un patient, un sous-citoyen qui n'est plus totalement maître de lui-même. Tel un mineur, il devrait être protégé de sa propre volonté, viciée par la faiblesse de son mental. La société prend alors le relais et l'oblige alors à continuer de vivre contre son gré.
Notons aussi que, contrairement au droit pénal de pays étrangers comme l'Espagne ou la Suisse, notre code pénal ne fait aucune distinction entre la mort donnée à autrui par compassion et celle préparée et infligée dans la plus noire intention, qui est qualifiée d'assassinat. Pourtant, les juges, lorsqu'ils sont appelés à trancher, ont bien du mal ; ils rendent donc parfois des verdicts qui interprètent très fortement la loi.
Le développement des soins palliatifs depuis 1999 fut une remarquable avancée, qui doit être amplifiée ; plusieurs d'entre nous l'ont demandé. Mais d'autres y ont vu le moyen de fermer la porte à toute discussion sur l'euthanasie et le droit d'aider à mourir ; nous venons d'en avoir un nouvel exemple.
Puis, l'émotion suscitée dans le pays par la détresse de Vincent Humbert et par l'inculpation de Marie, sa mère, qui l'aida à mourir, a rouvert ce débat dans la société, mais certains, au fond, n'en voulaient pas : ils ont utilisé la loi de 2005 pour faire taire les interrogations de nos concitoyens et faire croire que nous avions répondu à la détresse humaine. Depuis lors, le dramatique et pathétique suicide de Chantal Sébire a ravivé l'aspiration au débat, car la loi de 2005 laisse sur le bord de la route toutes les personnes atteintes de maladies longues, douloureuses et irréversibles, qui vivent dans une profonde détresse physique mais aussi, souvent, morale, sans que leur survie dépende de la poursuite d'un traitement.
Pour vous qui avez utilisé la loi de 2005 afin d'éviter tout débat philosophique et moral sur la fin de vie et l'euthanasie,…
C'est faux !

…pour vous qui vous opposez, pour des raisons philosophiques ou religieuses, à ce qu'une personne soit en dernier ressort maîtresse de son destin et de sa vie, la vie est une réalité transcendante qui ne peut être laissée à la libre disposition de l'homme. Il est temps de sortir notre corps de l'emprise des religions et de la pensée théiste. Il nous faut en prendre possession définitivement, le laïciser et affirmer qu'il n'appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes.
Vous considérez que l'allègement des souffrances physiques par les soins palliatifs est une réponse suffisante, qui épuise l'ensemble des interrogations existentielles. Toute souffrance apaisée, il n'y aurait plus de volonté raisonnable de mettre fin à ses jours.
Vous cherchez également – je ne vous vise pas personnellement, madame la ministre – à impressionner, à faire peur à nos concitoyens en leur dressant un tableau digne du Soleil vert de Richard Fleischer, où nos hospices deviendraient le théâtre d'euthanasies à la chaîne, dans lesquels les familles viendraient se débarrasser de leurs vieux parents pour capter leur héritage. On ne recule devant rien !
Vous faites peur en pointant des excès que la loi permet justement d'écarter. Vous faites peur pour ne pas agir, mais la peur ne doit pas entraver notre pas. Nous devons donner espoir à tous ceux qui, aujourd'hui bien-portants, veulent avoir l'assurance que leur volonté sera respectée aux derniers instants de leur vie et qu'ils pourront partir comme ils ont vécu : dignement. C'est un message d'espoir que nous portons.
Nous sommes de plus en plus nombreux, en France, à considérer le droit de mourir dans la dignité comme le dernier droit de notre vie. Entre les soins palliatifs et la possibilité donnée de fixer le terme d'une vie devenue insupportable, il n'y a pas contradiction mais, souvent, complémentarité. Vouloir opposer, comme le font certains des acteurs des soins palliatifs, ceux-ci et l'assistance au suicide ou le geste euthanasique est une erreur inspirée par certains préjugés. Tel qui accepte avec reconnaissance des soins palliatifs peut bien, à partir d'un certain moment,…

… souhaiter hâter une fin que sa conscience réclame et qu'il ne peut plus se procurer seul. Le moment est venu de venir en aide à celles et ceux qui sont dans une situation telle que leur volonté de quitter la vie est devenue plus forte que leur désir d'y demeurer encore quelques jours ou quelques semaines.
La question est de savoir si la mort est le droit ultime que la personne en détresse physique ou morale peut revendiquer. La mort volontaire peut être une manière appropriée de terminer une existence à laquelle l'être qui souffre ne parvient plus à donner une signification.
Je me réjouis que nos collègues du groupe SRC aient fait inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour car nous pouvons, mes chers collègues, voter sur un texte clair, et saisir enfin la chance d'accorder à nos concitoyens la liberté de ce dernier acte de volonté. Saurons-nous le faire ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui afin de débattre d'une proposition de loi qui concerne un sujet à la fois délicat et très médiatisé.
En préambule, je souhaite attirer votre attention sur l'intitulé pour le moins ambigu de ce texte : « proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité ».
Au premier abord, on pourrait croire qu'il s'agit de la perspective de bien vieillir, de finir sa vie dans la dignité. Or ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi, qui autorise « toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable » à demander « une aide active à mourir », afin d'« [éviter de subir] une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu'elle juge insupportable [et de] mourir dans la dignité ».
Il me semble essentiel de réfléchir à ce que ce signifie la dignité. A-t-on le droit de dire que l'homme qui souffre perd sa dignité ? La dignité se définit comme le sentiment de la valeur intrinsèque d'un être humain. Chaque homme est et reste toujours digne.
Comme l'a si bien souligné notre collègue Jean Leonetti la semaine dernière, lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires sociales, nous avons une expérience de la mort par la mort des autres. De nos jours, cette expérience suscite en nous, outre la peur ancestrale de la mort et de la souffrance, celle de la dépendance et de la dégradation. Malgré l'intense émotion que le sujet de la fin de vie peut provoquer en nous lorsque nous sommes informés de destins tragiques comme ceux de Chantal Sébire ou Vincent Humbert, nous devons mener notre débat de façon raisonnée et posée.
La présente proposition de loi fait franchir une étape décisive à la loi du 22 avril 2005 relative aux « droits des malades et à la fin de vie » qui prévoit qu'une équipe médicale ne doit pas poursuivre des traitements par une « obstination déraisonnable » et fait obligation de dispenser des soins palliatifs. Elle met un terme au « maintien artificiel de la vie » en instaurant un droit au « laisser mourir ». Bien entendu, interrompre le traitement ne signifie pas interrompre les soins qui sont dus jusqu'au bout de la vie.
La proposition de loi, qui nous est aujourd'hui présentée, veut aller beaucoup plus loin en légalisant la pratique de l'euthanasie active, transformant ainsi le droit de mourir en droit à mourir qui est un droit donné par un tiers. Ce droit, qui engage la responsabilité du groupe, dépasse largement la question de la seule liberté individuelle. Il est de nature à rompre le consensus qui fit adopter la loi de 2005 actuellement en vigueur. Nous devons, pour autant, veiller, pour cette loi comme pour toute loi, à son application et à sa bonne adaptation au contexte sociétal. C'est ce qui a été fait en novembre 2008 par la mission d'évaluation de la loi de 2005 qui a remis un rapport d'information présenté par notre collègue Jean Leonetti. Le rapport insiste sur le fait que la loi de 2005 est encore mal connue des soignants comme des patients et de leurs familles. Mal connue, cette loi est aussi mal appliquée et ne donne pas toute sa mesure. Le rapport met, de plus, en lumière l'insuffisance de l'organisation des soins palliatifs ainsi qu'une nécessaire amélioration de la formation des personnels de santé. Ce rapport de 300 pages avance vingt propositions et préconise, entre autres, la mise en place d'un observatoire des pratiques médicales de la fin de vie. Cet observatoire devait remettre chaque année un rapport au Parlement faisant état des problèmes liés à la fin de vie en France et comportant des études thématiques. Depuis la présentation de ce rapport, une année s'est écoulée. Quelles avancées ont été réalisées ? Quelles nouvelles questions se posent ? La loi de 2005 est toujours mal connue et, de ce fait, mal appliquée. Elle représente pourtant une véritable avancée et doit être améliorée. Le groupe Nouveau Centre demande le développement des unités de soins palliatifs, actuellement en nombre très insuffisant. En vue d'une meilleure assistance et prise en charge des personnes souffrant de maladies graves ou incurables, nous devons mobiliser davantage de moyens pour le renforcement et l'amélioration de la formation des personnels de santé accompagnant les personnes en fin de vie. Comme l'écrit la psychologue Marie de Hennezel, auteur du rapport de mission « La France palliative », nous considérons que « la fin de vie est encore la vie ». Il nous faut donc aller plus loin dans la réflexion du législateur sur les droits des malades et la fin de vie. Approfondissons la loi actuelle ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Je remercie Manuel Valls d'avoir posé le problème en termes apaisés. Nous sommes là pour respecter les convictions de chacun sur un sujet d'une particulière complexité et non pour invectiver et caricaturer.
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Très bien !

Ce climat est d'ailleurs celui qui a présidé à l'élaboration de la loi en 2005 où chacun a pu s'écouter et où nous avons abouti à une loi consensuelle. Ce n'est pas parce qu'elle est consensuelle qu'elle est parfaite, mais ce n'est pas parce qu'elle est consensuelle qu'elle est à rejeter.
Évoquer ce problème me permet d'abord de poser l'idée déjà développée selon laquelle « la mort, ce n'est jamais la mienne, mais celle de l'autre ». On a, en fait, très vite constaté que les convictions intimes que nous avons ne sont pas liées au fait d'être de droite ou de gauche, ni même de croire en Dieu ou de penser que le ciel est vide. Elles sont liées à nos vécus personnels, ancrés dans nos coeurs et dans nos âmes, de la mort de l'être cher. Nous raisonnons ainsi : « faut-il vivre cela, à notre tour, ou faut-il que nous puissions avoir une mort sereine et apaisée ? » Face à cet être cher qui meurt, nous sommes parcourus par ces désirs de mort et de vie : « J'ai envie qu'il reste parce qu'il est encore vivant, et j'ai envie qu'il parte pour cesser de souffrir, et cesser de souffrir de le voir souffrir… » Le malade lui-même est parcouru par ces désirs. L'homme se trouve, un jour, comme le dit Camus, devant la réalité incontournable de la vraie question philosophique : « Ma vie vaut-elle la peine d'être vécue ? » Ceux qui ne se sont jamais posé cette question sont fort démunis, lorsqu'ils arrivent au bord de leur finitude.
Nous vivons aussi dans une société qui nie la mort, qui la dénie, qui rejette l'idée du deuil, du rite et qui considère que la mort doit être discrète, peut-être même masquée. Elle est, en effet, devenue moins familiale, moins familière, plus hospitalière et quelquefois surmédicalisée. La médecine a fini par créer des situations complexes insupportables. À force de vouloir défendre la vie à tout prix, on se trouve face à des situations dans lesquelles la vie n'est acceptable ni pour ceux qui la subissent ni pour ceux qui l'entourent.
On sait aussi que la loi d'avril 2005, si elle n'est pas parfaite, posait au moins deux principes : le non-abandon et la non-souffrance. En effet, la demande de mort se justifie par deux raisons principales : la solitude et les douleurs physiques. Dans notre pays, on continue de mourir dans des souffrances physiques. La loi a voulu casser ce tabou en précisant que le double effet était autorisé et que l'on pouvait apaiser les souffrances, même au risque, en phase terminale, de raccourcir la vie. La loi a condamné l'acharnement thérapeutique sous le nom d'obstination déraisonnable. La loi a, enfin, précisé que l'autonomie de la personne devait être respectée dans ses demandes d'arrêt de traitement et que le malade ne devait jamais être abandonné. Nous avons trop vécu ces portes que l'on n'ouvrait plus parce que les mourants étaient derrière, ces malades qui, abandonnés à des soignants impuissants à prescrire, souffraient !
Cette révolution est en marche grâce à vous, madame la ministre. Les soins palliatifs se développent. Néanmoins, une évaluation supplémentaire a été menée avec Gaëtan Gorce, Michel Vaxès et Olivier Jardé. Il nous a alors semblé que l'arrêt des traitements était quelquefois pratiqué de manière barbare. Ce que nous avions proposé comme un « laisser mourir » devenait parfois insupportable, les médecins arrêtant tous les traitements de survie et fuyant la vie finissante et l'agonie douloureuse. (Approbation sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
Aujourd'hui, en Conseil d'État, et bientôt sous votre plume, madame la ministre, une modification de l'article 37 fera obligation aux médecins, qui arrêtent des traitements de survie, d'administrer des sédatifs et des antalgiques pour éviter ces agonies que nous avons connues avec l'affaire Pierra.

Cependant, la proposition de loi présentée aujourd'hui n'est pas une continuité, comme l'était la loi de 2005 avec celle loi de 2002. Elle est en rupture.

Je suis satisfait que Manuel Valls l'assume. Elle est en rupture à trois niveaux : juridique, médical et culturel.
Sur le plan juridique, cette proposition de loi ne doit pas s'inscrire dans le code de santé publique, mais dans le code pénal, car elle dépénalise l'homicide par compassion. Ne vous y trompez pas. Vous parliez d'hypocrisie. Or ce n'est pas en procédant hypocritement, par amendement, à une petite modification de la loi de 2005 que vous réglerez le problème. La loi française interdit l'homicide. Ainsi, même lorsqu'il est pratiqué en légitime défense, le juge peut s'y intéresser. C'est donc le droit pénal qui doit être modifié.
Ce droit à la mort est ouvert de manière très large puisqu'il se fonde sur l'interprétation d'une souffrance intolérable, voire d'une impasse. La souffrance, nous le savons, peut-être intolérable sur le plan physique, mais aussi psychique. Mais nous sommes tous bien placés pour savoir que la vie fluctue. Ainsi, 75 % des gens qui ont tenté de se suicider n'attentent jamais plus à leur vie. La mort n'est donc pas une liberté, elle interrompt la liberté puisqu'elle ne lui permet plus de changer.
Cette proposition est en rupture avec une pratique médicale. Vous pourriez me répondre que c'est une vision archaïque des choses et que la médecine doit s'adapter. Mais la médecine est faite pour soigner, guérir, soulager, consoler, accompagner : elle n'est pas faite pour tuer.

Aucun service de soins palliatifs de ce pays ne réclame d'ailleurs une évolution de la loi.
Si cette proposition de loi était votée, cela signifierait que les malades qui désireraient mourir sortiraient des soins palliatifs et seraient transférés dans des services où on leur donnerait la mort, comme cela se produit en Belgique. (Protestations sur les bancs du groupe SRC.) J'invite mes collègues à aller visiter les hôpitaux de Belgique, pays dans lequel une loi équivalente a été votée et où, dans certains cas, le malade sort d'un service pour aller dans un autre et y recevoir la mort.
Enfin, et j'ai suffisamment d'âge pour le dire, l'euthanasie a été une pratique institutionnalisée. Elle consistait en ce cocktail lytique – mélange de phénergan, de largactil et de dolosal – injecté et progressivement accéléré.

Et ceux qui le faisaient à cette époque-là étaient les médecins qui abandonnaient le moins leurs malades.
Je suis de l'avis de Goldwasser, élève de Schwartzenberg, qui considère qu'avec les techniques médicales, notre connaissance de l'humain et l'évolution de notre culture et de notre civilisation, l'euthanasie est aujourd'hui une démarche d'incompétence médicale. Il le dit avec en force en soulignant que c'est un ex-progrès devenu ringard. Il est ringard d'en revenir à des solutions que nous pratiquions il y a trente ans par manque de connaissances et par manque de moyens.

Ce qui est moderne, c'est d'accompagner les malades dans les services de soins palliatifs.
Enfin, la proposition de loi que vous proposez est hors de la réalité médicale et humaine. Il faut bien distinguer deux situations particulières. Il y a celle de la phase toute terminale, pour laquelle chacun s'accorde à dire, je crois, que la loi actuelle est suffisante. Et il y a celle, en amont, où le malade, qui vient d'apprendre qu'il souffre de telle maladie, déclare qu'il estime, en conscience, que la vie qu'il va mener ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous ne sommes alors plus dans la démarche de l'euthanasie terminale, mais nous nous approchons de celle du suicide assisté. Nous savons que des pays tels que la Suisse, aux législations pénales assez proches de la nôtre, qui ont opté pour le suicide assisté, ont abouti à des dérives qui ont fait qu'à terme on a donné la mort à des gens qui étaient seulement las de vivre et qui ne souffraient pas de maladie grave et incurable.
Aujourd'hui la législation hollandaise est condamnée par le conseil des droits de l'homme de l'ONU. La législation suisse revient sur ses propositions. La Belgique est, une fois de plus, divisée entre des hôpitaux qui pratiquent et des hôpitaux qui ne pratiquent pas. Quant à la loi anglaise, elle émet des recommandations calquées sur le droit français. Aujourd'hui, c'est la France qui est moderne, car elle a tracé une voie originale entre le respect de l'autonomie d'une part, le respect de la fragilité et la compassion d'autre part.
Quelle société voulons-nous ? Voulons-nous une société humaniste ? Je dis bien humaniste, non religieuse. Il me suffirait, monsieur Desallangre, de vous citer Robert Badinter disant que la loi de 2005, qu'il a soutenue, était « tout à fait satisfaisante ». Ou Axel Kahn, pour qui elle est « sans doute la meilleure d'Europe ». Ou encore Alain Grimfeld, qui affirmait qu'«il serait déraisonnable de voter une autre loi ». Ces hommes ne sont pas des religieux, ce sont des agnostiques. Ils savent que si le ciel est vide, notre responsabilité n'en est que plus grande. Nous sommes condamnés, comme le disait Sartre, à la liberté et à la responsabilité, laquelle est encore plus grande envers les plus fragiles.

Nous sommes face à deux projets de société. L'un relève d'une « société des individus » qui ont pour devise : « c'est mon choix ». C'est une société du repli, qui refuse les règles générales et l'idéal (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR) et qui dit : « je choisis, dans la carte des valeurs, celle qui me convient ». C'est une société qui répond à une éthique d'autonomie respectable, mais qui réclame paradoxalement que la décision individuelle soit assumée par le groupe…
Il y a une autre société, celle que nous appelons probablement tous de nos voeux, une société affirmant que la personne humaine ne se décline pas en fonction de sa force, que le nouveau-né, le mourant, le mendiant, l'homme mort dans les camps de concentration ne sont pas moins dignes que les autres (Nouvelles exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR) et que la dignité n'est pas une appréciation de soi.
Quelle intolérance !

La dignité est-elle une appréciation de soi ou une appréciation de la personne ? Pourquoi ces hommes et ces femmes, qui ont pu être torturés, connaître des situations atroces, n'ont-ils pas évoqué le suicide ? Cependant que nous, qui vivons dans une société d'opulence – au sein d'un monde où nombre de pays luttent pour la survie –, nous sommes en train de nous torturer pour savoir comment nous devons nous donner la mort…

Lacordaire disait qu'entre le faible et le fort, le pauvre et le riche, et on pourrait ajouter entre le souffrant et le bien-portant, c'est la liberté qui asservit et la loi qui affranchit. Pour ma part, je ne choisirai pas une loi qui élimine les êtres fragiles, même à leur demande. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP. - Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

La question du passage de la vie à la mort est une question philosophique, éthique et médicale. C'est aussi une question personnelle, à laquelle chacun d'entre nous sera confronté. C'est, enfin, une question politique, et je suis de ceux qui considèrent qu'il appartient à la représentation nationale de s'en saisir et de dire ce qui est acceptable ou non par la société.

Cela n'est pas, cela ne doit pas être, cela ne peut pas devenir une question partisane.
La question qui se pose à nous n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, et si un principe doit l'emporter sur l'autre. Si nous nous enfermons dans ce type de débat, nous n'arriverons pas à trouver de solution et c'est parce que nous ne l'avons pas fait que la loi du 22 avril 2005 a pu être votée.
Si nous restons sur l'idée qu'il peut y avoir une solution ou un point de vue unique et meilleur que les autres, peut-être satisfaisons-nous à nos idées, à notre conviction, mais sans doute pas à notre responsabilité de dire le droit au nom de la représentation nationale. Nous avons, les uns et les autres, j'en suis sûr, un point de vue personnel sur la façon dont nous envisageons la maladie et la mort. Mais si ce point de vue doit nous influencer, il ne peut pas nous dicter notre attitude en tant que législateur, dès lors que nous n'agissons pas pour nous-mêmes, mais pour la collectivité et pour la société.
C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas souhaité cosigner la proposition déposée par mes amis du groupe SRC, pour lesquels évidemment j'éprouve par ailleurs la plus grande sympathie. Si je ne l'ai pas fait, c'est d'abord que je ne me résous pas à cette formule, à cette idée d'un droit à mourir. Il me semble important de laisser à chacun – le mot choquera peut-être, mais c'est celui qui me semble s'imposer – la liberté de choisir, la possibilité d'affronter la mort comme il l'entend. La société doit offrir à tous cette possibilité, elle n'a pas à dire ce qui doit être fait par les équipes médicales, ce à quoi la famille ou le malade doivent normalement se référer.

La société doit créer les conditions dans lesquelles chacun peut choisir, qu'il s'agisse de soins palliatifs, de l'aide à mourir dans le cadre de la loi de 2005 ou de toute autre solution juridique dont nous pouvons débattre. Toutes ces options doivent lui être offertes, afin que la solution appliquée à son cas corresponde à sa situation, à son état, aux soucis de sa famille et à l'idée qu'il se fait de sa façon de mourir.
De ce point de vue, la loi de 2005 a constitué un véritable progrès. D'abord en raison des conditions dans lesquelles elle a été élaborée et débattue, et dont je garde un souvenir très précis. Ensuite parce qu'elle a permis de reconnaître, pour la première fois, que le droit du malade devait s'imposer dans ces circonstances et que l'interruption du traitement était un droit si le malade le souhaitait, considérant que ses souffrances étaient insupportables. Je regrette, madame la ministre, la défaillance des pouvoirs publics, qui auraient dû mieux faire connaître cette loi, mener les campagnes d'information nécessaires pour pouvoir surmonter aujourd'hui tous les obstacles liés à la méconnaissance de ce texte dans l'opinion publique, même ici dans notre assemblée, ainsi que, malheureusement, dans les milieux de la santé. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC et du groupe UMP.)

Vous devez, madame la ministre, faire en sorte que ce texte soit mieux connu et que l'observatoire, réclamé d'abord par Mme Morano, puis par Jean Leonetti dans le cadre de la mission qu'il a présidée, soit mis en place afin que nous puissions discuter de ces questions à partir d'éléments recueillis dans les hôpitaux et retraçant la réalité vécue par les uns et par les autres.
Une étape supplémentaire a été franchie avec les propositions de Jean Leonetti et je souhaite qu'elles soient rapidement concrétisées. Il y a fait allusion : il s'agit de préciser le rôle de la sédation à la fin d'un traitement. Cette précision était indispensable. Avec le droit d'interrompre le traitement et la précision donnée à la notion de sédation, il n'y aurait plus d'opposition entre les partisans de la liberté et les partisans d'un principe, entre les partisans du droit à mourir et ses adversaires. La frontière devient de plus en plus floue entre les solutions qu'il faut chercher et appliquer face à une situation terrible, personnelle, spécifique qui est celle du patient face à la mort, de la famille face au malade, au médecin et à la mort. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité signer cette proposition de loi, même si j'éprouve de la sympathie à son égard.
Il y a une seconde raison à ma position. J'ai déposé, de mon côté, une proposition de loi que j'ai signée seul, demandant la mise en place d'une exception d'euthanasie, c'est-à-dire visant à apporter une solution aux situations pour lesquelles la loi ne permet pas de trouver de solution humaine. En même temps, je n'arrive pas à me résigner, au-delà de l'approche progressive pour laquelle je plaide, à ce que notre approche ne soit pas consensuelle. Je n'arrive pas à imaginer que nous puissions voter un texte qui ne soit pas accepté par chacun d'entre nous, non comme une victoire ou comme une défaite, mais comme un progrès pour tous – je ne parle pas d'unanimité. Cette question de la fin de vie serait alors mieux traitée dans toutes les circonstances où nous avons à l'aborder.
Je remercie le groupe SRC de m'avoir permis d'intervenir dans ce débat, bien que j'exprime un point de vue légèrement différent. Mais la question qui nous est posée n'est pas celle de savoir ce qui doit, ou non, être fait au regard de nos principes. La question est de savoir si nous sommes en situation de voter un texte et de faire évoluer la loi afin qu'elle protège mieux le malade en garantissant mieux sa volonté, et qu'elle protège la société en défendant mieux les plus fragiles et les plus faibles. Nous ne pouvons régler la question de ce fameux droit à mourir sans avoir débattu, largement et sans polémique, de la situation des mineurs, des handicapés et des malades d'Alzheimer. Je ne peux aborder ces questions sans effroi, à la pensée que nous pourrions mettre en place un dispositif – et un droit –, sans savoir comment nous avons décidé d'aborder ces sujets et de régler les problèmes. Loin d'être un progrès humain, ce serait prendre le risque d'introduire un élément de barbarie, ce qui serait insupportable. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe SRC et sur les bancs du groupe UMP.)

La question qui nous est posée n'est pas de savoir si nous devons franchir la frontière, le Styx, si j'ose dire, mais de savoir comment nous pouvons aider nos congénères à appareiller. Nous savons tous que le mort est la règle qui s'appliquera à nous. Je considère que l'aide à mourir, dans ces conditions, doit rester l'exception. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe SRC et sur les bancs du groupe UMP.)

Il est difficile, en cinq minutes, de plaider de manière exhaustive la cause des soins palliatifs, ultime expression de la solidarité humaine devant la fin de vie.
Le sujet a fait l'objet de plusieurs années de travail parlementaire et trouve à mon sens sa meilleure traduction dans la loi de 2005 et ses prolongements récents dans l'évolution du code de déontologie médicale.
L'urgence, pour nous, est d'obtenir que l'état leur donne les moyens de s'exprimer pleinement et partout. C'est loin d'être le cas. C'est pourtant à cette exigence qu'il faut impérativement répondre,
Le 16 septembre 2008, devant la mission d'évaluation de la loi de 2005, Robert Badinter rappelait que « le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain » et « qu'il ne saurait en aucune manière se départir de ce principe ». Il ajoutait : « Donner la mort à autrui parce qu'il la réclame, je n'irai jamais dans cette direction ! » C'est aussi, à mon sens, ce que dit autrement le philosophe Lucien Sève, lorsqu'il écrit : « la libre volonté du sujet ne crée d'obligation éthique pour la collectivité que sous la condition d'être universalisable. »
Je partage totalement cette conviction et cette détermination, auxquelles font écho celles de nombreux autres philosophes, juristes, et de la plupart des médecins que nous avons entendus.
Pour ces mêmes raisons, je ne pourrai voter cette proposition de loi.
Je refuse d'inscrire dans notre droit que la mort puisse être rangée parmi les ultimes « thérapeutiques ».

La civilisation ne commence et n'avance que par les interdits qu'elle proclame et les limites qu'elle fixe. Celles-ci sont pour moi intransgressibles.
Nous savons tous ici qu'une dérogation admise risque toujours d'autoriser la suivante. C'est ce qu'exprime la sagesse populaire lorsqu'elle affirme que « lorsque les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites ».
On nous oppose souvent des législations étrangères, pourtant très minoritaires. Il faut en parler. Il faut rappeler, par exemple, ce que nous apprennent les publications internationales récentes sur les données hollandaises. Suzanne Rameix, professeur agrégée de philosophie, les rappelait devant notre mission lors de son audition du 7 mai 2008 : « Il y a aux Pays-Bas des euthanasies qui ne se font pas sous la forme légalisée ou dépénalisée de la loi. Les chiffres montrent des euthanasies sans demande du patient, au point qu'actuellement certaines personnes âgées portent sur elles un testament de vie dans lequel elles demandent explicitement qu'on ne pratique en aucun cas d'euthanasie sur elles ». Ou bien elles vont se faire soigner à l'étranger.
Les Hollandais commencent à s'interroger sur l'application de l'euthanasie aux enfants et, ce qui est plus délicat encore, aux malades mentaux.
Nous sommes tous ici fondamentalement animés par le même souci du respect de la personne humaine, de sa dignité et de sa liberté et c'est aussi pour cela que je voudrais convaincre qu'il est des libertés liberticides.
Dans leur exposé des motifs, nos collègues évoquent le souhait de personnes qui, ignorant Homère, pour qui le sommeil et la mort sont des frères jumeaux, refuseraient d'être plongées dans le coma bien qu'elles jugent insupportables leurs souffrances physiques ou psychiques. Mais faut-il que la loi s'adapte à la diversité des volontés individuelles ?
Le prolongement du droit liberté par le droit créance, autrement dit le passage du « droit de » au « droit à » que la société doit satisfaire, participe des avancées de civilisation. Ainsi en est-il du droit au traitement de la douleur ou du droit aux soins palliatifs. Mais faut-il reconnaître à l'acte d'euthanasie ce statut de droit créance, ici un droit créance partiel, puisqu'il ne vaudrait que pour les majeurs, et un droit à géométrie variable puisqu'il serait fonction du ressenti, forcément subjectif, de la personne ?

Comment, en effet, refuser au dépressif, au handicapé, au patient venant d'apprendre qu'il est atteint de telle ou telle pathologie irréversible au diagnostic vital, la possibilité de bénéficier d'un droit accordé à d'autres qui comme lui jugent insupportable leurs souffrances physiques ou psychiques ?
En ce domaine, comme en d'autres, je ne saurais me résoudre à séparer l'universel du particulier.
Je préfère une démarche qui, sans rien ôter par elle-même à la conflictualité du réel, s'efforce de faire vivre au singulier l'exigence d'universalité. Les soins palliatifs s'inscrivent dans cette démarche. Donnons-leur les moyens de se réaliser pleinement, partout. C'est urgent. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il s'agit d'un sujet extrêmement difficile. Je ne pense pas qu'il soit partisan, ni qu'il soit de droite ou de gauche. Je ne crois pas non plus qu'il relève d'une religiosité exacerbée ou d'un athéisme. Il nous interpelle tous, et personne n'a la vraie vérité.
Le mot « euthanasie » est d'ailleurs rempli d'ambiguïtés. Comme le disait un philosophe, les mots ont d'autant plus de sens qu'ils prêtent à contresens.
Euthanasie, est-ce le refus de l'acharnement thérapeutique ? Nous y sommes alors favorables, bien entendu. Comment voulez-vous qu'on accepte de poursuivre les soins quand un malade est en train de mourir, que la mort gagne, que la vie s'éteint, s'en va ? Nous avons maintenant l'obligation, mais faut-il parler d'obligation en médecine, nous avons le devoir d'éviter qu'il souffre, et nous avons depuis longtemps à notre disposition des produits qui permettent d'éviter la souffrance et qui se sophistiquent année après année, qu'il s'agisse de souffrance physique mais aussi de souffrance morale.
L'ambiguïté est là cependant car, lorsqu'on administre de tels produits alors que le corps s'en va, que la mort gagne, on est forcé d'en donner de plus en plus, ce qui va souvent hâter la mort. C'est toute la question de l'intentionnalité qui se pose alors, question fondamentale dans une société. Notre intention est bien de soulager, d'accompagner, car il serait indigne de ne pas accompagner, elle n'est pas de donner brutalement la mort. Ce n'est pas à nous, médecins, de la donner.

Dans les unités de soins palliatifs, et même ailleurs, nous devons absolument faire attention à ne pas accepter l'acharnement thérapeutique, mais est-ce entièrement vrai ? Quand Chris Barnard a changé le coeur d'un homme qui était en train de mourir, n'était-ce pas de l'acharnement thérapeutique ? Tous les progrès médicaux ne sont-ils pas quelque part un acharnement thérapeutique ? Rappelez-vous cet homme qui était en train de mourir d'un infarctus du myocarde et qui a été sauvé parce que quelqu'un a eu l'idée saugrenue de s'acharner et de lui mettre un stent. (Murmures sur les bancs du groupe SRC.)
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Non.

Pensez aux cancers. Il y a quelques années encore, quand un homme avait un cancer irrémédiable, peu importe lequel, on disait qu'il ne fallait pas s'acharner. Combien en guérit-on maintenant ?
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Cela n'a rien à voir.

Si, parce que, s'il faut refuser l'acharnement thérapeutique, il est parfois aussi source de progrès inouïs.
L'euthanasie, est-ce le suicide assisté ? Le suicide assisté, on l'a dit tout à l'heure très justement, c'est un peu en amont de l'acharnement thérapeutique, c'est quand le malade va encore bien et qu'on lui annonce la maladie. Je veux mourir, dit-il, mais cela pose encore certains problèmes. Quand, comment, pourquoi ? Le suicide est un droit, bien entendu, mais est-ce le devoir du médecin ? Non.
Vous avez tous donné une définition de la dignité, je voudrais vous en donner une autre, la mienne, peut-être n'est-elle pas bonne : la dignité, c'est le regard du bien-portant sur celui qui souffre.
On a parlé tout à l'heure de ces patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Sont-ils dignes, ne sont-ils pas dignes ?
Bien sûr qu'ils sont dignes !

C'est nous qui leur donnons leur dignité. Si un malade d'Alzheimer dit qu'il veut pouvoir mourir quand il sera indigne, qui va prendre la décision ? C'est nous, les bien-portants, qui regardons cet homme, cette femme, peut-être même paraplégique, peut-être même quadriplégique, peut-être handicapé moral, avec une forte dépression, qui demande à mourir dans la dignité. Sachons accueillir tous ces malades, et c'est la raison pour laquelle existent les unités de soins palliatifs.
Si j'avais été à la place de Mme Humbert, peut-être aurais-je eu le courage de faire la même chose, mais j'aurais certainement demandé à être jugé, pour être réinséré dans la société. Une société doit en effet avoir des repères. Si on les supprime, nous allons vers une anarchie éthique épouvantable.
Vous avez pris des exemples en Allemagne, en Hollande, en Belgique et dans d'autres pays. Ces exemples ne sont pas très bons car ils sont justement remis en question. De plus, faut-il absolument aller dans le sens du moins-disant éthique ? Ce n'est pas parce que l'Allemagne, la Hollande ou la Belgique ont pris une certaine position que nous sommes forcés de les imiter quand nous considérons en notre âme et conscience que ce n'est pas la meilleure réponse éthique. (Applaudissements sur de très nombreux bancs du groupe UMP.)

Le débat autour de cette proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité est, vous le savez, hautement polémique. Il l'est d'autant plus que, permettez-moi de le dire, l'appellation même de cette proposition de loi est parfaitement cynique.
En réalité, le débat est doublement tronqué dès le départ.
Il l'est tout d'abord sur les termes.
Certains parlent de fin de vie dans la dignité, d'autres de suicide assisté, d'autres encore d'aide active à mourir, d'autres, enfin, comme c'est le cas dans l'avant-dernier article de cette proposition de loi, d'euthanasie. Les barrières sont minces, et nous nous devons de sortir de ces définitions jésuitiques. Il s'agit clairement de permettre à un tiers d'administrer à un malade un produit qui mettra fin à ses jours. On peut appeler cela comme l'on veut, qu'il y ait accord ou non du malade, il s'agit bien d'une euthanasie. Il s'agit donc aujourd'hui de s'exprimer sur le principe, et nous n'avons pas le droit de leurrer les Français sur ce que sous-entend cette proposition de loi.
Il l'est aussi sur la dignité humaine, et c'est bien là le fond du sujet.
En conjuguant les termes de dignité et d'euthanasie, c'est une conception bien basse de l'être humain qui est ici défendue. Notre dignité et l'usage de notre liberté nous imposent au contraire de prendre en charge les patients qui souffrent pour qu'ils n'en viennent pas à souhaiter mourir. C'est cela que nous dicte la dignité de l'être humain. C'est cela qui nous distingue de l'espèce animale.
Mettre fin à la vie d'une personne souffrante a toujours été la limite éthique que les civilisations occidentales se sont interdit de franchir. C'est d'ailleurs toujours interdit en temps de guerre. Devons-nous aujourd'hui l'autoriser en temps de paix ? Dans notre société ? Au coeur de nos familles ? Je ne le crois pas. Ce serait même un signe inquiétant de l'état de notre société.
En réalité, accepter de bafouer ainsi la dignité humaine serait un triple échec.
Ce serait d'abord un échec législatif.
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie a été unanimement votée. Cette loi est adaptée aux situations concrètes. Elle permet de refuser, à raison, l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire le maintien artificiel de la vie qui ne donne qu'un sursis précaire et pénible pour le malade. Cette loi prévoit aussi un état des lieux et le développement des services de soins palliatifs, ce que réclame une grande majorité des Français, services sur lesquels il faut plus que jamais concentrer nos efforts. Accepter l'euthanasie reviendrait à aller en sens contraire des avancées qui ont été saluées par tous, et à créer de toutes pièces une grave incohérence législative.
Ce serait ensuite un échec médical.
La recherche médicale avance. Elle a besoin d'être soutenue et encouragée. Nous devons proposer aux malades non pas une solution pour mourir mais des remèdes pour guérir. Pour un grand nombre de maladies, considérées jusqu'à présent comme incurables, on trouve aujourd'hui des pistes encourageantes et parfois des moyens de guérison. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer la recherche médicale, de court-circuiter les avancées des chercheurs. Nous n'avons pas le droit de proposer une solution radicale sans avoir exploré toutes les autres solutions. L'euthanasie n'est pas le seul moyen d'échapper à l'acharnement thérapeutique. Les malades doivent pouvoir d'abord recevoir des soins appropriés.
Ce serait enfin un échec social.
Accepter l'euthanasie reviendrait à consacrer au rang de valeur suprême l'individualisme dont notre société souffre tant. Cela signifierait prendre acte que notre société est incapable de se mobiliser pour accompagner les malades jusqu'à leur mort naturelle. Ce serait surtout injuste pour toutes les associations et les milliers de bénévoles qui soutiennent au quotidien les malades et qui ont besoin que les pouvoirs publics les accompagnent.
Quel que soit le terme utilisé, l'euthanasie ou le suicide assisté est un drame. Au moment même où de nombreuses associations nous alertent sur le nombre grandissant des suicides, qu'avons-nous à proposer ? Une seule chose : réglementer cette mort brutale et délibérée. Bon nombre de malades qui demandent l'euthanasie changent d'ailleurs totalement de point de vue lorsqu'ils sont médicalement mais aussi humainement pris en charge. Il n'y a pas de solutions miracles, et certainement pas de solutions simplistes, contrairement à ce qu'insinue cette proposition de loi.
Je voudrais terminer en évoquant le comble du cynisme de ce texte, qui est de demander aux médecins de mettre la main à la pâte et, en réalité, de faire les basses besognes.
Ce que vous demandez là, mesdames, messieurs, est totalement contraire à l'esprit dans lequel les soins sont apportés aux hommes depuis l'Antiquité. C'est notamment totalement contraire au serment d'Hippocrate, qui impose aux médecins de ne pas provoquer la mort délibérément.
L'acharnement thérapeutique n'est pas une solution. L'euthanasie non plus.
En demandant à la représentation nationale de débattre sur cette proposition de loi, on ne fait qu'instrumentaliser des drames humains et les milliers de malades qui sont attachés à la vie. On se sert d'eux pour franchir de nouvelles portes, parmi lesquelles un nouveau droit pour eux, celui de mourir à la demande. Ce n'est pas ce que les Français attendent des élus de la République. Ce n'est certainement pas une proposition responsable, ni sur le fond ni sur la forme. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.)

Le 17 février dernier, nous adoptions, ici même, la proposition de loi de nos collègues Leonetti, Gorce, Jardé et Vaxès visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Si ce texte, qui n'est toujours pas examiné par le Sénat, apportera indéniablement un progrès quand il sera adopté, il ne réglera évidemment en rien la question de la fin de vie et du droit de mourir dans la dignité.
Et pourtant, depuis le décès en septembre 2003 de Vincent Humbert, les propositions de loi visant à la légalisation de l'aide active à mourir se sont multipliées, en provenance de tous les bancs et de toutes les familles politiques, témoignant de l'empathie de la représentation nationale pour toutes les personnes malades et leurs entourages qui souffrent.
C'est ainsi qu'avec mes collègues radicaux de gauche, après nous être longuement entretenus avec notre ancien collègue, également ancien président de l'ADMD, Henri Caillavet, nous avons déposé le 17 juin dernier une proposition de loi instaurant le droit de vivre sa mort, avant que nos collègues socialistes déposent le mois dernier la présente proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité. En dehors de quelques points de divergence, à commencer par leurs intitulés, ces deux textes sont très proches, et surtout ils poursuivent le même objectif : instituer le principe d'un droit à l'aide à mourir dans la dignité.
J'espère surtout qu'aujourd'hui nos collègues de la majorité, en tout cas un certain nombre d'entre eux, s'associeront à notre démarche et permettront l'adoption de cette proposition de loi. Car désormais notre société est prête, et il revient au législateur de prendre ses responsabilités. C'est au Parlement, et à lui seul, qu'il revient d'instaurer, au-delà des clivages politiques traditionnels, le droit de vivre sa mort. C'est une question d'éthique et, pour chacun d'entre nous, ni plus ni moins qu'une question de conscience.
Pour quelles raisons faudrait-il encore attendre ? Ces questions ne cessent de revenir avec acuité dans le débat public depuis plus de trente ans. Comme nous l'indiquions dans l'exposé des motifs de notre texte, la première proposition de loi sur le sujet date d'avril 1978 ; elle avait été déposée par le sénateur radical Caillavet. De même, le 15 novembre 1989, le député radical Bernard Charles déposait une proposition de loi tendant à rendre licite la déclaration de volonté de mourir dans la dignité.
Nous le savons tous, ce n'est qu'une question de temps, car un jour viendra où le Parlement légalisera et encadrera l'aide active à mourir. N'attendons pas d'y être contraints par l'actualité, mais sachons devancer la progression des attentes d'une société dont la position n'a cessé d'évoluer.
Pourquoi continuer de refuser de voir la réalité telle qu'elle est ? Aujourd'hui, en France, l'aide active à mourir est pratiquée dans une totale illégalité, et cette hypocrisie n'est plus acceptable. Le temps est désormais venu d'agir. Pourquoi ne pas franchir aujourd'hui le pas nécessaire pour autoriser l'aide active à mourir ? Pour nous, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un progrès social supplémentaire et d'un droit humain propre à une société civilisée et prétendument moderne. Face aux souffrances des malades et de leurs familles, le temps presse.
Comme la nôtre, la présente proposition de loi de nos collègues socialistes s'inspire des travaux de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Aussi est-elle de nature à apporter des solutions juridiques à la problématique éthique qui est posée, et donc à répondre le mieux possible aux souffrances des personnes pour lesquelles vivre est devenu insoutenable.
Dans le même temps, cette proposition de loi est relativement simple dans sa rédaction, comme du reste dans sa mise en oeuvre. Autant de raisons qui plaident en faveur de son adoption et préviennent toute objection technique de la part du Gouvernement pour nous expliquer savamment qu'il faut encore attendre.
Le texte qui nous est présenté aujourd'hui poursuit la logique de la loi du 22 avril 2005 qui a permis de mettre un terme à l'acharnement thérapeutique.
Il pose le principe d'un droit à l'aide active à mourir dans la dignité, avant d'en organiser la mise en oeuvre pratique. C'est ainsi qu'il prévoit les modalités de traitement collégial des demandes adressées au médecin traitant ainsi qu'un dispositif de directives anticipées, qu'il précise le droit à l'objection de conscience des professionnels de santé et qu'il intègre une formation sur les conditions de réalisation d'une euthanasie dans la formation des professionnels de santé.
De plus, le texte proposé met en place une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité, qui délègue à des commissions régionales le soin de vérifier si les exigences légales ont été respectées. Sur ce point, les radicaux de gauche souhaiteraient voir supprimer la référence à des commissions régionales. Au nom du principe de l'égalité républicaine, il nous semble impératif de maintenir une seule et unique commission, de fait nationale, en charge du contrôle.
Cette proposition de loi met également en avant un argument de justice sociale. Car il est difficilement possible d'accepter, dans notre pays et dans notre République, que l'aide active à mourir s'opère dans l'illégalité en France et en toute légalité à l'étranger, comme en Belgique et aux Pays-Bas, lorsque l'on possède les moyens financiers et les connaissances nécessaires.
De ce point de vue, ce débat sur la fin de vie en rappelle d'autres qui se sont tenus ici même, à cette tribune, il y a plus de trente ans et qui ont permis le droit à l'interruption volontaire de grossesse, que personne n'entend désormais remettre en cause dans l'hémicycle, du moins je l'espère.
Enfin, je rappellerai que le meilleur moyen d'éviter d'éventuelles dérives, c'est encore de légiférer. Ne rien faire, ne pas changer la loi ne signifie pas pour autant qu'aucune pratique d'euthanasie n'existe. Soyons responsables, assumons notre fonction de législateur.
Mes chers collègues, légaliser l'aide active à mourir, ce serait accéder à une demande lucide et réitérée de tous ceux qui ont sollicité et sollicitent, dans la souffrance, une assistance à mourir. C'est un principe de justice et d'humanité.
Je le répète : le compte à rebours a commencé. Ce n'est plus qu'une question de temps, mais pour beaucoup le temps presse. (Applaudissements sur de nombreux bancs des groupes SRC et GDR.)

Madame la ministre, mes chers collègues, le débat d'aujourd'hui repose sur une apparence et recèle une profonde réalité.
En apparence, il y a un consensus. Ce consensus, c'est le souci de respecter l'humanité de celui qui va mourir, c'est celui de la dignité.
La réalité du débat, c'est celle de la signification que l'on donne à ce mot de « dignité ». Au delà des meilleures intentions, deux conceptions opposées s'affrontent.
L'opposition se manifeste d'abord dans la démarche. Je me souviens de celle qui a caractérisé la mission conduite par Jean Leonetti et qui a débouché sur la loi du 22 avril 2005. Elle était guidée par une exceptionnelle volonté d'équilibre. Le temps passé, le nombre et la diversité des auditions, la qualité des informations, l'oubli des attaches partisanes dans les échanges laissent dans mon souvenir l'exemple de l'excellence d'un travail parlementaire. Nous avions pris en considération les deux confrontations qui nourrissent ce débat : celle des philosophies ou des croyances, bien sûr, mais aussi celle des évolutions scientifiques ou techniques face aux valeurs éthiques d'une société.
Cet équilibre a été pleinement réalisé par la loi de 2005, notamment en trouvant un juste milieu entre les deux écueils de l'acharnement thérapeutique et de l'aide active à la mort. Le rapport de la mission d'évaluation de décembre 2008 ne le remet pas en cause ; il déplore seulement les imperfections de sa mise en oeuvre.
Ce qui caractérise au contraire la démarche de la revendication en faveur de l'euthanasie, c'est la transgression, comme Mme la ministre le disait très justement tout à l'heure. Franchir « un nouveau pas », telle est la proposition qui nous est faite aujourd'hui.
Cette expression appelle deux remarques. D'abord, il faudrait montrer davantage d'esprit critique. Il ne suffit pas d'avancer, il faut aussi savoir dans quelle direction l'on avance. Ensuite, un nouveau pas, c'est parfois un pas de trop.
Apparemment, la revendication de l'euthanasie va dans le sens de l'histoire. Elle se présente comme la conquête d'un nouveau droit et peut donner à certains la satisfaction de faire tomber un tabou. Cette conception rectiligne de l'histoire est bien naïve. Il est évident que l'évolution de nos sociétés par rapport à la représentation de la mort est forte. Il n'est pas sûr qu'elle soit bonne.
Trois aspects la caractérisent. Tout d'abord, la mort est niée, elle se replie dans le temps et dans l'espace, elle se dépouille de ses symboles.
Ensuite, elle est sans doute la marque la plus forte de la « foule solitaire » que devient notre société. La mort est de moins en moins sociale, elle tend à enfermer chaque vie dans un destin strictement individuel.
Enfin, ce qui identifie nos sociétés, c'est le nivellement de tout relief spirituel. Certains pays sont effectivement les « plats pays » de la spiritualité. Ce n'est pas par hasard s'ils ont été parmi les premiers à légaliser l'euthanasie… (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
On peut au contraire penser à la manière de Durkheim, de Caillois ou encore de Mircea Eliade, indépendamment de toute croyance religieuse, que l'existence d'une frontière entre le sacré et le profane a joué un rôle essentiel dans la genèse de l'humanité. Celle-ci a commencé entre autres par le respect des morts. Le pas de trop consiste à oublier cette dimension du passage de la vie à la mort.
Mais la différence entre les deux conceptions qui s'opposent aujourd'hui repose aussi sur le rapport entre un homme et la société à laquelle il appartient. Un homme n'est jamais un individu, et encore moins un individu de trop. C'est une personne, que les autres personnes, celles des communautés auxquelles il appartient, ont construite au cours de son enfance, au cours de sa vie. Décider de sa propre mort, c'est rompre ce lien.
Le suicide, comme le montre encore Durkheim, est toujours l'expression d'un déséquilibre entre l'homme et la société, soit que la société exige trop de lui, par exemple qu'il se sacrifie, soit qu'il la refuse et veuille s'en délivrer. Choisir sa mort, c'est peut être s'estimer de trop pour les autres, c'est peut être s'estimer insuffisant face aux autres. Hannah Arendt souligne que le totalitarisme commence toujours quand on considère qu'un homme est de trop. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
C'est pourquoi la réponse la plus humaine consiste à accompagner celui qui va mourir le plus loin possible en lui évitant de souffrir. C'était le sens même de la loi que nous avons votée en 2005 ; il faut s'y tenir. Aller au delà, notamment en donnant droit à la souffrance psychique, subjective et sans limites définies, c'est ouvrir une voie dangereuse : celle de l'individualisme, comme l'a souligné Mme Besse, celle du matérialisme, une voie qui met en péril l'éthique médicale, qui tourne le dos au progrès des thérapeutiques, notamment celles propres à dominer la douleur, et enfin aux soins palliatifs qui sont l'une des plus belles expressions de la solidarité humaine.
Je tiens à dire que c'est grâce au travail conduit par Jean Leonetti que j'ai découvert les soins palliatifs.

J'ai découvert des hommes et des femmes extraordinaires. Je pense que c'est à ces hommes et à ces femmes qu'il faut donner les moyens de travailler, plutôt que de songer à voter une nouvelle loi qui ne sera pas sans dérives. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.)

Madame la ministre, mes chers collègues, il nous appartient aujourd'hui de statuer sur un sujet important et grave : comment offrir à tous une fin de vie dans le respect de la dignité humaine.
On l'a rappelé, des progrès ont été récemment réalisés dans notre pays. En particulier, la loi de 2005 offre à une grande partie des malades le choix du stade où l'arrêt des thérapeutiques agressives apparaît opportun. Arrêt de l'acharnement thérapeutique, dispensation améliorée des soins palliatifs, traitements antidouleur : cet arsenal apporte des solutions à de nombreux cas et, d'ailleurs, la loi de 2005 a été votée ici à l'unanimité.
Il reste cependant des circonstances sans solution satisfaisante. Certes, avec le bénéfice des mesures mises en place depuis 2005, on estime que seulement 1 500 à 3 000 malades en France se trouvent chaque année sans solution acceptable. Mais même s'ils n'étaient pas plus de mille, ce serait bien sûr mille patients de trop.
La vérité, c'est qu'ils ne sont pas tous sans solution. Les mieux nantis trouvent l'aide médicale permettant d'abréger leur calvaire soit en France, en catimini, soit à l'étranger, selon des procédures qui sont alors légales. Il s'agit bien d'un calvaire.
Si, dans près de 80 % des cas, les douleurs physiques sont bien calmées, il reste des insuffisances de correction des souffrances chez 20 à 25 % des patients. Surtout, la souffrance morale ne peut pas être levée, sauf à mettre le malade dans un état comateux.
Est-il digne de maintenir cette hypocrisie ? Sur le plan légal, on interdit l'organisation de la fin de vie désirée, souhaitée, espérée, tandis que, sur le plan pratique, on la laisse se réaliser, et que cette pratique est effectuée dans presque tous les hôpitaux de France.
Tous les médecins hospitaliers travaillant dans des services qui accueillent des pathologies graves vous le diront : chaque année, de tels cas se présentent et des solutions sont apportées pour abréger des souffrances physiques et psychiques. Mais peut-on alors affirmer dans tous les cas que le malade a donné son avis, qu'un collège de médecins et qu'une commission ont protégé le patient ?
Finissons-en avec cette hypocrisie. N'acceptons plus qu'en prétendant calmer la douleur, l'on administre en cachette des doses létales de sédatifs, sans aucun contrôle. À l'euthanasie actuellement pratiquée dans l'illégalité, substituons le choix offert d'une fin de vie encadrée par des règles, qui évite des disparités intolérables et, paradoxalement, représente une protection pour le malade.

Organiser décemment une possibilité de fin de vie dans la dignité devient inéluctable. Selon les sondages, 75 % à 86 % des Français attendent ce progrès. Pourquoi le retarder encore ?
Il ne s'agit pas d'avoir une vision pessimiste de l'homme ou de la vie comme l'exprimait Montaigne lorsqu'il qualifiait la mort « d'unique port des tourments de cette vie » mais, au contraire, d'élever notre idée de la dignité humaine et de la liberté. Il ne s'agit pas non plus d'opposer l'éthique de la vulnérabilité à l'éthique de l'autonomie. Il n'est en effet pas question de forcer quiconque à subir ou à participer à cette fin de vie organisée. Il importe seulement de respecter le libre choix de chacun.

Il importe de ne pas accepter de se voir imposer le choix de ceux ayant une philosophie différente. Dans une république laïque, la loi ne peut imposer à qui que ce soit de se soumettre aux convictions philosophiques d'un autre. Une telle proposition de loi doit donc garantir la liberté de choix. Cela est d'autant plus important qu'elle renvoie à l'idée que nous nous faisons de la dignité humaine. Après Manuel Valls, je rappelle notre devise républicaine : « Liberté, égalité fraternité ». Il s'agit donc de la liberté de choix, de l'égalité d'accès à une fin de vie digne, non limitée à ceux qui peuvent bénéficier du recours à un médecin complaisant ou se rendre dans un pays voisin, et de la fraternité, qui nous impose de ne pas laisser dans le désarroi un malade, une famille, une équipe soignante.
Le texte qui vous est proposé est très nuancé, l'encadrement des modalités de fin de vie très strict, les contrôles bien prévus. C'est une garantie pour les malades : il s'agit d'assurer un meilleur respect des voeux dûment exprimés par les intéressés.
Mes chers collègues, y compris ceux de la majorité, ce débat n'autorise aucune consigne de vote. Chacun doit s'exprimer en son âme et conscience. Chacun est sous le regard des Français, qui aspirent très majoritairement à ce progrès de nos droits et de nos libertés. Ne les décevons pas. Ayons le courage de manifester notre confiance en l'homme ! (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder une question extrêmement délicate : la fin de vie, la souffrance, la dignité humaine. « La complexité du sujet impose d'avancer avec précaution », disait notre collègue Jean-Frédéric Poisson il y a quelques jours. Par le passé, des cas ont défrayé la chronique – je pense à l'affaire Humbert ou à celle de Chantal Sébire – et ont interpellé l'opinion publique sur la fin de vie et sur l'euthanasie. Mais faut-il à nouveau légiférer en ce domaine ?

Je ne le pense pas. Faire la loi à partir d'une émotion collective, même justifiée, née d'une situation extraordinaire, ne me paraît pas devoir relever du législateur.
Il nous faut bien mesurer toutes les conséquences du texte que nous examinons. Contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs, ce texte ne propose pas simplement de franchir un pas supplémentaire dans l'accompagnement, iI remet tout bonnement en cause la philosophie de la loi de 2005 en instaurant un véritable droit à la mort, condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Si cette proposition de loi soulève une vraie question, celle de l'accompagnement de la fin de vie, elle y apporte, à mon sens, une mauvaise réponse en proposant ni plus ni moins une légalisation de l'euthanasie dans notre pays. La porte qui serait ainsi ouverte me semble dangereuse sur le plan éthique, moral et philosophique.
Les dispositions de la loi du 22 avril 2005, complétées par le décret en Conseil d'État sur la sédation d'accompagnement, permettent déjà de prendre en compte l'ensemble des situations de fin de vie en proscrivant l'obstination déraisonnable, en autorisant l'arrêt de traitement, y compris au risque de raccourcir la vie, et en mettant en place une sédation d'accompagnement encadrée. Cette loi, adoptée, je le rappelle, à l'unanimité à l'Assemblée nationale, a permis de trouver un point d'équilibre entre les différentes sensibilités sur ce sujet. Demain, l'autorisation de l'assistance médicalisée pour mourir dans la dignité permettrait-elle au malade d'échapper à l'acharnement thérapeutique et de ne pas subir des souffrances intolérables ? Serait-ce la garantie d'une mort plus douce ? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, le cadre législatif permet déjà de refuser à la fois l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, et de continuer à être soigné avec attention ; aujourd'hui, la médecine permet de prodiguer des soins anti-douleur de plus en plus adaptés, que l'on peut régulièrement réajuster. Au passage, je rappelle que des efforts réels en matière de soins palliatifs sont consentis. Le Président de la République a annoncé, le 13 juin 2008, la mise en place d'un programme de développement des soins palliatifs de 2008 à 2012, programme qui a pour ambition de doubler le nombre de personnes en bénéficiant : 230 millions d'euros supplémentaires seront consacrés aux soins palliatifs entre 2008 et 2012, soit environ 46 millions d'euros par an.
Enfin, je ne suis pas convaincu que l'euthanasie soit la certitude d'une mort douce car administrer une injection létale à un patient peut entraîner une mort brutale, parfois très pénible. Ce point nous interpelle sur la responsabilité des médecins : quid du serment d'Hippocrate et du code de déontologie médicale qui interdit à un médecin de provoquer délibérément la mort ?
Vous le voyez, mes chers collègues, le texte qui nous est proposé pose plus de questions qu'il n'en résout. Le sujet, cela a été rappelé en commission, est délicat et nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. Je suis absolument d'accord pour le refus de l'acharnement thérapeutique, pour l'amélioration et le développement des soins palliatifs, pour assurer la dignité jusqu'à la mort dans le respect des volontés du malade dûment informé. À cet égard, la mission d'évaluation de la loi du 22 avril 2005, conduite par notre collègue Jean Leonetti, formule une série de propositions pour améliorer encore l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je m'en réjouis. Ces recommandations, dont certaines sont déjà en cours de mise en oeuvre, tel le congé d'accompagnement de la fin de vie – adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 17 février dernier –, permettront encore d'améliorer l'accompagnement de la fin de vie, en particulier dans les situations les plus complexes.
L'instauration d'une aide active à mourir, je le répète, me paraît dangereuse. On croit savoir où cela commence, on ne sait pas, par contre, où cela doit s'arrêter ! Aussi, vous le comprendrez, je suis hostile à l'aide active à mourir et ne voterai pas le texte qui nous est proposé. La tonalité de nos débats démontre, comme je l'ai déjà dit en commission, tout à la fois la réalité de cette question de société et la nécessité du respect des opinions de chacun pour la réalisation de tout progrès dans ce domaine. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes invités à légiférer sur une proposition de loi dont nous savons bien qu'elle porte sur un sujet qui provoque beaucoup de passion. Je regrette que trop souvent les propos des uns et des autres soient dénaturés, accompagnés parfois de postures hypocrites, enfermés souvent dans de faux débats. La question qui nous est posée n'est pas celle de donner la mort, mais celle de l'accompagnement en fin de vie, de l'aide à mourir, comme en d'autres circonstances on peut aider à naître. J'ai exercé la profession de sage-femme pendant toute ma carrière professionnelle, j'ai été passeuse de vie ; cela m'a permis de mesurer l'importance des rites d'accompagnement que notre société doit organiser dans ces moments de passage que sont la naissance et la mort. Nous touchons alors à la substance essentielle de la nature humaine et je comprends que cela fasse peur à certains d'entre nous. Mais notre responsabilité de législateur est de nous emparer de ces questions qui traversent notre société, et d'apporter des réponses à ceux qui nous les demandent.
Pendant mes études, j'ai assisté, impuissante, au décès d'une jeune femme de mon âge, victime d'un avortement clandestin. La loi Veil n'avait pas encore été votée. Je suis frappée de voir combien les arguments avancés aujourd'hui par certains contre l'aide à mourir ressemblent à s'y méprendre aux arguments donnés par d'autres, en leur temps, contre la loi sur l'avortement (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR) : la sacralité de la vie, l'interdit du meurtre, la dignité humaine. Doit-on alors considérer que les pays qui ont accordé à leurs citoyens le droit à l'euthanasie sont des pays barbares ignorant le sens de la vie humaine, promouvant le meurtre à grande échelle et écrasant du pied la dignité de l'homme ? La législation de ces pays, je le rappelle, a été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

N'y a-t-il pas une autre sorte de barbarie à laisser mourir ou à poursuivre l'acharnement thérapeutique – pourtant interdit par la loi – sans répondre aux demandes de ces malades qui, en toute conscience, veulent partir dans la dignité ? Pas plus que la loi sur l'avortement, cette proposition de loi ne remet en cause les fondements républicains de notre démocratie. Bien au contraire, elle vise à donner un cadre légal à des pratiques que de nombreux soignants avouent connaître et que les tribunaux jugent parfois avec bienveillance.
Il s'agit bien d'une loi républicaine car c'est une loi de liberté : le droit de finir sa vie dans la dignité est une des dernières libertés fondamentales que nous avons à conquérir. Il est de notre responsabilité d'accorder le droit de pouvoir choisir sa mort parce qu'il ne sert à rien d'honorer la vie si nous sommes incapables de donner à l'être humain les moyens de maîtriser la sienne jusqu'au bout. (Applaudissements sur de nombreux bancs des groupes SRC et GDR.)

Le rôle des médecins est indispensable, mais nous ne devons pas les laisser seuls face à ces situations. Cette proposition de loi permettra de donner un cadre légal à ceux qui accepteront cet accompagnement tout en créant un nouveau droit pour les citoyens. Il s'agit de permettre à chacun d'exercer sa liberté individuelle ; pour les malades, ce serait le choix de finir sa vie dans la dignité, pour les médecins, celui d'accepter ou de refuser l'aide active à mourir.
C'est aussi une loi d'égalité. On ne peut pas accepter qu'il y ait dans notre pays une mort à deux vitesses. Certains ont les moyens de choisir la clinique ou le pays, ou encore connaissent des médecins, alors que des millions d'autres, sans moyens et sans relations, ne sont pas maîtres de leur mort.
Il s'agit en outre d'une loi de fraternité car, à l'inverse de la mort solitaire que nos concitoyens connaissent bien souvent, elle peut faciliter l'accompagnement, les derniers échanges, dans le respect de la vie qui s'en va.
En conclusion, je veux, mes chers collègues, vous inviter sur ce sujet important à éviter toute caricature : n'opposons pas euthanasie et soins palliatifs. Les deux sont indispensables pour garantir à chacun, selon son choix, une fin de vie dans la dignité ! Nous sortirions grandis de cette séance si, tout en votant cette loi, nous déclarions le développement des soins palliatifs comme une grande cause nationale. Je vous invite également à dépasser nos clivages partisans pour que nous puissions nous rassembler sur ce sujet de société. Une très large majorité de nos concitoyens le souhaitent, quels que soient leurs choix politiques, religieux ou philosophiques. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la loi de 2005 a réaffirmé un principe : celui de la différence essentielle entre l'arrêt des soins donnés à un patient dont la mort est prochaine, et l'acte qui consiste à provoquer sa mort directement. Eu égard à ce principe, cette loi fut un point d'aboutissement. Elle marque une limite infranchissable,…

…au-delà de laquelle on changerait de monde, de conception du droit et de la médecine, en légalisant l'homicide, réalité que l'on tente parfois d'adoucir en employant l'expression « suicide assisté ».
À la question du philosophe Alain Badiou qui se demandait : « Quand et comment, au nom de notre idée du bonheur, peut-on tuer quelqu'un ? », la loi de 2005 répondait : « Jamais ». Pas par méchanceté ni par ignorance, ni par souci de se référer à quelque transcendance que ce soit, mais par souci de ne jamais conduire quiconque à déclarer à autrui : « Ta vie actuelle ne vaut pas la peine d'être vécue. »
À cette même question, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui répond : on peut, effectivement, décider de tuer quelqu'un légalement à la demande du patient et sous condition. (Protestations sur de nombreux bancs du groupe SRC.)

C'est peu dire que ces deux positions sont incompatibles, parce qu'elles sont parfaitement contradictoires.
Il faut appeler les choses par leur nom, monsieur Terrasse !

Certains collègues expliquent que le vote unanime de 2005 contenait en fait la présente proposition de loi, qu'elle ne pouvait être considérée que comme un point de départ et non pas comme un aboutissement.
Cette lecture me paraît hasardeuse pour deux raisons. D'abord, l'intention majoritaire du législateur de 2005 n'était pas d'aller au-delà du texte voté. Ensuite, il existe une différence de principe entre l'accompagnement de la fin de vie et la suppression de cette même vie. S'il fallait aller au-delà de cette limite, on n'irait pas plus loin, mais ailleurs, comme je l'ai indiqué en commission, monsieur le rapporteur.
C'est pourquoi cette proposition de loi pose divers problèmes que je vais brièvement examiner. D'abord, deux conceptions de la dignité sont à l'oeuvre, comme vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur : certains pensent que la dignité est assise de manière définitive, inamissible, sans condition ni restriction ; d'autres considèrent qu'elle pourrait être fluctuante en raison des circonstances de la vie.
Notre rapporteur a développé les inconvénients de la première conception, celle d'une dignité acquise une fois pour toutes. Pour ma part, je vous invite à réfléchir aux inconvénients de la seconde. Où se trouvent les garanties d'un système de droit dans lequel on présuppose que la dignité peut-être soumise à fluctuation ? Dans un système de droit positif, si l'on n'accepte pas le caractère inamissible de la dignité, cette garantie n'existe plus beaucoup.
Dans son intervention, Mme la ministre posait la question : que devient un corpus législatif dans lequel on introduit ce droit de supprimer la vie d'autrui ?

Ce n'est pas le droit de supprimer la vie ! Nous ne nous sommes pas compris !

Je suis désolé que cela vous choque, mais il faut appeler les choses par leur nom, mes chers collègues. (Exclamations sur de nombreux bancs du groupe SRC.)

Quelle vision de l'homme propage-t-on lorsqu'on établit implicitement une hiérarchie entre les vies qui valent la peine d'être vécues et celles qui ne le valent pas ? Ce sont des questions qui méritent d'être posées.
Enfin, la notion de dignité soulève une difficulté juridique. En effet, cette notion est inscrite dans le bloc de constitutionnalité depuis la décision de 1994 sur la loi de bioéthique. Notre droit – dans beaucoup de ses codes – contient un principe qui a presque valeur de principe général : personne ne peut renoncer au droit qui est le sien.
Cela vaut en droit du commerce ou en droit du travail où même la volonté de celui qui est sujet de droit ne peut pas conduire à ce qu'il en soit départi, quand bien même il l'exprimerait de manière consentie, éclairée, libre, et sans subir aucune forme de pression.
En définitive, cette philosophie fonde notre corpus de droit.
C'est très important !

De ce fait, il est très difficile d'aller à l'encontre de l'affirmation du maintien du droit des personnes à mourir dans la dignité, c'est-à-dire à être accompagnées jusqu'à la fin de leurs jours, dans le système prévu par la loi actuelle, et sans aucune espèce de modification.
Mes chers collègues, maintenir ce choix de la loi de 2005 constituerait un renforcement de l'inspiration hippocratique de notre droit, ce qui me paraît absolument essentiel : c'est ce qui fonde à la fois la philosophie de notre droit, le droit de la loi de 2005, le code de déontologie et la propagation des soins palliatifs sur notre territoire.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, je pense qu'il ne faut pas adopter cette proposition de loi. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le débat que nous abordons à l'occasion de l'examen de la proposition de loi du groupe socialiste, relative au droit de finir sa vie dans la dignité, est particulièrement sensible puisqu'il touche à ce que nous avons de plus précieux, la vie, et au passage de la vie vers la mort.
La mort est inéluctable ; elle n'épargne aucun être vivant ; elle est un fait biologique, mais aussi culturel et social. Chaque peuple, en fonction de ses croyances et de son imaginaire collectif abordera le sujet de la mort de manière différente.
Il ne fait désormais aucun doute que les hommes de Lascaux, de Chauvet ou d'Altamira se sont interrogés sur la mort…

…et que les chefs-d'oeuvre de l'art pariétal ont un rapport à des rites funéraires.
Les philosophes de l'antiquité se sont également interrogés. Loin de rejeter la mort comme un véritable tabou, le monde antique la voyait comme une partie de la vie elle-même. Dans ses Pensées, Marc Aurèle se dit à lui-même : « C'est en effet une des actions de ta vie que le fait de mourir. »
Plus tard, l'Ars moriendi – l'art du décès, du bien mourir – fut parmi les premiers livres imprimés et les plus largement diffusés. L'Ars moriendi nous proposait de nous aider à bien mourir, selon les conceptions chrétiennes, à la fin du Moyen Âge.
Plus près de nous, Edgar Morin, dans L'Homme et la mort, nous invite à réapprendre à « convivre » avec la mort. Selon lui, la mort s'est incrustée dans le tissu même de l'être humain, de son esprit, de son passé, de son futur et de son environnement. Cette observation renoue avec les racines antiques : la vie et la mort sont des associées inséparables. La mort fait partie de la vie ; l'acte de mourir est l'acte d'un vivant.
Mes chers collègues, nous voici au coeur du sujet qui nous préoccupe ce matin. L'acte de mourir étant l'oeuvre d'un vivant, quels sont les droits d'un vivant à choisir sa mort ?
Dans notre pays, chaque année, plusieurs milliers de personnes décident de se donner la mort, le plus souvent dans des conditions brutales, atroces. Le texte que nous examinons ne prétend pas apporter une aide au suicide, même si la question reste posée et si l'on peut s'interroger sur le fait que, si cette aide existait, elle serait peut-être le premier élément de prise en charge des personnes dépressives et donc de la prévention du suicide.
Le texte que nous examinons porte sur la fin de vie et sur le droit pour chacun de choisir sa mort et d'obtenir une aide active à mourir. La Belgique et aux Pays-Bas – qui ne sont pas les plats pays de la spiritualité, contrairement à ce qu'a affirmé un précédent orateur – reconnaissent le droit de l'aide active à mourir et ont dépénalisé l'euthanasie. Établir ce droit dans notre pays est l'objet de la proposition de loi que j'ai déposée en juillet 2009, comme c'est l'objet de la présente proposition du groupe socialiste.
On nous rétorque que la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, et la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur la fin de vie, adoptée à l'unanimité, ont apporté des réponses. C'est vrai que la légalisation de la possibilité de faire cesser l'acharnement thérapeutique et la création pour le malade du droit de demander l'arrêt des soins constituent des avancées importantes.
Mais il nous faut convenir qu'à ce jour, la législation française ne répond pas à la demande de nos concitoyens, de plus en plus nombreux, qui réclament le droit de choisir leur mort et d'être assistés médicalement.
Même s'ils sont douloureux, ce ne sont pas les cas médiatisés qui doivent guider nos pas. J'en suis d'accord. C'est parce que la vie est sacrée, mes chers collègues, que nous avons le devoir de la respecter jusqu'au bout, y compris dans la décision de chacun d'en choisir la fin, donc de choisir sa mort. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, intervenant la dernière – certainement par le fait du hasard –, je me trouve dans la position – pas inédite en cet hémicycle, vous en conviendrez, madame la ministre – d'assumer une conviction différente de celle qui vient d'être exprimée par les collègues de mon groupe politique.
Cela arrive aussi à d'autres !

En effet, je soutiens la proposition de loi relative au droit de mourir dans la dignité, inscrite à l'ordre du jour à l'initiative d'un bon nombre de nos collègues socialistes.
Cette proposition de loi s'inscrit dans une réflexion sociétale, partagée bien au-delà des convictions politiques, religieuses et philosophiques des parlementaires et des citoyens que nous représentons en ce lieu. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe SRC.)
Pour ma part, en 2004, j'ai déposé une proposition de loi intitulée « Aide à la délivrance volontaire en fin de vie ». Puis, en 2008, j'en ai déposé une autre, quasiment identique mais intitulée : « Pour une aide active à mourir », cosignée par vingt-cinq de mes collègues de la majorité UMP.
Aujourd'hui, j'assume clairement ma réponse à la question posée : le choix de la mort douce, autrement dit de l'euthanasie.
La conscience éclairée de tout homme responsable de sa vie le conduit inéluctablement à réfléchir à sa propre mort. Ainsi que l'écrivait le philosophe Jankélévitch : « Si la mort n'est pensable ni avant, ni pendant, ni après, quand pourrons-nous la penser ? »
Consciente de la gravité de la question et respectueuse des choix individuels, j'exprime la volonté d'une immense majorité de Français – 85 % – et d'une large majorité de médecins généralistes – 65 % – qui sont favorables à une aide active à mourir.
Je ne vois pas pourquoi des sondages fiables, répétés sur plusieurs années, donnant toujours les mêmes résultats, ne seraient pas dignes du même intérêt que d'autres comme reflets de l'opinion française. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe SRC.)
De quoi s'agit-il vraiment ? J'entends dire que nous revendiquerions le droit de mourir. La belle affaire ! Point n'est besoin de revendiquer ce droit inhérent à notre propre naissance et à notre propre vie, car nous avons une certitude : nul n'échappera à la mort !

On me rétorque alors que revendiquer le droit de mourir dans la dignité constituerait un jugement de valeur sur la dignité d'autrui.

Allons donc ! Chacun d'entre nous n'est-il pas suffisamment responsable de sa vie, mon cher collègue, pour avoir une idée des limites qu'il ne veut pas atteindre, au-delà desquelles il ne souhaite pas aller parce qu'il les considère comme contraire à l'idée qu'il se fait de sa propre dignité ? (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe SRC.)

C'est notre droit le plus strict ! En quoi les règles que chacun définit pour sa propre vie seraient-elles maintenant un jugement de valeur sur la vie d'autrui ?

On me dit : vous voulez instaurer le suicide assisté, et si une personne dépressive ou malade demande à mourir, vous allez l'aider au lieu de la soigner.
Mais regardons le texte proposé ! Il s'agit d'aider à mourir une personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection dont le caractère grave et incurable a été dûment attesté par le corps médical.
Enfin, avec hypocrisie, l'on m'explique qu'un médecin ne peut donner la mort, alors que beaucoup d'entre eux avouent pourtant le faire…

…et que cela est désormais autorisé – mais à condition de ne pas le dire – par la loi de 2005 que j'ai approuvée et qui ne manque pas de mérites mais qui reconnaît le double effet des sédatifs.
Ainsi, le médecin qui calme la douleur en sachant qu'il va hâter la mort ne donne pas la mort.

Officiellement, il ne donne pas la mort ; en réalité, il sait très bien qu'il le fait. Quelle ambiguïté, quelle hypocrisie !

De même, lorsque le médecin arrête les soins à la demande du malade – si tant est qu'il connaisse et respecte la loi –, il prescrit un sédatif et laisse le malade à sa lente agonie. Il laisse mourir, il ne fait pas mourir. C'est l'euthanasie passive que nous avons introduite dans la législation.
Que dire de ceux qui avouent ne pas avoir besoin d'une loi car, au moment extrême, pour un proche ou pour eux-mêmes, l'entourage trouvera toujours une solution ?
Enfin, j'entends dire que les soins palliatifs seraient la seule réponse à toutes les demandes. Je soutiens la création de soins palliatifs, qui sont indispensables mais pas assez nombreux. Mais s'ils étaient la seule réponse, pourquoi l'enquête conduite au Canada dans des services de soins palliatifs, 63 % des malades demanderaient-ils qu'on les aide à mourir ?
Oui, il faut légiférer pour légaliser l'euthanasie, en modifiant simplement le code de la santé publique pour y préciser les conditions très strictes dans lesquelles un tel acte peut intervenir.
En effet, l'article L. 122-4 du code pénal indique : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte […] autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »
Nous n'avons pas procédé autrement pour légaliser l'euthanasie passive dans le cadre de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Il convient maintenant de faire de même pour l'euthanasie active.
Mes chers collègues, il s'agit de voter une loi qui permettrait à ceux qui le veulent de recourir à l'euthanasie, et qui protégeraient ceux qui ne le veulent pas ! Car, en encadrant les pratiques, on éviterait les abus : ce serait une loi pour respecter la volonté des malades.
Il s'agit, dans l'esprit laïc qui seul prévaut dans ce haut lieu de la démocratie où nous avons l'honneur de représenter nos concitoyens, de respecter – comme le dit très bien mon ami Jean-Luc Romero, que je salue, président de l'ADMD – les valeurs qui fondent notre pacte républicain : la liberté pour ce choix ultime propre à chacun d'entre nous ; l'égalité pour gommer les différences sociales devant la mort ; la fraternité pour prendre en compte la vraie souffrance d'autrui, qu'elle soit physique ou morale.

Forte de cette conviction qui est au coeur de mon combat pour l'homme, je voterai à titre personnel la proposition de loi qui nous est soumise, en remerciant le groupe UMP et son président, Jean-François Copé, d'avoir compris que ce vote relève de la conscience de chacun d'entre nous – même si je me sens un peu seule à exercer cette liberté. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)

Je voudrais d'abord remercier mes amis et collègues du groupe socialiste Danièle Hoffman-Rispal, Marie-Odile Bouillé, Jean-Louis Touraine et Germinal Peiro qui ont apporté des arguments forts et des témoignages indispensables. Je voudrais dire aussi combien Jacques Desallangre a eu raison de rappeler son travail sur le droit des malades, les soins palliatifs, et la fin de vie – donc aussi l'euthanasie. Dominique Orliac a eu raison de rappeler le combat d'Henri Caillavet, qui éclaire nos débats. Je voudrais dire également combien cette discussion – nous venons de le voir – traverse, peut-être moins d'ailleurs qu'il y a quelques années, tous les groupes. Ce ne sont pas les clivages politiques traditionnels qui se dessinent : les interventions d'Henriette Martinez, de Gaëtan Gorce et de Michel Vaxès l'ont bien montré.
Je voudrais répondre à quelques arguments, même si nous aurons aussi l'occasion de débattre des articles.
Madame la ministre, vous dites qu'on ne saurait admettre l'idée de donner la mort pour des raisons éthiques ou juridiques – j'imagine que vous y reviendrez dans un instant. Mais cela s'oppose à la prise en compte de certaines situations de souffrance, admises par la loi de 2005.
Une étude publiée en 1999 estime que 20 % des décisions de limitations ou d'arrêts de traitements actifs sont des « injections avec intentionnalité de décès ». Vous reconnaissez vous-même, madame la ministre, les équivoques du laisser-mourir : l'affaire Eluana Englaro a montré que la pratique d'un arrêt de traitement impliquait l'arrêt de l'alimentation. Cet acte, qui relèverait en France de la loi de 2005, a été dénoncé comme une inacceptable euthanasie.
Madame la ministre, monsieur Leonetti, vous rejetez l'argument de l'hypocrisie ; mais vous ne dites rien de l'hypocrisie, qui vient d'être rappelée, de la loi de 2005 elle-même.

Or cette hypocrisie est particulièrement inacceptable. Vous voulez limiter le débat à la question de la douleur : pour vous, c'est la douleur qu'il faut supprimer, et pas la vie. Or, la demande des malades n'est pas toujours de mourir sans douleur ; elle peut être aussi de mourir en conscience. L'euthanasie le permet.
Vous dites que l'autonomie de l'individu suppose la réversibilité de ses choix, que les malades changent souvent d'avis, suivant la fluctuation de la maladie. C'est pourquoi la proposition de loi prévoit la vérification de la volonté et la possibilité de révoquer à tout moment la demande.
M. Leonetti annonce qu'une mesure réglementaire rendra obligatoire dans certains cas les sédations terminales. C'est bien, comme l'a d'ailleurs dit Gaëtan Gorce, que la frontière entre « laisser mourir » et « faire mourir » est définitivement abolie : c'est la loi votée par tous en 2005, monsieur Leonetti, qui permet aujourd'hui ce débat ; c'est la raison pour laquelle, même s'il y a débat, même s'il y a confrontation, notre proposition de loi fait un pas supplémentaire.
Monsieur Leonetti, vous avez dit être heureux de constater l'accord sur la nécessité de poser le sujet hors de toute polémique – je regrette, d'ailleurs, que Mme Besse et M. Vanneste n'aient pas suivi cette direction.

Il n'y avait pas de polémique dans mon propos, mais une confrontation d'idées !

On ne peut que partager l'objectif, votre objectif, de n'abandonner personne face à la souffrance. C'est aussi, évidemment, la perspective de cette proposition de loi.
Vous reconnaissez que la loi de 2005 a été provoquée par l'existence de nombreuses pratiques d'arrêt ou de limitation de traitement. Pourquoi alors prétendre que le désaccord porte, non sur les situations de fin de vie, mais sur les maladies en général ? La proposition de loi écarte délibérément la situation des malades chroniques végétatifs : l'insinuer, c'est tenter un amalgame.

Il est nécessaire, dans un débat sur ces questions, d'être honnête intellectuellement. (Approbations sur les bancs du groupe SRC.)

C'est ce que nous avons fait, je crois, tout au long de cette discussion, en commission comme en séance.
Monsieur Vaxès, vous évoquez les dérives constatées à l'étranger ; Mme Martinez vous répondait, en quelque sorte, à propos du Canada. Il faut se garder de toute vision caricaturale : si des difficultés existent dans d'autres pays, avec d'autres législations – et cela peut aussi être le cas en France – il faut bien sûr les traiter.
Mais de très nombreux éléments de bilan des pratiques étrangères, que j'ai repris dans mon rapport, montrent au contraire que les pratiques illégales sont très rares. En tout cas, toutes ces évolutions ne s'opposent pas au développement des soins palliatifs – Mmes Martinez et Bouillé l'ont longuement souligné.

Au contraire, elles les accompagnent ! Aux Pays-Bas, les soins palliatifs font partie intégrante des soins réguliers – les cultures sont évidemment différentes, mais les Pays-Bas, qui ont été brocardés, c'est aussi le pays d'Érasme ! Cela peut nous inspirer : les droits sont différents, mais enfin il faut aussi regarder ce qui se passe dans d'autres pays, au lieu de donner en permanence des leçons sur la capacité que nous aurions à répondre à des situations qui existent partout : aux Pays-Bas comme en France, un homme est un homme et il est confronté, ici comme là-bas, à la mort !
Dès les années 1990, dans ce pays, a été lancé un programme de stimulation dans le but de promouvoir la recherche sur les soins palliatifs, ainsi que la formation et la diffusion. En Belgique, le projet de déclaration de politique générale wallonne, établi en juillet 2009 pour la période allant de 2009 à 2014, laisse une très large part au développement de la culture palliative. En outre, une récente étude publiée par le British Medical Journal montre, à partir d'études menées sur la situation des mourants en 2005 et 2006 durant les trois dernières années de leur vie en Belgique, que les décisions médicales visant à abréger la vie n'avaient pas entravé la pratique des soins palliatifs, mais ont au contraire été souvent prises dans le cadre de soins multidisciplinaires.
Ces deux logiques – celle des soins palliatifs et celle de notre proposition – sont donc tout à fait compatibles.
À ceux – Mme Le Moal, M. Poisson – qui objectent que la présente proposition constitue une instrumentalisation de la notion de dignité, qui ne serait pas morale, je voudrais rappeler quelques éléments.

Soyons précis. Le dictionnaire Robert définit le principe de la dignité de la personne humaine comme le principe selon lequel un être humain ne doit jamais être traité comme un moyen, mais comme une fin en soi. Nous sommes tous d'accord sur ce point.

La proposition de loi s'inscrit dans cette démarche qui pose l'homme, l'individu, au centre : c'est lui qui doit pouvoir décider de faire cesser ses souffrances, lorsqu'il le souhaite. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe GDR.)
Il est d'ailleurs étonnant que ce débat puisse opposer des socialistes et des libéraux, au sens politique de ce terme : précisément, nous revendiquons ici l'autonomie de l'individu, sa capacité à décider !

Comme l'a souligné le rapport d'évaluation de la loi du 22 avril 2005, la notion de dignité, c'est-à-dire l'affirmation que l'homme est reconnu comme ayant une valeur absolue, est inscrite dans le Préambule et l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Notre proposition ne heurte pas ce principe ; bien au contraire, elle le renforce en donnant à l'individu la liberté de préserver sa dignité. Elle place donc la personne au centre de cette question de la fin de vie : c'est la volonté de la personne qu'il faut préserver. Non, souffrance et dignité ne vont pas de pair !
L'article L. 1110-2 du code de la santé publique dispose que « la personne malade a droit au respect de sa dignité ». Ce même code dispose que les soins palliatifs visent « à sauvegarder la dignité de la personne malade ». Or, nous disons que, dans un certain nombre de cas, les décisions d'arrêt de soins ou les soins palliatifs peuvent ne pas suffire. C'est alors l'aide active à mourir qui permet de faire cesser la souffrance : c'est la raison pour laquelle il faut franchir un nouveau pas, et légiférer.
La question de la constitutionnalité a été évoquée, notamment par M. Poisson. Dans sa décision du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du principe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine en écrivant : « La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. » Depuis 1994, le Conseil s'est référé à ce principe dans plusieurs décisions à forte dimension symbolique, qu'il s'agisse du droit au logement, du droit des étrangers, de la lutte contre l'exclusion ou de l'interruption volontaire de grossesse.
Cher collègue Poisson, je ne peux pas vous suivre : fondamentalement, l'idée d'une incompatibilité entre une loi portant sur l'euthanasie et le principe constitutionnel de la dignité humaine achoppe sur l'ambiguïté intrinsèque de cette notion, entendue au sens juridique : cette référence pourrait tout autant servir à la consécration de l'euthanasie.

Je voudrais conclure sur l'un des autres débats, soulevé cette fois par Jean Leonetti, et sur sa logique fondée sur l'opposition de deux démarches : l'éthique de l'autonomie et l'éthique de la vulnérabilité.
Je souhaite rappeler qu'il paraît pour le moins réducteur – est-ce d'ailleurs à la hauteur du débat qui a lieu dans cet hémicycle sur ce sujet, depuis plusieurs années ? – d'assimiler la position que nous défendons, qui est de fait celle de la création d'un droit nouveau pour l'individu, à une démarche qui se contenterait d'un « c'est mon choix ». Je me permets d'ajouter, monsieur Leonetti, qu'une telle critique n'est pas totalement dénuée d'arrière-pensées que d'aucuns pourraient considérées comme inspirées par un certain mépris.

Acceptez tout de même que l'on puisse évaluer votre loi et que l'on veuille la changer si l'on considère qu'elle ne répond pas, aujourd'hui, à l'attente des malades.
Je souhaite également rappeler que la vulnérabilité n'est pas éloignée de nos préoccupations. Il n'y a pas – pardon de cette expression – de monopole de la volonté de répondre à la vulnérabilité et à la souffrance, et en particulier à celle des plus modestes. Ce sont précisément les situations de vulnérabilité des personnes en fin de vie qui nous font agir et proposer un cadre juridique assorti de garanties strictes, de manière à offrir, le cas échéant, une réponse à ces situations.
Quant à limiter les difficultés identifiées aujourd'hui à des questions d'applications de la loi du 22 avril 2005, c'est également réducteur – nous sommes ici en désaccord avec notre collègue Vaxès.
Certes, nous l'avons dit et répété, nous devons développer les soins palliatifs, mais il est aussi indispensable, et c'est là l'essentiel, d'apporter des réponses à certaines situations dans lesquelles la douleur ne saurait être apaisée. Personne ne saurait aujourd'hui affirmer, de manière péremptoire, définitive, qu'il n'existe plus aucune souffrance physique qui ne peut être apaisée, et je ne parle pas bien sûr de la souffrance psychique évoquée également par notre texte. Il s'agit aussi de prendre en compte les situations où les malades souhaitent choisir les conditions de leur mort et recevoir pour cela toute l'aide dont ils ont besoin.
Chers collègues, je ne suis pas médecin.

Comme d'autres, j'ai étudié ces sujets avec attention, je me suis déplacé pour voir comment on pouvait répondre à ces souffrances. Ces réflexions qui ont abouti à ce texte de loi, ce sont celles d'hommes et de femmes qui partagent les mêmes valeurs, celles de notre République, mais qui ont aussi le sentiment qu'il faut faire évoluer notre société.
Il ne s'agit pas de répondre, madame la ministre, aux sondages, il s'agit d'avoir une certaine idée de ce qu'est le progrès social dans notre pays et je vois une cohérence, une continuité entre cette discussion aujourd'hui et les débats qui ont permis, il y a plus de trente ans, l'adoption de la loi Veil dans cet hémicycle, ou les débats qui ont permis l'abolition de la peine de mort dans cet hémicycle.

Je vois une continuité entre ces débats et celui que soulèvent aujourd'hui celles et ceux qui défendent un nouveau droit, qui est la possibilité de terminer sa vie dans la dignité. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe SRC. – Exclamations sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

C'est dans cette continuité, c'est au nom de ces valeurs, au nom de cette conception de la laïcité et de la République que nous défendons cette proposition de loi, mais c'est également au nom de l'idée que nous nous faisons de l'homme et de l'individu. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
C'est un privilège, pour un ministre, que de participer à un débat d'une telle qualité, d'une telle richesse, qui nous interpelle sur des éléments fondamentaux. C'est une chance, pour un ministre, mais c'est aussi en quelque sorte un dilemme pour une ministre de la santé. Je reviendrai pas sur le débat, j'ai dit ce que j'avais à dire et mes réponses n'éteindraient pas les convictions des uns et des autres tant celles-ci ressortent d'un chemin de vie patiemment bâti, je note simplement un grand absent – on en n'a quasiment pas parlé ou on l'a évacué rapidement – c'est le médecin. (Murmures sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
Le débat convoque en effet le corps médical à une décision individuelle, stoïcienne, de décider de se donner la mort et c'est bien ça finalement l'autre pan du débat que personne n'a évoqué, sauf Jean Leonetti qui a parlé d'une demande qui n'était pas une demande médicale mais qui était fondamentalement une demande sociale qui interpellait au niveau juridique.
On confie dans ce débat au médecin le rôle de démiurge. C'est lui et lui seul à qui on demande d'autoriser de se donner la mort.
Est-il le plus compétent ? Est-il le plus capable pour assumer cette responsabilité qui est sans doute la plus contraire à l'esprit du serment d'Hippocrate qu'il a lui-même juré et qu'on lui consacre dans la loi.
Ensuite, on lui demande de mettre en oeuvre cette responsabilité, et pour cela, la proposition de loi lui demande même de se former.
Puis, on lui ouvre le droit de la refuser…
…dans une sorte de démarche paradoxale, qui reviendrait pour le médecin à refuser un droit que par ailleurs on a consacré comme irréfragable.
Je demande que cet aspect du problème ne soit jamais oublié. En tant que ministre de la santé, j'ai voulu que les médecins reviennent dans notre débat de ce matin, pour concilier cette éthique de la vulnérabilité et cette éthique de l'autonomie, qui ne sont pas paradoxales, mais qui sont, au contraire, étroitement liées en une seule éthique, une éthique sociale et morale.
Mesdames et messieurs les députés, pour conclure, je vous annonce qu'en vertu de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution et en application de l'article 96 du règlement de l'Assemblée nationale, le Gouvernement demande la réserve du vote sur les articles et les amendements en discussion. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP. – Protestations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

En application de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande la réserve des votes.
La réserve est de droit.

Madame la ministre, je craignais que vous n'en arriviez là, mais j'espérais malgré tout que vous éviteriez d'utiliser ce moyen constitutionnel dont le Gouvernement dispose en effet…

…qui implique qu'il n'y ait aucun vote ni sur les articles ni sur les amendements.
Par ailleurs, le groupe UMP a demandé un vote solennel, qui aura lieu mardi prochain. C'est son droit, mais ce sera un vote bloqué, compte tenu de ce que vous venez de nous annoncer.
Sur un sujet de cette importance, de cette gravité, madame la ministre, vous n'hésitez pas à vous contredire en quelques secondes puisque vous avez commencé votre propos en disant : « Quelle chance pour un ministre d'assister à un débat d'une si haute tenue ! »

Et c'est vrai que nous pouvons nous féliciter – comme beaucoup de mes collègues j'ai assisté à la séance depuis le début – de la manière, si l'on excepte quelques petits dérapages, dont l'Assemblée nationale a abordé cette question très difficile, dans l'esprit d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi qui porte votre nom, monsieur Leonetti, et dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle a été une grande étape, un grand progrès.

Cette discussion a montré que, au-delà des clivages politiques, on pouvait débattre et avancer sur une question d'une telle importance, une question qui nous interpelle tous profondément mais qui doit nous conduire, chacune et chacun d'entre nous, à faire notre travail de législateur en conscience.
Sur un sujet aussi sensible, la rédaction du texte de loi doit être pesée, doit être réfléchie, et donc le temps de l'amendement est extrêmement important. Des erreurs ont été proférées sur le texte lui-même dans la discussion générale. Il est important de discuter des articles pour les expliciter et montrer que, contrairement à ce qu'ont laissé entendre certains, il n'y a pas d'ambiguïté. Des amendements ont été déposés qui méritent d'être discutés. Il y a matière à perfectionner le texte. Sur un sujet comme celui-là, plus que sur tout autre texte de loi, le travail doit être bien fait. Pour cela, il faut laisser à chaque député la possibilité de pouvoir voter non seulement les articles mais les amendements.
Vous avez, madame la ministre, sur une question de société de cette importance-là, procédé comme d'habitude, c'est-à-dire fait croire aux Français que le Parlement disposait de pouvoirs nouveaux. On voit ce qu'il en reste avec la manière dont se comporte l'UMP concernant les demandes de commission d'enquête de l'opposition, qui dispose d'un droit de tirage mais qui ne peut se le voir accordé que si l'UMP décide du thème et du champ.

Cela vaut pour le groupe socialiste, radical et citoyen, cela vaut aussi pour le groupe de la gauche démocratique et républicaine à qui on refuse sa proposition de commission d'enquête sur la souffrance au travail, notamment à travers la dure réalité des suicides à France Télécom, sous prétexte que cela ferait baisser le niveau de l'action. Voilà où vous en êtes arrivé !

Concernant l'initiative législative des députés, on voit bien qu'elle n'existe pas puisqu'on ne peut pas voter, puisqu'on ne peut pas amender. En demandant le vote bloqué, vous videz de sa substance ces soi-disant droits nouveaux que vous avez donnés aux parlementaires, en particulier aux députés de l'opposition. Il n'en reste rien, vous en faites encore la démonstration ce matin. Je ne peux que protester.
Cela veut dire que sur les deux autres propositions de loi, celle de cet après-midi sur les propositions issues de la commission des lois pour encadrer les fichiers de police, ou celle de ce soir sur la concentration dans les médias, la même procédure sera utilisée et qu'il n'y aura pas de vote, ni sur les articles ni sur les amendements. Mais vous avez choisi ce matin le plus mauvais sujet, madame la ministre, un sujet de société, qui pouvait, au-delà des clivages, montrer qu'on était capable de hauteur de vue. Vous, vous faites l'inverse.
Madame la présidente, c'est une affaire grave. C'est pourquoi je demande une suspension de séance pour réunir mon groupe. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Rappel au règlement

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à douze heures vingt.)
Rappel au règlement

Madame la présidente, non seulement je réitère ma protestation, mais je ne veux pas que nous en restions là.
Certes, le débat a été de haut niveau. Mais, sans égard pour l'importance du sujet dont nous débattons, le Gouvernement agit à la seule fin de masquer l'absentéisme systématique de nos collègues du groupe UMP lorsque l'opposition défend ses propositions de loi. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)
Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. C'est pourtant la réalité !

La situation est confortable pour eux : instruction est donnée à quelques-uns de venir tenir la permanence.

C'est ce que vous êtes venus faire, chers collègues ! Si certains d'entre vous sont personnellement motivés par ce sujet, qui laisse place, même à l'intérieur de votre groupe, à une grande diversité d'opinions, les autres feraient mieux de rester dans leur circonscription. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)

Témoignent-ils du moindre respect à l'égard du travail parlementaire ou de l'Assemblée nationale ? Quel mépris, au contraire ! D'ailleurs, leur attitude en dit long sur les prétendus « nouveaux droits » des députés.

Ces droits, qui n'existent pas dans les faits, sont pourtant prévus sur le papier. C'est pourquoi j'espère malgré tout qu'un sursaut de dignité et de respect peut encore intervenir.
Je vous demande donc, madame la présidente, une nouvelle suspension de séance (Protestations sur les bancs du groupe UMP), pour obtenir une audience du président de l'Assemblée nationale. Je souhaite en effet que celui-ci reçoive immédiatement une délégation de mon groupe.
Ce qui se passe aujourd'hui s'est déjà produit le 15 octobre et il s'était alors engagé à évoquer le problème en conférence des présidents. J'espérais que la situation allait évoluer. Le ministre chargé des relations avec le Parlement s'était lui aussi montré attentif à notre demande. En réalité, rien n'a changé. Nous ne pouvons pas continuer notre travail dans ces conditions.
Je souhaite donc, madame la présidente, que vous transmettiez à M. Accoyer notre demande d'audience immédiate, et je renouvelle ma demande de suspension de séance.
Rappel au règlement

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à douze heures cinquante.)

La séance est reprise.
Madame la ministre, maintenez-vous votre demande de réserve des votes ?
Absolument, madame la présidente.
Rappel au règlement

Madame la présidente, je ne reprends pas les arguments que j'ai développés il y a quelques instants. Le laconisme, la brutalité de ce « absolument » de Mme Bachelot ne peuvent qu'indigner, au-delà des groupes de l'opposition. Des députés de la majorité m'ont dit être gênés par l'usage répétitif, abusif, de la réserve des votes par le Gouvernement. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) Cela gêne ceux qui sont présents parce qu'ils sont ultra-minoritaires. Si vous deviez voter ce matin, cet après-midi et ce soir, vous seriez battus à chaque fois !

Que les députés de la majorité prennent leurs responsabilités, qu'ils viennent en séance quand on examine l'ordre du jour fixé par l'Assemblée elle-même.
Madame la ministre, prendre une fois de plus en otage le débat, qui, ce matin, était de haut niveau, est indigne. Cette nouvelle humiliation est de trop.

Nous allons quitter la séance et ne viendrons pas à celles de l'après-midi et du soir, pour protester, et vous faire prendre conscience que vous rendez le travail parlementaire caricatural.
Le groupe SRC unanime émet la protestation la plus vive contre cette manière de faire et demande que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la conférence des présidents de mardi prochain. Nous quittons la séance et nous ne siégerons pas cet après-midi. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
(Mmes et MM. les députés du groupe SRC quittent la salle.)
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. C'est de la démagogie !

Je regrette que M. Ayrault n'attende pas qu'on lui apporte une réponse apaisée.

Je regrette également qu'un débat qui n'était pas dénué de qualité se termine ainsi par un geste théâtral et une polémique inutile.
Le groupe UMP a souhaité qu'il y ait un vote solennel car ce type de débat engage les convictions et la responsabilité de chacun. Et, chacun le sait également, le groupe UMP a laissé une totale liberté de vote à chacun de ses membres.

C'est pourquoi nous n'avons pas souhaité que le vote se fasse aujourd'hui, mais donner à chaque député la possibilité de s'exprimer en conscience.
Par ailleurs, nous avons largement débattu en commission des affaires sociales, et tous les amendements et tous les articles ont été rejetés. De plus, aucun des amendements présentés – j'en parlais il y a quelques instants avec Mme Martinez – ne modifiait profondément le texte.
Oui, c'est un débat de société. Les uns craignent que la liberté concédée n'entraîne des dérives dont pâtiraient les plus faibles. Les autres placent au contraire l'autonomie au-dessus de ce souci de protéger les plus vulnérables. Pour autant, ces valeurs ne sont pas contradictoires, et c'est pourquoi il y a débat éthique. Je ne comprends donc pas que l'on passe ainsi du tout au rien, alors que nous aurions pu poursuivre le débat, qui est la véritable source de richesse. C'est grâce à l'écoute de l'autre qu'aujourd'hui Michel Vaxès, Gaétan Gorce et moi-même avons tenu à peu près le même discours : en effet, depuis quatre ans nous travaillons ensemble et nous rencontrons des personnes qui nous apportent des points de vue différents. Et cela nous a tous fait évoluer.
C'est pourquoi l'attitude polémique du groupe socialiste est malencontreuse et ne convient pas à l'idée que nous nous faisons d'un débat sur ce thème.
Enfin, même si M. Ayrault est parti, je me dis que cela lui permettra peut-être de réfléchir. Il est signataire de cette proposition de loi. Mais interrogé par un journaliste, il a répondu qu'il n'était pas question de légiférer pour faire comme en Suisse. « Êtes-vous pour l'euthanasie ? » lui demande alors le journaliste. Ce à quoi M. Ayrault répond : « Nous ne sommes pas non plus pour l'euthanasie. » Le délai que nous accordons au président du groupe socialiste lui permettra sans doute de clarifier sa pensée. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Deux collègues du groupe GDR étant intervenus dans la discussion générale, je m'apprêtais à le faire sur les articles 1er et 2.
À ce stade, je voudrais intervenir sur la procédure.
Monsieur Leonetti, je regrette que vous ayez rouvert le débat de fond en citant je ne sais quelle interview, et je regrette tout autant que, alors que votre intervention avait bien commencé, vous ayez tenu des propos polémiques et offensants, au regard de ce qu'a été l'Histoire, et particulièrement graves. (Protestations sur quelques bancs du groupe UMP.)
Madame la ministre, pour notre part nous prenons au sérieux la procédure d'initiative parlementaire. Demandez à n'importe quel citoyen à quoi sert un député. La réponse sera : à faire des lois. On sait que ce n'est plus la réalité depuis 1958 et que l'initiative des lois appartient principalement au Gouvernement et même aujourd'hui quasiment au Président de la République. Mais on nous a quand même réservé des séances d'initiative parlementaire et même quelques semaines. Malgré le terme de « niches » qui a pu être utilisé, nous prenons cela au sérieux.
Et nous prenons tout particulièrement au sérieux le grave sujet que nos collègues socialistes avaient décidé de nous faire examiner en inscrivant cette proposition à l'ordre du jour. Nous l'aurions soutenue, même si nous en avions déposé une autre, un petit peu différente. Nous pensons, en toute modestie, avec Noël Mamère qui avait abordé ce sujet lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle en 2002, avoir fait oeuvre de précurseurs en la matière.
Nous regrettons profondément que le débat ne puisse pas avoir lieu et que vous ayez choisi cette dérobade que constitue la réserve du vote sur les amendements et sur les articles, ce qui revient à vider le débat parlementaire de sa substance. En effet, à quoi sert-il de discuter d'articles et d'amendements si nous ne pouvons même pas voter sur ces articles et ces amendements ? À quoi sert cette séance du jeudi sans vote ? Déjà, le groupe UMP a trouvé cette parade ridicule qui consiste à organiser le mardi un vote solennel qui n'a alors plus aucun lien avec les débats. Ainsi, alors que nous-mêmes ne l'avions pas demandé sur notre proposition de loi en mai dernier, vous nous l'aviez imposé. On peut accepter le principe de ce vote solennel s'il permet à chacun de prendre clairement position. Mais à quoi bon refuser le vote sur les articles et sur les amendements au moment où le débat a lieu ? Cela signifie que vous ne voulez pas du débat. Vous ne le voulez pas sur ce sujet, je le comprends bien des propos que vous venez de tenir, monsieur Leonetti ; et vous ne voulez tout simplement pas que le Parlement, ne serait-ce qu'une fois par mois, exerce son droit d'initiative parlementaire. Vous abaissez le Parlement comme jamais il ne l'avait été dans l'histoire de notre République.
Il règne une très grande confusion. Il ne s'agit pas d'interdire le débat. Il aurait continué cet après-midi comme il a eu lieu ce matin, de façon approfondie, sur tous les aspects juridiques, philosophiques – pas suffisamment sur les aspects médicaux, hélas. Les amendements allaient être examinés, mais chacun a bien conscience qu'il s'agit ici d'un débat de fond et qu'aucun amendement n'aurait fait revenir tel ou tel sur sa position – ce n'était d'ailleurs pas leur objectif.
J'ai donc demandé la réserve des votes, comme le Gouvernement a la possibilité de le faire. En effet, concernant un sujet aussi capital, nous avons voulu que le vote n'ait pas lieu, au détour de cette journée, à la fin de l'examen de la proposition de loi, mais qu'il s'exprime de façon solennelle. Alors que, de manière générale, le vote solennel est réservé à des textes déposés par le Gouvernement, quel plus bel hommage pouvions-nous rendre à un débat aussi important ?
Monsieur de Rugy, nous avons voulu qu'un vote solennel ait lieu sur une proposition de loi, texte d'origine parlementaire : je ne sais pas où vous voyez un manque de respect à l'égard du Parlement ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Bien au contraire, sur un sujet qui touche au plus intime de l'individu, nous avons voulu que ce vote exceptionnel soit réservé.
Alors, de grâce, ne faites pas de mauvais procès au Gouvernement ! Il s'agit d'un vote solennel, chacun aura le droit de faire son choix, en âme et conscience. Je ne jette l'opprobre sur personne, et cela concerne évidemment ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Car je rends cet hommage au Parlement : dans ce débat, chacun, au-delà de sa conscience, a sans doute parlé avec son coeur. Je voulais vous en remercier. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Suite de la proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité ;
Proposition de loi relative aux fichiers de police ;
Proposition de loi visant à réguler la concentration dans le secteur des médias.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma