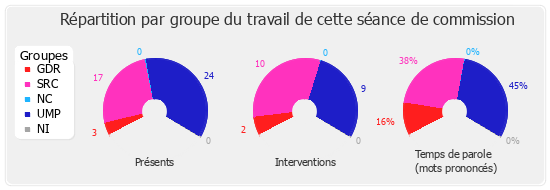Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Séance du 29 septembre 2010 à 10h30
La séance
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION
Mercredi 29 septembre 2010
La séance est ouverte à dix heures trente.
(Présidence de M. Michel Herbillon, vice-président de la Commission)
La Commission des affaires culturelles et de l'éducation entend M. François Rachline, directeur général de l'Institut Montaigne, accompagné de M. Laurent Bigorgne, directeur général adjoint, sur le rapport de l'Institut : « Vaincre l'échec à l'école primaire ».

Je vous prie, tout d'abord, de bien vouloir excuser l'absence de Mme la présidente Michèle Tabarot, retenue par d'autres obligations.
Je souhaite la bienvenue à M. François Rachline, directeur général de l'Institut Montaigne, ainsi qu'à M. Laurent Bigorgne, directeur général adjoint et à Mme Maylis Brandou, chargée d'études. Nous vous avons sollicités, Madame, Messieurs, afin que vous nous présentiez le rapport sur l'échec à l'école primaire que l'Institut Montaigne a rendu public au printemps dernier.
En ce qui nous concerne, nous avons commencé à travailler sur l'ensemble des problèmes de notre système éducatif à travers, notamment, un rapport de notre collègue Jacques Grosperrin consacré à la mise en oeuvre du socle commun de connaissances et de compétences au collège. Nous avons également décidé de nous pencher sur la question des rythmes de vie scolaire dans l'enseignement primaire avant même que le ministre de l'Éducation ne mette en place la conférence nationale à laquelle vous et nous, Monsieur le directeur général, sommes associés. Nous avons enfin abordé la problématique de l'échec scolaire à l'occasion de deux auditions successives de M. Jean Picq suite à la publication du rapport de la Cour des Comptes sur l' « Éducation nationale face à l'objectif de la réussite de tous les élèves ». J'ajoute que nous aurons l'occasion de reparler de ces questions avec M. le ministre Chatel dès la semaine prochaine à l'occasion d'un point sur un certain nombre de sujets d'actualité.
Je me félicite de l'apport de l'Institut Montaigne au débat public sur des thèmes qui engagent l'avenir de notre pays et je gage que nos échanges contribueront à faire émerger des solutions. Précisément, un certain nombre de propositions du rapport portent sur la structuration des enseignements ainsi que sur leur organisation administrative. Vous proposez ainsi d'abaisser à l'âge de cinq ans la scolarité obligatoire – ce qui ne serait pas sans incidence sur le financement de l'ensemble du système – et c'est sur ce type précis de sujet que nous ne manquerons pas de nous interroger ensemble après votre exposé liminaire.
Je vous remercie d'avoir pris l'initiative de cette audition qui témoigne de l'importance que vous accordez à cette grave question de l'échec scolaire dans l'enseignement primaire. L'Institut Montaigne qui, vous le savez, cherche à contribuer à faire évoluer la conscience sociale, se réjouit particulièrement de cet échange.
Notre Institut travaille sur les questions éducatives depuis une dizaine d'années, tant en ce qui concerne l'enseignement supérieur que secondaire ou primaire. Si nos concitoyens considèrent comme indispensable une réforme de l'université, du lycée et du collège, ils sont de plus en plus nombreux à penser qu'elle s'impose également dans l'enseignement primaire, lequel n'est plus « l'un des meilleurs du monde » comme en attestent les chiffres de l'Education nationale ou les résultats issus des tests réalisés dans le cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) : en effet, non seulement la situation n'est pas bonne mais elle se dégrade considérablement. En tant qu'enseignant, je suis désespéré à l'idée que chaque année 150 000 enfants sur 800 000 – soit 1,5 million en dix ans et 3 millions en vingt ans – présentent de graves lacunes en matière d'écriture, de lecture et de calcul. Pour le dire d'une manière plus abrupte : ceux-là sont quasiment illettrés. Or, non seulement les réformes s'empilent les unes sur les autres depuis des années sans résultats probants mais les moyens colossaux qui y ont été affectés n'ont pas eu les effets escomptés.
Afin de remédier à une telle situation, l'Institut Montaigne considère que les enfants doivent être au coeur de notre réflexion : l'école est d'abord faite pour eux, pas pour les adultes ou pour favoriser l'organisation socialement confortable des vacances. Nous avons également des propositions à formuler en matière de gouvernance ou de rythmes scolaires sur lesquelles je ne doute pas que nous reviendrons.
Trois constats, pour commencer.
Le premier : si, à la fin des années quatre-vingts, un enfant issu d'une famille ouvrière avait neuf fois moins de chances qu'en enfant issu d'une famille d'enseignant d'obtenir le baccalauréat, il en avait quatorze fois moins au seuil des années 2000.
Le deuxième : la fatalité n'existe pas. Les Allemands, dès 2003, ont lancé un vaste débat après les résultats des premiers tests PISA – d'aucuns ont alors parlé d'un « PISA-choc » – jusqu'à remettre en cause les fondements de leur système éducatif. Alors que les résultats français sont sans doute pires, cette prise de conscience n'a pas eu lieu chez nous ou, à tout le moins, elle n'a pas porté ses fruits.
Le troisième : nous sommes confrontés à une double difficulté puisque 40 % des enfants qui entrent en classe de sixième ont des lacunes graves – elles sont quasiment irrémédiables pour 15 % d'entre eux – et que notre élite scolaire plafonne à 6 % ou 7 % contre 12 % à 17 % dans d'autres pays qui nous sont comparables. Cela, me semble-t-il, éclaire d'un jour nouveau le débat sur l'accès aux formations supérieures les plus sélectives ainsi que sur l'effectivité du brassage social.
Quelques chiffres supplémentaires. Les sorties de notre système scolaire se répartissent comme suit : 20 % des élèves sont sans diplôme, 20 % obtiennent un CAP, 20 % un BEP, 20 % ont un niveau bac, 20 % un bac +2, 20 % un bac +3 – contre 30 % à 40 %, dans cette dernière catégorie dans des pays avec lesquels une fois encore la comparaison est possible.
L'OCDE réalise des tests PISA tous les trois ans depuis l'an 2000. S'agissant de l'acquisition de la lecture à l'âge de quinze ans, la France se situait cette année-là au douzième rang ; en 2006, nous avons rétrogradé au dix-septième ; aujourd'hui, notre pays se situe entre la Corée et le Mexique. En ce qui concerne les mathématiques, la situation est encore pire puisque entre 2003 et 2006 nous sommes passés au dernier rang des pays de l'OCDE. Je n'ignore pas que certains contestent la validité de ces tests mais, en l'occurrence, ils sont parfaitement légitimés par les croisements effectués par le Département des études de la prospective et des statistiques (DEPS) avec les tests réalisés en classe de CM 2 tous les dix ans depuis 1987.
En outre, si le niveau des meilleurs élèves tend à baisser légèrement en 2006, c'est surtout celui des 25 % des élèves les plus faibles qui s'effondre encore un peu plus.
Sur un plan sociologique, si les enfants des cadres et des professions intellectuelles supérieures « trustent » les voies d'excellence, la proportion d'enfants d'ouvriers non qualifiés dans les classes de baccalauréat général – a fortiori scientifique – et au sein des classes préparatoires aux grandes écoles est quant à elle extrêmement faible. Par ailleurs, l'étude PISA-Maths portant sur les résultats en mathématique dans ces trois pays d'immigration que sont le Canada, l'Australie et la France montre que notre pays est le seul dans lequel les enfants dits autochtones ont de meilleurs résultats que ceux qui sont issus de la première ou de la deuxième génération d'immigrés. Il n'y a donc aucune fatalité à ce qu'il en soit ainsi et c'est bien notre système qui est responsable de l'échec de l'intégration scolaire.
De surcroît, depuis les années quatre-vingts, les réformes ont été pléthoriques tant en ce qui concerne les programmes que les conditions d'enseignement ou la formation des enseignants mais, malgré l'ampleur des moyens déployés, les résultats demeurent significativement mauvais comme en attestera à la fin de l'année le rapport PISA 2009. Pire : ce dernier dessinera également la tendance sur les dix prochaines années…
Pourtant, dans de nombreux pays, les recherches menées par des médecins, des psycho-cognitivistes, des sociologues et des économistes ont permis de réaliser de remarquables avancées. Hélas, dans notre pays, elles sont quasiment inexistantes ou elles se déroulent très loin des salles de classes où nous savons que tout se joue. Nous n'avons pas investi – pas même dans le cadre du grand emprunt – dans une recherche pédagogique universitaire indépendante de très haut niveau qui s'élaborerait à partir des meilleurs standards internationaux ; nulle structure ne permet à des scientifiques comme Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, ou Michel Fayol, responsable des sciences psycho-cognitives à l'Agence nationale de la recherche (ANR), de travailler ensemble ; eux et quantité d'autres chercheurs sont isolés, n'entretiennent aucune relation avec l'Éducation nationale. C'est d'autant plus dommageable que, selon une étude américaine, des travaux de haut niveau réalisés par des chercheurs ont permis de remédier aux difficultés de lecture rencontrées par les élèves d'origine hispanique vivant en Floride. Au début des années 2000, les États-Unis avaient d'ailleurs évalué 100 000 expériences de lecture réalisées dans l'ensemble du pays ; conserver une centaine des plus probantes a permis d'élaborer et de diffuser les bonnes pratiques. L'efficacité de la science pédagogique est en effet comparable à celle de la médecine en ce qu'elle est fondée sur l'évaluation d'expériences : tant que cela ne sera pas reconnu dans notre pays et tant que nous ne ferons pas confiance aux chercheurs compétents, il sera vain d'attendre une amélioration de la situation dans les classes.
Michel Zorman, médecin conseiller du recteur de l'académie de Grenoble, a ainsi travaillé sur la maîtrise de la conscience phonologique des élèves – laquelle est le plus souvent tributaire de leur milieu social – dans des classes situées en zone d'éducation prioritaire (ZEP), entre la grande section de maternelle et le CE1. Un certain nombre de protocoles scientifiquement élaborés a permis de diminuer de moitié le nombre d'élèves en difficulté et de doubler le nombre de ceux qui figurent en tête de classe portant cette dernière, en l'occurrence, à un niveau supérieur à celui de la moyenne nationale ; en matière de lecture, M. Zorman a proportionnellement placé la France au même plan que la Finlande ! Mais si ces résultats sont connus depuis 2008, ils ne sont toutefois guère diffusés pas plus qu'ils ne bénéficient – malgré mes efforts auprès des cabinets des ministres successifs de l'Éducation nationale – d'une oreille attentive de la part de l'institution. Une fois encore, c'est d'autant plus dommageable que le protocole mis en oeuvre ne coûte que cent euros en moyenne par élève, ce qui n'est pas beaucoup comparativement aux dépenses induites par l'illettrisme. L'Institut Montaigne, quant à lui, s'efforce de diffuser cette expérience à Lyon en travaillant main dans la main avec le directeur général de l'enseignement scolaire et il s'évertuera à faire de même dans d'autres collectivités locales dès la rentrée prochaine.
J'ajoute, enfin, que nous ne disposons d'aucun outil comparable s'agissant des mathématiques.
Je me permets d'insister : faute d'expérimentations et d'évaluations, les contribuables pourront continuer à mettre la main à la poche et les réformes structurelles se succéder, les améliorations ne se feront qu'à la marge et la France conservera la palme des mauvais résultats au sortir de l'école primaire de même que celle des inégalités sociales les plus criantes.

Même si ce rapport, Monsieur le directeur général, est sans doute un peu trop exclusivement axé sur les sciences de l'éducation et le socio-constructivisme – résoudre le problème de l'échec scolaire, en effet, implique selon moi d'agir simultanément sur plusieurs leviers –, je le trouve éclairant et je ne partage pas les critiques trop véhémentes dont il a fait l'objet de la part du professeur Hubert Montagner.
Premier budget de la nation – notre dépense publique a été multipliée par deux alors qu'entre 1990 et 2000 les effectifs ont considérablement diminué – l'Éducation nationale est un service public qui doit contribuer à l'égalité des chances. Or, alors que 78 % des Français se disent satisfaits du fonctionnement de l'enseignement primaire, le constat que vous faites est accablant, notamment en ce qui concerne les lacunes des élèves entrant en sixième.
Afin de remédier à une telle situation vous considérez – parmi d'autres mesures concernant l'organisation de l'école et de l'année scolaire mais, également, les enseignants et la gouvernance – qu'il convient de placer l'enfant au coeur du système éducatif. N'était-ce pas déjà le cas avec la « révolution copernicienne » qu'était censée porter la loi Jospin de 1989 ? Le constat que vous faites ne s'explique-t-il pas également par une succession de réformes qui se neutralisent ou par l'inapplication de nombreuses lois – je songe à la loi Fillon de 2005 qui était fondée sur le socle commun de compétences – en raison de problèmes ministériels ou, en l'occurrence, de l'attitude de certains inspecteurs généraux peut-être trop académiques qui, exclusivement focalisés sur les savoirs, se soucient assez peu des savoir-faire ? Par ailleurs, ne pourrait-on émettre l'hypothèse selon laquelle la féminisation du corps enseignant ne faciliterait pas l'intégration des codes scolaires par des enfants issus de quartiers sensibles dont nous savons qu'ils sont en quête d'une imago paternelle structurante ? Lacan est formel quant à la fonction du signifiant du Nom-du-Père : si les non-dupes errent, c'est à la condition que Dieu soit inconscient – autrement dit, que le signifiant paternel ne soit pas forclos. Par ailleurs, quid de la reconnaissance sociale du métier des enseignants, mais, également, de leur formation au sein des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), notamment en ce qui concerne les sciences de l'éducation ? Enfin, la cogestion de l'Éducation nationale avec les syndicats ne contribue-t-elle pas à freiner l'innovation et la créativité dans la lutte contre l'échec scolaire ?

Je me félicite également de ce rapport qui met en évidence combien l'école primaire constitue un élément fondamental du cursus scolaire jusqu'à… l'université. En effet, contrairement à ce que les gouvernements successifs ont laissé penser à travers les réformes du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur, les problèmes ne commencent pas à partir de la classe de sixième : comme l'attestent les travaux que vous avez réalisés – à l'instar, d'ailleurs, de ceux de la Cour des comptes ou d'autres institutions – il convient d'agir dès le début du cursus scolaire, voire avant qu'il ne commence, afin d'éviter que les inégalités ne s'accroissent. À ce propos, d'ailleurs, l'école de la République est infidèle à sa mission constitutive puisqu'elle accentue ces dernières au lieu de les résorber. Je note, de surcroît, que les pays qui remportent des succès en la matière accordent beaucoup d'importance à la petite enfance alors que l'avenir de l'école maternelle – même si ce secteur ne saurait s'y réduire – me semble chez nous menacé en étant considéré trop souvent comme la variable d'ajustement de Bercy.
En outre, si les réformes ont porté jusqu'à présent sur les structures de l'enseignement, votre rapport a le mérite d'attirer l'attention sur la pérennité de la culture enseignante : c'est donc sur elle que doivent porter nos efforts.
J'ajoute, cette fois à destination de M. Grosperrin, que les syndicats ont réalisé des études passionnantes et ont formulé des propositions qui vont d'ailleurs dans le sens de celles que préconise le rapport – je songe, en particulier, à la continuité de la scolarité depuis l'école élémentaire jusqu'à la classe de troisième – ou de ce qui a cours en Finlande, pays qui reste une référence sur ce plan.
Au fond, la question fondamentale que soulève votre rapport est celle de l'essence de l'enseignement. Quelle est-elle, aujourd'hui, dans une France multiculturelle qui a profondément changé depuis Jules Ferry tant en ce qui concerne les mentalités que les personnes ? Quid d'une massification qui n'a pas pour autant été synonyme d'intégration et de démocratisation ? Quelle mission donner à cette école ? En quoi consiste le métier d'enseignant ? C'est incroyable, mais il semble bien que ce soit la seule profession qui ne fasse plus l'objet d'un apprentissage !
Par ailleurs, les pays qui réussissent, vous l'avez rappelé, ont promu une recherche pédagogique puissante quand nous avons quant à nous supprimé tous ses fondements. Comme vous l'avez également souligné, nos chercheurs sont isolés et ne cultivent aucun lien avec les classes.
Enfin, vous avez raison de faire le procès non des IUFM – les supprimer serait une erreur – mais de ce qu'ils sont devenus : comme vous, nous sommes persuadés que leur réforme est indispensable.

Ce rapport, Monsieur le directeur général, ne manque pas d'intérêt même si nous n'en partageons pas certaines propositions.
Depuis la constitution de notre commission, le 1er juillet 2009, c'est la première fois que nous consacrons l'intégralité d'une réunion plénière à l'audition d'un organisme privé qui, a priori, défend des intérêts privés, l'Institut Montaigne étant notamment financé par 80 entreprises à l'exclusion de toute subvention publique. Sont-ce donc là les prémisses d'une série d'auditions de personnalités, d'associations, de représentants des personnels de l'Éducation nationale et des chercheurs qui travaillent depuis des années sur la question de l'échec scolaire ? Si oui, je propose d'entendre un représentant de la Fédération nationale des associations des rééducateurs de l'Éducation nationale (FNAREN). Comme j'ai eu moi-même l'occasion de le constater, l'expertise de la FNAREN quant au traitement des difficultés scolaires est remarquable, de même que les propositions concrètes qu'elle a formulées pour lutter contre l'échec scolaire, mettant notamment en évidence la prégnance de facteurs sociétaux, environnementaux, institutionnels, personnels et familiaux. Je vous propose, également, d'auditionner M. Jean-Pierre Terrail, sociologue spécialiste de la question des inégalités scolaires, ainsi que Mme Danièle Trancart, MM. Choukri Ben Ayed et Sylvain Broccolichi qui dans École, les pièges de la concurrence, ont mis en évidence les dangers de la mise en concurrence des établissements scolaires.
Par ailleurs, s'il convient de repenser le fonctionnement de l'école afin que le nombre d'élèves sortant de l'école primaire avec de graves lacunes diminue sensiblement, il faudrait également concentrer nos efforts sur les élèves des ZEP qui connaissent de grandes difficultés. La Cour des comptes, au mois de mai dernier, avait elle-même considéré que faire face à l'écart qui se creuse avec les meilleurs élèves suppose l'engagement de moyens exceptionnels en faveur des établissements les plus défavorisés. En l'occurrence, le nombre d'enfants par classe n'est pas seul en cause : l'adaptation de nos dispositifs pédagogiques est urgente, de même qu'un travail soutenu sur la question de la formation des enseignants dans la France du XXIe siècle. Il semble, malheureusement, que nous ne nous engagions pas dans une telle direction : diminution de l'offre de formation continue, caractère catastrophique des conditions de la masterisation en formation initiale avec une baisse de la formation pédagogique des enseignants qui ne fera qu'accroître les difficultés dans la lutte contre l'échec scolaire, démantèlement de l'Institut national de recherche pédagogique, attaques répétées contre le mouvement pédagogique, réduction drastique des financements de la recherche et j'en passe.
Par ailleurs, j'ai été surprise par certaines propositions de l'Institut Montaigne relatives à la rémunération des enseignants, notamment, par celle visant à augmenter les salaires en début de carrière puis à ralentir ensuite l'évolution salariale alors que l'on ne peut sérieusement affirmer que nos professeurs soient grassement payés. Nous ne partageons pas non plus vos propositions visant à créer un statut de directeur d'école assorti d'un recrutement professionnalisé, à mettre en place des établissements publics d'enseignement primaire (EPEP) dans les ZEP notamment, enfin à transformer les écoles primaires en entreprises autonomes – ce qui ne manquera pas de contribuer à la mise en place d'une concurrence entre les établissements scolaires au lieu de faire reculer les inégalités.
De plus, confirmez-vous la proposition visant à diminuer le temps dédié à l'apprentissage du socle commun de connaissances, donc à l'enseignement reçu par l'ensemble des élèves ? Si tel est le cas, nous ne pouvons évidemment nous rallier à pareille perspective.
Enfin, je souligne les deux questions sur lesquelles vous avez insisté et qui nous semblent également déterminantes : l'indigence de la recherche publique sur le problème de l'échec scolaire et l'enjeu que constitue la formation initiale et continue des enseignants.
Se confronter aux problèmes que rencontre l'école primaire, c'est accepter le risque du découragement devant l'ampleur de la tâche. Au lieu de s'épuiser vainement à pousser le rocher de Sisyphe, je suggère de regarder d'abord si ce n'est pas un petit caillou qui l'immobilise ; si tel est le cas, une fois ôté, tout redevient possible ; en l'occurrence, le petit caillou, c'est l'absence de diffusion des bonnes pratiques qui ont été positivement évaluées. Pour un enseignant, non seulement il n'est pas possible, le soir venu, de s'endormir paisiblement avec la conscience de l'échec mais son sentiment de culpabilité ne fera que s'accroître s'il n'applique pas des méthodes éprouvées. Les professeurs attendent de l'aide ! Monsieur Durand, vous n'avez pas tort de souligner que nul n'apprend ce métier mais tout change si l'on transmet à ces professionnels des méthodes qui ont fait leur preuve !
Par ailleurs, Monsieur Grosperrin, l'organisation de la scolarité en cycles d'enseignement telle que préconisée par la loi Jospin n'a en effet pas été mise en place ; or, cette « révolution copernicienne » est toujours d'actualité et me semble nécessaire.
Jusqu'à présent, Monsieur Durand, l'école primaire échappait en effet à la critique de nos compatriotes parce qu'ils ignoraient ce qu'il s'y passe. Fort heureusement, des prises de conscience se sont fait jour. J'ajoute que la question que vous avez posée sur la nature du métier d'enseignant est essentielle. Enfin, si la Finlande constitue une référence dans le domaine qui nous préoccupe, il convient aussi de rappeler que le finnois est une langue contre-intuitive dont l'apprentissage est beaucoup plus facile que le français. Par exemple, le son O, chez nous, est le même dans les mots suivants – « eau », « haut », « oh », « Ô » – quand, en finnois, la graphie de « bateau » ou « d'auto » correspond à bato ou oto, ce qui limite considérablement les fautes d'orthographe. Cela ne suffit cependant pas, comme me l'a fait remarquer l'ambassadrice de ce pays, à expliquer les succès de l'enseignement scolaire en Finlande puisque la proportion des personnes issues de l'immigration, qui rencontrent forcément des difficultés particulières, y est aussi nombreuse que chez nous.
Enfin, l'Institut Montaigne, Madame Amiable, est une force de propositions et c'est sur ces dernières qu'il doit être jugé, quel que soit son mode de financement. Je gage que, si vous nous faites le plaisir de nous entendre, c'est que notre souci de l'intérêt général vous a paru conforme à notre mission.
Nous ne souhaitons pas que les sciences de l'éducation qui, d'ailleurs, souffrent dans notre pays d'une mauvaise réputation, soient omniprésentes. Nous soulignons simplement le fait que des recherches précises sont aujourd'hui menées par des personnes isolées dans le cadre de protocoles stricts répondant à des standards internationaux et dont les travaux se révèlent très utiles dès lors que le lien avec les classes est établi. Nous regrettons également que le grand emprunt n'ait pas conféré à ce domaine une impulsion supplémentaire. J'insiste : faute d'expérimentations évaluées, nous ne progresserons pas.
S'agissant de l'Institut Montaigne, je précise que nous ne nous adressons qu'aux chercheurs dont les laboratoires sont notés A+ par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).
Par ailleurs, si les Français manifestent leur satisfaction à l'endroit de l'école primaire, c'est qu'ils n'en connaissent pas la situation globale. Par exemple, si 25 % des élèves y redoublent une classe – ce qui constitue un record en Europe – comment imaginer qu'un enfant âgé de six ou sept ans est responsable de son échec ? Nous sommes le seul pays au monde à le prétendre ! En outre, le redoublement est extraordinairement prédictif : non seulement 90 % des élèves qui redoublent leur CP sont ceux qui ne savent pas lire aux vacances de Toussaint mais nous savons que, pour eux, les perspectives scolaires sont inexistantes : ils sortiront de notre système éducatif sans aucun diplôme. De la même manière, à partir du travail d'un élève en CE1, la DEPS est en mesure de déterminer très précisément ses résultats au brevet et de connaître les grandes lignes de ce que sera sa trajectoire scolaire. Aucun système en Europe ou au sein des pays de l'OCDE ne programme à ce point la reproduction des inégalités sociales et, de facto, la désespérance de certaines familles ! C'est précisément pourquoi l'Institut Montaigne, quelles que soient par ailleurs les urgences au collège et au lycée, a tenu à focaliser son attention sur les petites classes.
MM. Zorman ou Fayol, d'autres chercheurs encore, savent fort bien que tout commence à se jouer dès l'âge de 36 mois. Tant que nous n'en aurons pas collectivement pris conscience, les moyens déployés n'impliqueront pas mécaniquement les résultats escomptés. J'en veux pour preuve, par exemple, le dédoublement des classes de CP décidé en 2002 : l'évaluation en CE1 des élèves qui en avaient bénéficié a montré que leur niveau était identique à celui des autres. C'est que la méthode d'enseignement n'a pas changé et qu'à aucun moment il n'a été question, par exemple, de phonologie ou de vocabulaire ! L'« effet-maître » montre que seuls 20 % des enseignants savent intuitivement user de tels processus, or, c'est pour l'immense majorité des autres que la recherche est utile ! De surcroît, les enseignants connaissent parfaitement ceux qui, parmi leurs collègues, promeuvent les meilleures méthodes d'apprentissage mais faute de communiquer ces dernières, les autres continueront à appliquer des procédés moins efficaces pendant toute leur carrière. Comment, dans ces conditions, notre système éducatif pourrait-il évoluer ? C'est impossible ! Pourtant, ne rien faire, c'est déplacer le problème au collège et au lycée, lesquels confèreront alors aux élèves en grande difficulté un seul label : non diplômés.
J'en viens à la formation des maîtres. Personne ne pleure les IUFM « ancienne formule », mais en matière de formation, le « tout ou rien » pose problème. Nous avons besoin et de la formation initiale et de la formation continue. Il faut que les inspecteurs puissent se consacrer davantage à leur métier de formateur. La gouvernance globale du système – 300 000 enseignants dans le premier degré et 1 300 inspecteurs – ne permet pas aujourd'hui de diffuser ce qui marche – j'entends par là, bien sûr, ce qui est évalué soigneusement comme tel, c'est-à-dire ce qui a été testé et validé comme ayant produit des résultats.

L'expérience « Parler », conduite dans l'académie de Grenoble entre 2006 et 2008, a-t-elle été poursuivie ? A-t-elle été élargie à d'autres académies et sinon est-ce par manque de moyens budgétaires ?

Je me réjouis de ce débat, car le Parlement ne débat pas assez souvent des problèmes d'éducation.
Je remercie l'Institut Montaigne de sa contribution. J'estime moi aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Je remets d'ailleurs cet après-midi au ministre de l'éducation nationale un rapport sur la gouvernance des écoles, qui sera mis en ligne aujourd'hui sur le site du ministère et dont les conclusions rejoignent parfaitement vos propositions 10 à 13.
Vous proposez de rendre la scolarité obligatoire à partir de cinq ans. Ce serait assez logique, dans la mesure où le cycle des apprentissages fondamentaux commence avec la grande section de maternelle. À quatre ans, 99,7 % des élèves sont du reste scolarisés ; je ne suis donc pas tout à fait d'accord avec Yves Durand lorsqu'il dit que l'école maternelle est une variable d'ajustement…
Concernant les enfants en difficulté, vous parlez d'une « efficacité contestable » du système. Les outils existent, ils figurent dans la loi de 2005. Reste à les exploiter au mieux. Les heures consacrées aux enfants en difficulté, par exemple, sont-elles judicieusement placées dans la journée ? Sont-elles vraiment efficaces le soir, après six heures de cours ? L'aide doit être apportée aux enfants qui en ont besoin au moment où ils sont les plus réceptifs. Cela me conduit à poser la question de la dimension de l'école. Quelle est donc, selon vous, la taille critique que doit avoir une école pour fonctionner correctement ? Peut-on accepter qu'il y ait encore en France 5 000 classes uniques, et pas seulement en milieu rural ?
Nous sommes d'accord, tout se joue dès l'école primaire. L'expérimentation sur le terrain est diffusable au plus grand nombre – c'est aussi la philosophie de mon rapport – mais le but ultime reste de lutter contre l'échec. Sachant que la marche à gravir entre le CM2 et la sixième est considérable, ne pourrait-on envisager des écoles du socle commun pour assurer un continuum dans l'apprentissage ? D'autres pays l'ont fait.

L'école rurale, cher collègue Reiss, n'a pas fait la démonstration de sa moindre capacité à répondre aux inégalités scolaires !
La quatrième proposition de l'Institut Montaigne est à mes yeux incontournable : renoncer le plus vite possible à la semaine de 4 jours, qui est un échec patent.
S'agissant de la formation des enseignants, j'ai cru comprendre, même si ce n'est pas explicite dans le rapport, que vous préconisiez une pré-orientation du futur enseignant dès le bac, autrement dit un retour aux écoles normales des années 1960 et 1970. Me trompé-je ? Par quoi ce choix est-il motivé ?

Nous avons beaucoup parlé des élèves en difficulté. N'oublions pas le mal-être des enseignants, leur souffrance devant le constat de cet échec scolaire, leur sentiment d'être démunis des outils adéquats pour exercer leur métier. Un métier s'apprend : il y a besoin de formation initiale et de formation continue. Aussi aimerais-je que vous approfondissiez la réflexion sur ce que devrait être une véritable formation initiale. Sans pour autant revenir aux usages d'antan, il faut un temps où les futurs enseignants puissent acquérir les outils pédagogiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de leur métier.
Vous proposez d'abaisser à cinq ans l'âge de la scolarité obligatoire et d'intégrer la grande section à l'école élémentaire. J'aimerais pour ma part vous entendre sur l'école maternelle. Elue de Seine-Saint-Denis, je connais l'importance de l'accueil dès deux ans ou deux ans et demi pour les enfants issus des familles les plus défavorisées. Quel est donc l'avenir de l'école maternelle dans le schéma que vous proposez ? Comment aide-t-on ses enseignants à faire leur travail qui ne consiste pas seulement, quoi qu'ait pu en dire un ministre, à changer les couches, mais aussi à faire oeuvre pédagogique ?
Une remarque enfin. Certes, mettre beaucoup de moyens sans outils pédagogiques ne résout pas le problème et il est bon de créer de tels outils par la recherche et par la formation des enseignants ; mais il faut que les moyens demeurent, sans quoi la catastrophe perdurera.

En tant que médecin, je suis très attentif aux rythmes de l'enfant. Comme vous l'expliquez en vous fondant sur un rapport de l'Académie de médecine, le temps scolaire doit viser trois objectifs : améliorer les conditions d'apprentissage par des emplois du temps appropriés, réduire la fatigue et les tensions de l'enfant, instaurer une meilleure qualité de vie de l'enfant à l'école. Or le rythme en vigueur, qui « ramasse » le temps pédagogique sur 36 semaines, est source de problèmes : en fatiguant les élèves, en accroissant leur stress ainsi que celui des familles et des enseignants, il nuit grandement aux résultats de notre école. Vos propositions sont donc intéressantes : le rétablissement de la semaine de 5 jours combiné à un allongement de l'année scolaire pourrait desserrer les contraintes horaires des écoliers.
En revanche, la réduction du nombre de zones de congés scolaires pose problème. Certes, le calendrier scolaire est plus adapté aux contraintes parentales qu'aux rythmes de l'enfant ; mais l'étalement des vacances en trois zones est bénéfique aux professionnels du tourisme. De la même manière, vous semblez exclure la mise en place d'un système de « tuilage » par zones pour les vacances d'été. Pourquoi ?
À l'heure où le ministre de l'éducation nationale lance une grande conférence sur les rythmes scolaires, l'expérimentation – dont vous saluez les bénéfices – porte principalement sur la place du sport dans le nouvel aménagement du temps scolaire. Quel regard portez-vous sur ces expérimentations, qui ne sont pour l'instant menées que dans les lycées et les collèges ?

Vous préconisez une scolarisation obligatoire à partir de cinq ans. Mais que pensez-vous de la scolarisation entre deux et trois ans ? Dans les quartiers en difficulté, n'est-elle pas préférable pour les enfants ? Y a-t-il eu des évaluations ou des expérimentations sur le devenir scolaire des enfants concernés ?
Je le redis au risque d'être provocant : nous n'allons pas faire mine de découvrir ce matin que l'enseignement primaire est depuis plusieurs décennies le grand sacrifié des politiques publiques de l'éducation. Il n'est jamais la préoccupation réelle des recteurs, et on se contente assez bien que les arbitrages – notamment budgétaires – aient été rendus des années durant au profit du secondaire. Certes, nous sommes dans la moyenne de l'OCDE pour les dépenses d'éducation, mais nous avons sans doute le lycée le plus cher et le premier degré le plus cheap, et ce depuis longtemps.
Au-delà de cette maltraitance de l'école, il y a des priorités qu'on ne parvient pas à fixer. Nous ne parlons pas d'un problème qui touche 10 % des élèves : les mauvaises performances en lecture, en écriture et en calcul en fin de CM2 sont le fait de presque un sur deux ! Il faut donc se donner des priorités, car on ne pourra pas tout faire avec un corps social qui a déjà connu beaucoup de réformes, qui est en plein questionnement et qui a peu d'outils. Un grand plan contre l'illettrisme a été annoncé : avec un correspondant académique par académie et malgré tout le travail conduit par les associations, nous en avons pour plusieurs siècles ! La représentation nationale doit donc se fixer des priorités politiques et budgétaires.
Lorsque Michel Zorman a mis en place le programme « Parler », il a également développé « Parler Bambin », destiné aux 18-36 mois : pour remonter à la source des problèmes qu'il constatait en grande section, il s'est intéressé à ce qui se passe dans les crèches – soit dit en passant, il est aussi souvent plus simple de travailler avec les mairies qu'avec l'éducation nationale…
Nous avons réussi cette année à convaincre l'administration centrale de faire à Lyon une partie de ce qui s'était fait à Grenoble, mais cette fois-ci dans une centaine de classes, ce qui devient significatif. Il est vrai – ce n'est pas si fréquent – que nous avons avec Jean-Michel Blanquer, ancien recteur de l'académie de Créteil, un très bon directeur général des enseignements scolaires, qui a accepté que l'on s'engage dans des processus d'expérimentation avec les collectivités locales. Nous proposons de lier des expérimentations ciblées sur le premier degré et sur la petite enfance.
Oui, mais il y faut bien du courage et de l'abnégation !
J'en viens à l'aide individualisée aux élèves, sur laquelle 2 milliards sont fléchés chaque année. Mettez-vous cependant un instant à la place des personnels qui gèrent les politiques éducatives dans des communes comme Clichy ou Montfermeil : aucun de nous n'accepterait d'être confronté à pareil millefeuille de programmes et de budgets ! Il y a là matière à réflexion…
Personne ne peut être contre une aide individualisée, si elle est vraiment individualisée et utile. Mais deux heures, c'est à peine 10 % du temps scolaire… Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la classe. Si l'aide individualisée se fait sans soutien dans la classe ni connexion avec la classe, il y a peu de chances qu'elle ait l'efficacité espérée. L'effort doit à notre sens porter d'abord sur la salle de classe.
Vous me permettrez de ne pas me prononcer sur la « taille critique » des écoles. Nous avons identifié comme vous le passage du CM2 à la sixième comme un point névralgique, d'autant qu'il décuple l'angoisse des élèves en difficulté. J'en reviens donc toujours au même point : on intervient trop tard dans la chaîne éducative.
Vous m'avez parlé du métier d'enseignant. Quel fonctionnaire, quel salarié du privé vivrait bien avec 40 % d'échec dans sa tâche quotidienne, et ce depuis vingt ans, puisque nos résultats se dégradent continûment depuis 1987 ? Il y a certes un problème de formation initiale et un problème de formation continue, mais il y a surtout un problème de priorités. Qu'est-ce qui va le mieux nous aider à lutter contre l'échec scolaire ? Il faut un consensus national sur ce point, car les mesures à prendre, en particulier si on touche à la formation des enseignants, exigeront un débat au plus haut niveau.
L'échelon grande-section-CP-CE1 est fondamental : c'est là que se forgent les compétences indispensables pour l'avenir. C'est pourquoi il a été pensé en 1989 comme un cycle cohérent. Ce n'est hélas pas appliqué partout, mais lorsque c'est le cas – c'est-à-dire lorsqu'il y a un continuum pédagogique entre la grande section et le CP – cela se passe beaucoup mieux. Nous plaidons donc pour le renforcement de cet échelon, qui nous paraît essentiel.
Quant à la petite enfance, je pense qu'il y a là une carte à jouer puisque les communes ont à la fois compétence sur les écoles et sur la petite enfance. Les plus belles expériences de recherche pédagogique – celles que l'on a pu suivre sur vingt ou trente ans – ont concerné la petite enfance, entre zéro et cinq ans. On a par exemple suivi en Caroline et en Californie des populations difficiles : la différence à vingt ou trente ans entre celles qui ont bénéficié de protocoles pédagogiques du type de ceux que nous évoquons et celles qui n'en ont pas bénéficié est tout bonnement insupportable. Il n'y a pas à ciller : plus on prend précocement les enfants, mieux on peut traiter leurs difficultés en termes de maîtrise du vocabulaire et d'acquisitions langagières. Rappelons que s'agissant de la maîtrise des mots, la différence entre un enfant d'ouvrier et un enfant de cadre supérieur peut aller de 1 à 5 ou de 1 à 6 à l'âge de trois ans.
En ce qui concerne les rythmes scolaires, un seul chiffre : nous avons une année scolaire à 140 jours utiles, quand la plupart de nos voisins sont entre 190 et 220 jours. À cette difficulté s'en ajoute une seconde : nous avons sans doute l'année scolaire la plus dense. Si la Finlande – qui n'est pas la panacée – s'intéresse tant à l'éducation, c'est parce que c'est un petit pays où l'on estime que « perdre » ne serait-ce qu'un seul individu est une catastrophe. Le système scolaire se bat donc jusqu'au bout pour l'éviter, c'est une belle leçon. Il faut savoir qu'à six ou sept ans, les enfants finlandais ont 700 heures de cours, contre 900 en France – sur 140 jours !
Je ne prétends pas que nos propositions soient les meilleures. Nous pouvons en discuter, mais gardons en tête qu'avec l'année scolaire la plus courte et les charges horaires les plus lourdes, nous avons des résultats qui sont relativement médiocres.
Nous ne proposons pas de solutions « clés en mains ». La taille critique des écoles, par exemple, peut faire l'objet de discussions.
Les questions que vous soulevez renvoient à celle de la mission assignée à l'école. L'un d'entre vous a dit tout à l'heure que nous étions tous d'accord là-dessus ; je ne le crois pas. Pour prendre une image un peu excessive, en France on veut que tout le monde aboutisse à l'ENA ! Mais dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, la mission fondamentale de l'école est de socialiser. Dès lors, ne nous étonnons pas que notre pays fabrique tant de frustrés…
À une exception près, nos propositions n'ont pas d'incidence budgétaire majeure : il ne s'agit pas de diminuer les moyens, mais simplement de dire que ce n'est pas qu'une question de moyens.
Sachez enfin que l'Institut Montaigne n'a pas l'intention de s'en tenir là. Nous allons poursuivre nos recherches, en nous penchant notamment sur la maternelle.

Je précise que notre commission conduit une mission d'information sur les rythmes scolaires sous la présidence de Michèle Tabarot. Ses deux rapporteurs sont Yves Durand et Xavier Breton.

Permettez-moi d'apporter une modeste contribution à cet intéressant rapport. Vous parlez beaucoup d'expériences, mais il en est une que vous ne citez pas : celle qui a permis à de nombreux établissements d'obtenir des succès scolaires grâce à l'éducation artistique. Vous parlez de chaîne de l'intelligence ; je vous propose une chaîne de l'imagination et de la sensibilité. Je pense que l'une des raisons de l'échec scolaire tient au fait que l'enfant est plus un auditeur passif qu'un acteur de l'enseignement. On ne lui donne pas le désir d'apprendre. Notre enseignement cartésien est essentiellement axé sur les problèmes de la rationalité, mais l'art est le meilleur langage entre les peuples ! Dans le cadre de mon rapport sur l'éducation artistique en milieu scolaire, j'ai constaté que l'une des grandes réussites de l'enseignement scolaire dans les pays scandinaves – dont vous parlez tant – était justement la place faite à l'éducation artistique. Il me semble que vous devriez en tenir compte.
Allons plus loin. Les méthodes artistiques de travail ne devraient-elles pas s'appliquer aussi à l'enseignement des matières fondamentales ? Car celles-ci ont une dimension artistique : on peut faire de la géographie à partir de la peinture – en étudiant par exemple la représentation d'une montagne par différents peintres – ou de la physique à partir d'un pendule de Calder. Cela permettrait à l'enfant d'accéder à ces matières de façon ludique.
Vous évoquez, enfin, la formation des enseignants. Ils ne peuvent évidemment intégrer la dimension artistique dans leur enseignement sans être eux-mêmes formés, à moins d'intégrer à cet enseignement, dès le plus jeune âge, l'apport d'artistes, leurs pratiques et le mystère de la création.
Je suis toujours inquiète de voir aborder les problèmes de recherche d'un point de vue très scientifique, très médical. La construction de l'individu s'opère en effet par des méthodes qui échappent largement à la médecine.

Je souhaite vous interroger sur la prise en compte des élèves en difficulté – j'entends par là ceux qui ne parviennent pas à acquérir les savoirs de base malgré les entraînements et les sollicitations personnalisées. C'est en effet un problème que l'école ne se donne plus les moyens de traiter. Les difficultés d'apprentissage de ces jeunes sont sans doute liées à des inquiétudes identitaires et à un sentiment de frustration qui perturbent leur fonctionnement intellectuel. Comment les aider à enrichir et à sécuriser leur monde interne, qui ne produit plus de représentations fiables et régulières lorsqu'ils doivent affronter les contraintes du fonctionnement de l'école ?
Ne faut-il pas aider les enseignants à aller chercher, dans la présentation des savoirs et des exercices, l'intérêt de l'élève ?
Ma question est donc la suivante : comment traiter le problème des élèves en grande difficulté, avec quels objectifs et – surtout – quels moyens ?

Permettez-moi de revenir sur la taille critique des écoles. N'oublions pas qu'il y a encore, et pour longtemps je l'espère, des habitants – donc des enfants à scolariser – en milieu rural, l'écueil à éviter étant celui de la fatigue. Je ne pense donc pas que l'on puisse un jour trouver, du moins s'agissant de l'école primaire, la taille idéale pour obtenir les meilleurs résultats. J'ai moi-même enseigné en primaire en milieu rural. Mes élèves sont devenus qui agriculteur, qui artisan, qui médecin, qui ingénieur : ils ont très bien réussi !
Vous avez tout à fait raison de faire porter l'effort sur la maternelle et sur l'école élémentaire. Je ne sais pas si tout est joué à trois ans – il arrive que l'on puisse résorber les difficultés ultérieurement. Je ne suis pas non plus un défenseur acharné des écoles normales et des IUFM par lesquelles je suis passé et où j'ai même enseigné. J'ai le souvenir de certaines fantaisies pédagogiques, par exemple une écriture inventée pour des enfants de quatre ans alors qu'on aurait pu passer directement aux codes auxquels nous sommes tous habitués…
La transposition est un point très riche de votre rapport. Les méthodes de discrimination phonétique sont extrêmement intéressantes pour l'école élémentaire et surtout la maternelle, avant l'arrivée en CP. La plupart de ces méthodes dérivent de la méthode Le Sablier inventée par les Canadiens. Pourquoi ne pas transposer ce qui marche ailleurs ? Nous avons en France une certaine propension aux comparaisons « en interne ». L'Aveyron se classe ainsi au troisième rang pour ses résultats et nous nous en réjouissons, mais cette performance doit être relativisée par les comparaisons internationales…
Faisons par ailleurs en sorte qu'il n'y ait pas de différence d'appréciation entre la direction générale de l'enseignement scolaire et nos politiques publiques. Nous l'avions déjà dit, Xavier Breton et moi-même, dans le rapport que nous avons rédigé à la demande de Jean-François Copé. Je pense notamment à la fameuse évaluation en CM2, « plaquée » en janvier, ce qui me semble d'une stupidité sans égale…

Merci de nous avoir rappelé que l'école travaille avant tout sur de l'humain et d'avoir mis l'accent sur l'organisation quelque peu bancale de notre système scolaire. Je ne reviendrai pas sur les réformes non abouties des dernières années, mais je voudrais évoquer celle de 1989 sur les cycles, qui constituait un progrès dont nous n'avons pas su tirer la substantifique moelle. Nous continuons en effet à penser la progression des enfants par années, et à présenter les objectifs de la grande section de maternelle avec ceux de l'école maternelle alors qu'ils relèvent de ceux de l'école primaire. Il faut donc abaisser l'âge de la scolarité obligatoire de six à cinq ans.
Nous savons tous, d'autre part, que la qualité des apprentissages premiers et les progrès des élèves sont directement liés au temps consacré aux apprentissages. Or le nombre de jours de classe à l'école primaire contredit ce principe. Il faut donc poursuivre la concertation sur le volume et l'organisation du temps scolaire – car les mesures prises ces dernières années sont créatrices d'inégalités. Les heures de soutien, par exemple, sont inefficaces si elles allongent la journée des écoliers. Mieux vaudrait les prendre en compte en classe. Il me semble que nous confondons encore heures de classe et heures de cours. La prise en charge de tous les élèves pendant 26 heures et le réaménagement de l'année scolaire ne seraient-ils pas un progrès pour l'ensemble des écoliers ?

Je me réjouis de ce débat, qui compte tenu de l'urgence qu'il y a à réformer l'école primaire, ne peut se cantonner au ministère de l'éducation nationale.
Ma première question concerne les rythmes scolaires. Vous proposez de passer de trois à deux zones de congés scolaires et de raccourcir de deux semaines les vacances d'été. Est-ce compatible avec un passage à deux zones pour les vacances d'été ? Je pense notamment à l'économie touristique de notre pays.
Dans le cadre de la mission d'information sur les rythmes scolaires, nous nous sommes rendus en Allemagne et en Finlande. Le rapport de l'enseignant à la classe y est un peu différent de ce que l'on peut observer chez nous, grâce à la présence d'éducateurs dans les classes. Pourquoi ne pas s'en inspirer ?
Vous insistez, enfin, sur la nécessité de développer des recherches pédagogiques de haut niveau pour savoir ce qui se passe dans les salles de classe. Cela pourrait-il aller de pair avec une externalisation accrue des procédures d'évaluation ? Nous avions déjà fait cette proposition avec Alain Marc dans le rapport qu'il a cité tout à l'heure.
Ce n'est pas parce que l'art n'occupe pas une place prépondérante dans le rapport que nous ne sommes pas d'accord avec vous, Madame Marland-Militello. Sachez d'autre part, pour ceux qui en sont équipés, que vous pourrez accéder avec votre i-phone aux interviews que nous avons tournées à propos de l'échec scolaire. Vous y verrez notamment mon vieil ami Gérard Garouste, qui a pu réinsérer dans la société près de 15 000 enfants en dix ans exclusivement par des rencontres avec des artistes.
Nous avons également entamé il y a plusieurs mois un travail avec un économiste, Yann Algan, sur l'évaluation des orchestres à l'école – une association en fédère aujourd'hui plus de 500, presque tous situés en ZEP. Ces orchestres permettent aux enfants de progresser, d'apprendre à travailler en commun et à répondre à une instruction sans la rejeter d'emblée.
La frustration d'un élève de cinq, six ou sept ans devant l'échec est quelque chose de très fort. Dès lors, comment l'aider ? Il faudrait que nous nous fixions comme priorité globale que 95 % des élèves français – contre 60 % aujourd'hui – arrivent à un niveau de bon lecteur. On imagine bien les effets vertueux que pourraient avoir, y compris pour les enseignants, de meilleurs résultats globaux.
Comment aider les enseignants dans le traitement de la grande difficulté ? Dans le cadre de l'expérience de Lyon, les enseignants ont suivi six jours de formation. Certains y allaient à reculons – c'est normal compte tenu du nombre de réformes qu'ils ont vécues ces dernières années. Et pourtant, à l'issue de la formation, les résultats du questionnaire d'évaluation rempli sont excellents : en donnant aux enseignants des outils immédiatement utilisables au lieu de leur parler amélioration à dix ans, on entraîne des dynamiques très positives. Il me paraît donc essentiel que les réformes dans l'éducation nationale ne visent pas un objectif à dix ou même à cinq ans, mais à dix-huit mois. Nous devons avoir cette culture de projet qui permette d'obtenir dès la rentrée suivante un certain nombre d'améliorations et de les mesurer. J'insiste sur ce dernier point, car en matière d'évaluation, nous sommes clairement sous-équipés. Nous ne disposons guère que de PISA une fois tous les trois ans. Peut-être le Parlement pourrait-il peser en faveur d'un renforcement des outils de pilotage.
En ce qui concerne la formation des enseignants, je crois que nous avons intérêt à rompre la monotonie. Il faudrait déjà faire comprendre que le métier d'enseignant peut aussi s'apprendre en apprentissage ou par alternance. Il est tout de même surréaliste qu'un futur enseignant puisse attendre trois, quatre ou cinq années d'études supérieures pour mettre les pieds dans une classe ! Rien n'empêche de généraliser la possibilité d'aller avant la licence dans les salles de classe, fût-ce comme observateur ! C'est de bon sens à l'heure où l'on se bat pour promouvoir l'apprentissage et cela permettrait à certains de se rendre compte que ce métier n'est pas fait pour eux, à d'autres de conforter leur vocation. De plus, la présence d'apprentis apporterait de la variété à l'environnement de la classe.
Pour le programme « Parler », Michel Zorman répartit les élèves de sa classe en cinq groupes de niveau. Il consacre une demi-heure par jour, pour chaque groupe, à des exercices qui renvoient à la maîtrise du vocabulaire, du code phonologique et du code alphabétique, en faisant participer individuellement chaque élève. Pendant ce temps, le reste de la classe est soit en autonomie, soit confié à un autre adulte. Ce que l'éducation nationale n'a pas réussi à grande échelle – car il y a des enseignants exceptionnels qui la pratiquent – c'est l'individualisation de la pédagogie. Or celle-ci doit se faire en classe entière plutôt qu'en aide individualisée.
Bien sûr. Mais, dans la mesure où les enjeux se concentrent dans certaines zones, il faut regarder ce qui se passe à Sevran, Montfermeil, Clichy ou la Courneuve.

J'ai trouvé votre rapport intéressant et courageux. Moi-même enseignant et syndicaliste, je sais en effet qu'il n'est pas facile de faire bouger la maison…
Je partage beaucoup de vos propositions, en particulier celle relative à la prise en charge individualisée pendant le temps scolaire. C'est pourquoi je regrette – plus encore comme maire d'une ville de Seine-Saint-Denis – la quasi-disparition des Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et la suppression des deux heures de classe le samedi matin. J'aimerais avoir votre sentiment sur ces deux reculs préoccupants.
Permettez-moi de vous donner quelques chiffres, qui sont ceux de l'éducation nationale elle-même. Pour l'année 2010, seuls 23 % des élèves de Seine-Saint-Denis ont des acquis très solides en mathématiques, contre 35 % au niveau national ; 31 % contre 43 % en français. Les disparités sont donc réelles.

Vous mettez en exergue de votre rapport la citation suivante : « il n'est désir plus naturel que le désir de connaissance ». Cela m'a rappelé un ouvrage de François de Closets paru il y a une vingtaine d'années, Le bonheur d'apprendre et comment on l'assassine. La semaine dernière, j'ai également lu dans le Monde une interview de Peter Gumbel, auteur d'un livre intitulé On achève bien les écoliers…
J'ai cherché dans votre rapport des propositions susceptibles de répondre à ce constat. Le système d'évaluation au jour le jour pratiqué en classe est très décourageant, voire humiliant pour ceux qui se sentent en difficulté. Il me semble donc que les élèves pourraient bénéficier des méthodes de développement personnel en vogue dans les entreprises. Selon un récent sondage, près de trois quarts des élèves s'ennuient à l'école. Or fournir un effort et avoir du plaisir ne sont pas nécessairement antinomiques… Mais cet aspect psychologique et comportemental ne m'a pas semblé au coeur du débat aujourd'hui.

On ne peut que se féliciter d'une telle réunion. Puissions-nous en sortir tous avec l'idée que répondre aux inégalités qui se creusent doit désormais être la priorité des priorités pour notre pays. Nous sommes tous à peu près d'accord sur les rythmes scolaires, le rétablissement de la semaine de 5 jours, l'intégration de la dernière année de maternelle à l'école élémentaire… Nous voulons tous aller plus loin dans l'expérimentation et l'évaluation. Mais quand sauterons-nous le pas ? Pardonnez-moi, mais les inégalités scolaires passent avant les intérêts du tourisme et le confort des parents – même s'il faut, bien sûr, emporter l'adhésion du plus grand nombre au projet.
La personnalisation des parcours est un dessein passionnant mais délicat à mettre en oeuvre, puisqu'il suppose - à un moment ou à un autre - la présence de plusieurs adultes dans la classe. Le ministère de l'éducation nationale risque donc de nous opposer l'argument du coût. C'est pourtant la seule façon d'éviter la frustration des élèves, qui conduit vite à l'absentéisme – phénomène dont la montée inspire des lois très discutables.
On ne peut se contenter de petites évolutions successives. C'est d'un véritable changement des priorités dont nous avons besoin – et vite !

Vous évoquez les lacunes à l'entrée en sixième. Parmi celles-ci figurent aussi les problèmes psychomoteurs – il y a des enfants qui ne savent pas nager ou qui ne savent pas courir. L'éducation physique est aujourd'hui largement négligée à l'école primaire ; les jeunes enseignants nous disent d'ailleurs que le sport a quasiment disparu de leur cycle de formation. J'attire votre attention sur ce problème, et je souhaite instamment que vous en parliez. Cette matière devrait faire partie du socle commun, car elle permet de promouvoir des valeurs essentielles – entraide, partage, travail en équipe, gestion de l'échec – et d'aborder des notions d'hygiène de vie – alimentation, sommeil. L'acquisition de ces valeurs et de ces notions a en général une incidence directe sur les performances de l'élève dans les matières intellectuelles.

Ce que vient de dire notre collègue est très important : le sport est une véritable école de la citoyenneté.

Il est vrai que nous avons encore une vraie marge de progression, en particulier en ce qui concerne la recherche et l'évaluation. J'ai néanmoins quelques divergences avec vous sur le thème des moyens et sur celui des enseignants.
Autant je suis d'accord lorsque vous dites que l'enseignant a besoin des bonnes méthodes pour aider l'élève en difficulté, autant je me refuse à vous suivre sur le nombre d'élèves en classe. Il est tout de même plus facile de consacrer du temps aux élèves en difficulté lorsque les classes ne sont pas surchargées…
Vous constatez que les dépenses d'éducation en France sont supérieures à la moyenne des pays de l'OCDE – 5,9 % du PIB contre 5,7 % – mais que celles consacrées au primaire sont inférieures à ce que l'on observe dans la plupart des autres pays. La conclusion s'impose. Parler de « rééquilibrage » me semble donc insuffisant. Vous préconisez de clarifier l'organisation des cycles entre l'école maternelle et l'école élémentaire ; mais faute de moyens, les politiques actuelles conduisent plutôt à remettre en cause l'école primaire. Vous proposez de « réduire drastiquement le nombre de redoublements » : je suis pleinement d'accord avec vous, mais savez-vous que ceux-ci sont parfois utilisés par les écoles pour éviter les fermetures de classes imposées par le Gouvernement ? Vous parlez de « prendre en charge réellement les élèves en difficulté » : le Gouvernement remet en cause les RASED par mesure d'économie. Vous vous prononcez pour le retour à la semaine de 5 jours : le passage à la semaine de 4 jours a permis de réduire encore les effectifs des enseignants.
En ce qui concerne les enseignants, je regrette l'emploi de termes comme « management », « reporting », « performance » : on ne peut parler de rentabilité pour l'éducation, ni transposer – comme vous le suggérez de manière voilée – les méthodes de ressources humaines du privé aux enseignants. Je pense pour ma part que loin d'être individualistes, ils ont une réelle conscience de l'intérêt général et qu'il importe de la préserver. Ils ont avant tout besoin de reconnaissance ! Vous proposez enfin d'améliorer la politique salariale en début de carrière, moyennant une moindre progression par la suite et l'instauration de primes au résultat. Ne pensez-vous pas que pour vaincre l'échec scolaire et réduire les inégalités sociales, l'école primaire a plus besoin de « public » que de « privé » ?

Vous avez comparé l'Australie et le Canada avec la France du point de vue de l'impact de l'immigration. Il faut cependant rappeler que l'Australie et le Canada accueillent des immigrants qualifiés, alors que nous accueillons les moins qualifiés – qui sont parfois illettrés dans leur langue d'origine. Comment cette éminente difficulté est-elle prise en compte ?
Par ailleurs, vous n'évoquez pas un phénomène qui tend pourtant à se banaliser, que j'appelle la contre-culture ou l'anti-modèle : c'est désormais le bon élève qui est blâmé par ses pairs, alors qu'on voudrait encourager et valoriser le succès.
Vous déplorez qu'on ne sache pas évaluer. Conseiller général depuis douze ou treize ans, j'ai pourtant toujours entendu dire dans les ZEP que l'on connaissait exactement le niveau des élèves entrant en sixième. On connaît donc celui des élèves qui sortent de CM2 !
Ne pensez-vous pas que le poids du système est celui d'un compromis social ? Les évaluations sont plutôt mal vues dans l'éducation nationale, sans parler du secteur social. Esther Duflo, admirée partout ailleurs, est vouée aux gémonies en France. Les enseignants ne sont inspectés que tous les sept ou huit ans – encore ne s'agit-il que d'augmenter leur note.
Je m'inquiète comme vous de la course aux diplômes : obtenir une agrégation en sciences de l'éducation qui ne signifie nullement que l'on est qualifié pour apprendre à apprendre…
J'aimerais également savoir ce que vous pensez des expériences de busing, qui consistent à sortir des élèves de leur quartier pour lutter contre le poids des déterminismes.
Je me demande pour finir si l'État providence n'aurait pas un effet anesthésiant, les jeunes se laissant porter par le système alors que dans d'autres pays, le struggle for life nourrit un acharnement personnel à la réussite.
Je vous remercie en tout cas d'oser nommer les difficultés et de briser quelques tabous.

Universitaire ayant participé à des inspections, je ne partage absolument pas la vision du monde enseignant que vient de nous donner notre collègue. Les enseignants attendent d'être évalués pour faire progresser leur travail et leurs méthodes et non pour obtenir une note qui n'aura guère de retombées financières.
J'aimerais vous poser une question sur la proposition n° 7. Il vous paraît insensé, avez-vous dit en substance, que l'on puisse devenir enseignant sans avoir jamais mis les pieds dans une classe. Il me semble pourtant qu'il existait jusqu'à il y a peu en première année d'IUFM des modules permettant aux étudiants de fréquenter des salles de classe.
Vous estimez que les recrutements devraient prendre en compte la motivation des candidats. Mais comment faire en pratique ?
Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour ce travail extrêmement intéressant.

On nous a longtemps répété qu'il fallait mettre l'enfant au centre de l'enseignement. Si on ne peut qu'être d'accord avec le principe, le premier acteur de l'enseignement reste tout de même l'enseignant. Enseigner est un métier, qui exige une formation. Dans les années 1960, le recrutement des instituteurs se faisait à bac –3, avec une formation post-bac de deux ans. Aujourd'hui, la formation initiale a totalement disparu : un jeune lauréat s'est vu affecter cette année le jour de la rentrée en cours préparatoire en ZEP sans avoir bénéficié d'aucune formation ! Ne craignez-vous pas que dans quelques années, nous collectionnions les dernières places dans les classements comme PISA ?
Par ailleurs, il serait intéressant de mener une étude sur l'évolution de l'origine sociale des enseignants. De trop nombreux jeunes recrutés à bac+5 choisissent malheureusement ce métier par défaut. N'y aurait-il pas lieu de réinstaurer un recrutement au niveau bac avec une préparation à la licence, complétée par deux années de formation ?
La prise en charge individualisée est en effet essentielle. Le dédoublement des classes expérimenté en 2004 nous a cependant conduits à considérer que les résultats n'étaient pas assez concluants pour justifier une telle dépense. Je pense néanmoins que, dans certains établissements ou certaines zones sensibles, il reste souhaitable, à condition de modifier dans le même temps les pratiques pédagogiques. Dédoubler des classes sans former les enseignants au traitement de la grande difficulté, c'est arroser du sable !
On en revient à ce qui est le fondement du système, la compétence des enseignants. Ils ont besoin d'un certain nombre d'outils. Or si nous avons trouvé des choses pour la lecture, nous n'avons encore rien en mathématiques.
La recherche dont je parle est celle qui peut être comparée à des standards internationaux ou donner lieu à des articles qui ouvrent une perspective. La situation est sérieuse. Je rappelle qu'il se forme chaque année un stock de 300 000 élèves qui entrent au collège sans les bases. Pour traiter ce stock, il nous faut des outils qui puissent être déployés à l'échelle nationale, donc une vision collective de l'institution et de vrais processus. Or plus nous attendons, plus nous prenons de retard.
Nous nous sommes bien sûr intéressés au livre de Peter Gumbel. Notre pays est le champion d'Europe du redoublement – qui continue à se pratiquer couramment bien que la loi de 1989 l'interdise, je le rappelle, en dehors des cycles.
Venons-en au creusement des inégalités. Accepterait-on 40 % d'échec dans le secteur nucléaire ou dans l'armée ?
Certains ont évoqué la masterisation. Le pied de grille, pour un professeur des écoles, tourne autour de 1 300 euros. Les pays qui ont mené à bien des révolutions pédagogiques se sont tous demandé à un moment ou à un autre comment attirer les meilleurs d'une génération vers le métier d'enseignant. Offrir 1 300 euros à des « bac +5 » me paraît à terme strictement intenable. C'est pourquoi nous soulevons la question des salaires en début de carrière.
Je ne pense pas, Monsieur Féron, que nous ayons utilisé dans le rapport le mot « rentabilité ». Il n'est évidemment pas dans notre intention de dire que l'école doit devenir une entreprise. Mais dans la mesure où elle absorbe 22 % du budget de l'Etat, nos concitoyens sont en droit d'en attendre une certaine performance. Savez-vous qu'au lycée, il y a un enseignant pour 14 élèves ? C'est une moyenne, mais elle est extraordinairement luxueuse ! Nous ne disons donc pas qu'il n'y a pas assez de moyens, mais que les arbitrages ont été systématiquement rendus au profit du secondaire, alors que c'est en amont que se préparent les inégalités. Nous avons fait des choix ; nous les payons.
Monsieur Maurer, les Pays-Bas, qui connaissent une immigration comparable à celle de la France, se classent aujourd'hui dans PISA au troisième rang mondial pour les mathématiques et au neuvième pour la lecture. Il y a donc là un sujet que nous n'avons pas su traiter, et qui se traite à mon avis dans la salle de classe. La piste du lien entre la petite enfance et l'école est donc, je le redis, une piste intéressante. Il faut désormais penser non plus à des dynamiques d'institutions, mais à des dynamiques de territoires. Les maires ont ici un rôle très important à jouer.
Il est étrange qu'il n'y ait pas de traduction française pour le mot reporting. C'est la marque d'une société qui n'a pas l'habitude d'évaluer. Le reporting est pourtant un des fondements de la démocratie.
J'ai toujours dit à mes étudiants et à mes enfants, Monsieur Douillet, que la réussite était un produit de facteurs – histoire x mathématiques x anglais x phi, qui est le facteur physique et psychologique. Or pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut et il suffit qu'un des facteurs soit nul. Si phi est nul, tout est compromis…
Dans notre pays, on rend facilement une copie à un élève en lui disant : « c'est nul ! ». L'élève entend : « je suis nul ». Permettez-moi une anecdote personnelle : « Tu rentres sur un court de tennis, ai-je dit un jour à mon fils qui se désespérait, et tu joues au basket. Comment veux-tu avoir une bonne note ? ». Autrement dit : « tu n'es pas nul : tu n'as pas compris ce qu'il faut faire pour avoir une bonne note dans cette matière. » Et je dis peu ou prou la même chose à mes étudiants de Sciences-Po !
Autre caractéristique de notre pays, les programmes sont très lourds et on demande continuellement à l'élève de s'impliquer personnellement. Pendant toute sa scolarité, il est donc habitué à travailler sur la base de programmes et seul. Et lorsqu'il arrive dans la vie active, c'est pour s'entendre dire : « ici, on ne travaille que par équipes et par objectifs » ! Je livre cela à votre réflexion…

Merci infiniment, Messieurs, pour ce débat très intéressant. Ces questions seront certainement abordées à nouveau dans les prochains mois.
La séance est levée à treize heures.