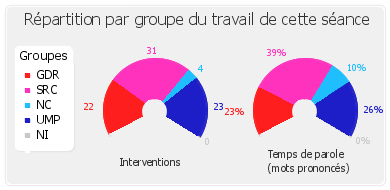Séance en hémicycle du 15 mars 2011 à 21h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (nos 2494, 3116, 3189).
Je vous rappelle que la Conférence des présidents a décidé d'appliquer à cette discussion la procédure du temps législatif programmé, sur la base d'un temps attribué aux groupes de vingt heures.
Chaque groupe dispose du temps de parole suivant : le groupe UMP, cinq heures quinze minutes ; le groupe SRC, sept heures dix minutes ; le groupe GDR, quatre heures vingt-cinq minutes ; le groupe Nouveau Centre, trois heures dix minutes ; les députés non inscrits disposent d'un temps de quarante minutes.
En conséquence, chacune des interventions des députés, en dehors de celles du rapporteur et du président de la commission saisie au fond, sera décomptée sur le temps du groupe de l'orateur.
Les temps de parole qui figurent sur le « jaune » ne sont en tout état de cause qu'indicatifs.
La parole est à Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, la réforme qui est proposée aujourd'hui à votre examen relève d'un domaine très sensible humainement et médicalement car il concerne des personnes souffrant de troubles mentaux. Il s'agit d'un sujet douloureux, qui doit mettre notre pays à la hauteur de ses responsabilités. Je tiens d'ores et déjà à souligner la qualité des travaux parlementaires, et à remercier tout particulièrement le rapporteur Guy Lefrand pour l'investissement si important dont il a fait preuve.
Vous le savez : les troubles mentaux touchent un cinquième de la population française.
En 2008, 1,3 million de personnes adultes ont été prises en charge, dont 70 % exclusivement en ambulatoire. Le projet de loi que vous allez étudier concerne uniquement les personnes atteintes de troubles mentaux sévères, souvent d'allure psychotique, c'est-à-dire 3 % de la population, dont un tiers est diagnostiquée schizophrène, ainsi que les personnes souffrant de troubles névrotiques graves, pour lesquelles il existe, par exemple, un risque imminent de passage à l'acte suicidaire. Au total, 70 000 personnes par an sont accueillies dans les établissements pour une hospitalisation sans consentement. Ces personnes souffrent de troubles mentaux qui les mettent en danger et qui rendent leur consentement aux soins impossible à obtenir.
L'accueil des malades psychiatriques a été prévu dès 1838 par une loi fondatrice. Cette loi combinait pour la première fois l'assistance et la sûreté en créant le placement d'office. Elle obligeait tous les départements de France à se doter d'un établissement spécialisé dans l'accueil des malades psychiatriques. Il y avait donc déjà là une logique territoriale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces établissements historiques sont bien connus et identifiés par l'ensemble de nos concitoyens. Il aura fallu attendre 1990 pour réformer cette loi afin de prévoir que l'hospitalisation libre est la règle et que l'hospitalisation sous contrainte devient une exception, dûment motivée et encadrée.
Néanmoins, la réforme de 1990 n'a pas résolu tous les problèmes posés : elle ne permet pas d'offrir aux malades qui ne peuvent pas consentir aux soins les formes contemporaines de prise en charge, notamment extrahospitalières ; elle ne résout pas le cas des personnes qui doivent être hospitalisées, mais pour lesquelles aucun proche ne peut en faire la demande ; elle fait intervenir immédiatement la mesure d'hospitalisation sous contrainte, alors que, souvent, une période d'observation de trois jours permettrait de dénouer la crise et d'obtenir que le patient consente aux soins, même sous forme d'hospitalisation à temps complet.
C'est précisément une amélioration sur ces trois points que vise le texte qui vous est présenté.
Il est important de rappeler, alors que s'ouvre l'Année des patients et de leurs droits, que toute restriction de liberté d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être motivée que par l'absolue nécessité dictée par son état de santé. C'est pourquoi les dispositions de ce projet s'inscrivent dans les préconisations des différents rapports d'évaluation de la loi du 27 juin 1990, loi dont je viens de rappeler le bien-fondé mais aussi les limites, et plus spécifiquement dans les propositions du rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires remis en mai 2005. Le bilan de l'application de certaines dispositions de la loi a constitué le socle de la réflexion menée depuis, en particulier sur les points suivants : la nécessité de réviser le dispositif pour tenir compte de la diversification des modes de prise en charge en psychiatrie – je crois en effet qu'il s'imposait de ne pas se limiter à la seule modalité de l'hospitalisation complète – ; la nécessité de pallier l'absence de demande d'un tiers pour procéder à l'hospitalisation sans consentement d'une personne car l'on sait qu'une telle absence est de nature à retarder, voire à empêcher, l'accès aux soins ;…
…enfin, la nécessité d'améliorer le fonctionnement des CDHP, les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques. S'agissant de ce dernier point, nous avons en effet constaté que le travail quantitatif de ces commissions départementales, pour louable qu'il soit, l'emporte trop souvent sur le travail qualitatif. Les CDHP, outils au service des droits des usagers, sont parfois embolisées par des examens obligatoires, au terme desquels il n'a toutefois jamais été démontré d'hospitalisation abusive. Ces points à améliorer ont été, depuis l'évaluation de la loi de 1990, systématiquement rappelés dans toutes les concertations, avec les patients et leurs familles comme avec les professionnels des soins psychiatriques.
Ce projet ne remet donc pas en question les fondements du dispositif actuel, qui permet une prise en charge, soit à la demande d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, soit sur décision du préfet. Mais il comprend des avancées substantielles, telle l'intervention du juge des libertés et de la détention, afin de renforcer les droits des personnes garantis par notre Constitution et de se conformer ainsi à la décision du Conseil constitutionnel. En effet, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé, le 26 novembre dernier, qu'« en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions relatives au maintien en hospitalisation sur demande du tiers méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ». Le Conseil constitutionnel a fixé au 1er août la date de l'abrogation des dispositions concernées.
Le texte poursuit un triple objectif : un objectif de santé en permettant une meilleure prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques ; un objectif de sécurité en assurant avant tout celle des patients, mais aussi celle des tiers, lorsque les troubles mentaux de la personne représentent un danger pour elle-même ou pour autrui ; enfin, un objectif de liberté en garantissant aux patients le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles.
L'objectif de santé se traduit par le remplacement de la notion d'hospitalisation par celle de soins. Il sera désormais possible d'offrir à un malade qui ne peut consentir aux soins sur un temps long la possibilité de ne pas devoir être hospitalisé continuellement, mais de bénéficier de l'ensemble de la palette des soins offerts par les services psychiatriques de notre pays. C'est une disposition tout à fait évidente. En effet, il arrive qu'une personne souffrant de troubles mentaux qui altèrent son libre-arbitre refuse d'être soignée, mais elle peut tout de même préférer une mesure de soins ambulatoires à une hospitalisation complète en service psychiatrique. Pourquoi alors lui imposer une hospitalisation complète de plusieurs semaines, hospitalisation dont le principe même freine l'adhésion aux soins ? Pourquoi ne pas offrir au praticien la possibilité d'accéder à ces modalités de soins modernes, qu'il pourra proposer à cette personne si elles-lui sont adaptées ?
Tel est bien le sens du projet de loi qui vous est présenté : dissocier les troubles du consentement des mesures d'enfermement, et limiter celles-ci au strict nécessaire, ce qui souligne la confiance que nous portons aux équipes extrahospitalières. Les outils qu'elles ont développés et les réseaux qu'elles ont tissés au plus proche des lieux de vie de la population permettent désormais de leur confier de plein droit des prises en charge particulières de patients au départ non consentants. Ce sont d'ailleurs bien souvent des patients que ces équipes connaissent déjà à travers les soins libres qu'elles leur procurent au moment où les troubles du consentement s'atténuent. Dès lors, il n'est plus nécessaire de conserver le dispositif des sorties d'essai, de plus en plus utilisé jusqu'alors comme une alternative à l'hospitalisation complète. C'était un dispositif qui allait dans le bon sens. Cependant, il faut bien admettre qu'il était assez limité parce qu'il ne ciblait que la réinsertion des malades, au terme d'une longue hospitalisation. Ce dispositif n'est donc plus utile puisque les alternatives à l'hospitalisation complète vont entrer désormais dans le droit commun des soins sans consentement.
Nombre d'hospitalisations sans consentement d'un patient en état de crise peuvent être évitées par des soins apportés dans les trois premiers jours. Les professionnels le disent : il est dommage d'enclencher des mesures au moment d'une crise si celle-ci est passagère. Nous introduisons donc, conformément aux recommandations des rapports successifs, une période d'observation de soixante-douze heures, qui sera matérialisée par un certificat médical à l'issue de celles-ci. L'instauration de cette période permettra de mieux appréhender l'évolution de l'état mental du patient, et donc de mieux décider des modalités de sa prise en charge si celle-ci s'avère nécessaire, hospitalière ou extrahospitalière, consentie ou non consentie. Pour les raisons déjà énoncées, on crée ainsi une procédure de suivi des patients soignés sans leur consentement sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Ces soins seront dispensés sur la base d'un protocole : celui-ci devra préciser le type de la prise en charge, les lieux de traitement et la périodicité des soins. L'avantage de ce processus, c'est de pouvoir adapter les modalités de la prise en charge à tout moment et de présenter les choses de façon très claire au patient.
Les tiers, souvent des membres de la famille, seront par ailleurs informés du changement de la prise en charge dès lors que l'hospitalisation complète s'interrompt. Concernant les familles, comme l'ont souligné de nombreux rapports, il apparaît que nombre de patients ont perdu tout lien avec la leur et avec leurs proches, et qu'il est alors très difficile de les faire entrer en soins. Parfois, la famille est là, mais il lui est trop difficile d'accepter l'idée de formuler une demande de soins psychiatriques pour son proche.
Les professionnels nous le disent : ils cherchent pendant des heures un tiers qui accepte de formuler une demande. C'est directement l'accès aux soins qui est alors mis en jeu, ce que nous ne pouvons tolérer. Il arrive parfois aux professionnels de la psychiatrie de devoir abusivement enclencher des hospitalisations d'office pour des patients qui ne présentent pas un risque majeur pour autrui.
Ce n'est pas satisfaisant, en effet.
C'est pourquoi la nouvelle procédure permettra au directeur de l'établissement, dans le seul cas de péril imminent pour la santé du patient, de prononcer l'admission du patient lorsqu'il n'est pas possible de recueillir une demande d'un tiers. Cette disposition a pour but de permettre aux personnes pour lesquelles il existe une urgence psychiatrique avérée d'être prises en charge immédiatement, et de ne pas dépendre de la présence, ou non, de proches.
Il arrive aussi parfois qu'un proche demande la sortie d'une personne hospitalisée sous contrainte, ce que la loi de 1990 autorise de plein droit. Le patient n'est donc plus soigné, ce qui engendre un risque grave pour la personne : par exemple, un patient sort à la demande de sa famille, alors qu'il est victime de d'un risque suicidaire encore majeur. Pour ces cas très particuliers, toujours très difficiles à vivre pour les médecins et leurs équipes, le projet de loi permet au psychiatre de s'opposer à cette sortie, dès lors qu'il existe un péril imminent pour la santé de ce patient. Cette mesure permet d'apporter des garanties supplémentaires en termes de continuité des soins.
J'en viens à l'objectif de sécurité, sécurité pour les patients mais aussi sécurité juridique pour les acteurs.
Garantir la continuité des soins est un objectif de santé, mais c'est aussi un objectif de sécurité, d'abord pour le patient, qui est avant tout une personne bien souvent victime de ses propres actes. Les personnes souffrant de troubles mentaux ont fréquemment des comportements qui leur nuisent, en effet. Elles sont aussi plus souvent victimes d'agressions. Faciliter l'accès aux soins, améliorer leur prise en charge, c'est donc directement agir pour leur sécurité, et pour la qualité de vie des aidants.
Par ailleurs, le projet de loi introduit des modalités particulières pour certains patients. Il s'agit de ceux qui ont fait l'objet d'une hospitalisation en application des articles L. 3213-7 du code de la santé et 706-135 du code de procédure pénale, c'est-à-dire qui ont été déclarés irresponsables pénalement en raison de leurs troubles mentaux. Ce sont aussi des personnes qui, au cours d'une hospitalisation sur décision du représentant de l'État, auront séjourné dans une unité pour malades difficiles.
Pour mieux encadrer le passage de l'hospitalisation complète aux autres formes de prise en charge, il sera nécessaire d'accompagner la proposition du psychiatre d'un avis collégial. Celui-ci associera le psychiatre traitant du patient, un psychiatre de l'établissement et un membre de l'équipe qui suit le patient au quotidien : cadre de santé, assistant social, infirmier, psychologue. Le but de cet avis est bien entendu de conforter l'examen du psychiatre traitant.
L'ensemble de ces avis seront d'ailleurs transmis au préfet pour étayer sa décision. En cas de désaccord entre, soit les membres du collège, soit le collège et les experts, il appartiendra au préfet de suivre, ou non, l'avis du psychiatre traitant, le cas échéant en sollicitant une ou des expertises supplémentaires.
J'en arrive au troisième axe majeur de ce projet de loi : l'objectif de garantie des libertés individuelles des patients.
La proportionnalité de la mesure d'hospitalisation complète, dès lors que celle-ci excède quinze jours, sera soumise au contrôle systématique du juge des libertés et de la détention. Le Gouvernement a fait le choix de prévoir un renouvellement du contrôle de plein droit exercé par ce juge tous les six mois, à compter de la dernière décision prise par le juge.
Je rappelle que cette saisine automatique du juge s'ajoute au recours facultatif, déjà prévu par le code de la santé publique, et qui, bien entendu, est maintenu : le patient peut déjà saisir à tout moment le juge des libertés, et conservera ce droit à l'avenir.
Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi de la conformité à la Constitution du régime de l'hospitalisation d'office. Il n'en demeure pas moins que les garanties demandées par le Conseil constitutionnel pour les hospitalisations à la demande d'un tiers doivent également être apportées aux hospitalisations d'office. La nécessité de faire intervenir le juge, en cas de prolongation de l'hospitalisation au-delà de quinze jours puis de six mois, doit donc également être requise pour les mesures d'hospitalisation d'office.
Mesdames et messieurs les députés, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, ce projet de loi vise à permettre un meilleur accès aux soins pour les malades, selon les modalités qui leur seront le mieux adaptées, aux différents moments de l'évolution de leur pathologie psychiatrique. Il permet également de garantir à l'ensemble de la population, aux patients et à leurs proches que toute personne pourra être prise en charge de manière continue et efficace, dès lors qu'il existe un risque grave d'atteinte à la sécurité de la personne malade et à celle d'autrui.
Je crois que le texte auquel nous sommes parvenus, après les travaux d'évaluation de la loi de 1990, les différentes concertations et les travaux en commission, est nuancé et équilibré. En ce domaine, l'équilibre est particulièrement difficile à trouver, car il y a toujours le risque, soit de stigmatiser les personnes atteintes de troubles mentaux, soit de dénier la spécificité de leurs troubles et des conséquences de ceux-ci.
C'est sur cet équilibre, mesdames et messieurs les députés, que vous allez débattre et vous prononcer. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je n'interviendrai quant à moi que sur l'aspect juridique de ce texte.
Le projet de loi soumis à votre examen modifie profondément notre droit en rénovant les modalités de prise en charge des patients en soins psychiatriques ainsi que la protection de leurs droits et libertés. Il met aussi l'institution judiciaire face à un véritable défi dont l'échéance, au 1er août prochain, arrive à grands pas.
Comme vous le savez, le volet « judiciaire » de ce projet vise à mettre le droit français en parfaite conformité avec les exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 novembre 2010, a en effet estimé nécessaire que soit instauré un contrôle systématique des mesures d'hospitalisation sans consentement par le juge judiciaire, qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, est le gardien de la liberté individuelle.
Le texte du Gouvernement prévoit ainsi un contrôle de plein droit du juge dans les quinze jours suivant l'admission en hospitalisation complète, qu'elle intervienne sur décision du directeur d'établissement ou sur décision du préfet. Le projet apporte une garantie supplémentaire en imposant qu'après ce premier contrôle à quinze jours le juge judiciaire intervienne de six mois en six mois, aussi longtemps que se poursuit la mesure.
Il s'agit là d'un véritable défi, car la mise en oeuvre de ce contrôle systématique, qui est d'abord un progrès de l'État de droit et doit être salué comme tel, exigera des juridictions et de l'ensemble des acteurs judiciaires un effort considérable et une mobilisation sans précédent.
En effet, le nombre de décisions juridictionnelles auxquelles donnera lieu ce nouveau régime de contrôle a été évalué, dans l'étude d'impact qui vous a été soumise, à environ 65 000 chaque année. Bien évidemment, le Gouvernement est déterminé à tout mettre en oeuvre pour que cette réforme soit accompagnée, dans les délais les plus brefs possibles, des moyens nécessaires, et des mesures vont être annoncées dans quelques jours. Mais cette réforme exigera aussi une organisation sans faille des juridictions afin qu'elles soient en mesure de faire face dès le 1er août aux nouvelles responsabilités que le législateur entend leur confier.
Aussi souhaitais-je appeler votre attention et votre vigilance, au cours des débats, sur l'impact de la réforme pour les juridictions et, au-delà, sur les principes qui doivent sous-tendre nos travaux.
Gardons-nous en effet de vouloir « toujours plus de juge », là même où son intervention n'est pas absolument nécessaire. Gardons-nous, surtout, de confondre les rôles et de faire jouer au juge celui de l'autorité administrative ou celui du médecin. La réforme ambitieuse que nous sommes en train de bâtir ensemble ne fonctionnera que si chacun remplit l'office qui lui revient en vertu de ses compétences et de sa place dans le fonctionnement de l'État.
À cet égard, je salue les travaux riches et intenses que votre rapporteur et votre commission des affaires sociales ont menés depuis quelques semaines, en peu de temps d'ailleurs.
Je veux saluer aussi les nombreuses améliorations qu'ils ont apportées au texte. J'ai cependant la conviction qu'il faut chercher encore un meilleur équilibre sur deux points importants à mes yeux.
Je veux que l'on parvienne au meilleur équilibre possible et je suis sûr que l'Assemblée sera d'accord avec moi.
La semaine dernière, la commission des affaires sociales a considéré que le rôle du juge devait être enrichi sur deux points pour compléter le dispositif proposé par le Gouvernement : d'abord par une intervention systématique du juge en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre, ensuite par la faculté donnée au juge d'ordonner des soins ambulatoires lorsqu'il est saisi d'une mesure d'hospitalisation complète.
En tant que telles, ces extensions de compétences du juge des libertés et de la détention ne m'apparaissent ni nécessaires au regard des exigences constitutionnelles ni opportunes même si, pour une partie au moins, les préoccupations qui les inspirent appellent des réponses.
Votre commission entend confier au juge le rôle d'« arbitre obligé » en cas de conflit entre le représentant de l'État et l'équipe soignante s'agissant de la modification éventuelle des modalités de soins. Appartient-il réellement au juge judiciaire d'intervenir systématiquement comme arbitre des divergences entre préfets et psychiatres, à quelque stade qu'elles apparaissent et en l'absence même de recours de l'intéressé ?
Honnêtement, je ne le crois pas. Ce serait aller très au-delà des exigences du droit, droit interne ou conventionnel. Il risque d'y avoir de nombreux conflits entre les préfets et les médecins.
Il n'appartient pas au juge d'être administrateur.
Il lui appartient tout à fait, en revanche, de juger si la décision de l'administrateur a été ou non la bonne. Mais, je le répète, ce n'est pas au juge de se faire administrateur. Si le préfet a une position et si le médecin en a une autre, ils ne vont pas appeler le juge comme arbitre. Il appartient très naturellement à l'administrateur d'assumer toutes ses responsabilités et de rechercher, avec le concours des médecins, le bon équilibre entre la protection de l'ordre public et les besoins du patient. Et une fois la décision prise, il est tout à fait normal que l'on puisse intenter un recours contre elle.
Monsieur Mallot, compte tenu des responsabilités auxquelles vous prétendez, c'est au contraire une affaire simple !

Vous voulez sans doute parler de ma candidature à la présidentielle ? (Sourires.)
Le décret du 16 fructidor an III interdit au juge de se faire administrateur, c'est-à-dire qu'il ne lui appartient pas de prendre la responsabilité de l'administration.
Il s'agit de donner au juge le pouvoir de contrôler l'administration, et éventuellement, comme cela existe partout…
Je ne suis pas embêté du tout…
Je répète simplement que le juge n'est pas un administrateur, qu'il peut être saisi, comme toujours,…
…de toute décision de l'administration. Il est donc possible de contester la décision devant un juge. Vous êtes vous-même, monsieur Le Guen, administrateur local. Il peut arriver que l'on conteste vos décisions. En revanche, ce n'est pas le juge qui prend la décision, mais l'administrateur.
Après, on conteste la décision de l'administrateur.
Il sera impossible de faire fonctionner le système si, chaque fois que le préfet et le médecin ne sont pas d'accord, ils décident d'appeler le juge comme arbitre.
Aujourd'hui déjà, des procédures sont prévues. Et si les choses se passent comme je le dis, on n'a plus de problème, monsieur le rapporteur ; l'affaire sera réglée et j'en serai heureux !
Bref, il est tout à fait normal que l'on puisse contester devant le juge la décision du préfet.
Ce recours, il est possible, il existe et, aujourd'hui même, le texte prévoit qu'il peut être fait par le patient, bien entendu, mais également par toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci. Nous sommes tout à fait d'accord pour que ces règles simples et claires puissent s'appliquer.
Avez-vous donc l'intention de parler toute la soirée, monsieur Le Guen ?

Monsieur le ministre, veuillez poursuivre, M. Le Guen n'a pas la parole.
Je n'ai aucun problème pour débattre avec vous quand vous voulez, mais à condition que ce soit un vrai débat !
Je veux donc insister sur le fait que le recours au juge est d'ores et déjà possible. Le Gouvernement l'admet parfaitement. Mais ce qui nous pose un problème, c'est que l'on vienne demander au juge d'arbitrer entre deux autorités : l'autorité médicale et l'autorité préfectorale,…
…parce que ce n'est pas son rôle. Que l'on conteste devant le juge la décision du préfet, c'est normal, acceptable,…
…et cela doit pouvoir se faire ; le Gouvernement en est tout à fait d'accord.
Je rappelle que la règle est simple : dès aujourd'hui, le directeur de l'établissement peut, sur simple déclaration recueillie auprès du patient, lancer le recours. C'est ce qui est prévu et nous n'avons aucun problème pour aller dans ce sens.
Afin de renforcer davantage l'effectivité de ce recours, je suis d'ailleurs tout à fait favorable à ce que l'on prévoie dans la loi que le patient doit être informé des conclusions du psychiatre, de la possibilité pour lui de former un recours et de son droit d'être assisté à l'audience par un avocat. Cette option me paraît tout à fait appropriée et replace chacun des acteurs dans son rôle.
Certains parlementaires ont déposé des amendements visant à substituer, en cas de conflit entre l'équipe soignante et le préfet, l'exigence d'une information spécifique du patient pour la saisine de plein droit du juge. Je tiens à souligner que le Gouvernement est favorable à ce dispositif et fait pleine confiance aux débats parlementaires pour faire émerger une solution équilibrée.
Votre commission des affaires sociales a également souhaité la semaine dernière que le juge puisse substituer à une mesure d'hospitalisation sans consentement des soins ambulatoires sans consentement au lieu de se limiter à en prononcer la levée ou le maintien. Si j'ai bien compris ce qu'a déclaré le rapporteur, un accord a été trouvé sur ce point ou est en passe de l'être.
Je comprends parfaitement l'intention qui sous-tend cette demande, mais il me paraît important que ne soient méconnus ni le sens de l'exigence, rappelée par le Conseil constitutionnel, d'une intervention accrue du juge dans le suivi des mesures, ni la nature de l'office du juge.
Le nouveau contrôle de plein droit du juge dans les quinze jours de l'admission en hospitalisation complète, puis tous les six mois, permettra d'assurer la conformité de notre droit à l'article 66 de la Constitution.
En revanche, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur les mesures de soins ambulatoires sans consentement.
Il n'a en effet aucune légitimité pour ordonner lui-même une telle mesure et arbitrer entre les très nombreuses modalités de soins auxquelles peut concrètement renvoyer cette forme de prise en charge.
Mais on ne saurait davantage envisager que le juge doive se borner à ordonner des soins ambulatoires sans en définir les modalités précises, ni être en mesure d'apprécier le degré d'atteinte aux libertés qu'elles impliquent : transformer le juge en caution médicale serait contraire aux exigences constitutionnelles.
C'est la première fois que je vois un médecin vouloir être remplacé par un juge, monsieur Le Guen. J'ai bien fait de venir !

Et moi, c'est la première fois que je vois un garde des sceaux prendre la poudre d'escampette, car c'est bien ce que vous êtes en train de faire !
Ainsi, le choix de l'opportunité d'un protocole de soins comme de ses modalités est et doit rester de la seule compétence des médecins.
Certains objecteront peut-être qu'un recours à l'expertise pourrait permettre au juge d'intervenir légitimement pour ordonner une mesure de soins ambulatoires. Un tel recours à l'expert est-il souhaitable ? Est-il seulement possible ? Je ne le pense pas. Pourquoi ?
Tout d'abord, chacun en convient, le nombre d'experts psychiatres disponibles est aujourd'hui très réduit, alors même que le nombre de missions judiciaires est en constante augmentation. Nous connaissons par ailleurs leurs inquiétudes fortes relatives à leur organisation pour répondre au mieux à leur rôle d'auxiliaire de justice.
Ensuite, le recours à l'expertise est un facteur d'allongement des procédures, en particulier s'il est demandé à l'expert la mission plus complexe consistant à proposer, le cas échéant, un protocole de soins. Or, dans le cadre du contrôle de plein droit, cet allongement n'est compatible ni avec les exigences constitutionnelles ni avec les exigences conventionnelles.
Je rappellerai simplement que l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne exige en effet que le recours soit examiné à bref délai. On ne doit pas oublier que cette exigence a valu à notre pays d'assez nombreuses condamnations devant la Cour de Strasbourg. Il importe de donner à la justice les moyens de les éviter à l'avenir.
Enfin, le recours accru à l'expertise aurait un impact budgétaire significatif sur les finances publiques, que l'on peut d'ores et déjà chiffrer à plusieurs millions d'euros. Il faut en avoir clairement conscience à l'heure où nous engageons les débats sur ce texte.
Le projet de loi, s'agissant en particulier du contrôle de plein droit, s'est efforcé d'assurer au juge les moyens de circonscrire l'expertise à un petit nombre de dossiers, ceux dans lesquels les avis conjoints de deux psychiatres, ou l'avis du collège de professionnels de santé s'avéreraient insuffisants.
Enfin, et je sais que ce point vous tient à coeur, vous devez être rassurés : la continuité des soins n'est pas méconnue par le texte qui vous a été proposé par le Gouvernement et elle peut être encore mieux garantie.
Le projet du Gouvernement prévoit la possibilité pour l'équipe médicale de mettre en oeuvre des soins ambulatoires sans consentement à l'issue d'une décision judiciaire de mainlevée d'hospitalisation.
Je ne verrais que des avantages à ce que la transition entre les deux régimes soit mieux garantie encore, et je sais que votre rapporteur, soutenu par la commission des affaires sociales, vous proposera des amendements en ce sens, avec lesquels je veux d'emblée marquer mon accord. Nora Berra vous signifiera elle aussi que c'est la position de l'ensemble du Gouvernement. Ainsi, nous ferons en sorte que la garantie des droits soit effectivement assurée et que les patients bénéficient des soins les plus adaptés à leur situation.
Comme je le disais en commençant, le juge, en vertu de l'article 66 de la Constitution, est le garant des libertés individuelles. C'est la grandeur de sa tâche en même temps que sa spécificité. Je fais confiance à la sagesse de l'Assemblée pour parvenir, à l'issue de ces débats, au texte le plus équilibré possible, qui soit en même temps opérationnel…
…et qui permette aussi au juge de remplir son office. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Guy Lefrand, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, avant d'aborder la question des soins psychiatriques sans consentement, qui fait l'objet du texte qui nous est soumis aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de manière plus globale de la santé mentale dans notre pays et, peut-être, contribuer ainsi à éclairer sous un nouveau jour le sujet que nous allons examiner.
Vous le savez, une personne sur cinq, chaque année, et une sur trois si l'on regarde la prévalence pendant la vie entière, est atteinte de troubles mentaux.

Une personne sur cinq est atteinte de schizophrénie, d'un trouble bipolaire, d'une addiction, de dépression ou d'un trouble obsessionnel compulsif. Ces cinq maladies mentales font partie des dix pathologies jugées les plus préoccupantes pour le XXIe siècle par l'Organisation mondiale de la santé.

En France, 20 % de la population souffrent d'une pathologie relevant de la psychiatrie. La schizophrénie représente 1 % de la population générale…

…et 15 % des schizophrènes se suicident. Les personnes atteintes de troubles mentaux dans la population générale sont douze fois plus victimes d'agressions physiques, cent trente fois plus victimes de vols et ont une espérance de vie de vingt-cinq ans inférieure à celle de leurs concitoyens.
Le rapport remis par Édouard Couty à la ministre chargée de la santé en janvier 2009 sur les missions et l'organisation de la santé mentale en France prévoit en outre une augmentation de 50 % de la contribution des maladies mentales à la morbidité générale si aucune mesure n'est prise.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je milite fermement pour l'élaboration d'un grand plan santé mentale, comme il y eut un plan cancer et un plan Alzheimer.
Ce plan est indispensable à plus d'un titre. Tout d'abord, en matière de recherche, car la France a accumulé beaucoup de retard et y consacre peu de moyens si l'on compare avec les dépenses de prise en charge des maladies mentales.

La prévention et la gestion des alertes doivent également être améliorées.

Une meilleure organisation de la réponse à ces alertes et, tout simplement, leur meilleure prise en compte sont indispensables. C'est le sens des amendements que nous avons votés ensemble, à l'unanimité, en commission.
De plus, une meilleure formation des médecins généralistes permettrait une détection plus précoce des troubles et un diagnostic moins tardif. Je vous rappelle en effet que les troubles bipolaires souffrent aujourd'hui d'un retard moyen de diagnostic de huit à neuf ans. Cela permettrait de limiter les recours à la contrainte.
Cela nous amène inévitablement à la question de l'organisation des soins et à la démographie médicale. Nous sommes, dans ce contexte, confrontés à un paradoxe : la France est au deuxième rang mondial en nombre de psychiatres par habitant, mais il lui manque plus de mille médecins hospitaliers. Or ce sont eux qui traitent les pathologies les plus lourdes. Une remise en cause de l'organisation actuelle et l'accentuation des moyens, notamment avec un renforcement des structures ambulatoires, sont indispensables.
Enfin, il est tout simplement impératif que les maladies mentales soient mieux connues et mieux acceptées par la population. Nous devons en parler sans tabou, sans stigmatiser celles et ceux qui en sont les victimes, pour qu'un plus grand nombre de personnes malades puissent in fine accéder aux soins. On ne le dira jamais assez : les personnes atteintes de maladies mentales sont avant tout des personnes qui souffrent et qui ont besoin de soins.

Comme je l'ai souligné lors de la réunion de la commission des affaires sociales, aujourd'hui, le premier risque pour ces personnes n'est pas l'hospitalisation abusive mais l'absence de détection et de prise en charge de leur pathologie.

Loin des travers caricaturaux que certains militants souhaitent, à tort, lui attribuer, le projet de loi que nous examinons a pour premier objectif de faire en sorte que les soins adéquats soient apportés aux personnes qui en ont besoin, que celles-ci soient conscientes ou non de leur maladie.

Car s'il doit y avoir des soins sans consentement, c'est avant tout parce que, dans bien des cas, la personne malade n'est pas consciente de ses troubles et n'est donc pas en mesure de consentir aux soins alors même qu'ils sont nécessaires.
Si, comme l'a souligné un amendement de Mme Fraysse adopté par la commission, l'hospitalisation libre reste évidemment la voie à favoriser pour permettre aux personnes malades de se soigner, cela n'est malheureusement pas toujours possible, en raison de l'état mental de la personne souffrant de ces troubles. C'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir admettre en soins sans consentement sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du préfet, des personnes qui ont besoin d'une prise en charge immédiate et qui, le cas échéant, représentent un danger pour autrui mais surtout pour elles-mêmes. Je vous rappelle que, sur les 12 000 suicides recensés chaque année, 4 000 sont attribués à des personnes souffrant de pathologie mentale. C'est un versant sécuritaire de la loi que j'assume parfaitement.
Toutefois, depuis l'adoption en 1838 d'une législation spécifique sur les soins psychiatriques, qui reste d'ailleurs l'ossature du texte actuel, les droits et la protection des patients hospitalisés sans leur consentement n'ont cessé d'être renforcés.
Avant même la loi du 27 juin 1990, la loi du 2 février 1981 a contribué à asseoir le contrôle du juge judiciaire sur les décisions de l'administration, et nous aurons l'occasion d'y revenir, monsieur le ministre. La montée en puissance du juge, rendue nécessaire par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, apparaît ainsi comme un processus continu, à l'oeuvre depuis trente ans.
Quant à la loi de 1990, si elle a conservé les deux modes d'hospitalisation sans consentement prévus par la loi de 1838, l'hospitalisation sur demande d'un tiers et l'hospitalisation d'office, elle a par ailleurs consacré un socle de droits incompressibles pour les patients hospitalisés sans leur consentement et amorcé un rééquilibrage au sein du dispositif de l'hospitalisation d'office entre les considérations sanitaires et les considérations d'ordre public, renforçant le caractère médical des hospitalisations. Cette évolution a ensuite été confirmée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a exigé une atteinte « grave » à l'ordre public pour justifier l'hospitalisation d'office.
En prévoyant l'information régulière des patients sur leurs droits, notamment au recours, et sur leur état de santé, et en consacrant, conformément à la décision du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel, une place accrue au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, dans le contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, le projet de loi s'inscrit dans la lignée des textes qui l'ont précédé.
La commission des affaires sociales a toutefois considéré que le projet de loi, dans sa version issue de la lettre rectificative du 26 janvier, restait au milieu du gué. Vous l'avez souligné et je vous en remercie, madame la secrétaire d'État : c'est le texte de la commission qui apparaît parfaitement équilibré.
Sur proposition de son rapporteur, la commission a choisi de prévoir un recours automatique au juge en cas de désaccord, objet de votre inquiétude, monsieur le ministre, entre le psychiatre et le préfet sur la levée de la mesure de soins. Je me permets de vous rappeler que le psychiatre donne un avis et que le préfet prend une décision. Le juge interviendra sur la décision du préfet, non sur une divergence entre les deux. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
Il s'agit là d'une avancée importante, qui s'inscrit dans la lignée du rééquilibrage à l'oeuvre dans notre législation entre le sanitaire et l'ordre public, avancée qui était attendue sur le terrain, tant par les psychiatres que par les familles.
Par ailleurs, la commission a souhaité rétablir la possibilité, prévue dans le projet de loi initial, pour le juge de substituer une forme de prise en charge à une autre lorsqu'il est saisi dans le cadre d'un recours individuel et d'étendre cette faculté aux cas qui lui seront soumis dans le cadre du contrôle automatique.
L'objectif poursuivi au travers de ces amendements était de renforcer l'obligation pesant sur le patient de se soigner, même lorsqu'une hospitalisation complète n'est pas jugée nécessaire. Néanmoins, monsieur le ministre, j'ai entendu l'interpellation des magistrats et votre inquiétude quant aux difficultés concrètes d'application que pourrait entraîner cette dernière disposition, notamment en termes de suivi de l'application du jugement, et eu égard à la charge déjà importante incombant au juge dans le dispositif prévu par le projet de loi. Je vous proposerai donc, par voie d'amendements, de préciser plus clairement dans le texte que la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète décidée par le juge ne signifie pas pour autant l'arrêt de tout soin – nous sommes bien sur deux versants différents, l'hospitalisation complète et les soins – et que le patient peut ensuite être admis en soins sans consentement sous une autre forme.
Par ailleurs, le texte ne fait pas fi des préoccupations liées à la sécurité de nos concitoyens en prévoyant des mesures de précaution renforcées pour certaines catégories de malades dont la dangerosité potentielle apparaît plus élevée. Ces précautions consistent notamment en des avis médicaux supplémentaires requis lorsqu'il est envisagé de modifier la forme de prise en charge, ou de prononcer la levée des mesures de soins dont font l'objet les personnes déclarées pénalement irresponsables.
La commission des affaires sociales, suivant en cela la proposition de son rapporteur, a cependant voulu, je crois à l'unanimité, introduire une forme de droit à l'oubli, rendant inopérantes ces dispositions lorsque l'événement déclencheur a eu lieu un nombre d'années suffisant auparavant, nombre d'années qui sera déterminé par décret en Conseil d'État, nous aurons l'occasion d'y revenir dans la discussion des amendements.

L'objectif est d'éviter une stigmatisation injuste de ces personnes et de ne pas rendre plus difficile leur sortie de soins.

Enfin, je voudrais dire quelques mots sur le changement de paradigme auquel procède le texte en substituant, vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, à la notion d'« hospitalisation sans consentement » celle de « soins sans consentement ». Il s'agit là, selon nous, d'une évolution très importante dans la conception des soins psychiatriques sous contrainte, qui réduit l'enfermement à une simple modalité de soins parmi d'autres.
Recommandée dans le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires de 2005, cette formule non seulement met fin aux dérives constatées dans la pratique des sorties d'essai renouvelées parfois pendant plus de dix ans, mais contribue à réexaminer nos pratiques et notre organisation médicale au service des personnes malades. C'est dans cette perspective que la commission propose, d'une part, de confier à l'agence régionale de santé la responsabilité d'organiser la gestion des urgences psychiatriques, d'autre part, de prévoir que des conventions soient conclues, à l'initiative des directeurs d'établissement psychiatrique, avec tous les acteurs concernés, afin d'assurer le suivi et l'accompagnement des personnes faisant l'objet de soins sans consentement sous forme ambulatoire.
Nous avons eu en commission un débat constructif et apaisé sur ce texte. Nombre d'entre nous, que ce soit en raison de leur profession ou de leur qualité d'élu local, se sont en effet trouvés, un jour ou l'autre, confrontés à des cas d'hospitalisation sous contrainte. Et si chacun a pu avoir connaissance d'erreurs, dans un sens comme dans un autre, de cas de personnes hospitalisées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être ou de patients qui sortent du système de soins prématurément, nous savons que le dispositif des soins psychiatriques sans consentement est nécessaire et utile.
D'aucuns souhaiteraient que le préfet y joue un rôle moins important, d'autres voudraient que seul le juge puisse décider de soins sous contrainte – cela a été proposé lors des auditions –, que les familles soient plus ou moins présentes, que l'hospitalisation reste la norme, soit pour des questions de facilité de soins, soit, au contraire, pour des questions de sécurité. Mais nous poursuivons tous, mes chers collègues, un même objectif : préserver l'équilibre fragile, sur lequel repose l'édifice de la loi de 1990, entre la nécessité d'apporter des soins, le respect des libertés individuelles et la protection de la sécurité de tous.
À cet égard, je crois, ainsi que vous l'avez indiqué, que le texte issu de la commission des affaires sociales préserve l'équilibre entre santé, liberté et sécurité.

Je ne doute pas que le débat que nous allons avoir et les amendements que nous allons examiner venant de part et d'autre de l'hémicycle nous permettent de conforter cet équilibre. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5, du règlement.
La parole est à M. Serge Blisko.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le 5 mai 2010, le Gouvernement avait déposé un projet de loi sur les droits et la protection des personnes bénéficiant de soins psychiatriques. Ce projet, qui devait initialement être discuté à l'automne dernier, est devenu une construction législative quelque peu hasardeuse puisque, par une lettre rectificative, le Gouvernement a été obligé de tenir compte des obligations nées de la récente décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010.

Ce projet de loi visait à réformer la loi du 27 juin 1990, ressentie par beaucoup de soignants et de familles, on l'a assez dit, comme mal appliquée, d'application difficile et assez peu respectueuse des droits des malades, en particulier peu en phase avec la loi du 4 mars 2002.
Mais, depuis plusieurs années, le contexte s'est modifié : s'est surajoutée une inquiétude sécuritaire qui se traduit par une mise en exergue et une surmédiatisation de faits tragiques impliquant des malades psychiatriques. Je citerai le terrifiant crime de l'hôpital psychiatrique de Pau ou encore la mort, le 12 novembre 2008, d'un étudiant assassiné par hasard dans une rue passante de Grenoble par un malade schizophrène qui venait de fuguer de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève.
Quelques jours après ce drame, le Président de la République présentait à l'hôpital psychiatrique d'Antony, dans un discours resté malheureusement célèbre, un projet de réforme de la loi de 1990, ainsi qu'un plan de sécurisation des hôpitaux qui prévoyait la création de multiples chambres d'isolement, de nouvelles places en unités pour malades difficiles, un contrôle préfectoral des permissions de sortie. Il annonçait la systématisation des soins sous contrainte et suggérait même l'utilisation de bracelets électroniques pour les malades, assimilés ainsi à des délinquants.
Il s'agissait d'ailleurs d'une récidive de sa part puisqu'une première tentative avait eu lieu en 2007, mais le ministre de l'intérieur de l'époque avait dû reculer devant la réprobation unanime de toutes les équipes soignantes quand il avait imaginé réformer l'hospitalisation sous contrainte en neuf articles dans une loi de prévention de la délinquance.

Cette fois-ci, nous y sommes, et les soignants et les patients comprendront enfin où se trouve l'autorité.
Le projet de loi a donc poursuivi son chemin et il arrive aujourd'hui bien mal ficelé.
En effet, vous l'avez tous dit, il s'est alourdi et complexifié suite à la décision du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel, qui avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. Plusieurs articles du code de la santé publique relatifs à l'hospitalisation psychiatrique à la demande d'un tiers ont été censurés a posteriori et le Conseil constitutionnel a précisé le contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation sans consentement. Car vous avez à juste titre, madame la secrétaire d'État, élargi la décision du Conseil aux hospitalisations d'office décidées par l'autorité publique.
Je souhaite, en exposant cette motion de rejet préalable, montrer à quel point ce projet de loi est irrecevable sur trois points.
Depuis 1838, loi princeps, en passant par 1990, des lois successives créent une dérogation spécifique aux malades mentaux en autorisant que le maintien à l'hôpital soit organisé contre leur gré, sans leur consentement, soit pour répondre à leur intérêt propre par l'hospitalisation sur la demande d'un tiers, soit en raison d'un trouble grave de l'ordre public ou à la sécurité des personnes par l'hospitalisation d'office.
M. le rapporteur a donné des chiffres que je ne conteste pas, mais il faut dire que le nombre d'hospitalisations d'office dans ce pays, plus de 13 000 par an, est tout de même extrêmement élevé par comparaison avec des pays voisins. De ce point de vue, nous devons nous interroger sur les difficultés que nous avons à entamer un dialogue avec un certain nombre de personnes malades pour ne pas arriver à cette extrême brutalité, même si elle est parfois nécessaire, qu'est l'hospitalisation d'office.
Le projet de loi que nous discutons vise à apporter une réponse à un problème complexe, nous le savons tous. En effet, il est particulièrement ardu de définir les critères permettant d'évaluer le risque de dangerosité d'un malade mental, et peut-être plus encore de déterminer à partir de quand les soins qui lui ont été prodigués longuement, pendant des semaines, voire des mois, autorisent qu'il puisse sortir d'un établissement sans créer de risques majeurs pour les tiers.
On voit bien que la procédure d'hospitalisation sous contrainte pourrait être orientée soit dans le champ de la sécurité publique soit dans celui de la santé publique.
Malgré les améliorations incontestables, monsieur le rapporteur, qui ont été apportées au texte initial par le travail en commission…

…le climat apaisé et l'écoute attentive dont vous avez fait preuve à l'égard de tous les députés, quelle que soit leur opinion, vous avez été, hélas ! contrecarré par l'autisme du Gouvernement. Le texte proposé reste peu protecteur, voire menaçant pour les droits du malade. Il n'est pas arrivé à se situer clairement dans le champ de la santé publique et c'est là son principal défaut.

Enfin, ce texte s'inscrit dans un contexte de grande souffrance de la psychiatrie publique en France. C'est ce contexte totalement occulté parfois, même si ce n'est pas le cas ce soir, qui amène à douter très fortement des chances de réussite de ce projet de loi.

J'affirmais il y a quelques instants que la logique sécuritaire l'emportait sur la logique sanitaire. En effet, ce projet de loi crée le soin sous contrainte en ambulatoire. Cela nous pose à tous de graves questions de principe. La création d'une « obligation de soins », qui ne se réaliserait pas nécessairement à l'hôpital mais pourrait se décliner en ambulatoire, permettrait d'aborder la question du consentement aux traitements, d'éviter autant que possible de recourir à l'hospitalisation – point positif selon vous, qui arguez du coût, mais aussi du traumatisme que peut constituer l'enfermement, a fortiori dans un lieu très fortement stigmatisé – et de sortir de l'hypocrisie de certaines sorties d'essai prolongées, parfois des années durant et utilisées de fait comme des contraintes au traitement ambulatoire.
De ce point de vue, n'aurait-il pas été plus prudent, dans un premier temps, d'expérimenter ce changement de paradigme, pour reprendre vos propres termes ? À la suite d'une hospitalisation sous contrainte, on aurait pu imaginer une période intermédiaire où la personne, une fois sortie de l'hôpital, serait astreinte à venir en consultation dans un CMP et à prendre un traitement. On aurait là l'équivalent de la sortie d'essai et l'institution d'un contrat entre l'équipe médicale et la personne malade.
Or, dans les alinéas 14 et 15 de l'article 1er de votre projet de loi, vous instaurez d'emblée – et c'est ce que nous critiquons – les soins sans consentement en ambulatoire, sans passer par l'étape de l'hospitalisation, donc sans progression « pédagogique ». Vous créez une contrainte majeure, puisqu'elle pourra s'exercer jusqu'au domicile du malade, avec tous les risques que cette intrusion comporte pour son entourage.
Nous nous réjouissons en revanche de la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010 et de sa motivation soulignant l'exigence de deux certificats médicaux pour toute hospitalisation sous contrainte,…

….même si l'on sait la difficulté de trouver deux médecins non attachés à l'établissement dans certaines zones, en raison de la démographique médicale catastrophique, et nous y reviendrons sans doute.
Par ailleurs, nous sommes satisfaits du contrôle désormais systématique des hospitalisations sous contrainte par le juge des libertés, imposé par le Conseil Constitutionnel au bout de quinze jours d'hospitalisation, puis au bout de six mois. Le groupe socialiste proposera d'ailleurs un amendement pour avancer ce deuxième contrôle à quatre mois plutôt que six, mais nous approuvons l'idée générale du contrôle par le juge judiciaire d'un enfermement aussi long.
Peut-on imaginer néanmoins que la nécessité d'un recours au juge, au quinzième jour d'une hospitalisation sous contrainte, puisse ne pas s'appliquer également aux soins sous contrainte en ambulatoire ? Vous avez évoqué cette piste, monsieur le rapporteur, mais vous avez sans doute été bloqué dans votre élan. Nous souhaiterions donc que vous puissiez vous libérer totalement.

En revanche, deux points nouveaux nous apparaissent très menaçants pour les libertés individuelles.
Le premier porte sur la question des soixante-douze heures. L'article L. 3211-2-2 prévoit qu'une personne admise en soins psychiatriques sous la contrainte « fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical [...] confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions d'admission [...].» Ce praticien est différent du rédacteur du ou des certificats nécessaires pour l'admission du patient, ce qui respecte l'esprit de la loi qui, depuis 1838, multiplie les précautions avant l'admission d'un malade dans un service fermé.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au précédent alinéa. Lorsque les deux certificats ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, un psychiatre de l'établissement propose dans un avis motivé, établi avant l'expiration du délai de soixante douze heures mentionné au troisième alinéa, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le protocole de soins », en quelque sorte la « feuille de route » médicale.
Certes, les hospitalisations contraintes sont parfois nécessaires pour des personnes en période de crise et qui ne sont plus en mesure d'accepter ou de demander des soins. Il est certain cependant que ce délai de soixante-douze heure sera compris comme ouvrant la possibilité de maintenir un patient hospitalisé pendant soixante-douze heures, sans devoir s'interroger auparavant sur le bien-fondé de cette contrainte. Cela représente trois jours d'hospitalisation pendant lesquels, certes, les gens sont soignés et vus par un psychiatre – en tout cas dans les conditions idéales.

Encore heureux ! Cela me rappelle le débat que nous avons eu cet après-midi sur la rétention administrative.

Il est dangereux de maintenir une sorte de « garde à vue psychiatrique », à laquelle on consentira d'autant plus facilement qu'elle apparaît comme une mesure brève, à même de dépasser le pic de la crise.

Mais, au moment même où l'on réforme le régime de la garde à vue judiciaire, dont on prétend limiter l'usage et la durée en la rendant plus respectueuse des libertés individuelles, le seul endroit où la garde à vue dépassera les quarante-huit heures, c'est à l'hôpital psychiatrique !
Le motif avoué de cette disposition est d'organiser une période d'observation permettant une orientation adaptée à l'état du patient, mais le risque est en fait que ces soixante-douze heures soient utilisées comme un temps de contention chimique des malades, parce que nous manquons de personnel dans les hôpitaux et les services d'urgence.

Mais venez dans les hôpitaux, chère collègue, et vous verrez que le « n'importe quoi », ce n'est pas ce que nous racontons mais ce qui se passe dans les services d'urgence. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
La vraie prise en charge ne commencera qu'au bout de trois jours. Nous craignons les dérives, car nous trouvons très longues ces soixante-douze heures de rétention médicale, beaucoup plus longues, je le répète, que le régime réformé de la garde à vue qui, sauf exception, est de quarante-huit heures, en présence d'un avocat. Entendons-nous bien : il ne s'agit pas de demander la présence d'un avocat ou d'un juge dans les quarante-huit premières heures, parce que le groupe socialiste, fidèle à la tradition médicale française, et contrairement à beaucoup de nos voisins européens, ne souhaite pas judiciariser l'entrée dans l'hôpital psychiatrique.

Nous pensons que cette responsabilité doit être celle du médecin, de la personne elle-même si elle en a la faculté, de la famille, d'un tiers, très exceptionnellement celle de l'autorité publique, en cas de péril grave et imminent. Il est primordial de demeurer dans un climat médical, et de ne surtout pas verser dans un climat judiciaire ou policier.

Nous pensons que quarante-huit heures sont suffisantes pour faire un premier examen somatique et psychiatrique, que c'est une durée raisonnable pour calmer un patient agité et commencer à nouer avec lui une relation de confiance.

Je fais d'ailleurs remarquer que, dans le cadre très particulier et très sécuritaire de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, où sont amenées toutes les personnes en crise sur la voie publique, proférant des menaces ou très agitées, la durée maximum de séjour est de quarante-huit heures, durée que le préfet de police, qui fait confiance aux psychiatres de cette institution particulière, estime suffisante pour placer une personne dans le circuit médical ou bien pour la renvoyer chez elle – ce qui est le cas une fois sur deux.

Le projet de loi permet une sortie au bout de vingt-quatre heures dans certains cas !

Le deuxième point qui fait frémir est ce qu'on appelle déjà le « casier psychiatrique ». Vous avez tort de récuser cette expression qui renvoie à l'article 3, alinéa 12, du projet de loi, lequel mentionne plus poliment le « dossier médical », institué pour les personnes ayant été placées sous certains régimes d'hospitalisation sous contrainte.
Le texte de l'article L. 3213-8 alourdit le régime de mainlevée des hospitalisations contraintes tant pour les personnes ayant été placées en unité pour malades difficiles que pour celles ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, au sens de l'article L. 122-1 du code pénal. Il sera désormais nécessaire d'obtenir l'avis du collège de soignants mentionné à l'article L. 3211-9 et composé de deux psychiatres et d'un cadre de santé. ainsi que deux expertises concordantes ordonnées, selon les hypothèses, par le juge des libertés et de la détention ou par le préfet.
Nous avons eu une longue discussion à propos du cadre de santé, car nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement exige sa présence alors que les intéressés y sont opposés, non pour des raisons syndicales mais parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le même rapport avec les malades que les psychiatres, parce qu'ils vivent toute la journée avec eux et peuvent manquer de recul pour une expertise. Nous essaierons de vous convaincre sur ce point.

La mise en oeuvre de cette disposition nécessitera la création d'un nouveau fichier pour une catégorie de malades a priori étiquetés dangereux, et ce sans limitation de durée. On sait pourtant que de telle déclarations d'irresponsabilité pénale peuvent ne concerner que des faits peu graves – il n'y a heureusement pas que des crimes de sang terrifiants –, par exemple des dégradations commises en période de crise. L'hospitalisation en unité de malades difficiles peut remonter à des années et résulter non d'une dangerosité particulière mais d'un conflit entre un malade et une équipe soignante.
Le texte crée donc à nos yeux une rupture intolérable d'égalité entre les malades devant la loi, car ceux qui auront eu un parcours judiciairement fléché seront extrêmement ennuyés par ce dossier. Un amendement du rapporteur, qui a perçu l'émotion des professionnels et des familles, introduit un droit à l'oubli, sorte d'amnistie, mais sans préciser de délai. Or prenons l'exemple d'un étudiant ayant trop bu – c'est de plus en plus fréquent –, qui se retrouve hospitalisé d'office à cause de son agitation, puis placé en UMD. Allez-vous condamner ce jeune homme a avoir un casier psychiatrique qui peut lui interdire de passer un concours administratif, d'intégrer une entreprise de sécurité ou, plus largement, de trouver un emploi ?

Précisez-nous donc au bout de combien de temps joue votre droit à l'oubli, pour ces dossiers dont on peut avoir bien du mal à se libérer à l'heure où tout est informatisé.
Il y a déjà suffisamment de fichiers policiers. Je pense notamment au STIC devenu aujourd'hui absurde puisqu'il comporte environ vingt millions de personnes, soit un tiers de la population française.
Ce projet de loi bancal s'inscrit dans le contexte très particulier de crise de la psychiatrie publique. Comme le soulignait déjà le sénateur Alain Milon, dans son rapport datant de juin 2009, « l'état de la psychiatrie en France est des plus inquiétants ».
L'excellent travail de ce parlementaire UMP est entièrement corroboré par l'étude d'impact qui montre que les pathologies psychiatriques se trouvent au premier rang des causes médicales à l'origine d'une attribution de pension d'invalidité. Elles sont la deuxième cause médicale des arrêts de travail et la quatrième cause d'affection de longue durée.
En France, cinq millions de personnes souffrent de dépression, maladie qui constitue la première cause de décès par suicide. Un peu plus de 1 % de la population est touchée par la schizophrénie, soit plus de 600 000 personnes, dont quelque 10 % se suicident. Les conséquences des troubles mentaux et des pathologies psychiatriques sont lourdes, autant pour les personnes qui en souffrent que pour les familles. Ne les oublions pas car elles se retrouvent en première ligne avec les personnes en grande souffrance psychiatrique.
L'étude d'impact estime que le coût direct et indirect des troubles mentaux représente 3 à 4 % du PIB de l'Union européenne.
Sur 500 000 hospitalisations annuelles, 80 000 se font sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, dont 13 000 sous le régime de l'hospitalisation d'office.
Confrontées à cette progression, les structures hospitalières psychiatriques ont enregistré une diminution de 56 % de leurs lits ces trente dernières années – ce chiffre est véritablement incroyable. On sait pourtant qu'elles sont les seules à assurer la prise en charge des pathologies lourdes et qu'elles ne peuvent malheureusement pas répondre à la demande toujours croissante de consultations et de soins venant d'une population de malades sujette à des pathologies de plus en plus diversifiées, notamment aux addictions de toutes sortes, aux sociopathies comme la violence des jeunes, véritable fléau, ou aux troubles mentaux des personnes âgées, continent nouveau encore à explorer.
Aucune réforme profonde n'a été conduite depuis la circulaire du 15 mars 1960 qui, il y a exactement cinquante et un ans, a créé le secteur psychiatrique comme mode d'organisation territoriale.
Au moment des débats sur la loi HPST de 2009, il avait été convenu que la psychiatrie serait peu concernée et qu'une loi spécifique, promise par le Président de la République, sur l'organisation des soins en santé mentale serait proposée par le Gouvernement. Comprenez notre déception de voir que la réforme que vous proposez aujourd'hui ne s'intéresse qu'à l'aspect très particulier des soins sous contrainte.

Récemment encore au Sénat, M. Fourcade, qui avait pour mission d'évaluer et de revoir la loi HPST, n'a rien proposé pour la psychiatrie, alors que la situation est de plus en plus inquiétante.
On connaît les lacunes de la répartition territoriale des psychiatres, avec une prédominance des effectifs dans les centres urbains et la véritable désertion des postes de psychiatres hospitaliers au profit d'un exercice libéral sans doute plus facile. Aujourd'hui, la situation est dramatique : plus de 1000 postes de psychiatres dans le secteur public ne sont pas pourvus, faute de candidats. Nous sommes au moins d'accord sur ce chiffre.
Dans certaines régions comme le Massif Central, l'est de la France ou l'outre mer,…

…il faut parfois parcourir plus de cent kilomètres pour se rendre à une consultation publique. Dans ces conditions, il sera difficile d'imposer des soins en ambulatoire à des malades qui, pour beaucoup d'entre eux, sont en état de grande précarité. Comment s'étonner alors d'un chiffre terrible : 30 à 50 % des personnes sans domicile fixe sont atteintes de graves maladies psychiques. Nous parlons de personnes livrées à elles-mêmes sans soins ni suivi, désocialisées, souvent concernés par l'alcoolisme ou les toxicomanies. Comme l'a démontré le professeur Jean-Pierre Olié, pour ces malades, l'absence de soins et de liens sociaux multiplie par huit les risques de délinquance et de criminalité.
Enfin, ce tableau sinistre ne serait pas complet si on ne rappelait pas les grandes difficultés rencontrées par les structures extra-hospitalières, qui devraient être aujourd'hui les fers de lance de la psychiatrie de secteur. Ces structures sont toujours débordées, toujours à cours de moyens et toujours dans l'obligation de retarder les consultations. N'oublions pas non plus ces milliers de malades dans la rue, et les 30 % de personnes détenues présentant des troubles psychiatriques sévères, comme l'a montré le rapport du professeur Rouillon.
Par ses discours, le Président de la République a contribué à la stigmatisation des personnes atteintes de pathologies mentales. Je le regrette et, dans l'hémicycle, nous sommes nombreux dans ce cas.
Trop souvent, hélas, les médias traitent ces questions à la rubrique des faits divers. On y trouve très rarement des informations scientifiques et médicales sur les progrès thérapeutiques. Je vous invite à relire le discours du Président de la République à Antony : vous constaterez que c'est absolument effarant !
Plus préoccupante encore est la faiblesse des investissements pour la recherche sur les troubles mentaux, alors que l'on sait qu'il s'agit du meilleur moyen pour faire reculer les maladies. À ce sujet, vous avez eu raison d'évoquer l'alerte précoce. L'investissement privé et public dans la recherche est très faible. Le professeur Marion Leboyer, grande spécialiste de ce secteur, estime que, en France, nous n'y consacrons que 25 millions d'euros par an, soit 2 % du budget de la recherche médicale. Les sommes investies sont particulièrement dérisoires au regard de ce qui se fait dans d'autres pays : 172 millions d'euros sont consacrés à la recherche sur les maladies mentales en Grande-Bretagne, soit sept fois plus qu'en France ; ce chiffre s'élève à 3,5 milliards d'euros aux États-Unis.
Voilà le tableau sinistré de la situation auquel vous voulez ajouter une grande complexité et beaucoup de travail supplémentaire pour les équipes soignantes.
En conclusion, chacun d'entre nous comprend que le projet de loi qui nous est présentée visant à réformer la loi du 27 juin 1990 sur les soins sans consentement est inapplicable s'il ne s'inscrit pas dans un cadre législatif précisant clairement l'organisation des dispositifs de soins et de prévention en santé mentale – je n'évoque même pas le nombre de juges et de greffiers qu'il faudrait recruter, comme le montre l'étude d'impact. De nombreux rapports, comme ceux du président du Sénat, M. Gérard Larcher, de M. Édouard Couty et du sénateur Milon ont souligné la nécessité d'une loi globale et spécifique.
L'absence d'une loi de rénovation de la psychiatrie et de la santé mentale nous conduit à refuser ce texte très partiel.
Il nous faut malheureusement constater qu'avec la procédure d'urgence parlementaire et ces trois journées de débat au plus, nous sommes loin, et très en retrait, de la démarche du législateur de 1838, qui avait mis plusieurs mois à discuter d'une question essentielle : comment concilier de la meilleure façon possible le respect de la liberté des patients et de l'obligation de soins ?

En tout cas, celui qui a traité la question l'a fait comme un sagouin !

À mon sens, le malade mental, surtout quand il est dans le déni de sa maladie, n'a pas besoin d'être contraint pour se soigner. Il a surtout besoin d'une relation de confiance où s'entremêlent qualité du soin, considération pour la personne et compétences professionnelles. Il s'agit alors, entre le malade et ses soignants, de tisser un lien très particulier répondant à la question que posait Paul Ricoeur dans son beau livre de réflexion, Soi-même comme un autre : « Qui suis-je, moi, si versatile, pour que, néanmoins, tu comptes sur moi ? ». Sur un tel sujet, j'aurais aimé que nous puissions compter sur un texte un tout petit plus ambitieux. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Nous en venons aux explications de vote sur la motion de rejet préalable.
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Le groupe GDR votera sans hésiter la motion de rejet préalable présentée par M. Serge Blisko. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Certes, nous aurions besoin d'un grand plan de santé mental traitant de l'accompagnement, de la prévention et des moyens humains et financiers. Cela est d'autant plus vrai que la loi HPST a méconnu les établissements dits « spécialisés » et la sectorisation.
La loi de 1990 devait être revisitée dans les cinq ans et la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des instances européennes rend nécessaire une modification législative.
La décision de soins sous contrainte est difficile. Il nous appartient de rechercher un juste équilibre entre les droits de la personne et la nécessaire protection de l'individu concerné, de ses proches et de la société. Il semble que ce texte réalise cet équilibre en renforçant les droits du malade et en permettant l'intervention du juge des libertés ainsi que les soins en ambulatoire.
Des questions demeurent sur les moyens humains et financiers. Seront-ils suffisants ? On peut ainsi énumérer les problèmes : celui de la démographie médicale, notamment psychiatrique dans les établissements ; celui des juges des libertés qui sont déjà surchargés aujourd'hui et qui devront prendre près de trente mille décisions supplémentaires par an ; celui de la composition du collège compétent en cas de problème entre deux psychiatres – peut-on laisser un cadre hospitalier trancher ? Le renoncement des soins en ambulatoire pose aussi un problème : comment obliger quelqu'un à se soigner s'il ne se sent pas malade ? Quant aux aidants, j'estime qu'ils ne sont pas assez pris en compte par le projet de loi.
Tous ces éléments seront abordés dans les amendements de notre groupe. J'espère qu'ils auront le soutien de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'État.
En attendant que nous en discutions, nous ne voterons donc pas la motion de rejet préalable. (Applaudissements sur les bancs des groupes NC et UMP.)

Comme d'habitude, ils énumèrent toutes les raisons de voter contre, mais ils votent pour !

La parole est à M. André Flajolet pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.

En écoutant Serge Blisko, j'ai eu le sentiment qu'il parlait d'un autre texte que de ce projet de loi, qui s'inspire essentiellement, comme Guy Lefrand l'a démontré, du triptyque santé, liberté, sécurité.
Les événements de Pau ou de Grenoble ne sont pas au coeur de ce texte ; on y trouve plutôt la volonté effective d'aborder concrètement les problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Le cheminement de soins a été comparé à un cheminement judiciarisé. Comparaison n'est pas raison, j'ai même craint qu'elle ne devienne déraison. Ce projet de loi propose bien un cheminement de soins et le travail de la commission des affaires sociales constitue un apport en la matière. Ce que le rapporteur qualifie de droit à l'oubli ne provoque pas de rupture d'égalité ; cela constitue plutôt un pari sur la possibilité pour les soignants d'intégrer dans la société ceux qui vivaient à sa marge.

À l'issue du travail de commission, je n'ai pas vu le même tableau noir que celui que nous a dressé Serge Blisko. Si le nombre de lits a diminué, c'est aussi parce que la psychiatrie a pu évoluer vers d'autres modes de soins comme, par exemple, des places dans des lieux d'accueils. Ma petite ville de 3 400 habitants héberge un hôpital départemental mais, sans même parler de cette institution, elle dispose aussi de quatre-vingt-dix lieux de soins que les patients fréquentent parfois une fois par mois et qui permettent d'assurer un réel suivi.

Il faut que nous examinions ce projet de loi pour pouvoir poser, comme le demande M. Blisko, la question des SDF ou celle des prisonniers. Nous devons aussi répondre aux interrogations formulées par M. Jean-Luc Préel. Il faut que nous puissions débattre. Le groupe UMP rejettera donc cette motion de rejet préalable.

La parole est à M. Jean-Marie Le Guen pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

L'intervention de M. Blisko a analysé avec précision la nature de ce projet de loi. Il a montré les avancées obtenues grâce au travail des députés membres de la commission, mais aussi les problèmes intrinsèques posés par ce texte. Indépendamment du contexte, ils justifient que nous rejetions ce projet de loi que nous trouvons profondément dangereux.
En fait, la question posée est à la fois très ancienne et fondamentale, tant en médecine qu'en psychiatrie, parce qu'elle touche aux libertés.
La question de la maladie et de la souffrance mentales est en effet au coeur de la réflexion sur le bien et le mal, sur l'organisation de la société. C'est pourquoi, ainsi que l'a rappelé Serge Blisko, tous ceux qui ont eu à en traiter, ont agi avec beaucoup de prudence. Ainsi, en 1838, à une époque où la connaissance scientifique était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui, où la maladie mentale et son expression violente étaient infiniment plus présentes, où la stigmatisation de la maladie mentale était plus forte, le législateur a eu le courage, toutes choses étant égales par ailleurs, de tenter de considérer le malade mental comme une personne humaine, dans sa globalité, et de privilégier la liberté individuelle plutôt que le risque social. Aujourd'hui, paradoxalement, alors que nous disposons de tous les éléments scientifiques qui nous permettent de réfléchir avec distance à ces questions, nous prenons, dans la précipitation, des décisions qui marquent une régression dans l'évolution historique des rapports entre la psychiatrie et la liberté, entre la médecine et les malades.
La quasi-totalité des organisations représentant le monde des soignants en psychiatrie sont opposées à votre projet de loi. Chargés d'une responsabilité éminente, les soignants vous disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce texte, qu'ils ne veulent pas appliquer parce qu'il est inapplicable. Or, vous n'en tenez aucun compte.

Quelle curieuse façon de procéder !
Il est vrai que vous avez déjà fait montre d'une semblable défiance vis-à-vis des professions médicales lors de l'examen du projet de loi HPST. De même que vous avez décrété que le directeur de l'hôpital devait décider de tout, vous désignez aujourd'hui le préfet comme celui qui décidera qui est malade et qui ne l'est pas, qui doit sortir de l'hôpital et qui doit y rester. Les mêmes simplifications extrêmes structurent votre réflexion.
Outre l'opposition des professionnels de santé, il convient de mentionner les rapports relatifs à ces questions, dont certains ont été commandés par ce gouvernement, qui tous insistent sur la problématique de la prévention et du dépistage – deux notions que je pourrais développer à loisir – et déplorent la désorganisation de notre système de santé mentale, voire l'absence de politique dans ce domaine. Je précise qu'aucun des auteurs de ces rapports ne réclame de moyens supplémentaires. Lorsqu'elle évoque le dépistage des troubles bipolaires, Marion Leboyer demande, certes, des moyens financiers, mais en insistant sur la nécessité d'une réorganisation. Quant au rapport Couty, il démontre que les moyens financiers dont dispose la santé mentale sont globalement suffisants, mais qu'ils sont mal organisés, mal structurés, mal répartis.
Pourtant, à aucun moment, vous ne manifestez la volonté de réfléchir à l'organisation de notre système de santé mentale, au contraire. Ce texte – qui a tout de même fait l'objet d'une lettre rectificative après les rappels à l'ordre du Conseil constitutionnel – s'inscrit dans la lignée d'un certain nombre de déclarations qui, depuis 2007, ont stigmatisé les malades mentaux et prôné une fausse sécurité. Car je refuse de considérer que votre projet de loi soit sécuritaire : il est faussement sécuritaire. Il n'apporte aucune sécurité, ni aux patients, ni à nos concitoyens, ni aux soignants, ni même aux juges, puisque M. Mercier veut qu'ils soient le moins possible saisis de ces dossiers.
Loin d'être sécuritaire, ce projet de loi est régressif. Vous faites de l'agitation en multipliant les déclarations simplistes ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Ce texte passe ainsi à côté de la réalité des problèmes de santé majeurs qui se posent dans notre pays ; il ne reconnaît pas la souffrance mentale.
Depuis 2007, vous tournez en rond autour d'un seul sujet : la stigmatisation des malades, assortie d'une fausse réponse sécuritaire. Voilà la réalité ! (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)

Vous négligez les rapports établis par votre propre majorité et, au lieu de la loi de santé mentale que vous aviez annoncée, vous nous présentez un texte faussement sécuritaire. Vous êtes des fossoyeurs !
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Lamentable !

Vous aggravez l'insécurité des Français, car vous êtes incapables de prévenir la montée de la violence et les problèmes de comportement, aveuglés que vous êtes par une idéologie répressive dont on mesure aujourd'hui toutes les conséquences. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC. – Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
(La motion de rejet préalable, mise aux voix, n'est pas adoptée.)

J'ai reçu de M. Yves Cochet et des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6, du règlement.
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, alors que nous attendions la grande loi sur la santé mentale qui nous avait été promise, nous voilà réduits à discuter du cas particulier et marginal des hospitalisations et soins sans consentement.

Alors que les pathologies mentales se développent dans notre pays – l'étude d'impact fait état de chiffres préoccupants et en constante augmentation –, nous voilà réduits à discuter de moins de 13 % des cas.
Pourquoi nous trouvons-nous dans cette situation – car il y a évidemment une raison ? Parce que le Président de la République et son gouvernement en ont besoin pour étayer la honteuse stratégie de stigmatisation, de peur, voire de haine, qu'ils cultivent assidûment, avec l'espoir qu'elle détournera nos concitoyens des véritables responsables et des vraies causes de leurs difficultés, à savoir leurs choix politiques, profondément injustes car entièrement tournés vers l'enrichissement des plus fortunés au détriment de l'intérêt général et des plus fragiles de notre société. Mes chers collègues de la majorité, je me permets de vous mettre en garde contre ce petit jeu avec le feu, car, s'il ne fait aucun doute qu'il sert les intérêts de l'extrême droite, du Front National,…

…il ne suffit pas – vous le constatez aujourd'hui – à faire remonter la cote du Président.
Depuis le début de la législature, le Gouvernement a fait voter au pas de charge pas moins de six textes sécuritaires à sa majorité, et celui-ci en fait partie. Il s'inscrit en effet dans la stratégie désormais bien rodée, mais tellement dégradante, qui consiste, à partir d'un fait divers tragique monté en épingle, à tenir, comme on sort une matraque, un discours accusateur à l'égard des professionnels concernés et un texte de loi répressif censé donner l'illusion d'une action efficace et déterminée. Cela peut marcher un temps, un peu, mais cela ne marche plus. Cela marche d'autant moins qu'avec le recul, toutes vos mesures répressives ont fait la preuve, non seulement de leur inefficacité, mais aussi de leur caractère contre-productif, aggravant.

La violence progresse au rythme de la dégradation de la vie sociale ; les prisons sont pleines et les troubles mentaux augmentent. Tels sont les faits, et ils sont têtus ; ce ne sont pas des affirmations à caractère idéologique.
Quelle est, en effet, la genèse du texte qui nous est soumis ? Des faits divers, tels ceux survenus à Pau ou à Grenoble. Ils sont effectivement dramatiques, car des personnes innocentes ont trouvé la mort du fait de comportements de malades mentaux dangereux. C'est très grave, et il est bien de notre devoir d'examiner la manière dont nous pouvons, sinon éliminer ces situations, du moins les limiter le plus possible. Mais il faut remettre ces événements à leur place et rappeler, par exemple, que l'alcool au volant tue quatre fois plus que la maladie mentale.

Alors, de grâce, examinons sérieusement ces problèmes, réfléchissons-y et donnons-nous les moyens d'y remédier, mais gardons-nous de les instrumentaliser et de cultiver des peurs, tout en faisant croire au risque zéro. Non, le risque zéro n'existe pas !

Quelles sont les conditions d'examen de ce texte ? Une procédure d'urgence. De surcroît, alors que le sujet, ô combien sérieux et complexe, porte sur un aspect très spécifique de la maladie mentale, nous ne disposons d'aucune étude sérieuse et argumentée sur les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation et de soins sans consentement : quelles sont les raisons de ces soins sans consentement ? Que deviennent ces personnes après leur hospitalisation ? Quelle évaluation sérieuse est faite de la dangerosité de ces personnes dans leur ensemble, au-delà des faits divers montés en épingle pour alimenter les conversations de café du commerce ?
Nous nous apprêtons à légiférer à la va-vite et sur du sable, en déconnectant les soins sans consentement du traitement de la maladie mentale dans notre pays. Pourtant, parmi les quelques éléments sérieux dont nous disposons, un chiffre mérite d'être rappelé : 50 % des malades faisant l'objet d'une hospitalisation ou de soins sans consentement sont des personnes connues pour leur pathologie mentale et qui pâtissent d'un manque de suivi. C'est parce que nous ne nous donnons pas les moyens de dépister, traiter et suivre ces patients que surviennent des crises aiguës, très difficiles à gérer, pouvant les conduire en prison – on estime à 25 % le nombre des personnes incarcérées atteintes de troubles mentaux – ou en hôpital psychiatrique sans leur consentement.
Ces faits soulignent l'impossibilité d'appréhender les soins sans consentement hors du cadre général de la maladie mentale. Pis, ils révèlent le caractère contreproductif d'une telle approche. C'est ce qui explique le rejet massif et justifié de ce texte par l'ensemble des professionnels concernés. Après avoir reçu une leçon de la part du Président de la République, qui leur a expliqué, dans son fameux discours d'Antony, en 2008, ce que l'on doit faire face à un malade mental, surtout s'il est dangereux,…

…ces professionnels découvrent que la grande loi annoncée est remisée, avec beaucoup d'autres, dans la boîte à promesses non tenues. Je rappelle tout de même qu'au début de l'année 2009, Mme Bachelot, alors ministre de la santé, avait annoncé « avant l'été 2009 », disait-elle, une grande loi sur la santé mentale comportant deux volets : la réforme de la loi de 1990 et la réorganisation de l'offre de soins en santé mentale. Deux ans plus tard, on voit ce qu'il en est, et cette situation, elle non plus, ne relève pas du hasard. Elle relève d'une conception erronée de la maladie mentale et de son traitement, une conception qui oublie le malade, la personne qui souffre, et qui, compte tenu des caractéristiques de sa pathologie, est victime non seulement de la maladie et de ses conséquences, mais aussi de la violence des bien-portants et de la stigmatisation de la société.
Elle relève d'une conception erronée de la thérapeutique et des conditions de sa réussite, essentiellement fondée sur la relation de confiance établie entre le psychiatre, l'ensemble de l'équipe soignante et le patient qui, souvent, récuse sa maladie. Il faut savoir, par exemple, que les schizophrènes présentent un taux de suicide neuf fois plus élevé que le reste de la population.
Ce texte procède également à une véritable déqualification des professionnels, des psychiatres, des psychologues et des juges.

Il s'appuie sur une vision simpliste du psychiatre, que vous considérez comme forcément laxiste, irresponsable, voire incompétent,…

…et à qui vous n'assignez que des tâches bien délimitées : appliquer des protocoles,…

…prescrire des neuroleptiques et rendre compte des manquements de leurs patients.
Vous avez la même approche à l'égard des juges, puisqu'ils sont, autant que le permet la récente décision salvatrice du Conseil constitutionnel, écartés du processus d'enfermement, ce qui fait de la France le dernier pays européen à refuser l'intervention du juge dès les premiers jours de l'hospitalisation sans consentement. Je rappelle que le juge, garant des libertés individuelles, doit l'être également dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte. S'il n'est pas là pour décider des traitements, c'est à lui qu'il revient d'apprécier l'opportunité des privations de liberté, y compris dans ce contexte.
Avec de telles conceptions, ce sont quarante ans d'évolution de la psychiatrie – ces quarante ans qui ont été nécessaires pour la faire passer d'un outil de relégation sociale à un outil de soin – que ce texte nie. Rompant avec le processus de désinstitutionnalisation entamé au début des années 1970, vous avez rehaussé les murs autour des établissements psychiatriques, mis en place la vidéosurveillance et renforcé l'enfermement des patients. C'est donc l'approche sécuritaire qui sous-tend ce projet de loi – évidemment présenté en urgence.
Si l'on ajoute à cette conception rétrograde la marchandisation de la santé que vous instaurez progressivement, la tarification à l'activité et la loi HPST, véritable machine de guerre contre les hôpitaux publics, c'est à un vrai recul de société que vous nous conduisez, et pas seulement en matière de psychiatrie.
Les plus modestes seront touchés en premier – comme toujours – mais, à terme, c'est toute la population qui sera pénalisée, comme le seront l'activité des soignants et des chercheurs ainsi que le rayonnement de notre pays, pourtant jusqu'ici reconnu pour la qualité des travaux de ses équipes médicales.
Si nous ne disposons pas d'études précises sur les hospitalisations et traitements sans consentement, nous disposons en revanche de nombreux rapports sur la psychiatrie en France. Leur lecture est très instructive et montre qu'au-delà des horizons et points de vue très divers, leurs auteurs se rejoignent sur un certain nombre de constantes et de principes fondamentaux.
Tout d'abord, sur la nécessité d'une loi générale sur la psychiatrie en France. Édouard Couty, conseiller maître à la Cour des comptes, considère, dans son rapport de 2009, qu'une loi de santé mentale se devrait « d'intégrer les différentes facettes de l'accompagnement et des prises en charge des usagers en santé mentale, des familles et des proches des malades ». Il cite ainsi le repérage et le diagnostic précoce, l'accès aux soins rapide et adapté, le suivi personnalisé et continu, la réhabilitation sociale, la prévention des risques, la recherche autour des déterminants de la santé mentale, l'organisation rénovée des dispositifs nécessaires aux hospitalisations sans consentement, et l'organisation des soins aux détenus.
Ces rapports se rejoignent également sur le rôle du psychiatre et l'importance de l'adhésion du malade, son consentement, sa confiance à l'égard des soignants. Pour Hélène Strohl, inspectrice de l'IGAS et auteure d'un rapport sur la psychiatrie en 1997, « l'évolution de la psychiatrie doit se situer dans une logique sanitaire et sortir définitivement de la logique sécuritaire ».
Le docteur Feberey, qui vient de remettre un mémoire sur l'hospitalisation sans consentement, fait remarquer que « lorsque nous disons “sans consentement”, nous supposons qu'il manque quelque chose et que ce consentement puisse être recherché et éventuellement obtenu dans le cadre d'un travail relationnel avec le patient, qui est l'essence de notre métier de soignants en psychiatrie ».
Quant au sénateur Alain Milon, auteur en 2009 d'un rapport pour l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, il considère que « l'on ne peut penser que l'obligation de soins, même étendue à la médecine ambulatoire, permettra une amélioration du niveau de santé mentale des patients s'ils ne sont pas encouragés à participer aux traitements et que ceux-ci leur sont imposés. En psychiatrie plus qu'ailleurs, poursuit-il, la prévention des rechutes est liée à l'observance, à l'adhésion aux traitements prescrits, et celle-ci passe par la compréhension des raisons du traitement par le malade. »
Ces travaux se rejoignent également sur la notion de dangerosité appliquée aux malades mentaux, prétexte à l'enfermement et à une stigmatisation qu'il faut combattre. Nous ne pouvons accepter, en effet, le présupposé de ce texte, qui suggère que les personnes en souffrance psychique sont potentiellement dangereuses. Le sénateur Milon écrit à ce propos : « À partir de cas tragiques, l'opinion publique a pu être encouragée à voir la personne atteinte de maladie mentale comme nécessairement incurable et récidiviste. »
Quant à Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, il fait remarquer que les considérations d'ordre public invoquées par les préfets pour s'opposer aux sorties d'essai demandées par les médecins pour certains patients réputés dangereux, s'appuient sur des éléments antérieurs à l'hospitalisation alors, justement, que des soins sont intervenus entre-temps.
Jusqu'où peut-on aller au nom de la notion floue d'ordre public ? Quelles sont les frontières entre la santé des malades, la sécurité des citoyens et la liberté des individus ? J'ai pu constater que notre rapporteur se posait également ces questions et j'ai entendu ses arguments lors du débat sur les amendements que nous avons déposés en commission.
Notre préoccupation n'est pas éteinte pour autant. Elle rejoint celle formulée par Hélène Strohl qui, dans son rapport, affirmait que la sécurité publique ne peut justifier à elle seule l'enfermement dans un hôpital psychiatrique, et que c'est le juge, garant de la sécurité publique, et non pas le psychiatre, ni même le préfet, qui est chargé de protéger la société en ordonnant la détention pour sécurité publique.
L'hospitalisation sans consentement doit rester une mesure exceptionnelle de contention, justifiée par les troubles mentaux et les comportements qu'ils induisent, et non pas une mesure d'enfermement et de sanction. Car, comme l'indique très justement M. Delarue, « la sécurité est un ogre dont l'appétit ne cesse jamais » – je trouve que cette formule est très juste et vous invite à la méditer.
La question fondamentale qui se pose aujourd'hui, à la fois pour la santé des personnes concernées, la sécurité de leurs concitoyens et le respect des libertés publiques, est celle du suivi des malades. Hélène Strohl explique très bien que « les progrès du soin psychiatrique permettent de sortir la majorité des malades de l'état de refus et ils peuvent, bien suivis, bien accompagnés, vivre sans jamais devoir être enfermés, ou alors pour des temps très courts ». « Bien suivis, bien accompagnés » : le problème se situe bien là, en effet, dans l'accès et la continuité des soins, tant à l'hôpital que dans les structures ambulatoires de secteurs.
Le rapport sénatorial cite les propos du professeur Philippe Batel, chef de l'unité fonctionnelle de traitement ambulatoire des maladies addictives à l'hôpital Beaujon, qui, lors de son audition, a déclaré : « Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous dans l'unité dont j'ai la charge, il faut entre trois et six mois d'attente, ce qui est pour moi une souffrance majeure par rapport à l'idée que je me fais de l'engagement du service public. Ce délai d'attente sélectionne les patients qui ont le moins besoin de moi et qui sont issus des catégories socioprofessionnelles les plus élevées ! »
Le Haut conseil de la santé publique estime ainsi qu'un tiers des schizophrènes, la moitié des dépressifs et les trois quarts des patients souffrant d'abus d'alcool n'ont pas accès à un traitement ou à des soins simples et abordables.
Comment, dans ces conditions, répondre au besoin de soins ? Comment s'étonner que l'hospitalisation à la demande d'un tiers soit détournée de son objet initial et n'apparaisse, dans bien des cas, que comme le seul moyen d'obtenir une hospitalisation rapide en cas de crise, sans avoir à attendre plusieurs mois ?

Comment, dans ces conditions, assurer le suivi des soins ? L'abandon des soins, rappelle le docteur Feberey, est un grand pourvoyeur d'hospitalisations d'office. Avec d'autres, nous militons pour une « banalisation » du soin psychiatrique, afin qu'il soit aussi simple de consulter un psychiatre dans un CMP qu'un médecin généraliste, ce qui permettrait d'anticiper le refus de soin en intervenant avant que la personne ait développé un état pathologique la conduisant à le refuser. Mais, pour ce faire, il est nécessaire que l'accès aux soins ait été assez simple, afin de pouvoir répondre rapidement aux demandes émanant du malade ou de son entourage.
Ce n'est qu'à la condition d'une offre de soins facilement accessible qu'il sera possible de différencier les patients qui ont besoin de soins et peinent à les trouver de ceux qui les refusent et qui, du fait de ce refus, présentent un danger pour eux-mêmes et pour autrui. Pour ces derniers, la contrainte est probablement nécessaire, mais les soins sans consentement doivent rester, je le répète, l'ultime recours, et non pas le préalable qu'induit, de fait, ce projet de loi.
C'est pourquoi nous défendons une psychiatrie ouverte et de proximité – ce que les psychiatres appellent une psychiatrie « communautaire » –, dans laquelle les soignants vont au-devant des malades, dans la cité et dans leur environnement. Car si l'hospitalisation protège temporairement la société, elle éloigne le patient de l'autonomie et annihile ses capacités d'intégration.
Un tel modèle doit s'appuyer à la fois sur l'hôpital et sur le secteur. Mais dans notre pays, l'un comme l'autre vont mal ! Les différents gouvernements ont, trop souvent, confondu désinstitutionnalisation et réduction de l'offre de soins. Or, vider les asiles ne signifie pas l'arrêt des soins, mais au contraire leur poursuite dans des structures ambulatoires ouvertes adaptées, telles que les centres médico-psychologiques. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe SRC.)
Mais aujourd'hui, ces structures manquent de médecins.

Elles manquent aussi de psychologues, dont le rôle est essentiel, justement pour assurer le lien indispensable avec les patients. Qu'attendons-nous pour en former, ainsi que des personnels soignants et sociaux ? Les CMP se trouvent dans une situation qui ne leur permet pas de mettre en place un accès aux soins rapide et d'organiser un suivi efficace, personnalisé.
Comment entamer une démarche thérapeutique en psychiatrie avec un adolescent que l'on aura, à grand-peine, réussi à convaincre d'appeler un CMP et qui se verra proposer un rendez-vous dans deux mois ? Les délais sont trop longs pour obtenir une consultation avec un psychiatre de secteur ; ils conduisent à décourager certains patients, qui arrêtent leur traitement.
L'hôpital constitue l'autre volet de la prise en charge des malades mentaux, qui peuvent y trouver un environnement rassurant lorsqu'ils sentent venir la crise, lorsqu'ils mesurent qu'ils perdent pied. Encore faut-il que l'hôpital puisse répondre à leur demande. Or l'hôpital public, qui accueille la grande majorité des hospitalisations en psychiatrie, va mal.
M. le rapporteur déplore que les psychiatres quittent le public pour s'installer en libéral. Comment s'en étonner après la loi HPST, qui a organisé cet exode en niant la spécificité de l'hôpital public et aussi le dévouement de son personnel ? Comment s'en étonner, alors que le Gouvernement ne cesse de réduire son financement en lui appliquant la tarification à l'activité, totalement inadaptée à ses missions et à son public ? Il est pourtant question de l'étendre à la psychiatrie, ce qui paraît surréaliste. Comment allez-vous codifier la parole nécessaire, le temps pour un suivi personnalisé indispensable ?

Alors que 1 000 postes de praticiens hospitaliers sont vacants, alors qu'a été supprimée la formation spécifique des infirmiers et infirmières en psychiatrie, dont chacun salue pourtant l'aide précieuse, particulièrement dans les situations de crise, votre texte n'avance aucune proposition concrète, que ce soit en matière d'organisation des soins ou de moyens pour la santé comme pour la justice, dont les dispositions nouvelles vont alourdir la charge.
Si l'exposé des motifs fixe bien à ce projet de loi 1'objectif d'améliorer la qualité et la continuité des soins, aucun article n'est hélas consacré à la mise en oeuvre de ces belles intentions. J'ai bien noté que M. le ministre de la justice nous a annoncé des moyens, mais je ne crois que ce que je vois et j'estime que nous sommes encore dans l'incantation, dans l'affichage.

Au fond, peu importe qu'un projet de loi soit pertinent pourvu qu'il ait l'air de répondre à l'émotion du moment.
Au-delà de la vision sécuritaire et rétrograde de la psychiatrie qui l'inspire, ce texte, en se désintéressant de l'accès aux soins et de l'organisation de la psychiatrie dans son ensemble, sera non seulement inopérant mais finalement dangereux : il touche aux libertés individuelles et il fait aussi courir des risques accrus aux personnes atteintes de troubles mentaux elles-mêmes et à la société tout entière.
Ce projet de loi n'apporte aucune réponse à la prise en charge des malades souffrant de troubles psychiatriques, de surcroît considérées a priori comme de dangereux délinquants potentiels.

Pour toutes ces raisons, je vous demande le renvoi de ce texte en commission, selon les termes consacrés, mais finalement son renvoi tout court. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

En qualité de rapporteur et en réponse à Mme Fraysse qui demande le renvoi en commission, je rappelle qu'à l'occasion de la préparation du présent texte nous avons auditionné près de quatre-vingts personnes et organisé une demi-douzaine de tables rondes. Toutes les personnes qui le souhaitaient ont été entendues, toutes les sensibilités ont été respectées. Cet après-midi, j'ai également reçu les représentants des quatre-vingts personnes qui manifestaient devant l'Assemblée nationale.
Ensuite, lors de sa réunion en application de l'article 88 du règlement, la commission des affaires sociales a examiné environ 300 amendements, dont plus des deux tiers ont été adoptés. Certes, nombre d'entre eux étaient de nature rédactionnelle...

…ou de coordination, mais ils témoignent du travail effectué au sein de l'Assemblée nationale.
Quant aux amendements de fond, je pourrais vous les lister mais cela alourdirait nos débats alors qu'ils ont été examinés et même approuvés par la plupart d'entre vous en commission. Ces amendements figurent dans le rapport. Vous les avez votés, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne changent rien à la physionomie du projet de loi, qu'ils ne contribuent pas à faire progresser les droits des personnes et à mieux encadrer les dispositifs d'admission en soins sans consentement.
Pour ma part, j'estime que la commission a travaillé dans des conditions satisfaisantes. Vous l'avez reconnu vous-mêmes à l'issue de ses travaux. Elle a produit un travail approfondi, dans un climat que je qualifierai de serein, sinon consensuel.
Le projet de loi ne met pas à bas le dispositif des soins psychiatriques sous contrainte, qui existe sans trop d'écueils depuis 1838, comme Mme la secrétaire d'État l'a rappelé, et qui permet de concilier trois impératifs de rang constitutionnel : la santé, la liberté et la sécurité. C'est un choix politique que nous assumons parfaitement.
Qu'un grand plan de santé mentale soit nécessaire, c'est une évidence. C'est d'ailleurs la position que je défends dans mon rapport et que j'ai rappelée ici. Nous sommes tous d'accord sur les différents bancs de cet hémicycle. Ce plan doit être l'occasion d'un réexamen approfondi de notre organisation médicale. Cependant, l'objet de ce projet de loi est l'amélioration de l'accès au droit des patients sous contrainte et non ce grand plan de santé mentale.
Pour toutes ces raisons, je demande le rejet de la motion de renvoi en commission.

Nous en venons aux explications de vote.
La parole est à Mme Marylise Lebranchu, pour le groupe SRC.

Dans le cadre de cette demande de renvoi en commission, Jacqueline Fraysse a eu raison d'exprimer la très grande déception de ceux qui attendaient une loi sur la santé mentale.
À présent, nous sommes tous très au fait de la situation des hôpitaux publics ; nous connaissons tous le nombre de services dans lesquels les postes de psychiatres et de psychologues ne sont pas pourvus. Pour l'avoir observé, nous savons tous aussi que la psychiatrie privée recule lorsque les hôpitaux ne sont plus capables de répondre : le psychiatre privé s'installe plus facilement à proximité d'un établissement où pourront être accueillis dans de bonnes conditions les malades qu'il ne pourra pas traiter en soins libéraux, à l'extérieur.
Toutes ces raisons nous conduisent à soutenir la motion présentée par Jacqueline Fraysse. On ne peut pas à la fois reporter sans cesse un plan de santé mentale et balayer d'un revers de main le fait que les hôpitaux publics manquent de postes et de candidats désireux de les occuper. Les personnels hospitaliers souffrent car ils ont l'impression d'être considérés comme les gardiens de gens qui seraient dangereux et qu'ils n'ont pas les moyens de soigner.
Tout à l'heure, je discutais avec l'un de ces psychiatres auxquels vous reprochez d'être en dehors de la réalité, pour ne pas dire autre chose. En France, nous n'avons pas besoin de travailler encore sur l'hospitalisation forcée quelle qu'en soit la nature, m'expliquait-il. En revanche, il posait cette question : combien de personnes vont-elles attenter à leurs jours ou commettre des actes difficiles à supporter pour leur famille ou pour les autres, faute d'avoir été admises dans un hôpital pour diverses raisons ?
La personne en souffrance a appelé un hôpital mais n'a pas pu obtenir un rendez-vous à temps. Un membre de la famille a tenté de prendre contact avec une clinique, sans trouver de lit. Une première demande de soins n'ayant pas abouti, on renonce la deuxième fois. C'est souvent parce que le malade n'a pas pu accéder à l'hôpital et aux soins psychiatriques que les choses se dégradent dans le cadre familial, ou à l'extérieur.
Jacqueline Fraysse l'a largement développé : faute de vraies interrogations sur la santé mentale dans notre pays, nous reculons. Du coup, sous prétexte de protection des droits, on s'intéresse aux malades qualifiés de dangereux envers eux-mêmes ou les autres. Dans le même temps, on renonce – et c'est ce qui est le plus difficile à supporter – à tout ce qui pourrait contribuer à la prévention et donc à la raréfaction des cas les plus difficiles, à l'espoir d'une meilleure vie pour beaucoup de malades et pour leurs familles.
Il est dommage que nous ne repartions pas en commission avec la ferme intention de revoir – comme le Conseil constitutionnel nous y a invités – les conditions de ce qu'on a appelé vulgairement les placements, mais surtout avec la volonté de réduire le nombre de personnes en déshérence dans la rue, dans leur travail ou dans leur famille, attendant vainement un rendez-vous, ce qui les conduit parfois à des actes brutaux envers eux-mêmes ou envers les autres. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Dans le plaidoyer qu'elle vient de faire avec passion et conviction, Jacqueline Fraysse a posé de bonnes questions.
Nous souhaitons tous un vrai plan de santé mentale doté de moyens humains et financiers, traitant de la prévention, du soin, de l'accompagnement du patient et du soutien aux aidants. Nous sommes tous favorables à une plus grande disponibilité du personnel, qui fait ce qu'il peut actuellement, mais qui est sans doute en nombre insuffisant pour prendre en charge correctement tous les patients. Nous avons tous conscience de ces difficultés.
Cela étant, le projet de loi qui nous est proposé se préoccupe d'un sujet particulier : les soins sans consentement, qui sont parfois nécessaires afin de protéger le patient lui-même, son entourage, la société. L'équilibre est extrêmement difficile à trouver.
La décision du Conseil constitutionnel et la jurisprudence européenne nous obligent à légiférer. Si l'équilibre est difficile à trouver, le texte prévoit de nouvelles dispositions – notamment l'intervention du juge des libertés – qui vont plutôt dans le sens de la protection de la personne.
Plusieurs problèmes, déjà évoqués lors de la précédente explication de vote, demeurent. Nous avons déposé des amendements et nous en discuterons. Un renvoi en commission n'est pas nécessaire car nous avons déjà débattu de l'ensemble du texte, des articles et des amendements. J'espère que l'équilibre sera assuré à l'issue de la discussion à venir sur les amendements.
(La motion de renvoi en commission, mise aux voix, n'est pas adoptée.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'objet du projet de loi qui nous est soumis est majeur en démocratie, mais le domaine dont il traite est particulièrement complexe et difficile. Nous devons en effet tenter de trouver un juste équilibre entre la liberté de la personne et la nécessaire protection d'elle-même, de ses proches, des soignants et de la société, tout en sachant que le risque zéro n'existe pas. Peut-on la laisser sortir avec un risque calculé dans le cadre d'un projet de soins ?
De plus, tout en en ayant conscience, il convient de s'abstraire des faits divers et d'éviter de légiférer sous le coup de l'émotion.
La loi du 27 juin 1990 aurait dû être réformée depuis longtemps. Il était d'ailleurs prévu qu'elle le soit dans les cinq ans, c'est-à-dire en 1995. Nous en sommes bien loin.
Le présent projet de loi prend en compte la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, afin d'éviter les décisions arbitraires liées à des intérêts personnels ou politiques, ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays mais qui existe dans des pays voisins.
Le Conseil Constitutionnel a estimé que cette hospitalisation sous contrainte ne pouvait être prolongée au-delà de quinze jours sans l'intervention d'un juge. C'est une bonne nouvelle au regard à la fois des libertés individuelles et des normes européennes. Mais, comme nous le verrons, son application sera difficile.
L'hospitalisation sous contrainte, ou mieux contre le gré de la personne, déroge au principe essentiel du libre consentement aux soins du patient et de son adhésion à ceux-ci.
Définir la dangerosité d'une personne dans un contexte le plus souvent d'urgence, porter un diagnostic sur la pathologie, décider si les soins peuvent être effectués en milieu ouvert ou en milieu fermé est particulièrement délicat et nécessite une grande expérience dont seuls les experts disposent. Mais ils ne sont pas à l'abri d'erreurs, d'autant que la démographie des professionnels de santé ne permet pas de disposer d'un temps médical disponible important.
Dans ce domaine, où intervient l'autorité administrative, le chemin est étroit entre la lettre de cachet, que nous avons connue il y a quelques siècles, et la privation de liberté d'une personne pouvant être dangereuse pour elle-même, ses proches ou la société.
Des drames, souvent médiatisés, peuvent survenir car il est difficile de prévoir un raptus avant qu'il ne se produise.
Le texte du projet de loi, compte tenu de son avenant, nous semble équilibré. Il prévoit un protocole de soins avant la soixante-douzième heure, établi par un psychiatre de l'établissement, définissant les soins à dispenser, le lieu de leur réalisation et leur périodicité ; la possibilité de soins en établissement ou en ambulatoire ; l'intervention du juge des libertés au quinzième jour, puis tous les six mois ; l'intervention d'un collège pour les patients dits difficiles ; le renforcement du rôle des commissions départementales des soins psychiatriques, qui devront obligatoirement intervenir pour examiner la situation des personnes admises en soins en cas de péril imminent ou dont les soins se prolongent au-delà d'un an.
Loin d'être le texte sécuritaire que certains y voient, ce projet de loi propose, au contraire, des mesures renforçant la protection de la personne hospitalisée sans son consentement. On souhaite toujours rendre le patient acteur de sa santé, en toutes circonstances. Si ce principe est valable pour les pathologies organiques, son application est beaucoup plus délicate lorsque le patient n'a pas conscience de sa dangerosité pour lui-même ou son entourage. Il convient cependant de le protéger contre des tiers mal intentionnés ou intéressés, ou contre des abus de l'État qui pourrait souhaiter mettre à l'écart des opposants en les taxant de déviants ou de malades.
Ce texte semble équilibré, mais plusieurs points demandent encore à être précisés ou améliorés.
L'intervention du juge des libertés au quinzième jour correspond à un souhait de protection de la personne. Mais comment le juge prendra-t-il sa décision ? Il se référera très probablement, comme vient de l'indiquer le ministre de la justice, aux certificats médicaux. Dès lors, où est le progrès ?
Le certificat au huitième jour est-il utile puisqu'il est à distance du quinzième jour, ce qui laisse un laps de temps pendant lequel l'état du patient peut s'améliorer ou s'aggraver ?
L'avis de deux psychiatres, s'il est souhaitable, est lourd compte tenu de la charge de travail de ces derniers et de la démographie médicale. L'avis du psychiatre responsable des soins ne serait-il pas préférable ?
D'après le texte, le malade devra le plus souvent être transporté au tribunal. Si son état ne le permet pas, et à défaut de moyens audiovisuels, ne doit-on pas prévoir la venue du juge dans l'établissement ? Mais sera-t-il disponible ? Les juges des libertés ont de lourdes responsabilités. Ils sont très sollicités et n'ont que peu de disponibilités. Ne pourrait-on pas laisser le président du tribunal désigner un juge éventuellement disponible ?
Quelque 62 000 patients sont hospitalisés sans consentement. Plus de la moitié d'entre eux sortent avant le quinzième jour. Les juges seront malgré tout concernés par 30 000 décisions, qui viendront s'ajouter à leurs tâches actuelles. Ce n'est pas rien, d'autant qu'il s'agit de décisions difficiles.
Pour les cas graves, il est institué un collège de trois personnes comprenant deux psychiatres et un cadre soignant. Pourquoi pas ? Une décision collégiale est intéressante. Mais la décision à prendre est essentiellement médicale. En cas de divergence entre les deux psychiatres, c'est le cadre soignant qui fera pencher la balance. Est-ce son rôle ? Il ne semble pas que les cadres le souhaitent. Ils peuvent cependant, bien entendu, donner leur avis. En cas de désaccord entre deux chirurgiens, est-ce le cadre qui devrait trancher ? Personne ne le pense. Un troisième psychiatre ne serait-il pas préférable ? Encore faudrait-il qu'il soit disponible.
La possibilité de mettre en oeuvre des soins ambulatoires sans consentement, notamment à partir du troisième jour, est une initiative intéressante, mais elle pose également des problèmes difficiles à résoudre. Comment obliger un patient qui a besoin de soins mais qui ne se sent pas ou ne se croit pas malade à suivre un traitement ? Peut-on lui faire, en ambulatoire, des injections médicamenteuses retard contre sa volonté ? Quelle est la responsabilité pénale du médecin ? Comment peut-il dénoncer le patient ne suivant plus son traitement ?
La tâche des psychiatres libéraux est également difficile. Elle suppose un climat de confiance, établi souvent difficilement, entre eux-mêmes et leur patient. Il semble que ces psychiatres n'acceptent pas d'être obligés de dénoncer à l'autorité administrative les patients ne suivant plus le protocole de soins. Je comprends leur inquiétude. Cependant, s'agissant de patients présentant un risque pour eux-mêmes, leur entourage ou la société, n'y a-t-il pas une obligation de protection ? Des conventions peuvent être passées avec les services de police ou de gendarmerie pour la recherche des patients fugueurs.
Je voudrais maintenant aborder la question de la sectorisation.
Les hôpitaux psychiatriques, comme les CHU d'ailleurs, ont été quelque peu oubliés dans la loi Hôpital, patients, santé et territoires.
La psychiatrie est sortie de ses murs et, grâce à la sectorisation, de nombreux liens ont été tissés entre les services hospitaliers, la médecine de ville, les paramédicaux et les services sociaux. Des structures extra-hospitalières ont été mises en place. Il n'est pas possible de ne pas en tenir compte.
Les territoires de santé ne correspondent pas aux secteurs psychiatriques. Les enjeux de la continuité des soins, de la responsabilité et de la sécurité sanitaire devraient impliquer l'inscription du dispositif dans une logique de responsabilité territoriale sectorielle claire, permettant d'offrir des modalités de soins sans consentement, à la fois hospitaliers et ambulatoires, suivis par la même équipe.
Enfin, il serait souhaitable de reconnaître le rôle des aidants, comme le demande l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques – l'UNAFAM – et de veiller à ce que les établissements aient les moyens humains et financiers de soigner correctement ces patients.

En conclusion, il était nécessaire de revoir la loi de 1990, pour tenir compte notamment de la décision du Conseil Constitutionnel et de la jurisprudence européenne.
Le projet de loi sur ce sujet ô combien difficile tente de trouver un juste équilibre entre la liberté de la personne et la nécessaire protection d'elle-même, de ses proches et de la société.
Cependant, plusieurs problèmes doivent encore trouver une solution. J'ai déposé, au nom du Nouveau Centre, plusieurs amendements. Je ne doute pas qu'ils connaîtront un sort favorable. Le rapporteur, Guy Lefrand, a beaucoup travaillé. Il connaît bien ce domaine complexe. Madame la secrétaire d'État, vous serez certainement également très attentive. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et sur plusieurs bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, chers collègues, le texte qui nous réunit répond à une histoire : celle de l'évaluation de la loi du 27 juin 1990 et des objectifs affirmés dans la loi de 2004. Cette évaluation a donné naissance, le 5 mai 2010, à un premier projet, modifié par les questions prioritaires de constitutionnalité du 25 novembre 2010, dont les conclusions précisent les rôles respectifs et complémentaires des uns et des autres.
Au-delà de ces dates symboliques, la philosophie générale du projet vise à rendre le plus compatibles possible la liberté de l'individu et la sécurité des personnes représentées par la société au coeur de l'activité de soins.
La question prioritaire de constitutionnalité donne une place éminente au juge dans le cadre du contrôle que ce dernier va exercer sur les délais acceptables du maintien de l'hospitalisation sans consentement.
Le projet de loi concerne 70 000 patients environ, relevant pour 84 % de l'hospitalisation à la demande d'un tiers et, pour le restant, soit 16 %, de l'hospitalisation d'office.
L'article 1er, en substituant à l'« hospitalisation sans consentement », les termes de « soins sans consentement », ne procède pas à un simple exercice de style, comme j'ai pu l'entendre, mais marque bien qu'au-delà de la relation entre un individu et la société, il y a de la part de ladite société une volonté délibérée de mettre en avant la question du soin, y compris et surtout quand la personne est altérée dans son autonomie intellectuelle.
Mais, bien au-delà, le principe de responsabilité sociétale est réaffirmé sous l'égide de la justice, puisque l'article L. 3211-12-1 instaure un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention, sa décision étant prise en lien avec le monde des soignants.
Les articles 2 et 3 précisent toutes les facettes des admissions en soins sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
Ainsi sont revisitées les modalités d'intervention, afin d'éviter l'arbitraire, est affirmé le droit à l'oubli d'un passé dépassé signifiant plus un passif, et est organisée par anticipation la sensibilisation du JLD.
Certains esprits ont exprimé une position divergente et dénoncé une rupture d'équilibre entre le bien-fondé des interventions thérapeutiques et les droits des personnes, alors que le projet de loi vise, premièrement à fermer la porte à la thématique de la peur et de l'enfermement par absence de réponse institutionnelle, deuxièmement à permettre au patient et à son entourage de saisir l'appareil judiciaire en cas de nécessité, troisièmement à renforcer le besoin de sécurité de la société sans procéder à l'exclusion des patients, lesquels gardent le droit à la rédemption.
Il n'empêche que ce texte, qui réforme une loi devenue obsolète et insuffisante, suscite de l'inquiétude, que les opposants à cette réforme expriment par une formule définitive : le projet de loi est qualifié d'« extension inadmissible du contrôle étatique des populations » !
Mais replaçons la problématique dans son contexte : ce projet de loi concerne un millier de patients pouvant être dangereux pour eux-mêmes, leur famille ou la société, en particulier lorsqu'ils ne prennent pas ou plus leur traitement.
Cependant, il est indécent de faire l'amalgame entre le souci de sécurité pour les soignants, souci légitime porté par les organisations syndicales devant la dangerosité de certaines situations, et l'affirmation idéologique d'un tout-sécuritaire. Seule une lecture partiale et partielle du texte peut conduire à une telle affirmation.

Les slogans de la rue ne procèdent pas d'une démarche intellectuelle, mais ne sont souvent qu'un cri idéologique.
Il convient de réaffirmer que les dispositifs prévus dans le projet de loi ne pourront que rarement être efficaces à moyens constants. Pour donner sens à ces nouvelles perspectives de pratiques sociales qui respectent mieux l'histoire individuelle de chaque personne, dans son énigme et son mystère, il appartiendra aux uns et aux autres de répondre sur cette question des moyens, lesquels relèvent à la fois du monde de la santé, madame la secrétaire d'État, et du monde de la justice.
Aussi le groupe UMP et la représentation nationale seront-ils attentifs aux engagements du Gouvernement quant aux effectifs qu'il va mobiliser pour que le juge des libertés et de la détention puisse exercer sa responsabilité en temps réel et pour que l'individualisation du suivi médical soit une réalité effective, dans une pratique où le soignant devient la conscience de l'aliéné dans son sens étymologique.
Le titre III a le mérite de préciser la relation soignant-soigné-société, répondant ainsi par avance à tout éventuel procès en arbitraire. Je dois dire que la pluie de critiques émanant de quelques personnes qui se sont auto-érigées en spécialistes ne m'a pas permis de voir pousser la moindre proposition alternative.

Il convient de constater que ce texte vise à réduire le principe de l'arbitraire, aujourd'hui possible faute d'une méthodologie institutionnelle partagée.
En tant que maire d'une petite ville de 3 400 habitants qui accueille un établissement public de santé mentale de statut départemental, un foyer de vie et un foyer à double tarification, j'ai pu apprécier les progrès importants qui ont été réalisés, tant dans les murs que dans les structures externes, tant dans les pratiques de soins que dans les efforts d'insertion, pour que les patients soient, hors des murs, acceptés comme tels dans la société.

Il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui ne figuraient pas non plus dans le texte, mon cher collègue ! (Rires sur les bancs du groupe UMP.)
Cependant, tout n'est pas possible, que ce soit pour les soignants, pour la société ou pour certains patients, dont les parents épuisés et angoissés demandent une sécurité à la fois pour leur enfant et pour leur entourage.
Je ne fais partie ni du monde de la justice – dont je respecte les prérogatives et que ce texte appelle à jouer un rôle important –, ni du monde de la santé, dans un segment de soins en perpétuelle évolution dans ses méthodes et pour les patients qu'il accueille. Je n'en ai pas moins estimé possible et souhaitable de dire ma part de vérité, inspirée par mon expérience de maire. Il s'agit d'exprimer une double demande : nous devons, d'une part, permettre à certains patients de retrouver notre monde quotidien et, d'autre part, en finir avec le déni de réalité qui s'oppose à toute mesure de privation de liberté en cas d'aliénation. Le but des soins est de rendre leur autonomie et leur dignité aux patients : ce texte vise à encadrer cette démarche et à la rendre plus aisée.
Ainsi, certains principes constitutifs des droits et de la protection des personnes relevant de soins psychiatriques sont actualisés au regard de l'évolution des pathologies et des méthodes de soin, pour tenir compte des recommandations européennes à l'égard des patients involontaires et des exigences de la Cour en ce qui concerne les droits de l'homme. Les travaux menés par notre collègue Guy Lefrand et les différents groupes de réflexion auxquels j'ai participé, ces apports et ceux de la commission des affaires sociales me conduisent, au nom du groupe UMP, à apporter un soutien éclairé à ce texte qui établit l'équilibre entre la liberté de la personne et la nécessaire sécurité de la société. Il va au-delà de l'événementiel pour organiser de façon durable et réfléchie la grande diversité des comportements, sans exclure ni stigmatiser, conformément aux objectifs initiaux, en matière de santé mentale, de la loi de santé publique du 9 août 2004. Elle est aujourd'hui complétée par ce projet – insuffisant, j'en conviens, car comme vous tous j'attends une grande loi de santé publique en ce domaine –, que j'invite mon groupe et les autres groupes à soutenir avec fermeté, au nom de l'intérêt commun. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous devons répondre à une injonction et avoir pris certaines dispositions avant l'été : nous légiférons donc sous contrainte – pardonnez le jeu de mots.
Je reconnais le travail réalisé en commission, mais les personnes concernées – psychiatres, psychologues, infirmiers, familles – disent toutes que ce texte les désole. Ce que demande une grande partie des équipes de l'hôpital public, c'est une loi de santé, et non une loi de sûreté.
Certes, le juge va intervenir, et c'est tant mieux. Mais les magistrats se demandent comment il leur faudra travailler pour répondre à plus de 10 000 demandes. M. le ministre de la justice a annoncé tout à l'heure que nous serions surpris, dans les jours ou les semaines qui viennent, par la façon dont il répondrait à l'étude d'impact. Dans la mesure où il se passera des années avant que les personnes entrées à l'École nationale de la magistrature ne soient opérationnelles, il n'y a guère qu'une solution : organiser un concours exceptionnel pour recruter en urgence des magistrats en nombre suffisant. J'espère que c'est ce qu'il s'apprête à annoncer. Pour ce faire, il faudra revoir la situation budgétaire du ministère de la justice.

Il est vrai que des concours exceptionnels ont déjà eu lieu mais, en règle générale, quand on sait qu'on doit en organiser un à la fin du premier trimestre, on anticipe en loi de finances – c'est-à-dire à la fin de l'année précédente – le coût de l'organisation du concours et de la formation des magistrats. Rien de tel n'a été voté en décembre 2010, et il va falloir corriger le budget.
Sans doute les équipes psychiatriques de l'hôpital public ont-elles le sentiment qu'on les montre du doigt, comme si elles faisaient preuve d'une compétence limitée. C'est le plus dur à supporter : l'école de Francfort a démontré que les gens demandent avant tout de la reconnaissance, et ces équipes n'ont pas l'impression d'en avoir obtenu beaucoup, même si elles sont d'accord avec la présence du juge.
On aurait pu concevoir un texte simple, prévoyant que le juge des libertés détermine une position au vu des déclarations contradictoires du préfet et du ou des médecins. Loin de s'en tenir à cela, on décide que seul le préfet ou le directeur de l'établissement – c'est-à-dire une autorité administrative – peut faire appel. J'ai appris, au cours de ma vie parlementaire ou ministérielle, qu'il fallait toujours veiller à l'équité ou à l'égalité des armes : or, en l'occurrence, elles ne sont absolument pas respectées. Pourquoi avoir décidé cela, qui est très choquant, non seulement pour la communauté médicale, mais pour les malades eux-mêmes, qui s'entendent dire que, si décision a été prise et appel interjeté, ils auront du mal à s'exprimer et à prendre place, comme des individus dignes de la République, dans la procédure ? Au contraire, celle-ci leur échappe totalement.
La question des cadres infirmiers suscite également des interrogations – Serge Blisko et d'autres l'ont dit. Ce n'est pas que les psychiatres ne veuillent pas être accompagnés d'un cadre infirmier. Ceux qui connaissent les services psychiatriques le savent, c'est souvent avec un psychiatre – quand on a la chance d'en avoir un dans les murs – et avec les cadres infirmiers que se fait l'organisation du service, du centre médico-psychologique, de l'hospitalisation à domicile, des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel. Faut-il rappeler que, dans les CMP par exemple, les cadres infirmiers sont souvent seuls ? Le cas d'un cadre infirmier s'occupant, seul, de cinquante personnes a été évoqué tout à l'heure.
Au-delà, dans la structure hospitalière, le cadre infirmier est un lien entre le psychiatre – dont la fonction première et essentielle est de soigner, mais aussi de décider de la durée de l'hospitalisation sous contrainte, ce que le patient sait pertinemment – et le malade, avec lequel il vit presque toute la journée, contrairement au psychiatre, qui n'est là que de temps en temps, même si c'est le plus souvent possible. Ce sont le cadre infirmier et son équipe qui, petit à petit, peuvent convaincre le malade qu'il doit accepter de dire sa souffrance pour aller au-delà du traitement chimiothérapique qu'il reçoit, pour en venir à un véritable échange avec le psychiatre, qui peut ainsi entamer un vrai traitement et mettre des soins en place. Casser cette organisation à l'intérieur du secteur, c'est, on l'a dit, mettre en danger la sectorisation sur le plan des moyens, mais aussi dans l'organisation des équipes. Interrogez les psychiatres, les psychologues, les cadres infirmiers, les infirmiers, les ASH, et même les secrétaires médicales, sur la façon dont se déroule le passage de la contrainte à l'acceptation : tous vous diront qu'un lien de confiance a dû être tissé par l'ensemble du service. Si le malade apprend que le cadre infirmier sera appelé, ne serait-ce que dans un conflit de loyauté, à décider de son sort, cet équilibre sera rompu.

La sectorisation s'est mise en place avec difficulté, elle est souvent insuffisante au regard des besoins, elle laisse trop souvent à la porte de l'hôpital des patients qui auraient pu être soignés mais qui craquent bien avant de l'être : nous n'avons pas le droit d'ajouter encore un caillou dans les chaussures inconfortables de la psychiatrie. En France, où nous reculons beaucoup, j'espère que nous aurons au moins envie de remonter une marche et de laisser au cadre infirmier sa fonction première. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le 2 décembre 2008, le Président de la République prononçait, à l'hôpital psychiatrique d'Antony, un discours assassin pour la psychiatrie, se livrant à une exécution sans appel de la logique sanitaire des soins aux personnes en souffrance psychique, au profit d'une logique sécuritaire de contrôle social. À la suite de ce discours, de nombreuses voix se sont élevées pour rappeler que la psychiatrie française se bat depuis cinquante ans pour être reconnue comme un dispositif de soins au service des patients, et non pas comme un lieu de relégation sociale, et pour réclamer, comme a dit Marylise Lebranchu, une loi de santé, et non une loi de sûreté. Ainsi, l'« appel des trente-neuf contre la nuit sécuritaire » et l'« appel contre la politique de la peur » ont largement relayé les attentes de cette discipline en termes de perception des troubles mentaux, soulignant les politiques publiques à mettre en oeuvre, rappelant les réalités auxquelles sont confrontés ces acteurs et dénonçant les reculs de l'approche gouvernementale.
Au rebours de ces prises de position des professionnels, le Gouvernement a, depuis ce discours, augmenté le nombre de chambres d'isolement dans les services d'hospitalisation et créé de nouvelles unités pour malades difficiles – les UMD. Il a, de ce fait, ignoré que la psychiatrie manque moins de moyens de contention physique que de personnel et d'une refonte en profondeur de la manière de l'appréhender.
Le projet de loi que nous examinons est la traduction de cette esquive, pour ne pas dire de ce recul. Il vise principalement à réformer la loi sur les internements en banalisant le recours aux soins sous contrainte, y compris pour les soins ambulatoires. L'un des quatre objectifs affichés de ce projet de loi serait d'améliorer la qualité et la continuité des soins. Or pas un seul article de ce texte n'évoque ces questions pourtant cruciales, sauf en dehors du cadre des soins sous contrainte.
Les députés communistes défendent depuis au moins trente ans, notamment après le rapport Demay commandé par Jack Ralite en 1982, une vision progressiste de la psychiatrie pour la faire sortir de la camisole aliéniste avec laquelle elle est historiquement aux prises.
Nous affirmons, comme l'immense majorité des praticiens, que la psychiatrie n'a pas pour vocation de traiter des maladies ou des troubles. Elle ne saurait se limiter à l'éradication de symptômes, à la normalisation de conduites ou au contrôle social. L'objet de la psychiatrie – n'en déplaise aux tenants de l'aliénisme – est de soigner des patients souffrant psychiquement. Or il apparaît que votre projet ne prend absolument pas la mesure de cette finalité.

Plutôt que des toilettages des lois précédentes, notamment celles de 1990 et de 1838, nous aurions aimé discuter d'une réforme en profondeur du secteur de la psychiatrie. Aussi comprendrez-vous que je ne développe que quelques-uns des points saillants de nos positions.
Nous plaidons en premier lieu pour des soins individualisés, qui prennent en compte l'histoire propre à chaque patient. C'est la condition d'un projet de soins individualisé pour chacun.

Nous voulons souligner ainsi l'importance primordiale de la continuité des soins, de la pluridisciplinarité des équipes de secteur et de leur collaboration permanente. Votre projet, en renforçant la place et l'opposabilité des protocoles, ne s'engage pas dans cette voie ; bien au contraire, il nie la singularité de chaque situation et des réponses thérapeutiques qui pourraient lui être apportées.

Mais non, puisqu'il y aura un protocole de soins individualisé pour chaque patient !

Pour répondre efficacement à cette attente, il faudrait ménager les conditions d'une véritable continuité des soins, que la psychiatrie devrait être en mesure de garantir, ainsi qu'un soutien et un accompagnement des familles et des proches. Force est de constater sur le terrain que cette condition est loin d'être remplie et que ce texte ne répond en rien à cette attente. Nous avons tous en tête – j'en suis persuadé – des exemples précis. À l'heure actuelle, il est parfois très difficile pour un patient d'obtenir un premier rendez-vous et, pour les professionnels, de proposer des rendez-vous suffisamment rapprochés pour assurer un suivi thérapeutique dans une logique de lien humain.
Pourtant, une telle approche réduirait considérablement le nombre des cas de rupture de soins par les patients ; elle est en effet la base d'un soin psychiatrique de qualité. Cela implique que les centres médico-sociaux disposent de moyens en rapport avec la demande croissante de soins psychiatriques. Or, dans votre projet, une seule disposition a trait à ce lien indispensable : le suivi des patients à leur domicile. Las, une fois encore, vous n'envisagez la question que dans la perspective de soins sans consentement, alors que l'articulation sanitaire, sociale et médicosociale est primordiale pour les patients souffrant de troubles psychiatriques. Elle nécessite une étroite coopération entre les équipes, dans le respect du libre choix des patients quant à leur prise en charge. Elle appelle une vision sociale de la prise en charge des troubles psychiatriques et requiert bien évidemment des moyens.
Or votre approche étriquée de la problématique confine ce suivi et cette articulation à un dispositif de contrôle de patients considérés a priori comme dangereux ou nuisibles, ce qui ne peut que nuire à la qualité de la prise en charge.

J'en veux pour preuve le primat de l'hospitalisation, qui transpire du texte qui nous est présenté, alors même que peu de cas nécessitent une prise en charge hospitalière. Ce primat est d'autant plus dommageable pour les patients que les places manquent dans les établissements, que les mises en chambre d'isolement augmentent dramatiquement faute de personnel – alors qu'il faut substituer la contenance psychique à la contention physique – et du lien sur lequel devrait être fondée chaque prise en charge. La qualité de la dimension relationnelle à chaque étape de la prise en charge est primordiale pour envisager un retour serein du patient à la cité.
À rebours de ce principe, votre projet de loi, rédigé à la suite du discours martial du Président de la République, élude ces questions essentielles pour répondre à une injonction. Rien n'est fait en amont : rien pour la formation des professionnels en psychiatrie, aucun questionnement sur la fin du numerus clausus, aucune réflexion de fond sur la spécialisation des infirmiers, pas plus que sur le financement de l'activité particulière que constitue la prise en charge des troubles psychiatriques ! En fait, avec une forme d'exclusion de la psychiatrie du champ de la santé publique, c'est le refus d'un vrai plan de santé publique !

La psychiatrie nécessite pourtant un financement global autant que spécifique afin de pouvoir mesurer, évaluer, ajuster au plus près des réalités vécues par les professionnels et dans l'intérêt des patients.
Nous regrettons – le mot est faible – que votre projet consacre la place primordiale de la solution d'internement propre à la psychiatrie française depuis plus d'un siècle et demi. Les députés communistes, républicains et du parti de gauche, à la suite de l'immense majorité des professionnels, affirment que le recours à la privation de liberté d'une personne à raison de troubles psychiques qu'elle présente doit rester une mesure exceptionnelle. Dans ce texte, elle est presque la règle…

…et elle n'est pas assortie des garanties suffisantes en termes de liberté et de droits individuels.
Le retour du patient vers le droit commun doit être chaque fois favorisé. Il constitue l'une des voies de la guérison.
Par la voix de Jacqueline Fraysse, nous défendrons des amendements en ce sens, notamment pour garantir l'intervention effective du juge de la détention et des libertés le plus tôt possible dans ce qui constitue, quels que soient les termes que l'on emploie, une privation de liberté.
Telles sont, mes chers collègues, les orientations défendues par les députés communistes, républicains et du parti de gauche. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques s'efforce de concilier trois objectifs essentiels : la santé, la sécurité des personnes, les libertés individuelles. Il vise en effet à tenir compte de l'évolution des soins psychiatriques et des thérapeutiques par la substitution de la notion de soins à celle d'hospitalisation sans consentement, mais aussi à renforcer l'accès aux soins en rendant effectives les garanties apportées aux personnes malades et en préservant celles qui sont dues à l'ensemble de la société.
Par ce projet de loi, le Gouvernement poursuit donc trois objectifs. Le premier est de permettre une meilleure prise en charge des malades, en augmentant le nombre des outils disponibles, en soins ambulatoires ou dans le cadre d'une hospitalisation. Le deuxième est d'assurer leur sécurité lorsqu'elles présentent un danger pour elles-mêmes ou pour des tiers. Le troisième est de garantir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux – droit à l'information et voies de recours – et de leurs libertés individuelles.
Les troubles mentaux se classent aujourd'hui au troisième rang des maladies en termes de prévalence. Selon une étude de 2005, plus d'un tiers de la population française en a souffert ou en souffrira au long de la vie. De fait, les personnes atteintes de troubles mentaux n'ont, bien souvent, pas conscience de leur maladie et ne peuvent exprimer un besoin de traitement. Pour environ un patient sur cinq, l'hospitalisation est imposée.
La spécificité du dispositif actuel, régi par la loi du 27 juin 1990, réside dans la coexistence de deux procédures d'hospitalisation sans consentement qui obéissent à des logiques distinctes, avec des conditions d'entrée et de sortie différentes. L'hospitalisation d'office implique la présence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l'ordre public. L'hospitalisation à la demande d'un tiers est mise en oeuvre lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossibles son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le présent projet de loi vise à tenir compte des faiblesses de ce dispositif, soulignées en particulier par le rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires de mai 2005.
Il s'agit de lever les obstacles identifiés dans l'accès aux soins et de mieux garantir leur continuité. Il faut en particulier répondre aux problèmes pratiques posés par l'absence de tiers pour l'accès aux soins. En effet, on se heurte trop souvent à l'impossibilité d'identifier un proche en raison de l'isolement social du patient ou du refus de son entourage d'assumer la responsabilité d'une demande d'enfermement.

Est également soulevé le problème de la levée de l'hospitalisation sur demande du tiers contre l'avis du psychiatre.
Il s'agit aussi d'adapter la législation à l'évolution des modalités de prise en charge des patients en prévoyant une phase d'observation hors les murs, donc en ambulatoire, en plus des « sorties d'essai » prévues dans le cadre de l'hospitalisation d'office à temps plein.
Consacrer la pratique des soins en dehors de l'hôpital exige d'aménager un suivi attentif des patients, pour leur sécurité et pour celle des tiers. Cela passe par la sécurisation des établissements de santé selon la gravité des pathologies, par le renforcement des avis médicaux pour les sorties d'essai des personnes admises en hospitalisation d'office et par une meilleure communication entre les autorités judiciaires, administratives et sanitaires, notamment pour les patients irresponsables pénaux.
Il convient alors de donner une place accrue au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, dans le contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte.

Il convient également de renforcer les droits et les garanties des patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement. Les assouplissements apportés par le présent projet en faveur de l'accès aux soins exigent, en contrepartie, un renforcement des droits des personnes malades et des garanties du respect de leurs libertés individuelles.
Il s'agit enfin d'adapter le droit français aux recommandations européennes.
Les difficultés de mise en oeuvre auxquelles nous sommes confrontés tiennent notamment au choix de leur secteur d'activité par les médecins psychiatres : si la France est le premier pays d'Europe pour le nombre de psychiatres, et le deuxième au monde si l'on rapporte ce nombre à celui des habitants, la psychiatrie souffre de la désaffection des étudiants en médecine pour la pratique hospitalière. Elles tiennent aussi à la capacité des services judiciaires, déjà très sollicités, à gérer les besoins spécifiques de malades aux problèmes particuliers.
L'amélioration significative de la politique de la santé mentale sera – n'en doutons pas – l'un des grands chantiers de demain. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons ce soir traite des modalités de prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Si tout le monde s'accorde à dire que les procédures d'hospitalisation sans consentement doivent être réformées, le texte qui nous est présenté est manifestement incomplet et déséquilibré. Il privilégie une logique sécuritaire en phase avec l'opportunisme politique de la majorité actuelle mais en inadéquation avec la réalité du terrain et les besoins des patients.
Au lieu de construire une nouvelle usine à gaz juridique, il aurait fallu, en particulier, prendre à bras-le-corps la question de la démographie psychiatrique, essentielle compte tenu du manque de psychiatres, notamment dans certains départements comme le mien.
La vocation sécuritaire de ce texte conduit à un amalgame malsain entre maladie mentale et délinquance. Elle conduit également le Gouvernement et la majorité à occulter certains aspects importants des modalités de prise en charge des malades.
Je veux notamment parler d'un dispositif alternatif que l'on aurait pu aborder à condition de retenir une approche sanitaire et non sécuritaire : l'accueil familial thérapeutique. Il constitue une forme d'hospitalisation à temps plein, alternative à l'hospitalisation classique. Il s'agit surtout d'un outil spécifique, destiné aux patients atteints de maladies psychiatriques qui sont susceptibles de retirer un bénéfice d'une prise en charge dans un milieu familial stable. Il favorise la continuité des soins tout en rompant avec le « tout hôpital ». Ce dispositif devrait faire l'objet d'une attention toute particulière puisque, au-delà de son originalité dans le cadre du parcours de soins et de l'environnement nouveau qu'il propose au malade, il est plus de deux fois moins onéreux en moyenne que l'hospitalisation complète.
Les accueillants, après une enquête menée par l'équipe de soins, doivent être agréés par un établissement de santé et avoir signé un contrat d'accueil avec cet établissement. Dans le cadre de leur travail, ils sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui assure le soutien thérapeutique et le contrôle de l'accueil, sous la responsabilité d'un médecin psychiatre coordinateur.
L'AFT concerne aujourd'hui un nombre relativement limité d'accueillants : à Ainay-le-Château, par exemple, on compte environ 400 familles d'accueil. Mais il est difficile d'en savoir plus : une estimation, datée de 1999, évoquait 5 000 accueillants dans tout le pays. En 2003, une autre estimation évoquait environ 3 500 patients, dont 1 450 soignés à Ainay-le-Château et Dun-sur-Auron. Les accueillants que j'ai pu interroger récemment parlent d'un maximum de 1 500 accueillants familiaux thérapeutiques au niveau national ; le nombre de patients accueillis en AFT, d'un à deux par accueillant, serait donc ici de 2 000 à 3 000. Le Gouvernement peut-il nous fournir des précisions à cet égard ?
Si, comme l'affirme l'exposé des motifs du projet de loi, « le premier objectif de la réforme consiste à lever les obstacles à l'accès aux soins et à garantir leur continuité », l'accueil familial thérapeutique est un dispositif qu'on ne peut mettre de côté. Mais il faudrait pour cela être sincère dans l'intérêt que l'on porte au sort des malades, à leur progression sur la voie de la guérison et à leur éventuelle réinsertion dans la société. Il est fort dommage que la vision sécuritaire de la majorité ne lui permette pas de considérer le problème sous cet angle.
La valorisation de l'AFT passe notamment par un travail sur le statut et la formation des accueillants. Le statut juridique de ces professionnels a longtemps posé problème puisqu'il n'était pas clairement défini. L'un des rares points positifs de la loi HPST a été leur reconnaissance comme agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Cette disposition a obligé nombre d'établissements de santé à réviser le statut des accueillants qu'ils ont recrutés à partir de juillet 2009. Les disparités entre accueillants restent toutefois très importantes, et certains ont des contrats plus que précaires : en Ariège, par exemple, un accueillant familial thérapeutique touche 600 euros par mois pour s'occuper d'une personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trente jours sur trente. Est-ce acceptable ? Il faudrait faire un premier bilan de la situation et nous fournir des statistiques fiables à ce sujet – je le demande au Gouvernement.
La question de la formation des accueillants familiaux thérapeutiques demeure posée, notamment pour ceux qui accueillent des adultes, dont la formation doit être assurée par l'établissement employeur. Dans une enquête menée par l'Établissement public de santé mentale de Lille-Métropole entre janvier et août 2009, il apparaît que plus de 60 % des accueillants familiaux thérapeutiques pour adultes n'ont bénéficié d'aucune formation, initiale ou continue. Il nous faut donc réfléchir à la mise en place d'une formation diplômante et qualifiante de ces professionnels, à l'image de celle qui existe pour les assistantes familiales. Ce n'est qu'en s'intéressant de plus près à ces deux questions – le statut et la formation – que nous pourrons encourager le développement de l'AFT.
Mais puisque ce dispositif implique la mobilisation des familles, il faut aussi aborder le sujet en termes de représentation mentale. La manière dont la majorité de cette assemblée traite la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques est très problématique. Faire le lien entre maladie mentale et délinquance, ne traiter que de l'hospitalisation à la demande d'un tiers et de l'hospitalisation d'office dans un texte sur les modalités de prise en charge de ces malades, conduit à faire du malade un danger qu'il faudrait écarter et à favoriser dans l'esprit de nos concitoyens une vision tronquée, à connotation asilaire, de la psychiatrie.
La ministre de la santé faisait remarquer en 2005, à l'issue d'une rencontre avec une famille d'accueil dans l'Allier, que « l'accueil familial thérapeutique est une solution ingénieuse dans le secteur de la psychiatrie et de la santé mentale ».
Le 11 janvier dernier, dans une réponse à une question écrite, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé indiquait qu'une réflexion allait être menée au sujet de l'AFT. Je vous pose la question, madame la secrétaire d'État : qu'en est-il aujourd'hui ? Le fait que vous présentiez un texte relatif aux modalités de prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans aborder ce sujet ne me semble guère encourageant. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Prochaine séance, mercredi 16 mars à quinze heures :
Déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen et débat sur cette déclaration ;
Suite du projet de loi relatif à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 16 mars 2011, à zéro heure trente-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Claude Azéma