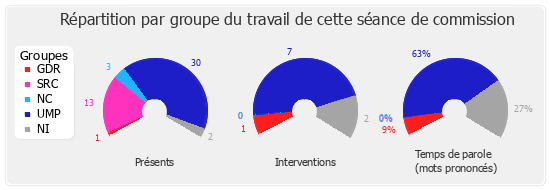Commission des affaires étrangères
Séance du 8 juin 2011 à 9h30
La séance
Table ronde sur les échanges internationaux de renseignements en matière fiscale, en présence de M. Jean-Marc Fenet, directeur chargé de la fiscalité à la direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, et de M. Yves Ulmann, directeur adjoint de Tracfin.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Notre commission a déjà entendu M. Jean-Marc Fenet et M. Yves Ulmann l'année dernière, avant d'examiner 19 accords relatifs à l'échange de renseignements en matière fiscale, qui obligeaient les paradis fiscaux à coopérer dans la lutte contre l'évasion fiscale et interdisaient notamment d'opposer le secret bancaire à des demandes d'information. Au moment où huit accords similaires sont en cours d'examen au Sénat, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau les deux responsables de l'administration fiscale française, ainsi que Mme Maïté Gabet, afin qu'ils nous présentent un premier bilan de l'application de ces conventions bilatérales.
Ces textes sont le pilier du programme international de lutte contre les paradis fiscaux dans le cadre duquel l'OCDE évalue, depuis un an, les progrès des États et juridictions à risques. À ce jour, seuls huit États continuent de susciter des interrogations quant à leur réelle implication dans le programme. D'une façon générale, le processus d'examen des législations fiscales a commencé dans les délais : 25 rapports ont déjà été publiés, et 35 devraient l'être d'ici le sommet du G20 à Cannes. Dans un deuxième temps, l'OCDE évaluera la qualité de la coopération des administrations.
Nous aimerions connaître votre appréciation sur ce processus. Constatez-vous des évolutions dans l'attitude des paradis fiscaux ? La coopération internationale sur ce thème est-elle effective ? Au-delà de ces aspects internationaux, nous souhaiterions aussi vous entendre sur les mesures nationales adoptées pour mettre en oeuvre ces accords. L'administration fiscale française est-elle plus encline à poursuivre les personnes soupçonnées d'évasion ? Avez-vous obtenu des résultats depuis l'entrée en vigueur de ces accords ?
Avant d'en venir précisément aux questions que vous avez posées, il convient de replacer les choses dans leur contexte général, qui résulte des démarches entreprises entre 2007 et 2009 en matière de lutte contre les paradis fiscaux. Le processus résulte d'une initiative franco-allemande lancée par Éric Woerth et Peer Steinbrück, et largement reprise ensuite par l'OCDE. La publication par l'organisation internationale de listes « noires » ou « grises » de paradis fiscaux avait provoqué un certain émoi dans plusieurs pays. Il en est résulté un mouvement important de signature de conventions internationales.
Celles-ci sont de deux types. Tout d'abord, les conventions bilatérales réglant la double imposition entre la France et d'autres pays ont été revues, afin d'y ajouter une clause d'échanges de renseignement aux normes de l'OCDE – c'est-à-dire reprenant les dispositions de l'article 26 du modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune. La principale de ces dispositions est celle qui interdit d'opposer le secret bancaire aux demandes de renseignements, à condition toutefois que l'information soit nominative. Il n'est donc pas possible de pratiquer le « fishing », c'est-à-dire de lancer des requêtes anonymes à partir de certains paramètres. Il faut disposer déjà de certaines informations sur la personne concernée, à commencer par son identité.
Ensuite, une série d'accords a été signée sur l'échange de renseignements avec des pays vis-à-vis desquels nous n'avons pas passé de convention de double imposition.
Par ailleurs, à la fin de l'année 2009, le Parlement français a adopté un dispositif très important relatif à ce que le code général des impôts appelle désormais les « territoires non coopératifs ». Les conditions fiscales des échanges avec ces territoires sont fortement durcies : les retenues à la source sont plus importantes, le régime mère-filiale ne s'applique pas, etc. La France dresse donc sa propre liste « noire » ou « grise », mise à jour chaque année, des États non coopératifs.
Au plan opérationnel et administratif, notre pays a également renforcé son dispositif de lutte contre la fraude fiscale internationale et les comptes offshore non déclarés. Ainsi, avec l'autorisation de la CNIL, un fichier administratif géré par la Direction générale des finances publiques, appelé Evafisc, sert de base à la programmation de contrôles fiscaux sur le territoire français ou à des échanges de renseignements avec nos principaux partenaires. Un certain nombre de contrôles sont d'ailleurs en cours à partir de renseignements dont nous disposons sur des comptes situés dans un État alpin voisin.
Ce fichier est enrichi par un dispositif mis en place à la fin de l'année 2009 et prévoyant un droit de communication auprès des établissements bancaires situés en France. Il est ainsi possible d'interroger ces derniers sur des transactions dépassant un certain montant et ciblées vers un certain nombre de pays. Les demandes ont été adressées assez récemment, et nous exploitons actuellement les renseignements fournis.
Nous avons également renforcé notre dispositif répressif, puisque depuis la fin de l'année 2009 dans le droit positif – et depuis la fin 2010 dans les faits –, nous disposons de ce que l'on pourrait appeler une « police fiscale », à l'instar de ce qui existe déjà chez certains de nos voisins. Il s'agit d'une brigade spécifique, composée à parité d'officiers de police judiciaire et d'agents de la direction générale des finances publiques, et chargée d'enquêter sur les fraudes fiscales sophistiquées.
Dans ce domaine, nous avons davantage progressé au cours des trois ou quatre dernières années que pendant les quinze ou vingt précédentes. Nous nous sommes dotés de nouveaux outils permettant d'agir vis-à-vis de la fraude fiscale internationale et des paradis fiscaux.
Cependant, le diable est dans les détails, et nous testons actuellement l'efficacité des accords internationaux – plus d'une vingtaine – ratifiés l'année dernière par le Parlement. Généralement, ces accords ne s'appliquent qu'à partir de leur signature, aux impôts exigibles à ce moment ou lors d'exercices fiscaux ultérieurs. Leur mise en oeuvre sera donc progressive par définition. Il est cependant possible de poser dès à présent des questions auprès d'un certain nombre de pays – notamment s'agissant de successions, de l'impôt de solidarité sur la fortune ou plus généralement d'impôts dont le fait générateur est postérieur à la date d'entrée en vigueur des conventions. Nous avons ainsi envoyé une centaine de demandes, adressées à une dizaine de pays différents. La façon dont elles seront prises en compte constituera une épreuve de vérité.
Il ne faut pas faire preuve d'angélisme : le risque existe que certains pays n'aient signé une convention avec la France que pour sortir d'une liste jugée infamante. Il reste à vérifier qu'ils sont prêts à jouer le jeu et ne vont pas invoquer des difficultés internes ou de procédure pour refuser de donner suite à nos questions.
Cela étant, deux mesures de sécurité ont été prévues. La première est la revue par les pairs de l'OCDE. C'est la première fois, au plan international, que la conclusion d'une convention s'accompagne d'un dispositif de suivi et, le cas échéant, de correction. Si à l'issue de ce long processus d'évaluation, il apparaît que certains signataires n'honorent pas leur engagement et refusent de fournir les renseignements demandés, ils pourraient à nouveau intégrer la liste noire.
La deuxième mesure ne concerne que le droit français : il s'agit des dispositions du paquet fiscal adoptées fin 2009. Elles peuvent non seulement s'appliquer aux pays qui n'ont pas signé de convention avec la France, mais aussi, le cas échéant, à des pays qui l'ont fait mais se refusent à honorer leur signature. Même si le cas ne s'est pas présenté jusqu'à présent, cette mesure constitue une corde de rappel.
Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de réponse à la centaine de demandes que nous avons adressées. Rien ne nous permet de préjuger de la suite qui leur sera donnée, même si les questions de procédure qui nous sont posées montrent à quel point les pays que nous sollicitons sont bouleversés dans leurs habitudes. Lorsque les pratiques propres aux paradis fiscaux sont ancrées depuis de nombreuses décennies, poser des questions sur le membre d'une fiducie ou d'un trust ou sur le détenteur d'un compte déterminé peut provoquer quelques hoquets. Cela dit, nos sollicitations datent d'il y a quelques semaines seulement, et l'épreuve de vérité devrait plutôt survenir à l'automne. Si vous me réinvitez l'année prochaine, monsieur le président, je pourrai en dire un peu plus sur le caractère effectif de ces accords.
Je souhaite évoquer les travaux menés dans l'enceinte internationale de lutte antiblanchiment qu'est le GAFI – groupe d'action financière –, même s'ils ne sont pas au coeur du sujet qui vous préoccupe aujourd'hui. Cet organisme intergouvernemental refond actuellement l'ensemble de ses standards et espère pouvoir inclure la fraude fiscale parmi les infractions sous-jacentes du blanchiment lors de sa prochaine réunion plénière, dans deux semaines à Mexico, ou au plus tard en octobre. Dans cette hypothèse, la fraude fiscale pourrait faire l'objet d'investigations de la part des cellules de renseignement financier du monde entier.
La révision des standards, entreprise dans le cadre de la feuille de route donnée lors de la réunion du G20 à Séoul en 2010, devrait être adoptée définitivement au plus tard à la fin de l'année, et entérinée par le G20 de Cannes.
Un autre aspect des travaux du GAFI, peut-être plus important encore, est la mise au point d'une liste rénovée de juridictions non coopératives, qui se déclinent désormais en quatre sous-catégories de pays soumis à un examen particulier.
La première est la liste noire des juridictions non coopératives soumises à des contre-mesures. Elle ne comprend que deux pays, l'Iran et la Corée du Nord. Bien entendu, nos relations financières avec cette dernière restent pour l'instant assez limitées…
La deuxième est la liste noire des juridictions sans contre-mesures. Pour l'instant, elle est vide, mais pourrait comprendre les noms de pays qui n'auraient pas satisfait, d'ici au mois d'octobre, aux efforts qui leur sont demandés pour accroître leur coopération et leur transparence.
Par ailleurs, parmi les grands partenaires figurant sur une liste « gris foncé » des pays susceptibles de basculer dans la liste noire, on peut citer la Turquie.
Enfin, une liste « gris clair » comprend une vingtaine de juridictions – dont un membre de l'Union européenne qui fait beaucoup parler de lui, la Grèce, et un pays très important pour nos relations bilatérales, le Maroc –, qui présentent des déficiences en matière de lutte contre le blanchiment et de transparence, et sont priés de mettre en oeuvre un programme lourd d'amélioration de leur processus d'échanges. La Grèce et le Maroc semblent toutefois en bonne voie, et devraient faire l'objet d'un examen positif à Mexico, dans quinze jours.

Nous vous avons peut-être invités un peu trop tôt ! Il aurait peut-être été préférable d'attendre un an pour vous interroger sur les conséquences de l'entrée en vigueur des accords internationaux signés récemment. Est-il possible, néanmoins, d'avoir d'ores et déjà une idée précise du volume des avoirs français placés à l'étranger ?
Par ailleurs, pouvez-vous faire un premier bilan du dispositif de régularisation mis en place par la France et clos depuis un an et demi ?

Je suis élu de la circonscription comprenant Sevran, une ville qui fait beaucoup parler d'elle et où circule beaucoup d'argent lié au commerce de la drogue. Une seule cage d'escalier pourrait générer jusqu'à 10 000 euros par jour. Le blanchiment de cet argent passe souvent par la création de sociétés dont je présume qu'elles veulent échapper à l'impôt et sont enclines à placer leurs capitaux ailleurs. D'après les informations dont je dispose, l'argent collecté à Sevran est presque systématiquement envoyé au Maroc. Quelles sont nos relations avec les autorités et les établissements financiers de ce pays ?

Si j'ai bien compris, vous pratiquez la pêche au gros avec une simple canne. C'est difficile, d'autant que les océans sont vastes. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille ? Comment êtes-vous alertés ?
D'autre part, quel est votre pourcentage de réussite par rapport au montant estimé de la fraude fiscale ?

Le Forum mondial pour la transparence et l'échange d'information fiscale organisé sous l'égide de l'OCDE vient de se prononcer sur huit pays, dont deux, la Suisse et Singapour, ne respectent pas les accords qu'ils ont conclus. Or, en discutant avec des responsables de Jersey, on se rend compte qu'il existe une concurrence extrêmement vive entre paradis fiscaux, certains pays jouant un rôle directeur en matière de secret bancaire. Si des États aussi importants que la Suisse ou Singapour se comportent ainsi, les autres auront tendance à faire de même. Quel jugement portez-vous sur ce rapport ? Quelles conséquences faut-il en tirer à l'égard de ces deux pays ? Le dispositif adopté par la France à la fin de 2009 ne prévoit pas d'intégrer dans la liste des États non coopératifs les pays ayant passé des accords mais qui ne les respectent pas. N'y a-t-il pas lieu de le compléter ?
Par ailleurs, que pensez-vous des fiducies ? Ce dispositif obscur, à l'utilité incertaine, encourage l'opacité. On affirme qu'il est bien encadré, mais au moment où l'on prétend, en France, lutter plus efficacement contre les paradis fiscaux, son introduction n'est-elle pas un signal déplorable envoyé au monde financier ?
Enfin, je suis très étonné de ne voir que deux États, l'Iran et la Corée du Nord, sur la liste du GAFI, d'autant qu'on a le sentiment qu'ils y sont surtout pour des raisons politiques. Les magistrats chargés de certaines affaires financières disent pourtant éprouver d'énormes difficultés lorsqu'ils réclament la coopération de pays dont le nom n'est pas cité – je pense en particulier à Singapour.

Vous nous avez dit que la Turquie était sur la liste « gris-foncé ». Pouvez-vous nous donner plus d'informations à ce sujet ?
De nombreux centres financiers refusent de coopérer en matière d'échanges bilatéraux de renseignements fiscaux. Avons-nous des moyens pour agir ?
Nous n'avons aucune idée du volume des avoirs non déclarés à l'étranger. Par définition, l'évaluation de la fraude fiscale est un exercice compliqué. C'est déjà vrai à l'intérieur du territoire français – même si le Conseil des prélèvements obligatoires s'y est essayé il y a quelque temps –, et ça l'est encore plus pour ce qui concerne l'évasion fiscale vers l'étranger. Certains pays voisins l'ont toutefois tenté : l'Allemagne évalue à une centaine de milliards d'euros la quantité d'avoirs allemands présents sur le territoire suisse. Mais la rigueur scientifique de telles démarches me paraît sujette à caution. Notre action, dans les prochaines années, nous permettra peut-être, par extrapolation, d'avoir une idée du montant de la fraude, mais pour l'instant, il m'est très difficile de répondre à cette question.
S'agissant du dispositif de régularisation que nous avons mis en place, je souhaite tout d'abord être très clair sur le choix du vocabulaire. Je le fais d'ailleurs en présence du ministre de l'époque, Éric Woerth, qui est à l'origine du dispositif. Sa consigne était justement de ne pas mettre en place une amnistie fiscale, contrairement à ce qu'ont fait certains pays voisins, comme l'Italie, au cours de la même période.
Rappelons qu'il n'est pas illégal de détenir des avoirs situés à l'étranger. Il est seulement obligatoire de les déclarer et de les intégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et sur le patrimoine. Une amnistie fiscale consiste donc à proposer aux détenteurs d'avoirs non déclarés une sorte de paiement pour solde de tout compte : à condition de rapatrier les fonds et de verser un impôt forfaitaire, on est libéré du paiement des droits, des pénalités et des intérêts de retard. Cette pratique, les autorités politiques et l'administration fiscale françaises l'ont refusée, préférant la constitution d'une cellule de régularisation.
Celle-ci a été fermée le 31 décembre 2009. C'était du moins la date limite à laquelle les contribuables pouvaient prendre contact avec nous, le cas échéant de façon anonyme, afin de mesurer les conséquences fiscales d'une déclaration de leurs avoirs. Ceux qui s'étaient signalés dans les délais avaient ensuite jusqu'au 15 mai 2010 pour procéder à la « désoccultation » elle-même.
Nous disposons donc depuis cette date d'un bilan complet, et public, de la cellule de régularisation. Environ 4 800 personnes se sont présentées à nos services. Les avoirs en cause, dont l'immense majorité a été rapatriée sur le sol français, s'élèvent à environ 7 milliards d'euros, tandis que le montant total des droits fiscaux rappelés à cette occasion atteint, sur plusieurs exercices, la somme de 1,2 milliard d'euros. Le rendement financier de cette opération est donc très important.
Tous les droits étaient dus sur toute la période non prescrite – trois ans pour l'impôt sur le revenu, six ans pour l'ISF. S'agissant des pénalités et des intérêts de retard, nous avons distingué entre les fraudeurs passifs – les plus nombreux – et les fraudeurs actifs. Les premiers sont ceux qui détenaient, en Suisse, au Liechtenstein ou ailleurs, des comptes peu utilisés et qui se transmettaient parfois de génération en génération. Ils ont saisi une occasion de se mettre en règle et, parfois, de résoudre des problèmes de succession. Nous avons accordé à ces personnes un taux plus favorable en matière de pénalité et un plafonnement des intérêts de retard.
Quant aux fraudeurs que nous avons qualifiés d'actifs, ce sont ceux qui ont alimenté régulièrement, notamment avec de l'argent non déclaré d'origine française, les comptes qu'ils détenaient à l'étranger. Pour eux, le niveau des pénalités et le plafond des intérêts de retard étaient plus élevés.
Nous continuons par ailleurs à traiter un flot de dossiers de régularisation, auxquels nous appliquons des conditions moins favorables depuis que la cellule a cessé son activité.
M. Myard s'est interrogé sur nos sources d'information et sur la façon dont nous posons nos questions. La procédure standard établie par l'OCDE nous oblige à être précis. Nous ne pouvons interroger les pays avec lesquels nous avons passé des conventions sur l'échange de renseignements que si nous connaissons le nom des personnes concernées, et si nous pouvons démontrer la « pertinence » – selon le terme employé par l'OCDE – des informations demandées. Nous avons donc eu besoin, en interne, de constituer une base de données comprenant les noms des personnes à propos desquelles il serait pertinent de poser des questions. Cette base, c'est le fichier Evafisc, alimenté grâce à la communication, par les établissements bancaires, d'éléments sur des transactions supérieures à un certain montant et effectuées vers des États connus pour abriter des fonds dissimulés. L'exploitation de ces renseignements, après recoupements, nous permet d'identifier les comptes suspects. Le fichier peut également être alimenté par des informations sur des échanges par carte bancaire, ou concernant la présence de personnes dans certaines structures écrans.
Nous comptons aussi sur la coopération internationale, même si elle est parfois lente et difficile. La lutte contre les paradis fiscaux a été relancée à la suite de la transmission, par des administrations fiscales étrangères, d'un fichier provenant du Liechtenstein et contenant les noms de 200 Français. En retour, nous avons nous-mêmes transmis des informations à des administrations homologues. L'assistance internationale fonctionne aussi en matière fiscale.
En résumé, nous lançons des lignes, en évitant de le faire à l'aveugle, mais les textes nous interdisent de lancer des filets.
J'en viens à la question de M. Garrigue sur l'examen par les pairs au niveau de l'OCDE. Le groupe des pairs se réunit en ce moment aux Bermudes pour étudier la situation d'une série de pays, dont la France – qui a passé l'examen sans difficulté – et les États-Unis.
Le processus d'examen est long puisqu'il se fait en deux phases, qui sont ensuite combinées : la première porte sur la législation et la seconde sur sa mise en pratique. Le rapport des pairs réunis aux Bermudes sera validé cette semaine ; notre pays y sera estampillé « coopératif », ainsi que les États-Unis, sans doute, même si le Delaware fait l'objet d'âpres débats. Les rapports d'examen sont consultables sur le site de l'OCDE.
La situation du Delaware n'empêche pas les États-Unis de passer le cap. La Suisse, et dans une moindre mesure Singapour, se sont fait épingler sur le niveau des identifiants requis pour la levée du secret bancaire, dans le cadre des conventions signées à cet effet. Le niveau de renseignements exigé par la Suisse est tel qu'il rendrait le contrôle presque superflu.

Quels sont, aux termes des accords de coopération, les identifiants exigés du demandeur ? Sur quels éléments la Suisse tente-t-elle de se dérober ?
La question posée par les autorités suisses est la suivante : le demandeur doit-il fournir non seulement l'identité du contribuable, mais aussi le nom de la banque et le numéro du compte ? Oui, répond l'OCDE, s'il les a ; mais dans le cas contraire, sa faculté d'interroger demeure inchangée. On peut d'ailleurs se demander si un État est en mesure de retrouver rapidement un compte bancaire à partir d'un simple nom, sans identifiant bancaire ni numéro de compte. La France le peut, car elle dispose d'un fichier informatique des comptes bancaires très structuré ; mais pour beaucoup d'autres pays, rien n'est moins sûr.
Après s'être montrées assez fermes, les autorités suisses, dans une déclaration récente, ont laissé entendre qu'elles accéderaient aux demandes même si les identifiants n'étaient pas complets. La question qu'il faudra alors se poser est de savoir si elles répondront. Nous en jugerons d'ici à la fin de l'année.
La revue par les pairs reproche à la Suisse un manque de clarté et la met en garde contre une attitude récalcitrante. Il s'agit donc plutôt d'un rappel à l'ordre.
Les autorités suisses ont réagi en promettant de lever toute ambiguïté ; mais la principale ambiguïté, selon nous, est l'offre concurrente, pour ainsi dire, qu'elles proposent aux États – notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni – afin d'éviter la levée du secret bancaire : le système Rubik, qui consiste à effectuer des prélèvements libératoires pour le compte de ces États, sans leur livrer l'identité des personnes en cause. Le principal attrait du dispositif est le rendement budgétaire espéré ; mais on peut aussi considérer qu'il est l'antithèse de la transparence assurée par la levée du secret bancaire. Il est aussi, bien entendu, le fruit d'une contre-offensive des banques suisses, inspirée de l'exception dont la Confédération, à l'instar de trois pays de l'UE ramenés depuis à deux, a bénéficié s'agissant des échanges d'informations prévus par la directive européenne sur la taxation de l'épargne. Plusieurs pays européens, à commencer par la France, avaient regretté cette exception qui fonctionnait selon le même système de prélèvement à la source, les pays récipiendaires n'ayant aucun moyen de contrôler l'exactitude des montants prélevés, ni d'accéder à l'identité des contribuables en cause.
Le blanchiment, au Maroc, s'opère selon deux voies. La première est historique puisqu'il s'agit de la valise à billets. Les douanes sont censées contrôler les entrées et sorties de capitaux supérieures à 10 000 euros ; le fichier des manquements aux obligations déclaratives, auquel Tracfin a accès, montre que ce phénomène perdure.
Seconde voie d'évasion du cash, plus sophistiquée et à peine plus coûteuse : les sociétés génératrices de cash dans leur principe ; en d'autres termes, le « lavage automatique » – money laundering –, par exemple par le biais de sociétés de revente de téléphones mobiles qui opèrent ensuite des transferts vers des juridictions étrangères.
Le Maroc ne disposait pas de loi anti-blanchiment adaptée aux standards internationaux jusqu'en 2005. Il n'avait pas non plus, avant 2008, de cellule de renseignement financier permettant une coopération internationale. Grâce à un parrainage de l'Union européenne, la France l'a aidé à créer une telle structure, mais celle-ci ne fonctionne que depuis moins d'un an. Elle rejoindra le groupe Egmont lors de sa prochaine session plénière en juillet ; il est donc un peu tôt pour apprécier les résultats de ces avancées.
Quant à la Turquie, le troisième tour d'évaluations mutuelles du GAFI repose essentiellement sur une analyse juridique. L'effectivité est l'enjeu majeur de la négociation des nouveaux standards du quatrième tour. En l'état actuel des choses, le GAFI juge que la législation turque est inadaptée, et ce pour plusieurs raisons : les obligations de vigilance des professions visées sont déficientes ; le contrôle des autorités bancaires sur le respect de ces obligations par les banques est imparfait ; enfin et surtout, les trois canaux de coopération – lutte anti-blanchiment par les cellules de renseignement, entraide judiciaire et coopération policière – sont jugés insuffisants.
Le troisième tour d'évaluations est assez formel, puisqu'il vise à déterminer si le corpus législatif et les structures institutionnelles permettent de répondre aux standards. La réponse a été affirmative pour Singapour. Cependant, le quatrième tour portera sur l'effectivité de la coopération : le contrôle par les pairs sera alors beaucoup plus sévère. De fait, nous éprouvons encore des difficultés à coopérer avec Singapour.

Le dispositif Rubik est pour la Suisse une manière de contourner la réglementation de l'OCDE. Rapporteur du projet d'avenant à la convention fiscale de 1966, je rappelle que le Parlement fédéral a adopté une loi de ratification selon laquelle l'État demandeur doit prouver qu'il a obtenu les renseignements d'une manière légale ; faute de quoi sa demande reste sans suite. C'est là un second moyen de contourner les règles internationales.
La Suisse est un petit pays où chaque citoyen participe à l'armée de milice jusqu'à un âge avancé. Elle a aussi un Parlement de milice, puisqu'il ne siège qu'une semaine par mois ; quant aux élus, dont les indemnités ne leur permettent pas d'exercer un mandat à temps plein, ils sont membres de conseils d'administration divers, afin, disent-ils, de réunir le politique et l'économique : chacun peut ainsi défendre son bout de gras en toute indépendance et en dehors de toute pression, bien entendu.

La fraude fiscale est le fait d'individus peu scrupuleux comme d'officines organisées, qui profitent des failles des législations nationales. Les progrès de la coopération internationale sont réels mais insuffisants, d'où la nécessité d'une gouvernance mondiale. Le G20 a-t-il permis des avancées dans la lutte contre les paradis fiscaux ?

Les collectivités locales sont régulièrement informées, en dehors de toute procédure légale, de flux de capitaux frauduleux ; or, elles n'ont ni la légitimité ni les moyens de vérifier ces informations. Dans l'immobilier, par exemple, leur rôle se borne à la vérification du respect des règles d'urbanisme, même si l'origine des fonds fait l'objet de rumeurs au niveau local.
Les administrations qui collectent le renseignement, parmi lesquelles Tracfin, laissent ainsi en jachère une source potentielle d'informations. De leur côté, les communes qui délivrent à des investisseurs un permis de construire dont elles savent qu'il est aussi un permis de blanchir n'ont aucun interlocuteur à qui faire part de leurs doutes. Elles ne peuvent pas davantage s'appuyer sur l'article 40 du code de procédure pénale, car on leur reprocherait d'agir à la tête du client. Le code des marchés publics contribue également au trouble, puisqu'il oblige à retenir l'offre la moins disante, pour peu que la différence soit significative. Certaines collectivités attribuent ainsi, en toute connaissance de cause, des marchés à des entreprises qui utilisent des capitaux illégaux. Que faire, en dehors de la modification technique des coefficients ?

S'il est vrai que les paradis fiscaux ont accéléré la crise financière, pourquoi les États ne se sont-ils pas montrés plus sévères à leur égard après le G20 d'avril 2009 ? De surcroît, le manque à gagner pour les recettes fiscales est considérable.
On a dressé une liste noire des États ; mais ne faudrait-il pas faire de même avec les institutions financières ? Comme l'a rappelé Jacques Myard, seuls deux États des États-Unis ont des régimes fiscaux vraiment inquiétants : le Nevada et le Delaware, où Lehmann Brothers avait d'ailleurs son siège social. Les institutions financières n'échappent-elles pas aux conventions fiscales entre États ?
Le but du dispositif Rubik que la Suisse propose aux États – même si l'Allemagne et le Royaume-Uni n'en sont qu'au stade de la négociation – est de leur faire espérer des recettes fiscales. Les avoirs allemands dans les banques suisses avoisineraient, dit-on, la centaine de milliards d'euros : on conçoit que des prélèvements de 5 à 10 % sur ces sommes aient de quoi faire envie, surtout en période de difficultés budgétaires. Mais, outre que ces chiffres sont sans doute exagérés, le mécanisme privilégierait le court terme et finirait par ruiner les efforts en faveur d'une plus grande transparence.
C'est la direction du Trésor et non celle des finances publiques qui suit le dossier du G20. Les précédents G20, notamment celui de Londres en 2009, avaient posé des exigences fortes, s'agissant de la lutte contre les paradis fiscaux. Ces exigences ont été relayées, non par le G20 lui-même, qui n'a pas d'institution pour cela, mais par l'OCDE – via la revue par les pairs – et bien entendu les législations nationales. L'Allemagne s'est ainsi dotée d'une législation vigoureuse, et notre pays a lui-même adopté des mesures strictes en 2009.
Pour les accords de coopération et d'échange de renseignements, la France traite évidemment avec les États et avec eux seuls. Mais on assiste parfois à des confrontations entre États et institutions financières, comme le bras de fer qui a opposé l'administration américaine à la banque suisse UBS, prise en flagrant délit d'incitation à l'évasion fiscale. La France ne peut pas non plus négocier avec un État des États-Unis, comme le Delaware. La même question s'était posée pour la Chine et certaines de ses provinces.
Vous avez rappelé, monsieur Guibal, les limites de l'article 40 du code de procédure pénale. Mais il suppose une démarche en deux temps. La première s'appuie sur l'ordonnance du 30 janvier 2009, selon laquelle toute autorité publique peut, si elle soupçonne une opération de blanchiment, transmettre des informations à Tracfin. À ce stade il ne s'agit que de soupçons ; c'est d'ailleurs toute la difficulté que pose l'article 40 aux collectivités.
Si Tracfin, pour des raisons de protection des données personnelles, ne peut révéler le contenu de ses propres fichiers à la collectivité locale, il se substituera à elle, dans un second temps, pour saisir le procureur de la République dès lors que les éventuelles investigations auront renforcé les soupçons. Ainsi l'information n'est pas perdue.

Quel est, selon vous, le taux de fraudes ? Combien de dénonciations anonymes recevez-vous ? J'en reçois moi-même un certain nombre en tant que maire ; je les lis toutes par précaution, mais elles finissent presque toujours à la corbeille car c'est une question de déontologie. Comment traitez-vous ce genre d'informations ?
Nous ignorons, par définition, le nombre de fraudes qui nous échappent ; cependant, selon les estimations faites en 2007 par le Conseil des prélèvements obligatoires, la fraude fiscale et sociale atteindrait 30 à 40 milliards d'euros.
Dans le cadre de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), nous essayons d'évaluer ce que l'OCDE appelle le « tax gap », c'est-à-dire l'écart entre les recettes fiscales attendues et celles qui sont effectivement perçues – écart dont la fraude n'est au demeurant pas la seule cause. Nous avons commencé avec la TVA, dont les recettes théoriques sont aisément calculables à partir de nos indicateurs macro-économiques : selon la Commission européenne, avec laquelle nous travaillons, l'écart avoisinerait 7 % des recettes dans notre pays – ce taux peut atteindrebeaucoup plus chez certains de nos voisins. Nous allons procéder aux mêmes évaluations pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu.
Aux termes du code monétaire et financier, la déclaration de soupçon est obligatoire pour les institutions financières, les notaires, les avocats ou les agences immobilières. Elle est en revanche interdite pour les particuliers. Les courriers que nous recevons d'eux sont le plus souvent électroniques, et ne sont d'ailleurs pas aussi nombreux qu'on pourrait l'imaginer. Nous y répondons toujours avec sévérité, rappelant que nous n'avons pas vocation à recevoir ces renseignements et que ceux qui nous les adressent s'exposent, le cas échéant, à des poursuites pour dénonciation calomnieuse.

Merci, messieurs. Notre commission vous invitera de nouveau pour apprécier le degré de coopération des différents États que vous avez interrogés.
Informations relatives à la commission
La commission nomme les rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2012.
– Affaires européennes :
• 1ère partie – article relatif au prélèvement communautaire
M. Roland Blum, rapporteur pour avis
– Action extérieure de l'Etat :
• Action de la France en Europe et dans le monde
• Français à l'étranger et affaires consulaires
• Présidence française du G20 et du G8
Mme Geneviève Colot, rapporteure pour avis
– Action extérieure de l'Etat :
• Diplomatie culturelle et d'influence
M. François Rochebloine, rapporteur pour avis
– Aide publique au développement :
Mme Henriette Martinez, rapporteure pour avis
– Défense :
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur pour avis
– Ecologie, développement et aménagement durables :
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur pour avis
– Economie
• Commerce extérieur
M. Jean-Paul Bacquet, rapporteur pour avis
– Immigration, asile et intégration :
M. Philippe Cochet, rapporteur pour avis
– Médias :
• Action audiovisuelle extérieure
M. Didier Mathus, rapporteur pour avis
La séance est levée à dix heures quarante-cinq.