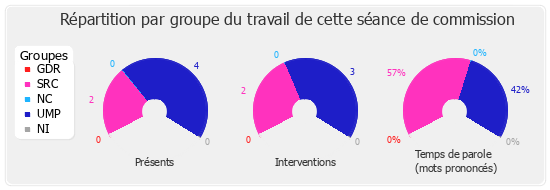Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale
Séance du 16 mars 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
Mercredi 16 mars 2011
La séance est ouverte à seize heures.
(Présidence de M. Bernard Accoyer, président de la Mission d'information)
La Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale entend, en audition ouverte à la presse, M. Jean-Pierre Clamadieu, président-directeur général de Rhodia, M. Patrick Pélata, directeur général délégué aux opérations de Renault, et M. Jean-Cyril Spinetta, président du groupe Air France-KLM.

Nous recevons aujourd'hui MM. Jean-Pierre Clamadieu, président-directeur général du groupe Rhodia, Patrick Pélata, directeur général délégué aux opérations de Renault, et Jean-Cyril Spinetta, président du conseil d'administration d'Air France-KLM.
En 2010, Rhodia a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros, grâce à quelque 14 000 collaborateurs établis dans vingt-cinq pays. Renault a réalisé, en 2010, un chiffre d'affaires de 38,9 milliards d'euros, est présent dans cent dix-huit pays et emploie plus de 120 000 salariés. Air France-KLM a réalisé, pour l'exercice 2009-2010, un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros et transporté 71 millions de passagers vers 244 destinations. Ce groupe compte plus de 104 000 salariés.
Rhodia est une entreprise de chimie, leader mondial sur plusieurs marchés. La France ne compte que pour 7 % dans son chiffre d'affaires, l'essentiel de celui-ci étant réalisé dans les pays dits émergents, à forte croissance, comme le Brésil, où nous sommes implantés depuis quatre-vingt-dix ans, et la Chine, où nous somme installés depuis trente ans. La France représente environ 30 % de notre production et 50 % de nos activités de recherche et développement.
La chimie demeure un secteur d'activité très capitalistique : les coûts des matières premières et de l'énergie représentent la moitié de notre chiffre d'affaires, contre 15 % seulement pour la main-d'oeuvre. Notre approche est donc différente de celle d'un constructeur automobile ou d'une entreprise de services.
La localisation de nos activités se fonde d'abord sur la dynamique de nos marchés : nous cherchons à nous installer dans les zones de croissance de ceux-ci.
Les coûts d'accès aux matières premières et à l'énergie constituent aussi un facteur essentiel de localisation de nos activités. Ils diffèrent considérablement d'une région du monde à une autre. Par exemple, le coût d'accès au gaz – dont Rhodia est le premier consommateur industriel en France – est deux fois plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. De même, pour accéder aux matières premières, notamment les terres rares, nous développons nos activités en Chine, qui en est l'un des principaux producteurs.
Enfin, le poids considérable de nos investissements industriels a pour conséquence une inertie très forte de nos implantations. Le coût de la construction d'une usine chimique s'établit à plusieurs centaines de millions, si ce n'est à des milliards d'euros. Un tel investissement est donc réalisé pour trente ou cinquante ans, voire un siècle, car il nous est difficile de délocaliser nos usines une fois construites. Pour cette raison – et nous en sommes très heureux – nous restons un producteur important sur le territoire français et donc un fort exportateur.
Rhodia conduit en France 50 % de ses activités de recherche et développement car l'environnement dans notre pays y est favorable. Nous avons, en effet, la chance de pouvoir nous appuyer sur les organismes de recherche universitaires et publics, avec lesquels nos relations sont étroites. Rhodia a ainsi monté quatre équipes mixtes, associant ses chercheurs et ceux du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur des thèmes de recherche définis en commun.
Le crédit d'impôt recherche, adopté lors de la présente législature, a rendu compétitif le coût d'un chercheur en France par rapport au reste du monde. Rhodia n'a donc plus aucune raison économique d'implanter des activités de recherche en Chine plutôt qu'en France. Les autres groupes industriels partagent cette analyse.
En revanche, si le coût du travail ne représente que 15 % du chiffre d'affaires du groupe, nous constatons qu'un opérateur industriel nous coûte 20 % plus cher en France qu'en Allemagne, du fait des charges patronales, sachant par ailleurs qu'il travaille pendant une durée inférieure de 7 % environ.
Un autre handicap de la France en matière de compétitivité réside dans la moindre flexibilité dans l'organisation du travail. Les nombreuses contraintes que nous impose le code du travail nous empêchent de nous organiser de manière optimale, ni même comme le souhaiteraient nos salariés.
Dans notre activité, le travail posté constitue la règle pour les opérateurs. Or, alors que, dans presque tous les pays du monde, nous collaborons avec des équipes travaillant douze heures par jour, en France nous n'avons pas le droit de leur imposer huit heures de travail par jour. Le plus grand nombre de nos salariés souhaiteraient pourtant travailler sur la base de créneaux horaires plus longs. Dans nos métiers, les opérateurs postés accomplissent pour la plupart des tâches de surveillance et d'intervention ponctuelle, qui seraient donc compatibles avec des durées de travail plus longues, en sachant que des postes de douze heures plutôt de huit permettent de limiter le nombre de jours de travail dans l'année. Seul le code du travail nous interdit d'établir une telle organisation, pourant souhaitée par nos partenaires sociaux et qui nous permettrait de simplifier notre organisation.
Chez Rhodia, un travailleur posté prend environ 180 postes dans l'année : en application du code du travail et des accords d'entreprise, il vient donc travailler huit heures d'affilée un jour sur deux. La mise en oeuvre des trente-cinq heures n'a pas eu de conséquences sur cette durée, car le temps de travail des travailleurs postés de Rhodia était déjà inférieur à cette limite.
Quant au taux de recouvrement des travailleurs de jour, il est en France de 1,5 salarié pour un poste assuré à plein temps pour l'ensemble de l'année, contre 1,2 dans la plupart des autres pays où nous opérons.
En France, la flexibilité de moyen terme demeure également limitée. Procéder à des ajustements d'organisation pour faire face par exemple à une chute sérieuse de la demande, nous impose d'affronter des contraintes de mise en oeuvre considérables.
Lors de la crise de 2009, Rhodia a fait le choix de faire porter la flexibilité sur les travailleurs intérimaires pour conserver le plus possible ses travailleurs permanents, former un opérateur à un poste dans une usine requérant de plusieurs mois à un an et demi, voire deux dans nos métiers. Pour supprimer quelques dizaines de postes, nous avons dû, afin de respecter le code du travail, élaborer un plan social. De ce fait, entre le début de la procédure et la première mise en oeuvre pratique, onze mois se sont écoulés. Ce délai est sans commune mesure avec ceux que nous constatons dans n'importe lequel des pays où nous opérons. La multiplicité des instances représentatives du personnel – comités d'entreprise, délégués du personnel, comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail – au niveau des sites comme de la direction de l'entreprise complexifie les procédures. Et, au bout du compte, chacun « joue la montre », dans un contexte où la sécurité juridique de l'entreprise reste fragile, car un juge pourra, à un moment donné, donner un coup d'arrêt, entraînant un retard supplémentaire, à un processus au motif que telle ou telle procédure de consultation ou d'information n'aura pas été conduite dans les règles.
Au contraire, dans certains pays comme l'Allemagne, il est possible en quelques mois de négocier un accord, même s'il peut se révéler coûteux, et de le mettre ensuite rapidement en oeuvre entre partenaires de bonne foi.
Tout ce qui nous permettrait en France de réagir plus vite face aux variations d'activité nous paraîtrait aller dans le sens d'une meilleure compétitivité de nos entreprises.
Nous nous réjouissons que la représentation nationale s'empare du thème de la compétitivité de l'industrie française, cruciale pour notre pays.
Les capitalisations boursières, traduisant en théorie l'espoir des profits futurs d'une entreprise et donc la confiance en sa croissance et sa santé financière, appellent à la modestie sur la force de Renault et de PSA Peugeot-Citroën dans la compétition mondiale.
Dans le secteur de l'automobile, au 15 mars 2011 – date peu favorable –, la capitalisation boursière de Toyota est d'un peu moins de 100 milliards d'euros, celles de Volkswagen, Daimler et Honda d'un peu moins de 50 milliards d'euros. Avec 11 milliards d'euros, Renault arrive en douzième position après Nissan, Hyundai et le premier chinois – près de 20 milliards d'euros –, suivi de Tata et de Dong Feng, à plus de 10 milliards d'euros, puis de Porsche, Suzuki, Fiat et BYD, un tout jeune constructeur chinois de voitures électriques, aux environs de 8 milliards d'euros. PSA Peugeot-Citroën occupe la dix-neuvième place du classement avec 6 à 7 milliards d'euros, dans une liste qui comprend encore trois constructeurs chinois dans les vingt-cinq premiers constructeurs mondiaux.
Si, en France, les deux constructeurs nationaux, et notamment Renault, sont considérés comme des entreprises très fortes, leur capitalisation montre qu'ils ne sont pas parmi les plus puissants au niveau mondial.
Grâce à son alliance avec Nissan, et un accord stratégique essentiel avec Daimler, Renault dispose cependant d'autres atouts. Ainsi, le budget de recherche et développement cumulé de Renault, Nissan et Daimler est le plus fort de l'industrie automobile, et supérieur même à celui de General Electric, probablement pourtant l'un des plus considérables de l'industrie mondiale. On voit quel potentiel ouvre une répartition intelligente du travail entre les trois entreprises.
En effet, comme l'a dit M. Jean-Pierre Clamadieu, le premier élément pour rendre une entreprise industrielle compétitive, c'est la recherche et le développement. Si, alors que la France représente pour Renault 25 % de son chiffre d'affaires, nous n'y fabriquons que 21 % ou 22 % de nos voitures en volume, cette production française représente 50 % environ de la valeur de notre production : autrement dit, nous fabriquons en France nos voitures à plus forte valeur ajoutée. C'est là le résultat d'une stratégie : eu égard à leur poids sur la profitabilité et à leur coût élevé, les coûts salariaux, charges comprises, nous poussent à produire en France les produits à plus forte valeur ajoutée.
L'institution du crédit d'impôt recherche a renforcé notre compétitivité. À l'année, nos ingénieurs français nous coûtent en moyenne 79 000 euros chacun. Grâce au crédit d'impôt recherche, ce coût est réduit à 68 000 euros. Celui de nos ingénieurs coréens ou brésiliens est de 38 000 euros ; en Inde, il est de 27 000 euros ; en Roumanie, il est de 21 000 euros. C'est dire l'intérêt de ce dernier pays, membre de l'Union européenne, pour Renault.
Nous avons également signé avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) un accord concernant la recherche sur les batteries de nouvelle génération. Nous y consacrons 20 millions d'euros par an. Nous n'avons conclu aucun partenariat équivalent ni en Corée, ni au Japon.
Enfin, la France est en pointe s'agissant du véhicule électrique. D'ailleurs, il y a un an, une mission japonaise est venue examiner son développement.
En matière d'émissions de CO2 dans l'automobile, l'Europe et, au sein de celle-ci, la France, sont en avance sur le reste du monde. Les véhicules vendus en France émettent en moyenne moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre ; en Europe, le chiffre est supérieur à 145 grammes et il est aux États-Unis de 195 grammes. Autrement dit – propos rare de la part d'un industriel –, la force de la taxation « verte », traduisant l'exigence européenne en matière d'émission de CO2 constitue un avantage compétitif. Les constructeurs européens, et en particulier les constructeurs français, du fait de dispositifs comme le bonus-malus environnemental, sont toujours bien placés en matière de techniques de réduction des émissions de CO2.
Le regroupement, à l'initiative de l'État, d'une commande de 100 000 véhicules électriques par les grands groupes, publics et privés, notamment La Poste, est un outil de politique industrielle conciliant fonctionnement du marché et, pour les constructeurs, accès plus rapide à la grande série.
Le principal point faible de l'industrie française demeure cependant le poids des charges sociales, parmi les plus élevées du monde.
Pour y faire face, Renault a décidé de localiser en France ses activités de recherche et développement, 82 % de la valeur de celles-ci y étant produite, ainsi que la production des voitures dont la valeur ajoutée est la plus forte et des voitures qui font l'objet de nouveaux développements : les véhicules électriques, utilitaires, et de haut et de milieu de gamme de Renault sont pour l'essentiel fabriqués en France, pour 50 % de la valeur ajoutée, à comparer avec 25 % du chiffre d'affaires et 21 % du volume produit. Dans cette répartition réside notre stratégie.
Nous avons aussi entrepris d'attirer en France des productions à forte valeur ajoutée pour Daimler et Nissan. Ainsi, les moteurs diesel des Nissan Infiniti vendues en Europe proviennent de l'usine de Cléon en Normandie et ont été développés en région parisienne par les ingénieurs de Renault.
L'accord de coopération stratégique entre Renault et Daimler a comme objectif essentiel de répondre à la menace stratégique considérable représentée par Volkswagen. La production de ce constructeur, cinq à six fois supérieure, lui permet des économies d'échelle très importantes. De plus, son budget de recherche et développement a dépassé largement celui de Daimler, qui a pourtant construit la réputation de sa marque, Mercedes, sur l'avance technologique. Ne pouvant plus suivre, Daimler doit partager ses progrès avec Renault et Nissan, cette démarche conduisant à rapatrier en France un travail de recherche et développement qui s'avère très compétitif avec celui de nos alliés Allemands.
L'adaptation de nos capacités de production en France pour que le taux d'engagement des usines soit désormais au moins de 80 % à 90 % par équipes de deux fois huit devrait être achevée en 2012, et au plus tard en 2013.
Les charges sociales restent le point faible de la compétitivité en France : avec 30 usines environ dans le monde, Renault se trouve bien placé pour en effectuer une comparaison. Les coûts complets, payés dans les usines de Renault à l'heure de travail ouvrier, sont de 28 euros de l'heure en France, de 20 en Espagne, de 10 en Slovénie, de 5 en Roumanie, de 6 en Turquie, de 4 au Maroc, de 16 en Corée du Sud, de 8 au Brésil, et entre 1 et 2 en Inde, dans le sud de laquelle nous détenons une usine commune avec Nissan. Nous n'avons en revanche pas d'usine en Allemagne. Aux États-Unis, où Nissan possède des usines, la comparaison, un peu plus complexe, est défavorable à l'Europe, bien que les produits européens n'y soient pas en compétition avec ceux des États-Unis.
Un document dressant une comparaison entre la France et les États-Unis, établi en coopération avec PSA Peugeot Citroën – ce qui explique les écarts de périmètre avec les autres chiffres de Renault – montre aussi, à partir de données de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de l'institut COE-Rexecode, que le poids des charges sociales dans le salaire brut au sein des secteurs exposés – industrie chimique, métallurgie, mécanique, électricité, électronique et automobile – varie en France entre 35 % et 43 % alors que, dans les secteurs abrités – construction, commerce, hôtellerie et restauration -, les taux sont compris entre 22 % et 28 %. Les taux élevés constatés dans les secteurs exposés fonctionnent comme des taux de douane dissimulés, puisque les voitures importées ne les subissent pas, au contraire des véhicules produits en France, qu'ils soient commercialisés en France ou à l'étranger.
Lors des états généraux de l'automobile lancés début 2009 par M. Luc Chatel, alors secrétaire d'État chargé de l'industrie, nous avions établi que l'écart de coût entre un véhicule produit en France et un autre entièrement conçu et produit en Europe de l'Est était de 1 400 euros, dont 1 000 dus aux charges sociales et 400 aux salaires réels. Or, si nous savons compenser ces 400 euros par la logistique, nous ne savons pas comment compenser les 1 000 autres.
Cette situation entraîne des difficultés considérables. Renault vend une Clio moins de 10 000 euros à son réseau. Or, 1 000 euros, c'est 10 % de cette valeur. La marge opérationnelle dans l'industrie automobile étant au mieux de 4 % à 5 %, l'écart représenté par le surcoût de 1 000 euros est celui entre un bénéfice confortable et un déficit dangereux.
Cela étant, une voiture Renault vendue en Europe de l'Est demeure moins chère fabriquée en Roumanie qu'en Inde ou en Chine. La situation face à la Chine n'est donc pas défavorable pour une Europe qui saurait bien gérer ses flux, et qui, comme le Japon le fait avec l'Asie, répartirait ses productions à faible valeur ajoutée dans les espaces où la main-d'oeuvre n'est pas chère et concentrerait celles réclamant des qualifications plus fortes dans les espaces où les salaires sont plus élevés.
Enfin, les difficultés que nous rencontrons en matière de flexibilité du travail ne concernent pas le travail ouvrier, notre production en Europe de l'Ouest ne subissant pas de très forte tension, mais l'ingénierie. Le technocentre représente un actif de 1,6 milliard d'euros et 14 000 personnes y sont employées, ce chiffre continuant de s'accroître. Le droit du travail français nous impose des contraintes considérables, alors que la gestion de l'activité courante n'est pas facile. Nous réussissons, avec difficulté, à maintenir un temps d'ouverture de 14 heures par jour cinq jours par semaine, pour un temps d'engagement qui n'est que de 50 %. Au contraire, l'ingénierie de Nissan, comparable en effectifs et en taille à celle de Renault, peut travailler sans difficulté, en cas de besoin, 24 heures sur 24. Le résultat sur l'engagement des actifs n'est évidemment pas le même, non plus que les délais de développement.
Les rapports récents de la Cour des comptes, de l'institut COE-Rexecode et du ministère de l'industrie convergent tous : depuis une dizaine d'années, l'économie française a reculé au regard de l'ensemble des indicateurs de compétitivité.
Même si le débat en France a tendance à se concentrer sur la parité monétaire, on voit bien qu'à l'intérieur de la zone euro, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas ou encore la Suède tirent remarquablement leur épingle du jeu au regard d'un pays comme la France. En 1999, la part des exportations de la France représentait 16,3 % des exportations des seize pays de la zone euro et celle des Pays-Bas 10,9 % ; en 2010, la France était à 13,1 % et les Pays-Bas à 12,4 %.
Les économies européennes, notamment celle de la France, ont pour principale difficulté l'adaptation à la mondialisation. Aborder celle-ci à travers les entreprises et les politiques publiques suppose de distinguer métiers régionaux et mondiaux. Cette grille de lecture est appliquée de façon systématique dans la stratégie du groupe Saint-Gobain, dont je suis administrateur.
Beaucoup de métiers industriels – la production de ciment, de verre ou de plâtre – sont des métiers régionaux. Une entreprise française qui veut vendre du ciment en Chine doit l'y fabriquer et, de même, une entreprise chinoise ne peut vendre du ciment en France qu'en l'y fabriquant, car les coûts de transport, en particulier, imposent ce modèle.
La logique des métiers mondiaux est exactement inverse : dans ces métiers, pour des raisons de coûts relatifs de transport ou de valeur des produits fabriqués, il est possible de fabriquer ailleurs que dans les pays de vente.
Cette distinction, pourtant appliquée par les groupes industriels, n'est pas assez prise en compte. Parmi les métiers régionaux, on ne compte que quelques métiers industriels, comme ceux qu'exerce Air Liquide, la plupart, comme l'hôtellerie et la restauration ou les soins à la personne, étant des métiers de services. Ces métiers régionaux ne sont pas soumis à des impératifs de compétitivité mondiale. Pour chaque mesure prise, le chef d'entreprise ou le décideur public doit se demander si celle-ci constitue bien une réponse adaptée aux problèmes de compétitivité existants, et si elle vise bien des métiers mondiaux et non pas seulement principalement des métiers régionaux.
Les mesures d'exonération de cotisations sociales sur les bas salaires constituent un exemple significatif. Elles ont été prises par trois gouvernements successifs, en 1995, 2000 et 2003, avec beaucoup de constance ; il est pour autant facile de remarquer que leur limitation aux rémunérations inférieures ou égales à 1,6 SMIC fait qu'elles profitent essentiellement, de fait, aux métiers régionaux.
La Cour des comptes a réalisé en 2008 un rapport sur les exonérations de charges sociales en faveur des métiers les moins qualifiés. Le taux apparent d'exonération, c'est-à-dire le montant des exonérations rapporté à la masse salariale, était de 2 % dans le secteur de l'automobile, de 2,8 % dans celui des équipements électriques, électroniques et informatiques, qui sont des métiers mondiaux, et de 9,8 % dans le secteur de la construction, de 7,8 % dans le commerce, de 13,6 % dans celui des cafés et hôtels-restaurants, tous des métiers régionaux.
Il me semble donc que cette distinction entre métiers mondiaux et régionaux devrait être toujours prise en considération, si l'on parle de compétitivité, d'autant qu'il est facile de savoir si une mesure s'appliquera à un métier mondial ou régional. Or, les efforts me semblent devoir être concentrés plutôt sur les métiers mondiaux que sur les métiers régionaux.
Le transport aérien est un métier de services mondial : il n'existe presque pas d'exemple où, pour aller d'un point à un autre du globe, le client n'ait pas le choix entre plusieurs offres de transport – au moins deux –, une compagnie française et une autre du pays desservi. Ce métier présente aussi la caractéristique d'être à très forte intensité capitalistique. Eu égard notamment au coût des avions, pour y rester, il faut pouvoir dégager, au profit de l'investissement, de 10 % à 15 % du chiffre d'affaires chaque année. Ce métier est également très intense en termes de coût de personnel : en Europe, par exemple, celui-ci représente entre 25 % et 30 % des coûts totaux des compagnies.
Le transport aérien avait, de plus, été soumis dans les années 1945 et 1946, à une régulation très spécifique de la part des Américains. Ces derniers ont créé des règles imposant, pour les échanges entre deux pays, des systèmes de droits de trafic, négociés non pas entre compagnies aériennes mais entre États, qui les octroient ensuite aux compagnies relevant de leur nationalité.
Le bilatéralisme, lié au principe de réciprocité qui présidait à ces échanges, protégeait très efficacement les compagnies nationales. Il a volé une première fois en éclats en 1993, lorsqu'un marché intra-européen absolument libre a permis la création des compagnies low cost en Europe. Il vit aujourd'hui ses dernières années. Notre métier sera bientôt régi par les règles habituelles des métiers de services : libertés d'établissement et d'accès au marché sans contraintes spécifiques.
Les compagnies aériennes européennes sont aujourd'hui les premières dans le monde par leurs chiffres d'affaires, leurs résultats sur les dix dernières années et leurs capacités à investir pour l'avenir. Cette position privilégiée s'explique par deux avantages qui vont malheureusement progressivement s'estomper.
Il s'agit, d'une part, d'une rente historique : créées dans les pays les plus développés, les compagnies aériennes européennes ont ouvert les liaisons. Ainsi, entre le Brésil et l'Europe, celles-ci assurent 80 % des liaisons contre 20 % seulement pour les brésiliennes. Mais les pays émergents souhaiteront évidemment assurer à leurs compagnies aériennes la moitié du trafic entre eux-mêmes et l'Europe.
Les compagnies européennes bénéficient, d'autre part, d'une rente de réputation en matière de service et de sécurité. Cette rente est elle aussi en train de disparaître.
Par ailleurs, notre métier n'est pas marqué par des innovations particulières : la seule compétitivité entre les compagnies réside donc dans les prix. Comment les compagnies aériennes européennes peuvent-elles rester les premiers opérateurs mondiaux, avec certes une performance économique acceptable, mais des prix supérieurs ? C'est que, profitant de leurs effets de taille, elles ont été les premières à créer des plateformes de correspondance, la productivité de ces instruments leur ayant permis de compenser un temps leurs déficits structurels liés à la part des salaires dans les coûts d'exploitation. Or, les autres pays atteindront certainement rapidement les mêmes niveaux d'organisation.
Les coûts de personnel, notamment en termes de charges sociales, constituent un handicap considérable en France. Pour un salaire brut de 100, Air France paie ses salariés, charges sociales comprises, 146 en France, mais 119 aux Pays-Bas, 129 en Allemagne, 125 au Royaume-Uni, 121 en Irlande, 129 en Italie et 124 en Espagne. Comparés à ceux versés par Lufthansa ou KLM, les salaires bruts eux-mêmes versés par Air France sont un peu inférieurs pour les pilotes, plus faibles pour le personnel au sol et en revanche supérieurs, hors charges sociales, pour les personnels navigants commerciaux. Alors que les salaires convergent globalement, les charges sociales et autres taxes propres à la France, telles que la taxe professionnelle, la taxe d'apprentissage ou celle sur les salaires, altèrent notre compétitivité au regard des autres pays d'Europe.
Grâce à la fusion entre Air France et KLM, nous pouvons établir une comparaison très précise. Si Air France était installée à Amsterdam, et régie par le droit néerlandais, sa masse salariale serait, pour les mêmes salaires que ceux qui sont aujourd'hui versés en France, inférieure de 700 millions d'euros. La taxe professionnelle, la taxe d'apprentissage ou celle sur les salaires représentent 130 millions d'euros de plus. Autrement dit, l'écart de coûts salariaux entre une société Air France immatriculée à Paris et une société Air France immatriculée aux Pays-bas est de 800 millions d'euros.
Il nous est aussi parfois reproché de ne pas avoir suffisamment réagi face au développement des compagnies low cost. Nous avons cependant créé, il y a cinq ou six ans, la compagnie Transavia. Néanmoins, celle-ci reste de 5 % à 7 % plus chère qu'Easyjet.
La concurrence avec les compagnies des pays du Golfe ne concerne pas seulement Air France, mais aussi l'ensemble de l'industrie du transport aérien. Dans ce secteur, trois grands opérateurs distants de quelques centaines de kilomètres, Emirates, à Dubaï, Etihad à Abou Dabi et Qatar Airways au Qatar ont des ambitions mondiales et, dans quelques années, mettront en ligne deux fois plus d'avions que Lufthansa, British Airways, Air France et KLM réunies. Cela est d'autant plus préoccupant que ces compagnies ne se soucient absolument pas d'être rentables et qu'aucun métier ne peut résister à ce genre de défi. Il est d'ailleurs fallacieux de faire valoir l'intérêt qu'elles représentent pour l'industrie européenne grâce aux commandes d'avions qu'elles passent : les voyageurs qu'elles transportent, si elles n'existaient pas, utiliseraient aussi bien d'autres compagnies et les commandes seraient exactement les mêmes. Leur donner un droit de trafic parce qu'elles achètent des avions n'a donc aucun sens – les flux de trafics mondiaux en attestent – et l'effet positif sur les fabricants est nul, la demande s'étant simplement déplacée des compagnies habituelles vers leurs concurrentes.
Permettez-moi maintenant de formuler quelques propositions.
Les charges sociales représentent des sommes d'autant plus considérables que notre situation budgétaire est extrêmement contrainte. Alors que les exonérations sont plafonnées en fonction des salaires, à effort budgétaire constant, ne serait-il pas économiquement plus efficace d'uniformiser une baisse des cotisations patronales sur la famille ou la maladie, peu importe, laquelle s'appliquerait à l'ensemble des entreprises ? Dans le secteur de l'automobile, les exonérations de charges sociales passeraient ainsi de 2 % à 4 % et, pour Air France, le gain serait de 4 % par rapport au système actuellement en vigueur. De surcroît, la création d'une « TVA sociale » visant à financer, au-delà de ces quatre points, une partie de la protection sociale qui l'est actuellement par les cotisations patronales et salariales me semble souhaitable, même si j'en mesure les contraintes et la nécessaire progressivité afin de ne pas déstabiliser l'économie.

Vous avez formulé essentiellement deux propositions, en l'occurrence sur les charges sociales et la flexibilité. Or, comme dit le Premier ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker : « Ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais. Dites-moi comment le faire ! »
Nous savons que 5,4 points de cotisations familiales ne devraient plus être financés par les entreprises, mais fiscalisés. Alors que l'impôt sur le revenu rapporte dans notre pays 2,5 points de moins que dans la majorité des autres pays européens, considérez-vous que les entreprises aient un rôle pédagogique à jouer afin de faire accepter le transfert de ces 5,4 points sur ce dernier, en y associant la réduction des niches fiscales et en poursuivant les allégements de charges sur les bas salaires qui, il est vrai, profitent essentiellement aux services ? Un tel dispositif me semblerait préférable à l'instauration d'une TVA sociale, compte tenu de l'attachement des salariés à leur pouvoir d'achat.
Par ailleurs, la création du dispositif de rupture conventionnelle des contrats à durée indéterminée a-t-elle eu des effets positifs ? Nous savons, en effet, que la multiplication des instances représentatives et la complexité de la procédure sont patentes, de même que l'insécurité juridique. D'après vous, monsieur Jean-Pierre Clamadieu, comment peut-on améliorer la négociation salariale et mettre en place des contre-pouvoirs simplifiés et juridiquement sécurisants ?
Enfin, que représente la baisse de la taxe professionnelle dans votre chiffre d'affaires et comment réagissez-vous aux propos récents d'un membre du Gouvernement sur la nécessité d'augmenter les salaires ?
Pour Rhodia, la réforme de la taxe professionnelle aurait dû être une bénédiction. Or, compte tenu du plafonnement, le prélèvement est passé de 3,5 % à 3 % de la valeur ajoutée. Cela représente 4 millions d'économies par an – c'est bien, certes, mais ce n'est pas révolutionnaire. J'ajoute que le déplafonnement de la contribution au service public de l'électricité et le projet visant à faire payer une fraction des quotas de CO2 – ce dernier semblant toutefois contraire au droit européen – engloutiraient environ la moitié des économies réalisées grâce à la réforme de la taxe professionnelle. Pour une entreprise qui investit considérablement et qui consomme beaucoup d'énergie, la direction suivie par les pouvoirs publics n'est guère claire.
Nous bénéficions en outre d'un dialogue social de bonne qualité. Un accord concernant une hausse des salaires de 3 % a ainsi été signé cette année avec l'ensemble des partenaires sociaux, y compris la Confédération générale du travail (CGT), en raison de la bonne santé de notre entreprise, laquelle semble d'ailleurs perdurer en 2011.
S'agissant, en revanche, de la flexibilité, nous souhaiterions qu'il soit mis fin au millefeuille social nous obligeant, pour de simples évolutions dont l'impact est très modeste, à passer devant de multiples instances et à respecter des procédures extrêmement complexes. Si les comités d'entreprise ont toujours recouru aux expertises, c'est maintenant aussi le cas des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, sur les mêmes questions, font appel à leurs propres experts. Bref, l'ingénierie est complexe et sa rationalisation serait bienvenue. Ainsi, au premier trimestre, 30 % de notre activité avait disparu : il a fallu onze mois pour que les plans d'ajustements structurels soient mis en place, alors qu'ils l'ont été en deux ou trois mois dans la plupart des autres pays du monde. La simplification de ce millefeuille constitue une telle priorité que j'avancerai que nous serions sans doute prêts à promouvoir des mesures d'accompagnement plus généreuses en échange d'une sécurité juridique et d'une rapidité d'action plus soutenue.
Autre exemple : en 2009, nous avons souhaité maintenir notre force de frappe pour préparer le redémarrage de l'activité après la crise. Dans la région lyonnaise, nous avions deux usines, l'une à Collonges, l'autre à Saint-Fons. Vous n'imaginez pas les difficultés que nous avons rencontrées pour affecter les salariés de celle dont la sous-activité était très forte à celle dont le niveau d'activité, au contraire, était tel que nous y employions un grand nombre d'intérimaires. La complicité était objective entre, d'une part, ceux qui étaient habitués à travailler avec leurs intérimaires et qui n'avaient pas très envie de les voir partir – nous avions fixé comme règle du jeu la préservation d'un emploi permanent – et ceux qui, d'autre part, considéraient que la sous-activité n'était pas si désagréable, dès lors que l'entreprise avait pris quelques engagements sur la façon dont elle serait traitée.
Même si l'année 2009 a, certes, été celle d'une crise majeure, nous devons faire face à des évolutions permanentes. La situation que connaît le Japon, par exemple, aura inévitablement un impact : dans certains secteurs, nous serons obligés de produire plus pour pallier des défaillances et, dans d'autres, de produire moins parce que nos clients auront d'autres priorités. La France, plus que d'autres pays, éprouve des difficultés à s'adapter.
Il est en effet indispensable d'améliorer nos procédures de concertation, surtout lorsqu'on les compare avec celles qui sont en vigueur en Allemagne – nous le constatons avec Daimler –, au Japon ou en Corée. Outre que les discussions sont, chez nos voisins, beaucoup plus fréquentes, la rapidité d'action – y compris s'agissant de la transformation de la structure des salaires en fonction des qualifications – y est autrement plus grande.
Par ailleurs, le flux de voitures fabriquées et vendues en France n'étant pas considérable en raison de l'actuelle division internationale du travail, les véhicules seront systématiquement en concurrence avec ceux qui sont produits à l'étranger, y compris par un même groupe. La taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant aux voitures importées, nous ne pourrons qu'être favorables à ce double effet et, donc, à son augmentation dès lors que les charges sociales diminueront.

Vous êtes donc favorable au transfert d'une partie du financement de la protection sociale sur la consommation.
En effet, et ce alors même que l'impact sera réel sur le marché, comme nous avons pu le vérifier lorsque l'Allemagne, en 2008, a augmenté sa taxe sur la valeur ajoutée de deux points. Les différentes estimations montrent, toutefois, qu'il ne s'agit que d'un passage difficile n'excédant pas un an avant que des conséquences positives sur l'emploi ne se fassent ressentir. Pour un véhicule vendu 14 000 euros, on observe un écart de 10 %, soit 1 400 euros, entre une voiture conçue et produite en Europe de l'Est et la même conçue et produite en France, dont 400 euros de différence de salaires, 250 euros de taxe professionnelle – que le Gouvernement français a donc diminuée – et 750 euros d'écart de charges sociales. Sur les 250 euros précités, nous en avons gagné 60 ou 70 : si ce n'est pas négligeable, ce n'est pas à la hauteur du problème.
Par ailleurs, nous souhaiterions contribuer à l'amélioration du moral des ménages et de la productivité en augmentant les salaires, mais les situations ne sont pas toutes identiques. En particulier, il n'est pas possible de gagner de la productivité sur le travail ouvrier quand ce dernier coûte 6 euros horaire en Turquie, 10 euros en Slovénie et 28 en France. En revanche, si une baisse significative des charges sociales peut entraîner une petite redistribution sur le salaire direct, des hausses de salaires de personnels qui sont peu nombreux et dont la qualification est peu répandue à l'étranger sont d'ores et déjà programmées. Nous sommes d'ailleurs favorables à la mise en place d'un tel cercle vertueux permettant d'accroître la productivité en la partageant, même si cette dernière, dans un monde où les marchés étaient fermés, était absolue et qu'elle est désormais relative. Ainsi, aujourd'hui, pour les « cols bleus » travaillant dans l'industrie automobile, elle est à peu près identique partout alors que les écarts de salaires sont très importants.
La prise de conscience des salariés, au moins dans les grands groupes, est acquise : on ne peut financer les politiques nationales de protection sociale sur les charges sociales acquittées par les entreprises. À Air France, j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'exposer les difficultés que nous rencontrions au sein de l'espace européen. En outre, un problème de fonctionnement peut surgir entre cette compagnie et KLM, la performance de la seconde étant meilleure que celle de la première alors que c'est celle-là qui a absorbé celle-ci. Les Néerlandais finiront par refuser de suppléer les défaillances françaises.
Nous souffrons également de la multiplicité des instances de procédure, l'intervention du juge, plus que les textes, contribuant souvent à compliquer davantage les situations. Parmi les grandes réformes récemment réalisées figure celle de la représentativité syndicale, dont les effets – je songe à l'amélioration du dialogue social à travers l'émergence de grandes organisations syndicales, condition d'une meilleure maîtrise des procédures – se feront ressentir progressivement. Si la négociation sociale se déroule dans de bonnes conditions, nous parvenons à respecter des délais convenables pour résoudre les problèmes mais, si les syndicats décident d'utiliser toutes leurs armes, ils peuvent le faire avec une maestria consommée. La situation est aujourd'hui en train de changer, comme nous l'avons constaté à Air France lors des élections qui se sont déroulées la semaine dernière, et qui ont acté les parts d'influence de certains syndicats, la représentation étant désormais de plus en plus circonscrite par de grandes organisations, avec une amélioration sensible du dialogue social à la clé.
La qualité de la concertation, aux Pays-Bas, est quant à elle assez comparable à celle de l'Allemagne. Les comités d'entreprise y disposent d'un véritable droit de veto – lequel paraît inimaginable chez nous –, le Work Council leur permettant, par exemple, d'empêcher une fusion d'entreprises, le juge devant alors déterminer si ce refus est légitime ou non. Cela n'est possible que parce que les syndicats jouent parfaitement le jeu en termes de maintien du secret des informations qui leur sont communiquées longtemps à l'avance, que leur nombre favorise un dialogue de qualité et, enfin, que l'examen des stratégies et des enjeux est commun.
En ce qui concerne la baisse de la taxe professionnelle, que nous avons grandement appréciée, celle-ci a profité à Air France à hauteur d'un peu plus de 30 millions.
S'agissant de l'augmentation des salaires, je ferai une réponse de Normand : tout dépendra de ce qui se passera en Allemagne. J'ai participé récemment à un échange sous l'égide de la Fondation Friedrich-Ebert avec les syndicats allemands DGB et VerDi, dont il ressortait que ce pays semble sorti d'une phase de « désinflation compétitive », soit d'une politique de rigueur assez prononcée en matière salariale. Qu'il s'agisse d'accords d'entreprises ou de branche, la situation évolue assez rapidement. Si l'Allemagne devait s'en tenir aux politiques de rigueur menées ces dix dernières années, les salaires ne pourraient pas augmenter dans notre pays mais, si ce pays relâche effectivement la pression, nous disposerions de quelques marges d'ajustement.

Si Air France, monsieur Jean-Cyril Spinetta, s'acquitte de la taxe sur les salaires, j'ignorais qu'à l'instar des banques, des hôpitaux et des sociétés d'assurance, elle fut donc dispensée de taxe sur la valeur ajoutée. La suppression de la première, compensée par l'application de la seconde sur les consommateurs de vos services – laquelle serait assez sensiblement augmentée puisque la suppression des charges de cotisations familiales représenterait 40 milliards, soit une augmentation de 5 points de taxe sur la valeur ajoutée qui, de 19,6 % passerait à près de 25 % – serait-elle neutre en termes de compétitivité pour Air France ?
En outre, si j'ai pris note de l'effet bénéfique de la suppression de la taxe professionnelle pour Air France, celui-ci reste ténu compte tenu de votre chiffre d'affaires. En matière de charges sociales, le transfert d'une assiette d'investissement vers, notamment, une assiette sur les salaires a-t-il alourdi vos coûts, et donc entravé votre compétitivité, puisque la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises inclut les salaires, et donc l'emploi ?
J'ai également pris note des coûts comparés par rapport à la Roumanie et au Maghreb. Un récent rapport de la Cour des comptes a toutefois montré qu'en matière de coûts salariaux, la situation est quasiment identique avec l'Allemagne, dès lors que l'on réintègre dans le périmètre de comptage les dépenses liées aux conventions sociales – obligatoire en France, facultatif en Allemagne – qui sont d'ailleurs importantes dans ce dernier pays compte tenu de la qualité de son dialogue social, comme vous l'avez vous-même souligné. Des mesures correctrices de périmètres permettraient-elles d'obtenir des chiffres moins préoccupants, notamment par rapport aux Pays-Bas ?
Enfin, selon M. Jean-Pierre Clamadieu, les entreprises doivent s'efforcer de garder leur personnel en période de crise afin de disposer des compétences nécessaires au moment de la reprise. C'est ce qu'a fait l'Allemagne avec le « travail réduit » dont 260 000 salariés ont bénéficié pour un coût social d'environ 6 milliards, tandis qu'en France le dispositif équivalent n'a concerné qu'un peu moins de 20 000 salariés pour un coût de 600 millions, alors que nous avons consacré un peu plus de 4 milliards à la défiscalisation et à la désocialisation des heures supplémentaires. Cette dernière mesure a-t-elle été d'un grand secours lorsqu'il s'est agi de traverser la crise ? Est-elle, selon vous, prioritaire en cas de reprise ?

Lorsque vous évoquez la baisse de la taxe professionnelle, y incluez-vous la taxation substitutive – contribution foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – que les élus ont instaurée afin de maintenir les recettes des collectivités locales ?

Entre les élus locaux et nationaux, il s'agit bien là d'un « conflit d'intérêts » – la formule est à la mode.
Je suis toujours frappé d'entendre parler de « TVA sociale » puisque l'on ne peut parler de valeur ajoutée dans un transfert fiscal ou de prélèvements obligatoires, fussent-ils à caractère social : nous sommes en présence d'une contribution comme, par exemple, la bien nommée « contribution sociale généralisée ». Il me semblerait donc à la fois plus habile et plus exact d'instaurer une « contribution sociale sur la consommation », sauf si l'on tient à bloquer toute évolution. Je vous invite donc à changer d'expression, pour l'abandonner à ceux qui, pour des raisons politiques, sont opposés à un tel dispositif.
Enfin, le principe de précaution – notamment dans l'industrie chimique – peut-il conduire à certaines hésitations en matière d'investissement ?

J'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie et de réfléchir aux conditions de l'attractivité française sur les investissements étrangers dans le cadre des travaux préparatoires du rapport sur « L'attrait de la France pour les investisseurs étrangers » que j'ai préparé pour M. le Président de la République. Si personne ne m'a parlé du coût du travail – sauf pour m'assurer que notre productivité est très supérieure à celle des États-Unis, par exemple –, il n'en est pas de même de l'effrayante instabilité, complexité et rigidité des règles, procédures, méthodes, habitudes, organisations françaises.
« We do not want to be trapped in France », ai-je entendu : la peur de se trouver prisonnier est bel et bien là car, lorsqu'un dispositif est bon, ce qui est d'ailleurs rare, nous nous empressons de chercher à le supprimer, comme c'est le cas de notre crédit d'impôt recherche, pourtant le meilleur du monde. Que pensez-vous de la mise en place d'un système qui garantirait davantage aux investisseurs étrangers, mais aussi français, une relative stabilité des règles fiscales et sociales applicables au moment où l'investissement est réalisé et, ce, sur une certaine durée ? Nous nous sommes assurés de la constitutionnalité d'une telle possibilité, même si elle ne plaît pas à Bercy ?
Ne pourrait-on pas également mieux informer les investisseurs étrangers sur le gigantisme des procédures auxquelles ils seront soumis s'ils veulent réaliser tel ou tel type d'investissement, y compris en s'engageant sur les délais ? Car ce ne sont pas les primes qui les attirent, même si certains succombent parfois à leurs attraits !
J'ai bien noté l'importance d'une entreprise comme Tata dans le secteur automobile, mais également dans bien d'autres domaines : sixième producteur mondial d'acier, elle compte 100 000 employés en Europe et figure parmi les premières entreprises mondiales dans les domaines de l'horlogerie, de l'hôtellerie et des fibres optiques. Sa structure capitalistique permet son contrôle par un conseil de famille. Avec 24 milliards de dollars, sa capacité d'investissement en Europe est colossale. Comme l'a dit un grand responsable du groupe : « It's like Olympics games : we will turn every four years. »
Dans le domaine de l'automobile, plus précisément, la compétitivité ne dépend pas des seuls coûts de production : nous sommes confrontés à un combat entre le pot de fer et le pot de terre. Je ne sais pas si Mittal était plus compétitif que Arcelor, mais je sais que le premier avait décidé d'acheter le second et que celui-ci ne pouvait refuser, essentiellement pour des raisons de gouvernance. Pourquoi cela ne se reproduirait-il pas dans le secteur automobile avec une entreprise comme Tata, qui vise explicitement l'Europe, ses entreprises et certains segments de ses marchés ? Comment vous y préparez-vous ?
Enfin, depuis vingt ans, l'évolution des aéroports indiens a été colossale. Si les aéroports de Paris se sont modernisés, leur rigidité institutionnelle et leur réactivité plus que discutable demeurent. Comparer Bangalore et Aéroports de Paris, c'est un choc ! La modernité n'est pas où on le pense ! Fedex nous explique ainsi que si sa présence en France est impérative pour des raisons géographiques et stratégiques, elle essaie d'échapper à Aéroports de Paris en organisant des bases ailleurs en Europe. Voilà l'exemple type de ce qui porte atteinte à notre compétitivité puisque notre système supprime un atout considérable d'un point de vue géographique et économique !

M. Pierre Méhaignerie était soucieux de savoir si le salaire net et, en conséquence, le pouvoir d'achat des Français serait altéré par l'instauration d'une « contribution sur la consommation » selon l'expression de notre président, à la suite de la diminution des charges patronales. Comment limiter un tel impact sur la feuille de paie ? Faut-il espérer le retour d'un cycle de désinflation, comme celui qui est survenu opportunément par rapport à l'Allemagne et qui a permis d'opérer un certain nombre de rattrapages d'une façon naturelle ? La question du pouvoir d'achat est particulièrement importante même si, statistiquement, la France fait partie des rares pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans lequel il n'a statistiquement pas baissé.
Si je comprends que l'augmentation des salaires est étroitement liée à la situation en Allemagne, il n'en demeure pas moins que la différence de traitement entre les actionnaires et les salariés est frappante. Alors que les taux de distribution des dividendes retrouvent à peu près leur niveau d'avant la crise, les salariés ne profitent guère de l'issue positive qui se profile. Même si des dirigeants font parfois de grands sacrifices face à des difficultés ponctuelles, comme nous l'avons vu récemment à la télévision, les sommes en jeu suffisent à faire croître l'incompréhension, voire le scandale. La situation étant comparable dans le reste de l'Europe, Mme Angela Merkel a fait savoir au mois de septembre dernier que, la crise s'estompant, il était temps de s'intéresser à l'évolution des salaires. J'ai d'ailleurs été satisfait d'entendre certains membres de notre Gouvernement raisonner de la même manière. Le ministère du travail a évoqué un possible nouage entre dividendes et participation, la règle des trois tiers – égale répartition entre actionnaires, investissements et salariés – n'étant quant à elle pas retenue. Indépendamment de toute considération partisane, il convient en effet de réfléchir à une amélioration de cette allocation dans le sens d'une plus grande justice sociale.
Enfin, il semble que les grands groupes français n'entraînent pas suffisamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire dans leur sillage, à la différence par exemple de l'Allemagne, alors qu'il s'agit d'un élément important de notre compétitivité.

Sur ce dernier point relatif à la sous-traitance, j'approuve les propos de M. Olivier Carré.

M. Jean-Pierre Clamadieu a insisté sur les difficultés d'application du code du travail, en particulier dans le cadre de plans sociaux ou de restructurations internes, en faisant état d'un délai de onze mois entre la prise de décision et son effectivité. Quelles sont les incidences de notre législation du travail sur le recours au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée ?
Gagner en flexibilité nous pousse en effet à recourir au travail temporaire, alors que la nature de nos métiers et la nécessité de former nos collaborateurs nous inclineraient à privilégier les contrats à durée indéterminée. L'ajustement auquel nous avons procédé chez Rhodia en 2009, de surcroît, s'est traduit in fine par des non-remplacements de salariés partis en retraite.
En 2009, le dividende a quant à lui été nul – il est revenu à un niveau normal l'année suivante – car notre priorité a été de traverser la crise, tandis que les salaires, eux, ont bien entendu continué à être versés.
Nous n'en avons pas. En revanche, si l'intéressement a également souffert en 2009, il a de nouveau atteint un niveau satisfaisant et nous avons signé un accord sur les salaires. Enfin, le bonus des dirigeants a été fortement réduit en 2009 – le mien l'a été de 80 % parce que les performances n'étaient pas au rendez-vous, et il a augmenté en 2010. Certains éléments liés à la rémunération sont donc variables et d'autres beaucoup plus stables.
Le dispositif du chômage partiel est quant à lui excellent et traduit une très bonne utilisation des fonds publics. En 2009, nous avons d'ailleurs été parmi ceux qui ont souhaité le déplafonnement du volume d'heures disponibles, même s'il est parfois difficile d'en faire accepter le principe au sein de l'entreprise. En revanche, la problématique des heures supplémentaires ne nous concerne pas puisque nous travaillons en continu et, étant soumis à un plafonnement, nous ne sommes pas non plus concernés par les questions liées à la taxe professionnelle et aux contributions qui lui ont été substituées.
Les réglementations environnementales n'entraînent aucune délocalisation de notre part, les contraintes réglementaires et morales étant les mêmes en Chine, au Brésil, aux États-Unis et en Europe. Les autorités chinoises, en particulier, se montrent de plus en plus rigoureuses en la matière, surtout pour les entreprises étrangères. L'essentiel, pour nous, demeure la sécurité juridique et la capacité des différentes autorités administratives à instruire rapidement des dossiers.
À cet égard, les situations diffèrent d'un pays à l'autre, même si la France se trouve plutôt bien placée. En revanche, j'ai eu l'occasion de dire à la directrice de cabinet de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, que la définition d'une réglementation française sur les nano-particules, au nom du principe de précaution – alors que l'Europe y travaille également de façon sérieuse – n'est pas opportune : avançons d'une manière coordonnée car nos produits voyagent et traversent les frontières.
Enfin, comme M. Paul Giacobbi, j'ai pu entendre des collègues – anglo-saxons pour la plupart – se plaindre de l'instabilité de la législation française. Il en est ainsi, par exemple, du déplafonnement soudain de la contribution au service public de l'électricité pour des raisons circonstancielles, lequel pèse considérablement sur les industries consommant beaucoup d'énergie et dont les investissements sont lourds. Il en va de même des systèmes de rémunération de type actions gratuites ou stock-options qui concernent nombre de nos cadres, en France comme à l'étranger : pas une année ne passe sans que la réglementation évolue et que nous soyons obligés de consacrer du temps à trouver les moyens de les pérenniser. Peut-on imaginer un système dans lequel les dispositions existantes lors des investissements seraient maintenues ? Hélas, je n'y crois guère.
Le contrat social de crise nous a permis de maintenir nos personnels en sécurisant l'intégralité du salaire de base, quel que soit le nombre de jours chômés, et en appliquant aux « cols blancs » un système de cotisation, ce qui a contribué à maintenir un climat serein au sein de l'entreprise.
Nous ne pouvons agir sur ce plan-là même si certains ont utilisé les mêmes dispositifs.
En revanche, s'agissant des investissements et des aides de l'État dans la durée, les pratiques françaises sont loin d'être les meilleures. Alors que nous aurions dû fermer une usine en Espagne, plus de 200 millions ont été débloqués en un an, les syndicats, en accord avec la province et l'État central, ayant négocié un accord salarial sur trois ans portant sur l'ensemble de nos usines espagnoles. Finalement, nous sommes parvenus à une issue économiquement positive, une telle cohérence nous permettant d'y voir clair pendant six ou sept ans. On ne peut en dire autant dans notre pays où, seul constructeur à fabriquer des fourgons en France – en l'occurrence des Kangoo, à Maubeuge –, nous avons bénéficié d'une aide de 7 ou 8 millions d'euros, mais, comme nous n'avons pas produit les volumes prévus en raison de la crise, le remboursement de cet argent nous a été réclamé.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un réel fardeau.
Par ailleurs, notre coût de production en Roumanie étant moindre qu'en Chine, notre business modèle avec Dacia nous semble solide face à Tata et aux menaces chinoises. M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondial du commerce, a déclaré voilà cinq ou six mois qu'un iPod intégralement fabriqué en Asie crée plus de valeur aux Etats-Unis qu'en Asie, le bilan net étant très positif. Il en est de même pour notre pays, à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, s'agissant de la fabrication de la Logan et de la Sandero en Roumanie par des « cols bleus », les « cols blancs » étant quant à eux en France. Et nous importons 100 000 de ces véhicules chaque année.
Je parle de la valeur ajoutée réalisée en France, en incluant dans le calcul le coût des pièces de nos fournisseurs ainsi que les dépenses d'ingénierie et de marketing. En tenant compte des importations et des exportations, le solde de notre balance est positif. Cette stratégie fonctionne ailleurs, comme en attestent les relations économiques et commerciales que le Japon entretient avec les autres pays asiatiques et comme l'Europe peut elle-même le faire, par exemple avec le Maroc s'agissant de Renault : ici, haute valeur ajoutée, là, moindre valeur ajoutée.
Depuis 1999, Renault a versé 3,9 milliards d'euros de dividendes, dont 3,4 issus de Nissan, Volvo et Daimler. La valeur ajoutée par Renault distribuée aux actionnaires s'élève donc pour cette période à moins d'un demi-milliard d'euros, ce qui est modeste, et nous avons investi la majeure partie des sommes en cause.
Enfin, je souffre toujours d'entendre que nous n'aiderions pas nos petites et moyennes entreprises. Nous achetons 50 % de notre valeur ajoutée mondiale en France à des entreprises françaises qui, il est vrai, hors quelques grosses structures comme Valeo ou Faurecia, souffrent de faiblesses structurelles, dont une sous-capitalisation. Le Mittlesstand allemand est sans équivalent chez nous, et je ne crois pas que la situation puisse changer. Si nous nous adressons toujours à nos fournisseurs français en premier lieu, comme ce fut encore le cas avec le véhicule électrique, il n'en reste pas moins que le moteur de la petite Twizy, par exemple, sera fabriqué par un industriel étranger faute d'une offre nationale satisfaisante. Inversement, nous produisons notre petit moteur diesel en Espagne, mais c'est le fournisseur français des pièces qui crée le plus de valeur ajoutée.
L'écart de marge brute des industries allemandes et françaises entre 2000 et 2007 est éloquent, puisque nous nous situions à 5 points au-dessus de l'industrie manufacturière allemande et que nous sommes passés à 5 points au-dessous. La situation est identique en matière de charges sociales, ce qui n'est pas un hasard puisque c'est d'abord à ce problème que nous devons nous attaquer.
La non-application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les voyageurs, monsieur Jérôme Cahuzac, constitue une règle mondiale du transport aérien afin d'égaliser les conditions de la concurrence. L'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 25 % serait désastreuse.
Le chiffre que j'ai cité concernant la baisse de la taxe professionnelle correspond à un résultat net entre les gains et les coûts.
En ce qui concerne le temps partiel, les Allemands ont remarquablement procédé, tant économiquement que socialement. Aucune entreprise de transport aérien n'a toutefois usé du chômage partiel car, en cas de grave problème économique, faute de pouvoir stocker notre production, nous nous efforçons de maintenir nos programmes. Nous enregistrons alors une légère baisse du nombre de passagers et une diminution importante de nos recettes compte tenu de l'excès de l'offre par rapport aux besoins des consommateurs.
Air France n'a pas non plus utilisé le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires pour de nombreuses raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder, et nous sommes peu concernés par une éventuelle limitation des investissements en raison du principe de précaution.
La stabilité des règles fiscales et sociales, monsieur Paul Giacobbi, marquerait un progrès considérable, je vous l'accorde. S'agissant de la comparaison avec celui de Bangalore ou d'autres grands aéroports internationaux, Paris-Roissy souffre d'une erreur de conception : au début des années soixante-dix, les constructeurs ont préféré faire accomplir de courtes distances aux voyageurs entre les avions et l'aérogare plutôt que de multiplier les points de contact. Un tel système, quelque peu baroque, n'existe d'ailleurs qu'à Washington et Paris. Ce problème sera toutefois complètement corrigé en 2012 grâce au travail de la direction d'Aéroports de Paris menée par M. Pierre Graff.
Outre qu'Air France, monsieur Olivier Carré, a versé peu de dividendes – aucun depuis trois ans –, ceux-ci ont toujours été à peu près équivalents aux sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés.
J'ajoute qu'Air France, comme KLM, Lufthansa et British Airways, est une compagnie nationale, dont 95 % des salariés sont des nationaux. Nous sommes le premier employeur privé de la région d'Île-de-France et les délocalisations sont infimes. Nous faisons moins appel à la sous-traitance que nous ne sous-traitons nous-mêmes pour le compte d'une centaine de compagnies aériennes, en particulier s'agissant de l'entretien des avions. Environ 10 000 personnes travaillent dans des métiers exclusivement industriels à très haute valeur ajoutée, et de 3 000 à 4 000 d'entre elles vivent de la sous-traitance.
Enfin, en tant que membre du conseil d'administration d'Alcatel-Lucent – société qui, après des moments difficiles, s'est aujourd'hui redressée à tel point que nous pouvons être raisonnablement optimistes quant à son avenir –, je rappelle que cette entreprise a été sauvée par les groupes Verizon et AT&T qui, pour moderniser leurs systèmes de communication, l'ont choisie alors que les offres du chinois Huawei, par exemple, étaient bien moins chères. Sans aucune consigne industrielle de la part de l'État fédéral américain, ces deux entreprises ont décidé que, pour des raisons stratégiques de long terme, il était préférable de payer plus cher et d'être fidèle à un fournisseur de service ayant un ancrage national, plutôt que d'améliorer ses résultats à court terme et d'aller au-devant de difficultés stratégiques. Certaines compagnies françaises pourraient sans doute s'inspirer d'un tel exemple, y compris Air France.

Je vous remercie, monsieur Jean-Cyril Spinetta, de ce message final.
Je vous sais gré, messieurs Clamadieu, Pélata et Spinetta, de la qualité, de la clarté et de la densité de vos exposés, ainsi que de vos réponses. Vous avez vous-mêmes éloquemment illustré le bien-fondé de l'intitulé de notre mission, liant compétitivité économique et financement de la protection sociale. Nul doute que votre aide aura été importante, tant pour la rédaction de notre rapport, qu'en ce qui concerne les différents constats que vous avez dressés. J'espère que ceux-ci seront partagés et je ne doute pas qu'ils seront au coeur des débats politiques qui s'ouvriront prochainement.
La séance est levée à dix-huit heures dix.