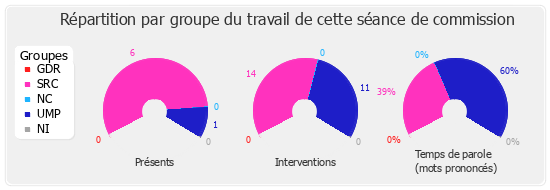Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
Séance du 28 avril 2009 à 16h00
La séance
La mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a auditionné Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT).

Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Marylin Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Cette audition va nous permettre d'aborder une question peu souvent traitée et qui est pourtant importante dans le cadre de nos travaux : celle des violences faites aux femmes sur les lieux de travail.
L'AVFT est une association qui, depuis 1985, a pour but de « défendre les droits au travail et à l'intégrité de la personne ». Elle a pour champ d'action et de réflexion toutes les formes de violences contre les femmes, bien qu'elle soit spécialisée dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles au travail et oeuvre pour l'élimination de ces violences, qu'elles soient publiques ou privées. Une enquête INSEE de 2008 a montré que 5 % des viols et le quart des agressions sexuelles les plus fréquentes (caresses, baisers, gestes déplacés) se produisaient sur le lieu de travail.
Je propose de laisser la parole à Mme Baldeck pour qu'elle nous présente plus précisément l'action de son association et son expérience sur cette question.
Merci de votre invitation. Je suis salariée et militante à l'AVFT depuis six ans. J'occupe un poste polyvalent, mais qui demande surtout des compétences de juriste. Je suis déléguée générale de cette association depuis octobre 2007.
L'AVFT a été créée il y a vingt-cinq ans, sous l'impulsion de Marie-Victoire Louis, chercheuse au CNRS, spécialiste de l'histoire du droit de cuissage en France et des violences masculines à l'encontre des femmes. Elle étudie plus particulièrement les politiques publiques liées aux violences commises à l'encontre des femmes, notamment les politiques publiques en matière de lutte contre le système proxénète. L'AVFT est à l'origine des lois qui répriment le harcèlement sexuel, et intervient de manière concrète dans toute la France, auprès de victimes de violences sexuelles – plusieurs milliers depuis sa création.
L'AVFT a trois types de missions : la première, consiste à intervenir auprès des victimes afin qu'elles soient rétablies dans leurs droits, à toutes les étapes de la procédure, jusqu'à la constitution de partie civile devant les juridictions pénales et l'intervention volontaire devant les conseils des prud'hommes. Aujourd'hui, 377 personnes, dont deux ou trois hommes, bénéficient de cette intervention ; mais il ne s'agit là que d'une infime partie des victimes, et des femmes victimes de violences en France.
Les chiffres de l'enquête INSEE ne nous étonnent absolument pas. Ils sont néanmoins intéressants : c'est la première fois que cet organisme, dans son enquête régulière sur les violences commises à l'encontre des femmes, s'intéresse plus particulièrement au champ du travail, ce qui est en soi signifiant. Pour autant, les enquêtes sur les violences au travail commencent à se multiplier. J'appelle plus spécialement votre attention sur une enquête menée en Seine-Saint-Denis, sous l'impulsion de la déléguée départementale au droit des femmes, la direction départementale du travail et de la formation professionnelle, sur les violences sexuelles commises à l'encontre des femmes. Ses résultats, qui sont également très intéressants, viennent d'être publiés.
Parmi les 377 personnes qui bénéficient actuellement de l'intervention de l'AVFT, 45 % ont été victimes d'agression sexuelle, 25 % de harcèlement sexuel, 20 % de viol, 5 % de coups et blessures volontaires et 5 % de discrimination à la maternité. Alors que l'on associe souvent l'AVFT à une structure intervenant auprès des victimes de harcèlement sexuel, les violences qui sont à l'origine de sa saisine sont souvent plus graves, au sens du code pénal, que le harcèlement sexuel. Bien sûr, je ne parle que des personnes qui sont venues nous consulter, donc des statistiques de l'AVFT.
De cette pratique auprès des institutions policières, judiciaires, de l'inspection du travail et de nos relations avec le corps médical, etc. nous tirons la légitimité de nos deux autres missions qui sont la sensibilisation et l'information de tous les publics, surtout les professionnels concernés, et, parfois, les élus et la veille législative, à savoir l'analyse du droit applicable, la critique des politiques publiques et plus globalement l'étude de toutes les formes de violences commises à l'encontre des femmes. Ces réflexions se sont souvent traduites par des demandes de modifications législatives, j'y reviendrai. D'ailleurs, Catherine Le Magueresse, ancienne présidente de l'AVFT, travaille actuellement sur le traitement, par les différentes institutions, des violences dénoncées par les femmes auprès de l'AVFT. Elle se fonde sur environ 1 000 dossiers traités et archivés par l'association entre 1994 et 2007.
Cette troisième mission d'analyse et de recherche a été marquée par plusieurs travaux importants. Le premier, de longue date, est relatif à la définition légale du harcèlement sexuel, depuis les lois votées il y a dix-sept ans. La première critique de ce texte date de mai 1992 et s'intitule : « Harcèlement sexuel, une réforme restrictive qui n'est pas sans danger ». Y étaient dénoncées déjà : « des limitations rendant ce texte quasiment inopérant ». Notre dernier travail date de 2005 et a pris la forme d'une proposition de loi visant à transposer une directive européenne sur le harcèlement sexuel et à modifier la définition du harcèlement sexuel. Il a été présenté lors d'un colloque organisé au Palais du Luxembourg en janvier 2005.
Nos travaux sur le harcèlement sexuel nous conduisent, en dépit des réformes intervenues en 1998 et en 2002 et plus récemment avec la loi du 27 mai 2008, à radicaliser notre critique du dispositif législatif. Il nous est possible en effet d'affirmer aujourd'hui que le harcèlement sexuel est de facto dépénalisé.
Il ressort de nos dossiers que les plaintes qui relèvent stricto sensu du harcèlement sexuel (les commentaires sur le physique, les injonctions sexuelles, les invitations répétées en dépit des refus de la salariée, l'affichage pornographique, les attouchements corporels non sexuels) sont systématiquement classées sans suite et font l'objet d'ordonnances de non-lieu. Les seules condamnations prononcées sous le chef de harcèlement sexuel concernent en réalité des agressions sexuelles. Le délit voté en 1992 ne sert aujourd'hui, de notre point de vue, qu'à déqualifier les agressions sexuelles, de la même manière, d'ailleurs, que l'on correctionnalise les viols. Les faits de harcèlement sexuel stricto sensu, eux, ne sont pas poursuivis et condamnés.
Pourquoi en est-on arrivé là ? On entend souvent que le problème n'est pas dû à la loi, mais à la façon dont elle est appliquée. Or, s'agissant du harcèlement sexuel, le problème vient bien de la loi elle-même car, notamment, l'article 222-33 du code pénal ne le définit pas. Selon la loi, le harcèlement sexuel est « le fait de harceler autrui, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. » Comme si l'on définissait le vol par « le fait de voler » ! Par ailleurs, pour que l'infraction soit constituée, il faut que la victime apporte la preuve de l'intentionnalité de l'auteur d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Or ceci est quasiment impossible. Nous-mêmes, lorsque nous examinons de tels dossiers, sommes bien en peine d'affirmer que les auteurs avaient l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, puisque, bien souvent, le harcèlement sexuel n'a pas cet objectif ; il a pour objectif d'humilier une personne, de la faire partir, d'exercer un pouvoir, certes de nature sexuelle. Il est donc très difficile, pour les magistrats, de retenir des éléments matériels et un élément intentionnel. Voilà pourquoi, entre autres, nous échouons, à réprimer les agissements de harcèlement sexuel. Je précise que ce texte a été voté en violation totale du principe de légalité des délits et des peines ; En effet les infractions pénales doivent être très précisément rédigées afin d'être d'application stricte. Cette définition pose donc un problème fondamental de droit.
Nous demandons que le harcèlement sexuel soit précisément défini et que l'on supprime cette intentionnalité. On nous oppose qu'en droit pénal, il faut à la fois un élément matériel et un élément moral et qu'on ne peut donc supprimer l'intentionnalité. Or, l'élément intentionnel est facultatif en matière de harcèlement moral. En effet, l'article 222-33-2 du code pénal dispose que le harcèlement moral est « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, etc. ».
La loi du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a transposé une directive européenne de septembre 2002 qui imposait aux États membres d'adopter une nouvelle définition du harcèlement sexuel. La définition européenne comporte des pistes intéressantes. Elle avait d'ailleurs servi de base à la proposition de loi de l'AVFT de 2005.
Cependant, la loi du 27 mai 2008 ne comporte même pas le terme de « harcèlement sexuel » !
Cela a par exemple pour conséquence qu'un avocat qui aurait à défendre une cliente victime de harcèlement sexuel, qui ne connaîtrait pas ou peu ce contentieux qui est assez rare, et qui ferait une recherche dans une base de données juridique pour connaître les textes applicables et la jurisprudence ne la trouverait pas à partir du mot-clé « harcèlement sexuel ». Cette loi échappe ainsi totalement à l'activité juridictionnelle actuelle. Les avocats avec lesquels nous travaillons ne la connaissent d'ailleurs pas non plus ; nous passons beaucoup de temps à les informer de l'existence de ce texte.
Ceci étant dit, cette loi ne change rien en matière pénale puisqu'elle n'a pas été codifiée dans le code pénal. Dans celui-ci, la définition pénale du harcèlement sexuel n'a pas été modifiée. Ainsi, les critiques portées par l'AVFT à son propos restent d'actualité.
La loi du 27 mai 2008 n'a pas non plus été codifiée dans le code du travail. Certes, il est possible d'invoquer directement la loi et la directive devant les juridictions sociales. Mais, quelques mois après le vote de la loi, il n'existe encore aucune jurisprudence nous permettant de savoir si elles la prendront en compte, sachant que les conseillers prud'homaux sont assez réticents pour appliquer des textes qui ne sont pas dans leur code. Ce constat pose de manière cruciale la question de l'effectivité des directives.
La conceptualisation juridique du harcèlement sexuel traduit bien évidemment les valeurs qu'un État souhaite promouvoir et garantir en matière de relations entre les hommes et les femmes. Tel qu'il est inscrit dans la loi, ce délit ne constitue qu'un pseudo droit, puisqu'il n'est pas effectif, n'égratignant qu'à peine les privilèges sexuels masculins dans le monde du travail.

La question que vous avez évoquée est très délicate et je serai très prudent dans mon propos. Selon vous, lorsque l'on parle du harcèlement moral, on le définit à la fois comme pouvant être ou non intentionnel et lorsque l'on parle, sans le définir, du harcèlement sexuel, on ne l'évoque que s'il est intentionnel. La difficulté ne vient-elle pas du fait qu'on peut se livrer à un comportement qui n'est pas « volontairement » du harcèlement moral mais dont les conséquences font qu'il s'agit d'un harcèlement moral, alors qu'il n'est pas évident qu'on puisse obtenir les faveurs sexuelles de quelqu'un sans les avoir recherchées ? Cela dit, je ne faisais pas partie des législateurs de 1992 et peut-être que l'examen des débats de l'époque nous permettrait d'apporter une réponse plus affirmée.
Votre association a-t-elle construit, de son côté, une définition qui permettrait de surmonter la difficulté d'application juridique de la loi telle que vous nous l'avez présentée ?
Enfin, votre association s'appelle « Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ». Or, à vous écouter, elle agit surtout en France. Je suppose que vous aviez l'intention, très légitime, de situer la réflexion à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union. Quelles références avez-vous qui pourraient nous permettre de progresser en droit français ?
Prenons l'exemple d'une femme au travail qui, tous les jours, entend des commentaires sur son physique, reçoit des propositions à dîner, des injonctions sur sa manière de s'habiller ou des mails pornographiques. L'intention de l'auteur de ces agissements lui importera peu, seules compteront pour elles leurs conséquences (sur sa santé physique et psychique, sur ses droits…). En outre, en retenant, comme élément constitutif de l'infraction de harcèlement sexuel, « l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », le législateur s'est très précisément inscrit dans les stratégies de défense des harceleurs qui affirment qu'ils n'ont pas « agi » dans cette intention, mais qu'il s'agissait de « tentatives de séduction », que c'était « pour rire », ou même «pour créer de la cohésion d'équipe ». C'est la raison pour laquelle nous avons souvent l'habitude de dire que la définition légale du harcèlement sexuel est un mode d'emploi pour pouvoir harceler en toute impunité. C'est la raison pour laquelle la preuve de l'intentionnalité « d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » doit être facultative pour obtenir une condamnation pour harcèlement sexuel.

Pourriez-vous nous préciser les différences qui peuvent exister entre harcèlement sexuel et harcèlement sexiste.
Il existe une différence entre le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste. La directive européenne de 2002 opère d'ailleurs cette différence en indiquant que le premier est lié à des comportements non désirés « à connotation sexuelle », s'exprimant verbalement, non verbalement ou physiquement et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant. Le second est lié à des comportements non désirés « liés au sexe d'une personne » – dans la mesure où la victime est, par exemple, une femme – le reste de la définition étant équivalent à celle du harcèlement sexuel.
Tous les États n'ont pas encore transposé la directive européenne et il est difficile de comparer des traditions judiciaires très différentes entre les pays, notamment entre les pays du Nord et ceux du Sud. Dans les pays scandinaves, le harcèlement sexuel n'est qu'une faute au regard du code du travail ; il n'y a pas d'incrimination pénale ; moyennant quoi, les obligations qui pèsent sur l'employeur sont beaucoup plus lourdes qu'en France.
Pour autant, nous revendiquons la dimension européenne de notre association puisque nous nous intéressons au droit européen et que nous travaillons régulièrement avec les autres pays. En 2008, nous avons participé à un colloque à Athènes organisé par la Ligue Grecque des Droits des Femmes au moment où le gouvernement grec menait les travaux de transposition de cette directive européenne sur le harcèlement sexuel.
Je vous invite effectivement à lire les débats parlementaires qui ont abouti au texte de 1992. Ils véhiculent en effet un certain nombre de stéréotypes, au point qu'on les croirait dater du XIXe siècle, s'agissant notamment des réactions des hommes qui éclairent le caractère extrêmement restrictif, voire inapplicable, de la loi.
Je voudrais mettre l'accent sur les travaux qui nous ont conduit à étudier les dispositifs légaux qui freinent, voire empêchent la dénonciation des violences dont les femmes sont victimes. Il en est un dont nous demandons la modification depuis cinq ans : le délit de dénonciation calomnieuse défini à l'article 226-10 du code pénal. À ce propos, je tiens d'emblée à lever toute ambiguïté. Il n'est absolument pas question, pour nous, de demander la suppression de la possibilité, pour une personne qui aurait bénéficié d'une relaxe, d'un acquittement ou d'un non-lieu, de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Il s'agit de demander la suppression de l'alinéa 2 de cet article.
Cet alinéa 2 dispose que « La fausseté du fait résulte nécessairement d'une décision devenue définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie, etc. ». Une décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu serait donc si infaillible que la justice se donne le droit de s'en servir d'unique fondement pour condamner pour dénonciation calomnieuse ! L'adverbe « nécessairement » entraîne une condamnation quasi automatique d'une personne en dépit de son droit à la présomption d'innocence. Il est exact que certains magistrats recherchent la bonne foi de la plaignante pour la relaxer. Reste que la rédaction de cet alinéa ne les y invite pas et ne les y contraint pas. D'autres magistrats se contentent d'un jugement de relaxe, d'acquittement ou d'une ordonnance de non-lieu pour condamner la dénonciatrice pour dénonciation calomnieuse sans même rechercher, ni caractériser son éventuelle mauvaise foi. De tels jugements existent, nous les avons régulièrement transmis aux Gardes des sceaux depuis cinq ans.
Nous demandons la suppression de l'alinéa 2, afin de donner au juge la possibilité d'apprécier le dossier dont il est saisi dans son entier avec toute la latitude de juger. S'il n'est saisi que sur le fondement de l'alinéa 2, il est quasiment obligé de condamner.
Lorsque Mme Gisèle Gautier, présidente de la Délégation aux droits des femmes du Sénat, avait déposé en 2006, à la faveur du projet de loi dit Courteau, un amendement visant à supprimer cet alinéa 2, le ministre de la justice, s'y était opposé au motif que le juge ne peut condamner que si la victime sait que les faits allégués sont faux, ce qui caractériserait sa mauvaise foi. Mais les juges condamnent au motif que, s'agissant de violences commises sur elles-mêmes, les plaignantes ne peuvent en ignorer la fausseté. La mauvaise foi serait ainsi consubstantielle à la dénonciation.
Les résistances que nous rencontrons depuis de nombreuses années à la modification de ce délit ne sont pas juridiques mais idéologiques. L'alinéa 2 supprimé, le juge pourrait se fonder sur l'alinéa 3 : « En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ». En outre, si le juge saisi d'une plainte pour dénonciation calomnieuse était réellement obligé de caractériser la mauvaise foi de la dénonciatrice pour le condamner, l'alinéa 2 avec le « nécessairement » n'aurait plus de raison d'être et sa suppression serait sans incidence.
Tant que cet alinéa restera tel quel dans le code pénal, toute politique de lutte contre les violences faites aux femmes sera décrédibilisée et invalidée. Lorsque nous avons commenté sur notre site internet l'existence de ce délit et la manière dont le texte était rédigé, notre permanence téléphonique a été submergée d'appels de femmes victimes de violences qui nous ont dit que, dans ces conditions, elles préféraient se taire. Le risque est trop grand et elles ne voulaient pas, en plus d'avoir été violées, être condamnées pour dénonciation calomnieuse.
Sur ces deux points : le harcèlement sexuel et la dénonciation calomnieuse, l'État porte une immense responsabilité à l'égard des victimes. Il écoute depuis des années les analyses que je viens de vous présenter, sans jamais les contredire sérieusement ni les prendre en compte.
À l'avenant, les politiques publiques de lutte contre les violences sexuelles, en particulier au travail, sont très faibles voire inexistantes. Parmi les engagements pris par Valérie Létard dans le plan global triennal de lutte contre les violences faites aux femmes, il est question d'une enquête à l'échelle nationale sur les violences sexuelles ou sexistes au travail. Or, un an et demi après le début du plan, cet engagement est resté lettre morte. Dans la dernière campagne gouvernementale contre les violences faites aux femmes, le slogan des affiches ne vise pas les violences sexuelles, mais uniquement les violences physiques ou psychiques. L'AVFT est la seule association compétente en matière de lutte contre les violences sexuelles ou sexistes au travail. Les financements qu'elle reçoit ne lui permettent de fonctionner qu'avec un effectif très réduit : nous sommes quatre ou cinq et nous ne pouvons faire face à la spectaculaire augmentation des saisines de l'association : 44 % de nouveaux dossiers ouverts entre 2007 et 2008.
En matière de politique pénale, les violences sexuelles dans nos dossiers sont rarement poursuivies par le Parquet. Quand elles le sont, elles sont déqualifiées. Les victimes doivent donc déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. À ce titre, le projet gouvernemental de supprimer les juges d'instruction ne peut que nous inquiéter.

Tout ce que vous nous dites est très intéressant. Je suis moi-même très sensible aux plaintes qui peuvent être déposées pour dénonciation calomnieuse, auxquelles on associe parfois les associations qui soutiennent les femmes victimes de violences. Je suis d'ailleurs vice-président d'une association de ce type. Malgré tout, votre argumentaire sur l'alinéa 2 me semble un peu fragile juridiquement.
L'alinéa 2 dispose simplement qu'une personne mise en cause et qui bénéficie d'un non-lieu, ou est acquittée, ne peut pas ne pas être considérée comme innocente du fait pour lequel elle a été mise en cause. Dans un pays de droit, une personne qui a été déclarée innocente, parce que la présomption d'innocence l'a emporté, ne peut plus à aucun moment être considérée comme ayant commis un acte tel qu'il aurait pu conduire à sa condamnation. C'est cette présomption d'innocence qui est défendue par l'alinéa 2, et qui vient buter sur une autre présomption d'innocence : celle de la personne qui, ensuite, va précisément être attaquée, au motif qu'il s'agit d'une dénonciation calomnieuse.
C'est donc présomption d'innocence contre présomption d'innocence. Je ne suis pas sûr que la suppression pure et simple de l'alinéa 2, telle que vous la proposez, règle le problème. Je suis même perplexe devant l'insécurité juridique qui pourrait en résulter.
Une femme a déposé une plainte, par exemple pour agression sexuelle. Le Parquet estime avoir suffisamment d'éléments pour renvoyer l'affaire devant le tribunal. Cette femme a été réellement agressée. Mais le tribunal prend une décision de relaxe pour charge insuffisante et au nom de la présomption d'innocence de la personne mise en cause. Cette dernière, non contente d'avoir été relaxée de cette plainte, dépose elle-même une plainte pour dénonciation calomnieuse. Ce jugement de relaxe, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, sert d'élément matériel duquel découle un élément intentionnel. C'est une grave violation de la présomption d'innocence de la femme alors mise en cause. Il est fondamentalement injuste qu'elle n'en bénéficie pas, au même titre que la personne qu'elle avait mise en cause, et qui en avait bénéficié lors du premier procès.
Si l'on supprimait l'alinéa 2, le juge, sur le fondement de l'alinéa 3, pourrait tout de même condamner cette femme s'il y estime qu'elle avait menti, ne trouvant pas dans le dossier des éléments visant à rapporter sa bonne foi. Sur le fondement de l'alinéa 2, si l'on s'en tient strictement au texte, le juge n'est pas autorisé – même si certains le font – à rechercher la bonne foi de la dénonciatrice.

Le juge n'est jamais lié par la loi au point de ne pas pouvoir apprécier le fond du dossier.
Certains le font, mais certains ne se privent pas d'appliquer strictement le droit. Ainsi, au nom de la sécurité juridique, on sacrifie tous les ans un certain nombre de femmes qui ont été réellement victimes de violences.
Je signale que l'AVFT et une femme ont introduit un recours devant la Cour européenne des Droits de l'homme pour violation de la présomption d'innocence et que nous attendons une date d'audience devant la Cour de Strasbourg.

La question que vous posez est réelle, mais je ne suis pas sûr que la suppression de l'article 2 soit la solution.
Nous sommes preneuses de solutions meilleures que la nôtre. Seulement, jusqu'à présent, personne ne s'est intéressé à cette question et aucun parlementaire n'en a eu le courage politique.

La question a-t-elle vraiment été posée ? J'ai pourtant participé aux débats de 1992, je fais partie de votre association et mon attention n'a jamais été appelée là-dessus. Peut-être ne nous sommes-nous pas rendu compte de son importance. Nous allons nous en occuper.

Voici un extrait d'un jugement de Cour de cassation, qui me semble répondre en partie à votre très légitime interrogation à propos de l'alinéa 2 :
« Si, en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de mauvaise foi chez le dénonciateur. »
Le juge ne peut donc pas s'appuyer sur des faits dont la réalité n'est pas établie. Même si des faits sont bien imputables à la personne dénoncée mais qu'elle n'a pas été condamnée, la présomption d'innocence interdit qu'on refasse son procès de manière indirecte puisqu'elle a été l'objet d'un jugement de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement. En revanche, le juge, lorsqu'il se prononcera sur la nature du caractère calomnieux de la dénonciation, devra motiver sa décision.
Cette solution me semble équilibrée, même si je vous concède que l'on a peut-être à travailler sur une évolution législative qui permettrait de conforter cet équilibre.
Nous connaissons évidemment très bien cet arrêt. Il est satisfaisant dans le cas d'un harcèlement sexuel qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. Le juge peut motiver sa décision de relaxer l'intéressée sur le chef de la dénonciation calomnieuse en disant qu'elle a porté plainte pour harcèlement sexuel, mais qu'elle a pu se tromper sur la nature des faits, confondant des tentatives de séduction maladroites avec du harcèlement sexuel, et qu'elle était donc de bonne foi lorsqu'elle a déposé plainte. Mais pour un viol, ce n'est plus possible : une femme qui a déposé plainte pour viol n'a pas pu s'être trompée.

Votre démonstration concernant le viol est imparable. Merci d'avoir soulevé ce point, que nous allons examiner.
Par ailleurs, j'aimerais que vous nous présentiez votre position vis-à-vis de la proposition de loi-cadre.
Vous connaissez la position de l'AVFT par rapport aux propositions d'une loi-cadre portée par le CNDF. Marie-Victoire Louis, ex présidente de l'AVFT, Catherine Le Magueresse, également ex présidente de l'AVFT, et moi-même avons rédigé en juillet 2007 une critique de ce texte, dont les propositions nous semblent extrêmement dangereuses pour les droits des femmes. Si par extraordinaire cette loi-cadre était votée par le Parlement, elle aurait pour conséquence un bouleversement de notre paysage judiciaire, pour le pire, en raison notamment de la création de « tribunaux spécialisés dans la violence à l'encontre des femmes ».
En effet, soit nous continuons à nous battre pour que la justice sanctionne à la hauteur de leur gravité les violences massives et quotidiennes dont les femmes sont victimes, soit nous faisons un gigantesque pas en arrière en excluant du droit commun les femmes victimes de violences et, ce faisant, en les stigmatisant davantage encore.
Cette proposition de création de tribunaux spécialisés, même si elle est le coeur de cette loi-cadre, n'est pas la seule que nous jugeons inacceptable : je citerai la proposition d'élargir la présomption de consentement aux actes sexuels, déjà prévue dans le cadre du couple marié, à toutes les formes de relation. Comme vous le savez, la loi du 4 avril 2006 a introduit une présomption de consentement à l'acte sexuel des époux par l'ajout d'un alinéa, qui dispose que : « la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ». De ce fait, le code pénal inscrit noir sur blanc une présomption de consentement à l'acte sexuel, quel que soit d'ailleurs cet acte – il n'est pas défini – à condition que les personnes soient mariées. Cela pose un problème philosophique de taille. Les associations féministes se battent depuis des années pour que, au contraire, on ne présuppose pas la disponibilité sexuelle des individus, qu'ils soient des hommes ou des femmes et que l'indisponibilité sexuelle soit posée jusqu'à preuve du contraire. Cette présomption est de notre point de vue inacceptable, même dans le cadre d'un couple marié. Or le CNDF propose d'élargir, nonobstant des décennies de lutte des femmes pour la réappropriation de leur corps, cette présomption de consentement à toute femme de couple marié ou non.
Nous critiquons également la proposition d'ordonnance de protection. Sans entrer dans le détail, cette protection, telle qu'elle est conceptualisée par cette loi-cadre, n'est qu'une possibilité pour le juge, et pas une obligation. Or il s'agit de vie ou de mort de femmes.
En matière de viol, le CNDF nous propose une réécriture du texte qui ne remet aucunement en cause les carences actuelles de la loi. Je vous incite à prendre connaissance des travaux initiés par l'AVFT en matière de contrainte et de consentement présentés par Catherine Le Magueresse le 22 novembre 2007 à La Sorbonne lors d'un colloque organisé par la Préfecture de police de Paris.
Enfin, en matière de prostitution, la loi-cadre portée par le CNDF s'abstient de proposer la pénalisation du client, seule mesure à même de signifier le choix d'une société d'interdire la marchandisation des corps.
Pour toutes ces raisons, et il y en a encore de nombreuses autres, les propositions contenues dans ce texte ne sont pas acceptables.

Merci. Nous fournirons aux membres de la mission une photocopie de l'analyse effectivement très fouillée que fait l'Association de la loi-cadre proposée par le CNDF.

J'ai été le rapporteur de la loi de 2006. Votre analyse est totalement à l'inverse de la volonté du législateur.

Je me suis battu, et j'ai été bien seul pendant longtemps, y compris jusqu'en commission mixte paritaire, pour faire admettre le fait que l'on introduise dans la loi l'existence du viol entre époux. Jusqu'alors il était écrit qu'« il ne saurait y avoir de viol entre époux ». Depuis la loi de 2006, il y a présomption de consentement au sein d'un couple marié, sauf preuve du contraire – donc sauf preuve qu'il n'y a pas eu consentement et que le viol a effectivement été perpétré bien que l'on soit au sein d'un couple marié. Je ne me fais pas le défenseur de la proposition de loi à laquelle vous avez fait référence. Il me semble malgré tout qu'en l'occurrence, elle tend à rendre possible la reconnaissance du viol, même dans le cas de personnes non mariées.
Quoi qu'il en soit, sur ce point la loi de 2006 ne constitue pas un recul. C'est une vraie et belle avancée. Et il a fallu se battre pour l'obtenir.
Je pense qu'il était effectivement important d'inscrire dans le code pénal l'existence possible du viol entre époux. Il n'était cependant pas utile de préciser qu'une présomption de consentement existait dans le cadre du couple marié, jusqu'à preuve du contraire.
Cet alinéa : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage » était suffisant ! Pourquoi apporter cette précision : « Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ». ? À quoi sert cette phrase si ce n'est à bien affirmer la disponibilité sexuelle des époux ?

Votre analyse de la loi-cadre est très intéressante et très fouillée, même si je ne la partage pas entièrement. En revanche, je partage entièrement votre analyse sur les tribunaux. Vous avez fait un travail remarquable.
Je vous remets, pour illustrer mon exposé, une série de documents, dont un jugement de décembre 2008 qui déqualifie très manifestement des agressions sexuelles en harcèlement sexuel et une lettre saisissant à nouveau la secrétaire d'État à la solidarité de demandes de modifications législatives relatives au harcèlement sexuel et à la dénonciation calomnieuse ainsi que les actes de l'intervention de Catherine Le Magueresse le 22 novembre 2007 à la Sorbonne proposant une évolution du droit en matière de violences sexuelles.
La mission aensuite auditionné Mme Emmanuelle Latour, secrétaire générale de l'Observatoire de la parité, et de Mme Caroline Ressot, chargée d'études, sur les conclusions du groupe de travail : « Faut-il faire évoluer les lois concernant les violences au sein du couple ? ».

Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Mme Emmanuelle Latour, secrétaire générale de l'Observatoire de la parité, et Mme Caroline Ressot, chargée de mission.
L'Observatoire de la parité a publié en février 2009 une note de synthèse portant sur la question : « Faut-il encore faire évoluer les lois concernant les violences à l'égard des femmes au sein du couple ? »
Nous vous remercions de nous en présenter les conclusions. Nous vous demanderons ensuite certaines précisions, notamment sur la notion de violence psychologique au sein du couple et la forme que cette définition pourrait prendre.
L'Observatoire de la parité, créé en 1995, est un service du Premier ministre qui a pour mission de centraliser, faire produire et diffuser, au besoin par des programmes d'actions spécifiques, les données, analyses, études et recherches sur la situation des femmes aux niveaux national et international ; d'évaluer la persistance des inégalités entre les sexes et identifier les obstacles à la parité, notamment dans les domaines politique, économique et social ; d'émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires dont il est saisi par le Premier ministre ; de faire toutes recommandations et propositions de réformes au Premier ministre afin de prévenir et de résorber les inégalités entre les sexes et promouvoir l'accès à la parité.
De 1995 à 2001-2002, la majorité des travaux de l'Observatoire a été consacrée à la question de la parité politique, dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 1999et des lois votées à partir de juin 2000 sur ce sujet. Si la parité en politique a permis des avancées importantes, nos rapports font encore état de nombreux obstacles, j'en veux pour preuve le pourcentage de 81,5 % d'hommes à l'Assemblée nationale.
Mme Marie-Jo Zimmermann, rapporteure générale de l'Observatoire de la parité depuis 2002, a décidé d'ouvrir le champ thématique de nos réflexions. Depuis 2006, l'Observatoire a élargi son champ de travail aux sphères économique et sociale. M. Guy Geoffroy, membre de l'Observatoire a ainsi mis en place un groupe de travail sur les violences à l'égard femmes au sein du couple, dont il est le rapporteur.
Les travaux de l'Observatoire sur ce thème se sont déroulés au cours de l'année 2008 autour de la question de l'utilité d'une loi-cadre, en tout cas d'une collation de textes qui constituerait un socle des lois traitant des violences à l'égard des femmes. Nous avons organisé six séances de travail qui ont permis l'audition d'une vingtaine d'intervenants permettant de couvrir le champ relativement large de la question des violences à l'égard des femmes.
À ce propos, la multiplicité des échanges pendant les auditions et dans l'élaboration des comptes-rendus et de la note de synthèse qui vous a été communiquée, nous a permis de faire un point de terminologie important sur la question.
Tout d'abord, afin de mettre en avant l'aspect systémique de ces violences, l'Observatoire a privilégié l'expression « violences à l'égard des femmes » ou « violences à l'encontre des femmes », à celle de « violences faites aux femmes » telle qu'elle apparaît dans les médias ; l'enjeu étant de mettre en évidence le caractère genré de ces violences. Ceci correspond à l'approche suivie par la recommandation numéro 19 du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAWCEDEF), élaborée en prévision de la Conférence mondiale des droits de l'homme de 1993 à Vienne.
L'expression « femmes victimes de violences » a également été privilégiée par rapport à celle de « femmes battues », car il ne s'agit pas seulement de coups, violences physiques, mais aussi de violences psychologiques et de violences sexuelles. Ces violences peuvent prendre de nombreuses formes: excision, privation de papiers, mais aussi humiliations et même mariages forcés.
L'expression « violences au sein du couple », a paru plus pertinente que celle de « violences conjugales », ce dernier qualificatif renvoyant au seul lien matrimonial, alors que les concubins, les pacsés, les ex-pacsés sont aussi bien concernés que les conjoints. De plus, contrairement à « violences domestiques », elle permet d'éviter une confusion avec la question des violences et maltraitances familiales.
Les personnes auditionnées ont mis en avant les avancées de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs en matière de lutte contre les violences à l'égard des femmes, ainsi que les autres dispositifs existants, à savoir la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, la loi du 5 mars 2007 sur la délinquance et la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive.
Nos débats et échanges ont mis en évidence la possibilité de rendre ces dispositifs plus performants dans la perspective d'une loi ou d'un socle commun de lois qui pourrait clarifier certaines zones d'ombre. Trois principales mesures ont été préconisées : la nécessité d'une évaluation de la situation et de ses répercussions socio-économiques, la clarification du cadre juridique et le renforcement de la protection judiciaire des victimes.
En premier lieu, la question de l'évaluation a été jugée essentielle. D'ailleurs, l'ensemble des travaux de l'Observatoire sur la question de la place des femmes en politique a montré la nécessité absolue d'outils statistiques performants pour dresser un diagnostic valable.
Les premières statistiques, très médiatisées, qui ont été produites par l'Espagne sur les violences à l'encontre des femmes, ont fait apparaître cette problématique comme fondamentale en termes d'enjeu et de priorité dans l'agenda politique. Quand elles ont été publiées – une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint –, l'ensemble des pays européens a considéré que l'Espagne devait être un pays particulièrement violent. La France, qui pourtant avait lancé en 2001 une enquête nationale sur les violences envers les femmes (ENVEFF), ne s'est dotée que très récemment d'outils statistiques plus performants – qu'il reste essentiel de rendre plus systématiques – et qui nous ont permis d'avoir ces statistiques effrayantes aujourd'hui : une femme décède tous les deux jours et demi, victime de son compagnon ou ex-compagnon.
S'il est essentiel que cette évaluation de la situation passe par des données statistiques systématiques – y compris pour les violences au travail et dans les établissements d'enseignement et de formation, pour lesquels il y a encore trop peu de données, voire pas du tout –, encore faut-il s'en donner les moyens. Or, sans évaluation de la situation, la puissance publique ne peut prendre aucun engagement, ni se doter de moyens pour traiter cette problématique.
Les répercussions économiques des violences au sein du couple ont commencé à être évaluées et elles sont considérables : 383 millions d'euros par an dans le domaine de la santé, 305 millions pour le coût humain induit, 232 millions pour la police et la justice, 89 pour le logement et les prestations sociales, 2,5 millions pour le champ social et médico-social, et 83 millions pour la perte de production au sein du couple et de revenus suite aux arrêts de travail. Ces données chiffrées montrent que ce qui a été perçu pendant longtemps comme un problème familial et privé, concerne en réalité directement la puissance publique en termes de coûts autant qu'en termes de sécurité, de justice et de santé.
Avant de proposer d'améliorer ces dispositifs d'évaluation des coûts économiques, il est nécessaire d'évaluer la cohérence entre les actions et l'utilisation des finances publiques y compris au niveau des collectivités territoriales. Or nous n'avons pas encore d'outils assez performants nous permettant de faire des études d'impact.
Il est également important d'évaluer la situation de l'ensemble des femmes victimes de violences au sein du couple. Il peut s'agir de femmes qui vivent dans une grande précarité économique, laquelle pèse beaucoup sur la capacité à pouvoir sortir de l'enfermement du milieu familial.
Il reste nécessaire, ce qui n'a pas encore été fait de manière systématique, de se poser la question de la situation des femmes immigrées primo-arrivantes, au sujet desquelles un rapport très important a été rédigé par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, afin de croiser les problématiques de l'alphabétisation et de l'accès au travail avec celle des violences.
Il convient, en outre, d'évaluer les structures existantes et le personnel mis à disposition pour mettre en oeuvre les lois adoptées et les politiques publiques, à savoir les actions menées par les associations et les financements qui leur sont alloués, sachant qu'elles accompagnent non seulement les victimes, mais aussi les auteurs de violences.
Enfin, une évaluation de la jurisprudence civile, pénale et administrative est nécessaire sur ce sujet. Des inégalités très importantes existant sur le territoire, il faut se donner les moyens de comparer la jurisprudence et de comprendre pourquoi tel cas est instruit de manière aussi différente d'une juridiction à l'autre. Une des pistes importantes issues des travaux de l'Observatoire est la formation des professionnels de justice et des acteurs qui accompagnent les victimes. S'il est de la responsabilité de l'État d'apporter la formation nécessaire au personnel de justice, notamment par l'intermédiaire de l'École nationale de la magistrature où un enseignement sur cette question vient d'être mis en place, une formation en réseau, coordonnée, est également indispensable, comme l'ont rappelé les personnes auditionnées. Des formations collectives pour les magistrats, le personnel médico-social et les policiers leur permettraient d'acquérir des automatismes et une méthodologie commune dans le cadre des dossiers qu'ils seront conduits à traiter ensemble.

Vous avez évoqué les répercussions économiques des violences au sein du couple. Peu importe le coût de la lutte contre les violences faites aux femmes ! Même si ces violences ne coûtaient rien, il serait toujours extrêmement important de les combattre.
Bien entendu, l'égalité entre les femmes et les hommes est une question de justice, et non de rentabilité économique. L'idée de pouvoir évaluer le coût des violences faites aux femmes est, avant tout, un argument de poids pour montrer que les financements qui sont consacrés à ce problème sont considérables et pourraient être transférés, si l'on s'en occupait plus en amont, et non plus une fois que le mal est fait. Ma collègue pourra développer ce point.

Votre souci sémantique me paraît fondé, mais à mon avis, les violences sont perpétrées contre les femmes. Par conséquent, parler de violences « à l'encontre des femmes » me paraît plus judicieux que « à l'égard des femmes ». Il n'y a aucune notion d'égard ici.
L'expression « à l'égard des femmes » peut en effet paraître antinomique. Nous ferons en sorte qu'elle n'apparaisse plus.
S'agissant des recommandations formulées par les personnes auditionnées sur la clarification du cadre juridique et sur le renforcement de la protection judiciaire des victimes, le premier point, concerne les violences psychologiques.
Les personnes entendues ont, dans leur très grande majorité, expliqué la nécessité de prendre en compte les violences psychologiques, mais n'ont pas souhaité qu'elles fassent l'objet d'un délit spécifique. D'abord, parce qu'il pourrait être utilisé par les auteurs de violences pour porter plainte contre la victime au prétexte que l'action en justice contre eux n'a pas abouti et leur aura causé une vraie violence psychologique. Ensuite, faire une liste exhaustive des violences étant compliqué, il pourrait en résulter une difficulté de qualification des faits par le magistrat.
Deux options avaient été mises en avant dans le groupe de travail.
La première consistait à modifier les articles du code pénal relatifs aux violences – à savoir les articles 222-9, 222-11 et 222-13 – pour y inclure les violences psychologiques, sachant qu'elles s'exercent souvent en amont des violences physiques.
La seconde option était la création d'un délit spécifique pour les violences au sein du couple. Le projet de la Chancellerie « sur les violences habituelles », a été trouvé plus intéressant car il met en avant toutes les violences : psychologiques, physiques, voire sexuelles, même si ces dernières constituent un délit spécifique. Concrètement, un même délit pourrait couvrir tout le champ, des violences psychologiques jusqu'aux viols.
Nous avons d'ailleurs été interpellés sur l'article 222-22 du code pénal qui porte notamment sur la question du viol conjugal, lequel dispose : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. » Or cet article a été modifié en 2006 par l'ajout de la phrase suivante : « Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ». À l'époque, les personnes auditionnées s'étaient déjà posé la question de savoir si l'on pouvait parler de consentement général, sachant que, dans une vie de couple, il n'y a a priori que des consentements particuliers à des actes sexuels particuliers. Pour eux, c'est donc la particularité qui devrait primer.
La question des violences au travail fera l'objet d'une note particulière de l'observatoire. Je vous livre cependant les premiers travaux sur cette question.
Pour ce qui est du harcèlement, la loi du 27 mai 2008 « portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations » a été présentée comme une avancée importante. Elle apporte une définition beaucoup plus précise du harcèlement sexuel en son article 1er et intègre le harcèlement sexiste.
Les personnes auditionnées ont mis en avant la nécessité de codifier ces définitions dans le code pénal et dans le code du travail. Ces avancées devant bénéficier également à la fonction publique, elles ont aussi mis en avant la nécessité de modifier l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, afin d'harmoniser la législation entre les salariées du secteur privé et les femmes fonctionnaires. Cet article ne traite que du harcèlement sexuel, et avec une définition très imprécise.
Dans la mesure où la définition proposée dans la loi du 27 mai 2008 est calquée sur celle du harcèlement moral, lui-même inscrit dans le code du travail, modifier cet article présenterait un avantage dans la mesure où les magistrats ont beaucoup de mal à qualifier les faits.
En fait, le traitement par les tribunaux administratifs est différent de celui des conseils de prud'hommes.
Si la loi n'est pas en cause, l'article 6 quinquies n'aide pas les magistrats administratifs à se prononcer car ils ont beaucoup de mal à qualifier les faits. La loi de 2008 le leur permettrait.
Maître Marie-Pierre Chanlair, du cabinet MPC Avocats, spécialisé en droit de la fonction publique, a soulevé deux problèmes : d'une part, une définition du harcèlement sexiste et du harcèlement sexuel qui reste très floue, d'autre part, une inégalité en matière de recours. Entre le tribunal administratif et le conseil de prud'hommes, les possibilités de recours sont très différentes, de même que l'accompagnement juridique, sachant qu'il existe très peu d'avocats formés sur ces questions pour la fonction publique.

Ce que vous dites est très important. Il n'y a pas un droit particulier à la fonction publique. La différence tient à ce qu'est le droit civil ou pénal, d'un côté, et ce qu'est le droit administratif de l'autre. Au civil ou au pénal, on attaque une personne à qui l'on reproche des faits, un comportement ou une absence de faits ou de comportement. Au tribunal administratif, on attaque une décision, même quand elle n'a pas eu lieu, c'est-à-dire à une absence de décision. La difficulté est là !

Caractériser un comportement pour en faire une décision ou une absence de décision susceptible, dans le cadre de la mise en oeuvre des principes généraux du droit, d'être jugée par le tribunal administratif est très compliqué.
Même si certains jugements ne sont pas allés jusqu'en appel et n'ont donc pas fait jurisprudence, il doit être possible de traiter une affaire de discrimination, éventuellement de harcèlement, au sein de la fonction publique selon les principes généraux du droit et devant des tribunaux privés, sans avoir besoin de déposer un recours devant une juridiction administrative, sauf quand la juridiction administrative est saisie d'une décision de nature disciplinaire prise au sein de la fonction publique – d'où la question que vous évoquez du poids de la hiérarchie. Il nous faudra approfondir cette question.
Le deuxième point abordé dans le cadre des violences au travail est celui de la dénonciation calomnieuse.
Les personnes auditionnées nous ont en effet relaté des cas où, une fois la victime déboutée de sa demande ou l'auteur des violences acquitté, ce dernier portait plainte pour dénonciation calomnieuse. Elles nous ont donc proposé de supprimer l'alinéa 2 de l'article 226-10 du code pénal, la présomption d'innocence de la victime de violences pouvant être remise en cause.

Nous avons déjà abordé cette question au cours de l'audition précédente, avec Mme Marilyn Baldeck.
Cette clarification du cadre juridique est importante car elle guidera les magistrats et leur permettra de se positionner en toute connaissance de cause. Dans le cadre de la refonte du code pénal notamment, toutes les personnes concernées par la lutte contre toutes les formes de violences devraient être largement impliquées pour que tous ces aspects ne soient pas oubliés.
Je reviens sur la fonction publique et sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, principalement des universités. Les étudiants ne sont pas encore considérés comme salariés bien qu'ils commencent à faire de la recherche. Ils sont dépendants d'une hiérarchie et d'un droit applicable très flou, ce qui permet des discriminations importantes. Les chiffres actuels – 56 % d'étudiantes à l'université, 40 % de femmes maître de conférences et 18 % de femmes professeurs – montrent l'existence d'un plafond de verre très important.
Dans le contexte de la réforme des universités, la perspective de genre, à savoir une analyse du processus de différenciation et de hiérarchisation des trajectoires des hommes et des femmes, à l'intérieur des universités, dans leur formation et leur carrière, a été soumise à notre attention comme un point très important sur lequel se pencher. Les circulaires diffusées à partir de 2003 demandant aux présidents d'université d'être particulièrement vigilants sur les questions de harcèlement sexuel à l'université ont abouti à la mise en place de commissions de pilotage, où les questions de harcèlement sont jugées entre pairs !
Ces structures, composées de maître de conférences et de professeurs ne permettent aucun recours aux étudiants et aux étudiantes.

Nous avions déjà soulevé ce point en 1968 : les choses n'ont donc pas évolué. Nous dénoncions alors le fait que les étudiantes n'avaient pratiquement aucun recours lorsque leurs travaux avaient été « pillés ».
Aujourd'hui encore, me disent-elles, elles ont très peu droit à la parole pour dénoncer l'exploitation de leurs publications alors que les hommes ont davantage de poids à l'intérieur de l'institution pour faire valoir et revendiquer l'identité de leurs travaux.
Concernant la seconde recommandation, à savoir le renforcement de la protection judiciaire des victimes, je commencerai là encore par les violences au sein du couple.
Hormis les instances de médiation auditionnées, la grande majorité des personnes entendues ont considéré que la médiation pénale ne constitue pas une protection pour les victimes de violences et certaines d'entre elles ont demandé sa suppression dans le cadre des violences au sein du couple. C'est un point qui a fait débat. La médiation pénale pourrait être justifiée si elle intervenait dès les premiers signes de violences ; or les recours à cette procédure sont souvent tardifs et conduisent à des récidives qui mettent en danger les victimes.
Les associations nous ont alertés sur le respect des droits des victimes et de leurs enfants et sur leur sécurité, les séparations et les divorces entraînant parfois des violences très graves. Elles ont proposé de permettre la domiciliation des victimes au cabinet de l'avocat ou au siège de l'association – encore que l'auteur des violences peut déduire que si la victime est domiciliée au siège de telle association, elle se trouve sûrement dans l'antenne locale de cette dernière.

Cette possibilité existe déjà, et la domiciliation peut même se faire dans une gendarmerie.
Les associations ont beaucoup insisté sur ce point pour qu'il soit systématisé.
Les personnes auditionnées ont également demandé que les droits de visite du père violent soient organisés dans des lieux sécurisés, avec du personnel formé à proximité, pour que ces moments puissent se passer de la façon la plus paisible possible et pour mettre en sécurité les mères et les enfants.
Elles ont préconisé, si la situation le permet, de suspendre les droits de visite et le droit de garde, d'autant qu'un consensus commence à apparaître pour dire qu'un mari violent ne peut pas être un bon père.
Ces questions ont été abordées longuement et les associations ont beaucoup insisté pour que les procédures soient mises en place de façon plus systématique afin de protéger les mères et les enfants en cas de séparation et de divorce.
Pour ce qui est des violences au travail, l'accent a surtout été mis sur la question de la preuve.
Pour le pénal, s'il ne peut pas y avoir de renversement de la preuve pour cause de présomption d'innocence, on peut en revanche faciliter la preuve de l'intentionnalité en intégrant les dispositions de la loi de 2008 dans le code du travail et le code pénal. En effet, la définition, telle qu'elle est présentée, permettrait au magistrat de qualifier plus facilement les faits.
Pour la fonction publique, il serait intéressant de renverser la charge de la preuve, car il est à l'heure actuelle trop compliqué pour une fonctionnaire d'apporter les éléments de preuve, l'administration détenant la plupart des documents. D'où la nécessité, encore une fois, de modifier la loi du 13 juillet 1983 sur la fonction publique.
Je reviens sur les procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement supérieur ou établissements publics à caractère scientifique et technologique, qui posent un véritable problème car, pour l'instant, l'impartialité des décisions ne peut pas être garantie. En effet, non seulement le président de l'établissement statue seul sur la recevabilité de la plainte, mais les membres de la section disciplinaire sont juge et partie. En outre, le cadre de l'administration implique des ententes et des soutiens entre collègues, sans compter le pouvoir hiérarchique et la question de l'ascendance entre professeurs et étudiantes.
En outre, Maître Chanlair a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'est plus possible, depuis quelques années, de faire appel dans la fonction publique, notamment pour les procédures dans le cadre des établissements d'enseignement supérieur. Autrement dit, on peut seulement déposer un recours en cassation devant le Conseil d'État – qui de toute façon ne se prononcera pas sur les faits –, et non faire appel de la décision prise par le tribunal administratif, à l'inverse du secteur privé.
Même si les femmes du secteur public ont plus de facilités en termes d'aide juridictionnelle, l'accès aux tribunaux reste difficile, les magistrats ont du mal à se positionner en matière de harcèlement, dont la définition est imprécise, et elles ne peuvent pas faire appel de la décision.
L'immense majorité des personnes auditionnées a mis l'accent sur la formation des magistrats, mais aussi des personnes qui accueillent les femmes victimes : policiers, gendarmes, médecins, y compris de la médecine légale, avocats, personnels de la préfecture. Il faudrait également réintroduire la possibilité pour les magistrats de suivre des stages dans des structures associatives, car ils sont demandeur en la matière.
Les travaux ont d'ailleurs soulevé la question des femmes immigrées qui, depuis une loi récente, ont « plus de facilités pour porter plainte », « obtenir un titre de séjour et être protégées ».
Enfin, il serait intéressant de désigner des policiers, des gendarmes, des magistrats référents, formés en matière de violences au sein du couple. C'est toute la question de la sensibilisation et de l'information sur ces questions pour un meilleur accompagnement et une meilleure protection des victimes.

Une fois n'est pas coutume : j'aurais tendance à modérer votre approche de la défense des femmes, car il est très risqué d'aller jusqu'à la suspicion de défaut d'objectivité en matière de genre. Je me réfère à l'exemple de l'université et de sa masculinité, car ce procès pourrait conduire certains à faire celui de la féminisation de la magistrature. Notre mission doit circonscrire précisément le concept de violences, quitte à l'élargir, mais sans faire a priori ce procès. Pour des raisons culturelles, sociologiques ou autres, il est des domaines où l'autorité hiérarchique est féminisée.
Personnellement, je ne me vois pas suspecter un magistrat sur l'objectivité de sa décision au prétexte qu'il est une femme.
Il est effectivement important de faire la distinction entre les discriminations dans le cadre des carrières professionnelles et la question des violences. Parler de la place des femmes en tant qu'étudiantes, maître de conférences et professeurs est une manière de poser le cadre général. Comme vous le savez, la place des femmes sur le marché du travail est identique partout : à l'université, comme ailleurs, le plafond de verre est trop souvent systématique. Il ne s'agit pas de faire un procès « en masculinité » à l'université, sinon la violence serait partout, donc nulle part.
Les discriminations existent et des recours auprès de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) seront peut-être formés dans les années à venir si, par exemple, au bout de vingt ans de carrière professionnelle, les femmes ont 20 % de salaire en moins par rapport à leurs collègues masculins entrés en fonction en même temps qu'elles. Mais, encore une fois, cet aspect concerne les femmes sur l'ensemble du marché du travail.
S'agissant de l'enseignement supérieur et la recherche, nous avons souhaité attirer votre attention sur un point précis : non pas sur les inégalités professionnelles et salariales, ni les inégalités de carrière mais sur la question spécifique du harcèlement sexuel – parce que le harcèlement sexuel constitue une discrimination à l'encontre des femmes – qui a été spécifiquement mise en avant parce qu'elle s'exerce aujourd'hui dans une sorte de zone de non-droit : recours impossibles, commission entre pairs, président seul à juger.

Je reviens sur l'évolution possible de la définition des violences psychologiques.
Il y a une attente par rapport à cette définition pour pouvoir enfin obtenir une incrimination par la justice, et donc une vraie libération par des solutions judiciaires face à une situation d'enfermement. De nombreuses femmes se savent maintenant victimes de violences au sein de leur couple, mais ne savent toujours pas comment en obtenir la reconnaissance par la justice !
Quelle piste nous conseilleriez-vous de privilégier ? Une définition générale, mais précise – un peu sur le mode du harcèlement moral au travail –, c'est-à-dire un article général intégrant la violence psychologique définie au même titre que les autres types de violence ? Ou une incrimination particulière ?
C'est une excellente question, mais le sujet est sensible.
La définition proposée par le Conseil de l'Europe dans sa recommandation est intéressante. Elle retient une liste des violences à l'égard des femmes, proche a priori de la définition du projet de la Chancellerie sur les violences habituelles. En étant plus précise et en permettant de prendre en considération les violences psychologiques, elle va plus loin que la définition proposée par l'ONU dans sa déclaration sur l'élimination des violences. C'est très important, sachant que la majeure partie des violences au sein du couple est de nature psychologique. C'est pourquoi la quasi-unanimité des personnes auditionnées a été d'accord sur la reconnaissance des violences psychologiques. En revanche, en faire un délit spécifique est très risqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut être récupéré par l'auteur des violences.
La nécessité de mettre à disposition, avec des outils comme le guide de l'action publique, un maximum d'éclairage sur la terminologie a été mise en avant. Préciser la définition du harcèlement sexiste pour donner aux magistrats les moyens d'évaluer la situation n'entraîne pas nécessairement la création d'un délit supplémentaire. Toutes les associations le soulignent : tout délit supplémentaire entraîne la crainte d'une instrumentalisation de celui-ci et du retournement contre la victime, à l'image de la dénonciation calomnieuse. Si la victime n'a pas réussi à apporter de preuves suffisantes et perd son procès, l'auteur des violences se retourne contre elle, et elle est automatiquement condamnée.
La confiance en la justice et en l'interprétation des magistrats est en jeu. L'important est donc moins l'outil législatif en lui-même, que la compréhension et l'interprétation qu'en font les magistrats.
La mission a enfin auditionné, sous la présidence de M. Henri Jibrayel, Mme Andréanne Sacaze, ancien bâtonnier d'Orléans, et Mme Franceline Lepany, avocate au barreau de Paris

Nous avons le plaisir de recevoir maintenant Mme Andréanne Sacaze, ancien bâtonnier d'Orléans, et Mme Franceline Lepany, avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit du travail.
Je limiterai mon propos aux violences faites aux femmes dans le cadre des relations du travail, en essayant d'être aussi objective que possible, sachant que j'exerce comme avocate auprès des salariés et des syndicats. Je commencerai par deux remarques préliminaires.
D'abord, le débat sur les violences au travail ne se limite pas aux femmes, même si je conviens que le besoin qu'elles ont de travailler les place souvent dans une situation de soumission et qu'elles peuvent accepter plus facilement des conditions de travail extrêmement dures.
Ensuite, je constate un clivage énorme entre les grandes et les petites entreprises. Dans les premières, des instances internes – instances représentatives du personnel, DRH – jouent le rôle d'interface entre l'employeur et les salariés. Dans les secondes, ces derniers peuvent difficilement faire valoir les dispositions du code du travail, faute de représentants ; ils vivent dans une proximité avec l'employeur qui, quand le dialogue existe, place celui-ci sur le mode affectif, ce qui peut être le pire.
Je ne parlerai pas des violences physiques, qui le plus souvent sont liées au harcèlement sexuel, car dans le cadre de ma vie professionnelle j'ai eu surtout à travailler sur le « harcèlement moral ».
Je n'aime pas cette notion et je demande aux salariés de ne pas l'utiliser d'emblée pour me présenter leur situation. En effet, il est très rare que la jurisprudence reconnaisse le harcèlement moral tel qu'il est défini dans le code du travail. Comment cela se passe : le salarié doit établir les faits susceptibles d'être admis comme du harcèlement moral, et non se contenter de les présenter. Quant à l'employeur, il doit apporter la preuve que les faits dont il s'agit sont liés à une réalité objective, comme la situation économique ou le lien de subordination auquel est soumis le salarié.
Dès lors, à partir de quand y a-t-il harcèlement moral ? Lorsque des salariés se prétendent harcelés moralement parce qu'ils reçoivent beaucoup de mails, par exemple, il peut simplement s'agir d'une réaction à une insubordination. On peut également avoir des déconvenues car il arrive que le salarié soit lui-même harceleur. Le harcèlement moral est une situation très complexe et Mme Hirigoyen, qui ne nous a pas facilité la tâche avec cette notion, a même été obligée d'écrire un autre livre pour expliquer comment discerner le vrai harcèlement moral du faux!
C'est pourquoi on essaie de déplacer le débat sur le terrain de l'obligation de sécurité de l'employeur, inscrite à l'article L 230-2 du code du travail, ou encore de l'exécution loyale du contrat de travail, figurant à l'article L 120-4 du même code, qui n'est ni plus ni moins que la transposition de l'article 1134 du code civil. De cette façon, on part non pas des agissements répétitifs comme le veut la définition du harcèlement moral, mais du contrat et de son exécution dans le cadre du lien de subordination avec l'employeur.
Dans les grandes entreprises, divers outils permettent de lutter contre ces situations difficiles pour les salariés. Il en existe un qui est très peu utilisé : le droit d'alerte. Il permet au salarié de signaler sa situation aux délégués du personnel, lesquels peuvent alors demander une enquête interne qui sera menée avec lui et le directeur du personnel. Mais bien souvent, les salariés ont peur de s'exposer et les délégués du personnel eux-mêmes craignent de voir la procédure aboutir à une plainte en diffamation ou en dénonciation calomnieuse - et tout le monde se tait.
Je préconise donc le déclenchement de ce système d'alerte en cas de problème d'« exécution du contrat de travail », notion contractuelle moins fortement connotée, susceptible de déboucher sur le harcèlement moral, voire le harcèlement sexuel. Inutile de vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de condamnations en matière de harcèlement sexuel, l'acte en lui-même ne suffisant pas puisqu'il faut démontrer l'objectif « d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », comme le prévoit l'article 222-23 du code pénal, ce qui est très difficile. Du coup, le harcèlement sexuel se transforme en harcèlement moral et, au bout du compte, il n'y a pas de décision.
Je conseille aussi d'intervenir en amont pour aider les salariés. Certaines entreprises ont réfléchi, avec leurs services de relations humaines, aux moyens de les aider à exprimer leur malaise. En effet, la souffrance des salariés n'est pas forcément due à la présence d'un pervers narcissique, elle vient souvent aussi de l'organisation de l'entreprise qui les place dans une situation de soumission.
L'arsenal juridique existe, mais il conviendrait de développer l'intervention des inspecteurs du travail sur ce terrain. Actuellement, les inspecteurs du travail interrogent de façon anonyme les personnes qui se disent victimes de harcèlement moral et n'entendent que les salariés. Les employeurs font donc valoir devant la juridiction le caractère non contradictoire de l'enquête.
Il faudrait que l'on examine s'il y a « exécution loyale du contrat de travail » par l'employeur, de façon plus globale et notamment en matière d'organisation du travail du salarié.
En revanche, je suis totalement démunie face aux problèmes qui se posent dans les petites entreprises, où les salariés n'ont pas de représentants du personnel pour réclamer de l'employeur le respect des dispositions du code du travail.
Pour terminer, je voudrais évoquer l'esclavage moderne. Cette « servitude domestique », constitue une réelle situation de violence. Un groupe de travail a été constitué au ministère de l'intérieur sur la traite des êtres humains.
Il est très difficile de mener des enquêtes sur ces situations car les policiers ne peuvent entrer dans un domicile privé. Ils demandent, en outre, qu'on leur démontre qu'il existe un contrat de travail, ce qui est évidemment impossible car ces personnes sont dans un état de servitude totale. Ce sont souvent des femmes qui arrivent avec des diplomates. Elles doivent tout faire dans la maison, sont mal logées, mal nourries, bref sont soumises nuit et jour à des conditions de vie épouvantables.
Nous avons essayé de sortir des femmes de cette situation et de demander la requalification de leur situation en contrat de travail. D'abord, il a fallu faire reconnaître au pénal que la personne avait des conditions de vie inhumaines, pour ensuite faire reconnaître devant la juridiction prud'homale le travail dissimulé. Cela prend des années… Je travaille avec le Comité contre l'esclavagisme moderne, qui accompagne ces femmes, les place dans des foyers et les aide à se reconstruire au moyen de ces procédures pénales et prud'homales. Mais encore une fois, il est évidemment difficile de démontrer le travail dissimulé si les policiers ne peuvent pas entrer.
Généralement, ce sont des voisins qui repèrent ces femmes, font un signalement à la police, qui appelle le Comité contre l'esclavagisme moderne. Ensuite, nous essayons de constituer des dossiers sur leurs conditions de vie. Petit à petit, nous reconstituons leurs droits – avec la limite que constitue le délai de prescription de cinq ans, leur situation durant parfois depuis de très longues années. Quant aux décisions de justice, elles sont souvent bien difficiles à faire exécuter car elles concernent la plupart du temps des personnes qui bénéficient d'une immunité diplomatique ou qui sont reparties dans leur pays.

Merci pour la très grande qualité de votre exposé.
Vous nous dites qu'il est très difficile de prouver directement le harcèlement moral, mais qu'en revanche, en partant du contrat de travail et en montrant comment la relation a dévié, il est possible d'arriver à la qualification de harcèlement moral, voire sexuel. Je comprends votre démarche, mais elle est très frustrante pour nous qui nous interrogeons sur la manière dont on peut définir la violence psychologique au sein du couple. Nous ne pouvons pas partir du « contrat » que constitue la vie de couple et examiner ensuite pourquoi ce contrat ne fonctionne plus « normalement » car, si on sait ce que signifie l'application « normale » d'un contrat de travail, on ne sait pas ce qu'est le « fonctionnement normal » d'un couple… Pouvez-vous nous aider à ne pas sombrer dans le découragement ?
C'est ma consoeur qui vous parlera des violences conjugales. S'agissant des relations de travail, j'insiste sur le fait qu'un salarié qui s'est dit victime de harcèlement moral sans pouvoir le prouver peut se retrouver non seulement licencié, mais poursuivi pour dénonciation calomnieuse.

On arrive à prouver le harcèlement moral s'il se traduit par des éléments tangibles sur lesquels le magistrat peut s'appuyer, comme une maladie psychologique ou un arrêt de travail. Néanmoins, la suspicion d'abus demeure toujours ; nous connaissons le même problème dans le cadre du droit de la famille, avec les certificats médicaux qu'on suspecte d'être de complaisance pour empêcher, par exemple, l'exercice du droit du garde par l'un des parents.
C'est la raison pour laquelle il me semble que notre mission devrait focaliser son attention sur ce qui peut être fait en matière de prévention, peut-être plus qu'en matière de constructions juridiques pour lutter contre des infractions qui sont difficiles à prouver. En matière de prévention, dans quels domaines constatez-vous des carences – qui pourraient d'ailleurs justifier, elles, l'élaboration d'un cadre juridique ?
J'ai du mal à comprendre l'attitude des médecins du travail. Quand ils écrivent : « Inapte à tout travail, pas de deuxième visite », il faut comprendre qu'il y a harcèlement moral. L'employeur doit alors procéder à un reclassement dans les mois qui suivent ; s'il ne trouve pas, il peut licencier le salarié. Mais pour autant, rien n'est réglé… Il faudrait que les médecins du travail aient le courage de qualifier ce qu'ils ont vu et fassent une enquête sur place.

Je crois moi aussi qu'il faut pouvoir s'appuyer sur des professionnels ayant l'indépendance et le recul nécessaires. Je pense également aux assistantes sociales. Il faudrait que vous nous aidiez à déterminer l'autorité qu'il convient de conférer à ces professionnels indépendants pour travailler sur la prévention.
Avant d'intervenir sur le problème des violences faites aux femmes dans le cadre de la famille, j'aimerais répondre sur la question de la prévention.
Comme vous le savez, le rapport Darrois invite les avocats à se pencher sur le thème de l'avocat dans l'entreprise. Celui-ci serait titulaire du CAPA et sous contrôle du bâtonnier. Voilà une autorité qui pourrait être d'une importance capitale pour avancer.
Nous sommes bien d'accord. Reste que voilà une idée. Pour le moment, la moitié des avocats y est favorable.
J'en viens aux violences conjugales. Dans mon exercice d'avocat de province, je reçois des femmes qui viennent me confier leur détresse. Ce problème de société renvoie une image assez désagréable de la gente masculine. Cependant la violence existe aussi de l'autre côté, même si c'est beaucoup plus rare …
Comme celui de l'entreprise, le contexte familial est très délicat à manier car les femmes sont parfois très ambiguës dans leur relation avec leur conjoint, pour de multiples raisons. Souvent, elles sont sans emploi, et donc en situation de précarité. Souvent aussi, leur éducation les a conduites à considérer qu'elles ne pouvaient pas penser par elles-mêmes, mais seulement à travers celui qui leur apportait de quoi se nourrir et se vêtir.
En arrivant dans mon cabinet, les femmes me disent : « Je ne peux pas déposer plainte ». Après les avoir entendues une première fois, je les reçois plusieurs fois, afin de créer entre nous un lien de confiance suffisamment fort pour leur faire entendre que la loi de 2006 peut leur apporter beaucoup.
La loi sur le divorce de 2004 permettait déjà de saisir le juge en urgence en la forme des référés, de manière à obtenir contradictoirement, l'expulsion de celui qui bafoue l'autre. La loi de 2006 qui, avec son arsenal pénal, permet la « mise de côté » de l'auteur présumé des actes de violence et donne à l'autre la possibilité de rester dans son domicile en sachant que si le conjoint transgresse la règle, il pourra se retrouver en détention, me paraît d'une réelle efficacité.
Il y a cependant un contre-argument : les enfants demandent pourquoi ils ne peuvent plus voir leur papa. Il faut donc aller vite dans la réponse pénale. Cela suppose, pour commencer, la reconnaissance par les parquets que la notion de violences conjugales correspond à une réalité...
C'est tout à fait exact, mais il n'en va pas de même partout. Dans le Guide de l'action publique, le garde des sceaux a donné à l'ensemble des procureurs généraux des instructions à ce sujet. À Orléans, il n'y a pas de difficultés mais exerçant aussi à l'extérieur d'Orléans, je constate que la situation est très inégale.
Elle l'est aussi en matière de formation des services de police et de gendarmerie, et je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous une dame connaissant mal la langue française, arrivant à la gendarmerie en pyjama, avec ses enfants sous le bras, après avoir été violentée par son conjoint. Imaginez le gendarme qui, très gentiment, transcrit ses propos dans une bonne forme de français. À l'audience, le contradicteur va dire qu'il n'est pas possible qu'elle se soit exprimée ainsi à la gendarmerie puisqu'elle n'est pas capable de s'exprimer de la même manière à la barre !
Voilà pourquoi je prends des mesures en amont. Comme je travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes, j'ai des relations étroites avec les services de police et je m'autorise à leur téléphoner pour leur expliquer la situation. Mieux vaut décaler l'entrevue d'une journée pour permettre à la femme d'être reçue dans de bonnes conditions, avec un interprète, après avoir vu son avocat ainsi que le médecin, qui lui aura fourni un certificat médical.
Depuis longtemps, je me bats pour que la victime, quelle qu'elle soit – femme, enfant, homme – bénéficie d'une consultation juridique auprès d'un avocat et soit assistée d'un avocat. Ce n'est pas une demande corporatiste ; je suis convaincue que ce serait efficace. Alors que dès la première heure de sa garde à vue, une personne soupçonnée de faits de violences bénéficie de la présence d'un avocat, il n'est pas normal que la victime, elle, n'ait droit à rien.
Elle arrive avec des coups sur le visage ou sur le corps, sans savoir ce qui va se passer. Dans le meilleur des cas, elle a déjà été en contact avec une association, mais elle ne connaît pas le déroulement de la procédure, par exemple pourquoi on va la confronter à l'auteur présumé des faits ; or cette confrontation est extrêmement douloureuse psychologiquement. Si un avocat était à ses côtés, il pourrait l'apaiser en lui donnant toutes les explications nécessaires. Je crois aussi que, lors de la confrontation avec l'auteur présumé dans un commissariat ou une gendarmerie, il serait bon que l'avocat soit présent.
Il reste la question de la pression psychologique, du « harcèlement moral » dans le couple. C'est le fait, par exemple, de dire sans arrêt à une femme : « T'es une nulle, une bonne à rien ! », « Si j'apportais pas le fric, tu ferais rien, comment tu boufferais avec tes mômes ? », « De toute façon, si tu veux t'en aller, j'aurai les mômes parce que j'ai l'argent ! » Moi qui travaille beaucoup à l'aide juridictionnelle, j'entends cela de manière récurrente dans les affaires de divorce.
Or, comment le prouver ? Il n'y a pas de réelle possibilité de le faire car tout se passe à huis clos. Il y a aussi, en particulier dans la communauté turque, que je ne cible pas mais que je connais bien, le problème de ces femmes qui se sont fait confisquer leurs papiers d'identité par leur mari : non seulement elles ne peuvent pas s'échapper, mais elles ne peuvent pas demander l'aide juridictionnelle…
Il faut y trouver une solution ! À l'ère d'Internet, il me semble que les consulats pourraient établir des attestations prouvant l'origine et le lieu de naissance de ces personnes. Actuellement, nous sommes totalement démunis : alors qu'il y a urgence, nous ne pouvons même pas lancer la procédure.
J'en viens au problème de la qualification des faits. Comme ma consoeur dans le monde de l'entreprise, je reconnais faire du « palliatif » en matière de violences dans le couple.
Premièrement, je dis aux victimes de se rendre dans un lieu de parole, autrement dit une association où des psychologues les aideront gratuitement. Il faut aussi saluer le travail réalisé par certains conseils généraux en matière d'assistance sociale et d'aide psychothérapeutique. Je fais ensuite établir une attestation indiquant le nombre de fois où ces personnes se sont rendues dans ces lieux, ce qui va nourrir le dossier sur le plan de la preuve.
Deuxièmement, je demande aux victimes si elles ont déjà parlé de ces violences. Si, par bonheur, des témoignages sont possibles, je demande là aussi des attestations.
Troisièmement, je dépose moi-même une plainte auprès du Procureur de la République, avec une lettre circonstanciée, et j'essaie qu'une enquête soit déclenchée. En général, les investigations sur le contexte familial et social m'aident beaucoup ; et si, au bénéfice du doute, l'enquête n'aboutit pas à des poursuites pénales, la dénonciation calomnieuse n'est pas recevable.
S'agissant d'un problème de société qui touche toute la société – il m'arrive de voir des femmes de personnes qui ont des postes très élevés, dont on n'imaginerait pas un instant qu'elles puissent être humiliées de la sorte – je suggère de commencer par nos enfants. Dès sa prime enfance, à l'école mais aussi dans sa famille, on doit apprendre au petit garçon qu'il n'est pas supérieur aux filles. Il faut continuer tout au long de la scolarisation. Il convient d'apprendre aux jeunes le respect d'autrui, le respect de la femme, l'égalité qui interdit que l'un soit brimé par l'autre. Ce processus culturel d'ensemble serait peut-être susceptible de nous faire progresser, mais je ne suis pas en mesure de dire s'il faudrait une loi-cadre comme en Espagne.

Le dispositif que vous préconisez est intéressant, mais il suppose que les avocats organisent des permanences, jour et nuit, afin de proposer aux victimes la présence d'un avocat auprès d'elle, y compris à l'initiative de la gendarmerie ou du commissariat et avant qu'elles n'expliquent les circonstances des faits. Tous les barreaux y sont-ils prêts ?
Une permanence « victimes » existe déjà dans de nombreux barreaux, avec une formation spécifique. Paris a donné l'exemple, et la province a suivi.
Le Conseil national des barreaux, le Barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers sont sur la même longueur d'ondes sur le sujet.

Le Procureur de la République décide de l'opportunité des poursuites, mais il y a un « filtre préalable » que constitue le choix par le gendarme ou le policier, de conseiller de porter plainte ou de procéder à une main courante, et dans ce dernier cas, de la transmettre ou non au Parquet– car les transmissions ne sont pas systématiques. Or consulter une main courante ou se voir transmettre une plainte, pour un magistrat du parquet, ce n'est pas la même chose.
Que manque-t-il sur les plans législatif, budgétaire et humain pour donner suite à votre préconisation ?
Sur le plan législatif, il faudrait inscrire dans la loi que la personne qui se dit victime de violences peut être assistée d'un avocat ou bénéficier d'une consultation juridique auprès d'un avocat.
Sur le plan humain, chaque barreau gère son potentiel d'avocats. À Orléans, nous assurons cette permanence à tour de rôle pendant vingt-quatre heures, avec notre portable.
Sur le plan matériel, il faut que l'avocat puisse être indemnisé – on ne parle pas de « rémunération » dans le cas de l'aide juridictionnelle – pour son intervention. Dans l'hypothèse où il y a des poursuites, il peut demander l'application du relèvement de l'aide juridique, c'est-à-dire solliciter du tribunal, lors de la constitution de partie civile et dans le cadre des écritures, des frais irrépétibles qui seront imputables au condamné. Ces frais sont ceux engagés par les parties pour assurer leur défense. Si la victime obtient leur paiement par l'autre partie et parvient bien à les recouvrer dans l'année, il n'a pas besoin de demander à être indemnisé au titre de l'aide juridictionnelle.

Vous dites essayer de créer un climat de confiance pour aider les femmes à prendre la décision de porter plainte, mais comment décident-elles, étant donné leur situation d'enfermement, de venir vous voir ? Travaillez-vous dans une association ?
Par ailleurs, vous dites que les enfants demandent pourquoi ils ne voient plus leur père. Pour ma part je considère qu'un homme qui bat sa femme pervertit ses enfants et je ne vois pourquoi il aurait le droit de les revoir. Ne pourrait-il pas être déchu de ses droits de père pendant un certain temps ?
Non, je ne travaille pas dans une association. En revanche, je suis connue dans mon département en tant qu'avocate des femmes et des enfants violentés, et on me demande d'intervenir dans des colloques, dans les lycées, à l'Aide sociale à l'enfance. Sans doute certaines femmes viennent-elles me voir parce qu'elles connaissent mon nom. Souvent, elles sont amenées par une amie. Elles peuvent venir aussi sur les conseils de leur médecin traitant, voire du pédiatre qui, après plusieurs visites, finit par remarquer qu'elles ont des marques sur le corps et leur donne les coordonnées d'un avocat. Bref, si les femmes ont une possibilité à un moment donné de sortir de leur enfermement, elles viennent.
Sur le second point, on ne peut pas être manichéen. Il arrive que des femmes soient provocantes et provocatrices. Quant aux enfants, ils ne comprennent pas cette violence, et ils en souffrent intensément parce qu'ils aiment quand même leur père. On peut être un père câlin avec ses enfants, et un mari frappeur, je le constate fréquemment.
C'est pourquoi je suis très favorable à la loi de 2006 car elle permet au conjoint d'être « mis entre parenthèses » par le procureur de la République pendant un certain temps, temps pendant lequel il pourra réfléchir sur son comportement. Voyant ses enfants dans un cadre médiatisé ou un point rencontre, sous le contrôle d'éducateurs, il devra leur expliquer pourquoi il a frappé leur maman. Parallèlement, un soutien médico-psychologique se met en place. Je pense que c'est mieux pour l'enfant car d'une part, on lui montre, à travers la sanction pénale, qu'il existe des limites à ne pas franchir, et d'autre part on essaie, malgré tout, de maintenir ses liens avec son père – car les enfants doivent se construire avec le père qu'ils ont, même si c'est un père « cogneur ».

Un pédopsychiatre a évoqué devant nous le cas de ces hommes qui réussissent à monter leurs enfants contre leur mère.
C'est pourquoi il ne faut jamais dire à une femme de partir seule : cela se retourne contre elle car le père manipule les enfants. En revanche, une fois que la procédure est lancée, on peut demander un droit de visite médiatisé, afin de maintenir un contact avec le père tout en l'empêchant d'avoir la mainmise sur ses enfants.

Le magistrat a la possibilité d'écarter le conjoint, mais ne pourrions-nous aller plus loin, avec une ordonnance de protection, permettant notamment aux femmes de régler la question de leur logement ?
Ce serait une bonne idée, d'autant que certaines femmes me disent ne pas vouloir rester à leur domicile parce qu'elles y ont vécu des choses terribles. Pour l'instant, le juge aux affaires familiales n'a pas la possibilité de prendre une mesure de cette nature.
Je le connais mal, mais il serait intéressant d'en étudier les résultats.
Par ailleurs, la commission Guinchard, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, a proposé la création d'un pôle famille dans chaque tribunal, le juge aux affaires familiales dont les compétences seraient renforcées bénéficiant, pour prendre la décision la mieux adaptée à la situation, de l'assistance d'une équipe comprenant certes des médiateurs – auxquels, il ne faut jamais renvoyer les violences conjugales –, mais aussi des psychologues et des assistantes sociales.

Ne serait-il pas possible d'inclure dans la loi de 2006 l'obligation pour le policier ou le gendarme qui reçoit la plainte de proposer systématiquement une aide juridictionnelle ?

Généralement, les grands-parents sont aussi victimes de la situation familiale car les petits-enfants comptent beaucoup pour eux, et réciproquement. Quelle est votre approche sur ce point ?
Les situations sont très variables.
Il peut arriver que la mère, qui a obtenu que la résidence des enfants soit à son domicile, ne veuille plus avoir à faire avec la famille de son conjoint et prive ainsi les grands-parents de toute rencontre avec leurs petits-enfants. Après plus de trente ans de pratique professionnelle, je peux dire qu'en expliquant les choses, on arrive progressivement à une solution. Souvent, on peut demander au juge aux affaires familiales d'organiser la visite du père non pas dans un lieu médiatisé, mais chez les grands-parents paternels après une enquête sociale préalable pour connaître leur position sur le comportement de la mère vis-à-vis de leur fils.
Il arrive aussi que des grands-parents se heurtent à leur belle-fille qui refuse de répondre à leurs appels. Ils ont maintenant davantage de possibilités pour obtenir satisfaction – et les juges sont très sensibles à ce type de démarche – mais il faut tout de même prouver l'existence d'un blocage. Nous conseillons aux grands-parents de solliciter, d'abord par simple lettre, puis par lettre recommandée, le droit de voir leurs petits-enfants, en choisissant tel ou tel dimanche, par exemple. En cas de refus ou à de défaut de réponse, nous leur suggérons de saisir le tribunal car il n'y a pas d'autre solution.
Lorsque les grands-parents ont l'intelligence de comprendre qu'ils ne doivent pas se mêler de la vie conjugale de leurs enfants et que les problèmes des adultes ne doivent pas se répercuter sur leurs petits-enfants, il y a beaucoup moins de problèmes. Ce n'est toutefois pas le cas le plus fréquent. Très souvent, il y a le clan de la femme et le clan du mari.
Dans des situations extrêmes, il m'arrive de saisir le juge des enfants – qui sera demain le juge des mineurs – ou le substitut pour lui expliquer que la grand-mère maternelle ou paternelle serait un très bon référent et qu'il faudrait s'appuyer sur elle pour éviter aux enfants d'être dans un conflit de loyauté permanent entre ses parents.

Si je comprends bien, vous préconisez la création par la loi de pôles de la famille avec, au minimum, un magistrat du parquet spécialisé, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales. Cela me paraît être une excellente suggestion.

Dans certains territoires, comme nous l'avait expliqué le vice-procureur d'Albi, les policiers préviennent automatiquement les associations lorsqu'il y a une main courante. Est-ce le cas là où vous exercez ?
Je ne pourrais pas vous répondre sur le plan statistique. Cela dit, mon sentiment est que les mains courantes sont généralement peu suivies d'effet.