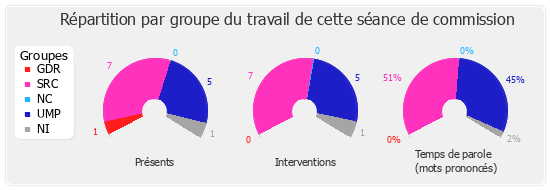Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption
Séance du 22 novembre 2011 à 17h00
La séance
La séance est ouverte à dix-sept heures.
La Commission procède d'abord à l'audition de Mme Catherine Hesse et de M. Pierre Naves, inspecteurs généraux des affaires sociales.

Nous accueillons Mme Catherine Hesse et M. Pierre Naves, qui vont nous présenter le rapport qu'ils ont rédigé en novembre 2009 sur les conditions de la reconnaissance du « délaissement parental » et ses conséquences pour l'enfant, et dans lequel ils soulignent les limites et les lacunes du cadre juridique actuel.
Nous vous remercions de nous avoir invités pour évoquer avec vous la question, très souvent débattue, de la déclaration judiciaire d'abandon. Parmi les importants travaux auxquels elle a donné lieu, je me dois de citer l'excellent rapport du Conseil supérieur de l'adoption paru en 2005 et qui n'a pas pris une ride.
En avril 2009, Mme Nadine Morano, alors secrétaire d'État chargée de la famille, a demandé à l'IGAS d'établir, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à l'adoption, un rapport sur les difficultés pratiques de notre dispositif de protection de l'enfance. Catherine Hesse et moi-même, qui avions travaillé au sein d'un conseil général, connaissions bien le fonctionnement des services, les travailleurs sociaux et les relations entre les conseils généraux et les juges. Nous avons mené une enquête auprès de plusieurs conseils généraux avant de rassembler nos informations et de les traiter. Ce sont ces informations qui sont présentées dans notre rapport, qui contient assez peu de propositions.
Tout d'abord, il n'existait aucune estimation du nombre annuel d'enfants susceptibles de bénéficier de l'article 350 du code civil mais qui n'en bénéficient pas. Dans les faits, nous avons évalué ce chiffre à plusieurs centaines. Ce phénomène n'est donc pas marginal, comparé aux 600 accouchements sous X et aux quelque 250 déclarations judiciaires d'abandon effectives que l'on constatait en 2011.
Il est faux de croire qu'une application plus stricte de l'article 350 du code civil permettrait de répondre à tous les parents en attente d'adoption. Pour autant, nous pourrions doubler le nombre d'enfants bénéficiaires de cet article, à législation constante, en mettant simplement en place un système de veille administrative et en améliorant la fluidité des contacts avec la justice. Je précise que le nombre des déclarations judiciaires d'abandon a baissé entre 2011 et 2007, passant de 248 à 172.
Le faible nombre de déclarations judiciaires d'abandon tient aux réticences des travailleurs sociaux et de leurs responsables. L'article 1er de la loi du 5 mars 2007, qui dispose que « la protection de l'enfance a pour but d'accompagner les familles », est compris comme l'obligation d'aider les parents à assumer leur rôle de parents. Or ce n'est pas toujours possible car il existe des parents incapables d'assumer leur rôle. Souvent, lorsqu'une mesure d'assistance éducative est prononcée, que ce soit à la suite d'une décision administrative ou d'une décision judiciaire, les enfants sont déjà séparés de leurs parents.
Les travailleurs sociaux, les personnels d'encadrement et les juges doivent alors changer à 180 degrés leur posture professionnelle. C'est très difficile, surtout dans les départements qui préfèrent recourir, parmi la gamme des modalités d'intervention, au consentement à l'adoption, tellement plus simple pour les parents.
Il faut naturellement réformer l'article 350 du code civil. Rédigé en 1966, il a fait l'objet de nombreuses modifications depuis, qui ont toutes provoqué des levées de bouclier. Nous avons rencontré les responsables de nombreuses associations. Certes, ces associations font un travail remarquable, mais elles confondent l'article 350 et l'article 375, lequel prévoit des mesures d'assistance éducative, parmi lesquelles les placements judiciaires et qui, selon elles, est trop souvent utilisés.
Vous proposez d'introduire la notion de « délaissement parental », effectivement plus riche de sens. Mais votre rédaction reste centrée sur les carences des parents alors qu'il faudrait la recentrer sur l'intérêt de l'enfant, qu'un certain nombre de termes du droit positif permet désormais d'apprécier.
La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance reposait sur la définition de l'autorité parentale, seule susceptible d'assurer le développement physique, psychique et social de l'enfant, et cette définition est conforme à celle de l'Organisation mondiale de la santé. Il est important d'utiliser des termes modernes, aisément compréhensibles, qui correspondent à des références jurisprudentielles et s'appliquent à tous les parents : c'est le cas de la notion d'« autorité parentale », mais aussi de celle d'assistance éducative, à destination des parents qui ont du mal à éduquer leurs enfants. Il faut reprendre ces termes dans le cadre de la déclaration judiciaire d'abandon.
Le désintérêt « manifeste » des parents est une notion très subjective qui, malheureusement, a toujours été comprise comme un désintérêt « volontaire », notamment par la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette intentionnalité nous place du point de vue des parents, et non du côté de l'enfant et de ce qu'il ressent. Ce n'est plus sa souffrance qui est au centre de l'affaire, mais celle de ses parents. Il s'agit pour nous d'un détournement de sens.
Une évolution jurisprudentielle s'impose. Il faut sortir de ce focus autour de ce que peuvent et veulent faire les parents, et qui est parfois très difficile à interpréter – par exemple lorsque le parent est malade mental. C'est à l'enfant de dire si la situation lui permet de se développer, de mûrir et de s'attacher encore à ses parents. Il faut renverser la logique et passer de la protection des parents à la protection de l'enfant.
Cette idée est révolutionnaire, en ce sens qu'elle nous ramène au point de départ. Depuis de nombreuses années, la protection de l'enfance n'a pour but que de donner aux parents les moyens d'élever leurs enfants, sur le plan tant financier que psychologique – ce que nous appelons aujourd'hui « accompagnement ». Les travailleurs sociaux et les services d'aide à l'enfance n'ont pour objectif que de permettre aux parents en difficulté de devenir de bons parents.
Pendant ce temps-là, les enfants grandissent dans des familles d'accueil, qui peuvent être stables – au moins jusqu'à l'adolescence. C'est une course contre la montre qui s'engage. Faute d'éclaircir rapidement leur situation, les enfants s'installent dans une famille. Celle-ci s'attache à eux, et après quelques années il est trop tard pour déplacer les enfants.
Les travailleurs sociaux constatent que les enfants ainsi placés se développent dans de bonnes conditions, même si leurs parents biologiques, qui restent présents dans le paysage, ne leur rendent jamais visite.
Ce tripode peut tenir debout plusieurs années, mais ne nous leurrons pas : il arrive que la situation se dégrade au sein de la famille d'accueil, souvent lorsque l'enfant atteint douze ou treize ans. Ces problèmes peuvent provoquer une rupture et l'enfant se retrouve alors sans famille. Si aucune mesure n'a été prise, on est prisonnier d'une situation sans qu'aucune volonté n'ait été exprimée de part et d'autre. D'ailleurs, dans la plupart des cas, la famille d'accueil ne cherche pas à adopter l'enfant. Quelques enfants atteignent la majorité dans de bonnes conditions, mais d'autres se retrouvent totalement seuls à douze ou quinze ans. Ce n'est pas un hasard si 30 % des jeunes sans domicile fixe sont issus de ce circuit.
Le temps de l'enfant n'est pas celui des adultes : il passe très vite et il n'est parfois plus possible de revenir en arrière. C'est une réalité que les services de l'aide sociale à l'enfance, mais également la justice, ont beaucoup de mal à admettre.
La traduction de « manifeste » par « volontaire » a été actée par la Cour de cassation. Certains parquets se retrouvent dans des situations ubuesques : le conseil général présente une requête ; le tribunal, ne pouvant statuer que si les parties sont informées, convoque les parents ; si aucun des deux ne se présente, on les recherche, et les mois passent…
Le 28 octobre 2008, le ministère de la justice, estimant nécessaire de revoir cette disposition, a publié une circulaire relative à l'amélioration des conditions de mise en oeuvre de l'article 350. Mais les procureurs que nous avons interrogés nous ont dit ne pas en avoir eu connaissance. Nous avions nous-mêmes appris l'existence de cette circulaire en lisant les débats parlementaires car Mme Nadine Morano l'avait citée dans l'une de ses interventions au Sénat.
Cette circulaire enjoint aux juges d'examiner les demandes de déclaration judiciaire d'abandon dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête auprès du parquet.
Lorsque je travaillais au sein d'un conseil général, j'ai pu constater à quel point il était difficile de tenir les finances du département. C'est malheureusement de plus en plus vrai.
Faisons un rapide calcul : lorsque nous finançons les mesures d'assistance éducative pour 200 enfants pris en charge chaque année au titre de l'article 375 jusqu'à l'âge de vingt ans. Cela représente 4 000 enfants « en stock », si je puis dire !
Bien que nous soyons des personnels administratifs, nous avons fort heureusement, Catherine Hesse et moi-même, quelques compétences en psychologie. Nous savons donc que certaines femmes ont pu ressentir, à un moment donné, un désir d'enfant, mais qu'elles ne retrouvent pas ce désir lorsqu'elles sont en présence de l'enfant. Leur cas nous entraîne dans un processus pour le moins surprenant. Étant entendu qu'un enfant doit être déclaré sous trois jours, que font les personnels de la maternité si les services du conseil général ne sont pas venus reconnaître que l'enfant était né dans le cadre du secret ? Ils lui donnent le nom de sa mère puisque c'est le seul qu'ils connaissent. Et ce dispositif oblige les femmes à être mères alors qu'elles n'en ont pas la capacité. Cela provoque des situations dramatiques. Nous ne sommes plus au XIXe siècle : dans le monde de protection et de prise en charge qui est le nôtre, ces femmes se retrouvent liées à un enfant dont on leur dit qu'elles sont la mère mais dont elles ne veulent pas.
Mais je m'emporte tant le sujet me passionne…
Pour conclure, permettez-moi de vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup choqué. Au cours de l'un de nos voyages, nous avons rencontré un psychiatre qui nous a dit se féliciter du dispositif juridique qui permet aux femmes malades de rencontrer leur enfant quand elles le souhaitent, même si c'est une fois par semestre… Dans quel monde vivons-nous ?
Mme Michèle Tabarot, rapporteure, remplace M. Jean-Marc Roubaud à la présidence de la séance

Nous ne pouvons vous en vouloir d'être passionné. Permettez-moi de vous féliciter pour le travail que vous avez accompli, et qui a inspiré le Conseil supérieur de l'adoption.
Comment expliquez-vous la frilosité des travailleurs sociaux et des magistrats ?
Vous proposez de modifier la rédaction de l'article 350 du code civil en nous plaçant du côté de l'enfant. Comment rédiger en ce sens notre proposition de loi ?

J'ai présidé l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). Votre rapport, ainsi que celui de l'Académie de médecine, fait apparaître que le chiffre des enfants relevant de l'article 350 est en diminution. Mais, si nous y ajoutons les délégations d'autorité parentale et les mises sous tutelle, nous obtenons un total constant. Cette situation m'interpelle. Comment un tel glissement peut-il perdurer depuis une vingtaine d'années sans que personne ne l'ait jamais évoqué, compris et mesuré ? Votre réponse nous permettra certainement de comprendre les pratiques des professionnels. Quoi qu'il en soit, modifier la loi ne sert à rien si ces pratiques n'évoluent pas.
La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance, qui a été votée quasiment à l'unanimité, répond parfaitement aux préconisations de votre rapport. Elle contient les outils nécessaires, en particulier le projet individuel pour chaque enfant. Pour autant, quelque cinq ans plus tard, peu de choses ont changé dans le domaine de l'adoption, en particulier en matière de prise en compte de l'intérêt de l'enfant.
Dans le domaine de la protection de l'enfance, comme dans bien d'autres, nous manquons d'outils d'évaluation. Comment expliquez-vous cette lacune ? Nous reprochons aux professionnels leur attitude face aux décisions difficiles, mais nous les laissons seuls face à ces décisions. Faisons en sorte qu'elles deviennent celles de l'institution tout entière !

Le Gouvernement et le législateur ne peuvent se délester sur la frilosité des travailleurs sociaux ou des magistrats, qui n'ont pas les outils nécessaires pour prendre les décisions les plus justes. C'est à nous de leur donner ces outils. Dans une société de plus en plus procédurière et judiciarisée, il est normal que les travailleurs sociaux cherchent à se garantir.
En 2010, dans mon département, la Haute-Vienne, 29 enfants ont été confiés à l'adoption, dont 22 d'origine étrangère, et 10 enfants sont devenus pupilles de l'État, dont 9 à la suite d'un accouchement secret, le dernier étant un enfant trouvé. Mais seul un enfant a été confié dans le cadre de l'article 350 du code civil.
J'attire votre attention sur un point : la loi du 5 mars 2007 a redonné toute leur place aux parents, mais les enfants confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) sont plus âgés qu'auparavant. Or l'adoption d'enfants âgés se solde souvent par un échec, et il n'y a pas pire drame pour un enfant adopté que de revenir ensuite dans les services de l'ASE. Comment prévenir un tel risque ?

Je souscris aux propos de ma collègue Patricia Adam. Notre vision commune des problèmes s'explique certainement par l'important travail que nous avons accompli ensemble sur la protection de l'enfance.
Lorsque nous avons examiné la dernière loi relative à l'adoption, en 2005, j'ai déposé un amendement qui a modifié l'article 350 en supprimant l'exception à la mise en oeuvre de la procédure d'abandon résultant de la grande détresse des parents, qui interdisait à certains enfants de devenir pupille de l'État. En effet, nous savons bien que les parents dits « en grande détresse » sont dans l'incapacité de prendre en charge un enfant. J'espérais que cela permettrait ainsi l'adoption d'un certain nombre d'enfants. Quelle est, selon vous, la proportion des enfants ayant bénéficié de cette modification législative ?
Les travailleurs sociaux ne sont pas frileux : ils ne font qu'appliquer un dogme, qui est contenu dans les textes, y compris la loi de 2007, selon lequel la protection de l'enfance passe « nécessairement » par le soutien aux parents. Ce « nécessairement » est de trop. C'est un phénomène culturel. Dans notre pays, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant ne parvient pas à se diffuser. Nous sommes encore dans la protection – qu'on appelle aussi soutien ou accompagnement – des adultes. Or, lorsque des adultes et des enfants se font face devant les magistrats ou les travailleurs sociaux, seuls les adultes s'expriment, naturellement pour défendre leurs propres intérêts. Les enfants de trois ou quatre ans ne sont pas présents. Il arrive que des parents assiègent le bureau du magistrat pour que leur enfant passe Noël près d'eux. Je plains le magistrat à qui il incombe de leur opposer un refus, car c'est une décision violente. Et l'enfant n'est pas là pour dire qu'il préfère passer Noël ailleurs qu'avec ses parents. Les magistrats sont confrontés à de véritables rapports de force.
Il convient sans doute de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est désormais inscrit dans le droit français et dans le droit international, peut exiger des mesures qui peuvent paraître violentes à l'encontre des parents qui ne sont pas en mesure d'assumer leur rôle.
Il est cependant difficile de stigmatiser des personnes qui connaissent des difficultés physiques ou psychologiques, sans parler des difficultés financières, même s'il est vrai que les personnes qui se trouvent dans la misère matérielle bénéficient d'un certain nombre d'aides. Il est cependant vrai que la misère psychologique conduit souvent à la misère matérielle.
Il n'est pas simple de résister à cette culture, mais tentons au moins de cibler les enfants très jeunes. Le projet de vie de l'enfant ne peut pas adopter le temps de l'adulte car il exige parfois d'aller plus vite. Quelques départements ont réussi à faire accepter cette idée et, à l'étranger, il faut citer l'exemple du Québec, qui a mis en place des indicateurs.
En 2002, M. Christian Jacob, alors ministre de la famille, avait mis en place un groupe de travail sur la protection de l'enfance, que j'ai moi-même présidé. Nos travaux ont abouti à la création de l'ONED et à la mise en place du « projet de vie de l'enfant ». Nous y abordions la question difficile de l'article 350. De notre réflexion est née la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance.
Les travailleurs sociaux doivent changer d'état d'esprit. S'ils hésitent à engager la procédure de l'article 350, c'est qu'ils craignent qu'elle ne débouche sur un échec. La délégation d'autorité parentale et la mise sous tutelle sont des procédures plus simples, qui, en outre, ne remettent pas en cause l'autorité parentale.
Plusieurs départements disposent d'outils d'évaluation. Rien ne s'oppose à ce que nous les mettions au point au plan national, mais il serait très difficile de trouver un consensus pour les généraliser. Si nous voulons que les travailleurs sociaux s'approprient ces outils, ils doivent être définis au niveau départemental. Dans un département de la région parisienne, le nombre des enfants relevant de l'article 350 est différent d'une unité territoriale à l'autre : il dépend de la façon dont les travailleurs sociaux comprennent et appliquent le référentiel. Les nombreux départements qui nous ont renvoyé le questionnaire ont reconnu que celui-ci les avait obligés à s'interroger sur leurs pratiques. Il appartient à la loi de tracer les grandes lignes de ce référentiel.
Je m'étonne, madame la députée, que le département de la Haute-Vienne ne compte qu'un seul cas relevant de l'article 350…
Madame la Présidente, j'ai pu constater lors de l'élaboration de la loi de 2007 à quel point les termes de la loi pouvaient être « subtils ». Vous pouvez modifier la rédaction de l'article 350 à la marge ou bien le transformer en profondeur, en mentionnant l'enfant avant les parents.

La suppression de la notion de grande détresse des parents a permis d'augmenter le nombre des adoptions. Je tiens toutefois à préciser que la grande détresse ne s'applique pas à la situation sociale des personnes. Il ne s'agit pas de juger les familles sur leur pauvreté ou leurs difficultés psychologiques. La grande détresse concerne les familles en situation de dérive totale, connaissant des problèmes psychiatriques ou une incarcération, par exemple, mais les juges restent maîtres de leur appréciation.
Je vous citerai une phrase qui nous a beaucoup frappés lorsque nous avons reçu les réponses aux questionnaires. À la question : « Seriez-vous d'accord pour dire que l'autorité parentale prévaut sur l'intérêt de l'enfant ? », les personnes interrogées, qu'il s'agisse de magistrats ou de responsables de service, ont toutes répondu par l'affirmative. Le consensus est quasiment conscient.

C'est pourtant l'opposé de ce que dit la loi !
La proposition de loi parle de « délaissement », terme qui rejoint le concept d'attachement. Mais ce mot n'est pas écrit. Le concept d'attachement n'est pas reconnu et beaucoup de professionnels le contestent – les travailleurs sociaux, les psychiatres comme les médecins, et sans doute les juges. Peut-on, selon vous, faire accepter ce concept ? Doit-on légiférer pour cela ? Au Québec, par exemple, l'adoption, comme l'ensemble de la protection de l'enfance, est basée sur ce concept.
J'ai observé dans de nombreux départements que les services en charge de l'adoption, quand ils existent, sont totalement dissociés des autres services de la protection de l'enfance. Ils ne sont pas consultés pour les cas qui pourraient nécessiter l'application de l'article 350. Pourtant, ils connaissent bien les conditions nécessaires pour réussir une adoption, notamment la préparation des familles adoptantes et des enfants. Cette préparation existe dans le cadre des adoptions internationales, mais pas pour les adoptions en France. Or les échecs, en matière d'adoption, sont bien souvent dus à un manque de préparation.

L'adoption est souvent traitée sous un angle technique et administratif, au détriment de l'enfant. Prendre en compte la notion d'attachement permettrait d'éviter l'échec à des enfants qui ont déjà été abandonnés.
Un enfant en âge de comprendre peut-il refuser d'être adopté par telle ou telle famille ?
La loi de 2007 rappelle que toute décision concernant un enfant doit être prise en accord avec lui. Je n'imagine pas qu'un juge puisse prononcer une adoption contre l'avis de l'enfant, ni les services envoyer un enfant et sa famille au casse-pipe…
Je me suis intéressé à la loi sur la protection de la jeunesse votée au Québec en 2006. Les Québécois sont très en avance par rapport à nous. Par exemple, ils actualisent régulièrement leur référentiel.
Je ne sais pas quelle serait la réaction des professionnels si le législateur utilisait le terme d' « attachement », d'autant que, si l'on peut constater le développement de l'enfant sur les plans physique, psychique et social, il est plus difficile d'évaluer son « attachement ».
Si les professionnels sont amenés à faire une révolution culturelle – ce qui serait dans la logique de la loi de 2007 – nous préconisons d'organiser une conférence de consensus afin qu'ils puissent s'exprimer.
L'IGAS, qui a étudié une trentaine de services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, peut témoigner de leur logique organisationnelle. La protection de l'enfance est une responsabilité très lourde pour les présidents de conseil général, qui englobe l'encadrement des familles d'accueil, la délivrance de l'agrément, la gestion des établissements d'accueil des enfants et diverses actions sociales. La cellule en charge de l'adoption, qui devrait être un service de ressources susceptible d'aider les directeurs de service à prendre leurs décisions, administratives ou judiciaires, n'est pas placée au coeur du dispositif.

La notion d'attachement n'est pas floue. La loi de 2007 la prend en compte à travers le projet de vie et la possibilité de prolonger les placements. Nous reconnaissons que l'attachement d'un enfant à son milieu et aux personnes qui l'éduquent est fondamental pour son développement personnel. Pourquoi ne pourrions-nous pas, à l'instar des Québécois, l'intégrer dans la loi française ?
Pourquoi l'autorité parentale prévaut-elle toujours sur l'intérêt de l'enfant ? Pourquoi ne recourons-nous pas davantage à l'avocat de l'enfant, dont la loi de 2007 impose la présence ? Pourquoi les avocats ne sont-ils pas mieux formés pour assister les enfants ? Pourquoi ne sont-ils pas systématiquement sollicités pour assister les enfants en cas de litige, comme cela se passe au Québec, où même le bébé est défendu par un avocat ? Dans notre pays, l'enfant n'est pas défendu comme une personne : il reste un objet.
Je m'interroge depuis longtemps sur la notion d'autorité parentale, qui renvoie à un paternalisme datant du XIXe siècle, à un pater familias qui décide de ce qui est bien pour son enfant. Au nom de l'autorité, on peut enfermer un enfant dans un placard ou l'attacher sur la cuvette des WC. Pourquoi ne pas substituer à cette notion celle de responsabilité parentale, qui exclut de telles pratiques et qui permettrait de clarifier la place de l'enfant ?
Pourquoi n'avons-nous toujours pas de référentiels, alors que nous en débattions déjà en 2007 ? Ces référentiels doivent-ils être départementaux ? La politique de protection de l'enfance est, certes, départementale, mais les compétences sont définies par la loi. Les référentiels devraient donc être annexés à la loi.
Quant aux travailleurs sociaux, qu'ils soient satisfaits ou non de la loi, ils ont pour mission de l'appliquer. Nous préoccuper de leurs états d'âme va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. La situation me paraît totalement surréaliste !
Si nous voulons que les travailleurs sociaux appliquent la loi, il faut les y former. Or j'ai le sentiment qu'on leur inculque encore un concept d'une autre époque, qui privilégie l'autorité parentale et le lien familial au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le lien familial est extrêmement important, certes, mais s'il est défaillant et que les parents sont pathogènes, il faut savoir le rompre !
En matière de protection de l'enfance, deux principes doivent être privilégiés : l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de précaution. Et ces principes doivent s'appliquer aux enfants qui sont confiés à l'ASE comme à ceux qui sont adoptés. Nous appliquons le principe de précaution à la protection des oiseaux, des forêts et des bêtes sauvages, mais nous ne sommes pas capables de l'appliquer à nos enfants. C'est pour moi une grave défaillance.
Je vais vous faire une révélation brutale : les travailleurs sociaux ne sont pas formés à l'application de la loi mais à celle de leur éthique, qui structure leur pensée et leur mode de fonctionnement. Cela doit changer. L'organisation d'une conférence de consensus, au sein de laquelle la justice aurait toute sa place, serait un électrochoc qui permettrait aux travailleurs sociaux de changer d'éthique et d'intégrer la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Le rapport Colombani préconisait déjà la mise en place d'une conférence de consensus. Il faut engager un grand débat national pour que tous intègrent ces nouveaux concepts, y compris celui de responsabilité. L'ASE a changé d'optique lors de la parution du rapport Bianco-Lamy.
Je le répète, seule une conférence de consensus permettrait de faire évoluer ce dispositif complexe, qui engage plusieurs niveaux de responsabilité et suspend l'avenir de l'enfant à la décision d'une seule personne.
En matière d'organisation des services, on ne peut comparer les départements importants, qui gèrent cinquante adoptions par an, et ceux qui ne traitent que deux cas par an. Certaines fonctions pourraient être mutualisées entre plusieurs départements. La préparation des adoptants et des enfants ne doit pas être confiée à un service qui a de nombreuses missions, et tous les départements ne peuvent être dotés d'un service réduit de l'adoption.
Il faut une volonté politique et administrative forte pour rendre toute sa place au service chargé de l'adoption. Lorsque je travaillais dans un conseil général, je demandais tous les trois mois la liste des enfants de moins de deux ans dont s'occupait notre service. Nous sommes ainsi passés de deux applications de l'article 350 à quatre.
S'investir est la seule façon de faire bouger les choses.
La Commission spéciale procède ensuite à l'audition de M. Jean-Marie Mantz, professeur, membre de l'Académie nationale de médecine.

Monsieur le professeur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose d'évoquer le rapport que vous avez rédigé avec le docteur Aline Marcelli et le professeur Francis Wattel sur le thème « Faciliter l'adoption nationale », qui traite de l'enfance en danger et des enfants maltraités et délaissés, et pointe les imperfections du dispositif administratif et judiciaire actuellement en vigueur.
J'ai en effet présenté, le 12 février dernier, à l'Académie nationale de médecine, au nom d'un groupe de travail dont faisait partie le professeur Wattel, ici présent, un rapport sur le thème « Faciliter l'adoption nationale ».
Alors que l'adoption internationale a quadruplé au cours des vingt dernières années et concerne aujourd'hui près de 4 000 enfants par an, l'adoption nationale a diminué de moitié pendant la même période. Le nombre d'enfants adoptés dans notre pays se situe autour de 700 par an. Parmi eux, une centaine seulement sont des enfants dits en danger, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une mesure officielle de protection judiciaire ou administrative. Les autres sont des orphelins, des enfants abandonnés ou nés sous X.
Pourtant, le nombre d'enfants en danger ne diminue pas dans notre pays : il est actuellement d'environ 300 000. L'adoption n'est évidemment pas la solution pour tous ces enfants, mais la disproportion est flagrante.
Autre constat : de 25 000 à 30 000 familles agréées attendent, souvent depuis plusieurs années, qu'on leur confie un enfant. Le schéma que nous présentons dans notre rapport permet de suivre l'itinéraire d'un enfant en danger. Il montre la multiplicité des instances concernées – commissions, cellules, navettes –, laquelle explique la lenteur du processus d'adoption, qui aboutit au bout de cinq à six ans en moyenne. L'enfant entre alors, du fait de son âge, dans la catégorie des enfants dits « à particularité », qui ont peu de chances d'être adoptés.
Deux situations – la maltraitance et le désintérêt parental – ont retenu notre attention en raison de leur fréquence et de leur gravité.
Je m'arrêterai un instant sur la maltraitance, qui n'est pas un épiphénomène anecdotique ou un fait divers. Entre 19 000 et 20 000 enfants maltraités sont recensés chaque année en France, et ce chiffre est probablement bien inférieur à la réalité car de nombreux enfants sont savamment torturés dans la clandestinité, sans défense et sans témoin – qu'il s'agisse de sévices physiques ou psychologiques, ou encore, depuis quelques années, sexuels. Une difficulté majeure tient à la capacité de dissimulation et à la perversité des parents maltraitants, qui présentent des troubles profonds de la personnalité sous une apparence de normalité. Les médecins, eux, s'abritent trop souvent derrière l'article 4 du code de déontologie médicale, qui prône le respect absolu du secret médical. En conséquence, 3 % seulement des signalements émanent des médecins.
Que deviennent ces enfants maltraités ? Les médias décrivent le drame et font pleurer Margot le soir dans les chaumières, mais ne renseignent nullement sur le devenir des enfants concernés, quand ils survivent.
Le retrait des droits parentaux, qui permet à l'enfant d'être adopté, d'oublier et de repartir, est très rarement prononcé en France, contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni, au Canada et en Italie. En général, un placement provisoire est suivi du retour et du maintien de l'enfant dans sa famille d'origine sous AEMO (action éducative en milieu ouvert) judiciaire. Il sert alors de matériel de travaux pratiques et de tests à la rééducation des parents. En général, les sévices reprennent en changeant de forme.
Une modification de la loi s'impose, et il y a urgence ! Comme le dit le député Alain Suguenot, cosignataire de la proposition de loi visant à faciliter et améliorer la procédure d'adoption, il nous est permis d'espérer.
Le désintérêt parental concerne les enfants placés en institution ou en famille d'accueil. D'après la loi du 22 décembre 1976, sont considérés comme s'étant désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
Selon les termes de l'article 350 du code civil, le désintérêt avéré des parents pendant au moins un an justifie, de la part du président du conseil général, une demande de déclaration judiciaire d'abandon adressée au président du tribunal de grande instance. L'enfant sera alors admis comme pupille de l'État, statut qui le rend adoptable. Bien entendu, cet article ne s'applique pas aux cas de désintérêt dit involontaire, lié à l'incapacité physique ou à l'incarcération des parents. Or, le nombre d'enfants déclarés pupilles de l'État après déclaration judiciaire d'abandon a diminué de 70 % au cours des vingt dernières années : on lui préfère la délégation de l'autorité parentale, qui place l'enfant sous tutelle de l'État, même si ce statut est beaucoup moins protecteur.
Que deviennent les enfants placés ? Ils sont exposés à l'inégale qualité des familles d'accueil, à la multiplicité des changements, à la rigidité administrative. Et le temps passe. La tutelle cesse à la majorité de l'enfant, qui se retrouve, à dix-huit ans, seul, souvent sans diplôme et sans emploi. On sait que 30 % des sans domicile fixe sont d'anciens enfants placés.
L'adoption est à l'évidence une solution plus satisfaisante. On objecte que l'enfant délaissé reste habituellement attaché à ses parents – ce serait une forme clinique du syndrome de Stockholm. En pareil cas, l'adoption simple, qui transfère l'autorité parentale au parent adoptif, tout en conservant des liens avec la famille d'origine, semble répondre à cette objection. Encore faudrait-il que l'adoption simple soit, à l'instar de l'adoption plénière, déclarée irrévocable.
En ce qui concerne la proposition de loi sur le délaissement parental, soumise à votre commission, on ne peut qu'approuver sans réserve son objectif : améliorer l'adoption en réaffirmant son rôle central en matière de protection de l'enfance. Mais il est surprenant de ne pas y trouver mention de la nécessité d'accélérer les procédures de demande de déclaration judiciaire d'abandon, au lieu d'attendre une hypothétique métamorphose des parents, tandis que l'enfant est en souffrance. Quant au recours aux visites obligatoires médiatisées, il peut masquer la réalité du délaissement parental et retarder d'autant la déclaration d'abandon.
De même, à l'article 2 de la proposition de loi, le rapport sur la situation de l'enfant placé, élaboré au terme des six premiers mois, ne devrait pas concerner uniquement les enfants de moins de deux ans mais être étendu à tous les enfants car c'est en effet l'éducateur qui suit l'enfant qui dispose de la connaissance attentive et approfondie de la situation.
Je souscris par contre à la disposition de l'article 1er concernant la modification de l'article 350 du code civil, qui substituerait à la notion floue de « désintérêt parental » celle, plus claire, de « délaissement » – en espérant que le référentiel soit rapidement rédigé.
Je souscris également aux modifications prévues par l'article 3 concernant l'agrément des familles candidates à l'adoption, ainsi qu'à la proposition, à l'article 4, d'une expérience pilote concernant l'information et la préparation des candidats à l'agrément. Mais j'aimerais que soit étudiée la création d'une filière de familles candidates bénévoles, parallèlement à la filière rémunérée, comme c'est le cas en Suède.
J'adhère enfin à l'article 5, qui propose de rendre irrévocable l'adoption simple, à l'instar de l'adoption plénière. Cette mesure soulignerait le caractère généreux de l'adoption et lui rendrait sa véritable signification : donner une famille à un enfant, et non l'inverse.
Mme Henriette Martinez, secrétaire de la commission spéciale, remplace Mme Michèle Tabarot à la présidence de la séance.

Monsieur le professeur, je vous remercie. Vous avez rappelé que seuls 3 % des signalements sont le fait des médecins. La raison en est-elle la méconnaissance d'une obligation légale, ou la peur des sanctions, notamment de la part de leur juridiction ordinale ?
Tout d'abord, le diagnostic de sévices n'est pas toujours facile. Il peut l'être si l'on est en présence d'hématomes multiples, de fractures ou de traumatismes, mais ce n'est pas le cas lorsque la symptomatologie est commune à certaines maladies rares comme la maladie de Lobstein, la maladie des os fragiles, ou le syndrome de Marfan. Toutefois la principale difficulté tient à l'attitude des parents, qui est probablement irréversible car on ne modifie pas les mentalités des gens. C'est pour cette raison que les médecins font peu de déclarations, mais aussi parce qu'ils suivent à la lettre les recommandations du conseil de l'ordre : l'article 4 du code de déontologie médicale prône le respect absolu du secret médical.
Non, encore que… Il existe des dérogations à la règle déontologique du secret médical, par exemple l'article 226-14 du code pénal, qui préconise la déclaration des sévices à l'autorité compétente mais précise qu'il ne s'agit pas d'une délation. Ne pas déclarer, c'est enfreindre l'obligation d'assistance à personne en péril. L'article R. 4127-44 du code de la santé publique, ancien article 44 du code de déontologie médicale, précise que les personnes ayant connaissance de maltraitances doivent en informer l'autorité responsable, sauf situation particulière laissée à l'appréciation du médecin, exception qui ôte tout sens à cet article.
Je me dois de vous dire en outre que, pour les médecins, les malades et leurs familles sont des « clients ». Le Conseil de l'ordre a récemment précisé que la déclaration des sévices était obligatoire, mais c'était au cours d'une réunion interne et le principe n'en est pas encore inscrit dans le code de déontologie.

Non seulement l'article 226-14 du code pénal, que j'avais modifié par voie d'amendement avec Patricia Adam, crée l'obligation de signalement, mais nous avons depuis introduit dans la loi le secret professionnel partagé, qui rend le signalement obligatoire, ainsi que la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. J'ai du mal à comprendre pourquoi le Conseil de l'ordre édicte ses propres règles.
S'agissant d'un sujet aussi important que la protection de l'enfance, le principe de précaution devrait prévaloir !
L'article auquel vous faites allusion est une recommandation à l'adresse des médecins, pas une obligation.

Ce n'est pas ainsi que l'interprète le ministère de la justice, que j'ai longuement interrogé sur ce point.
Je ne suis pas certain que les médecins en soient informés.

Une harmonisation des points de vue entre le législateur et le Conseil de l'ordre est nécessaire.

La loi est relativement claire, mais elle n'est appliquée ni par les médecins, ni par les juges, ni par les travailleurs sociaux.
Le problème vient de ce que la protection de l'enfance n'est pas un sujet médiatique, sauf lorsque se produit un scandale dont les médias se saisissent pour un temps très bref. Il s'agit toujours d'enfants qui ne peuvent s'exprimer et de familles pour qui il est très difficile de s'exprimer. Les enfants, bien que la loi le prévoie, ne sont pas représentés par un avocat, car les professionnels s'y refusent.
Dans d'autres domaines de la médecine, la non-application de la loi se traduirait devant les tribunaux car les patients porteraient plainte.
En matière de protection de l'enfance, le patient n'existe pas puisqu'il n'a pas le droit à la parole. Il faudra qu'un jour des associations courageuses portent plainte contre les médecins pour non-respect de la loi. C'est en tout cas le conseil que nous leur donnerons. De notre côté, en tant que législateurs, nous avons écrit la loi. Nous l'avons votée, mais elle n'est pas appliquée.
Je souscris pleinement à vos propos : c'est vrai, l'enfant n'est pas représenté. Nous avons eu une défenseure des enfants, mais son poste a été supprimé. L'enfant ne parle pas. Il défend ses parents, en tout cas il ne les accuse pas, même s'ils sont maltraitants. Mais il dessine. Les dessins représentant sa famille sont très significatifs de la souffrance d'un enfant.
Il est possible qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à porter plainte contre les médecins pour qu'ils changent leurs habitudes.
Je reconnais que beaucoup de médecins ne connaissent pas la loi. Mais je note également qu'au cours de leur formation, les juges n'ont aucun contact avec le terrain. Or il est très différent de rencontrer un enfant dans le cadre d'une réunion obligatoire médiatisée et de le rencontrer au cours de la période aiguë, couvert de bleus, et de soutenir son regard interrogateur. Je suggère qu'au cours de leur formation, les juges assistent à l'autopsie d'un enfant décédé à la suite de maltraitances.

En tant que conseiller général du département du Nord, je fais partie du conseil départemental de l'adoption. Accueillir un enfant nécessite des mois, voire des années, et les démarches administratives sont un filtre nécessaire.
La création d'une filière de familles d'accueil bénévoles choisies parmi les familles agréées est une idée généreuse, mais difficile à mettre en place. Quelles pistes pouvez-vous nous suggérer pour faire évoluer en ce sens la loi et les institutions ?
Quel regard portez-vous sur la problématique des violences faites aux femmes, dont les enfants sont souvent les victimes, directes ou indirectes ?
Les enfants sont souvent témoins des violences conjugales. Un médecin radiologue imagier a récemment montré que les enfants qui assistent aux violences intrafamiliales, en particulier conjugales, présentent des lésions de la substance blanche de leur cerveau. De la taille d'une pièce de monnaie, ces lésions disparaissant dès lors que ces enfants sont soustraits à leur famille. Que ne peut-on craindre pour les enfants qui, non seulement assistent à ces violences, mais les subissent eux-mêmes ?
En ce qui concerne la filière de familles bénévoles, je vous suggère de vous inspirer du modèle suédois, qui semble donner satisfaction aux uns et aux autres. Sachant que certaines familles rémunérées sont maltraitantes, une filière bénévole aurait l'avantage de montrer la générosité des parents adoptifs et de rendre à l'adoption sa véritable signification.

Nous sommes tous d'accord pour privilégier le droit de l'enfant sur le droit à l'enfant. Mais que pensez-vous de la pratique, encore en vigueur dans certains départements, qui consiste à retirer un enfant à sa famille d'accueil au motif qu'il lui est trop attaché ?
Cela me scandalise, d'autant plus que l'enfant est souvent arraché à sa famille d'accueil du jour au lendemain. C'est d'autant plus ridicule que certaines familles d'accueil peuvent devenir des familles adoptives.

Pour l'enfant, la construction de sa personnalité et son parcours de vie, l'attachement réciproque est plus un avantage qu'un handicap. Nous ne comprenons pas ces pratiques, qui ne devraient plus exister depuis la loi de 2007.
La solution réside dans l'adoption simple, qui maintient des liens avec la famille d'origine. Encore faut-il éviter qu'à l'adolescence la famille d'origine fasse irruption dans la famille d'accueil et bouleverse la situation. Mais l'irrévocabilité de l'adoption simple répondrait à cette objection.
Seul le référentiel permettra d'évaluer le délaissement parental. Il sera difficile d'en aborder tous les aspects. Cela dit, quelques expériences ont été menées. Il était déjà question d'un référentiel en 2008 dans la réforme de l'adoption présentée par Mmes Nadine Morano et Rama Yade.

C'était un souhait. Quelques départements ont effectivement élaboré un référentiel, mais ce n'est pas une règle nationale.
Il faudrait vous inspirer des expériences menées dans certains départements et dans d'autres pays.

Un enfant victime de violences risque, lorsqu'il est adulte, de reproduire ce qu'il a subi. Le suivi de l'enfant ne doit-il pas être plus opérationnel ?
Les enfants maltraités deviennent souvent des parents maltraitants. Pour y remédier, il faudrait suivre de très près le devenir de ces enfants, au lieu de les laisser dans la nature, et améliorer le dépistage systématique de la maltraitance, qui est actuellement très négligé.

Je vous remercie, Monsieur le professeur, de nous avoir accordé cette audition. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt.
La séance est levée à dix-neuf heures.