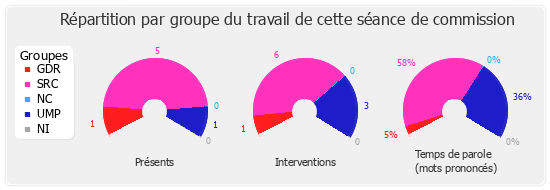Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
Séance du 17 mars 2009 à 16h00
La séance
La mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a auditionné . Paul Durning, directeur de l'Observatoire national de l'enfance en danger, l'ONED, Mme Anne Oui, chargée de mission protection de l'enfance, et Mme Nadège Severac, chargée d'études.

Nous avons le plaisir d'accueillir M. Paul Durning, directeur de l'Observatoire national de l'enfance en danger, l'ONED, Mme Anne Oui, chargée de mission protection de l'enfance, et Mme Nadège Severac, chargée d'études.
L'ONED a été créé par la loi du 2 janvier 2004 avec pour mission de mieux connaître le champ de l'enfance en danger afin d'en améliorer la prise en charge.
Les enfants sont aussi des victimes indirectes de la violence faites à leur mère. Or dans le guide sur les enfants exposés aux violences conjugales, élaboré par l'ONED et le Service des droits des femmes et de l'égalité, le SDFE, on peut lire que « L'action des pouvoirs publics n'a pas spécifiquement traité cette problématique du fait notamment d'un cloisonnement des approches et d'une méconnaissance du phénomène. »
Pouvez-vous nous préciser les pistes que vous avez étudiées pour remédier à cette situation ? Cette question est extrêmement sensible et nous souhaitons lui donner une place importante dans notre travail.
Les questions des violences faites aux femmes et de l'enfance maltraitée ont émergé selon une chronologie sensiblement identique, même si l'analyse de leur interaction est très récente.
Le sujet de l'enfance maltraitée apparaît aux États-Unis dans les années soixante-dix. Le premier ouvrage français est publié en 1982. Les abus sexuels envers les enfants sont « découverts », si j'ose dire, en 1984, grâce à l'impact du congrès de Montréal. En 1985 et 1986, la médiatisation est forte.
En 1989, les deux thématiques se rejoignent : une loi relative à la protection des enfants maltraités est votée et la France ratifie la Convention internationale des droits de l'enfant ; dans le même temps une première campagne nationale de lutte contre la violence conjugale est organisée, à l'initiative de Mme Michèle André, secrétaire d'État aux droits des femmes, et les commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes sont instituées.
Ceux que l'on appelait les « enfants témoins » sont évoqués à notre connaissance pour la première fois comme victimes de maltraitance en 1996, avec la publication d'un ouvrage sur les violences psychologiques. Les violences psychologiques ont fait l'objet d'une conférence de consensus très importante aux États-Unis, en 1983, avec une première définition, à laquelle ont succédé deux autres. Cette approche a traversé l'Atlantique en passant par le Québec, où les premières recherches ont été traduites en français. La question de la typologie des violences psychologiques s'est très vite posée. Six ou sept formes ont été identifiées.
En quelque sorte, la problématique des violences psychologiques fait le lien entre violences faites aux enfants et violences faites aux femmes.
L'ONED est clairement centré sur les enfants ; nous interviendrons donc de ce point de vue.
Nous avons développé des activités avec le SDFE. Nous finançons trois travaux de recherche sur l'articulation entre protection de l'enfance et violences faites aux femmes et nous diffuserons les résultats sur notre site web.
Avant de répondre à vos questions, je dresserai un diagnostic puis je formulerai des propositions.
La littérature, qui est essentiellement étrangère, souligne que les conséquences sur l'enfant sont très variables dans leur forme et dans leur gravité : on retrouve le diptyque troubles intériorisés et troubles extériorisés, mais aussi les troubles de l'image de soi et de la capacité de gestion des émotions, avec des écarts importants entre enfants.
Le trouble manifesté par l'enfant n'est pas directement corrélé à la gravité des violences subies par sa mère. Du reste, pour tous les problèmes que nous étudions, de très nombreuses variables interviennent, au point qu'il est difficile d'élaborer un modèle du type causes-effets. Les variables interagissent et l'environnement a une influence forte. Selon les conditions de vie de la famille, à violences conjugales égales, le degré d'exposition de l'enfant varie. Certains enfants peuvent être très perturbés par une simple menace de séparation, même sans violences, même verbales, tandis que d'autres semblent surmonter le vécu de violences extrêmement fortes – même s'il convient d'insister sur leur impact. Tout dépend de la façon dont l'enfant perçoit les risques encourus par lui-même, par sa mère, mais aussi par ses frères et soeurs. Les Nord-Américains parlent également des dating violence, c'est-à-dire des violences dans les relations entre adolescents. Plutôt qu'un témoin exposé aux violences, l'enfant doit être considéré comme un témoin confronté aux violences : la façon dont il réagit fait partie du sujet d'étude ; c'est un acteur du processus.
Par ailleurs, la littérature souligne combien la concomitance entre violences exercées envers la femme et violences exercées envers un ou plusieurs enfants est fréquente : selon les auteurs, le taux est de 40 à 70 %. Les phénomènes sont donc reliés : dans certains cas le père est lui-même violent envers ses enfants, dans d'autres la mère reporte son énervement sur son enfant. Parmi les appels téléphoniques reçus au 119, 20 % relevant qu'un enfant encoure un danger font état de violences conjugales, élément évoqué spontanément par nos interlocuteurs. Au cours des huit derniers mois, cela représente 3 300 appels.
Le guide que nous avons élaboré avec le SDFE émet une série de propositions. Je soulignerai surtout l'importance de prendre en compte l'enfant. Ces propositions procèdent d'une recherche de consensus entre, d'une part, des professionnels et des spécialistes concernés par les violences faites aux femmes, d'autre part, des professionnels et des spécialistes concernés par l'enfance en danger. L'enfant, dans toutes les situations, doit être considéré comme une personne à part entière, sans identifier immédiatement sa situation, sa souffrance et son intérêt à ceux de sa mère.
Tout enfant témoin de violences conjugales relève-t-il de la protection de l'enfance ? Cette question est centrale. Si la réponse est positive, le nombre d'enfants à prendre en charge sera accru d'au moins 50 %. Quand les violences exercées contre la mère sont extrêmement graves, ses enfants relèvent incontestablement de la protection de l'enfance. Par ailleurs, la capacité des parents à assurer la protection de leur enfant et à assumer l'ensemble de leurs responsabilités est un critère essentiel. L'évaluation ne porte pas uniquement sur l'état de l'enfant mais aussi sur la capacité parentale – souvent maternelle – à exercer son autorité. Si c'est le cas, une aide psychologique peut être envisagée, sans nécessairement recourir au dispositif de la protection de l'enfance.
La question de la prévention est évidemment fondamentale. À une époque, les Québécois, imitant les Américains, développaient des programmes télévisés de prévention tous publics, sous forme de fictions, pour traiter des sujets relatifs aux violences entre enfants, aux violences en direction des enfants ou aux violences parentales. Les personnes précédemment auditionnées ont aussi évoqué les politiques de lutte contre l'alcoolisme et de lutte contre les valeurs machistes, qui interviennent fréquemment très en amont des violences physiques ou sexuelles contre les enfants et des violences faites aux femmes. L'importance de la prévention précoce est déjà soulignée par la loi de 2007, lors de l'entretien au cours du quatrième mois de grossesse ; les violences commencent en effet souvent au cours de la grossesse, les foetus endossant eux-mêmes des souffrances.
Dans les rapports de suivi de jeunes en AEMO – action éducative en milieu ouvert–, le diagnostic de situation fait souvent état de violences conjugales, mais on n'y voit pas trace d'une action vis-à-vis de ce problème. Il est donc indispensable de sensibiliser aux violences faites aux femmes les professionnels de l'enfance et, parallèlement, de sensibiliser aux besoins de l'enfant, les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ des violences faites aux femmes. Quand une mère en détresse arrive dans un service d'accueil et qu'elle entre dans le bureau de la psychologue, il arrive que son enfant en très bas âge reste sans jouet ni assistance, la psychologue étant uniquement prévue pour la maman. Il est essentiel de prêter attention aux enfants, y compris dans les situations de grande urgence.
Se pose aussi la question de l'offre de traitements psychologiques. Il manque des psychologues et surtout des psychologues formés à la question des violences faites aux femmes et à celle des enfants confrontés à ces violences que ce soit dans le secteur libéral ou dans les services de l'aide sociale à l'enfance. Pour les former, nous manquons de connaissances, d'expérimentations et de travaux. Faut-il privilégier l'approche par écoute empathique, assez généralisée parmi les thérapeutes français formés depuis plus de dix ans, ou l'approche centrée sur le coping, (stratégie pour faire face) visant à aider l'enfant à gérer les situations en adoptant des comportements de protection ? La communauté des psychologues n'a pas tranché le débat.

Vous avez insisté sur la nécessité de prendre en compte l'enfant comme une personne et non comme une victime collatérale de la violence. Faut-il admettre le maintien d'un lien affectif et d'une présence physique entre le parent maltraitant et l'enfant ? Si oui, dans quel cadre et avec quelles précautions ? Un père violent et maltraitant n'est-il pas nécessairement un parent maltraitant psychologiquement ? Cela justifierait la suspension, éventuellement à titre provisoire, de l'autorité parentale et la protection de l'enfant et la femme pendant un certain temps, à la suite d'une décision judiciaire ?

Je vous remercie, monsieur, pour vos propos et pour l'éclairage qu'ils nous apportent.
Il est difficile de faire coïncider les réponses de la justice pénale et celles de la justice civile. Même s'il n'est pas la cible, lorsqu'un enfant assiste à des violences, celles-ci peuvent être considérées comme directes, d'autant qu'il est parfois l'otage de situations juridiques complexes. Des maris violents sont considérés pourtant comme de bons pères, ce qui conduit parfois le juge à prendre des décisions contradictoires, au profit de l'auteur des faits. Même si la victime est entendue au pénal, elle peut être en difficulté au civil, avec un véritable déni de ce qu'elle a subi. Que suggérez-vous, tout en respectant la présomption d'innocence, pour résoudre ce problème, dans l'optique de la protection des enfants ?
Madame la Présidente, il existe un continuum, en partant des toutes petites violences, en particulier psychologiques, jusqu'à des violences mettant en jeu la vie de la victime, en passant par les situations d'emprise. Lorsque la violence est ressentie comme une tradition, comme un fait culturel lié à une vision du rôle de l'homme, elle est certes inacceptable, mais elle n'a rien à voir avec une emprise perverse.
Il s'agit de savoir dans quelle proportion des violences extrêmement graves faites aux enfants sont corrélées à des violences extrêmement graves faites à la femme. Vous semblez postuler, monsieur le rapporteur, que c'est systématique ; pour ma part, je n'en suis pas certain.
En réponse à la question de M. le Rapporteur, rappelons que nous avons dernièrement évoqué la possibilité de conférer aux parquets civils une fonction de coordination. Toutefois, n'étant pas juriste, je serai particulièrement prudent.
Je souhaite appuyer cette suggestion. Dans la pratique, lorsque le juge aux affaires familiales et le juge des enfants sont saisis, il arrive que le dossier soit renvoyé de l'un à l'autre, ce qui provoque des problèmes de procédure. Charger le parquet de porter un regard global sur la situation constitue une piste intéressante.
L'équation mauvais conjoint égale mauvais père pose la question du travail effectué avec les hommes sur la dimension de la parentalité. Or celui-ci est très lacunaire, ne serait-ce que parce que le problème des violences conjugales, à lui seul, est déjà très prégnant et difficile à traiter. Le rapport commandé par Mme Valérie Létard à l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, pointe le manque de structures de prise en charge des auteurs de violences.
Sans lui faire porter la moindre responsabilité, il importe d'entendre l'enfant pour comprendre ce qu'il éprouve, ce que sont ses besoins et la façon dont il vit cette situation. Les violences du père ne doivent faire l'objet ni de déni ni de diabolisation. S'il ne doit pas être excusé, il n'en reste pas moins le père, et son enfant peut éprouver le besoin de conserver des liens avec lui.
Les ordonnances de protection pourraient être assorties, non pas de mesures de suspension de l'autorité parentale mais plutôt de mesures d'accompagnement de l'enfant, sur le modèle suédois : un tiers vient chercher l'enfant au domicile de la mère et le conduit chez le père, afin de préserver les coordonnées personnelles de la mère, d'éviter les contacts entre parents et de préserver l'enfant des conflits entre le père et la mère.

La vision que ces enfants ont des relations entre les hommes et les femmes risque très vraisemblablement d'être altérée – manque de respect des garçons vis-à-vis des filles et perte de repères des filles. Comment ceci est-il pris en compte ?
Quel est par ailleurs le pourcentage de femmes victimes de violences qui exercent elles-mêmes des violences envers les enfants ?
Les appels au 119 émanent-ils davantage de filles ou de garçons ?
Enfin, les pères sont-ils plus violents envers leurs garçons ou envers leurs filles ?

Les deux sujets – la protection de la femme et la protection des enfants – sont extrêmement délicats et pas forcément corrélés. La responsabilisation excessive des enfants devant la violence qui sévit entre leurs parents peut être destructrice ; il convient de protéger les enfants avec une approche distincte de celle prévalant pour la prise en charge de la femme victime. Lorsqu'il y a violence, la question de l'éloignement du conjoint violent par rapport à son épouse devrait être examinée séparément de celle de l'éloignement du père par rapport à ses enfants. Autant nous devons trouver les moyens de protéger la femme, autant il nous faut affirmer que les enfants ont un droit absolu : celui de grandir, et de grandir en dehors de la violence. À mes yeux, la procréation et l'adoption n'induisent que des devoirs, aucun droit, et certainement pas celui de la possession. Il est prioritaire de protéger les enfants de la violence des adultes.
Je suis assez favorable à un système dans lequel un médiateur, qui pourrait être le parquet, aurait une vision synthétique des situations, dans leur dimension pénale comme dans leur dimension civile, un peu à l'image du parquet des enfants. Certaines associations, notamment à Lyon, offrent des possibilités de placement dans un environnement familial autre qui permet à ces enfants d'échapper à la violence, sans stigmatisation de la famille d'origine mais au contraire, avec un souci d'accompagnement et de réhabilitation de celle-ci.
Bref, dans notre approche comme dans les solutions juridiques que nous préconisons, il faut distinguer le problème des adultes de celui des enfants.
Le recours au concept de « corruption » développé par les anglo-saxons comme une des formes de violence psychologique, renvoie à l'idée d'apprentissage du rôle d'agresseur ou de victime, ce qui favorise incontestablement la reproduction intergénérationnelle, même si elle n'est ni complète ni systématique.
Il a été démontré outre-Atlantique, que les enfants ayant subi des punitions physiques sévères après l'âge de sept ou huit ans deviennent plus souvent auteurs ou victimes de violences conjugales. Cela est un argument employé pour contester les punitions physiques.
J'ignore le pourcentage de femmes violentes. Les violences physiques sont plus fréquemment le fait des femmes – qui consacrent beaucoup plus de temps à l'éducation de leurs enfants –, surtout dans les situations de violences conjugales. Leur mal-être peut les conduire à avoir un comportement qu'elles regretteront quelques instants après. Les hommes exercent néanmoins des violences plus fortes et des violences sexuelles plus nombreuses.
Les garçons sont davantage victimes de violences physiques que les filles. Les filles sont davantage victimes de violences sexuelles que les garçons.
Je pose comme postulat que rien ne justifie de laisser des enfants subir des violences. Malgré tout, même si l'homme a été violent, maintenir un lien psychologique avec son enfant conserve tout son sens pour celui-ci. Si l'enfant est placé dans un environnement sain mais s'il ne voit plus son père, il peut se juger responsable de la situation, regarder son père comme une victime et ne pas aller bien. La prise en compte du point de vue psychique affectif profond de l'enfant, après travail avec un professionnel, est essentielle pour qu'il puisse se développer dans son nouvel environnement.
Certaines approches thérapeutiques, surtout au Québec, mettent l'accent sur la nécessité d'aider l'enfant à clarifier son point de vue et à penser à lui, par exemple à travers l'apprentissage de signaux selon lesquels la situation va devenir violente. L'enfant peut alors appeler des secours ou se mettre en sécurité ; c'est le fameux coping. Une approche similaire peut être utilisée pour les interactions entre le parent violent et l'enfant : l'enfant doit être aidé à mieux percevoir les situations violentes et du coup à élaborer des stratégies les mieux adaptées pour lui. Des protocoles d'intervention existent ; ils méritent d'être expérimentés, validés, confrontés et enrichis pour aider les enfants, et cela que l'on décide de maintenir les liens avec le parent violent ou de les couper. Les anglais, à une époque, ont favorisé les adoptions rapides d'enfants maltraités ; ils sont aujourd'hui revenus à un système de placement de l'enfant dans un milieu sécurisé et de possibilité de maintien des liens avec la famille d'origine.

Vous avez évoqué la conférence de consensus américaine de 1983 relative aux violences psychologiques et l'édiction d'une typologie. Aux États-Unis, une définition des violences psychologiques est-elle déjà transcrite dans la loi ?
Pour certaines femmes, l'évocation de la protection de l'enfance entraîne la peur de se voir retirer leurs enfants, surtout dans un contexte de violence conjugale et de difficulté de relogement. Si les enfants témoins de violences conjugales relevaient systématiquement de la protection de l'enfance, des femmes ne craindraient-elles pas de dénoncer ces violences ?
En France, les professionnels en charge des mères et ceux en charge des enfants peuvent entrer en conflit. Mais ce n'est rien au regard des conflits qui opposent, au Canada ou aux États-Unis, les militants du soutien aux femmes et les professionnels de la protection de l'enfance. Les relations sont beaucoup moins tissées là-bas qu'elles ne le sont chez nous.
Tous ceux qui travaillent avec les femmes victimes de violences savent qu'elles craignent de voir leurs enfants placés si elles dénoncent leur mari – même si ce n'est pas souvent le cas en pratique – les actions éducatives en milieu familial étant beaucoup plus courantes.
Les Américains ont construit des définitions des maltraitances psychologiques contre les enfants. Il s'agit cependant de travaux de psychologues spécialistes de l'éducation familiale, pas de juristes et ne sont pas utilisables dans un but juridique. Ils insistent avec force sur la vulnérabilité de l'enfant, être en développement. La typologie est classique : le rejet ; le dénigrement ; le terrorisme, avec par exemple des menaces d'abandon ; l'isolement, c'est-à-dire la rupture de tous contacts ; l'indifférence face aux demandes affectives ; la corruption, qui consiste à valoriser des comportements socialement inadéquats ou illégaux. Certains ajoutent la négligence grave ; je propose pour ma part de distinguer entre négligence grave et maltraitance psychologique volontaire.
Sur la question des violences exercées par la mère, je préciserai que le problème des mères reçues par les associations n'est pas tant d'être irritables et dépressives que d'avoir un style éducatif trop négociant et par conséquent de manquer d'autorité vis-à-vis de l'enfant.
L'enfant exposé aux violences conjugales relève-t-il de la protection de l'enfance ? Je crois tout de même que la population des enfants victimes de maltraitance est distincte de celle des enfants témoins de violences conjugales. De toute façon, dans les situations de ce type, le père n'est pas disposé à collaborer, ce qui pose un problème pratique.
Il faut soutenir les actions entreprises en faveur des enfants par les associations comme par les services d'accueil des femmes : les enfants doivent disposer d'espaces où évoluer, avec des jouets et des interlocuteurs spécifiques.
Toutes les situations de violence ne conduisant pas à des séparations, le thérapeute doit aussi doter les enfants d'outils concrets pour qu'ils sachent se repérer dans le cycle de la violence, conscientiser leurs émotions et ainsi ne pas se sentir démunis lorsqu'ils retournent au domicile familial. Les psychologues comme les associations proposent une aide à la parentalité. Il existe donc des alternatives au basculement vers la protection de l'enfance, dont l'intervention poserait peut-être davantage de questions qu'elle n'apporterait de réponses.
Je souhaite insister sur le manque d'équipements dédiés aux enfants dans les établissements d'accueil d'adultes.
La mission aensuite auditionné le Docteur Maurice Berger, chef de service en psychiatrie de l'enfant au CHU de Saint-Étienne.

Monsieur le Docteur Maurice Berger, merci de votre présence. Vous êtes chef de service en psychiatrie de l'enfant au CHU de Saint-Étienne, et auteur de l'ouvrage :Voulons-nous des enfants barbares ?
Selon le rapport de l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) que nous venons d'entendre, le bilan de littérature a mis en évidence l'apparition, après trente ans de recherche, d'un consensus affirmant l'existence d'un impact de la violence conjugale sur les enfants, variable selon le degré d'exposition à la violence, l'âge et le sexe de l'enfant.
Pouvez-vous nous dresser un état des lieux de vos observations et nous exposer vos préconisations, afin que nous puissions agir dans ce domaine.
Permettez-moi de faire d'abord un rappel historique.
Dans le service dont j'ai la responsabilité au CHU de Saint-Étienne, nous nous sommes spécialisés, depuis une vingtaine d'années, dans la prise en charge des enfants très violents.
Au début, nous pensions recevoir essentiellement des enfants qui avaient été maltraités, c'est-à-dire battus, négligés. Or nous avons constaté que, pour un certain nombre de ces enfants – parmi les plus violents –, ce n'était pas le cas. Par contre, ces enfants avaient été soumis au spectacle de scènes de violence conjugale extrêmement fortes, et de manière répétée. Cette observation est venue battre en brèche nos théories selon lesquelles l'enfant devait avoir été directement frappé ou négligé corporellement pour être violent.
De surcroît, beaucoup de ces violences avaient eu lieu alors que l'enfant avait moins de deux ans. Autrement dit, plus l'exposition à la scène de violence avait eu lieu précocement, plus elle avait d'impact, ce que nous n'imaginions pas.
Face à ces observations, nous avons débuté une recherche clinique et nous sommes mis en relation avec des collègues d'autres pays, en particulier du Québec, de Belgique et d'Israël. Je vais donc vous faire part de quelques-unes de nos conclusions concernant l'impact sur les enfants des violences faites aux femmes – dans lesquelles j'inclus les violences sexuelles faites aux femmes en présence de leurs enfants.
En plus de l'axe de référence psychologique, nous avons été obligés de faire appel à des connaissances neurologiques et sociologiques. Je précise tout de suite que notre position est mitigée – je dis « notre » car c'est un travail d'équipe – sur l'impact de la précarité. Les violences conjugales existent dans tous les milieux. La précarité aggrave tout, c'est vrai, et vivre dans un tout petit appartement avec plusieurs enfants crée des tensions intrafamiliales. Cependant, le premier rapport faisant part de l'augmentation inquiétante des violences en milieu scolaire date de 1972, c'est-à-dire pendant la période des Trente glorieuses et avant le premier choc pétrolier, époque où il y avait seulement 50 000 chômeurs. Je ne dis pas que la précarité ne joue pas, mais on en fait trop souvent un argument unique.
Nous avons dû également nous appuyer sur l'axe culturel et sur une réflexion judiciaire, que j'évoquerai plus tard.
Mon propos comportera trois chapitres : les troubles que, nous cliniciens, observons directement chez les enfants ; les causes de ces troubles ; et ce que peut proposer la société ?
En premier lieu, les troubles.
Tous les enfants exposés à des scènes de violence conjugale ne présentent pas des troubles. Nous ne connaissons pas le pourcentage d'enfants qui en souffrent – ce serait une recherche à faire.
La première sorte de troubles est ce que nous appelons la violence pathologique extrême.
Un enfant, que j'appelle Joël dans mon livre, a vu sa mère être rouée de coups devant lui par son père, en particulier lorsqu'elle était enceinte. Les scènes ont été répétées, très violentes, et la police est intervenue à plusieurs reprises. Cet enfant n'a pas été suffisamment protégé par le juge des enfants qui, l'ayant retiré treize fois du foyer, l'y a rendu treize fois. Il nous a été adressé à l'âge de deux ans et demi parce qu'il tentait sans arrêt d'étrangler les autres enfants – il avait d'ailleurs vu son père essayer d'étrangler sa mère. Nous avons réussi à sortir à peu près d'affaire cet enfant. Le coût du traitement a été de 582 000 € sur notre budget de service, ce qui est énorme. Lorsque cet enfant frappait les autres enfants –et certains ont été blessés –, il riait avec un sourire complètement « plaqué ». À notre demande : « Explique-nous pourquoi tu fais cela ! », il répondait : « C'est papa en moi qui me fait agir ainsi. ».
Selon nos propres statistiques, réalisées à partir de nos observations dans la Loire et extrapolées par rapport à la population française, il y a – au minimum – 14 000 enfants de ce type en France. C'est un chiffre important.
Un autre exemple – parmi beaucoup d'autres –, cité par la chercheuse israélienne Miri Keren concerne un bébé de six mois. Cet enfant a vu le compagnon de sa mère la gifler et lui cracher au visage. Dès qu'il a eu la maîtrise musculaire pour le faire, il a reproduit ce comportement sur les autres : il a donc enregistré cette scène.
Nous nous sommes donc demandé comment des troubles pouvaient être inscrits aussi précocement.
Selon nos hypothèses, confirmées par le travail clinique et thérapeutique d'autres équipes, ces enfants n'ayant pas la parole pour comprendre ce qui se passe, cette violence s'inscrit dans leur cerveau, dans leur psychisme, sous la forme de cris, d'images, de sensations à l'état brut. Et, à l'occasion d'événements minimes, comme une exigence éducative du genre « va te brosser les dents », ou à l'occasion du contact avec le corps d'autres enfants en groupe, cette violence ressurgit de manière immédiate comme une hallucination. C'est une sorte de reviviscence hallucinatoire : l'enfant est habité par l'image du parent violent, et elle se met en route comme si l'on appuyait sur un bouton. C'est aussi ce qu'on trouve chez certains agresseurs ayant attaqué une personne dans la rue car, selon eux, elle leur avait lancé un « mauvais regard ».
Cette violence présente une caractéristique très précise : l'enfant se transforme. Il profère des insultes d'adulte qu'il a entendues – un enfant de deux ans et demi ou trois ans ne pouvant pas les avoir appris d'autres enfants. Il frappe jusqu'au bout, c'est-à-dire avec une violence impossible à arrêter par des sanctions, ou en le tenant dans les bras, en le maternant, en essayant de le calmer par des mots. Il n'a aucune culpabilité et « efface » l'événement par la suite. Si nous lui disons « Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ! », il répond : « Oui, mais c'est terminé ! », quels que soient les dommages créés à la victime. Ces enfants pris en charge – avec cinq entretiens hebdomadaires individuels –, parviennent petit à petit à nous expliquer qu'ils ont, en eux, l'image de la scène où le parent frappe la mère.
Je citerai aussi le cas d'un enfant de sept ans pour lequel j'ai été appelé en urgence un soir dans mon service car il était en train de frapper l'infirmière. J'ai essayé de parler avec lui, rien n'y a fait. Il a mis son visage à vingt centimètres du mien et a hurlé pendant vingt minutes – à tel point que j'ai souffert d'un traumatisme auditif. Je n'avais jamais entendu un enfant hurler aussi fort. Il a fallu lui injecter un calmant. Cet enfant avait été soumis, sans être battu, à des scènes de violence interminables – elles duraient quatre ou cinq heures – entre son père et sa mère. C'est ce qu'il avait reproduit entre lui et moi, et entre lui et l'infirmière.
On le voit : l'impact des violences conjugales est terrible !
L'autre aspect qui nous complique considérablement la tâche est l'aspect neurologique.
On pourrait penser naïvement pouvoir expliquer à l'enfant : « Ce n'est plus comme cela, maintenant : tu es protégé. » Or on constate que ces enfants ont enregistré ces souvenirs sous la forme de ce qu'on appelle une « mémoire traumatique ». Les neuropsychologues sont parfaitement clairs là-dessus : il ne s'agit pas de notre mémoire habituelle, celle des souvenirs, d'un voyage, par exemple, dont les personnes concernées ne donnent pas la même version. Les enfants enregistrent à la milliseconde près la scène et la ressortent exactement de la même manière : c'est une mémoire automatique. Cela est très compliqué à traiter. Lorsque ces scènes sont enregistrées, elles sont fixées à partir de l'âge de deux ans, et entraînent d'énormes complications thérapeutiques.
La deuxième sorte de troubles est la violence associée à la cruauté. Dans la violence pathologique extrême, l'enfant n'est pas cruel : il frappe automatiquement et peut même blesser grièvement s'il en a la force physique, mais ce n'est pas de la méchanceté en soi. Avec la violence et la cruauté, les enfants se sont identifiés à la cruauté de l'homme par rapport à la femme. On les repère très rapidement car ils ont du plaisir à faire mal, à humilier l'autre. C'est aussi ce qu'on retrouve chez ces jeunes qui filment des scènes de viols et les rediffusent avec jubilation devant leurs camarades. Allègre, le tueur en série de Toulouse, a expliqué avoir été exposé de manière répétée – des centaines de fois – à des scènes de violence familiale extrêmement importantes entre son père et sa mère.
La troisième sorte de troubles est ce que nous appelons le syndrome post-traumatique.
En ce domaine, nous accusons en France un réel retard. Lors d'une conférence à Montréal en 2005 consacrée à ce thème, Miri Keren a fait part des travaux internationaux sur ce sujet. Ce travail a été mené par un groupe de psychiatres et de psychologues palestiniens et israéliens. Ils se sont dit qu'ils avaient au moins un point commun : les traumatismes causés à leurs enfants par la guerre et les bombardements. On a aujourd'hui des échelles d'évaluation de l'importance du syndrome post-traumatique chez les enfants de moins de trois ans. Surprise, ce traumatisme le plus important concerne les enfants exposés à une violence domestique au cours de laquelle leur figure d'attachement sécurisante, c'est-à-dire le plus souvent leur mère, est menacée. Ces enfants présentent un syndrome post-traumatique plus important qu'après avoir été pris dans des attentats ou – cela a aussi été mesuré – dans un tsunami. Ainsi, en prenant ces indicateurs, l'enfant de six mois ayant assisté aux scènes de violence dont je vous ai parlé présentait des séquelles beaucoup plus importantes qu'un autre enfant pris dans un attentat commis par des Palestiniens en Israël. En effet, la mère de ce dernier, bien que sévèrement blessée au bras, était restée à côté de lui, avait été sécurisante, était montée avec lui dans l'ambulance, l'avait accompagné jusqu'à la salle d'opération, avant de se faire soigner. Et, malgré de grosses blessures abdominales, cet enfant n'a gardé pratiquement aucune séquelle.
Il est impressionnant que ces chercheurs de ces deux pays arrivent à dire que les violences conjugales sont plus traumatisantes que les attentats.
Ces travaux datant de 1988, nous savons depuis lors que la mémoire d'un traumatisme demeure précise et fidèle chez l'enfant, quel que soit son âge ! On appelle événement traumatique chez l'enfant de moins de quatre ans tout événement vécu de façon directe ou en tant que témoin et qui menace son intégrité physique ou émotionnelle, mais aussi tout événement qui menace l'intégrité de la personne responsable de l'enfant.
Considérés comme insuffisants, ces travaux ont été repris en 1993 pour les enfants âgés de zéro à trois ans. Et, là encore, on a pu prouver que les nourrissons perçoivent des événements traumatiques et qu'ils s'en souviennent avec cette mémoire appelée « procédurale », « automatique » ou « traumatique », et que ces événements influencent leur développement ultérieur.
Différents de groupes des critères ont été établis.
Tout d'abord, ces enfants revivent les événements. Par exemple, ils « rejouent » leurs traumatismes dans leurs jeux. Ils ont également des épisodes dissociatifs, consistant à couper leurs pensées de leurs sentiments et de leurs sensations. Pour vous donner un exemple, une jeune femme qui a été violée n'a plus de sensation entre le haut du thorax et la racine des cuisses ; sa méthode pour se défendre étant de dissocier sa pensée de ses sensations.
Le deuxième groupe est celui de l'indifférence généralisée. Les enfants concernés perdent leurs compétences ou sont en retrait social.
Le troisième groupe celui de la suractivité : on voit des enfants hypervigilants, qui ont des réactions de sursaut ou ne s'endorment pas.
Dans le quatrième groupe, les enfants ont des nouvelles peurs : ils ont, par exemple, un comportement adhésif, ils « se collent » aux adultes. Ils peuvent aussi être agressifs.
Depuis 1993, ces cotations permettent de dire s'il existe un syndrome post-traumatique et de déterminer son intensité. Or je trouve que, là encore, on a du mal à les intégrer.
Une étude franco-suisse conduite par Franck Voindrot porte sur les syndromes post-traumatiques. Selon cette étude, 41 % des enfants reçus en pédopsychiatrie de liaison – un pédiatre, sentant que ce n'est pas de son ressort, appelle un pédopsychiatre dans la journée – pour encoprésie, angoisse, phobie, ont été exposés à des scènes de violence conjugale. La plupart du temps, les pédopsychiatres et les pédiatres ne les ont pas recherchées. Il a fallu pour cela une équipe sensibilisée d'autant que si l'on posait la question directement aux mères sur l'existence de violences, elles répondaient par la négative. Il fallait poser des questions indirectes du genre : « Y a-t-il des moments où vous n'êtes pas d'accord avec votre mari, où le ton monte ? » pour le savoir.
À ma connaissance, peu de travaux sont réalisés en France sur ce sujet. Ils sont essentiellement américains. Un important travail a été réalisé sur 8 860 adultes suivis par des services de soins psychiatriques – l'équivalent de nos consultations de secteur. Résultats : 43 % ont été soumis dans leur enfance à des traumatismes répétés, physiques, sexuels ou émotionnels, dont des scènes de violences conjugales, et 14 % ont eu comme traumatisme principal le spectacle de scènes de violences conjugales, si bien que les auteurs de ces travaux en ont fait une sorte de maltraitance particulière aux enfants. Les Québécois également – j'en reparlerai.
Un autre travail, intitulé « Hurtful words » – « Les mots qui blessent » –, compare les traumatismes en étudiant les conséquences psychiatriques à l'âge adulte de l'exposition à l'agressivité verbale et aux scènes de violence. Ainsi, on voit apparaître des symptômes anxieux, dépressifs, dissociatifs et des sentiments d'agressivité et, chose impressionnante – je suis presque gêné de le dire –, les troubles sont aussi importants que pour les enfants ayant subi des abus sexuels. Pour nous, c'est inimaginable. Faut-il faire d'autres études ? En tout cas, ce travail est valable.
Deuxième élément : les causes des troubles. J'en ai distinguées trois.
La première est l'exposition directe et l'enfant intériorise la scène de violence.
La deuxième cause est la baisse des compétences maternelles. Dans ces situations de violence, certaines mères étant avant tout préoccupées par leur survie perdent leur capacité protectrice et leurs préoccupations à l'égard des enfants. Une directrice de foyer pour femmes battues expliquait que toutes les femmes, au début de leur accueil dans le foyer, sont incapables de jouer avec leur bébé et il leur faut des mois pour se remettre de la violence et commencer à avoir du plaisir à être avec leur enfant.
Le troisième facteur est culturel. Parmi les principaux facteurs de risque, Jorge Barudy, l'un des responsables de la protection de l'enfance en Catalogne, place l'inégalité hommes-femmes quand elle est violente ou humiliante. Qu'entend-on par cette inégalité, souvent d'origine culturelle ? Les mariages forcés, qui, dans certains cas, s'apparentent à un viol, la violence sur l'épouse, les interdictions de sortir, la polygamie, l'excision, notamment.
Nous avons constaté une surreprésentation d'enfants d'origine maghrébine exposés aux violences conjugales, à peu près 30 %, alors que nous n'avons pas 30 % de population d'origine maghrébine.
La question de l'image de la femme est aussi posée par une étude publiée par la Fédération française de psychiatrie. Je ne suis sans doute pas politiquement correct en disant cela, mais il faut voir les choses en face : d'après des expertises réalisées par Patrice Huerre, psychiatre parisien connu, sur 52 jeunes de treize à dix-sept ans ayant participé à des viols collectifs, 50 % sont d'origine maghrébine et 22 % originaires d'Afrique noire.
Face à ces chiffres, nous avons décidé de travailler avec des psychologues maghrébins. Ils nous ont appris que les jeunes beurs, souvent, ne se trouvent pas séduisants. Or, si l'on ne se trouve pas séduisant, une des manières d'avoir des relations avec une fille, c'est de passer en force. Pourquoi ne se trouvent-ils pas séduisants ? En fait, beaucoup de mères maghrébines auraient du mal à investir leurs enfants de sexe mâle, car c'est le garçon de l'homme qu'elles n'ont pas forcément aimé, et c'est un garçon qui va devenir un homme comme leur compagnon. Même s'il ne faut pas généraliser, on retrouve très souvent dans ces situations de violence un investissement plus important de la part des mères auprès des filles. En outre, leur petit garçon n'aurait pas été pour elle « le plus beau bébé du monde », comme c'est le cas habituellement pour les nouvelles mamans.
Troisième chapitre : vous m'avez demandé quelles propositions peuvent être formulées. Je vais vous les exposer en sept points.
Premier point : il faut partir du principe que protéger une femme ou l'aider à se protéger, c'est protéger son enfant.
Deuxième point : on ne devrait plus entendre, en particulier de la part des juges aux affaires familiales, la phrase selon laquelle un mauvais mari – je précise qui donne des coups, je ne parle pas d'adultère – peut être un bon père. En effet, un homme qui tape sa femme devant son enfant perd toute préoccupation parentale puisqu'il soumet son enfant à un spectacle particulièrement angoissant.
C'est si vrai que les violences conjugales sont considérées dans la loi québécoise sur la protection de la jeunesse comme une forme de mauvais traitement psychologique. Pour élaborer leur loi sur la protection de la jeunesse, les Québécois n'ont pas eu recours à des facteurs émotionnels mais se sont référés aux travaux scientifiques existants. Voici ce qui figure maintenant dans leur loi : les mauvais traitements psychologiques sont susceptibles d'atteindre les jeunes sur tous les plans de leur développement avec une intensité qui pourrait même surpasser celle qui peut être associée à l'impact des autres formes de violence : abus sexuels, négligences et abus physiques. Ils nomment « mauvais traitements psychologiques » des mauvais traitements qui – caractéristique fondamentale – ne portent pas directement atteinte à l'intégrité physique de l'enfant.
Troisième point : les juges aux affaires familiales devraient être plus protecteurs pour l'exercice du droit de visite. Soit il faut permettre aux femmes de bénéficier d'un lieu d'accueil plus prolongé qu'actuellement, soit il faut créer l'obligation, plus longue, que ces visites se déroulent dans un lieu tiers. Vous le savez sans doute, l'enquête réalisée en 2006 en Seine-Saint-Denis a montré que, de toutes les femmes tuées par leur ex-conjoint, une sur deux l'avait été à l'occasion du droit d'hébergement par l'homme – l'enfant ayant probablement assisté à cette scène.
Quatrième point : une meilleure coordination entre les procédures pénales et le juge aux affaires familiales est souhaitable. En effet, en cas de procédure pénale pour mauvais traitements, les avocats du mari se débrouillent pour faire traîner la procédure de manière que l'homme ne soit condamné qu'après la décision du droit d'hébergement, et le juge aux affaires familiales ne peut pas en tenir compte.
Cinquième point : il ne faudrait pas de résidence alternée en cas de maltraitance avérée sur la femme. J'assure une consultation pour des enfants en résidence alternée souffrant de difficultés psychiques. Je précise très clairement aux parents que je ne ferai aucun certificat qui serait remis à leur avocat ou au juge ; la consultation sera centrée uniquement sur les difficultés psychiques de l'enfant. J'ai constaté que de 40 % à 50 % des mères venant consulter avaient été maltraitées avant ou même après la séparation d'avec leur conjoint, avaient été battues et vivaient toujours sous menace. Il y a trois semaines, j'ai reçu une mère que son conjoint avait quittée lorsque leur bébé avait huit mois. Ce père a exigé la mise en place d'un droit de visite du vendredi après-midi au lundi matin, plus un jour dans la semaine – c'est-à-dire presque une résidence alternée. L'enfant présente une angoisse importante, n'arrivant pas à s'endormir, ni à se séparer de sa mère. Le soir, il veut que la porte de sa chambre reste ouverte, il a peur qu'un loup ou un tigre ne vienne s'emparer de lui, ou que sa mère ne meure dès qu'il est chez son père, etc. Au fur et à mesure de la consultation, la mère s'est décomposée et a fini par me dire : « Cela va être terrible pour moi si mon fils parle à son père de ce qu'il vous a dit ; je ne reviendrai plus vous voir car j'ai trop peur. » Je lui ai alors proposé de la recevoir seule pour voir comment je pouvais l'aider, elle, à aider son enfant qui ne va pas bien, donc indirectement. Cette femme m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait trop peur de revenir, et le rendez-vous suivant a été annulé. Je suis impuissant face à de telles situations.
Voilà pourquoi, selon moi, il ne faudrait pas de résidence alternée en cas de maltraitances avérées sur les femmes car ce dispositif d'hébergement est utilisé par l'ex-conjoint pour maintenir une emprise sur la mère. Ces pères se trompent en pensant attaquer leur femme ; ils créent en fait un handicap pour le développement affectif de leur enfant.
Sixième point : pourquoi nous n'arriverons pas à changer les choses. D'une manière générale, nos lois sur la famille, mais aussi sur la justice des enfants, ne sont pas centrées prioritairement sur les enfants c'est-à-dire sur les besoins minimums qui doivent être satisfaits pour qu'un enfant se développe à peu près correctement, en particulier son besoin de sécurité affective.
Malgré la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale et la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, il manque plusieurs choses
Tout d'abord, il n'est jamais indiqué que l'intérêt de l'enfant doit avoir préséance sur celui des adultes. Les seuls pays où les lois soient réellement protectrices sont ceux où cela est précisé noir sur blanc, car on considère que l'enfant est vulnérable, que sa personnalité est en voie de développement, qu'il dépend totalement de son environnement et que, souvent, il n'a pas la parole pour faire comprendre ce qu'il ressent. En France, on cherche un équilibre entre les droits des parents et les droits de l'enfant. Or, dans certaines situations, ces deux droits sont incompatibles.
Ensuite, la définition de l'intérêt de l'enfant n'est pas appliquée pour plusieurs raisons.
Un débat parlementaire extrêmement tendu avait eu lieu à ce sujet, les parlementaires ayant imposé au gouvernement de l'époque – qui la refusait, puisque les juges, la sauvegarde de l'enfance et les conseils généraux n'en voulaient pas – la définition de l'intérêt de l'enfant. Et je ne cache pas avoir oeuvré pour cela.
Première raison : à l'École Nationale de la Magistrature, on m'a dit qu'il n'y a toujours pas de définition de l'intérêt de l'enfant. L'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, est pourtant ainsi rédigé : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant ». C'est la définition du Canada, du Québec, de l'Italie, de certains cantons de Suisse et de l'Angleterre. Mais la virgule – après les mots « l'intérêt de l'enfant » – définit une juxtaposition de mots qui n'ont pas forcément de lien entre eux ! Il aurait donc fallu écrire : « l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux… », cette apposition permettant aux premiers termes de définir les suivants.

Notre intention était bien celle-là. La formulation malencontreuse de la loi ne convenant pas, il nous faut envisager de la modifier. Je comprends votre préoccupation, et elle fait partie des propositions que nous devons faire.
Écrire que l'intérêt de l'enfant a préséance sur celui des adultes et résoudre le problème de virgule seraient le fondement d'un dialogue entre professionnels. Actuellement, on entend dire que l'intérêt de l'enfant n'est pas mentionné en tant que tel !
Deuxième raison : l'utilisation même des termes « l'intérêt de l'enfant » est refusée par beaucoup de professionnels, sous le prétexte qu'ils sont beaucoup trop subjectifs. Or c'est faux. Lors du débat à l'Assemblée nationale, un des arguments avancés avait justement été qu'on ne peut plus laisser 4 000 ou 5 000 professionnels avoir chacun leur définition.
Il existe donc des outils précis pour évaluer le développement affectif et intellectuel d'un enfant. Par conséquent, prétendre que l'intérêt de l'enfant introduit de la subjectivité est un mensonge. Un de ces outils est le test de Brunet-Lézine. Dans l'une des épreuves, on donne un cube à un bébé de neuf mois, puis on lui prend pour le cacher sous un mouchoir, et on lui demande où il est. Un enfant élevé dans un milieu familial calme et prévisible, hésite mais tire le mouchoir. Autrement dit, il ne perçoit pas le cube, mais il sait qu'il est toujours là : c'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Un enfant élevé dans un milieu violent, chaotique, va tourner la tête à gauche, à droite car il ne sait plus où est le cube : il n'a pas acquis l'image d'une mère sécurisante – toujours elle – à l'intérieur de lui.
En outre, la définition de l'intérêt de l'enfant, dit-on aussi souvent, n'est pas utilisable car elle figure uniquement dans le code de l'action sociale et des familles, et pas dans le code civil. Les juges, les éducateurs et autres recourent seulement à l'article 375 du code civil sur l'assistance éducative. De même, la loi de 2002 est inscrite dans le code civil. La définition de l'intérêt de l'enfant, déjà insuffisante, déjà refusée, est donc, en plus, hors du code civil. Résultat : tous les prétextes existent pour ne pas s'en servir.
Septième et dernier point – je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais quand même le faire au risque de vous choquer – : je suis consterné par le refus d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale de treize à douze ans.
Je ne parle pas en termes sécuritaires, ni idéologiques. Je m'occupe d'une consultation spécialisée pour les jeunes violeurs et nous parlons aussi du droit des femmes dans le cadre de cette mission. Il s'agit d'empêcher que des jeunes filles, des filles, des fillettes soient violées. Les jeunes violeurs que je reçois commencent à violer à partir de onze ans – de plus en plus de jeunes commencent à cet âge.
Mais la question n'est pas seulement celle-là. Les soins aux jeunes violeurs sont extrêmement : ces jeunes effacent ce qu'ils ont fait et imaginent que la victime efface de même. Autrement dit, ils n'ont aucune conscience du décalage entre leur acte et le syndrome post-traumatique de la victime après un viol qui est énorme. Et les violeurs commencent à penser à ce qu'ils ont fait seulement au moment où tombe la sanction judiciaire.
Dans le cadre d'une obligation de soins, je me suis occupé d'un jeune qui avait violé à treize ans et deux mois. Il ne se passait rien jusqu'à ce que son avocat lui dise : « Tu as caché avoir sodomisé ce garçon, mais on en a la preuve et tu vas être condamné ». Le garçon répond alors: « Je ne voulais pas y penser car il me semblait que, si je n'y pensais pas, le juge n'y penserait pas non plus et qu'il oublierait. ». Voilà le fonctionnement des jeunes violeurs. Si l'on veut maintenir l'âge de la responsabilité pénale à treize ans, il faudrait en exclure les délits sexuels.

Monsieur Berger, j'ai eu le sentiment que les enfants dont vous parlez – reproduisant non pas des choses qu'ils ont subies, mais vécues en spectateurs obligés – étaient quasi exclusivement des garçons. Y a-t-il les mêmes indications cliniques pour les petites filles et peut-on en mesurer les conséquences éventuelles sur leur comportement ou leurs difficultés ultérieures ?
Comme nous le savons, les violences commises envers les femmes débutent souvent avec la grossesse. Je ne sais pas si cette question est pertinente mais a-t-on le moyen de mesurer l'impact que pourraient avoir sur un enfant des violences qu'il aurait « subies » du fait que sa mère en a été victime pendant la grossesse?
J'ai fait partie de la commission Varinard sur la réforme de la justice des mineurs. Tous les membres – je dis bien, tous – avaient, après un débat très approfondi, adhéré à l'idée de fixer l'âge de l'engagement de la responsabilité pénale à douze ans. Cependant, la question de l'enfermement, donc de la prison à douze ans, a complètement perverti le sujet. Selon vous, il serait donc nécessaire de pouvoir engager la responsabilité pénale, au moins des jeunes violeurs, à partir de douze ans, ce qui ne signifie nullement une incarcération obligatoire.
Enfin, votre septième point – sur lequel vous nous avez dit ne pas vouloir faire de la provocation – est pour le moins décoiffant, mais il m'a permis d'avancer. Aujourd'hui, vous m'avez donné une idée du titre que je pourrais donner au rapport sur les violences faites aux femmes que je proposerai à mes collègues. Sans vous plagier, je l'intitulerais bien : « Je vais vous indiquer pourquoi tout doit changer. »
Nous recevions jusqu'à présent, une grande majorité de garçons, mais nous commençons à voir arriver des filles. Ces filles, exposées à des scènes de violence, peuvent être aussi violentes que les garçons ; elles agissent souvent en groupe et avec beaucoup de cruauté, en exposant une fille à ce qu'elles ont elles-mêmes subi. Par exemple, elles amènent la victime au bas d'un immeuble pour la regarder se faire violer, ou elles violent d'autres filles dans des internats.
Une quantité importante de travaux montre que le foetus est sensible au stress éprouvé par la femme pendant la grossesse, ne serait-ce que par des biais hormonaux. En effet, le stress provoque une augmentation du cortisol et de l'adrénaline. Les pics d'adrénaline sont un phénomène bien connu. On constate que le taux de cortisol est en augmentation constante chez une personne adulte, ou même un enfant, en situation de stress permanent. Par conséquent, chez une femme enceinte stressée, le foetus baigne dans cette augmentation de cortisol qui, malheureusement, est une hormone liposoluble, c'est-à-dire qu'elle passe dans le cerveau. Nous avons des traces de ces maltraitances chez l'enfant après la naissance, qui sont le fait de mères très stressées. Certains nourrissons ont une manière de réagir à fleur de peau, supportent mal qu'on les touche, d'autres sont hyperkinétiques, par exemple.
Votre troisième point est délicat. Ayant moi-même déposé devant la commission Varinard, mon texte distinguait trois sous-groupes de jeunes violeurs. Il y a d'abord ces jeunes extrêmement impulsifs, animés d'une violence pathologique extrême qui surgit d'un coup. Je ne suis absolument pas convaincu que la prison leur serve ; par contre, il est extrêmement important qu'ils sachent qu'ils « peuvent » aller en prison. Nous les emmenons visiter la prison tant ils sont incapables d'anticiper les effets de leur geste. D'autres sont des jeunes qui commettent des violences en groupe ou des violences de caïds, c'est-à-dire de jeunes ayant un plaisir à transgresser la loi devant des témoins et à se montrer plus forts qu'elle. Pour eux, seul un acte transmis par la société peut leur signifier qu'ils doivent arrêter. C'est pourquoi, à mon avis, même entre douze et treize ans, leur place est en établissement pénitentiaire pour mineurs, à condition d'y trouver des psychologues et des éducateurs.
Si l'on me dit qu'il s'agit d'enfants, je réponds ceci : ces enfants ont eu la force de commettre un viol en étant complètement insensibles aux cris et aux supplications. Nous devons donc construire des établissements adaptés. Cela dit, c'est aborder la question du mauvais côté. Notre service comporte une pièce d'isolement permettant aux jeunes, lorsqu'ils sont complètement débordés par la violence, d'aller se calmer – on pourrait l'appeler aussi pièce d'apaisement. Lorsque je demande à des jeunes de dix-onze ans de m'expliquer pourquoi ils ont commis cet acte extrêmement grave, la seule réponse que j'obtiens est : « Ta gueule, tu me prends la tête ! » Après les avoir isolés un moment dans cette pièce, ils disent : « J'ai pensé aux vingt-six questions pour lesquelles mon enfance s'est mal passée. » Ces jeunes n'arrivent pas à penser et, une fois l'excitation ou la violence calmée, la pensée survient. Or, en France, on n'arrive pas à concevoir qu'un lieu fermé protège le sujet à la fois de l'excitation du monde extérieur et de la violence qui naît en lui. La contenance n'est pas forcément qu'une sanction, mais qu'elle est le moyen d'aider les sujets à penser.
Les Québécois ont mis en place des centres éducatifs renforcés ou fermés depuis 1999, pour les six à douze ans, avec des résultats intéressants. On peut discuter de l'âge mais je ne supprimerais pas l'option pénitentiaire de douze à treize ans, à condition qu'elle offre des outils qui aident à penser.

D'après vous, mais aussi d'après les personnes auditionnées juste avant vous, il est indispensable, en cas de violences faites aux femmes, que les enfants soient pris en charge. En outre, selon vous – et c'est un peu le contraire du discours ambiant –, il n'est pas toujours bon de maintenir des liens avec le père violent.
Mon autre question ne se veut pas provocante, mais sincère : parvenez-vous à sortir ces enfants de cette violence, de leurs traumatismes ?
À peu près la moitié des enfants les plus violents admis dans notre service ont été soumis à des scènes de violences conjugales.
Sur trente-cinq, dix-huit ne sont plus violents, même si on les provoque, et onze ne sont plus violents spontanément, mais l'on déconseille quand même d'aller les narguer. Sur les quatre restants – dont l'un vient d'un des pires internats roumains –, deux ont été bien traités en psychiatrie pour adultes ; les deux derniers sont dans la nature, et j'ai des doutes sur ce qu'ils deviennent.
Le coût humain et financier de ce travail a été phénoménal ! Les 582 000 € pour Joël représentent cinq ans d'hôpital de jour, cinq jours par semaine ! Les autres services ne peuvent pas suivre, par conséquent, on ne le donne pas comme modèle. Simplement, si l'on pousse jusqu'au bout la démarche, on peut arriver à des résultats dans beaucoup de cas. Mais peut-on ruiner le dispositif de santé français pour les traiter ? Ne vaut-il pas mieux les prévenir ?
J'en viens au lien avec le père.
Votre question pose celle de l'évaluation des compétences parentales ? Ce que l'on n'arrive pas à mettre en place en France, où évaluation rime avec « flicage » et enfermement des gens dans des cases.
La compétence parentale se définit par : la capacité d'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce que ressent son enfant ; la capacité à être une figure d'attachement sécurisante, autrement dit à être fiable et à pouvoir rassurer son enfant s'il est inquiet ; la capacité à jouer avec lui, car cela lui apprend à faire semblant, à mettre sa violence ou ses inquiétudes sous forme de jeux ; la capacité à lui poser des limites cohérentes. Voilà ce qu'on demande à un parent !
À partir de là, la réponse est graduée. En fonction des guides d'évaluation plus ou moins complexes dont on dispose, si un père a cette capacité, on peut permettre des contacts, à condition qu'il ne dénigre pas la mère, car dénigrer la mère, c'est mettre l'enfant en insécurité.
Si un père n'a pas ces capacités parentales, la question se pose de savoir si l'on doit mettre en place des contacts médiatisés, en présence de professionnels, et selon quelle périodicité, mais aussi de savoir comment est l'enfant. En effet, certains enfants vont mal simplement en revoyant leur père et ils iront donc mal pendant un ou deux mois – c'est ce qu'on appelle les reviviscences hallucinatoires. Les visites médiatisées permettent donc de protéger l'enfant jusqu'à ce qu'il ait pu changer l'image qu'il a de son père. Malheureusement, elles sont un des outils les plus mal compris en France !
Enfin, faut-il qu'une fillette ayant subi un inceste aille absolument voir son père en prison, alors qu'elle a peur de lui ? Je peux vous dire que cela se fait régulièrement.
En plus, le père et l'enfant sont laissés dans un lieu sans la présence d'un adulte pour écouter les paroles ! C'est pourquoi je dis qu'en France on n'arrive pas à penser l'enfance, et que le premier des besoins est le besoin de sécurité affective.

Votre exposé est décapant. J'ai sélectionné les points sur lesquels je souhaite quelques éclaircissements.
Un point m'a beaucoup intéressé : la cause culturelle. Vous avez illustré votre propos en citant le cas de ces jeunes beurs qui ne se trouvent pas séduisants, ayant un rapport particulier à la mère, laquelle ne leur a peut-être pas accordé autant d'affection qu'attendu, car ils incarnent cette figure masculine à l'origine des inégalités hommes-femmes, et donc une certaine violence.
Vous avez prix l'exemple de « tournantes ». Les jeunes concernés n'ont pas forcément été confrontés à de la violence sexuelle de leurs parents. Si les mariages forcés, les violences sur épouse, les interdictions de sortie, les excisions – autrement dit l'environnement culturel –, sont autant d'éléments considérés comme des violences, ils ne sont pas une exposition à l'acte violent auquel vous vous référez au regard d'autres enfants totalement perturbés par cette exposition. Il y a donc une gradation. Non seulement ces jeunes beurs ont été élevés dans une culture de l'inégalité, mais ils passent à l'acte. Empêcher sa petite amie de sortir, ce n'est quand même pas la même chose que la violer.
J'aimerais donc savoir comment cela se passe au Maghreb, car vous parlez d'enfants immigrés ou issus de familles elles-mêmes immigrées. Est-ce l'environnement culturel occidental français qui change, qui provoque un passage à l'acte et ce saut de l'inégalité hommes-femmes à la violence sexuelle pure et dure ?
Par ailleurs, vous semblez opposé aux gardes alternées. Que pensez-vous de l'enfant pivot, dispositif où les parents viennent et exercent leur droit de visite et d'hébergement, l'enfant restant sédentarisé dans le foyer familial ?
Enfin, votre conclusion sur la préséance de l'enfant sur l'adulte me paraît être une évidence. Elle doit ressortir clairement dans notre droit et, si vous pouvez nous suggérer des adaptations, nous sommes preneurs.
Sur le dernier point, on mettra immanquablement en avant l'inutilité de changer la loi, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, parlant de « l'intérêt supérieur de l'enfant ». Mais, il faut préciser que l'intérêt de l'enfant a « préséance » sur celui des adultes. Sinon, on en restera à une formule vague, qui permet tout.
Quant à la résidence alternée, j'y suis clairement réticent pour les enfants petits. Une étude française du Dr Izard, parue dernièrement dans la revue Neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, montre que même dans les résidences alternées consensuelles, les enfants ont un vécu de perte constant. Ils dépriment, mais sans le montrer à leurs parents, souffrant de ce qu'on appelle le « syndrome de l'enfant parfait ».
Pas de résidence alternée, donc, pour les enfants de moins de six ans et dans les cas de violence. S'agissant des enfants plus grands, je ne suis pas sûr que la résidence alternée leur convienne très bien, mais on n'est pas là pour légiférer sur ce que veulent tout le temps faire les parents avec leur enfant. La loi de 2002 sur l'autorité parentale avait d'ailleurs été votée principalement pour des adolescents. Telles sont donc mes limites : les petits et la violence.
À la longue, le dispositif pivot ne donne pas de très bons résultats. On a constaté que ce dispositif était toujours transitoire et durait généralement de six à huit mois. Il a un avantage, l'enfant restant dans son lieu de vie ; mais il présente aussi un inconvénient, car l'enfant garde l'illusion que papa et maman ne sont pas vraiment divorcés et qu'ils seront de nouveau ensemble. Par conséquent, si des parents ont besoin de choisir ce dispositif pivot, pourquoi pas, mais il ne peut être que transitoire.
J'en viens à votre question de fond : qu'est-ce qui est culturel ? Qu'est-ce qui est lié à l'immigration ?
On ne peut évidemment pas relier les viols collectifs uniquement aux violences conjugales, car ce serait prendre un raccourci abusif. Je ne sais pas comment cela se passe au Maghreb, mais je peux dire que la violence conjugale n'est pas le seul facteur. Pour avoir un peu travaillé avec des jeunes des banlieues sensibles, nous avons observé l'existence d'une multitude de facteurs que, malheureusement, les politiques ont du mal à prendre en compte.
Le premier facteur est souvent une atteinte profonde de l'estime de soi. Cela découle de ce que je vous ai dit : les enfants ont-ils été suffisamment aimés petits ? D'où l'importance du mot « respect ».
Le deuxième facteur est un trouble énorme au niveau de la construction de la pensée. Souvenez-vous des interviews des jeunes lors des émeutes de novembre 2005 et d e leur difficulté à expliquer les raisons. Quand certains de ces jeunes ont été reçus chez nous, nous nous sommes rendu compte que simplement, ils « jouaient » lors des émeutes !
En fait, ces jeunes n'avaient jamais, petits, joué avec leurs parents. Le jeu apprend aux enfants à faire semblant. N'ayant pas joué à faire semblant, ils savent uniquement jouer dans le vrai. Au lieu de jouer avec de petites voitures, ils brûlent de vraies voitures ! « Pourquoi avez-vous brûlé l'école maternelle ? », a-t-on entendu à la télévision. Réponse : « C'était pour s'amuser, parce que c'était rigolo. » On entend dans les prétoires des jeunes déclarer : « On l'a violée, c'était pour s'amuser : » La distinction entre le réel et virtuel n'est pas faite chez eux. Et comment acquiert-on cette distinction ? En apprenant à faire semblant. Voilà pourquoi j'affirme, même si c'est complètement utopique, qu'une France qui jouerait un quart d'heure par jour avec ses enfants petits, la télévision éteinte – ce qui serait le plus difficile à obtenir – serait une France moins violente.
À tel point que nous mettons actuellement en place dans notre service un groupe de jeunes mères maghrébines, dont les enfants commencent à être violents, pour leur apprendre à jouer avec leur bébé, en espérant y arriver.
Dernier point : un bon schéma corporel permet de contenir ses pulsions violentes. Le corps de ces enfants n'ayant pas été très investi, ils souffrent de gros troubles du schéma corporel, n'arrivent pas à apprendre, à comprendre, et sont humiliés scolairement. Or, l'échec scolaire se construit avant trois ans car les structures de pensée permettant d'apprendre se construisent avant cet âge. Gøsta Esping-Andersen, un des plus grands économistes, ainsi que James J. Heckman, Prix Nobel d'économie en 2000, ont démontré qu'on ne mettait pas l'argent où il fallait. Une étude parisienne étonnante, qui va paraître le démontre également. Or, en France, on débute toujours la lutte contre l'échec scolaire trop tard, à trois ans, à l'école maternelle.
La question des jeunes beurs, des jeunes immigrés est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Les violences groupales sont un problème public d'origine intime.

Les crèches, les écoles maternelles – où les professionnels ont été formés – préparent l'enfant, le sortent de sa famille, le mettent en société, lui apprennent à jouer. D'où leur intérêt, ne pensez-vous pas ?
Tout à fait. Mais, à mon avis, cela ne suffit pas. Il faut une aide à la parentalité beaucoup plus structurée que celle que nous avons actuellement.
Un exemple très simple. Les professeurs Guedeney et Dugravier débutent à Paris un modèle avec de toutes petites séquences vidéo – déjà utilisé au Québec et dans beaucoup d'autres pays. On filme, pendant cinq minutes, l'interaction d'une mère, qui est d'accord pour être filmée, avec son bébé. Puis après avoir repassé la première minute où cela se passe bien, on demande à la mère comment elle a compris, senti, qu'il fallait faire cela avec son enfant ? Ensuite, on lui montre la séquence où cela se passe mal – le bébé pleure, regarde la mère qui s'en fiche complètement, elle peut même le repousser, et c'est la catastrophe. En fait, on a réalisé que certains parents n'étaient pas sensibles à nos paroles, mais à l'image : les images les touchent psychiquement, mais pas nos mots – ils ne voient pas vraiment où nous voulons en venir, et nous répondent « oui » pour être gentils. Il faut donc des dispositifs d'aide à la parentalité précoces et structurés, avant la maternelle. De cette manière, on peut gagner. Il faut donc se mettre au travail !

Merci beaucoup, monsieur Berger. L'ensemble de votre propos est effectivement iconoclaste par rapport à certaines choses que nous avions intégrées.
La mission a enfin auditionné Mme Isabelle Gillette-Faye, directrice du Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles.

Nous accueillons maintenant Mme Isabelle Gillette-Faye, directrice du Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, le GAMS. Créée en 1981 à Paris, pour prévenir les mutilations sexuelles, cette association a, depuis, élargi son action à la lutte contre les mariages forcés.
Selon plusieurs sources, 50 000 femmes vivant en France auraient subi des mutilations sexuelles et environ 70 000 femmes seraient concernées par un mariage forcé.
Disposez-vous, madame, de chiffres permettant de préciser l'importance en France de ces violences faites aux femmes ? Quelles propositions pouvez-vous faire pour que la situation évolue et que le nombre des victimes diminue ?
Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invitée pour parler de cette question.
Nous avons découvert l'existence des mutilations sexuelles féminines au début des années 1980 avec l'arrivée massive, dans le cadre du regroupement familial, de femmes originaires notamment d'Afrique subsaharienne. Les centres de protection maternelle et infantile ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme, car ils accueillaient des femmes en état de grossesse qui exprimaient l'intention de faire exciser leurs filles, en France ou dans leur pays d'origine. Des procès ont rapidement été intentés – le premier date de 1979 – et l'excision a été considérée comme un crime dès les années 1983-1984, par l'application de l'article du code pénal relatif aux mutilations.
Les premiers chiffres ont été donnés par les centres de protection maternelle et infantile PMI de Seine-Saint-Denis et des Yvelines : en 1980, entre 40 et 70 % de la population féminine concernée était touchée ; au début des années 1990, avec la première campagne de sensibilisation « Nous protégeons nos petites filles », les constats d'excision par les centres avaient chuté à 1 % par an et ne concernaient plus que des primo-arrivants d'Afrique subsaharienne. Nous avions l'impression que les familles avaient intégré le fait que cette pratique était interdite sur le territoire national, d'autant que des campagnes de sensibilisation étaient également menées dans un certain nombre de pays d'origine et que des lois y étaient prises pour interdire l'excision. Les centres de protection maternelle et infantile continuaient à en parler et à examiner les enfants mais le nombre de constats était nettement plus faible que par le passé.
En 1999, s'est déroulé le procès d'Hawa Gréou : pour la première fois, une victime portait plainte contre son exciseuse exerçant sur le territoire national. Plus de 200 familles ont été concernées, réparties sur plusieurs procès jugés par la Cour d'assise de Paris ou par celle de Bobigny.
Vers 2000, on estimait que la pratique avait bien reculé. Le constat est plus mitigé aujourd'hui.
Si l'on a assez peu de signalements pour les filles âgées de moins de six ans – bien qu'il y en ait encore et j'en ai encore eu un la semaine dernière dans le XIXe arrondissement de Paris –, nous sommes beaucoup plus inquiètes pour les plus de six ans. Je précise que notre association n'est appelée par un centre de protection maternelle et infantile ou un service d'aide sociale à l'enfance que s'il y a un dysfonctionnement. Mais, comme nous ne sommes que deux associations en France à travailler spécifiquement sur cette thématique, les informations passent par l'une ou l'autre de ces associations qui se tiennent régulièrement informées.
Les praticiens de la médecine scolaire ne peuvent pas procéder à des examens systématiques des organes génitaux externes des enfants de plus de six ans – le contexte scolaire ne s'y prête pas et on ne voit pas comment légitimer le fait d'examiner certaines enfants et pas d'autres –. Par contre, les collègues travaillant dans le secteur de la planification familiale rencontrent des jeunes filles venues les voir et découvrent, après avoir reconstitué leur histoire, qu'elles ont été excisées entre l'âge de six et douze ans sans que cela ait jamais été détecté. Souvent, ces jeunes filles se sont fait « piéger » lors d'un premier voyage dans le pays où elles ont été, non seulement excisées, mais encore mariées de force, ce qui constitue un double traumatisme. Il y a des plaintes – la loi les autorise maintenant jusqu'à l'âge de 38 ans – mais, malheureusement, les parquets les classent sans suite.
Nous cherchons actuellement à affiner notre outil statistique. L'étude démographique et de santé lancée actuellement ressemble à un recensement : des agents se rendent au domicile des familles et demandent aux femmes si elles sont excisées et si elles ont l'intention de faire exciser leurs filles. De plus, il arrive que des femmes qui, en 2000, ont dit avoir été excisées, affirment en 2006 qu'elles ne l'ont pas été. Nous réfléchissons au moyen de croiser l'outil statistique avec les examens cliniques.
En effet, on se trouve dans une situation paradoxale qui est une source inquiétude. Alors que les observateurs nationaux et internationaux constatent, à la suite des campagnes d'information et de prévention, des résultats encourageants dans les pays d'origine, les populations vivant dans les pays occidentaux et, notamment, en France – y compris de deuxième et de troisième génération – s'accrochent, par un phénomène de repli identitaire, à ce qui peut les rattacher à leur pays d'origine, dont l'excision. On note pourtant une baisse de cette pratique dans quasiment tous les pays, à l'exception de l'Égypte. Au Mali, alors qu'il y avait un taux de prévalence de 94 % en 1991, à l'époque des premières campagnes, celui-ci est passé à 91 % en dix ans – ce qui était déjà une baisse importante dans un pays où il n'y a pas de loi condamnant cette pratique – et vient de baisser à 83 %.
Le mythe du retour au pays d'origine prévaut toujours. Des personnes, vivant depuis deux ou trois générations en France, sont toujours dans cette optique. L'excision étant un préalable le mariage, ils en perpétuent la pratique. Dans un village du Mali, alors que les autorités administratives locales et les autorités coutumières étaient d'accord pour décider l'abandon de l'excision, c'est un groupe de migrants venant de France qui s'est élevé contre cette décision au motif qu'il s'était battu en Europe pour maintenir cette pratique.
La réalité d'aujourd'hui est faite de ce décalage entre les pays d'origine où il y a une avancée vers l'abandon de l'excision et les pays européens où l'on constate un recul.
Nous nous heurtons également à des résistances des professionnels : travailleurs sociaux, médecins, professionnels de la protection maternelle et infantile. Lors du colloque national sur la prévention des mutilations sexuelles féminines, en décembre 2006, destiné à susciter une déclinaison de notre travail en région, le professeur Henri-Jean Philippe a reconnu, avec une grande sincérité, que les professionnels de la santé ne savaient pas constater les excisions. Les médecins, notamment généralistes, les sages femmes, les infirmières, n'ont pas été formés pour cela. Les grands services de gynécologie obstétrique ne savent pas non plus faire ces constats.
L'étude de l'INED – Institut national d'études démographiques –, qui constitue la première recherche scientifique réalisée sur le sujet en France, estime que 20 % des 53 000 femmes adultes excisées vivant régulièrement en France, l'ont été sur le sol français. Nous connaîtrons les chiffres définitifs à la fin du mois de mars.
Cela impose une remise en question de la pratique des professionnels de terrain qui accueillent les femmes, les adolescentes et les petites filles, et la poursuite du travail d'information, de sensibilisation et de prévention car le repli identitaire en Europe risque d'avoir à terme des effets pervers dans les pays d'origine. Nous devons poursuivre concomitamment notre travail sur les deux continents.
Nous travaillons également au niveau européen pour demander une cohérence et une harmonisation des mesures de protection de l'enfance dans tous les pays car il y a aussi le risque, qui nous inquiète beaucoup, que les enfants n'aillent plus dans le pays d'origine des parents mais en Espagne, au Portugal ou aux Pays-Bas, pour subir une mutilation. La France est en effet très en pointe sur cette thématique, et les enfants ne sont pas aussi bien protégés partout en Europe.
Il existe également une hétérogénéité dans la prise en compte du problème d'un département et d'une région à l'autre, parfois même en traversant le périphérique : une enfant peut être protégée à Paris et ne pas l'être de la même manière dans un département limitrophe. Nous espérons que la nouvelle loi sur la protection de l'enfance apportera une aide en ce domaine.
La problématique du mariage forcé est encore plus large : alors que les migrants pratiquant l'excision viennent majoritairement, quoique pas exclusivement, d'Afrique subsaharienne, ceux pratiquant le mariage forcé sont issus de très nombreux pays d'Asie, du Moyen-Orient – dont la Turquie – et d'Afrique, dont l'Afrique du Nord. De surcroît, les pratiques sont multiformes, allant du mariage précoce au crime d'honneur.
L'élévation de l'âge légal du mariage des filles en France en 2006 a été une avancée très importante. Mais la difficulté vient de ce que nous sommes face à des populations qui continuent à pratiquer des mariages dits coutumiers, qui se font au domicile des familles de façon très peu visible.
Le milieu scolaire reste le principal lieu de repérage de ce genre de mariage.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Dans le premier cas, la jeune fille part en vacances dans le pays d'origine de ses parents et ne revient pas. Elle y a été mariée de force et obligée de rester. Dans le deuxième cas, la jeune fille, mariée de force dans le pays d'origine, revient en France où elle peut déposer une plainte. Le renforcement de la législation a permis de faciliter les annulations de mariages, notamment dans le cas de personnes mariées à quelqu'un d'une autre nationalité. Les auditions faites dans les consulats peuvent également permettre de prévenir ces unions forcées. Mais il reste malheureusement encore des cas qui passent au travers de ces dispositions. Dans le troisième cas de figure, la jeune fille est mariée de force en France, continue à aller à l'école pendant la semaine mais rejoint son époux ou est rejointe par lui pendant le week-end. Lorsqu'elles ont moins de 21 ans et dans certains départements, en fonction de la prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il est possible de conclure un contrat jeune majeur et de verser à la jeune femme une allocation lui permettant, le cas échéant, de poursuivre ses études ou sa formation professionnelle.
Nous essayons d'agir au maximum en prévention, avant le mariage et ses effets – le viol et la séquestration. Cela étant, autant nous pouvons apporter des solutions lorsque l'union a été organisée par la famille, autant il est difficile de faire reconnaître qu'il existe un risque réel avant qu'il se réalise. Si, dans une fratrie, la soeur aînée n'a pas été victime d'un mariage forcé, il est très difficile de se faire entendre à ce sujet.
Comme l'a indiqué le docteur Berger, en France, on essaie avant tout de préserver la cellule familiale. Cela peut faire réagir quand on entend qu'on peut obliger une petite fille victime d'un inceste à aller voir son père en prison. Mais c'est une réalité qui vaut pour toute forme de maltraitance et de violence faites aux femmes, qu'elles soient mineures ou majeures. L'importance donnée au maintien du lien familial a des raisons historiques – on était tombé dans un autre excès auparavant – et ses raisons d'être. Mais c'est une réalité contre laquelle nous butons en matière de mariage forcé et qui nécessite des adaptations.
Le combat que nous menons actuellement est de donner toute sa place à la parole de la personne concernée. On rencontre les parents puis on organise une confrontation entre eux et la jeune fille. Quand vous avez 16 ou 17 ans et que vous avez subi depuis votre plus jeune âge un véritable matraquage psychologique et moral tendant à vous expliquer que vous êtes destinée à une union dont dépend l'honneur de la famille, comment espérer que vous serez capable de redire devant votre père ce que vous avez dit à une association, à une assistante sociale scolaire ou à tel adulte bienveillant ?
Autant on peut être relativement content, même s'il y a des ajustements à faire, de l'avancée enregistrée en matière de mutilations sexuelles féminines, autant on doit déplorer un manque de réflexion de la part des acteurs politiques et sociaux en matière de mariage forcé. Il existe, là aussi, une hétérogénéité des pratiques suivant le lieu où l'on se trouve sur le territoire national ; mais, partout prévaut le maintien du lien familial, de sorte que la victime ou la victime potentielle est ramenée dans sa famille et n'est pas écoutée comme elle le devrait quand elle appelle au secours pour ne pas être mariée de force.
Le nombre de jeunes femmes qui tombent enceintes pour éviter un mariage forcé est encore trop élevé. Cela signifie que l'on n'a pas su apporter les réponses dont elles ont besoin.
(M. Henri Jibrayel remplace Mme Danielle Bousquet au siège de président.)

Nous vous remercions pour ces informations très intéressantes. Notre mission étant chargée à la fois d'une analyse et d'une évaluation de la situation, nous vous saurions gré de nous aider à compléter notre panoplie d'outils d'évaluation dans deux domaines.
Vous avez évoqué la loi d'avril 2006 pour vous réjouir de l'élévation de l'âge du mariage des jeunes filles de 15 à 18 ans, comme pour les garçons. Cette loi contient d'autres dispositions en lien direct avec les thèmes que vous avez abordés. Elle ne devait, au départ, concerner que les violences au sein du couple mais, j'ai été amené, en tant que rapporteur, à proposer à mes collègues de traiter également d'autres questions comme les mutilations sexuelles féminines. Nous avons pris plusieurs mesures à ce sujet, telles que l'allongement des délais de prescription à vingt ans, la levée du secret médical et des dispositions autorisant les poursuites pénales lorsqu'une jeune fille de nationalité étrangère vivant en France va à l'étranger pour subir une excision. Nous souhaiterions connaître votre appréciation sur ces mesures et sur leur éventuel impact, trois ans après la promulgation de la loi.
Nous souhaiterions également avoir votre évaluation de la capacité existant en matière d'hébergement d'urgence pour venir en aide à des jeunes femmes cherchant à échapper à un mariage ou à une mutilation sexuelle. Quelles suggestions pouvez-vous nous faire à ce sujet ?
L'élévation de l'âge du mariage pour les jeunes filles est une avancée essentielle, comme toutes les dispositions de la loi du 4 avril 2006 concernant le mariage et son annulation.
A partir de cela, un « Guide en direction des élus » a été réalisé avec la Mairie de Paris. Nous cherchons maintenant à le diffuser dans d'autres municipalités. Il a pour objet de faciliter la lecture de la loi concernant le mariage forcé et, notamment, de rappeler aux officiers d'état civil qu'ils ont le pouvoir de surseoir à un mariage. Lors des colloques sur la problématique des mariages forcés, il y a toujours des élus qui me font part des difficultés qu'ils rencontrent quand ils sont confrontés à ce cas. Que peuvent-ils faire quand ils ont devant eux une assemblée masculine entourant une jeune fille, seule et en pleurs ? Le « Guide » tiré de la loi du 4 avril 2006 donne une application pratique des dispositions de la loi.
Concernant les mutilations sexuelles féminines, la loi constitue une grande avancée. Elle permet normalement de protéger toutes les enfants résidant habituellement en France, sans conditions relatives à la légalité de leur résidence. Mais nous n'arrivons pas à faire passer ce message. La complexité du contexte, les différences de situations entre les personnes issues des immigrations – situation irrégulière, situation régulière, en voie de régularisation – ont conduit les professionnels à faire une application simplifiée du texte. Le message n'est plus que l'enfant qui réside habituellement sur le sol français est protégée contre l'excision, même si celle-ci est réalisée dans le pays d'origine, mais que l'excision est interdite en France. Il y a des familles dont on sait, avec une probabilité de 99 %, que l'enfant sera excisée si elle va au pays avec ses parents ; et cela arrive tous les jours. J'écris régulièrement aux préfets et aux parquets, en leur rappelant, noir sur blanc, les termes de la loi, pour réclamer des mesures de protection pour ces enfants. Mais dans les faits, cet aspect de la loi n'est pas appliqué.
Pour ce qui concerne l'allongement des délais de prescription à vingt ans après la majorité, il semblerait qu'un certain nombre de victimes l'utilisent, mais dans les parquets les procureurs classent en général l'affaire sans suite, au motif que, comme l'acte n'a pas été perpétré sur le sol français, il est difficile de condamner les auteurs.
En matière d'aide d'urgence, nous devrions parvenir, après beaucoup de difficultés, à la création en 2009, ou au plus tard en 2010, d'un centre d'hébergement dédié aux femmes victimes ou menacées de mariage forcé. Des crédits ont été prévus à cet effet. Nous avons constitué un réseau appelé « Agir avec elles » regroupant des associations nationales travaillant depuis longtemps sur le thème du mariage forcé avec des populations très diversifiées : l'ASFAD – association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates –, Elele (Migrations et Cultures de Turquie), l'association « Voix de femmes » et la Commission pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles.
La loi du 4 avril 2006 est un outil remarquable que nous utilisons au quotidien dans notre travail de formation et de sensibilisation. Son application se heurte malheureusement parfois à celle du droit des étrangers en France, avec lequel il y a parfois un conflit de loyauté.
L'étude de l'INED indique que, sur les 53 000 femmes adultes recensées, 20 % ont été excisées sur le territoire français. Cela signifie que l'excision a été pratiquée en France jusqu'à une date récente.
Dans certains départements, la protection des enfants est assurée grâce à la présence de réseaux. Sur le territoire parisien, dès qu'on a le moindre soupçon, nous avons la chance d'avoir une brigade de protection des mineurs très alerte sur cette thématique, avec des référents « violences » dans les commissariats. En région francilienne, j'ai encore eu, il y a quinze jours, un signalement dans deux départements : les Hauts-de-Seine et la Seine-et-Marne. Là encore, les services réagissent immédiatement.
Par contre, pour deux signalements en région Haute-Savoie, la situation n'a pu être débloquée alors qu'une femme avait porté plainte dénonçant sa propre excision dans le but de protéger sa fille.
À partir du moment où il y a un travail en réseau et une mise en relation des différents partenaires – police, justice, associations –, comme au sein des commissions de prévention des violences faites aux femmes d'Ile-de-France, la protection des enfants est assurée.

Le repli identitaire peut s'exprimer de plusieurs manières comme le montre l'exemple, réel, que je vais citer. Après une vie sexuelle assez libre en France, un homme jeune, né en France, est poussé par sa famille à aller prendre femme au village. Il revient ensuite dans son pays de naissance, la France, et fait venir sa femme après régularisation juridique. Il se trouve alors dans une situation juridiquement et culturellement complexe. Le couple est mixte sur le plan de la culture comme de la nationalité et reproduit les coutumes contre lesquelles se bat la République française : le mariage forcé et l'excision. Le cas que je viens de citer est-il fréquent ? Comment peut-on le gérer ?
Nous sommes en train de réfléchir, notamment avec l'ANAEM – l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations – sur les outils à diffuser dans les pays d'origine afin de préciser le positionnement de la France et l'engagement que tout candidat à l'immigration doit prendre pour venir sur notre territoire. Nous cherchons les moyens de faire passer des messages avant le départ du pays d'origine. Cela répond, d'ailleurs, à une demande récente du conseil de l'immigration. Nous réfléchissons également sur le prochain conseil interministériel qui doit traiter de l'immigration de façon transversale.
Dans le cas des personnes qui sont nées et ont grandi en France et qui sont dans la reproduction de traditions du pays d'origine de la famille, tout dépend du contrôle social exercé par les familles.
Quand un homme, pour reprendre votre exemple, retourne au pays d'origine de sa famille pour se marier, il y a, ensuite, plusieurs cas de figure. Dans le premier, il laisse la jeune femme au pays et continue sa vie en France. Dans le deuxième, l'homme fait venir son épouse en France qui est au service de sa propre mère. Ne connaissant souvent pas le français, elle sera réduite à l'esclavage domestique, première levée et dernière couchée. Un troisième cas de figure se présente quand la femme a suivi un cursus universitaire et occupé un rang social important dans le pays d'origine. S'étant mariée pour pouvoir venir en France où elle espérait avoir plus de liberté et d'opportunités, elle se retrouve voilée et esclave domestique, état qu'elle n'accepte pas du tout. Elle ne parle pas de mariage forcé, mais de mariage arrangé lui ayant permis, avec son accord, de venir en France. Mais, en fin de compte, on se rend compte qu'elle est victime de la situation.
Les parents qui poussent leur enfant à aller se marier au pays le font parce qu'ils considèrent que le fait d'être né et d'avoir grandi en France lui a fait perdre leurs valeurs. Ils veulent que se perpétuent les traditions et la culture qui ont fait leur histoire.
Si certains jeunes hommes et certaines jeunes femmes acceptent ce conditionnement familial – conditionnement que l'école devrait avoir la force de combattre –, un nombre de plus en plus grand de jeunes hommes s'en affranchissent, expriment à leur famille leur opposition au mariage forcé et choisissent eux-mêmes leur conjointe, qui peut être d'une origine différente. Les jeunes filles n'ont malheureusement pas cette possibilité. Elles sont victimes d'une vision inégalitaire des rapports hommesfemmes, d'une image de la femme soumise et obéissante jusqu'à accepter la polygamie. Les femmes sont parfois soumises à des situations inégalitaires extrêmement fortes.

Avez-vous l'impression que votre travail a porté ses fruits et que la situation s'améliore petit à petit ?
La protection de l'enfance étant confiée aux départements, comment ces derniers peuvent-ils faire avancer les choses ?
Vous avez évoqué le risque que des enfants vivant en France aillent dans d'autres pays d'Europe se faire exciser. Un partenariat est-il en train de se mettre en place pour lutter contre ces pratiques sur l'ensemble du territoire européen ?
Dans les collèges et les lycées sont apposées de grandes affiches contre la violence sous toutes ses formes. Une solidarité se manifeste-t-elle vis-à-vis des jeunes filles en danger ? Y a-t-il parfois une mobilisation des jeunes pour les protéger ? Celles-ci alertent-elles parfois leurs camarades de classe ou les professeurs sur les risques qui les guettent ?
La prise en compte de ces problèmes est très hétérogène selon les départements. Il faut reconnaître que tous n'ont pas le même afflux de populations issues de l'immigration. Quand nous avons voulu étendre nos colloques d'information sur les mutilations sexuelles féminines en dehors de la région francilienne, nous avons dû batailler avec certains départements et certaines régions pour leur prouver que ces pratiques existaient sur leur territoire.
La situation s'est bien améliorée. Grâce à la chirurgie reconstructrice, beaucoup de professionnels de santé et de professionnels sociaux se sont autorisés à aborder les mutilations sexuelles féminines, malgré leur aspect culturel qui ralentit beaucoup leur prise en compte.
Le GAMS a jugé utile de créer des antennes régionales dans les régions et les départements où personne ne prenait en charge cette question. Dans certains départements et régions, comme les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Nord-Pas-de-Calais, cela n'a pas été nécessaire car il existait des associations locales sur lesquelles nous pouvions nous appuyer et avec lesquelles nous travaillons en partenariat.
Il reste des résistances liées à l'aspect culturel de ces pratiques. Le département ne peut pas tout faire. La justice a également un rôle à jouer : il est assez désespérant pour un professionnel de la protection maternelle et infantile ou une assistante sociale scolaire de voir un magistrat du parquet des mineurs ne pas décider le placement d'une enfant qui risque de subir une excision, et ne pas même faire un rappel à la loi. Pour prendre une mesure de placement d'une enfant mineure, il faut impérativement une ordonnance provisoire de placement. Informée un mercredi matin qu'un mariage coutumier impliquant une mineure de seize ans allait être organisé dans la nuit du mercredi au jeudi, je me suis entendu dire par un procureur que ce n'était pas possible puisque la loi du 4 avril 2006 interdisait les mariages à seize ans… Plusieurs personnes ont essayé de lui faire comprendre qu'il s'agissait non d'un mariage civil mais d'un mariage coutumier, elle n'a rien voulu entendre. L'aide sociale à l'enfance a pris ses responsabilités et a décidé une mesure de placement mais il y a eu une mainlevée de la famille dans les vingt-quatre heures.
Il y a là un hiatus. S'il n'existe pas un travail commun entre les services du département qui assurent la protection de l'enfance et les services de l'État qui assurent la justice, les victimes peuvent se retrouver dans des situations assez dramatiques.
Le travail de partenariat avec des associations locales s'améliore en dépit de l'hétérogénéité des situations et des pratiques. Dans certains endroits, le modèle que nous avons conçu en région parisienne a été reproduit et fonctionne bien car sont enfin réunis autour de la même table des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales, de l'Éducation nationale, de la police et de la justice. Le travail en commun de toutes ces composantes concourt à faire avancer les choses.
Le partenariat au niveau européen est plus difficile à réaliser, la principale raison étant que la France mène depuis longtemps une politique intégrationniste et assimilationniste tandis que nos partenaires européens appliquent depuis longtemps une politique communautariste.
L'Angleterre s'est dotée en 1985 d'un texte de loi pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines, mais elle ne l'a jamais appliqué, tout en continuant son travail d'information et de prévention. En revanche, elle a mis en place des dispositifs pratiques, dont nous pourrions nous inspirer, pour empêcher le départ d'une jeune fille en danger de mariage forcé ou pour l'héberger.
Les Pays-Bas sont très avancés dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines et se sont inspirés de ce qui se fait en France. Pour éviter les mariages forcés, ils ont déjà, comme l'Allemagne, des centres d'hébergement dédiés pour les victimes réelles ou potentielles.
Les avancées ne sont pas égales d'un pays européen à l'autre, mais les situations non plus. La France est moins confrontée aux crimes d'honneur que les pays que je viens de citer où il s'en perpétue un ou deux par mois, contre un ou deux par an en France. L'Italie a une population sénégalaise relativement importante, mais les migrants viennent essentiellement d'une ethnie, les Wolof, qui ne pratique pas l'excision, tandis qu'arrivent en France des populations d'une même région, qui traverse le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, pour qui cette pratique est très forte.
Nous travaillons à la mise en place de partenariats en Europe depuis bientôt neuf ans et nous poursuivons nos efforts. Les parlementaires européens réfléchissent à une homogénéisation des pratiques.
Dans les collèges et les lycées se manifestent parfois localement des volontés de faire avancer les choses et, dans ce cas, elles avancent très bien. Mais l'obligation d'un travail de prévention n'existe pas au niveau de l'Éducation nationale. Nous regrettons que les associations spécialisées dans le problème du mariage forcé doivent solliciter rectorat par rectorat l'autorisation d'intervenir dans les établissements scolaires, faute de directive nationale le prévoyant.
La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.