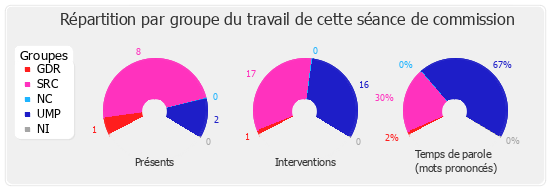Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
Séance du 2 juin 2009 à 16h00
La séance
La mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a auditionné des représentants du collectif ADFEM, Action et droits des femmes exilées et migrantes : Violaine Husson, de la CIMADE, Claudie Lesselier, du Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées (RAJFIRE), Irène Ansari, de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie (LFID), Élisabeth Zucker, du Réseau éducation sans frontières (RESF), Khalda Vescovacci, du Comité médical pour les exilés, Comède.
Présidence de M. Henri Jibrayel, vice-président

Nous avons le plaisir de recevoir les représentantes du collectif ADFEM – Action et droits des femmes exilées et migrantes. Sont donc présentes Violaine Husson, pour la CIMADE ; Claudie Lesselier, du Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées, RAJFIRE ; Irène Ansari, pour la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, LFID ; Élisabeth Zucker, du Réseau éducation sans frontières, RESF ; et Khalda Vescovacci, pour le Comède, Comité médical pour les exilés.
Mesdames, je vous laisse la parole.
L'ensemble des dispositifs législatifs et des politiques publiques de prévention des violences à l'encontre des femmes et de défense des droits des victimes doit inclure les femmes de toute nationalité, de toute origine, quelle que soit leur situation administrative.
Or, des femmes de nationalité étrangère vivant en France sont particulièrement vulnérables, car elles rencontrent des obstacles pour se libérer des violences en raison de leur situation administrative. Les femmes sans titre de séjour, en particulier, rencontrent de très grandes difficultés. Nous considérons que la défense des droits humains des femmes ne doit pas être conditionnée à la régularité de leur situation administrative.
En outre, les violences contre les femmes ont aussi à voir avec la question du droit d'asile lorsque des femmes qui sont persécutées dans leur pays demandent l'asile en France.
Si nous n'avons pris ce nom que l'année dernière, Action et droits des femmes exilées et migrantes – ADFEM – a été créée il y a cinq ans. Cette coordination regroupe les associations représentées aujourd'hui et d'autres, comme la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés – FASTI – ou encore la Fédération nationale Solidarité femmes qui lutte contre les violences conjugales.
Aujourd'hui nous interviendrons sur un ensemble de problèmes que nous avons repérés au travers de notre expérience de terrain : délivrance et renouvellement des titres de séjour ; traite des êtres humains, proxénétisme, esclavage moderne et polygamie ; droit d'asile ; droits sociaux ; plainte et aide juridictionnelle. Nous voulons souligner que, s'il y a eu des avancées législatives, la situation demeure très imparfaite.
Premier sujet : Que se passe-t-il en cas de violences provoquant une séparation ?
Les avancées législatives de 2003, 2006 et 2007 prennent en compte la violence conjugale, notamment lors de la délivrance du premier titre de séjour. S'il y a donc eu des améliorations dans ce domaine, des difficultés persistent.
Une personne mariée à un français ou qui arrive au titre du regroupement familial pour rejoindre son conjoint en situation régulière, doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour si des violences conjugales ont été commises entre l'arrivée sur le territoire français et la délivrance du premier titre de séjour. Or, dans les faits, les préfectures appliquent très mal ces dispositions, refusent le dépôt du dossier ou se limitent à délivrer des récépissés pour des délais anormalement longs.
Par ailleurs, le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA) ne prévoit pas le cas des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire français pour rejoindre leur conjoint français ou leur conjoint qui réside en situation régulière sur le territoire français, non plus que pour celles qui sont unies par un PACS ou qui vivent en union libre. Pourtant, elles aussi peuvent subir des violences conjugales. Il faut combler ce vide législatif.
Pour le renouvellement du titre de séjour des conjointes de français entrées avec un visa de long séjour ou des conjointes d'étranger en situation régulière entrées au titre du regroupement familial, victimes de violences conjugales les conduisant à rompre la communauté de vie, certaines préfectures demandent la reconnaissance d'un divorce pour faute, d'autres la condamnation pénale du mari. Or la procédure pénale est extrêmement longue et complexe et les femmes voient leur demande de renouvellement rejetée car elle ne correspond pas aux conditions arbitrairement ordonnées par les préfectures. Ainsi une femme qui décide de rompre la vie commune en raison de violences conjugales est punie d'avoir voulu se protéger… Nous demandons donc que le renouvellement du titre de séjour de ces femmes victimes ne relève plus du pouvoir discrétionnaire des préfets et que les pratiques des préfectures visant notamment à demander des documents qui ne correspondent pas à des conditions légales requises (telles que la condamnation pénale du conjoint), cessent
D'autre part, les femmes de nationalité algérienne ne se voient pas appliquer les dispositions du CESEDA, dispositif du droit commun. En effet, les accords franco-algériens de 1968, modifiés pour la dernière fois en 2002, ne prennent pas en compte les lois de 2003, 2006 et 2007. Si elles sont victimes de violences conjugales, elles ne peuvent bénéficier du pouvoir discrétionnaire du préfet pour le renouvellement de leur titre de séjour. Il y a là une grande discrimination. Les tribunaux et les cours d'appel estiment que c'est l'accord franco-algérien qui doit être appliqué et non le CESEDA. Nous demandons donc que les dispositions plus favorables du code soient appliquées aux Algériennes de la même façon qu'aux Tunisiennes, pour lesquelles, selon la jurisprudence du tribunal administratif, le code s'applique si rien n'est prévu dans l'accord franco-tunisien.
Enfin, en cas de décès du conjoint français, le renouvellement du titre de séjour des conjointes est laissé à la discrétion du préfet. Une femme arrivée en France avec un visa long séjour, qui entre dans la catégorie de plein droit, mais dont le mari décède avant le renouvellement de son titre de séjour, n'a plus droit à rien : c'est le préfet qui décide. Nous demandons que le législateur règle ce problème. Pour les personnes de nationalité algérienne, rien n'est prévu en cas de rupture de la vie commune suite à un décès
Le problème de la dépendance administrative concerne aussi les hommes : un conjoint, homme ou femme, perd ses droits au séjour en cas de rupture de la vie commune, même si celle-ci est causée par un décès, ce qui entraîne des situations dramatiques.
S'agissant de la traite des êtres humains, du proxénétisme et de l'esclavage moderne, délits sanctionnés par le code pénal, les victimes sont très majoritairement des femmes.
Dans ce domaine aussi, nous avons constaté quelques avancées dans la législation. le CESEDA prévoit qu'une victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme peut se voir délivrer un titre de séjour, mais à condition de porter plainte contre les trafiquants ou les proxénètes. Le renouvellement de ce titre est soumis au pouvoir discrétionnaire du préfet. En fait, tout dépend de l'issue de la procédure pénale, comme si la victime était responsable de l'arrestation ou de la condamnation des proxénètes !
La loi prévoit aussi des structures d'hébergement et d'accompagnement social des victimes, traumatisées et souvent dans une situation extrêmement précaire.
Ces quelques avancées, obtenues ces dernières années grâce à la mobilisation des associations, nous paraissent très imparfaites. Nous demandons que les victimes de la traite et du proxénétisme obtiennent de plein droit la délivrance et le renouvellement du titre de séjour, à condition qu'elles rompent avec les proxénètes ou les trafiquants. Nous revendiquons précisément ce titre de séjour pour qu'elles puissent se libérer de cette exploitation. Mais nous demandons que la condition du dépôt de plainte ne soit pas impérative car les femmes ont peur de porter plainte en raison du risque de représailles, notamment contre leur famille. Nous demandons également une application effective des dispositifs d'hébergement et d'accompagnement social prévus par la loi, qui demeurent très insuffisants par rapport aux besoins alors qu'ils sont absolument nécessaires.
Le vide juridique et administratif est encore plus grand pour les femmes et les jeunes filles confrontées à des situations d'esclavage domestique. Aux termes du code pénal l'esclavage moderne est un délit, le fait d'« imposer des conditions de travail et d'hébergement contraire à la dignité humaine ». Dans la pratique, les préfectures exigent que la femme porte plainte et que les poursuites pénales aboutissent à la condamnation des exploiteurs. Or d'après le Comité contre l'esclavage moderne beaucoup de plaintes n'aboutissent pas faute de preuves : les exploiteurs nient leurs actes et la personne soumise à l'esclavage, enfermée au domicile, n'a ni témoin ni document qui permettent à la justice de se prononcer. De surcroît, en raison du lien familial fréquent entre les exploiteurs et leur victime, le risque de représailles les dissuade de porter plainte. Afin que les victimes d'esclavage, de la traite et de prostitution puissent se libérer, elles doivent bien entendu apporter des éléments sur leur situation – par exemple un récit probant après un contact avec des associations compétentes –, mais nous demandons surtout qu'elles se voient délivrer un titre de séjour, même en l'absence de procédure pénale et même si celle-ci n'aboutit pas, car elle aboutit rarement.
Si la polygamie est illégale sur le territoire français depuis 1993, elle est encore une réalité, sans être quantifiée. Ces femmes sont sans titre de séjour et n'ont pas pu bénéficier du regroupement familial. Elles sont dans une très grande dépendance, notamment économique, vis-à-vis de leur conjoint : elles ne peuvent pas travailler et elles sont sans ressources. Nous insistons sur le fait qu'elles n'ont pas choisi d'être dans cette situation, leur mariage ayant toujours été arrangé par les familles.
Certes, elles peuvent bénéficier d'une régularisation si elles décohabitent et divorcent, mais encore faudrait-il qu'elles disposent d'un endroit où aller avec leurs enfants et d'un minimum de ressources.
Nous partageons entièrement les analyses et les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui s'est penchée sur ce cercle vicieux dans son rapport du 9 mars 2006. Elle préconise d'aider ces femmes à mener, dans la sécurité, un parcours de décohabitation, en les faisant bénéficier, de façon globale et simultanée – c'est essentiel car ce processus ne peut pas se faire par étapes – d'un premier titre de séjour et d'un accompagnement social et juridique leur permettant de travailler, d'avoir des ressources et un logement, pour pouvoir in fine entamer une procédure de divorce. Ce rapport extrêmement important semble être passé aux oubliettes, c'est bien dommage. Nous demandons que ces recommandations soient prises en compte
Beaucoup de femmes victimes de persécutions liées au fait d'être une femme et non protégées par les autorités de leur pays se voient refuser l'asile ou accorder seulement la protection subsidiaire, statut plus précaire que celui de réfugié. Nous demandons la reconnaissance, dans le cadre de la Convention de Genève, du statut de réfugié pour les femmes victimes ou menacées de persécutions en tant que femmes. Nous demandons aussi que toutes les personnes accueillant les femmes à l'Office de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA – soient formées et informées des problématiques des persécutions de genre en général et dans les différents pays. Nous demandons en outre l'abrogation de la liste des « pays sûrs », car aucun pays n'est sûr pour les femmes. De façon générale, nous demandons une meilleure prise en charge des femmes en tant que demandeuses d'asile.
Établie il y a quelques années par l'OFPRA, la liste des pays sûrs comprend une douzaine de pays considérés comme démocratiques, notamment le Mali, le Sénégal, l'Inde, la Bosnie. Les ressortissants de ces pays peuvent faire une demande d'asile mais celle-ci est traitée en procédure prioritaire, c'est-à-dire sans admission au séjour. Autrement dit, pendant tout le temps de leur demande, ils n'entrent pas dans le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile et ne reçoivent pas la prestation sociale dont bénéficient les demandeurs d'asile. Cela concerne bien entendu les hommes comme les femmes, mais ces dernières sont dans une grande précarité, sans ressources et sans hébergement, donc vulnérables à toutes sortes de violences et de dépendance.
Les officiers de protection de l'OFPRA qui auditionnent les demandeuses d'asile originaires des pays dans lesquels les violences contre les femmes sont légalisées ignorent totalement la situation de ces pays. Il est donc nécessaire qu'ils bénéficient d'une formation initiale et continue sur la situation de ces pays et leur législation.
Les demandeuses d'asile iraniennes, en particulier, s'entendent poser des questions aberrantes, du style : « Madame, puisque vous êtes victime de violences conjugales, pourquoi n'allez-vous pas vous plaindre au commissariat pour être hébergée dans un lieu sûr ? ». Mais les violences contre les femmes en Iran sont légalisées ! Et des lieux pour les femmes violentées par leur conjoint ou l'homme de la famille n'y existent pas !
Nous refusons le glissement de plus en plus systématique du statut de réfugié vers la protection subsidiaire. L'arrêt Kona du 25 mars 2009 a d'ailleurs dénoncé « l'élargissement artificiel du statut de la protection subsidiaire ».
Enfin, la majorité des personnes obtiennent l'asile ou la protection subsidiaire non pas devant l'OFPRA mais à l'occasion d'un recours à la Commission des recours des réfugiés – CNDA – ce qui témoigne d'un grave dysfonctionnement.
La problématique des droits sociaux découle de tout ce qui a été décrit par mes collègues. Une femme qui se sépare de son conjoint, concubin ou mari à la suite de violences conjugales, si elle est sans titre de séjour ou se le voit retirer, perd ipso facto tous les droits que lui ouvrait la vie commune, notamment les prestations familiales et l'accueil de ses enfants dans des structures collectives. L'accès à des structures d'hébergement est très limité.
La première condition pour que les personnes sans titre de séjour perçoivent des prestations est l'ouverture d'un compte bancaire. Toute personne a le droit d'avoir un compte bancaire, droit consacré dans la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions (article L.312-1 du code monétaire et financier). Bien qu'aucun texte n'exige la régularité de séjour, la plupart des banques refusent l'ouverture du compte et ne notifient pas un refus écrit qui permettrait de s'adresser à la banque de France, comme la loi le prévoit. C'est sous la menace d'un courrier à la direction de la banque ou d'un recours à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité – HALDE, car il s'agit bien d'un cas de discrimination – que nous avons pu obtenir l'ouverture du compte. Nous demandons donc que les banques appliquent les dispositifs légaux pour permettre aux personnes d'avoir accès à leurs droits et pour nous éviter tous ces recours.
Si une femme quitte le domicile de son conjoint par lequel elle avait accès aux prestations sociales, celui-ci peut continuer à percevoir les allocations familiales jusqu'à ce que la preuve soit apportée qu'il n'a plus la charge des enfants. Mais si les allocations versées au conjoint en situation régulière sont supprimées, ce n'est pas pour autant que la femme sans titre de séjour peut les percevoir. Les caisses d'allocations familiales ne versent finalement pas les prestations auxquelles les enfants ouvrent droit.
Nous demandons donc que soit pris en compte l'intérêt de l'enfant et non la situation administrative du parent au regard du séjour.
Certaines caisses acceptent de verser les allocations familiales, d'autres pas. Certes, elles sont indépendantes, mais une telle disparité est regrettable et nous sommes obligés de faire appel aux tribunaux administratifs de la sécurité sociale, à la Défenseure des enfants et à la HALDE pour que les gens aient accès à leurs droits.
Actuellement, les structures d'hébergement du type CHRS ne sont de fait pas accessibles aux femmes sans titre de séjour. Cette exclusion place les femmes dans une situation de très grande vulnérabilité. Elles se trouvent dans un cercle vicieux : soit elles restent au domicile du conjoint violent, soit elles se retrouvent à la rue.
Autre problème : quand un homme veut se débarrasser de sa femme, non seulement il la met dehors après l'avoir battue, mais il peut la dénoncer à la préfecture ou porter plainte contre elle. Nous connaissons des cas où une enquête sociale a été lancée par l'Aide sociale à l'enfance et, la femme n'ayant pas de ressources ni d'hébergement stable, l'ASE a voulu lui retirer ses enfants pour les placer.
S'agissant enfin de l'accueil de la petite enfance, les choses varient beaucoup selon les crèches, certaines refusant d'accueillir les enfants de parents sans titre de séjour. Nous demandons donc une égalité d'accès aux structures d'accueil.
Dans tous les cas évoqués – traite, esclavage moderne, mariage forcé, violences conjugales, etc. –, les préfectures demandent des preuves matérielles des violences physiques, notamment des certificats médicaux, mais aussi un dépôt de plainte. Or, il est déjà difficile à toute personne victime de violences de raconter sa vie dans un commissariat ou une gendarmerie. Les femmes que nous rencontrons se heurtent à un obstacle supplémentaire lié à leur situation irrégulière ou régulière précaire, beaucoup d'entre elles étant dans l'attente du renouvellement d'un titre de séjour d'un an.
Certaines ne portent pas plainte par manque de connaissance de leurs droits, mais elles sont aussi confrontées à certaines pratiques policières. En venant au commissariat ou à la gendarmerie, certaines sont menacées d'interpellation au regard de leur situation, parfois insultées – « comment peut-on déposer plainte contre un ressortissant français ! ». D'autres se voient refuser de déposer plainte ou amenées à faire seulement une main courante. Nous constatons de telles pratiques quotidiennement. Il est très difficile pour ces femmes d'aller au commissariat, d'être en confiance, d'arriver à expliquer leur situation, de porter plainte contre leur conjoint ou une personne de la famille, ou tout simplement de se voir remettre une photocopie de leur plainte.
Des décisions de justice rappellent qu'une victime de violences conjugales en situation régulière, régulière précaire ou irrégulière est effectivement une victime. Nous demandons donc que la loi soit appliquée. Nous demandons également que ces femmes, certes en infraction sur le territoire français au regard de leur situation, ne soient pas interpellées et ne se heurtent pas au refus des policiers de prendre leur plainte. Nous demandons que les agents dans les commissariats et les gendarmeries soient formés et informés. Si des avancées ont été constatées dans certains commissariats, notamment via la mise en place des référents violences conjugales, ce n'est pas le cas partout.
Si les demandeurs d'asile peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle depuis décembre 2008, les personnes résidant habituellement sur le territoire français mais de manière irrégulière ne peuvent pas bénéficier d'un avocat commis d'office. L'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit toutefois des exceptions, notamment pour « les situations particulièrement dignes d'intérêt ». Une victime de violences est bien dans une situation particulièrement digne d'intérêt, d'autant plus que, par exemple, l'avocat est obligatoire pour la procédure de divorce.
Nous demandons que soit intégrée dans la loi la possibilité pour les personnes victimes de violences conjugales, de la traite, de l'esclavage moderne ou de toute autre violence de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Nous avons souvent été appelées au secours par des femmes de nationalité étrangère résidant régulièrement en France, victimes de violences dans leur pays d'origine où elles se trouvaient en vacances ou pour un court séjour, leur conjoint ou leur famille leur ayant confisqué leurs papiers dans le but de les empêcher de revenir en France. Nous avons remarqué à quel point les représentations diplomatiques françaises sont lentes à faire ce qui est pourtant légal, à savoir délivrer un visa retour pour ces personnes.
Si une femme – ou un homme - de nationalité française a des problèmes graves de violences à l'étranger, il ou elle peut bénéficier d'une assistance des représentations consulaires. Nous demandons donc que les femmes étrangères résidant en France en situation régulière et les femmes binationales (si elles ont la nationalité du pays dans lequel elles voyagent) puissent bénéficier de la même assistance de la part des représentations diplomatiques françaises. Car là aussi, il y a une discrimination, une inégalité flagrante.

Merci, Mesdames, pour votre exposé concis et précis.
A-t-on une idée du pourcentage de ces femmes victimes des violences de toute nature ?
Vous nous dites que les préfets devraient être mis devant une forme d'obligation plus évidente qu'aujourd'hui de ne pas mettre en difficulté les femmes victimes de violences en situation régulière et donc de maintenir leur séjour.
Nous réfléchissons à l'idée d'une ordonnance de protection qui serait le premier acte judiciaire par lequel un juge, estimant être en présence de suffisamment d'éléments faisant apparaître des violences, déciderait dans l'urgence de protéger la victime. Ne pourrait-on pas, lier la décision du préfet à celle du juge établissant cette ordonnance de protection ? Car face à une source judiciaire valide, le préfet pourrait prendre des dispositions de manière plus systématique.
Vous expliquez que si les femmes victimes de proxénétisme, pour la plupart en situation irrégulière, déposent plainte, leur ex-souteneur les menace, elles et leurs proches. Je le comprends, mais quelle est la solution, car s'il n'y a pas plainte, il n'y a pas poursuite ! Or il faut accorder la protection à ces femmes sans arriver à une totale impunité du proxénète.
Le dispositif à trouver ne peut-il pas être également du type de l'ordonnance de protection ? Car même si l'on évite à la victime de déposer plainte – et je le dis toujours sans provocation –, le parquet a le devoir de poursuivre, d'engager l'action publique s'il estime être en possession d'éléments faisant apparaître un réseau de prostitution dont au moins une victime est connue. Et dans ce cas-là, il y a toujours risque de représailles contre les femmes.
Quelles solutions nous proposez-vous pour aller dans le sens de vos demandes, auxquelles j'adhère dans l'esprit, mais sans fragiliser l'ensemble du dispositif et, partant, l'intérêt de la victime ?
Il ressort de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, réalisée en 2000 que les femmes étrangères ou d'origine étrangère sont proportionnellement un peu plus nombreuses que les autres à subir des violences. Cependant, tout le monde s'accorde à dire que ces violences sont très sous-estimées, car beaucoup de ces femmes ne disposent pas d'un téléphone fixe, ne parlent pas le français ou hésitent à répondre à ce genre d'enquête.
Des enquêtes sont réalisées à partir des sources associatives. Je pense au livre du sociologue Smaïn Laacher sur les violences faites aux femmes étrangères, publié il y a quelques mois à partir d'appels de femmes et de jeunes filles à des associations. Mais les données chiffrées ne sont que le sommet de l'iceberg car, qu'elles soient françaises ou étrangères, beaucoup de femmes ne portent pas plainte, ne s'adressent pas à une association, ne contactent personne.
Par conséquent, on ne dispose pas de données globales et ventilées par nationalité ou origine. À partir de nos expériences de terrain, nous nous rendons compte que le nombre de femmes étrangères violentées peut être important ; je pense que les femmes reçues dans les permanences de nos associations ne représentent qu'une toute petite partie des femmes étrangères victimes.
Bien entendu, nous souhaitons que les victimes portent plainte. Nous refusons l'impunité des agresseurs, des violeurs, des proxénètes. Il n'empêche que, malgré nos efforts et les incitations à porter plainte, il y aura toujours des personnes pour qui cette démarche paraîtra insurmontable et dangereuse. Ces difficultés sont accentuées pour les femmes étrangères, car elles sont souvent isolées – en arrivant en France, elles n'ont pas de famille, pas d'ami –, elles ne maîtrisent pas toujours le français, et leur titre de séjour est précaire.
En tout cas, nous notons votre proposition d'une ordonnance de protection prise dans l'urgence et nous allons réfléchir à ce dispositif avec les autres associations luttant contre les violences faites aux femmes.
Quand nous exprimons notre opposition à l'usage par les préfets de leur pouvoir discrétionnaire, c'est parce qu'il permet trop d'arbitraire, soit d'une préfecture à l'autre, soit d'une personne à une autre. Nous connaissons deux femmes dont la situation est identique : l'une s'est vu renouveler son titre de séjour, l'autre pas. Pourquoi une telle disparité ? Nous souhaitons donc que la loi dispose dorénavant que le préfet « doit », et non pas « peut », renouveler le titre de séjour en cas de violences.

Vous avez parlé de situation régulière précaire, expression qui résume bien la situation.
Connaissez-vous le pourcentage de femmes dans cette situation par rapport à celles qui sont titulaires d'un titre de séjour ? Sont-elles en augmentation ? J'ai moi-même été confrontée à plusieurs reprises au cas de femmes n'arrivant pas à obtenir le renouvellement de leur titre de séjour au décès du conjoint. En outre, il est aujourd'hui très difficile pour les femmes étrangères d'obtenir une carte de dix ans, d'où le risque pour elles de se retrouver à la merci du conjoint violent.

Des femmes étrangères en situation irrégulière qui ont été victimes de violences au sein de leur couple ont-elles été expulsées ? Disposez-vous de chiffres ?

Notre ordre juridique n'est pas dépourvu de moyens d'action. Je voudrais rappeler avec insistance que l'article 40 du code de procédure pénale s'impose à tout serviteur de l'État, le préfet en tête, car il est le représentant de l'État !
Nous sommes dans un État républicain dont la politique en matière d'immigration est celle du gouvernement, mais nous ne sommes dans une autre logique à partir du moment où une violence est constatée ! Un fonctionnaire, quel qu'il soit, informé d'une telle situation ou d'une suspicion forte de violence, se doit – c'est la loi – de la signaler au juge. Ensuite, ce dernier sait ce qu'il doit faire.
Il y a une sorte de confusion, d'inversion entre le rôle de l'article 40 et les instructions reçues de leur hiérarchie par les services administratifs des préfectures. Je ne souhaite pas voir notre droit encombré par un dispositif supplémentaire, le code de procédure pénale disposant déjà que l'État républicain doit protéger contre la violence.

Vous avez évoqué des solutions pour permettre aux femmes en situation de polygamie de partir et de vivre normalement dans notre pays. Mais si la femme part, elle est remplacée ! Comment faire pour que les choses ne se reproduisent pas constamment ?
Quantifier le nombre de personnes en situation régulière précaire est très compliqué ; nous n'avons pas de chiffres. En revanche, nous recevons depuis un an et demi dans nos permanences un très grand nombre de personnes dans ces situations que l'on qualifie de « régulière précaire », car de plus en plus de préfectures délivrent des récépissés pendant deux ans. Autrement dit, la personne se rend à la préfecture tous les mois en espérant obtenir un titre de séjour, auquel elle pourrait prétendre parfois de plein droit, mais se voit indéfiniment délivrer un récépissé. C'est un obstacle supplémentaire pour que la victime de violences trouve du travail, un hébergement, ait une nouvelle vie.
Les statistiques du ministère de l'intérieur ou de l'immigration présentées dans le rapport au Parlement sur la politique d'immigration font apparaître le nombre important de titres de séjour d'un an par rapport aux titres de résident de dix ans.
Désormais, les conjoints de Français, par exemple, n'ont que des cartes d'un an, renouvelables chaque année pendant trois ans ; c'est seulement au bout de la troisième année qu'elles peuvent avoir une carte de résident. Une personne qui vient rejoindre son conjoint au titre du regroupement familial a aussi une carte de séjour d'un an. Il est possible de demander une carte de résident au bout de cinq années de carte de séjour « vie privée vie familiale », mais cela relève là encore du pouvoir discrétionnaire du préfet. Je pense aussi aux personnes qui ont un titre de séjour pour raison médicale : même en cas d'affection de longue durée, comme le VIH, qui n'est pas guérissable et demande un traitement à vie, ne sont délivrés que des titres de séjour d'un an et il faut chaque année redéposer sa demande, avec toujours le risque de non-renouvellement.
Nous pourrons vous envoyer une note statistique sur ces situations régulières, mais précaires.
La délivrance d'un titre de séjour d'un an concerne une grande partie des nouveaux immigrés – des migrants actuels ou de ceux qui ont migré il y a cinq ou dix ans. La proportion de femmes y est très importante car, toujours d'après les statistiques du rapport au Parlement, elles sont plus nombreuses que les hommes à venir soit dans le cadre du regroupement familial, soit en tant que conjointe de français, soit à se voir délivrer une carte de séjour temporaire en raison de leurs liens personnels et familiaux en France.
Nous avons connaissance de cas de femmes en situation irrégulière, interpellées et reconduites à la frontière après avoir porté plainte. Le dernier, dont la presse a fait état, concerne une jeune marocaine dans le Nord de la France ; mais il y a certainement d'autres cas dont personne n'est averti.

Le fait de subir des violences dans le pays d'origine facilite-t-il l'octroi de l'asile en France ?
Par définition, l'asile concerne des personnes qui sont persécutées dans leur pays. Si la notion de persécution n'est définie nulle part, la jurisprudence estime qu'il s'agit de faits graves mettant en danger la vie ou la liberté de la personne et l'exercice de ses droits fondamentaux. Bien entendu, ces persécutions doivent être établies, d'où l'audition à l'OFPRA. Ce sont les conditions fondamentales telles qu'elles sont exposées dans la Convention de Genève.
Depuis le début des années 2000, des femmes obtiennent l'asile en raison de persécutions liées au genre. Il peut s'agir de petites filles menacées d'excision, de jeunes femmes menacées de mariage forcé, de crime d'honneur, parfois même de violences domestiques. Il y a donc un progrès, mais encore beaucoup de disparités et d'insuffisances et, comme cela a été dit, une tendance assez significative au glissement du statut de réfugié à la protection subsidiaire. Symboliquement, la protection subsidiaire créée par une loi française est d'une valeur inférieure au statut de réfugié – statut international, issu de la Convention de Genève – et moins protectrice, car avec une carte d'un an seulement la personne est en situation régulière précaire alors que le statut de réfugié donne droit à une carte de résident de 10 ans.
La polygamie est un système patriarcal coutumier très ancien, une structure sociale, familiale qui continue à se reproduire dans un certain nombre de pays. Les hommes font venir en France plusieurs épouses en profitant clairement du fait qu'elles sont en situation irrégulière afin de pouvoir les dominer, les maintenir dans une dépendance. Comme pour l'excision, une action est nécessaire à la fois dans les pays d'origine (ou d'ailleurs des femmes combattent la polygamie) et en France.
Mais, dans l'immédiat, nous devons nous préoccuper de ces femmes arrivées en France depuis plusieurs années, dont les enfants sont nés ici, et qui, de ce fait, ne peuvent pas repartir dans leur pays où elles se retrouveraient dans totale marginalisation sociale, communautaire, voire subiraient un remariage imposé par les familles.

Avez-vous été confrontées à des situations d'esclavage moderne et notre législation est-elle suffisante en la matière ?
Effectivement, il y a des situations d'esclavage moderne. Nous travaillons beaucoup avec le Comité contre l'esclavage moderne qui a énuméré des conditions pour identifier une personne victime d'esclavage moderne
Comme pour la traite, afin de pouvoir prétendre à un titre de séjour, il faut porter plainte. Or ces personnes étant parfois séquestrées pendant, par exemple, sept à dix ans, voire plus, il est très difficile d'apporter la preuve qu'elles ont été contraintes de vivre dans des conditions indignes pendant tant d'années. En outre, les victimes ont peur de porter plainte en raison du risque de représailles dans le pays d'origine, les exploiteurs ayant souvent la même nationalité qu'elles.
Dans ces cas-là, nous ne nous appuyons pas forcément sur le CESEDA, mais poussons les gens à faire une demande d'asile, car un dispositif, mis en place par la loi de sécurité intérieure, fixe une sorte de donnant-donnant : si l'on porte plainte, on « peut » – toujours à la discrétion du préfet – obtenir un titre de séjour. La demande d'asile doit donc être détaillée et précise sur les conditions de l'esclavage : combien de fois la personne mangeait-elle par jour, à quelle heure se couchait-elle, que faisait-elle toute la journée, où dormait-elle, y avait-il des sévices… ? Nous arrivons à obtenir des protections subsidiaires, car il est difficile d'obtenir un statut de réfugié ; mais nous avons les deux. Et lorsque la personne obtient la protection subsidiaire, elle parvient parfois à se reconstruire et à porter plainte.
La mission aensuite auditionné M. Bernard Bétremieux, directeur de l'association « je.tu.il » et de Mme Virginie Dumont, psychologue.

Pour faire évoluer les représentations stéréotypées et les modèles de relations conflictuelles, qui sont les prémices des violences commises contre les femmes, il faut agir en amont auprès des enfants. Votre association accomplit un travail très intéressant sur ce thème, à travers des outils spécifiques sur la sexualité et les relations entre les garçons et les filles. C'est pourquoi nous avons souhaité vous entendre dans le cadre de notre mission d'évaluation.
Nous sommes très honorés de vous apporter notre contribution. Notre association, composée de huit personnes, intervient au sein des collèges parisiens qui le souhaitent. Elle bénéficie du soutien de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes de la Mairie de Paris, des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la santé et de la justice, du conseil régional et du groupement régional de la santé publique.
Depuis 2003, nous présentons aux jeunes adolescents programme d'éducation à la responsabilité sexuelle et affective dans un but de prévention des violences qui s'intitule « Cet autre que moi ».
Nous formons également des adultes en province, car nous pensons qu'il est important que ceux qui sont chargés d'encadrer les jeunes travaillent leur propre relation à la sexualité.
Au cours d'une année scolaire, nous intervenons dans une quarantaine de collèges parisiens, soit auprès de 3 800 jeunes environ. Ces interventions se déroulent suivant un protocole bien fixé : au cours de réunions préparatoires avec l'équipe éducative, médico-sociale et administrative de l'établissement, nous déterminons les classes dans lesquelles nous souhaitons intervenir, le nombre de nos interventions – qui va de deux à quatre – et leur répartition au cours du trimestre.
Nous réalisons des évaluations à partir de questionnaires diffusés auprès des jeunes, avant, pendant et à l'issue du travail que nous réalisons ensemble. Ces évaluations, supervisées par le sociologue Étienne Douat, extérieur à l'association, nous permettent de comprendre les préoccupations des jeunes. Force est de constater que bien souvent, ce que nous apprenons d'eux va à l'encontre des stéréotypes dans lesquels nous les enfermons quelquefois, influencés que nous sommes par les médias et par leur vision négative de l'adolescence.
Nous intervenons le plus souvent en quatrième, auprès d'enfants généralement âgés de treize à quatorze ans. À l'âge de la puberté et de la découverte des pulsions sexuelles, il faut que les enfants puissent mettre des mots sur leurs émotions. Car avant de leur demander d'être responsables, il faut aider les jeunes à se comprendre. En quatrième, les élèves sont tous différents : les uns sont encore des enfants, les autres de jeunes adultes pubères, dont certains se vantent d'avoir été confrontés au premier rapport sexuel. Cette « première fois », objet de fantasme, est aussi la cause de relations violentes. Mettre des mots sur leur développement apaise les jeunes et leur permet de se construire à partir d'autre chose que ce modèle essentiellement viril que leur proposent les médias. Notre programme de prévention a pour objectif de les aider à aborder le sentiment amoureux et les conduit à s'interroger sur des sujets comme l'homophobie, la rumeur, les différences ou encore les viols en réunion ou la situation des femmes battues.
Notre démarche est citoyenne, car elle aide les jeunes à accepter les différences entre les filles et les garçons et à comprendre que chaque personne humaine peut être sensible et vulnérable.
Quelques jeunes filles lors d'une récente évaluation ont déclaré : « Pour la première fois, j'ai pu entendre d'autres points de vue que le mien », ou encore : « J'ai beaucoup aimé toutes ces séances, car pour une fois toute la classe participait ensemble sans se disputer ». Nombreux sont les jeunes qui reconnaissent à quel point il est intéressant d'entendre des avis différents du leur. Pour mener à bien notre action éducative, nous devons veiller à ne pas identifier les jeunes aux dangers que nous redoutons pour eux.
Notre association travaille sur les thématiques de l'adolescence : le sentiment amoureux, les pulsions et leur contrôle, l'image et l'estime de soi, le respect. Ce dernier est important car la plupart du temps, les jeunes associent le sentiment de respect à la peur. Nous les aidons à évoluer sur ce point et à prendre leurs responsabilités. Pour illustrer ces problématiques, nous leur présentons des courts métrages qui mettent en avant le rôle prépondérant du groupe.
Nous voulons les amener à « détricoter » les stéréotypes qui les gouvernent et à considérer l'autre comme un sujet et non comme un objet soumis à leurs propres pulsions. C'est ainsi qu'une jeune fille écrit : « Cela ouvre les yeux de certaines personnes de la classe sur la situation des filles et le fait qu'elles ne sont pas un objet qui sourit et qui a la peau douce, qu'elles ne sont pas qu'une enveloppe corporelle ».
En 1999, j'ai réalisé un film sur les clients de la prostitution, qui généralement s'appuient sur les stéréotypes pour justifier leur mépris du corps de la femme. Cette représentation de la virilité est néfaste et un certain nombre de jeunes gens se sentent le droit de se servir des femmes pour assouvir leurs besoins sexuels. On peut naturellement lui associer la domination, la performance et l'expression de la force. Or, pour les jeunes garçons, le fait d'être dominant, et non dominé, a une importance cruciale.
En effet, pour éviter d'être dominé, il faut être dominant : les jeunes ont du mal à imaginer une autre alternative relationnelle.
Cette relation entre bien dans le cadre des violences faites aux femmes puisque nombre de jeunes filles, pour avoir la paix, épousent le discours des jeunes gens, au risque de nier leur identité et le sexe auquel elles appartiennent.
Nous intervenons également auprès de jeunes en difficulté, en liaison avec la protection judiciaire de la jeunesse auprès de jeunes soumis à des travaux d'intérêt général ou à des peines de substitution. Rejetés par le système scolaire, ces adolescents n'ont pas appris à mettre une distance entre leurs pulsions et leurs actes.
Si j'ai évoqué l'univers de la prostitution, c'est qu'il inspire un grand nombre de jeunes garçons. L'un d'entre eux écrit : « Maintenant je sais que la fille n'est pas soumise et que ce n'est pas une pute », et un autre : « Avant, je croyais que des attouchements sexuels de la part d'un adolescent sur une adolescente, c'était pour rire, mais maintenant j'en comprends les conséquences ». Personne ne leur avait jamais dit que le corps d'une femme lui appartient et que l'attouchement est une violence sexuelle.
En 1988, l'association « je.tu.il » a mis au point un programme pour la prévention des violences sexuelles à l'égard des enfants. C'est sur ce programme que le ministère de la santé et des affaires sociales a lancé sa première campagne nationale. Aujourd'hui, les jeunes savent qu'ils peuvent téléphoner au 119 et qu'un adulte n'a pas le droit de commettre une violence sexuelle à l'égard d'un enfant. En revanche, le fait qu'un jeune puisse commettre cet acte sur un autre jeune leur paraît d'une gravité moindre. Une jeune fille a écrit cette phrase terrible : « Avant de voir les films et les explications, je ne savais pas tout cela, car à moi on me touche les fesses et les seins et je ne savais pas que c'était important de le dire… Comme dans ma famille ils disent que les femmes sont soumises aux hommes, j'étais d'accord avec eux, mais plus maintenant ». Mais les garçons évoluent, car l'un d'entre eux écrit : « Moi, je croyais que toutes les filles étaient des putes, mais plus maintenant », et un autre : « Tout le monde est libre. Si une fille ne vous aime pas, elle a le droit. Ce n'est pas la peine de la frapper ».
Ces phrases montrent que les violences dites ordinaires induisent les violences sexuées et que celles-ci peuvent mener aux violences sexuelles.
Dans un monde de plus en plus technique, il est très important de savoir exprimer sa sensibilité. C'est pourquoi nous devons aider les garçons à s'identifier à des personnages de culture féminine, et les amener à reconnaître qu'ils apprécient la poésie et ne s'intéressent pas uniquement aux films d'action. Mais la pression sociétale est telle que les garçons ont du mal à exprimer leur sensibilité, c'est particulièrement vrai dans les quartiers difficiles.
Nous avons intitulé notre programme « Cet autre que moi » car il a pour objectif d'aider les jeunes à se mettre à la place de l'autre et à imaginer les conséquences de leurs actes pour autrui.
Pour la psychologue que je suis, il s'agit de les amener à faire une place à l'autre dans leur tête. En 2007, lorsque nous avons pris connaissance des résultats de l'évaluation, nous avons eu la surprise de constater qu'un grand nombre de jeunes avaient choisi comme support d'identification un personnage rejeté par le groupe, soit pour sa trop grande sensibilité, soit pour son physique peu attrayant, et que 18 % des garçons avaient choisi un personnage de culture féminine. Dès lors qu'ils l'ont découvert la part féminine qui est en eux, les garçons sont prêts à l'accepter.
C'est juste, mais lorsque nous avons présenté les résultats de l'évaluation à la classe, tous les garçons ont protesté que naturellement, ce n'était pas eux !
Une jeune fille écrit : « Les commentaires des garçons montrent qu'ils ne sont pas si sûrs d'eux que cela, qu'ils peuvent avoir honte et être sensibles, contrairement à ce que revendique leur comportement assez machiste dans la vie de tous les jours ». Un garçon dit de l'une de nos animations : « Elle a appris à certains garçons à ne plus considérer les filles comme de la marchandise ou comme un élément pour impressionner les copains ; elle a appris aux filles que les garçons n'étaient pas tous des obsédés sexuels et qu'ils avaient des sentiments ».
La découverte de la sensibilité des garçons, tant pour eux-mêmes que pour les filles, est fréquente et commune à tous les établissements. Mais les filles ne seront elles-mêmes que lorsque les garçons auront évolué, car la loi du groupe est prédominante à l'âge de la puberté. C'est encore plus vrai pour les jeunes des quartiers difficiles, qui respectent la loi du quartier. Certains nous ont confié qu'ils ne peuvent agir comme ils le souhaitent car cela n'est pas conforme à la loi du groupe. Nous devons mener des actions pédagogiques et éducatives, en liaison avec l'ensemble des personnes qui interviennent auprès des jeunes. C'est pourquoi nous proposons des formations aux éducateurs, afin de les aider à clarifier leur représentation du masculin et du féminin.
Le quatrième film de notre programme, Victime et coupable, traite spécifiquement de la violence sexuelle. Il fait apparaître que les informations recueillies auprès de tous les acteurs du procès jettent le doute sur la personne qui a subi l'agression. On pourrait croire que les filles se font violer pour de l'argent ! À l'issue du film, 20 % des élèves considèrent que la jeune fille a une responsabilité – et l'on compte parmi eux autant de garçons que de filles – ; après notre travail commun, ils ne sont plus que 3 %…
Mais ce ne sont plus que des garçons ! Une jeune fille dit du film : « Finalement, c'est offensant pour la victime de mettre en doute son témoignage, surtout dans une situation de viol »…

Je vous remercie pour vos propos mais vous n'avez pas du tout évoqué l'éducation par les parents
Les parents éduquent leurs enfants, mais ils le font avec ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Cette transmission, consciente et inconsciente, est très variable selon la culture familiale. Or, la sexualité relève plus de la culture que de la nature. Les jeunes filles à qui l'on interdit de sortir le soir pour les préserver du danger sont éduquées – même si c'est à la peur de l'homme. J'ajoute qu'aujourd'hui, ce que transmettent les parents a moins d'impact que ce que diffusent les médias.
En effet. On parle aux jeunes de quatorze ans de sexualité, alors même qu'ils ne peuvent se la représenter. Dans certains établissements scolaires, on leur explique, au cours de la même année scolaire, le sida, les maladies sexuellement transmissibles, la drogue, le suicide… Ce monde terriblement dangereux ne les aide pas à appréhender la relation à l'autre ! Il faut encourager les jeunes, durant la puberté, à développer leur sensibilité pour aborder tranquillement ce qu'ils imaginent de la sexualité. Savez-vous ce qu'écoutent les adolescents de treize ans à la radio ? Des émissions qui présentent l'acte sexuel d'une façon qui les porte à croire que dès sa première expérience sexuelle le corps d'une fille ne lui appartient plus. Ces émissions vont à l'encontre de la mission éducative dont nous avons tous la responsabilité, qui consiste à présenter la sexualité autrement qu'à travers l'acte sexuel. D'ailleurs, les élèves ne nous posent aucune question sur l'acte sexuel, tant ils sont étonnés que nous leur parlions d'émotions, de sentiments...

À mon tour, je salue votre action. Depuis trente ans que vous travaillez au contact des jeunes, pensez-vous que la relation entre les garçons et les filles ait évolué, et dans quel sens ?
Selon vous, doit-on organiser des actions de sensibilisation auprès d'enfants plus jeunes ?

Le collège est l'établissement scolaire où il se passe des choses importantes, car les élèves voient leurs corps changer et connaissent de nouvelles émotions. Pourquoi ne pas anticiper et aborder ces thématiques en sixième, par exemple ? Le climat serait plus serein et les élèves plus réceptifs.
S'agissant des équipes pédagogiques, ne serait-il pas plus judicieux de cibler un certain nombre de thématiques et de les pérenniser, au lieu de vouloir tout aborder ? Sur quels critères sont établies les évaluations ? Les équipes pédagogiques assurent-elles un suivi après vos interventions ?
Les équipes avec lesquelles nous travaillons inscrivent notre action dans la politique de prévention de l'établissement. Le thème des relations entre filles et garçons est abordé dès la sixième et la cinquième, puis il est approfondi en quatrième avec l'intervention de l'association. En troisième, c'est le planning familial qui poursuit notre action d'information. Les professeurs s'engagent à nos côtés. Cinq ans après notre intervention, dans un collège difficile du XVIIIe arrondissement, après des années de relations agressives, on a vu des filles et des garçons se tenir par la main. Progressivement, à l'intérieur du collège, se sont mis en place d'autres modes relationnels. Si cela a été possible, c'est que l'équipe pédagogique a mené une politique de prévention efficace.
Nous devons mener des actions d'éducation et de prévention en cohérence les unes avec les autres, en associant différents partenaires et en les encourageant à travailler ensemble.
Dans certains établissements, notre intervention se déroule sur deux ans, en quatrième et en troisième. Vous avez raison, monsieur le député, il serait peut-être intéressant d'agir dès l'école primaire.
Le plus important est de savoir ce qu'il convient de dire à ces jeunes. S'agit-il de les alerter de certains dangers ou de leur faire découvrir ce que peut apporter la relation à l'autre, avec ses différences et ses émotions ? J'ajoute que les éducateurs doivent cesser de s'adresser différemment aux garçons et aux filles.
La première version de notre programme fut mise au point en 1997. À l'époque, lorsque j'évoquais la violence des jeunes, en particulier celle des jeunes filles, on ne me prenait pas au sérieux. Mais dès le début des années 2000, nous avons été submergés de demandes d'interventions, car les personnels d'encadrement ont été confrontés à des comportements violents de la part d'adolescents de plus en plus jeunes. Nous agissons tous selon un certain mimétisme, et les enfants, pour ne pas être rejetés par le groupe, reproduisent le comportement des plus âgés. Il est important d'agir pour améliorer la situation des femmes battues, mais ce problème ne saurait faire l'objet d'un de nos programmes car il relève tout simplement de l'humanité.
Les comportements des jeunes ont évolué, c'est vrai, et la médiatisation des actes de violence a tendance à normaliser cette dernière. Et si les plus jeunes reproduisent les actes de violence qu'ils ont vu commettre par des délinquants plus âgés, c'est peut-être que les adultes les regardent comme de futurs délinquants !
Une chose est certaine : l'éducation et la prévention ont des répercussions sur les résultats scolaires. Dans les questionnaires d'évaluation, à la question : « Quelle est la chose la plus importante à l'adolescence ? », la majorité des élèves, dans un premier temps, répond : « avoir des amis ». À notre grande surprise, le deuxième élément de bonheur, pour 20 % des élèves parisiens, est de « réussir en classe » ! Et dans les collèges « ambition réussite », ce pourcentage varie entre 27 et 38 % ! Lorsqu'on leur pose à nouveau la question, à la fin de notre intervention, la seule réponse qui progresse, à Paris, c'est « réussir en classe ». Dans les collèges « ambition réussite » – notamment le plus explosif de Paris – elle avoisine les 50 % ! Nous savons bien que cette réponse n'est pas spontanée, qu'elle est due à l'intervention de l'association « je.tu.il » et, surtout, au travail des équipes éducatives.
Si les collèges sont explosifs, c'est qu'ils sont le lieu de la puberté. Les choses se calment au lycée, où la pression du groupe est beaucoup plus légère.

Je salue à mon tour cet exposé passionnant et le travail admirable que vous réalisez auprès des jeunes adolescents. Vous avez évoqué la loi du groupe, le rôle de la famille et celui des médias : j'y ajouterais, pour ma part, l'environnement culturel et religieux de l'enfant.
Un enfant de quatorze ans doit-il tout savoir, ou bien faut-il laisser toute sa place à la découverte individuelle ?
Que faire, en dehors de l'école, pour que la reconnaissance de l'autre devienne une réalité ?
Tout dire et tout montrer friserait l'obscénité. Mais dans son fantasme de transparence, notre société ne cache rien. Les jeunes sont envahis de messages qu'ils ne comprennent pas. J'ai ainsi entendu un jeune élève demander, très naïvement, si la sodomie était douloureuse : c'est la seule pratique sexuelle dont il avait entendu parler !
Je suis d'accord avec vous, monsieur le député, sur la nécessité de laisser toute sa place à la découverte personnelle, mais il ne faut pas faire abstraction de l'environnement dans lequel vivent les jeunes. Il faut entendre les plus spontanés d'entre eux expliquer qu'après avoir observé les affiches publicitaires qui jalonnent leur trajet, ils arrivent au collège en érection… Ils n'ont que treize ans !
Un enfant de treize ans, c'est vrai, observe tout ce qui se passe autour de lui, et ce qu'il voit ne peut produire que de l'excitation. Or, il ne peut pas la comprendre. C'est pourquoi, je le répète, nous devons faire très attention à ce que nous disons aux adolescents et tenir compte de leur degré de maturité.
Nous employons souvent le mot « respect », mais que représente-t-il pour les jeunes ? Ils l'associent sans doute à la loi, mais pour comprendre la loi, il faut comprendre l'altérité. Les lois doivent être perçues comme des protections, et non comme des sanctions. Je n'ai pas la prétention, mesdames et messieurs les députés, de vous dire ce qu'il convient de faire en matière de prévention, mais il est clair que nous ne pouvons agir que si le pouvoir politique nous en donne les moyens. En 1988, le Gouvernement s'est emparé de la question des violences sexuelles faites aux enfants – sujet hautement tabou à l'époque – après nous avoir autorisés à réaliser notre programme, ce qui a permis aux associations d'agir, avec les résultats que l'on sait. Le rôle du politique est déterminant, car c'est lui qui décide de développer telle ou telle thématique. Ensuite, dans les territoires, nous développons les politiques choisies, en fonction de la maturité du public auquel nous nous adressons et de la capacité des familles à relayer notre message. Nous vivons dans un pays laïque, mais les jeunes font de plus en plus référence à la religion pour légitimer certains comportements violents. Je précise que nous n'intervenons auprès des jeunes qu'en présence des responsables de l'établissement et des enseignants, en espérant que notre enseignement atteindra la famille, lieu privé par excellence.

Je rappelle que notre mission d'évaluation ne peut qu'émettre des préconisations pour améliorer la loi, mais il apparaît que vous pourriez intervenir plus tôt. Pourquoi ne pas lutter dès le CM2 contre les violences langagières, sans nul doute génératrices de violences physiques ? Que faire pour donner aux enfants une vision poétique du monde ?
Nous réfléchissons actuellement à un programme en amont, mais un programme ne peut à lui seul changer les comportements. Seule la communauté des adultes en a le pouvoir. Si j'avais une préconisation à faire, ce serait d'améliorer la formation des travailleurs sociaux, des éducateurs, des personnels de l'éducation nationale, qui ne sont pas au clair avec les questions relatives à l'identité sexuelle, car ils évoluent dans des univers où les personnes sont identifiées uniquement au sexe auquel elles appartiennent. J'axerais le travail sur la responsabilité des adultes et l'importance de leur fonction éducative, je réfléchirais au contenu des messages qu'il faut délivrer aux jeunes, et j'imposerais des formations sur les questions de l'altérité et de la sexualité dans tous les secteurs professionnels.
La mission a enfin auditionné Mme Nicole Crépeau, présidente de la Fédération nationale « Solidarité Femmes », de Mme Françoise Brié, vice-présidente, et de Mme Christine Clamens, directrice.

Merci d'avoir répondu à notre invitation. La Fédération nationale « Solidarité femmes » est un réseau national regroupant depuis vingt ans des associations féministes engagées dans la lutte des violences faites aux femmes, notamment celles qui s'exercent au sein du couple et de la famille. Nous avons souhaité approfondir avec vous un certain nombre de questions, en particulier le suivi des femmes victimes, la gestion du numéro national d'écoute : le 3919, et l'hébergement des victimes.

Au sein du réseau de la Fédération, les professionnelles sont formées de façon continue à la problématique des violences faites aux femmes grâce à un service de formation spécifique. Il existe également un échange soutenu de pratiques entre les différentes associations, ainsi que des remontées d'informations provenant des situations de femmes accueillies ou hébergées.
Nos centres assurent aussi des écoutes téléphoniques locales ou départementales ainsi que des accueils en externe et des hébergements de différents types (urgence, moyen séjour, C.H.R.S, centres maternels). Au total, nous recevons environ 40 000 femmes chaque année, dont plus de 3 000 sont hébergées.
Les femmes victimes de violences sont adressées à nos structures essentiellement par les services sociaux, mais aussi par le numéro d'appel national et par les numéros départementaux – particulièrement utiles aux femmes issues de l'immigration, qui sont séquestrées, et aux femmes issues de milieux socio économiques favorisés, qui ne se rendent jamais dans les services sociaux –, soit par différents partenaires.
Il est important de développer les campagnes de communication pour que les femmes puissent avoir connaissance de l'ensemble des dispositifs : après chaque campagne, on constate que le nombre d'appels et le nombre de femmes qui arrivent dans nos centres augmentent significativement.
Les femmes voient souvent dans nos associations l'ensemble des professionnels qui peuvent répondre à leurs difficultés et aux conséquences des violences : travailleuses sociales, juristes, psychologues. L'accompagnement est axé essentiellement sur la sortie de la violence et sur ses conséquences. Nous estimons que les violences ne sont pas un problème psychologique, masculin ou féminin, mais un phénomène sociétal dû aux inégalités hommesfemmes et à un certain nombre de discriminations à l'encontre des femmes. Ceci constitue la base de l'accompagnement global que nous proposons. L'accueil peut en outre être collectif, afin que les femmes échangent sur ces violences subies et profitent de l'expérience des autres, pour sortir plus rapidement du processus de violence.
Sortir de la violence c'est parler de l'emprise, phénomène très spécifique qui peut être comparé à ce qu'on observe dans les sectes. Ces femmes sous emprise ne vivent, ne pensent et ne fonctionnent qu'à travers le conjoint violent. Elles sont souvent dans un tel état de dépendance psychologique qu'elles ne peuvent plus réagir, ni même éviter les coups. Nous travaillons avec ces femmes à partir de la stratégie des auteurs violents. Nous analysons la situation de violence, indépendamment de leur histoire personnelle : stratégie des auteurs, sape de la base psychologique, peurs, terreur, coups, humiliations, isolement. Nous abordons les diverses formes de violence, parmi lesquelles il ne faut pas oublier la violence économique et la violence administrative. Il s'agit aussi de leur permettre de comprendre les représentations qui traversent les différentes institutions et qui freinent la réparation qu'elles espèrent parce qu'elles sont femmes et victimes de violences. On rejoint là la question des inégalités, des droits des femmes, ce qui ne les renvoie pas à leur responsabilité individuelle.
Les femmes sont accompagnées par différents professionnels, à travers des accueils collectifs ou individuels puis, éventuellement, dans des centres d'hébergement. Certaines n'ont pas besoin d'hébergement. Dans les Hauts-de-Seine, 25 % des femmes le demandent ; les autres recherchent d'abord un accompagnement, juridique, psychologique, social. Mais les centres d'hébergement d'urgence spécialisés pour les femmes victimes de violences sont très importants lorsque les femmes se sentent en danger. Or, ils n'existent pas partout ou sont en nombre insuffisant : dans certains départements, on ne peut accueillir qu'un quart des femmes qui le demandent. Il est essentiel que les femmes puissent être reçues par des équipes formées à cette problématique en particulier dans le cadre de l'urgence, ce qui améliore leur protection, raccourcit leur parcours dans la violence et la précarisation qu'elle induit.
Dans les centres d'hébergement, les femmes sont accompagnées de façon globale pour reconstruire une estime de soi mise à mal mais aussi sur la question de la parentalité : une victime de violences peut présenter un stress post-traumatique et un soutien peut l'aider à gérer les conséquences que la situation aura sur ses enfants.
La mise à l'abri est également très importante : 30 % des homicides sont commis au moment de la séparation qui est une période à risque. D'où la nécessité d'accompagner de manière très professionnelle la femme dans le processus de séparation en analysant l'ensemble des difficultés, et la question de sa sécurité.
Lorsque la question des enfants et de leur protection se pose, nos équipes font des signalements, pour permettre à la fois à la mère et aux enfants de se mettre à l'abri. Leur sécurité est pour nous indissociable. Il est très important, dans les processus engagés sur le plan judiciaire, dans le cadre de la protection de l'enfance et pour la protection des femmes, de ne pas oublier que la sécurité des enfants passe aussi par la sécurité de la mère.
En cas de nécessité, nous lançons un appel aux soixante associations de notre réseau pour que les femmes soient mises à l'abri dans d'autres départements. D'autres questions peuvent se poser, à commencer par celle de la confidentialité de l'adresse. En effet, une femme qui a des enfants devrait donner au conjoint violent l'adresse où elle se trouve avec eux. Un procès pour dissimulation d'adresse a été engagé contre la directrice et la présidente d'un de nos centres. Voilà pourquoi une demandons une modification sur ce point précis, qui rejoint la question de l'autorité parentale. La loi sur l'autorité parentale n'a pas pris en considération la question des violences conjugales. Cela met en danger les femmes et leurs enfants et entrave notre travail aux côtés de ces femmes.
L'accompagnement est semblable dans toutes les associations de notre réseau. Il est important de prendre en compte la parole de la femme et de prendre le temps pour qu'elle puisse se reconstruire. Une fois que la victime a osé parler, un parcours compliqué se met en place. Nous avons fait des propositions pour trouver des réponses adaptées, notamment sur le plan social, et nous souhaitons que la loi évolue sur le plan judiciaire

Souvent les femmes victimes ne partent pas du domicile à cause des enfants. Comment leur faire passer le message que la construction de leurs enfants doit se faire en dehors de la violence du conjoint ? Voir battre leur mère régulièrement ne peut avoir que des conséquences fâcheuses sur l'avenir des enfants.

Nous nous intéressons à la problématique individuelle de ces femmes et à celle de leurs enfants, qui a été mise un peu de côté pendant de nombreuses années. Les femmes se heurtent souvent à la pression de la famille ou à des difficultés économiques car elles sont souvent isolées. Elle peut avoir perdu son emploi et son conjoint peut avoir fait en sorte qu'elle soit privée de ressources. Elle hésite donc à partir de son domicile. En emmenant ses enfants dans un hébergement d'urgence, elle les prive par ailleurs d'un certain confort matériel et les oblige éventuellement à changer d'école. De tels obstacles doivent être levés.
Cela dit, les femmes sont très souvent tout à fait conscientes des difficultés que vivent leurs enfants et ce peut être une des raisons de leur départ. Elles sont parfois bien plus conscientes que certaines institutions des conséquences que peuvent avoir sur les enfants les violences qu'elles subissent. Dans le monde judiciaire, en particulier, la notion de « bon père », même si celui-ci est violent, est toujours très prégnante. Dans la procédure de divorce, les parents sont mis à égalité, ce qui peut poser des difficultés aux femmes lors des droits de visite et d'hébergement ou lorsqu'elles souhaitent quitter le domicile.
Les services, notamment ceux de l'action éducative en milieu ouvert, veulent absolument maintenir le lien entre le père et la mère, alors que nous pensons qu'il faut d'abord évaluer la situation de dangerosité et prendre des mesures de protection. C'est pour cela que nous proposons, en cas de violences conjugales, un éventuel aménagement temporaire du droit de visite de l'auteur des violences.

Nous avons auditionné un pédopsychiatre, qui nous parlait des traumatismes subis par les enfants. Comment peut-on être un « bon père » lorsque l'on est violent vis-à-vis de sa femme. Sans aller jusqu'à les déchoir de leur autorité paternelle, ne pourrait-on pas les éloigner de leurs enfants lorsqu'ils sont très violents avec leur femme ?

Avant que le juge aux affaires familiales ne statue, il faut prendre des mesures de protection pour la mère et rompre le lien, même temporairement, avec le père, en fonction de la dangerosité de la situation. Dans certaines situations, il arrive que le père, dont la violence est avérée, ait toujours le droit de voir ses enfants, hors du lieu médiatisé. Les points rencontres sont indispensables et devaient être plus nombreux avec du personnel formé à la problématique des violences conjugales. Il faut donc s'interroger sur la dangerosité de l'auteur, y compris à l'égard des enfants (ils sont tous des victimes indirectes et dans 30 à 40% de ces situations, victimes de violences directes), se demander ce que cette relation apporte à l'enfant et si le père ne continue pas, à travers les enfants, à exercer sa violence à l'égard de sa femme.
Quand la victime vit avec l'auteur de violences, elle est sous son emprise. Lorsqu'elle part l'auteur des violences veut la récupérer et a tendance à utiliser les enfants à l'occasion de son droit de visite, en essayant d'obtenir des informations sur la mère Il faut protéger les enfants de cette instrumentalisation.

Ne faudrait-il pas créer un lien entre vos associations et la personne qui reçoit la plainte ? Que penseriez-vous d'une modification législative permettant au policier ou au gendarme de protéger immédiatement celle qui ose dire qu'elle veut partir ? La situation devient dangereuse pour la femme lorsqu'elle décide de quitter son domicile.

Il faut effectivement créer des liens entre les commissariats et les associations spécialisées. Ces liens existent avec les associations généralistes, mais ce n'est pas suffisant. On n'accompagne pas les femmes victimes de violences comme on accompagne les autres victimes. Un accompagnement global, la réflexion sur les inégalités femmeshommes, le retour à l'autonomie sont essentiels pour ces femmes. Par ailleurs, les conventions qui ont été signées par le ministère de l'intérieur, de ce point de vue, ne sont pas toujours appliquées.

En effet. Une fois que l'auteur entre dans le processus judiciaire, il est important aussi de créer un lien avec les associations, afin qu'elles puissent informer la femme de la façon dont on pourra la protéger, et de l'ensemble des ressources qui s'offrent à elles.

Comment venir en aide aux femmes étrangères qui subissent des violences conjugales, mais dont le titre de séjour est lié à leur maintien au domicile conjugal ?

Il nous semble important qu'il y ait, dans les préfectures, pour ces femmes victimes de violences, des référents spécialisés sur les questions des violences conjugales et des doubles violences en lien avec les associations. Les situations sont très différentes d'un département à l'autre et les notes de situation que nous dressons pour ces femmes sont prises en compte de façon variable selon les préfectures. Ces femmes ont peur, ne peuvent pas porter plainte or l'obtention de leur titre de séjour est souvent liée à une plainte qui aboutit, à un divorce pour faute, ou à d'autres éléments, que ces femmes ignorent. La FNSF demande à ce que soient pris en compte les rapports rédigés par les intervenants sociaux (associations, assistantes sociales,…), les différentes formes de violences, et à ce que les demandes de preuves soient adaptées à la réalité de ces violences. La délivrance d'un titre de séjour devrait être liée à la situation personnelle et non à la situation matrimoniale.

Vous parlez de référente. Pensez-vous à la chargée de mission aux droits des femmes ou à quelqu'un d'autre ?

Ce pourrait être elle. Mais ensuite, elle devrait elle-même se référer à quelqu'un d'autre à la préfecture, impliqué dans l'application des règles relatives au séjour.
Les démarches sont compliquées pour les étrangers et plus encore pour les femmes victimes de violences sans titre de séjour. Nous les accompagnons pour ces démarches en préfecture, mais les moyens humains manquent, et certaines sont toutes seules.

Dans ces situations extrêmes de violence, il me semble important qu'intervienne un juge dont la seule mission est de protéger les enfants. C'est le juge des enfants et non le juge aux affaires familiales. Mais l'intérêt des enfants peut être qu'ils soient retirés du milieu familial. Pourquoi considérer comme allant de soi qu'ils doivent rester avec leur mère ? Le juge doit avoir la possibilité de retirer les enfants, et au père et à la mère.
Le juge des enfants a la possibilité de retirer les enfants du domicile, au vu de la situation ou de prendre des mesures d'action éducative en milieu ouvert. La logique des professionnels des services d'action éducative est de faire en sorte que l'enfant maintienne des liens entre le père et la mère et font pression sur la mère pour maintenir ce lien Or, dans certaines situations de violences, quand la mère a besoin d'être protégée, il n'est pas toujours possible, à certains moments de maintenir ces liens. Au moment de l'application de ces mesures, le service qui exerce la mesure et l'association qui accueille et soutient la mère se trouvent en contradiction dans leurs logiques et pratiques professionnelles et le père peut profiter de cette situation pour maintenir son contrôle.
Il arrive que les enfants soient placés. On a tendance à en conclure que la mère est incapable de protéger et de s'occuper de ses enfants, alors qu'elle est elle-même traumatisée par la situation et peut être aussi en danger. C'est une autre contradiction à laquelle nous nous heurtons sur le terrain.

On manque cruellement de places d'hébergement, notamment d'hébergement d'urgence. Que pensez-vous de l'orientation actuelle des femmes victimes de violence vers des familles d'accueil ?
Nous sommes contre le principe. Une femme victime de violences est aussi une mère capable de s'occuper de ses enfants dans un lieu qui lui est propre. Ensuite, il peut lui être difficile de se trouver face à un autre modèle de couple. Enfin, on voit mal les familles d'accueil gérer les rencontres entre le père et les enfants. La femme victime se sentira mieux dans un lieu neutre, où elle pourra être écoutée par des professionnels, faire le point de sa situation et être accompagnée vers son autonomie.

Il est vrai que le coût est moindre. Mais en plaçant les femmes dans des familles d'accueil, on va à l'encontre de leur autonomisation et cela n'est pas adapté à leur situation.

A l'occasion des précédentes auditions, nous nous sommes rendu compte des faiblesses du dispositif. Existe-t-il une coordination entre tous les acteurs pour régler au cas par cas les problèmes d'une famille ?
Disposez-vous de suffisamment de lieux d'accueil ? Ne serait-il pas judicieux que les collectivités d'une certaine importance s'engagent et créent quelques lieux dédiés, permettant d'accompagner ces femmes ? L'État a des responsabilités dans ce domaine, il me semble que les collectivités sont aussi à même d'intervenir. Ne devrait-on pas les y obliger ? Enfin, quels sont vos liens avec les services sociaux ?

Pour les associations spécialisées, travailler autour d'une situation de violences conjugales nécessite un partenariat avec l'ensemble des acteurs des services sociaux (CVS, PMI, ASE, etc.) ou d'autres partenaires (associations, avocats, police..). Notre rôle est également de créer un réseau autour des femmes. Quand les acteurs sont formés, connaissent leurs limites et la nature de notre action, les analyses de situation se font de façon cohérente et la sortie de la violence est beaucoup plus rapide. D'où l'importance des formations et des actions de sensibilisation auprès de ces différents partenaires.
La coordination peut se faire à l'échelon départemental. Les observatoires départementaux peuvent mettre l'État, le conseil général, les associations, les communes autour d'une table pour mettre en place différents programmes.
Pour gérer les centres d'urgence, une certaine expertise est nécessaire dans le domaine de la sécurité et de la santé, les femmes qui arrivent ayant parfois des blessures importantes. Il faut travailler avec les hôpitaux. Il serait bon que nous ayons aussi, dans les communes, des médecins référents pour établir des certificats médicaux et travailler en liaison avec nous dans certaines situations.
Les collectivités locales ont un rôle à jouer pour faciliter la sortie des centres d'hébergement. En Île-de-France, par exemple, de nombreux centres sont totalement « embolisés » et nous ne parvenons pas toujours à faire sortir les femmes hébergées qui sont pourtant prêtes à être relogées.

Les représentations des femmes victimes de violences, qui sont par ailleurs à la tête d'une famille monoparentale, sont encore prégnantes et la nécessité de devoir quitter la commune d'origine, condition souvent reconnue, aboutit difficilement à l'obtention d'un logement dans une autre commune..
D'autres obstacles surgissent, par exemple lorsque le bail était aux deux noms. Il y a encore peu d'évictions du domicile du conjoint violent. Et puis, le domicile est le lieu où les femmes ont connu la violence et elles peuvent ne pas vouloir y rester. Il faut donc aussi trouver des passerelles de sortie de leur propre logement, améliorer les réponses judiciaires en matière d'éviction et donner à celles qui ne souhaitent pas rester dans leur logement les moyens de le quitter.
Souvent, le conjoint violent, en ne payant pas le loyer, a provoqué l'endettement de sa femme. Il faudrait peut-être prévoir des fonds d'aide. Si la femme n'a pas de travail et que l'époux a été évincé, le loyer devient trop onéreux.. Il faudrait là encore engager un travail en réseau avec les services sociaux et les bailleurs pour améliorer la situation.
L'obtention d'un logement dans le parc social est difficile pour ces familles monoparentales à faible revenu, surtout lorsqu'elles sont issues de l'immigration et que les femmes ne peuvent pas compter sur l'aide de leur famille. Il serait important, pour lever ces obstacles, de constituer des groupes de travail sur le relogement des femmes victimes de violences, avec les associations, les bailleurs, les communes, les départements et les régions, ou des groupes de travail associant plusieurs partenaires.

Une disposition prise par amendement dans la loi sur le logement fait des femmes victimes de violences des personnes prioritaires. Mais cela ne règle pas tous les problèmes. Les organismes se réfugient derrière les arguments que vous avez avancés. Nous devons donc mener une réflexion sur ces problèmes de logement, qui sont fondamentaux.

Nous devons auditionner les représentants d'un organisme d'HLM pour trouver des solutions qui ne soient pas législatives. Les femmes victimes de violences devraient être intégéres dans le contingent dont dispose le préfet.

Dans ma ville de Saintes, qui ne compte que 27 000 habitants, on donne la priorité à ces femmes. Lorsque j'appelle la présidente de l'office d'HLM, elle me dit qu'elle est au courant et que la femme concernée obtiendra un logement.

C'est loin d'être systématique. Les femmes étaient prioritaires dans les PDALPD (plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées) mais dans la pratique elles ne l'ont pas forcément été par rapport à d'autres publics.
Le numéro 3919 a été associé à la plate-forme « violences conjugalesfemmes info service ». Celle-ci avait été créée en 1992 et, jusqu'en mars 2007, y était associé un numéro à dix chiffres, payant pour les femmes, mais aussi pour les tiers qui viennent s'informer.
Au moment du passage au 3919, cette plate-forme est devenue « Violences Conjugales Info». Le 39 19 est un numéro très efficace car il est facilement mémorisable. Certaines femmes sont tellement contrôlées par leur conjoint que, même si un numéro est diffusé lors d'une émission de télévision, elles n'ont pas la possibilité de le noter.
Au lancement de la campagne de marsavril 2007, il s'agissait d'un numéro azur (coût d'un appel local). Un an après, le ministère et le SDFE ont décidé de le passer en numéro vert afin qu'il n'apparaisse par sur la facture de téléphone des appelantes. Le passage en numéro vert est en effet la seule possibilité pour masquer le numéro – d'où un coût supplémentaire.
La campagne médiatique de marsavril 2007, très bien relayée sur le plan médiatique, a suscité énormément d'appels. Nous y avons consacré des moyens supplémentaires, mais pas en proportion du nombre d'appels supplémentaires, qui s'ajoutent à ceux résultant de la notoriété du numéro. Nous sommes ainsi passés de 10 équivalents temps plein à 11 en 2007 puis à 12 en 2008 et à 12 et demi en 2009.
Une troisième campagne média sur le 3919 va être lancée le 11 juin. Après celle de 2007 et un afflux d'appels, la situation est revenue à la normale. Surtout basée sur des plaquettes et des parutions dans les journaux, la campagne d'octobre 2008 a été moins marquante. La prochaine sera une campagne télévisée, avec un plan média assez important sur TF1 et sur M6. Nous attendons le plan média pour les chaînes de la TNT.
Nous risquons de recevoir des appels « périphériques », qui ne concernent pas les violences conjugales mais les violences faites aux enfants, aux personnes âgées, etc. Une plate-forme de pré-accueil nous permettra de diriger tous les appels ne nécessitant pas d'écoute vers les associations de la Fédération et vers les partenaires.
Non : de 8 heures à 22 heures, du lundi au samedi, et les jours fériés, où les appels sont moindres, de 10 heures à 20 heures ; il n'y a pas de service le dimanche.
C'est un numéro d'écoute, d'information et d'orientation. En cas d'urgence, nous orientons les personnes vers la police ou la gendarmerie locale. Un appel dure en moyenne vingt minutes.
De 2003 à 2005, on traitait 15 000 appels par an. Après un fléchissement à 14 000 en 2006, on a atteint 17 700 appels en 2007. La progression a été moindre en 2008 mais VCI a répondu quand même à 18 254 appels.
Le nombre des appels augmente à chaque campagne et à chaque date symbolique (8 mars, 25 novembre), puis il fléchit mais en restant à un niveau plus élevé qu'auparavant. Cela dit, nous allons devoir affiner nos analyses, pour mieux savoir quelles sont les personnes qui appellent, connaître le taux d'erreurs, etc.
Le service de communication de Madame Létard est en charge de ce dossier. France 2 ou FR3 sont aussi concernés.
Effectivement, il ne s'agit pas de publicité. Mais pour une question de ciblage un budget est prévu, en particulier pour TF1.

Les campagnes sont toujours payantes. Mais ce qui est payant n'est pas forcément de la publicité.

Il est possible d'obtenir des coûts réduits, s'agissant par exemple de campagnes d'intérêt général.

J'ai cru comprendre qu'il y aurait aussi un programme, un peu moins important, sur les autres chaînes hertziennes.
Sans doute un peu sur France 2, FR 3 et Arte et sur les chaînes de la TNT.

Des questionnaires sont remplis à la fin de chaque écoute. Les femmes disent que la première cause de violences conjugales est le caractère autoritaire du mari (44 %), bien avant les causes psychologiques. Cela rejoint notre analyse sur les inégalités hommesfemmes et les rapports de domination et de contrôle qu'entretiennent les auteurs de violences avec leur conjointe.
La Fédération regroupe plus de soixante associations, qui travaillent avec de nombreux partenaires – notamment la déléguée aux droits des femmes du département. Chacune possède un numéro d'écoute et reçoit de nombreux appels.

Les numéros de proximité sont importants. Les femmes savent qu'elles pourront se rendre immédiatement dans une association proche de leur domicile.

Vous dites que le caractère dominateur des hommes ressort des analyses. Avez-vous des propositions pour que l'on travaille en amont sur ce phénomène ?
La plupart des associations ont développé des programmes tendant à prévenir les comportements sexistes. Nous intervenons sur ces questions en primaire, au collège, au lycée. Nous essayons de déconstruire tous les stéréotypes auprès des jeunes et de travailler en partenariat avec les enseignants qui doivent, de leur côté, s'interroger sur eux-mêmes. Chacun a tendance à reproduire, de manière inconsciente, certains schémas. La France est par ailleurs en retard par rapport aux autres pays européens dans la sensibilisation des enseignants : ce n'est qu'une option d'une durée de trois heures dans les IUFM. Nous avons à travailler pour lutter contre les préjugés et pour faire évoluer les rapports hommesfemmes vers plus d'égalité et de respect.

Il faudra que nous proposions que cette sensibilisation soit obligatoirement intégrée à la formation.
Nous avons commencé à développer des programmes en nous inspirant de l'exemple québécois. Quand nous nous rendons dans les établissements, les élèves sont très contents que nous abordions ces questions et les professeurs s'impliquent. Mais c'est un travail de longue haleine.

Mme Yvette Roudy avait institué des chargés de mission académiques. C'était une très bonne méthode.
Ce travail s'inscrit dans des circulaires interministérielles publiées par l'éducation nationale. Mais ce n'est pas elle qui impulse ces programmes et c'est dommage. La démarche est laissée au bon vouloir du chef d'établissement ou de professeurs alors qu'il faudrait intégrer ce travail dans les programmes scolaires.
La séance est levée à vingt heures.