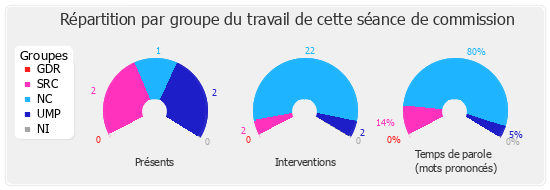Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Séance du 15 décembre 2011 à 9h00
La séance
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
MISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Jeudi 15 décembre 2011
La séance est ouverte à neuf heures dix.
(Présidence de M. Jean Mallot et M. Pierre Morange, coprésidents de la mission)
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) procède d'abord à l'audition de M. Joël Ménard, professeur agrégé de médecine à l'université René Descartes Paris V.

Il est aussi difficile de mesurer les actions menées en matière de prévention, qui sont vastes et protéiformes, que d'en proposer un chiffrage financier. Faudrait-il instaurer dans ce domaine, comme le recommande la Cour des comptes, une coordination nationale, qui serait assurée par la direction générale de la santé ? Comment pourrait-on prendre en compte des objectifs à long terme, dont la réalisation serait évaluée par des acteurs différents de ceux qui les ont définis ? Telles sont nos premières interrogations.

Trois raisons au moins justifient votre audition. D'une part, lorsque vous avez été directeur général de la santé, vous vous êtes heurté à la difficulté de mener de front une politique de prévention ambitieuse, tout en étant sollicité sans cesse pour des actions au jour le jour. D'autre part, vous êtes responsable du plan Alzheimer, qui appelle des mesures de prévention. Enfin, nous souhaitons connaître votre réaction, en tant que spécialiste de la question, à l'exclusion de l'hypertension artérielle de la liste des affections de longue durée prises en charge à 100 % par la caisse d'assurance maladie.
Quand j'étais directeur général de la santé, en 1998-1999, j'ai constamment paré à l'urgence, les problèmes se réglant généralement le vendredi soir faute de temps le reste de la semaine, alors que plus personne n'était disponible. Par ailleurs, j'ai organisé les conférences nationales de santé, que M. Alain Juppé avait instaurées dans le droit fil de la politique de santé publique initiée par M. Claude Évin. En 1992, celui-ci avait créé le Haut Comité de la santé publique, en s'inspirant de l'exemple étranger, pour prendre acte des campagnes de lutte contre le tabagisme menées par MM. Claude Got, Maurice Tubiana et François Grémy. C'est dans ce contexte qu'a été précisé le concept de prévention, bien que celle-ci existait déjà dans les faits, puisque l'espérance de vie était plus élevée en France que partout ailleurs.
La Conférence nationale de santé a montré qu'il était possible d'adopter chaque année un plan national étalé sur cinq ans. Mais issu des premières conférences régionales, apparues en 1994, un autre mouvement s'est développé. Compte tenu de leurs spécificités, les régions ont isolé certaines priorités de santé publique. Ensuite, il fallait créer des liens entre leurs analyses. Je considère toujours qu'il faudrait définir chaque année un plan national, complété d'initiatives régionales. Mais il faut limiter leur nombre, car il est inutile de multiplier les annonces, documents superbes à l'appui, si elles restent sans effet.
Depuis le début des années 1990, on constate une fragmentation des structures, dont M. Yves Bur a décrit récemment, dans son rapport sur les agences sanitaires, les effets désastreux : dix-sept institutions, à la place mal définie, se partagent 6 100 équivalents temps plein. L'affaire du sang contaminé ou celle de l'hormone de croissance ont révélé un système éclaté et coûteux, que le directeur général de la santé n'a pas les moyens de coordonner. Je souscris totalement à cette analyse, même si, depuis mon départ de la direction générale, je me suis abstenu de toute intervention dans le débat public pour ne pas gêner mes successeurs.

Puisque la prévention associe des partenaires aussi divers que les caisses d'assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, les complémentaires santé, les départements ou l'Éducation nationale, la Cour des comptes, qui regrette l'absence de pilote, propose de confier au directeur général de la santé la coordination interministérielle de toutes les actions. Cela lui permettrait-il d'être plus efficace ?
La prévention relevant, au-delà de la santé, de l'Éducation nationale, de l'agriculture ou de l'environnement, pourquoi ne pas créer en effet un délégué interministériel – à condition qu'il soit doté des pouvoirs nécessaires ? Si j'ai pris en charge le plan Alzheimer, c'est avant tout parce que c'était une initiative présidentielle, ce qui permettait de faire travailler les gens ensemble. La gestion en étant confié à une spécialiste, tout le monde a apporté sa collaboration. Elle a organisé chaque mois une réunion, que chacun se sentait tenu de préparer. Une telle contrainte est indispensable, car la prévention est toujours soumise à des forces centrifuges. La direction générale de la santé, celle de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, les agences sanitaires, l'Institut de veille sanitaire ou l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé sont comme les musiciens d'un orchestre : un chef d'orchestre est nécessaire. Si l'on confie cette responsabilité au directeur général de la santé, il ne pourra plus s'occuper, comme j'ai dû le faire moi-même, de la grippe ou du sida. J'ai plaint M. Didier Houssin qui a dû intervenir à tout propos, sous la pression des journalistes, sur la grippe H1N1 en plus de ses fonctions de directeur général de la santé. Quant à moi, estimant que je ne pouvais pas mener tous les dossiers de front, j'en ai tiré les conséquences et je n'ai exercé que deux ans les fonctions de directeur général de la santé que durant deux années.
Ce responsable doit être nommé par le Premier ministre, puisqu'un plan relève plusieurs ministères. Celui de la santé n'a pas les moyens de tout gérer. Quand on prépare un plan de prévention sur la lutte contre le tabac, il est impératif d'intervenir dans les établissements scolaires. Si, dans le milieu clos de l'éducation nationale, on considère que ce n'est pas une priorité, il est impossible d'agir. De même, pour examiner la situation dans les prisons, il faut une coordination avec le ministère de la justice. En matière de prévention, un plan de santé publique est toujours multifactoriel et, pour le mettre en oeuvre, il faut prévoir les moyens, l'organisation et les structures.
Le plan Alzheimer a mobilisé à temps plein cinq personnes de haut niveau, notamment Mme Florence Lustman, inspecteur général des finances. Elles étaient dotées d'un pouvoir réel. Mais, dans les autres plans, chaque acteur reste autonome, ce qui signifie qu'on ne peut organiser une réunion avec un directeur sans qu'il s'y fasse représenter soit par un sous-directeur, un chef de bureau, voire un chargé de mission, qui arrive généralement en retard et s'éclipse avant la fin de la réunion. C'est ce type fonctionnement que j'ai combattu quand j'ai mis en oeuvre le plan Alzheimer.

En admettant qu'il y ait un responsable par plan annuel, qui coordonnera leur action ? Un directeur général de la santé y parviendra-t-il si les délégués reçoivent leur pouvoir du Premier ministre ?
Le directeur général de la santé ne peut pas être sur tous les fronts. Dès qu'on annonce un plan, l'opinion publique se mobilise et, le nombre de personnes concernées étant considérable, un autre acteur doit prendre le relais. À mon époque, une trentaine de personnes en étaient capables, sur un effectif de 300. Lorsque plusieurs ministères sont concernés, l'appui de chaque ministre est nécessaire, car, si les membres de leurs cabinets n'ont pas de bonnes relations, rien n'avance. Ainsi, quand une campagne de prévention contre l'obésité dénonce des publicités destinées aux enfants, le ministre de la santé doit travailler avec celui de la communication. Il est normal, quand un problème est national, que s'expriment certains groupes de pressions dont les objectifs sont différents nôtres. C'est pourquoi il faudrait, comme nous l'avons demandé à l'Union européenne, que toute action comprenne un volet santé, car, la plupart du temps, quand on signale les dangers d'un produit toxique, nos partenaires – mauvaise foi ou aveuglement ? – refusent d'envisager ses conséquences sanitaires. Il faut lutter sans cesse, sans garantie de succès. Ainsi, je n'ai jamais obtenu qu'on régule la quantité de sel dans l'alimentation, alors même que j'ai été invité à prononcer des conférences à ce sujet dans différents pays. Le Portugal a agi dans ce domaine, à la différence de la France. Peut-être m'a-t-il manqué le caractère d'un ayatollah.

Comment articuler les plans nationaux et les priorités définies au niveau régional, comme la prévention du suicide ou de l'alcoolisme ?
Au plan local, la géographie, les aspects socioculturels et l'histoire peuvent être pris en compte. Ensuite, le directeur général de la santé doit organiser des journées d'échange entre les responsables. Quand j'étais directeur général de la santé, le dépistage des cancers fonctionnait bien en Isère et en Bourgogne, ainsi que dans le Bas-Rhin, le Calvados et les Bouches-du-Rhône. C'est en comparant ces expériences qu'on a pu rédiger un cahier des charges national pour le dépistage. La Bourgogne était en avance pour le cancer colorectal, les Bouches-du-Rhône ou l'Aquitaine pour celui du sein. Croiser les initiatives permet de définir une action nationale. Tous les problèmes de santé ne peuvent être prévus de la capitale : ainsi en Aquitaine, nul ne s'inquiète du radon qui préoccupe davantage l'Auvergne ou la Bretagne.
On m'a souvent demandé comment étaient arrêtés les plans de prévention. Si j'ignore pourquoi le Président de la République a retenu le dossier Alzheimer, il existe des techniques d'aide à la décision. En utilisant le travail mené en 1996 à l'Organisation mondiale de la santé et à Boston sur le poids de maladies, j'ai refait a posteriori les calculs portant sur la maladie d'Alzheimer. Si celle-ci est un problème lourd, c'est à cause du poids qu'elle impose aux malades et à leur famille. Mais il n'est pas seulement technique. La population peut être particulièrement sensible à une maladie dont l'importance n'apparaît pas dans nos calculs. Le vécu amène à définir des priorités. Le Haut Conseil de la santé publique joue aussi son rôle. Depuis 1996, il apporte sa réflexion au directeur général de la santé, qui la traduit en actes.

Un secrétaire général supervise les agences régionales de santé, qui coordonnent les plans au niveau régional et fixent des priorités. Comment simplifier ses relations avec le directeur général de la santé ?
C'est une question d'entente. On découvre parfois avec consternation que deux personnes, voire deux ministres, ne peuvent travailler ensemble. Si j'étais actuellement directeur général de la santé, je demanderais à Mme Annie Podeur, directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, de recevoir le groupe d'études des conférences régionales de la santé, car, quand les responsables des agences régionales de santé se rencontrent à Paris, leur priorité n'est pas de définir une politique de santé publique dont les effets n'apparaîtront pas avant cinq ou dix ans. C'est même la première chose à laquelle ils renoncent. Il faut repenser tout le système, en incitant les acteurs à se rencontrer périodiquement. Jadis, j'organisais des rendez-vous réguliers entre les directions départementales et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, tandis que M. Édouard Couty rencontrait les responsables des agences régionales de l'hospitalisation. Il ne s'agissait pas d'instaurer une compétition mais un échange entre la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la direction générale de la santé. D'autres fois, je recevais les agences régionales de l'hospitalisation et M. Édouard Couty les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, car des tensions existaient déjà entre le système de soins et la santé publique. Mais de telles difficultés sont gérables. Si j'étais actuellement directeur général de la santé, je m'adapterais au système tel qu'il a évolué.

Le Haut Conseil de la santé publique, constitué d'experts, est-il encore utile depuis qu'il existe des conférences régionales et une Conférence nationale de santé ?
M. Yves Bur écrit dans son rapport qu'il ne voit pas l'utilité de cette instance. À côté du Haut Comité de la santé publique, de nombreux comités, qui dépendaient directement de la direction générale de la santé, ont été intégrés dans le haut conseil, dont le périmètre de responsabilité est étendu. Le haut conseil établit un rapport sur l'état de la France. S'il suffit que celui-ci ne soit remis que tous les cinq ans, il est indispensable qu'il associe des compétences diverses comme par exemple celles des médecins et des sociologues et qu'il soit rédigé en anglais, ce qui permettra de le diffuser dans tous les pays européens.
Quand j'étais directeur général de la santé, je jugeais essentiel d'avoir à mes côtés le président du Haut Comité de la santé publique. Engagé dans l'action et manquant de temps pour réfléchir, j'avais besoin de sa réflexion et de celle de ses groupes de travail. J'ai découvert les arcanes de l'administration : lorsque j'ai été nommé président de la première Conférence nationale de santé, le directeur général de la santé et le président du Haut Comité de santé publique me considéraient comme un intrus. De fait, j'étais un nouveau partenaire. Cela s'est bien passé parce que je les connaissais tous deux, que je ne prenais la place de personne et que je leur ai laissé expliquer leur politique. Il faut vaincre la méfiance pour pouvoir travailler ensemble. Mais comment coordonner dix-sept instances différentes ?

Qui a exclu l'hypertension artérielle sévère des affections de longue durée ? Pourquoi cette décision ? En a-t-on évalué les conséquences ?
C'est un dysfonctionnement si grave que, bien que j'aie cessé de travailler sur l'hypertension depuis quinze ans, je suis sorti de ma réserve en apprenant la nouvelle. Loin de moi l'idée d'endosser le rôle d'enquêteur, mais ma double culture de médecin et de directeur général de la santé me permet de deviner ce qui s'est passé.
À partir de 2006, on a remarqué que les affections de longue durée, en tant que maladies chroniques, coûtaient de plus en plus cher à l'assurance maladie obligatoire. Mais qu'est-ce qu'une maladie chronique, sinon une maladie qui n'est plus mortelle mais qui est soignée par un traitement régulier ? La création de maladies chroniques est un succès de la médecine, même si leur coût est élevé.
En 1998, les caisses d'assurance maladie ont décidé de couvrir à 100 % les hypertensions artérielles de toute nature et, malgré ma sensibilité de chrétien de gauche qui aurait pu me pousser à favoriser cette décision, je m'y suis opposé. Je n'ai pas ménagé les courriers pour limiter la prise en charge aux cas d'hypertension sévère. Les sommes en jeu étaient considérables : près de 5 milliards d'euros pour un total de 10 à 12 millions d'hypertendus. J'ai obtenu qu'une nouvelle rédaction des textes distingue l'hypertension banale, qui ne demande guère plus d'un cachet par jour, soit moins d'un euro, le patient prenant lui-même sa tension, et les cas graves, qui sont beaucoup plus rares et coûteux. Sans être parfait, le système a fonctionné.
En 2006, s'est posé un autre problème, indépendant de la liste des affections de longue durée : celui du reste à charge, qui va conduire aux discussions sur le bouclier sanitaire. Tous les rapports de cette période ont été conservés : beaucoup d'experts ont écrit des choses très sensées, mais, bien que la Haute Autorité de santé se soit saisie du problème en 2007, aucune décision n'est intervenue avant le décret du 24 juin 2011, qui a retiré l'hypertension artérielle sévère de la liste des affections de longue durée, au motif qu'elle ne constituerait qu'un « facteur de risque » et non une pathologie avérée.
Pourquoi ce décret, qui ne résout ni le premier ni le second problème ? En principe, la sécurité sociale vérifiait que les patients souffrant d'une affection de longue durée consultaient leur médecin une fois par an, mais ce dispositif a été contesté au motif qu'il coûtait cher – 40 euros par visite – ou qu'il était vain, la sécurité sociale se dispensant des vérifications. En résumé, les affections de longue durée ont été critiquées sans pour autant proposer de solution. C'est dans ce contexte qu'a été décidée la dernière mesure, qui frappe près d'un million de personnes et particulièrement ceux qui, en dépit de la couverture maladie universelle complémentaire, des mutuelles ou des assurances complémentaires, sont en dehors du système. Il est toujours difficile de trouver une solution à deux problèmes différents, mais celle-ci est inacceptable. Comment un ministre, sortant de son rôle, peut-il commettre un tel contresens ? C'est un dysfonctionnement typique de notre organisation.
Parce que je me bats contre l'hypertension depuis 1973 et que des confrères m'ont demandé mon aide, j'ai écrit des articles très critiques. Il est notoire que, l'an prochain, la nouvelle majorité politique, quelle qu'elle soit, sera confrontée à un manque de moyens financiers. Il faudra prendre des décisions. Quand une pathologie est à l'origine de 35 millions de consultations par an, qui coûtent en tout 5 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 5 autres milliards d'euros d'examens, peut-on diminuer de 10 % les sommes qui lui sont allouées ? Certes, des solutions existent, mais elles supposent de supprimer d'autres dépenses. Reste à savoir comment l'expliquer aux professionnels concernés.

Nous connaissons bien le problème. Nul besoin d'être spécialiste pour savoir que l'hypertension artérielle non soignée entraîne des complications au niveau des yeux, des reins ou du coeur. Si la décision est uniquement économique, son résultat est douteux. Qui l'a prise ? N'y a-t-il eu aucune coordination avec l'assurance maladie et les complémentaires santé ?
Je n'ai pas envie d'essayer de trouver le coupable.
Voyons plutôt comment il faudrait procéder. Les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'État doivent s'entendre, ce qui n'était pas le cas, jadis, entre M. Gilles Johanet et Mme Martine Aubry. Face à une telle question, j'aurais évité de prendre une décision immédiatement et j'aurais réuni autour de la table les partenaires concernés, sans oublier les associations de malades, très présentes aujourd'hui. J'imagine qu'on serait parvenu à la solution à laquelle on aboutira le 31 mars. Il faut actualiser le profil de l'hypertension sévère, en retenant les seuils 180110, que viennent d'adopter les États-Unis. En France, 450 000 personnes seraient concernées.
En même temps, il faut travailler sur les génériques. Par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, nous avons mené depuis dix ans une politique désastreuse. En 2010, nous avons dépensé 1,7 milliard d'euros, contre 0,8 milliard d'euros en Angleterre, pour le même nombre d'unités de médicaments, prescrits dans les mêmes quantités. Seules les politiques de santé divergent, les Britanniques ou les Allemands ayant anticipé la situation, ce que nous n'avons pas su faire.
Je n'ignore pas certaines objections. Préconiser les génériques, c'est s'aliéner les pharmaciens. Pour traiter un hypertendu, un médecin a besoin d'une vingtaine de médicaments, alors qu'il existe 390 génériques, pour 120 médicaments. Comment garantir la sécurité des malades quand, à partir des vingt molécules nécessaires, il y a 390 possibilités de médicaments ? Je n'ai pas de solution, mais celle qu'on nous propose, coûteuse pour la nation, ne convient ni aux malades ni aux médecins.

La semaine dernière, M. Gilles Johanet m'a assuré, au cours d'un dîner-débat, que le prix du médicament, princeps et générique, n'est pas plus élevé en France qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, alors que, selon certaines publications, leur prix varierait du simple au double. Il serait nécessaire d'y voir plus clair.
La multiplication du nombre de génériques pour une seule molécule découle des règles de la concurrence. Si l'on en croit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le ministre s'oriente vers la procédure des appels d'offres, sachant que les pharmaciens, qui perçoivent des marges arrière, sont très sollicités par les génériqueurs.
Auditionné dans le cadre de la mission sur le Mediator et la pharmacovigilance, créée après l'affaire du Mediator, M. Philippe Even a souligné que la règle de normalité du cholestérol avait été abaissée, permettant d'élargir le champ des prescriptions des statines, même si elles s'avèrent peu efficaces en prévention primaire et qu'elles produisent de graves effets indésirables. Si, à l'époque où je faisais mes études, on admettait que la tension augmentait progressivement en fonction de l'âge, la définition de la normalité a baissé, elle aussi. À cet égard, quelle est la position du Haut Conseil de la santé publique, dont la gestion ne peut éviter d'éventuels conflits d'intérêts ?
Vos propos, pertinents au début, sont devenus désagréables à la fin : je commencerai par la fin, afin de rester sur l'agréable. (Sourires.)
Tout envisager à travers l'affaire du Médiator n'a aucun sens.
Certes, mais certains raisonnements sont désastreux.

Nous avons auditionné le professeur Philippe Even il y a quelques mois, mais il pourrait tenir les mêmes propos aujourd'hui.

Selon le professeur Hubert Allemand, c'est l'industrie du médicament qui exerce une pression au niveau mondial pour faire baisser les normes. Le même problème se pose d'ailleurs pour le diabète. Qui peut, selon vous, définir le niveau de la norme qui détermine le dosage des médicaments ?
Lorsque, en 1985, mes étudiants m'interrogeaient sur la norme de la tension, je leur répondais : 16095 pour la sécurité sociale et 11070 pour l'industrie. En cette matière, il n'existe pas de formule idéale mais la norme doit résulter d'un consensus.
Reste à savoir si ce consensus peut être biaisé, en particulier par les industriels. La baisse des normes a en réalité trois causes. La première est la tendance naturelle du corps médical à l'exagération : voyez Knock. En toute bonne foi, les médecins surestiment les risques des maladies et sous-estiment ceux des traitements.
Ensuite, les épidémiologistes, qui n'ont pas affaire aux malades mais travaillent sur des chiffres, lient l'espérance de vie au niveau de la tension ou du cholestérol. Ils ont établi dans les années 1980, pour l'essentiel à partir des données de Framingham, un modèle fondé sur les 10 % de la population qui leur semblent avoir le profil cardiovasculaire idéal. Or, si l'on ne parvient pas à atteindre cet idéal par l'alimentation ou les exercices physiques, on préconise le recours aux médicaments.
La troisième cause vient en effet de l'industrie. Si les experts sont soumis à des conflits d'intérêt, je dois être à vos yeux, monsieur Gérard Bapt, celui qui l'est le plus ! J'ai en effet commencé ma carrière en 1969, et dirigé l'entreprise Ciba-Geigy pendant trois ans et demi, à Bâle. De tels soupçons me font pourtant sourire : de 1970 jusqu'à aujourd'hui, mes comptes sont restés transparents ; par ailleurs, j'ai toujours refusé de travailler sur les dossiers liés à l'hypertension, étant un spécialiste en ce domaine. Du coup, et bien que je connaisse les statines et les prescrive à mes patients, on m'a fait observer, lors d'une réunion en 1992 ou 1993 consacrée à la pravastatine, que l'on ne suivrait pas mes observations car je n'étais pas considéré comme un expert. Les experts qui sont aussi des praticiens sont soupçonnés de conflit d'intérêt, et les autres, qui ont une connaissance plus théorique, ne sont pas reconnus en tant que tels ; dans les deux cas, on est exclu du système.
Le prix des médicaments peut dépendre de la dose, auquel cas il est dit linéaire, soit rester fixe, auquel cas on parle de prix plateau. Pour le prix linéaire, la tricherie est la règle : Les études préconisent volontairement un faible dosage au départ, que l'on augmente par la suite, de sorte que le nombre de comprimés prescrits est multiplié d'autant. Une vraie politique de santé publique voudrait que l'on ajuste la dose en fonction du malade. Pour la pravastatine, le dosage initial était de 20 milligrammes ; mais après l'étude WOSCOPS – West of Scotland coronary prevention study –, qui avait fixé la dose utile à 40 milligrammes, les patients se sont vu prescrire deux comprimés au lieu d'un.
À la demande de la direction générale de la santé, j'ai rédigé un rapport sur les statines en 2005 et, avec l'appui de Mme Blum-Goisgard, de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, je me suis opposé aux conceptions du professeur Hubert Allemand sur ces médicaments. Sans trancher sur les statines – une telle décision revient en fin de compte à la population –, je me suis borné à indiquer que la prise systématique d'un comprimé, à titre préventif, pourrait présenter un bénéfice-risque favorable pour un homme âgé de cinquante à soixante ans. Si l'on ne peut formellement recommander un tel traitement, on peut le proposer individuellement aux patients.
Il est difficile de répondre d'une manière générale. La prévention doit intervenir à tous les âges de la vie, dès la grossesse et la petite enfance : les personnes ayant un haut niveau d'éducation et de culture déclarent en moyenne la maladie plus tardivement. La politique de prévention dans le domaine cardiovasculaire est positive, même si l'on ne peut réduire la maladie d'Alzheimer aux facteurs cardiovasculaires. Avec mes collègues de Bordeaux, je travaille à des projections pour voir si l'absence de pathologie cardiovasculaire retarderait l'apparition de cette maladie. Le concept essentiel, cependant, reste celui de la prévention durant la vie entière.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale procède ensuite à l'audition de Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice générale de l'Agence de la biomédecine, et M. Dominique Royère, chef du pôle Stratégie procréation, embryologie et génétique humaine à la direction médicale et scientifique.

Votre audition doit nous permettre d'aborder la façon dont la médecine prédictive peut contribuer à la prévention.
La manière générale dont les médias présentent la médecine prédictive est source de confusions entre le prédictif proprement dit qui correspond à l'appréciation d'un léger sur-risque et ce que l'on pourrait dénommer la génétique récréative à savoir la susceptibilité à différents agents, laquelle n'a aucune utilité en termes de santé publique.
Si l'on excepte les aspects anténataux, la médecine prédictive concerne des personnes porteuses de gènes entraînants, de façon certaine, une pathologie à déclaration tardive. Les tests de susceptibilité, eux, reposent sur l'appréciation des antécédents familiaux.
Tout autre est la pharmacogénétique : elle consiste à tester un traitement sur un patient qui présente certaines caractéristiques génétiques, mais qui n'a déclaré aucun symptôme de maladie génétique ; ce test a précédé, par exemple, l'autorisation de mise sur le marché de la molécule traitant l'hépatite. Une telle démarche permet d'optimiser l'efficacité d'un traitement ou d'en limiter la nocivité.
Si toutes les maladies rares ne sont pas génétiques, la quasi-totalité des maladies génétiques sont rares. En ce domaine, la médecine prédictive, hormis les tests de prédisposition, concerne donc peu de monde. Néanmoins les maladies génétiques sont souvent graves ; elles supposent donc des dépenses lourdes.
La pharmacogénétique, qui porte essentiellement sur les cancers, est en plein essor ; elle permet d'apprécier les différents traitements à partir des caractéristiques génétiques du patient ou de sa maladie.
En matière de tests génétiques, la médecine prédictive peut s'envisager à partir des patients ou des tests eux-mêmes. Les tests ont un intérêt pour le patient, qu'il soit asymptomatique ou symptomatique, ou pour sa parentèle ; ils peuvent aussi apporter une information sur une prédisposition génétique, qu'elle soit avérée pour l'individu ou statistique par rapport à la population.
Je prendrai deux exemples de maladies asymptomatiques à déclaration tardive, et dont le diagnostic est certain. Le premier est celui de la chorée de Huntington, destruction de cellules neuronales qui entraîne de terribles souffrances mais ne fait l'objet d'aucune prise en charge. La médecine prédictive peut rendre des services en évaluant les risques pour la descendance du patient.
Le second exemple est celui de la maladie de Steinert, dystrophie musculaire dont la détection précoce s'avère très utile, car cette maladie peut s'accompagner de troubles cardiaques.
La détection des maladies asymptomatiques peut aussi avoir un réel intérêt pour la parentèle. Le cas le plus typique, dans l'hypothèse d'une prédisposition avérée, est celui de gènes associés à des cancers tels que BRCA1 et BRCA 2 pour le cancer du sein, par exemple. Ainsi, une femme porteuse du gène BRCA1 a entre 40 % et 85 % de chances de déclarer un cancer du sein, et entre 10 % et 63 % de déclarer un cancer des ovaires, contre, respectivement, 10 % et 1 % pour l'ensemble de la population. Ces variations s'expliquent par l'histoire familiale, dans la mesure où le risque augmente de génération en génération ; par conséquent, plus l'antécédent est ancien dans la famille, plus les actes de chirurgie prophylactique doivent intervenir tôt. Si un système d'information recensant les personnes porteuses de tel ou tel gène peut être utile, l'essentiel est d'apprécier cette information au regard de l'histoire familiale.
La prédisposition génétique peut aussi reposer sur une évaluation statistique par rapport à la population ; c'est l'objet des tests génétiques sur internet. Les maladies concernées – insuffisance coronarienne, diabète ou hypertension – sont fréquentes ; l'essor des nouvelles technologies a permis de les associer à certains marqueurs, dits SNP – Single nucleotid polymorphism. Reste que cette information, purement statistique, ne contribue qu'à hauteur de 10 % à l'explication de la pathologie chez un individu.
Pour les patients symptomatiques, les tests peuvent avoir un intérêt direct ; on l'a vu avec les gènes BRCA1 et BRCA2, dont la détection permet une prise en charge plus précoce, et aura un impact sur les conduites à tenir. Cependant, si le gène n'est pas détecté chez un patient mais qu'il est présent dans sa famille, c'est probablement que la pathologie est liée à un autre gène, si bien qu'il faudra prendre les mêmes précautions.
S'agissant de la pharmacogénétique, on a cité l'exemple de l'hépatite C, qui implique le gène IL28B, et du traitement à l'interféron alpha. Celui-ci n'est efficace que pour les patients ayant un certain profil génétique ; pour les autres, non seulement il sera inefficace, mais il engendrera des effets secondaires. De même le tamoxifène, molécule anti-oestrogène proposée pour le traitement du cancer du sein, n'est réellement efficace que s'il est associé au variant CYP2D6. On pourrait prendre bien d'autres exemples, tels que le Plavix ou la warfarine, voire, pour le cancer du sein évolutif, l'herceptine, autrement dit le trastuzumab, lequel n'a d'intérêt thérapeutique qu'en présence de certains variants. Dans tous les cas, ces informations améliorent donc la pertinence du traitement.
Les tests ont aussi un intérêt pour la parentèle des patients symptomatiques, comme on l'a vu avec le BRCA1. On peut aussi prendre l'exemple du cancer colorectal, lié, dans 3 % des cas, au syndrome de Lynch : la présence de ce syndrome chez un patient indique que, pour sa parentèle, le risque de développer le même cancer avant l'âge de soixante-dix ans est d'environ 45 %. On conçoit l'intérêt de ce type d'information pour l'approche préventive.
Il convient donc de distinguer entre risque statistique et risque individuel, l'impact du dépistage pour le patient et pour sa parentèle. Par ailleurs, certains dépistages à valeur purement statistique n'ont guère de portée en termes de prévention sanitaire : ils relèvent de la « génétique récréative », pour paraphraser Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, ou de la « génomancie ». Je passe enfin sur l'exploitation de ces tests, c'est-à-dire sur l'aspect commercial, qui touche à la liberté individuelle.
Les tests génétiques vont faire l'objet de validations successives. L'an dernier, l'administration américaine a ainsi recueilli des prélèvements issus de tests proposés sur internet. Certains résultats se sont révélés fantaisistes.
En plus de cette validation analytique, il faut une validation clinique, qui détermine le niveau de prédictibilité : en quoi la présence de tel ou tel marqueur chez un individu l'expose-t-il à un risque par rapport au reste de la population ?
À un troisième niveau se pose la question de l'utilité clinique du test, c'est-à-dire de sa plus-value.
La présence d'un certain marqueur sur le chromosome 9 conduirait, par exemple, à un risque d'infarctus de 1,68 contre 1,52 pour le reste de la population. Un tel dépistage n'a pas de sens : il vaut mieux étudier l'histoire familiale et appliquer des mesures de prévention.
En dernier lieu, il convient d'examiner le rapport entre le coût du test et le bénéfice attendu. On ne considère pas seulement l'efficacité ou l'efficience du dépistage, mais aussi son intérêt en matière de survie et de qualité de survie – on s'intéresse aussi bien à la mortalité qu'à la morbidité.

Qu'en est-il du diagnostic anténatal dans le cadre des lois de bioéthique et de la prévention des maladies dont les gènes associés sont connus ? Je pense en particulier au cancer du sein et à l'hémochromatose.
La loi de bioéthique ouvre deux possibilités, lesquelles concernent des populations et des cas différents.
Il y a, tout d'abord, les diagnostics préimplantatoires réalisés après une fécondation in vitro : on prélève une cellule sur l'embryon pour dépister une maladie grave, incurable et mortelle que les parents ont déjà transmise à un enfant ou qu'ils sont susceptibles de transmettre. Ce sont des maladies à transmission héréditaire qui sont concernées, et non des mutations de novo – je rappelle que la trisomie résulte, la plupart du temps, d'une mutation. Selon la volonté des parents, les embryons porteurs de la maladie sont détruits ou donnés à la recherche ; les autres pourront être implantés. Seuls quelques centaines de couples sont concernés chaque année par ce dispositif, pour une cinquantaine de naissances in fine.
Le contexte du diagnostic prénatal est un peu différent : il fait suite à un acte d'imagerie médicale ou à un examen bactériologique laissant penser qu'il existe un risque. En ce qui concerne la trisomie 21, on propose systématiquement un dépistage qui fait appel à des examens biologiques et échographiques pour mesurer le risque. S'il est « majoré », un diagnostic peut être réalisé. L'an dernier, 650 000 femmes ont fait un dépistage sur un total de 830 000 potentiellement concernées, certaines d'entre elles y ayant renoncé. Le diagnostic est ensuite invasif, car il s'agit d'une ponction permettant la réalisation du caryotype. Environ 35 000 femmes ont été orientées vers les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, seuls habilités à délivrer une attestation autorisant une interruption médicale de grossesse – 6 000 attestations sont délivrées chaque année. Dans les autres cas, des gestes de prévention ont été réalisés pendant la grossesse – on peut traiter le foetus ou la mère – ou juste après la naissance.
La plupart du temps, ce ne sont pas des maladies génétiques que l'on identifie dans ce cadre, mais des malformations telles qu'une transposition simple des gros vaisseaux, une absence de paroi abdominale ou un syndrome « transfuseur – transfusé ». On peut intervenir in utero en réalisant des actes de prévention pour permettre la naissance d'enfants sains au lieu d'une interruption spontanée de la grossesse ou de la naissance d'enfants lourdement handicapés.
À ces deux dispositifs s'ajoute le dépistage néonatal, qui n'entre pas aujourd'hui dans la sphère de compétence de l'Agence de la biomédecine. Cinq tests sont effectués d'office pour dépister des maladies extrêmement graves, pouvant conduire à des handicaps mentaux très sévères, mais susceptibles d'être prévenus par un simple régime.

Pouvez-vous revenir sur le taux de trisomie préalablement au dépistage ? Quelle est l'incidence de ce dernier ?
Ce dépistage a lieu depuis plus de vingt ans, mais nous n'avons pas de statistiques systématiques.
Les méthodes ont évolué : le dépistage et le diagnostic ont longtemps été réservés aux femmes de plus de trente-huit ans, avant l'adoption du dosage des marqueurs sériques du deuxième trimestre. En raison de l'insuffisante sensibilité de ce test, on a ensuite multiplié les gestes invasifs, avec une efficacité en réalité modeste. Des femmes s'inquiétaient beaucoup de devoir réaliser une amniocentèse, alors que la probabilité de trisomie 21 était inférieure à 10 %. Depuis quelques années, il existe un nouveau procédé de dépistage reposant à la fois sur le dosage des marqueurs sériques du premier trimestre et sur une échographie, laquelle permet notamment de mesurer la clarté nucale. L'objectif n'est pas de découvrir davantage de cas, mais de réduire les gestes invasifs en améliorant la sensibilité de détection. Cet objectif a vraisemblablement été atteint, car le nombre d'amniocentèses a diminué de 30 % ou 40 % en 2010. Il reste à vérifier que la capacité de détection n'a pas changé.
Je précise, par ailleurs, que les 74 000 examens cytogénétiques réalisés chaque année ne concernent pas tous le dépistage de la trisomie 21.
Outre les décisions d'interruption de la grossesse à la suite d'anomalies majeures, le diagnostic prénatal peut conduire à des mesures de prévention. La possibilité de connaître très tôt le rhésus permet notamment d'éviter les incompatibilités sanguines foeto-maternelles : on peut réaliser des transfusions in utero et empêcher la fabrication d'anticorps par la mère. La découverte de maladies métaboliques telle qu'un déficit d'ornithine carbamyl transférase, enzyme intervenant dans le métabolisme des protéines, conduit également à des mesures préventives : un régime alimentaire normal serait toxique pour le cerveau et pourrait nuire au développement psychomoteur de l'enfant.
Tout dépend du contexte, notamment de l'histoire familiale. Pour ce qui est du dépistage néonatal, les tests dépendent de la fréquence des anomalies attendues : s'il fallait dépister toutes les maladies rares – on en compte entre 6 000 et 7 000 en France –, le coût serait supérieur au budget de la sécurité sociale.

La surdité constitue une anomalie pour certains et une identité culturelle pour d'autres. Nous nous sommes ainsi interrogés sur la mise en place d'un dépistage néonatal et sur l'action, médicale ou non, à adopter. Quel regard portez-vous sur ces deux questions ?
La surdité peut résulter d'une altération du génome. Considérer un variant génétique ou une mutation comme une anomalie, dans la mesure où l'on s'écarte de la normalité, ne revient pas à porter un jugement. On ne dit pas que les porteurs de l'anomalie doivent suivre tel ou tel traitement.
Quel que soit le dépistage, les parents doivent être informés et leur consentement recueilli : cela relève de l'autorité parentale. Le dépistage et le traitement d'une maladie ne peuvent être imposés par les pouvoirs publics que dans certains cas, tel celui de l'hyperplasie congénitale des surrénales, une des cinq maladies concernées par le dépistage néonatal : l'enfant risque de mourir ou de souffrir d'un handicap mental profond si son régime alimentaire n'est pas adapté. Pour la plupart des autres maladies, la stratégie médicale résulte d'un dialogue entre les professionnels de santé et les parents.

Les parents sourds d'un enfant lui aussi atteint de surdité partagent un même environnement. Ils peuvent donc lui offrir toutes les possibilités de développement et d'insertion au sein de la société. Or, ce n'est pas le cas des parents non sourds. En l'absence de dépistage et de traitement, leurs enfants risquent de souffrir de retards mentaux très importants.
Il y a la question de la disponibilité du test, et celle de sa performance : le dépistage doit être fiable et relativement simple. Puis son coût doit être évalué au regard de son rendement social, lequel dépend du nombre de personnes concernées. C'est pourquoi, par exemple, le dépistage et la prise en charge précoce de l'hypothyroïdie congénitale présentent un intérêt considérable.
La médecine prédictive fait partie de la médecine. Il faut donc préserver la notion de consentement aux soins, pour soi comme pour ses enfants. Quand un dispositif est rendu obligatoire, il faut mesurer l'atteinte aux libertés fondamentales que cela implique, et mettre en balance la nécessité de santé publique et l'atteinte aux libertés.
Dans le cas de la surdité, l'avenir de l'enfant est en jeu, de même que son insertion sociale. C'est aux pouvoirs publics de se prononcer. Quel que soit le bénéfice attendu d'un dispositif, les professionnels de santé ne doivent pas oublier que les patients ont la liberté de ne pas se soigner, de ne pas savoir et de ne pas soigner leurs enfants – dans la limite du raisonnable, le procureur de la République pouvant intervenir en cas de mise en danger d'autrui.
S'agissant des maladies génétiques, l'information peut être utile pour les descendants, mais c'est beaucoup moins vrai quand il n'est question que de soi ou quand il n'existe pas d'arsenal thérapeutique. Si votre père ou votre oncle est mort de démence à l'âge de quarante ans, vous pouvez souhaiter vous organiser en conséquence, mais vous avez aussi le droit absolu de ne pas savoir. Si des soins sont possibles pour les proches, le législateur a souhaité, en revanche, que l'on fasse tout pour qu'ils soient avertis.

Quand il n'existe pas de traitement, le diagnostic d'une maladie ne peut que susciter de l'angoisse. La situation est un peu différente lorsqu'il peut y avoir des conséquences pour la parentèle : le diagnostic est susceptible d'éviter l'apparition de la maladie.
S'agissant de l'hémochromatose, il existe un diagnostic et un traitement peu intrusif permettant d'éviter les complications hépatiques et cardiaques. La question est de savoir à qui l'on fait passer le test.
L'hémochromatose est un cas d'école : le dépistage fait appel à toute la sophistication de la génétique, et quand le résultat est positif, le traitement repose sur une technique en vogue au XVIIe siècle – mais en l'occurrence très efficace –, la saignée.
Le problème est celui de la prescription, dont la fréquence a connu une progression foudroyante depuis que le test a été inscrit dans la nomenclature. On observe d'ailleurs le même phénomène s'agissant de la thrombophilie non rare : près de 40 % des tests génétiques moléculaires effectués en France sont afférents à ces deux maladies. Or, nous sommes convaincus qu'une grande partie de ces prescriptions est inutile. Ces tests font donc courir, nous le pressentons, un grand risque pour les finances publiques.
Les tests de génétique moléculaire permettent de diagnostiquer des maladies génétiques rares, mais graves. Cependant, s'ils sont prescrits trop largement sous prétexte qu'ils sont très efficaces et qu'un traitement correspondant est disponible, nous irons devant de graves difficultés sur le plan financier. La pression augmente avec la progression des techniques. Certes, les puces à ADN, les tests permettant de repérer un SNP (single nucleotide polymorphisme) ne sont pas coûteux à l'unité. Mais leur banalisation, elle, le serait, surtout si l'acte n'a aucune utilité clinique mais ne sert qu'à rassurer.
Je ferai deux remarques complémentaires, l'une concernant l'offre de soins, l'autre sur les conséquences d'une prescription non sélective.
On le voit avec le développement du schéma régional d'organisation des soins : en matière de génétique, la réflexion menée actuellement en liaison avec la direction générale de l'offre de soins porte non seulement sur l'aptitude de tel laboratoire à procéder à tel examen, mais aussi sur la nécessité de replacer le patient au centre du dispositif. Entre le patient et le laboratoire se trouve le médecin : ce dernier doit non seulement prescrire de façon pertinente et au bon moment, mais aussi rendre compte au patient du résultat et de la façon dont on peut l'interpréter. Le niveau de compétence nécessaire pour satisfaire à ces deux exigences est un élément crucial à prendre en compte lors du maillage du territoire.
S'agissant des conséquences financières d'une prescription non sélective, le groupe de travail chargé de réfléchir, aux États-Unis, à la mise en pratique des tests génétiques et à leur intérêt clinique a réalisé une évaluation très précise du rapport coût-bénéfice de la détection de la mutation à l'origine du syndrome de Lynch, compte tenu du risque de cancer colorectal. Or, ce rapport est vingt fois plus favorable quand la prescription s'appuie sur la connaissance du contexte – âge, histoire familiale – que lorsque l'examen est prescrit de façon systématique : le coût est de 10 000 dollars dans le premier cas, mais de 260 000 dollars dans le second. S'agissant de l'hémochromatose, une analyse du rapport coût-efficacité aboutirait probablement à des résultats similaires : celui-ci est bien meilleur quand la prescription n'est pas réalisée de façon aveugle, mais guidée par un contexte.

L'inscription du dépistage de l'hémochromatose dans la nomenclature a permis d'en autoriser le remboursement. Le problème est de le prescrire à bon escient, ce qui relève de la responsabilité du médecin et de la Haute Autorité de santé, et nécessite un contrôle des bonnes pratiques.
Le problème va se poser de façon aiguë pour la pharmacogénétique. Certes, des marqueurs peuvent permettre de déterminer si un traitement sera efficace ou au contraire toxique pour le patient. Mais cette relation n'est pas toujours aussi claire. Or, de plus en plus, des firmes pharmaceutiques proposent des molécules associées à un outil diagnostique de recherche de marqueur, si bien qu'au lieu de rembourser seulement le coût de la molécule, la sécurité sociale en vient à rembourser également le coût du développement du marqueur. Cela semble pertinent si on a la certitude que le traitement est inefficace en l'absence de marqueur – comme dans le cas de l'hépatite C –, car on ne prescrit alors le traitement qu'aux gens qui en tireront bénéfice. Mais le caractère systématique de la recherche de marqueurs et la facilité à les mettre en évidence ont, en l'absence de validation, quelque chose d'assez inquiétant. Une réflexion s'impose, non seulement dans notre pays mais au niveau mondial, sur l'opportunité de généraliser le lien entre prescription et recherche génétique. Dans le cas contraire, il en résulterait un surcoût dont ni les patients ni les comptes de la sécurité sociale ne pourraient tirer le moindre bénéfice.

Il faut distinguer les marqueurs s'attachant à la personne et ceux qui sont liés à une tumeur.
Mes propos ne concernaient pas l'oncogénétique.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale procède ensuite à l'audition de M. Jean-Claude Étienne, rapporteur de l'avis du Conseil économique, social et environnemental relatif aux enjeux de la prévention en matière de santé.

La communication de la Cour des comptes sur la prévention sanitaire a dénoncé le manque de coordination entre les organismes chargés de la prévention et l'absence de hiérarchisation des priorités en la matière. Quelle appréciation portez-vous à ce sujet ?
Le rapport sur les enjeux de la prévention en matière de santé n'a pas encore été adopté par le Conseil économique, social et environnemental, ni même validé par les sections concernées ; je m'exprimerai donc à titre personnel.
La prévention rencontre beaucoup d'intérêt aujourd'hui : depuis trois ans, le sujet est à la mode. Pourtant, même si l'on sait a priori qu'elle coûte assez cher, les derniers chiffres disponibles, selon lesquels les dépenses en ce domaine s'élèvent à 10,5 milliards d'euros, soit 0,6 % du produit intérieur brut et 6,4 % des dépenses de santé, datent de dix ans. Du point de vue financier, les données précises manquent donc, d'autant plus que prévention et soin s'entremêlent souvent.
Dans son communiqué du 29 septembre relatif à la programmation de ses travaux, la MECSS ne s'est pas contentée de citer l'Organisation mondiale de la santé pour définir la prévention sanitaire – « l'ensemble des mesures prises pour éviter l'apparition, le développement ou la complication d'une maladie » – ; elle a aussi rappelé la coexistence de deux approches, l'une centrée sur les pathologies et l'autre sur les populations. Or ce dernier aspect est fondamental, et reste négligé par beaucoup de ceux qui écrivent sur le sujet.
Il existe en effet en France un travers culturel que d'autres pays comme la Grande-Bretagne, les pays scandinaves ou certains Länder allemands ne connaissent pas dans la même mesure : pour les professionnels de santé comme pour le reste de la population, c'est la maladie qu'il faut guérir, en particulier dans ses manifestations les plus aiguës. Or la courbe exprimant l'investissement financier en fonction de l'âge montre bien que les dépenses de santé culminent dans les dernières années de la vie. La prévention – et notamment la prévention primaire – doit intervenir avant, au moment où cela coûte le moins. Financièrement parlant, il convient de séparer le bon grain, ce que l'on dépense en faveur de la prévention primaire, de l'ivraie, c'est-à-dire du désordre des autres dépenses de prévention – préventions secondaire, tertiaire, et même quaternaire, contre la surmédicalisation –, qui se mêlent aux dépenses consacrées aux soins. Tant que l'on n'aura pas effectué cette séparation, on ne pourra pas estimer le coût de la prévention.
Que cette dépense soit ou non équivalente à ce qu'elle était il y a dix ans, j'ai le sentiment qu'elle pourrait être plus efficace. Avant de se préoccuper de nouveaux moyens de financement, il importe donc de chercher des solutions pratiques, concrètes, simples et pas nécessairement très coûteuses qui permettraient d'être plus efficient. Nos résultats ne sont certes pas mauvais, mais ils sont loin d'égaler ceux qu'obtiennent certains pays européens à niveau de développement comparable. Cela tient à cette culture du « tout curatif » qui imprègne notre pays : être soignant, c'est d'abord soigner un malade.
Désormais, nos concitoyens, avec raison, demandent à la collectivité de les accompagner afin qu'ils restent en bonne santé : c'est le champ de la prévention. Même si les assurances qu'elle peut procurer sont encore scientifiquement incertaines, certaines pistes sont déjà reconnues comme très prometteuses.
Je ne peux donc qu'approuver les dix préconisations formulées par la Cour des comptes. Mais si l'on s'en tient à ces mesures, nous n'aurons encore effectué qu'une petite partie du chemin. Il reste à décliner concrètement, dans la vie de nos concitoyens, l'action de prévention, notamment primaire, même sans la certitude d'obtenir des résultats immédiatement tangibles. La prévention, surtout primaire, est comme le placement or : coûteux au début, mais rentable ultérieurement. Le retour sur investissement apparaît lorsque l'on passe au versant curatif. C'est pourquoi j'appellerai dans mon rapport à rechercher la meilleure utilisation possible des fonds actuellement consacrés à la prévention primaire.
Dans un pays préoccupé avant tout par la performance des technologies curatives, il convient en premier lieu de diffuser une culture de prévention. Mais nous n'obtiendrons rien de nos concitoyens si nous cherchons à leur imposer des préconisations trop éloignées de la vie courante. Je souscris donc à la notion de prévention tout au long de la vie, en commençant dès l'âge scolaire. Ainsi en matière de consommation de tabac, les enfants du cours moyen sont les meilleurs vecteurs de prévention. Celle-ci doit par conséquent dépasser le cadre trop étroit du ministère de la santé et associer l'Éducation nationale. Pour l'instant, la prévention n'apparaît pas dans les programmes scolaires relatifs aux sciences et techniques de la vie, alors qu'à l'époque de mon grand-père, instituteur de campagne, les manuels donnaient des règles d'hygiène. Or les jeunes élèves ne peuvent se contenter de disséquer le muscle gastrocnémien chez la grenouille ; ils doivent également diffuser une culture de prévention auprès de leurs aînés.
De même, chaque étape de la vie mérite de bénéficier d'un relais en matière de prévention. Alors que celle-ci se décline aujourd'hui de manière confuse à travers de nombreux programmes, il n'existe pas d'étape obligée permettant à un professionnel – de santé ou non – de dispenser des conseils en la matière.
J'ai examiné le programme de formation des aides-soignantes : la partie consacrée à la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, reste insuffisante. Elles pourraient pourtant jouer, à moindre coût, un plus grand rôle en ce domaine. D'une façon générale, la prévention doit être enseignée à tous ceux qui interviennent auprès de nos concitoyens en matière de santé. Toutes les catégories doivent être concernées et pas seulement les médecins. Ces derniers sont d'ailleurs ceux qui font le moins de prévention, car les personnes bien portantes, par définition, les consultent rarement. Quant aux autres, elles souhaitent avant tout guérir, et peu leur importe de savoir ce qui leur aurait permis d'éviter de tomber malade. De toute façon, le médecin n'a pas de temps de s'occuper d'autre chose que de soin.
Le résultat est que les contacts entre la population et les médecins se limitent à une action curative. Les contrats d'amélioration des pratiques individuelles pourraient permettre la diffusion d'une culture de prévention, mais celle-ci doit également occuper une plus grande place dans la formation des médecins ou des infirmières ; ainsi, dans les questions d'internat, la prévention tient en deux lignes sur un total de quinze pages. Pourtant, former à la prévention l'ensemble des professionnels de santé et en diffuser la culture auprès des associations ne seraient pas coûteux, à la différence des messages de prévention pour lesquels on dépense aujourd'hui des sommes considérables sans en évaluer correctement l'efficacité !
Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse à ce propos. Pour tester la pertinence de ces messages, il suffirait d'utiliser l'imagerie par résonance magnétique qui renseigne sur leur mémorisation ! La mention « Fumer tue », apposée sur les paquets de cigarette, n'a absolument pas fait diminuer le tabagisme. En revanche, les informations selon lesquelles la fumée du tabac peut rendre malade son entourage, en particulier les enfants, ou encore selon lesquelles les spermatozoïdes sont beaucoup moins mobiles chez les fumeurs, ont un réel impact sur la population. L'approche cognitive préalable que permet cette imagerie par résonance magnétique, et dont le coût est beaucoup moins élevé qu'une enquête de résultats réalisée au bout de deux ou trois ans, permet de donner une consistance objective à ces observations. D'ailleurs, cette approche scientifique moderne est en usage chez certains de nos voisins.
Je suis favorable à la mise en place de quatre visites de prévention, une à chaque grande étape de la vie. La première, pour les enfants, serait celle qui est déjà assurée par la protection maternelle et infantile des départements. La deuxième concernerait les jeunes étudiants et les apprentis. La troisième devrait être effectuée par la médecine du travail, à l'entrée dans la vie professionnelle. Les visites périodiques de prévention obligatoires pour les entreprises, selon le code de la santé publique, ne sont malheureusement réalisées qu'à raison d'une sur trois aujourd'hui ! Enfin, la quatrième visite – ô combien utile – doit se faire au moment de la retraite. Dernièrement, j'ai reçu en consultation à l'hôpital un retraité qui ressentait une douleur au pli de l'aine : il n'avait jamais eu de problèmes articulaires avant sa cessation d'activité et marchait quatre kilomètres chaque jour, comme le préconisent toutes sortes de publications. L'examen médical a révélé qu'il souffrait d'une coxarthrose, qu'une visite de prévention lui aurait épargnée en permettant de détecter une coxa valga et une coxa retrorsa, ce qui aurait conduit à prescrire le vélo ou la natation, mais surtout pas la marche à pied ! Combien de gonarthroses et de coxarthroses pourraient ainsi être évitées grâce à une visite de prévention autour de la soixantième année !
En outre, les résultats de ces visites devraient être consignés dans le carnet de santé ou, à défaut, dans un document renseigné par les professionnels de santé – pas seulement par les médecins – et que le patient conserverait toute sa vie. Le coût pour le budget de l'État ne serait pas important.
À ce propos, je me permets d'appeler votre attention sur le fait que le dossier médical personnel, pour lequel de gros investissements ont été réalisés, n'est toujours pas opérationnel : la prévention n'y est même pas formalisée et, des quatre régions dans lesquelles il est expérimenté, une seule a souhaité qu'on y remédie !
La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique énumère cent thèmes, dont certains se recoupent très largement ; ainsi la maladie d'Alzheimer y est citée trois fois, l'accident vasculaire cérébral deux fois. Or la prévention ne peut reposer sur « un inventaire à la Prévert », qui ne peut conduire à une politique budgétairement viable. Cette liste n'est d'ailleurs pas exhaustive puisqu'elle n'inclut aucun élément se rapportant à l'environnement et aux différentes étapes de la vie – si ce n'est une petite ligne sur la consultation préretraite et une autre sur les activités physiques et sportives.
Une des oppositions à la hiérarchisation des priorités de santé publique, est la crainte qu'en cas d'effort consenti pour le cancer, les cardiaques ne se sentent lésés. Il faut sortir de cette ambiguïté, dénoncée par la Cour des comptes dans sa recommandation n° 8, car elle est coûteuse et est contre-productive.
La hiérarchisation relève d'une décision politique. Tant qu'elle ne sera pas effectuée, la prévention primaire se révélera inefficace, sans compter que son évaluation budgétaire restera impossible. Une nouvelle loi de santé publique est aujourd'hui nécessaire afin de définir, non pas les priorités, mais la méthode à suivre pour déterminer celles-ci. Cette méthode devrait nous conduire à faire porter l'effort sur les maladies pour lesquelles n'existe pas de dispositif curatif et pour lesquelles la prévention primaire présenterait par conséquent le plus fort intérêt.
Ainsi que le montre la Cour des comptes, d'autres pays ont procédé à cette hiérarchisation, comme certains Länder allemands, mais aussi le Royaume-Uni qui a retenu quatre thématiques seulement : les maladies cardiovasculaires pour sauver 200 000 vies, les cancers pour en sauver 100 000, les accidents pour en sauver 12 000 et la santé mentale pour en sauver 4 000 –, assorties d'indicateurs de suivi. Nous gagnerions beaucoup à nous inspirer de ces exemples, étant entendu qu'il conviendrait chez nous de faire prévaloir la prévention des cancers sur celle des maladies cardiovasculaires.
Au lieu de cela, on lance à grands frais un plan Alzheimer tandis que certains politiques soutiennent qu'une fois diagnostiquée, cette maladie évolue inéluctablement. Or la recherche clinique a montré, certes depuis un an et demi seulement, qu'il était possible de prévenir le changement de stade de la maladie. Ce serait donc une erreur dramatique que de porter l'effort sur les cas les plus graves et non sur les patients atteints au premier stade de la maladie ! C'est justement au moment du diagnostic que la prévention secondaire doit intervenir pour éviter une aggravation ! C'est donc à ce moment qu'il convient d'investir, d'autant que les scientifiques sont très loin d'avoir mis au point le médicament qui agira sur la corne de l'hippocampe, malgré les sommes consacrées à cette recherche ! Je ne préconise pas l'arrêt de la recherche médicamenteuse sur les maladies pour lesquelles il n'existe pas de procédure curative efficace ; mais je souligne que le seul levier dont nous disposons aujourd'hui est celui de la prévention primaire et secondaire.
Il faut non pas des financements supplémentaires, messieurs les parlementaires, mais une refonte du système, car il est possible de faire beaucoup mieux avec les moyens budgétaires actuels.

Quand pourrons-nous disposer du rapport du Conseil économique, social et environnemental ?
Comme l'a montré la Cour des comptes, de multiples acteurs interviennent dans le domaine de la prévention. Afin de remédier au défaut de pilotage, elle propose de donner au directeur général de la santé les compétences de délégué interministériel à la prévention sanitaire. Or comment ce dernier pourrait-il avoir autorité à la fois sur la médecine du travail, sur la médecine scolaire et sur tout ce qui relève de l'environnement, de l'agriculture et de la santé ? Que proposez-vous pour votre part ?
Notre rapport sera rendu public dès que nous aurons achevé de traiter du problème de la gouvernance. En la matière, je pense que la prévention doit cesser de relever du seul ministère de la santé, car elle relève de bien d'autres ministères : ceux de l'éducation nationale, du travail, du logement, de l'environnement ou encore des transports. À défaut, elle restera en déshérence.
Il nous faut une entité dédiée à la prévention, même si on ne peut la concevoir sans le soutien du ministère de la santé. J'aurai deux propositions à faire en ce sens.
Premièrement, le Comité d'animation du système d'agences devrait être davantage ouvert aux autres départements ministériels impliqués dans la prévention. Certes, c'est une instance de travail collectif, mais il est actuellement trop dépendant du ministère de la santé.
Deuxièmement, il faudrait créer une structure ad hoc comme dans certains Länder allemands qui se sont dotés, à côté d'un office de la santé, d'un office de la prévention, les deux collaborant. Une délégation interministérielle, dépendant directement du Premier ministre, permettrait d'assurer la participation des différents ministères intéressés, mais aussi de garantir le suivi des indicateurs de prévention indépendamment de celui des indicateurs de santé. Chaque ministère impliqué serait satisfait. On appliquerait pour la prévention ce que M. José Luis Rodriguez Zapatero voulait faire pour la santé quand il affirmait que tous ses ministres étaient des ministres de la santé et que ceux qui ne l'étaient pas encore devaient le devenir…
En revanche, si, comme certains le proposent, le directeur général de la santé animait un groupe « pluriministériel » mais que la prévention restait dans le seul giron du ministère de la santé, je doute fort que les choses évoluent favorablement.
En résumé, la prévention nécessite une approche pluridisciplinaire associant l'ensemble des acteurs éducatifs et sociaux et impliquant tous les ministères, chacun agissant dans son domaine respectif, sur des thématiques précises et hiérarchisées conformément à une méthode définie par le Parlement. Il ne s'agirait pas d'un bouleversement, mais d'une évolution à partir de l'existant, qui m'apparaît toutefois indispensable si l'on veut que les choses changent à l'avenir.

La situation est complexe. D'une part, au niveau régional, où les agences de santé sont chargées à la fois du soin et de la prévention, il existe de fortes inégalités en matière de taux de suicide ou d'alcoolisme par exemple. Par ailleurs, la prévention doit inclure le dépistage : comment un délégué interministériel pourrait-il intervenir sur le dépistage du cancer de la prostate, par exemple ? Il nous faut trouver une solution viable…
Plusieurs directeurs d'agences régionales de santé m'ont interrogé sur ce point. Ils doivent en effet pour la première fois élaborer un document pour l'exercice 2012 sur cette thématique de la prévention. Ils disposent au demeurant d'un budget dédié. Or les exigences en matière de prévention diffèrent en effet considérablement d'une région à une autre. Selon nos préconisations, chaque agence régionale de santé aurait donc à décliner pour sa région les thématiques fondamentales, hiérarchisées qui seraient dotées financièrement au niveau national.
Il y a donc deux niveaux pour la prévention : un niveau national, qui nécessite une gouvernance regroupée, et un niveau local, qui doit être l'échelon régional, où la gouvernance relève de l'agence régionale de santé.
Si vous acceptez le principe de la hiérarchisation, ce qui serait pour la prévention en France une révolution dont il vous reviendrait de prendre la responsabilité politique, le Haut Conseil de la santé publique et, peut-être, la Haute Autorité de santé auraient à définir la méthode permettant de l'appliquer. En effet, cette tâche ne relève pas des politiques, mais des experts en la matière que sont ces instances d'ailleurs constituées ad hoc.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale procède en dernier lieu à l'audition de Mme Valérie Delahaye-Guillocheau, chef de service à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Mme Mireille Jarry, sous-directrice des conditions de travail, et Mme Patricia Maladry, responsable de l'inspection médicale.

Mesdames, vous savez que, dans sa communication sur la prévention sanitaire, la Cour des comptes a insisté, en même temps que sur le défaut de coordination et de hiérarchisation des objectifs de santé publique, sur la nécessité d'intégrer dans une politique ambitieuse de prévention la contribution de la médecine scolaire et de la médecine du travail. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous entendre.

Pas plus que l'Éducation nationale, en effet, la médecine du travail ne peut être ignorée d'une politique de prévention. La première question a trait à la gouvernance générale du système. Pour permettre aux ministères de la santé, de l'environnement, du travail ou encore de l'agriculture de collaborer, la Cour des comptes propose la nomination d'un délégué interministériel. Est-ce la bonne solution ? Quelle serait l'autorité de ce délégué interministériel vis-à-vis des ministères ?
Malgré la réforme de cet été, la médecine du travail est confrontée à un certain nombre de difficultés : les visites sont de plus en plus espacées, et la démographie médicale est préoccupante. Comment établir un lien entre médecins traitants et médecins du travail pour prévenir, notamment, les maladies musculo-squelettiques ? Comment s'articulent la médecine du travail, la prévention et la prise en compte de l'environnement ?
Je vous prie d'excuser M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail, retenu par une réunion de la Commission nationale de la négociation collective.
Le particularisme de la politique de la santé au travail par rapport aux autres politiques de santé publique tend à s'atténuer. Ainsi, au cours de la dernière décennie, nous avons nous aussi élaboré des plans – nous en sommes aujourd'hui à la deuxième génération, avec le plan Santé au travail 2010-2014. Cette politique n'en présente pas moins des spécificités, inhérentes à son ancrage dans le monde de l'entreprise. Ainsi deux acteurs y jouent un rôle important : l'entreprise et les partenaires sociaux, et, sur un sujet comme la prévention des troubles musculo-squelettiques – l'une des priorités de l'actuel plan Santé au travail –, l'action n'est même possible qu'en collaboration avec ce binôme : elle suppose en effet de travailler à la fois sur l'organisation du travail, sur l'aménagement des postes et sur la gestion des ressources humaines.
La politique de prévention et de santé au travail s'inscrit également dans une continuité historique, qui relie la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail à certaines dispositions du code du travail actuel, spécialement à l'article L 4121-1, qui pose clairement le principe de la responsabilité de l'employeur en matière de santé et de sécurité des salariés. Cette responsabilité trouve sa traduction dans le fait que les cotisations pour financer le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles sont exclusivement des cotisations patronales. Aucune autre politique de santé publique ne présente cette particularité, qui se traduit également dans l'obligation faite à l'entreprise de tenir à jour un document d'évaluation des risques professionnels – obligation réaffirmée dans le cadre de la transposition des directives européennes.
Cependant, ses spécificités ne remettent pas en question la place de la médecine du travail, dont l'apport est essentiel à la construction des politiques de prévention au sein de l'entreprise.
Comme je l'ai dit, l'articulation avec la politique générale de santé publique et de prévention a été renforcée au cours de la dernière décennie. Élaboré en 2008-2009, le deuxième plan Santé au travail a été lancé en 2010. Il identifie quatre axes d'intervention prioritaires, parmi lesquels une meilleure connaissance des risques professionnels, un développement de la prévention de certains risques particulièrement importants et une prise en compte des problèmes spécifiques aux petites entreprises. Il a été élaboré et il est appliqué en interaction constante avec d'autres plans de santé publique. Ainsi le plan Cancer II comporte des dispositions qui se retrouvent dans le plan Santé au travail par la priorité donnée à la connaissance des cancers professionnels. La convergence est également forte avec le plan national Santé environnement II en ce qui concerne la prévention des risques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. De même, un certain nombre d'actions du plan Santé au travail trouvent un écho dans le plan national d'action concertée 2009-2012 de la branche des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et sont reprises dans la convention d'objectifs et de gestion de celle-ci. Nous travaillons par ailleurs en étroite collaboration avec les services de santé sur le plan du virus VIH, et avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie et la direction générale de la santé sur la lutte contre les addictions. La tutelle conjointe exercée sur des opérateurs tels que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la participation aux comités de pilotage des différents plans de santé ou celle de la direction générale de la santé au comité d'orientation des conditions de travail sont autant d'autres occasions de travail en partenariat.
La même logique est à l'oeuvre au niveau territorial. Le plan Santé au travail II se décline ainsi dans des plans régionaux de santé au travail, qui ont été élaborés à partir de l'été 2010 en partenariat avec les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, avec les agences régionales de santé, avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, mais aussi avec la Mutualité sociale agricole et avec les associations régionales de l'amélioration des conditions de travail. Instruction avait en effet été donnée par le directeur général du travail que ces plans régionaux soient soumis aux commissions de coordination des politiques publiques qui travaillent sous l'égide des agences régionales de santé. Dans certaines régions, des collaborations et des coordinations s'opèrent entre la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et l'agence régionale de santé, s'agissant de l'application du plan régional de santé au travail et de son articulation avec le plan régional de santé publique.
On ne peut donc plus vraiment dire – comme le faisait un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales en 2003 – que la politique de santé au travail se déploie de manière totalement autonome et cloisonnée par rapport aux autres politiques de santé publique.
Compte tenu de l'existence de tous ces lieux d'échange et de coordination, faut-il parfaire le dispositif en instituant une délégation interministérielle, comme le propose la Cour des comptes ? Pour notre part, nous sommes plutôt dubitatives. Nous avons ouvert un certain nombre de pistes en faveur d'une action coordonnée et d'une plus grande complémentarité. L'effort mérite sans doute d'être amplifié, mais cela n'implique pas nécessairement de mettre en place un système très structuré, qui risquerait de poser des difficultés. Car quand bien même la direction générale de la santé serait le point d'ancrage et détiendrait cette autorité interministérielle de coordination des politiques de santé publique, rien ne dit qu'il ne faudrait pas s'en remettre dans certains cas à l'expertise du ministère du travail… À la suite des drames qui ont endeuillé France Télécom à l'automne 2009, le ministre de l'époque, M. Xavier Darcos, avait arrêté un plan d'urgence pour la prévention des risques psychosociaux. Le travail qui a été conduit en liaison avec la société, à tous ses niveaux, exigeait une connaissance très intime des problèmes spécifiques à l'entreprise. Il faut donc conserver une souplesse qui permette de rester en prise avec les particularités du monde du travail. C'est pourquoi nous sommes assez réservées sur l'idée de confier à la direction générale de la santé une fonction de supervision. La coordination et le partenariat mis en oeuvre aujourd'hui sont réels et sont positifs : nous ne sommes plus dans une logique de cloisonnement. Le système actuel pourrait donc utilement prospérer.

Vous ne m'avez pas répondu sur la coordination entre les médecins traitants et les médecins du travail.
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail commence seulement à entrer en application, puisque nous travaillons encore sur ses décrets d'application qui seront prochainement soumis au Conseil d'État. Il est donc un peu tôt pour estimer que ce texte n'atteindrait pas tous ses objectifs…
L'évolution de la démographie médicale entraîne, il est vrai, une situation tendue. Mais, tout en préservant la particularité et le rôle éminent de la médecine du travail, la réforme vise à tirer le meilleur profit de la composition pluridisciplinaire des services de santé au travail, qui ne comptent pas seulement des médecins, mais aussi des ingénieurs, des ergonomes, des infirmiers, des assistants de santé au travail pour pouvoir concentrer le temps disponible des médecins du travail là où leur valeur ajoutée est la plus évidente. Les visites périodiques sont l'un des éléments sur lesquels on peut avoir une marge de manoeuvre pour assurer un fonctionnement optimal de ces services.
Quant à l'articulation entre médecins du travail et médecins traitants, certains suggèrent que ces derniers pourraient jouer un rôle en matière de santé au travail. J'objecterai que les médecins généralistes ne connaissent pas nécessairement les milieux de travail. Il serait par exemple difficile de leur demander d'apprécier l'aptitude au poste des personnes concernées.
À l'inverse, on peut se demander dans quelle mesure les médecins du travail pourraient jouer un rôle dépassant leur fonction de conseil et d'appui à l'employeur, de responsable de la santé du travailleur, et intervenir dans des actions de santé publique au sens large – par exemple en participant à des plans de prévention de l'obésité. On peut certes établir des passerelles entre les différentes politiques de santé, pour autant, et compte tenu du problème de démographie médicale que vous avez rappelé, l'entreprise n'apparaît pas nécessairement comme le lieu où mettre en oeuvre toutes ces actions. Il convient donc de rester prudent face à cette tentation.
Les relations entre médecin traitant et médecin du travail sont longtemps restées insuffisantes. Une des raisons réside d'abord dans la formation générale des médecins : dans les centres hospitaliers universitaires, le temps d'enseignement de cette discipline était jusqu'à présent compris entre deux et quatorze heures, ce qui est très inférieur à la moyenne européenne. Des progrès ont néanmoins été accomplis : la médecine du travail a investi les amphithéâtres, et le nombre d'heures d'enseignement dispensées aux étudiants en deuxième cycle d'études médicales a augmenté. L'objectif est de susciter des vocations, la spécialité en médecine du travail n'étant pas, comme chacun le sait, la plus prisée à l'examen national classant de fin de deuxième cycle, mais aussi de sensibiliser ceux qui se tourneront vers des spécialités susceptibles d'être concernées par les risques professionnels – cancérologie, pneumologie, dermatologie, psychiatrie. Des stages dans les services de santé au travail sont désormais prévus dès le deuxième cycle, afin que les futurs médecins découvrent cette discipline. Tous ne deviendront pas médecins du travail, mais du moins connaîtront-ils les missions de ces spécialistes – ce qui sera déjà un progrès.
La réforme de la médecine du travail prévoit par ailleurs que des médecins d'autres spécialités pourront se former, avec l'aide d'un tuteur spécialiste, au sein des services de santé au travail. Elle rend également obligatoire, à l'issue de tout arrêt maladie de plus de trois mois, la visite de pré-reprise – qui peut être demandée au médecin du travail par le médecin traitant, par le médecin de la sécurité sociale ou par le patient lui-même. N'oublions pas, en effet, que le maintien dans l'emploi fait partie des objectifs de la médecine du travail. Cette mesure devrait contribuer à améliorer la communication entre les praticiens.

Les problèmes de démographie touchent également les médecins généralistes.
Même si les médecins du travail ne semblent guère favorables à l'idée, ne pourrait-on imaginer que le médecin traitant, qui par définition connaît très bien son patient, puisse déclarer si ce dernier est ou non apte au travail, le médecin du travail déterminant quant à lui la nature du poste auquel il peut prétendre en fonction des nuisances auxquelles il pourrait être exposé dans l'entreprise ? La question se pose d'autant plus que le médecin du travail pourrait ne pas avoir accès au dossier médical personnel, ce qui n'est pas propice à un bon suivi puisqu'il pourrait ignorer les pathologies affectant ses patients.
Les médecins du travail ont en effet souvent demandé à avoir accès au dossier médical personnel, mais, hélas, sans succès. C'est dommageable puisque, comme vous l'avez mentionné, ils ne peuvent de ce fait connaître la nature des soins qui pourraient être prodigués par ailleurs à leurs patients, tandis que les médecins traitants ignorent si leurs patients travaillent ou non dans un contexte pathogène. Mais il faut aussi préciser que, jusqu'à présent en tout cas, les médecins du travail ont à se prononcer, non sur l'aptitude au travail du salarié, mais sur son aptitude à occuper tel ou tel poste de travail : le travail d'un coiffeur, en effet, peut différer selon le salon où il exerce même si le métier est le même.
Lors d'une récente rencontre, un enseignant en médecine du travail spécialisé dans la médecine factuelle « evidence based medecine » (EBM) m'assurait, suite à une méta-analyse réalisée dans plusieurs pays et contrairement aux idées reçues, que la visite d'embauche était probablement la plus utile de toutes. Cela étant, compte tenu de la démographie médicale, peut-être pourrait-on envisager que les visites périodiques soient l'occasion d'une collaboration avec le médecin traitant.

L'amélioration sensible de la coopération dont vous faites état concerne-t-elle les services de l'assurance maladie et, plus particulièrement, ceux de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles ?
La situation est assez variable, mais les médecins du travail et les médecins conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail souhaitent renforcer leur coopération, en particulier sur les questions relatives au maintien dans l'emploi. Une des premières mesures pourrait être une meilleure organisation des visites de pré-reprise. Lorsque le médecin conseil constate que la pathologie est susceptible de modifier l'aptitude au travail d'un salarié, il ne peut obliger celui-ci à consulter le médecin du travail. La solution passe par un effort de pédagogie auprès du patient.
De la même manière, il appartient au patient de transmettre au médecin de la sécurité sociale les informations reçues du médecin du travail et relatives au poste qu'il peut occuper. Je rappelle, en effet, que le médecin du travail se prononce sur l'aptitude au poste de travail et le médecin de la sécurité sociale sur l'employabilité de la personne. Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre se rencontrent régulièrement et parviennent à mieux communiquer au cas par cas.
Enfin, mais c'est un autre aspect du problème qui ne concerne pas les médecins conseils de la sécurité sociale, la prévention des risques professionnels dans les entreprises relève également des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Vos propos démontrent quand même la réalité d'un cloisonnement dû à la diversité des schémas d'organisation. Une meilleure structuration serait donc nécessaire.
Quelles que soient les spécificités de la médecine du travail, que vous avez rappelées, nul ne peut nier que les grands facteurs de risque pour la santé que sont l'alcoolisme et l'intoxication tabagique ont une incidence immédiate sur l'aptitude au poste de travail et sur la productivité du travailleur. Dès lors, il ne serait pas absurde que la médecine du travail les prenne en compte, dans le cadre plus large des dispositifs de prévention définis par les autorités interministérielles.
Le cloisonnement que vous dénoncez résulte d'une histoire administrative particulière, certains acteurs appartenant à l'administration d'État et d'autres relevant de la sécurité sociale. Dans ce contexte, nous agissons quotidiennement pour améliorer la coordination et la coopération. Il en est ainsi, au niveau national, lorsque le plan Santé au travail reprend des axes de la convention d'objectifs et de gestion 2009-2012 de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles ou, au niveau local, lorsque les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mènent des actions conjointes. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ont intérêt en effet à une prévention efficace des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la mesure où ils influent sur leurs charges et sur le niveau des cotisations patronales, mais les actions de leurs ingénieurs de prévention peuvent très bien s'articuler avec l'action des inspecteurs du travail ou du médecin inspecteur régional des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. De la même manière, la direction générale du travail travaille régulièrement avec la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Une organisation institutionnelle entièrement remodelée permettrait-elle d'agir encore plus efficacement ? La question reste ouverte.
Les problèmes d'addiction se posent sans doute aussi sur les lieux de travail, mais la politique nationale de prévention définie en la matière peut-elle s'appliquer sans spécifications dans les entreprises ? Par exemple, jusqu'à quel point le règlement intérieur peut-il proscrire la consommation de certaines substances ? La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, la direction générale de la santé et celle du travail ont récemment élaboré un guide sur ces questions, comportant un certain nombre de recommandations à l'adresse des entreprises.
L'alcool et la drogue peuvent en effet constituer des facteurs d'accidents du travail dont le médecin du travail doit tenir compte en tant qu'acteur de la prévention des risques professionnels. Cependant, la médecine du travail étant, comme la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, financée par les cotisations des employeurs, ceux-ci insistent fortement pour qu'elle s'en tienne là. De fait, une hypercholestérolémie, par exemple, a peu à voir avec les risques professionnels…

Cette mission n'entend nullement remettre en cause l'organisation globale de la médecine du travail. Nous cherchons simplement à oeuvrer à l'amélioration de la santé publique. Mais précisément, quand vous suggérez que la médecine du travail n'a pas se préoccuper de l'obésité, du diabète ou de l'hypertension d'un salarié, même si j'admets votre argument relatif à la position des employeurs, vous démontrez à nouveau l'existence de cloisonnements tout à fait déraisonnables au regard de cette préoccupation.

Les addictions ayant un effet immédiat sur la productivité du travailleur, on ne peut concevoir que les employeurs soient indifférents à cette question. Il ne s'agit évidemment pas ici de faire un procès à la médecine du travail, mais, compte tenu du coût de la politique nationale de prévention – entre un et dix milliards selon la Cour des comptes –, il est essentiel qu'elle gagne en efficacité grâce à une plus grande coordination des acteurs, chacun la relayant à son niveau. Les financeurs y ont un intérêt évident.

Nous ne visons pas spécialement la médecine du travail. Il est notoire qu'en matière de prévention, plus une action est précoce, plus elle sera efficace. Or la médecine scolaire n'est pas une priorité pour l'Éducation nationale comme en atteste le nombre d'infirmières et de médecins scolaires. De surcroît, la dernière réforme du statut des infirmières ne concerne pas les infirmières scolaires, qui continueront d'être recrutées au niveau bac + 2 alors que leurs collègues des hôpitaux le seront au niveau bac + 3. Cette absence de coordination est évidemment dommageable pour qui veut améliorer la santé de nos concitoyens et c'est pourquoi nous déplorons la persistance des cloisonnements, où qu'ils se situent.
Le terme de cloisonnement est un peu excessif. La médecine du travail et les partenaires sociaux – l'employeur, en effet, ne peut rien seul – contribuent, et à mon sens habilement, au règlement des problèmes que vous avez évoqués car ils s'efforcent de conjuguer la prévention des risques professionnels avec les priorités de santé publique.
Par exemple, la médecine du travail contribue grandement au programme national Nutrition santé en s'intéressant aux travailleurs de nuit et postés, dont le rythme de travail a une incidence sur leur mode de nutrition. Faire le procès du cloisonnement est vain dès lors que les différents acteurs travaillent ensemble. Cette collaboration s'étend même à la définition de la formation des médecins du travail : la Haute Autorité de santé et la Société française de médecine du travail ne sont pas les seules à formuler des recommandations sur ce sujet, c'est aussi le cas des associations d'endocrinologues, de nutritionnistes, de rhumatologues ou d'orthopédistes.
Il est en effet très important d'assurer aux patients une prise en charge continue, quelle que soit la diversité des professionnels de santé auxquels ils ont recours, et, dans le cas de la médecine du travail, même si leur maladie n'a pas une origine professionnelle.
Nous travaillons en ce moment avec l'Association France-Parkinson sur la question des pathologies chroniques lourdement invalidantes et sur le maintien dans l'emploi. Les salariés n'étant pas tenus de déclarer une telle maladie auprès du médecin du travail, certains retardent le moment de la déclaration, de peur de perdre leur emploi ou de subir une discrimination, ce qui fait obstacle à un bon suivi – et pose aussi, pour l'accès du médecin du travail au dossier médical personnel, un problème qui a été évoqué lors d'un colloque à Sciences-Po. Le cloisonnement du système, en l'occurrence, n'est pas responsable.
Si la politique de santé au travail participe des politiques de santé publique, elle s'inscrit également dans le cadre des politiques de l'emploi, et pas seulement parce que la prévention des risques professionnels relève de la responsabilité de l'employeur : les dispositions relatives à l'emploi des salariés âgés ou à la pénibilité, par exemple, ont des incidences sur elle. Ainsi l'incitation à élaborer des accords ou des plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité, qui figure dans la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, engage les partenaires sociaux à travailler sur ce difficile problème, au niveau des branches et des entreprises. Plus largement, le report de l'âge de la retraite à taux plein n'est pas sans effet sur les actions que nous devons mener en faveur du maintien dans l'emploi et de l'employabilité.

Ces précisions étaient utiles. J'étais quant à moi favorable à ce que le médecin du travail ait accès au dossier médical personnel puisqu'il est soumis au secret médical, mais certains ont fait valoir qu'il est lié à l'employeur et que le risque était grand, dès lors, que ce secret ne soit pas respecté. Nous devons donc nous attacher à convaincre que cet accès au dossier est nécessaire – comment assurer le suivi d'un salarié en ignorant s'il souffre de telle ou telle pathologie ? –, et rappeler que le médecin du travail est en principe indépendant de l'employeur. Le ministre du travail qui est en même temps celui de la santé devrait être en mesure de résoudre la difficulté – qui, il est vrai, ne se posera que lorsque le dossier médical personnel existera vraiment…

Ce qui risque de prendre d'autant plus de temps que le Royaume-Uni – pour des raisons budgétaires – et l'Allemagne en ont abandonné l'idée. La Cour des comptes s'apprête d'ailleurs à se pencher très attentivement sur l'évaluation des financements consacrés à ce dossier attendu. L'Assemblée nationale, quant à elle, a suggéré, non des solutions alternatives, mais des mesures complémentaires, qui me semblent autrement plus pertinentes, telles que le recours à des supports informatiques sécurisés comme les clés USB.
Enfin, vous avez eu raison d'élargir le débat en rappelant que la santé au travail participe aussi de la problématique de l'emploi. De ce point de vue, le thème de la « flexi-sécurité », tel que défini à la suite du Traité de Lisbonne, me semble crucial.
La séance est levée à treize heures.