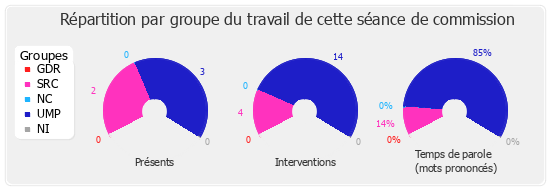Délégation aux droits des femmes et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Séance du 11 octobre 2011 à 16h00
La séance
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'audition de M. Luc Ferry, président délégué du Conseil d'analyse de la société (services du Premier ministre).
La séance est ouverte à 16 h 20.

La définition et l'enseignement du genre, sujets essentiels quand on travaille sur l'égalité entre femmes et hommes, sont actuellement en débat. Je crains que les enseignants qui les aborderont y soient mal préparés, n'ayant pas reçu de formation spécifique. Il est d'autant plus dommage qu'ils ne soient pas parfaitement à l'aise sur ces notions qu'un professeur marque généralement ses élèves pour toute la vie. C'est pourquoi nous avons souhaité vous entendre sur ce sujet en tant que philosophe et en tant qu'enseignant.
Je suis heureux de revenir dans cette maison, où j'ai d'excellents souvenirs.
Derrière la différence entre l'identité sexuelle, de caractère biologique, et l'orientation sexuelle, dont on ne sait si elle résulte d'un destin ou d'un choix, se cache la question de l'homosexualité.
Rappelons le contexte du débat. Dans les années 70, les gender studies ont été le bras armé du politiquement correct dans les universités américaines. On connaît leurs excès, parfois délirants. Quand l'université d'Ottawa m'a invité en 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je n'ai pas pu prononcer ma conférence, ayant refusé, pour des raisons de rigueur historique, d'en modifier le titre afin de parler de la « Déclaration des droits humains ». C'était également l'époque où l'on créait le terme d'« ovarium » pour faire pendant à celui de « séminaire ». Les professeurs qui enseignaient la philosophie du XVIIIesiècle devaient absolument intégrer à leur corpus des auteurs femmes ou noirs, ce qui constituait évidemment une gageure. Tel est le désastre causé par les gender studies.
Cela posé, comment aborder en cours le fait que l'identité sexuelle biologique diffère parfois, au moins en apparence, de l'orientation sexuelle ou, pour le dire plus simplement, qu'on ait le droit d'être homosexuel ? Certains députés ont signé une pétition. Elle émane d'associations catholiques qui protestent contre la dissociation entre identité et orientation sexuelles. Pour comprendre cela, il faut peut-être se référer à la doctrine de l'Eglise catholique sur l'homosexualité. J'ai ici son Catéchisme officiel : Il repose sur la pensée de saint Thomas, disciple d'Aristote, comme saint Augustin l'est de Platon.
Pour Aristote, il existe un ordre naturel – cosmos – et une loi naturelle du monde, lequel est semblable à un organisme vivant. Dans le cosmos, chaque chose est à sa place, comme le sont, dans un corps, le coeur, les poumons et la rate. Du mot cosmos dérive d'ailleurs celui de cosmétique, qui désigne l'art de mettre en valeur dans le visage ce qui est harmonieux et bien ordonné et de dissimuler ce qui l'est moins. Les Grecs pensent aussi qu'il existe une âme du monde, ce qui a fondé la tradition animiste, présente en France jusqu'à la Révolution. De même que cet univers bien ordonné peut subir des désordres, tsunamis ou tremblements de terre, de même le corps est sujet aux maladies. Mais quand il est en bonne santé, il est organisé de façon parfaite, c'est-à-dire de manière juste, harmonieuse, belle et bonne. Selon la tradition grecque reprise par saint Thomas, il revient aux humains de s'ajuster à cet ordre. Ainsi, Ulysse, déplacé par la guerre de Troie, passe-t-il vingt ans à reprendre sa place, et se trouve enfin heureux quand il revient à Ithaque. L'ordre naturel, qui repose sur la loi cosmique, est la matrice de la morale et de la politique. L'organisation politique n'est pas démocratique, puisqu'elle reflète non la volonté générale mais la hiérarchie des êtres : les bons sont en haut, les moyens au milieu et les mauvais en bas, ce qui justifie l'esclavage.
Par référence à la doctrine thomiste et aristotélicienne, l'Église définit l'homosexualité comme un désordre qui enfreint la loi du cosmos, mot qui, en grec, signifie aussi « ordre ». Dans un premier temps, l'homosexualité apparaît donc non comme une faute morale, mais comme une maladie, un handicap. De même qu'un tsunami est un désordre cosmique, l'homosexualité est un désordre individuel, une maladie, qui justifie la compassion. L'Église prescrit de faire preuve d'une sensibilité aiguë à l'égard des malheureux frappés par ce désordre naturel. Mais dès lors que ceux-ci, au lieu de rester abstinents, passent à l'acte, l'homosexualité cesse d'être un désordre pour devenir une faute grave, ce qu'on appelait jadis un péché mortel.
Le Catéchisme officiel du Vatican écrit à ce sujet : « L'homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves […], la Tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. […]. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présente des tendances homosexuelles foncières. Cette propension, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leur condition. […] Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. » En somme, l'orientation sexuelle n'étant que le reflet de l'identité sexuelle, l'homme et la femme doivent être hétérosexuels. À défaut, c'est-à-dire si l'identité naturelle a été perturbée, les seules voies qui s'offrent à eux sont l'abstinence ou le péché.
La tradition de la droite extrême, comme de l'extrême gauche écologiste, présente la nature non comme une donnée de base ou un environnement, terme que les écologistes radicaux comme Antoine Waechter jugent anthropocentrique, mais comme un modèle, comme Gaia, incarnation de l'ordre cosmique. Selon Aristote, « les fins morales sont domiciliées dans la nature », autrement dit, celle-ci est un modèle esthétique et moral, auquel il faut obéir. On condamne donc le fait de pratiquer une fécondation in vitro après la ménopause – en ignorant que toute la médecine moderne est fondée sur le combat contre la nature, car enfin rien n'est plus naturel que le virus de la grippe ou du HIV. Si la nature est notre code et notre modèle, l'orientation sexuelle ne peut se distinguer de l'identité sexuelle, et l'homosexualité doit être considérée comme une maladie.
L'extrait du Catéchisme que j'ai cité – et dont on trouverait l'équivalent dans les religions juive ou musulmane, devrait d'ailleurs tomber sous le coup de la loi Raffarin. Quoi qu'il en soit, pour les associations catholiques, héritières de la tradition aristotélicienne et thomiste, on ne doit pas apprendre aux enfants que l'orientation sexuelle peut être légitimement différente de l'identité sexuelle. Lorsque le cas se présente, c'est une catastrophe au sens grec : cela contrevient à la loi naturelle. Dans notre monde sublunaire, pour parler comme Aristote, tout n'est pas parfait, il y a des désordres, dont l'homosexualité fait partie, mais l'idéal reste l'harmonie avec la nature, et le cosmos notre norme morale. Toute la tradition d'extrême-droite, jusqu'à l'hitlérisme, mais aussi, comme le montre Élisabeth Badinter, la tradition écologiste des Fundis, ces fondamentalistes allemands qui s'opposent aux Realos, comme les deep ecologists aux shallow ecologists, considèrent que la nature est le véritable sujet de droit.
À mes yeux, la nature n'est ni un code ni un modèle. Depuis la Révolution française, ce qu'il y a de plus grandiose dans la politique et la science moderne a été au moins en partie dirigé contre elle. Outre la médecine, toute la politique démocratique et républicaine est hostile à la seule logique naturelle, qui est au fond darwinienne : si nous étions naturalistes, nous devrions éliminer les faibles. Le débat que nourrit cette nouvelle querelle des anciens et les modernes se pose de manière assez complexe. Les gender studies ont été une telle catastrophe que je me sens en sympathie avec les députés qui veulent protéger l'école française de pareilles âneries ; mais les associations catholiques extrêmes qui se sont mobilisées sur le sujet témoignent d'une volonté de rabattre l'humain sur le naturel que je récuse de toute mon âme.

Si l'on s'en tient strictement à la nature, une femme peut mettre au monde environ douze enfants, dont les deux tiers mourront de maladie. Mais le pape, qui rejette le préservatif, la pilule et l'interruption volontaire de grossesse (IVG), ne refuse pas les vaccins et les antibiotiques. S'il considère que la science doit protéger ceux qui viennent au monde, il doit aussi accepter qu'elle limite le nombre des naissances, faute de quoi l'équilibre vital ne sera plus respecté. C'est pour cette voie médiane que je plaide, en tant que députée et pédiatre.
C'est également au nom de l'équilibre que je m'oppose à Elisabeth Badinter, qui dénonce l'allaitement comme une forme d'esclavage pour les femmes. Dans nos civilisations extrêmement scientifiques, on oublie tout ce qui passe par le regard d'une mère qui allaite son bébé. Pour avoir exercé quarante-cinq ans, notamment en maternité, et avoir connu des civilisations différentes, je sais que, tout en utilisant les avancées de la science, il faut respecter ce que la nature nous rappelle des besoins de l'être humain.
C'est enfin avec équilibre qu'il faut poser la question de l'identité et de l'orientation sexuelles, qui ne se correspondent pas nécessairement. Il n'est pas mauvais d'informer les enfants, de leur envoyer un message de respect et de faire comprendre à ceux qui, à neuf ou dix ans, ne se sentent pas comme les autres, qu'ils n'ont pas à être déprimés ou à songer au suicide. C'est un vrai problème, qu'il faut aborder sans dogmatisme et sans choquer les familles. Vous le voyez : le pédiatre est toujours entre nature et culture.
Si je rejoins Mme Badinter sur la critique de l'écologisme, cela ne veut pas dire que je l'approuve en tout.
Quant à expliquer la distorsion qui peut se produire entre l'identité et l'orientation sexuelles, c'est une question scientifique et philosophique complexe. En général, on invoque un mélange de nature et de culture, ce qui est manifestement une motion de synthèse. Les travaux menés aux États-Unis par Simon LeVay sur le gène de l'homosexualité tendent à lui assigner une origine génétique et à montrer qu'elle ne résulte pas d'un choix. Ils confirment le témoignage d'homosexuels qui disent avoir découvert leur sexualité, souvent très tôt, sans l'avoir choisie. Quoi qu'il en soit, et quelque explication qu'on lui donne, la différence entre identité et orientation sexuelles existe. La question scientifique et philosophique reste ouverte. Elle engage l'idée qu'on se fait de la liberté humaine, dans laquelle Sartre distingue détermination et situation, c'est-à-dire ce qui nous détermine et ce par rapport à quoi nous nous déterminons. Il ne me paraît pas illégitime que le problème puisse être abordé par un agrégé de biologie qui expliquerait aux élèves, avec intelligence et sensibilité, que, si la nature ne fait pas tout, elle a sa part dans cette affaire.
J'ajoute un dernier point. Non seulement le pape n'est pas Jésus, mais il y a un abîme entre eux. Sans être croyant, j'ai une admiration sans limite pour l'Évangile de Jean. Or, j'ai beau le lire et le relire sans cesse, je n'y trouve pas un mot ni sur le préservatif ni sur d'autres sujets qui semblent tétaniser l'Église sans que Jésus s'y soit jamais intéressé. Un des plus beaux passages, avec la résurrection de Lazare, est l'histoire de la femme adultère. Aux Juifs qui s'apprêtent à la lapider, Jésus, qui s'est mis hors de leur cercle et trace des figures dans le sable, lance : « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». C'est l'apparition du forum intérieur, de la conscience.
Le débat entre Jésus, qui est un rabbi, un sage juif, et les orthodoxes, les traditionalistes, est plus présent encore dans l'Évangile de Mathieu. Jésus leur explique que rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut les souiller. Peu importe ce qu'ils mangent ou le fait qu'ils serrent la main à une prostituée ! Lui-même est entouré de courtisanes, d'ouvriers, de charpentiers que les rabbins distingués d'alors ne fréquentaient pas. À ses yeux, on ne peut être souillé que par ce qui vient de soi. Instaurant la conscience comme instance de décision éthique, il renvoie chacun à sa propre délibération intérieure plus qu'à la règle extérieure, qui prescrit, entre autres absurdités, de ne pas manger de poissons sans écailles. Le débat est interne au judaïsme, puisque, par définition, le christianisme n'existe pas encore. Quelle différence entre Jésus, lançant l'idée que c'est la conscience morale et spirituelle qui compte, et les âneries que l'Église inventera au fil des siècles, comme l'obligation de manger du poisson le vendredi !
Quand une petite fille de neuf ans qui attendait des jumeaux, à la suite d'un viol, s'est trouvée en danger de mort, parce qu'elle était trop petite pour accoucher, il s'est trouvé un évêque brésilien pour annoncer que, dans son cas, mieux valait mourir, l'avortement étant un péché mortel. Il a été heureusement désavoué par Benoît XVI, car face à une telle bêtise, qui faisait la une de la presse mondiale, il fallait bien revenir à la raison. Dans l'Evangile de Jean, on trouverait plus de raisons de laisser la fillette en vie.
Sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, j'ai défendu Luc Chatel, considérant que les associations catholiques s'étaient engagées sur une mauvaise voie. J'aurais signé des deux mains une pétition dénonçant les écarts de l'idéologie américaine des gender studies. Mais pourquoi soutenir que, si l'orientation sexuelle s'écarte de l'identité sexuelle, c'est un désordre et potentiellement une faute ? Arrêtons l'homophobie, qui est le fond du problème. Les écologistes durs et l'extrême droite traditionaliste se sont retrouvés sur un mauvais terrain.

Puisqu'on ne peut lui fournir aucune explication biologique, ne vaudrait-il pas mieux évoquer la différence entre identité et orientation sexuelles en cours de philosophie plutôt qu'en cours de biologie ?
Le sujet est abondamment traité dans Biologie des passions de Jean-Didier Vincent, Fondements naturels de l'éthique de Jean-Pierre Changeux, ou les écrits des grands théoriciens américains de l'éthique évolutionniste. Mais, si les biologistes sont honnêtes, ils doivent dire jusqu'où va leur science et où elle s'arrête. Quant aux philosophes, la plupart d'entre eux ignorent le débat biologique et n'ont pas accès aux travaux de Simon LeVay. Il faut avoir étudié la biologie pendant trois ans à un haut niveau, comme je l'ai fait moi-même, pour savoir ce que sont les allèles, les gènes, les codons-stop et la transcriptase inverse. Ne faites pas de la philosophie une voiture-balai, qui ramasserait tous les sujets que les autres renoncent à traiter ! Il faut laisser celui-ci à des biologistes experts en évolution-développement ou en génétique, qui diront eux-mêmes à leurs classes qu'ils ne savent pas tout.

Vous proposez donc de laisser ce chapitre dans le programme de biologie mais de le traiter autrement ?
Un biologiste expliquera qu'il y a peut-être une base génétique à l'homosexualité, comme à la schizophrénie, ce que pensent 95 % des biologistes, de gauche comme de droite. On ne tient plus pour une thèse néofasciste, comme dans les années 70, d'affirmer que l'autisme a une base génétique. La Forteresse vide de Bruno Bettelheim, dont j'aime beaucoup par ailleurs Psychanalyse des contes de fées, a culpabilisé en vain des centaines de milliers des mères.
Plutôt que d'un gène de l'homosexualité, un savant comme Axel Kahn parlerait plutôt d'une logique polyfactorielle, avec interaction entre la nature et la culture, la donnée de base génétique et le milieu. S'il ne s'agit pas d'une véritable explication, le professeur de biologie est du moins mieux placé que le professeur de philosophie pour éclairer l'aspect scientifique du problème. Les documents d'application lui recommanderont de ne pas choquer les consciences et de ne pas adopter de partis pris excessifs.
La question, qui doit rester ouverte, n'est qu'un cas particulier de la biologie des passions, qui traite aussi de l'addiction, de la schizophrénie, ou même de l'état amoureux. En tant que médecin, vous savez ce que les biologistes disent aujourd'hui de l'ocytocine : il suffit qu'on en injecte à un rat pour qu'il tombe amoureux fou de sa voisine. Si la distinction sartrienne entre détermination et situation est cruciale, on ne peut ignorer que l'infrastructure neurale et génétique est déterminante. Des anomalies génétiques peuvent entraîner des déficiences ou des problèmes psychiques très graves. Il n'est pas mauvais que ces questions soient enseignées, avec prudence, par des professeurs de biologie.

Je fais partie des quatre-vingts pétitionnaires, qui ont peut-être tous obéi à des motivations différentes. Certains ont signé par homophobie, d'autres s'appuyaient sur la doctrine de l'Église que vous avez rappelée. Si je l'ai ratifiée, après l'avoir lue attentivement, c'est que certains passages des manuels incriminés comportent à mes yeux un déni de réalité. En philosophie, on présentait il y a vingt ou trente ans l'athéisme comme une absurdité, au sens où il n'y a pas lieu de nier l'existence d'un être dont on considère qu'il n'existe pas : mieux vaudrait, disait-on, parler d'antithéisme. C'est parce qu'il me semble tout aussi absurde de nier a priori l'identité sexuelle, c'est-à-dire la réalité biologique, que j'ai signé la pétition, tout en refusant de cautionner le second texte, dont un de nos collègues était l'inspirateur, et qui dérapait complètement sur la question de l'homosexualité.
Enfin, l'analyse de l'ordre naturel, fondé sur le cosmos, ne rejoint-elle pas l'opposition philosophique classique entre nature et culture, et celle qu'on établit dans la philosophie politique entre le droit naturel et le droit positif ?
Pas exactement. Certaines doctrines politiques considèrent que la cité est juste quand elle imite l'ordre cosmique. Dans La République de Platon, l'ordre qui place les philosophes en haut, les guerriers au milieu et les esclaves en bas reproduit celui du corps. En haut se trouve la tête, le nous - les aristocrates, qui doivent gouverner la cité –, au milieu le diaphragme – le thymos, c'est-à-dire le coeur et le courage –, et en bas, l'epithymia – le bas-ventre, le désir.
L'opposition entre droit naturel et droit positif peut exister tant dans une vision aristocratique ancienne, fondée sur la cosmologie, que dans une vision moderne. Le droit positif est le droit en vigueur, « positif » signifiant simplement « réel » au XIXe siècle. On parlait d'ailleurs de « positivité de la religion » pour parler du clergé, de l'Église telle qu'elle est. Le doit naturel, en revanche, est le droit idéal, celui qui devrait être. Un député peut fort bien s'opposer à une loi positive au nom du droit naturel, c'est-à-dire rationnel ou idéal.
À l'égard des biologistes, j'éprouve une crainte inverse à la vôtre. Si on leur confie le sujet, ils risquent non de nier la réalité, mais de pousser très loin l'explication biologisante. Des savants comme Lucie ou Jean-Didier Vincent ne cessent d'expliquer que les femmes et les hommes sont très différents, qu'il y a un cerveau féminin et un cerveau masculin, et que les hormones ont une influence considérable sur le caractère et la vie psychique. Dans ses travaux sur l'état amoureux, Lucie Vincent distingue, en matière de coup de foudre, les biologies de la femme et de l'homme. On rencontre le même naturalisme chez Jean-Pierre Changeux. La tendance des biologistes est plutôt d'aller vers la nature, qui est le fond de leur pensée. Quantité d'articles opposent par exemple le cerveau féminin et masculin, en expliquant pourquoi, quand l'homme est au volant, sa femme assise à côté de lui n'arrive pas à lire la carte Michelin. Plus sérieusement, d'autres étudient la génétique de la schizophrénie, de l'autisme ou de l'homosexualité. La tendance actuelle est de biologiser les comportements plutôt que de faire l'éloge de la liberté.
Il est logique que ces questions entrent dans les programmes à l'heure où la science s'intéresse à la biologie des passions, et réfléchit à nouveaux frais à la problématique entre nature et culture. Quelle part de fondement naturel entre dans nos comportements éthiques ou esthétiques ? Pourquoi préfère-t-on la musique classique aux concerts de Boulez ? Y a-t-il une cause biologique à notre goût pour l'harmonie plutôt que pour la discordance ? Ces questions posées par les biologistes rejoignent celle de la différence entre identité et orientation sexuelles. Certains d'entre eux se demandent aussi quelle part de nature et de culture, de destin et de liberté entre dans nos comportements politiques, et pourquoi les hommes font plus la guerre que les femmes. Un biologiste peut expliquer, notamment par le rôle de la testostérone, pourquoi, en tant que ministre de l'éducation nationale, je n'ai jamais été confronté à un cas de pédophilie féminin. C'est sans doute une question d'hormone si aucune femme ne viole un garçon de trois ans, même si des épouses, comme celle de Marc Dutroux, peuvent être complices de leur mari. Bref, la tendance actuelle n'est pas à la négation de la différence biologique entre femme et homme.
Sur une question aussi complexe, je ne jette pas la pierre aux pétitionnaires, même si l'homophobie de certains était si évidente qu'on avait envie de crier « Au secours ! », mais la droite n'a pas à entrer dans ce combat d'arrière-garde.

Ne peut-on craindre que les théories biologiques appliquées aux passions ou aux goûts esthétiques ne portent en germe le retour du scientisme ?
Bien sûr, le danger serait de présenter la nature comme une sorte de code, de programme informatique. Il ne faudrait pas qu'un livre comme Fondements naturels de l'éthique serve à instaurer un déterminisme biologique, qui serait terrifiant.
Oui, alors même que toute la politique moderne est fondée sur le fait qu'en l'homme, comme le dit Rousseau dans le Discours sur l'origine de l'inégalité, « la volonté parle encore quand la nature se tait. » La volonté est capable de construire ce monde antinaturel qu'est le monde démocratique. Tout père de famille, tout professeur sait que la civilité n'est en rien naturelle. Freud définit l'enfant comme un pervers polymorphe, j'ajouterai qu'il est naturellement fasciste et raciste. À la petite école, il attaque bille en tête ceux qui ont un bec-de-lièvre, ou qui sont un tant soit peu en retard, gros ou empotés. C'est au prix d'un combat permanent qui dure des années qu'on lui apprend à dire bonjour ou merci. Ni la démocratie ni la civilité ne sont des données naturelles de l'être humain. D'ailleurs, l'histoire de la démocratie ne recouvre qu'un siècle, alors que celle de régimes politiques abominables s'étend sur des milliers d'années.
Cela dit, un manuel scolaire est au programme ce qu'une interprétation est à une partition : on peut en jouer de différentes manières. Si l'édition scolaire est parfaitement libre, le ministère peut faire rédiger des documents d'application. Sur cette question, Luc Chatel pourrait charger trois ou quatre biologistes intelligents, compétents et modérés de fixer les bornes du cours, en recommandant aux enseignants de ne pas s'écarter de certaines hypothèses de travail. Bien entendu, il ne s'agirait que de conseils, les professeurs faisant ce qu'ils veulent dans leur classe.
Les professeurs du secondaire, qui détestent a priori le ministère, dans lequel ils voient un ennemi, liraient avec intérêt des documents rédigés par des professeurs du Collège de France, de grands universitaires ou des membres de l'Académie des sciences. Si l'on tient absolument à pétitionner, ce pourrait être pour demander un document d'application intelligent.

Je m'inquiète de ce que les enseignants n'aient aucune formation relative à la question de l'identité ou de l'orientation sexuelles. Faut-il introduire ce sujet dans leur cursus ?
On peut d'abord supposer qu'un agrégé ou un certifié de biologie n'est pas un fou furieux. Ensuite, pourvu qu'on ne rogne pas dans les budgets, l'Éducation nationale organise quantité de stages de formation dans les académies. Enfin, le ministère peut fait rédiger de bons documents d'application.
Sans vouloir polémiquer, je regrette que Xavier Darcos ait taillé dans les programmes que j'avais rédigés pour l'école. Il est parti du principe que plus les programmes sont courts sur le papier, moins ils sont pléthoriques. C'est évidemment l'inverse. Si le programme mentionne seulement « La Révolution française », on peut y passer beaucoup de temps. François Furet a passé sa vie sur le sujet. Mais si l'on précise « Dans la Révolution française, on traitera seulement la nuit du 4 août et deux personnages principaux », le programme, dont la rédaction est plus longue, exige moins d'heures de cours. Les consignes actuelles, réduites à douze items, n'opèrent pas le recentrage annoncé sur les fondamentaux, qui exigerait au contraire un programme détaillé, explicite, argumenté et justifié. Les professeurs ont aimé celui que j'avais rédigé pour le primaire, parce qu'il expliquait comment aborder les thèmes.
La suppression du Conseil national des programmes (CNP), en 2005, était également absurde. Les groupes techniques disciplinaires regroupaient une vingtaine de spécialistes, biologistes ou historiens, qui pouvaient rédiger des documents d'application expliquant pourquoi ils choisissaient d'insister sur tel aspect. Quant à la suppression de la formation des maîtres, elle est d'une absurdité sans nom.
Le malheureux Luc Chatel n'y est pour rien, car on la lui a imposée. Mais, si un agrégé de lettres classiques peut s'en tirer, sans formation, devant une classe du second cycle, pour peu qu'il ait préparé son cours, on ne peut pas lâcher devant des élèves de cours préparatoire (CP) un instituteur de vingt-deux ans qui ne sait rien de l'apprentissage de la lecture ou de l'utilisation des réglettes en mathématique. Pourquoi avoir supprimé les écoles normales et rattaché les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) aux universités ? Alors que les institutrices d'application faisaient un excellent travail, un professeur d'Université est incapable d'enseigner l'apprentissage de la langue au CP, sujet particulièrement complexe, puisqu'il existe 150 méthodes de lecture.
La suppression du CNP, celle de la formation des maîtres et celle des programmes explicites et argumentés sont autant de bêtises énormes. Les programmes que j'avais rédigés offraient l'avantage d'être précis, ce qui laissait la possibilité d'en discuter. Dans la Révolution française, on peut préférer traiter Sieyès plutôt que Louis XVI ou Robespierre, mais j'expliquais du moins mon choix : j'entends qu'on insiste sur la nuit du 4 août parce que l'abolition des privilèges me semble fondamentale. Si les lecteurs d'Albert Soboul préféraient qu'on traite des sans-culottes, ils pouvaient du moins argumenter. Dans les groupes techniques, qui regroupaient des professeurs d'université et de lycée, le pluralisme était la règle, et l'on finissait toujours par trouver un accord. Par quoi tout cela a-t-il été remplacé ? Qui fait aujourd'hui les programmes de l'école ?
Les inspecteurs généraux, autant dire quatre personnes sur un coin de table. Leur nom n'est même pas connu. De mon temps, comme disent les vieux mammifères, on savait qui présidait le CNP – c'était moi, en l'occurrence – et quels professeurs siégeaient dans les groupes d'économie, d'histoire ou de français. On pouvait leur demander des comptes et, pourquoi pas, organiser à l'Assemblée nationale un débat sur les programmes, car, si ce n'est pas aux députés d'en décider, le sujet peut du moins les intéresser.
Quand j'ai demandé à Xavier Darcos quels étaient les rédacteurs de ses fichus programmes – qu'il n'avait d'ailleurs pas lus ! –, il n'en savait rien. Il ignorait qu'ils rétablissaient l'étude du passé antérieur, que nul ne connaît, et qu'ils intégraient la connaissance des institutions européennes. Pour rien au monde je n'expliquerai à ma fille de dix ans la différence entre la Commission européenne et le Conseil de l'Europe. Les élèves auront le temps d'y venir, puisque la scolarité est obligatoire jusqu'à seize ans. Le fait que nul ne sache le nom de l'auteur des programmes, qui engagent la vie de 10 millions d'élèves, est un scandale qui me choque en tant que parent, qu'ancien ministre et que démocrate, et dont les députés devraient saisir le ministre.
Si l'on a supprimé le CNP, au bénéfice de l'inspection générale, ne serait-ce pas pour faire vivre les éditeurs scolaires, auxquels le ministère alloue 60 millions par ans, et qui seraient en déficit si l'on ne changeait pas les programmes tous les quatre ans. Or j'avais institué que ceux-ci ne soient modifiés que de manière infime, car enfin l'histoire de la Révolution française ou de la guerre de 1914 n'a pas changé au cours des quatre dernières années.
Le CNP auquel l'inspection générale était hostile, parce qu'il lui avait retiré le privilège historique de décider des programmes, comptait en tout 120 personnes, les groupes techniques disciplinaires ne dépassant jamais vingt participants. Il coûtait 300 000 euros par an, ce qui est dérisoire au regard du budget de l'État. S'il avait des défauts, dont celui d'être présidé par moi, la fabrication des programmes était transparente. À présent, le ministre en découvre le contenu quand il y a une polémique.
Enfin, pour laisser place au débat public, j'avais tenu à ce que les groupes techniques disciplinaires rassemblent des professeurs de tous horizons : de grands universitaires, mais aussi des instituteurs de base, des professeurs de collège et des experts extérieurs au système éducatif. Désormais, ils n'ont plus voix au chapitre, alors que leur point de vue apportait beaucoup.
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'audition de Mme Françoise Héritier, anthropologue, professeure honoraire au Collège de France.

Madame, c'est un honneur pour la Délégation aux droits des femmes que vous ayez répondu à son invitation ; je vous en remercie. Après qu'une polémique a éclaté sur l'enseignement de la théorie du genre, nous avons souhaité entendre votre opinion à ce sujet.
Je suis moi-même très honorée d'avoir l'occasion d'exprimer quelques idées devant vous et de répondre à vos questions.
On ne peut être que saisi d'étonnement devant la levée de boucliers que suscite l'introduction de l'enseignement du genre dans les programmes scolaires, notamment auprès de groupes de députés et de sénateurs, et cela pour trois raisons. La première est la confusion volontairement entretenue entre construction du genre et construction de l'orientation sexuelle. La deuxième est l'idée revendiquée qu'il existerait une « nature » humaine dictant à chaque sexe son comportement et induisant ses capacités – quand il ne s'agit pas, pour certains, d'une volonté dictée par une divinité. La troisième est le rejet de l'idée que puisse exister une connaissance scientifique de l'homme et de la société du même type que celle dont on reconnaît l'existence pour les sciences de l'univers, de la terre et de la vie.
Sur le premier point, il y a peu à dire sinon ceci. La « théorie du genre » pour reprendre cette expression, n'a pas été construite au fil des observations et expériences pour imaginer agir sur des orientations sexuelles. La présenter de la sorte, à l'abri de phobies encore présentes, vise à la discréditer. En réalité, le travail qui a été conduit clairement depuis quelques décennies et qui continue de l'être, porte non sur la sexualité mais sur la constitution d'identités dites de « genre » : ces identités correspondent aux normes voulues par toute société, toute culture et sont reprises à leur compte par les individus. Ces normes ne sont pas exprimées nécessairement de manière consciente – c'est d'ailleurs un des objectifs de la recherche de les désigner – mais elles le sont dans les mots, les regards, les gestes, les contacts, les comportements, les attitudes, qui sont différenciés. Dès la naissance, les adultes, et les parents au premier chef, se comportent différemment avec le nourrisson selon qu'ils savent que c'est une fille ou un garçon. Ainsi, récemment, un couple canadien a-t-il eu les honneurs de la presse. Ce couple s'est refusé à faire connaître à son entourage le sexe de leur bébé en espérant, ingénument sans nul doute, mener une expérience du type de celle des enfants-loups. Comment se construirait un enfant qui ne saurait pas qu'il est sexué ? Mais se sentent-ils capables ces parents qui savent, de ne jamais tenir compte de ce savoir dans leurs actes quotidiens ? Espèrent-ils couper leur enfant de toutes les interactions publiques susceptibles de faire naître en lui des interrogations ? Il reste que, dans l'accomplissement au jour le jour de cette expérience hors normes, qui pose tant de questions, l'entourage est considérablement perturbé car il ne sait pas comment se comporter à l'égard de ce bébé. La gêne profonde ressentie par chacun nous amène à comprendre à quel point nous sommes intimement conduits à nous comporter à l'égard des autres, et en premier lieu des enfants que l'éducation doit modeler pour leur permettre de vivre en société, en fonction du sexe morphologiquement apparent.
Pour donner plus de poids à l'aversion que suscite chez certains l'idée même de la construction du genre et donc celle de sa possible subversion, prétendre que le « genre » vise à rendre l'homosexualité tout aussi acceptable que l'hétérosexualité est une réduction qui frise la malhonnêteté. Il s'agit, on le conçoit, de bien davantage : de cette place normée qui est faite à chacun en fonction de son sexe et l'oblige à se conformer au « genre » qui lui est rattaché ; de cette place construite universellement de façon hiérarchique selon ce que j'ai appelé dans mes propres travaux « la valence différentielle des sexes », laquelle établit une équivalence entre le statut de femme et celui d'enfant ou de cadet, c'est-à-dire de mineur. Cette obligation de conformité est intériorisée par les individus, femmes et hommes, car la pression est constante. J'en donnerai un exemple anodin, tiré de la lecture de la presse récente, où l'on voit le rôle de l'école qui est un excellent lieu de reproduction des schémas usuels de pensée. L'enseignement scolaire fait comprendre systématiquement aux filles qu'elles ne sont pas douées pour la représentation dans l'espace, la géométrie, les objets industriels, l'ingénierie, mais qu'en revanche les lieux où s'exprime la sensibilité, comme la littérature ou l'esthétique, sont pour elles. Si l'on demande à des filles de reproduire le schéma d'un objet industriel compliqué, elles n'y parviennent pas ou avec un très faible taux de réussite. Si, en revanche, l'objet leur est présenté comme un dessin qu'il faut reproduire, elles réussissent parfaitement l'exercice. Or elles ne sont pas nées en ayant en tête l'idée d'une ligne de démarcation entre l'objet et le dessin qui le représente, l'un leur étant accessible, l'autre non. Il a bien fallu que cette limitation leur soit fournie. Et ce n'est pas leur nature qui les empêche de réussir la copie du schéma de l'objet puisqu'elles réussissent fort bien la tâche esthétique d'en dessiner la forme.
Il n'y a pas de « nature » humaine ni d'essence féminine ou masculine qui nous obligeraient. Ce qui compte est la variabilité individuelle. Prenons cent individus au hasard, la seule obligation étant que ce groupe soit composé à moitié de femmes et à moitié d'hommes. Les cinquante plus grands ou les cinquante plus lourds ne seront pas tous des hommes, loin de là. Les classements que l'on pourrait faire selon toutes les capacités imaginables, physiques, intellectuelles, émotionnelles, sensibles, créatrices, etc… seraient également marquées par une grande diversité et jamais par l'apanage d'un seul sexe. La théorie du genre ne nie pas l'existence du sexe morphologique, anatomique et physiologique. Elle montre simplement cette diversité individuelle et comment se construisent et se surimposent des images mentales de ce qui serait le propre de la féminité et le propre de la masculinité. Elle montre aussi quels sont les moyens utilisés pour obtenir un formatage au plus près de ces préconceptions. Nous y obéissons tous peu ou prou : dans la façon de se camper ou de se tenir – contrairement à un homme, une femme ne se tiendra jamais les jambes écartées –, dans la façon de se saluer, de rire, de boire... pour ne parler que de ces comportements corporels ostensibles.
Je donnerai quelques exemples en commençant par deux expériences de neurologie et de psychologie cognitive menées aux États-Unis et reproduites plusieurs fois. Des mères accompagnent leur bébé de neuf mois à un test de motricité, hors de leur présence puis en leur présence. Il s'agit de faire ramper le bébé sur une planche dont on varie l'inclinaison selon une pente de 10° à 30°. On fait le test sans les mères : tous les bébés rampent, et il apparaît d'ailleurs que les filles sont légèrement plus hardies et aventureuses que les garçons et acceptent des pentes plus roides. Quand les mères font leur entrée, on leur demande de régler elles-mêmes l'inclinaison de la planche en fonction de ce qu'elles pensent que leur enfant est capable de faire. Toutes surestiment de 20° à peu près les capacités de leur fils et sous-estiment de 20° environ celles de leur fille, ce qui établit un écart de 40° entre les sexes dans l'accomplissement de la même tâche. En clair, les attentes des mères en termes de hardiesse, esprit d'aventure et esprit de compétition sont infiniment plus grandes pour leurs enfants mâles, qui y seront poussés, que pour les filles, qui seront réfrénées.
Dans une autre expérience, on présente à deux groupes d'étudiants constitués d'autant de filles que de garçons la photo d'un nourrisson hurlant, âgé de quelques jours. Au premier groupe on demande : pourquoi ce petit garçon pleure-t-il ? Au deuxième : pourquoi cette petite fille pleure-t-elle ? Les réponses obtenues des deux groupes sont à plus de 85 % les suivantes : il est en colère, il est furieux, quelque chose lui a déplu et il le fait savoir ; elle a eu peur, quelque chose l'inquiète, elle a besoin d'être dorlotée et rassurée. C'est pourtant le même bébé. La caractérisation de genre est dans la tête des adultes et non dans l'essence sexuée du bébé : colèrepeur, assertivitéémotivité, satisfactiontendresse, tout est là, en germe, de ce qu'on attend de l'adulte à venir.
Vous me permettrez d'ajouter à cela le récit d'une expérience que j'ai vécue en Afrique et qui m'a laissé un sentiment de tristesse. Les femmes y procèdent à leurs activités quotidiennes en portant leur bébé dans le dos. J'avais remarqué un comportement aléatoire pour donner le sein quand le bébé le réclamait : elles le faisaient tantôt toutes affaires cessantes, tantôt de façon différée. Je mettais cette différence sur le compte de la plus ou moins grande urgence de la tâche qu'elles étaient en train d'accomplir, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les mères nourrissaient leurs fils au premier cri et faisaient attendre les petites filles, et cela sans exceptions. La réponse à mes questions a toujours été peu ou prou la même : les garçons ont le coeur rouge, violent et impatient et la colère de l'attente pourrait les tuer, alors que les filles doivent s'attendre à ne jamais voir leurs désirs satisfaits de toute leur vie et qu'il faut donc le leur apprendre au plus vite. C'est une réponse intéressante car elle se fonde sur deux registres d'explication : l'un, biologique, sur une « nature » violente et dangereuse supposée des hommes, l'autre, sociologique, sur une « culture » qu'il faut inculquer aux femmes. Le résultat est la création de deux attitudes radicalement différentes devant la vie : l'une faite de la tranquille assurance de son droit et de la certitude d'avoir ses désirs immédiatement et légitimement satisfaits, l'autre nourrie de méfiance en soi-même et en la légitimité de ses désirs et même de la certitude de ne pas compter. Cela aboutit à la même dichotomie entre assertivité et satisfaction d'une part, soumission et frustration d'autre part, que l'on observe dans les expériences scientifiques américaines.
Serions-nous donc si sûrs que rien dans nos modes éducatifs, familiaux, scolaires, en images, en mots et dans l'expérience de la rue, n'agit dans le même sens et avec les mêmes résultats dans nos propres sociétés ? N'y aurait-il donc pas de « nature » à laquelle nous serions soumis ? Il n'y en a pas d'autre que celle qui nous fait différents, morphologiquement et physiologiquement. Cette différence est importante et ne peut être occultée, mais elle ne devrait pas être utilisée, comme elle l'a été depuis l'origine de l'humanité pensante, comme source de hiérarchie, inégalité et domination d'un sexe sur l'autre. C'est le saut de la différence à l'inégalité qui n'est pas « naturel » mais qui est, au contraire, le produit d'une réflexion et donc d'une « culture » – ce qui d'ailleurs fait que la situation peut être transformée. La théorie du genre montre comment se construit et s'exprime cette hiérarchie mentalement, pratiquement, socialement.
La réflexion anthropologique m'a permis d'esquisser le schéma des images mentales et des représentations qui ont abouti au Paléolithique à la création du modèle du genre et à sa reproduction aisée au fil des générations par l'éducation et l'habituation. L'anthropologie nous permet également de montrer en quoi la référence à une « nature » de l'homme – c'est-à-dire à un substrat que nous partagerions avec le règne du vivant animal – pour expliquer la hiérarchie, est une idée fausse. J'en prendrai pour élément principal de preuve le fait que, de toutes les espèces animales et notamment les plus proches de nous, les mammifères, l'être humain est le seul où les mâles frappent et tuent leurs femelles. Un tel gaspillage n'existe pas dans la « nature » animale. Conflits et hiérarchies s'expriment au sein du même sexe dans l'espèce. Paradoxalement peut-être, on peut affirmer que ce comportement aberrant est le propre de la réflexion humaine et des constructions mentales et sociales auxquelles cette réflexion a abouti. La violence meurtrière à l'égard des femelles au sein de sa propre espèce est un produit de la culture humaine et non de sa nature animale. Et si, dans le renvoi explicatif par la « nature », nous devons entendre l'obéissance à nos hormones, il apparaît là aussi qu'il y a erreur. Premièrement, ocytocine et testostérone ne sont pas l'apanage d'un sexe donné. Deuxièmement, nous considérons qu'une des propriétés de l'homme en société est la capacité de dominer et maîtriser ses pulsions. Enfin, le jeu hormonal ne dit rien, pas plus que la conformation physique sexuée, de l'intelligence, de l'imagination, de la remémoration des expériences, de la capacité de prévoir, de l'adaptation aux situations nouvelles, de l'inventivité créatrice, de l'empathie, de l'esprit de solidarité, des besoins de justice et de protection, etc…, toutes propriétés que partagent les individus à des degrés divers.
Il apparaît en fait que s'en tenir à l'idée d'une « nature » biologique et génétique de l'être humain pour expliquer les situations existantes d'inégalité entre les sexes, « nature » qui serait relayée par une « volonté » divine présente dans les religions révélées, est en soi la preuve de l'efficacité du modèle archaïque dominant de représentations qu'est la valence différentielle des sexes, et de la difficulté qu'ont des individus à s'en sortir. Alors que ce modèle a été construit par l'esprit, continue d'être reproduit et pourrait être déconstruit, il est plus confortable de se le représenter comme dicté de l'extérieur par un destin immuable. Le simple rejet, sans bénéfice du doute et sans examen, de la théorie dite du genre est une preuve du bien-fondé de la mise en examen que cette théorie a fait porter sur nos comportements d'êtres pensants et sociaux.
J'en viens brièvement à mon troisième point. Ce rejet, fondé sur des vérités révélées, se présente pour ce qu'il est : un refus que l'on peut qualifier d'obscurantiste d'admettre que la science peut s'exercer sur autre chose que sur des objets extérieurs à l'esprit qui les observe et, dans la foulée, qu'elle puisse s'exercer sur les mondes que l'esprit humain a créés et forgés pour déployer ses talents : la société. Les sciences humaines et sociales ne seraient pas des sciences. Or, comment pourrions-nous nous targuer de la capacité d'étudier toutes les facettes de ce qui nous est donné à voir et dont les limites s'élargissent de plus en plus si nous en excluons cette capacité même d'étude detoutes les parties où nous sommes en personne investis et investisseurs ? Comment pouvons-nous traiter de l'atome, de l'espace, du temps, des neutrinos et des neurones si nous sommes impuissants à comprendre les mécanismes du pouvoir, de la circulation des biens, des idées et des personnes, les mobiles de nos actes, la nature de nos organisations sociales, le fonctionnement de l'intuition, du rêve, des désirs, le surgissement de la pensée, la nature des sentiments ?
Non seulement tout ce qui relève de l'humain peut et doit être un objet de connaissance mais la scientificité des démarches est la même que dans les autres disciplines : observation, description, comparaison, expérimentation si possible, soumission à la critique et à la statistique, recherche de lois et d'invariants... Il n'est pas question ici de vouloir apporter la preuve de la scientificité des sciences de l'homme et de la société mais simplement de s'inscrire en faux contre un point de vue qui traite le travail dans ces sciences de pure idéologie en se fondant non sur la critique mais sur le poids des traditions de pensée. Un point de vue qui proteste du caractère soi-disant « idéologique » d'ensembles conceptuels réfléchis et argumentés au nom de vérités révélées dont la nature proprement idéologique, quant à elle, saute aux yeux.

Je fais partie des pétitionnaires protestataires, qui n'avaient pas tous les mêmes motivations ; or vous semblez les mesurer à la même toise. Certains sont influencés par l'idéologie chrétienne, d'autres par l'homophobie, mais il en est aussi qui, par leur signature, voulaient contester un déni de réalité ; je suis de ceux-là. Je fais miennes certaines de vos analyses, je ne suis ni homophobe ni opposé à la théorie du genre – sinon je n'appartiendrais pas à la Délégation aux droits des femmes – mais je tiens que l'on ne peut nier les différences morphologiques. Or, certains passages des manuels en question les nient. Me donnerez-vous acte que l'on peut s'opposer à ce que l'on estime être un déni de réalité sans méconnaître les situations que vous avez décrites ? Je n'exclus pas qu'il y ait des idées préconçues sur les prédispositions des femmes et des hommes, mais aucune thèse ne peut se fonder sur un déni de réalité. Vous n'êtes nullement en cause : votre exposé était aussi brillant que nuancé. J'ai signé cette pétition et je ne me renie pas car on ne peut envisager les choses en tout noir et tout blanc ; le sujet est très complexe et l'on ne peut soutenir que les uns auraient complètement raison, les autres complètement tort. Il faut, certes, lutter pour améliorer la situation des femmes et contre le déterminisme, mais cela ne peut se faire au mépris de la réalité biologique. Voilà ce qui a motivé un grand nombre, sinon la majorité, des signataires de la pétition.
Vous avez défini trois types de motivation des signataires, vous rattachant à la troisième ; je souscris à cette différenciation. S'agissant de la théorie du genre, il se peut qu'il y ait des excès dans les théories dites queer, mais ces excès ne sont pas représentatifs de cette théorie. La théorie du genre, c'est la lutte contre les déterminismes sociaux et culturels – et non pas naturels. Le genre est un déterminisme social imposé aux femmes.

Nous sommes d'accord – je parlais de déterminisme social. Mais l'on peut juger la théorie du genre utile et considérer qu'il faut établir l'équité entre les femmes et les hommes sans pour cela nier la réalité biologique.
Connaissez-vous des adeptes de la théorie du genre qui font cet amalgame ?

Par ma signature, je me suis élevé contre certaines formulations. J'ai commis l'erreur de ne pas apporter les manuels litigieux et je ne voudrais pas déformer les propos que j'ai lus, mais il était explicitement écrit qu'en aucune manière on ne peut fonder la différence entre femmes et hommes sur des critères biologiques. Pour moi, c'est faux.
Je suis un peu mal à l'aise d'être venue vous parler sans avoir lu ces fameux manuels. La rédaction de certains passages est peut-être malheureuse, des modifications sont peut-être nécessaires, mais ce n'est pas une raison pour jeter le bébé – la théorie du genre – avec l'eau du bain.

Et, en contrepartie, il faut accepter l'idée que tous les pétitionnaires ne rejettent pas cette théorie. Les phénomènes compliqués s'expliquent par une pluralité de causes. Il serait ridicule de dire que la biologie et la morphologie expliquent seules les différences entre femmes et hommes, mais je n'irai pas jusqu'à dire que tout s'expliquerait par le déterminisme social imposé aux femmes…
Aux deux, en effet.
Il faut expliquer, et expliquer encore ; l'explication est démocratique. Mais derrière cette pétition, une forme d'obscurantisme me gêne, qui consiste à nier qu'il puisse y avoir une connaissance scientifique de ce qui relève de l'humain. Les sciences humaines et sociales sont encore jeunes mais elles progressent, et les expériences conduites en ces domaines sont menées scientifiquement.
Certains les contestent, qui qualifient la théorie du genre de pure idéologie.
Pour ma part, je regrette qu'après que la République, en fonction de l'état des connaissances dans les diverses disciplines, a décidé des programmes scolaires et de ce qui doit être enseigné, l'on veuille revenir sur des décisions républicaines pour des raisons telles que les vôtres, ou d'autres. Au nom de la religion, on voudrait que telle chose ou telle autre ne soit pas enseignée à l'Université, comme la théorie de l'évolution aux États-Unis ? C'est regrettable.

D'un autre côté, M. Luc Ferry nous a dit qu'ayant été invité à l'université d'Ottawa à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on lui a demandé de changer le titre de son intervention pour parler de la « Déclaration des droits humains ». Il s'y est refusé par rigueur historique et il est reparti sans avoir prononcé l'exposé pour lequel il était venu. Les manifestations d'idéologie excessives sont également partagées.

Pour ce qui concerne les pétitionnaires, la polémique est née, me semble-t-il, de la différence faite entre sexe biologique et orientation sexuelle. Vous avez fort bien démontré, madame, que ce sont la culture et l'éducation qui font la différence entre la femme et l'homme. Tous les signataires de la pétition ne sont pas dans les mêmes dispositions d'esprit que M. Guénhaël Huet. La démarche de certains est tout autre, et nous devons être très vigilants face à des pétitions qui concernent directement le fonctionnement de notre République et qui peuvent nous entraîner très loin. On sait ce qu'il en est aux États-Unis, où certains enseignements sont désormais interdits. C'est un chemin que nous ne devons pas prendre.

La théorie queer n'est-elle pas dangereuse en ce qu'elle risque de faire considérer l'analyse scientifique comme idéologique ?
Selon moi, ce n'est pas un risque. À chaque fois que des démarches remettent en cause des idées acquises, des fers de lance vont plus loin que le but premier et des points de vue s'expriment sur lesquels on s'enflamme. Mais ces phénomènes sont de courte durée. Dans le cas qui nous occupe, la thèse de l'indifférenciation absolue des sexes n'est pas tenable, ce pourquoi l'on n'en tient pas compte. La théorie queer fera long feu : que peut-être un individu sans sexe revendiqué ? On ne sait pas. La sexuation est une condition du vivant à l'heure actuelle. Il y a 900 millions d'années, la reproduction – celle des amibes – avait lieu par scissiparité. J'ai essayé un temps d'imaginer ce que serait la société sans l'apparition du vivant sexué, avec des amibes devenues intelligentes, et c'est impossible : on ne peut imaginer le social sans la division sexuée. En revanche, on peut concevoir une organisation du social autre que celle bâtie sur les bases que l'on sait, et faire avec la diversité biologique de la manière la plus égalitaire possible, pour qu'il n'y ait pas un sexe dominant et un sexe dominé.
Ce n'est pas un obstacle : c'est, paradoxalement, la réflexion des humains sur eux-mêmes qui en a fait un obstacle. Quand, au Paléolithique moyen, l'humanité devient pensante, elle appréhende le réel en observant le monde, où elle constate des choses incompréhensibles, dont la plus étonnante de toutes : pourquoi y a-t-il deux sexes, dont un seul est capable de se reproduire lui-même et de reproduire l'autre, l'homme ne pouvant se reproduire directement dans son propre corps ? À quoi servent les hommes, s'interrogent les Néandertaliens ? On notera que les généticiens se posent à nouveau la question… La production de spermatozoïdes est superfétatoire – d'où la gabegie que représente le meurtre des femmes. Les hommes de Néandertal observent également qu'il faut une copulation pour que les femmes soient enceintes, et trouvent là la réponse à leur interrogation : les hommes sont les pourvoyeurs de vie puisqu'ils mettent les enfants dans les femmes. C'est faux, nous le savons : il y faut et un homme et une femme. Les prémisses sont fausses car elles reposent sur des observations erronées, mais c'est d'elles que découle la domination masculine : les femmes sont perçues comme une ressource rare qui permet aux hommes d'avoir les fils qu'ils ne peuvent avoir seuls. Ni les femmes ni les hommes ne sont contraints par la biologie : il s'agit de se répartir les femmes comme on se répartit les autres ressources rares. Puis-je faire observer que nous n'avons nous-mêmes mis fin à cette pratique qu'au début du 20ème siècle – c'est tout proche ? Les femmes ne sont pas des êtres inférieurs mais les enfants sont considérés comme le produit de la seule semence de l'homme, le produit « de son sang ».
Soit, mais une fois cela dit, on ne peut plus avancer. Or, il reste à expliquer à l'école pourquoi les femmes sont dominées.

On ne fait pas changer les choses en les niant. Ce n'est pas ce que vous faites, mais d'autres le font.
Ce n'est pas ce que fait la théorie du genre.

La présentation que vous en faites me convient parfaitement, mais certains écrits exprimaient des abus caractérisés.
Je me sens coupable de ne pas avoir lu les passages incriminés. D'un autre côté, les gens comme moi, qui ne suis pas classée comme une théoricienne du genre mais comme une anthropologue qui s'est interrogée sur les raisons de la place universellement majorée des hommes et minorée des femmes et qui, par des analyses de documents et de terrain, a formulé une hypothèse plausible, se sentent niés quand ils lisent qu'il est inadmissible d'enseigner à nos enfants une théorie qui serait pure idéologie.

Je vous en donne acte. Pour moi, la théorie du genre n'est pas pure idéologie. Mais parfois le militantisme se substitue à la pédagogie, et certaines des formulations retenues m'ont paru relever du militantisme ; ce n'est pas acceptable.
Je ne pense pas non plus que l'on puisse faire avancer les choses par des conflits paroxystiques à coup de petites phrases ; il faut convaincre les irréductibles.
J'ai eu l'occasion de rencontrer un footballeur bien connu, M. Lilian Thuram qui, venu m'interviewer, m'a raconté comment il s'est intéressé à la hiérarchie imposée aux sexes. Ayant accompagné son fils à un entraînement de football qui mêlait filles et garçons, il a vu une fille l'emporter au dribble sur un garçon. Que croyez-vous que fit l'entraîneur ? Il n'adressa pas un mot de félicitations à la fille mais réprimanda le garçon au motif qu'il s'était fait battre par une fille, et incita ses camarades à le huer pour cette raison. Un tel comportement est inacceptable ; pourtant, l'entraîneur ne pense pas mal faire : le masculin doit l'emporter.

Je ne suis pas certaine que les chaînes de télévision aient accordé à notre formidable équipe de football féminine toute l'attention qu'elle mérite…

Si, à partir du moment où elle est parvenue en quart de finale de la coupe du monde de football féminin. Mais ce fut souvent pour faire des comparaisons avec le football masculin, ce qui n'est pas l'objet : il faut laisser les filles s'exprimer dans le football à leur manière ; le résultat est éloquent. Quant à M. Thuram, il serait plus crédible s'il avait fait davantage pour le football féminin.
L'histoire racontée par M. Thuram est exemplaire de ce qui continue de se produire spontanément. De même, des professeurs de collège m'ont dit qu'il est très difficile de donner la parole aux filles qui, si elles donnent les bonnes réponses aux questions posées, se font ensuite tabasser.

Alors que nous nous sommes battus pour la mixité, on entend de plus en plus souvent dire qu'il faudrait en revenir à la séparation des filles et des garçons dans les établissements d'enseignement. Qu'en pensez-vous ?
La mixité est une bonne chose, ce sont les mentalités qui n'ont pas changé ! Ce fut une erreur de penser que les enfants sont plus sages que nous et qu'ensemble à l'école, ils sauraient construire un monde plus égalitaire. On déchante, car ils ne le peuvent pas : ils suivent le modèle de la rue, de leurs parents et de leurs enseignants. Il n'y a pas échec de la mixité mais échec des idées. Conservons la mixité, et changeons les idées.

Votre approche diffère de celle de M. Luc Ferry qui, citant Freud, voyait dans les enfants des pervers polymorphes… et mêmes des fascistes !
L'esprit d'un enfant est une éponge molle : il n'a d'autres connaissances à acquérir et à transmettre que celles que nous lui enseignons. C'est en ce sens que Freud décrivait l'enfant comme un pervers polymorphe : tous les possibles lui sont ouverts, toutes les perversions et tous les acquis de la science.

Si, grâce à l'enseignement de la théorie du genre, on parvient à faire évoluer les mentalités, on aura gagné quelques années. Madame, je vous remercie pour votre précieuse contribution à nos travaux.
La séance est levée à 18 heures 55.