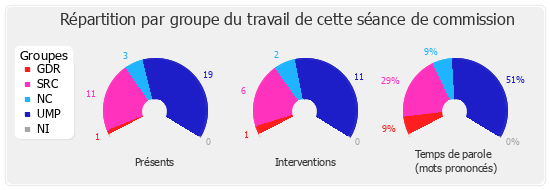Commission de la défense nationale et des forces armées
Séance du 9 février 2010 à 17h00
La séance
Audition du général d'armée Jean-Louis Georgelin, chef d'état-major des armées, sur la situation des opérations extérieures.
La séance est ouverte à dix-sept heures.

Mes chers collègues, c'est avec un très grand plaisir et avec émotion que je souhaite en cette fin d'après-midi la bienvenue, en votre nom, au chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin, que nous recevons sans doute pour la dernière fois à ce titre.
Nous avons souhaité vous entendre, mon général, comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire, sur la situation des opérations extérieures (OPEX).
Nos armées sont engagées sur plusieurs théâtres dans le monde, notamment en Afghanistan. Vous étiez venu après le drame d'Ouzbine, puis vous aviez fait une présentation globale des OPEX le 10 septembre 2008. Vos exposés sur les projets de lois de finances ont été à chaque fois l'occasion de dresser un panorama de nos engagements.
La situation reste difficile en Afghanistan. Ces dernières semaines ont malheureusement été marquées par la mort de plusieurs soldats français – un de nos chasseurs du 13e bataillon de chasseurs alpins vient de perdre la vie il y a quelques heures à peine, devenant ainsi la quarantième victime française de ce conflit.
Une conférence s'est tenue à Londres le 28 janvier dernier et la France va envoyer 80 instructeurs supplémentaires dans l'est Afghan.
Vous allez donc nous faire le point sur la situation en Afghanistan, ainsi que sur les autres théâtres où nous sommes présents, sachant que l'intensité de notre engagement en Afrique est sans doute moindre qu'il y a quelques années – je pense notamment à la Côte d'Ivoire et au Tchad. En revanche, avec le réarmement du Hezbollah et le maintien de la menace israélienne, on note un regain de tension au Liban.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, vous avez souhaité m'entendre sur les opérations extérieures, un an après ma dernière audition sur le sujet. À cet égard, je tiens à souligner que l'ensemble des évolutions qui avaient été annoncées par le Premier Ministre à cette époque a été réalisé. À votre demande, mes propos se borneront aux seules opérations extérieures. Je n'aborderai pas les missions conduites par les armées sur le théâtre national ni celles réalisées dans le cadre de la sécurité de notre territoire national. Ces missions, qui engagent chaque jour 1 500 hommes et femmes, sont partie intégrante de notre politique de défense et nécessiteraient une audition spécifique.
Avant de répondre à vos questions, je vous livrerai d'abord un panorama global de l'évolution de nos opérations extérieures sur l'année qui vient de s'écouler, puis je m'attacherai à vous présenter les enseignements, les conséquences ainsi que les défis liés aux opérations extérieures que nous conduisons.
Tout d'abord, quel est le panorama général de nos opérations extérieures ?
Nous sommes actuellement engagés au sein de 25 opérations différentes, qui se singularisent par leur diversité. Chaque crise est différente, chaque théâtre est spécifique. Il y a peu de similitudes entre la crise israélo-libanaise de juillet 2006 et la crise ivoirienne. Chacune des ces crises est unique et nécessite un traitement particulier. Notre niveau d'implication est également très variable : un militaire pour la mission des Nations unies au Libéria (MINUL) – et près de 4 000 en Afghanistan.
Ces opérations sont longues car les résolutions des crises s'inscrivent dans la durée. À titre d'exemple, notre engagement le plus ancien remonte à 1948, date de l'installation de la mission de l'Organisation des Nations unies chargée de la surveillance de la trêve en Palestine (ONUST). Cette mission compte encore, 60 ans plus tard, près de 400 hommes et femmes, dont deux observateurs militaires français. Cette notion de durée doit impérativement être intégrée quand on décide de participer à une opération.
Il faut également comprendre que les forces armées stabilisent une situation dégradée, rétablissent la paix mais ne règlent jamais à elles seules des crises qui sont le plus souvent infraétatiques et dont les racines sont anciennes et profondes. Telles sont les opérations d'aujourd'hui, même si les armées remplissent aussi des missions plus ponctuelles comme peut l'être notre participation à l'aide aux populations touchées par le tremblement de terre en Haïti.
Ces opérations sont très dispersées géographiquement et marquées par une évolution du déploiement de nos forces sur « l'arc de crise » tel qu'il est défini dans le Livre blanc. Nous engageons 38 % de nos effectifs en Asie centrale, contre 31 % en Afrique, 16 % en Europe et 15 % au Proche-Orient. La modification de la répartition de nos efforts a été sensible en 2009, puisque 57 % de nos troupes sont engagées sur l'arc de crise alors qu'elles ne représentaient que 43 % en fin d'année 2008.
Au total, nos interventions mobilisent aujourd'hui des effectifs de l'ordre de 9 000 hommes et femmes.
Depuis ma dernière audition au printemps 2009, le volume des forces déployées a diminué de près de 3 500 militaires. Cette diminution sensible des effectifs a été rendue possible par les évolutions positives que nous enregistrons sur les différents théâtres – cela n'est jamais assez souligné –, notamment au Kosovo, en Côte d'Ivoire, au Tchad et, dans une moindre mesure, au Liban. Ces évolutions soulignent que les notions de sortie de crise et de réversibilité sont bien réelles.
Si ces évolutions positives se confirment, elles permettront d'envisager de nouvelles réductions de nos effectifs déployés au cours de l'année 2010. Après le déroulement attendu du processus électoral en Côte d'Ivoire, nous pourrions mettre un terme à l'opération Licorne, qui mobilise 900 hommes. Au Kosovo, en accord avec nos partenaires de l'OTAN et conformément à la planification, nous devrions nous désengager de la KFOR, à laquelle participent 760 de nos hommes.
Sous réserve que nous ne soyons pas engagés dans une nouvelle crise, nous aurons ainsi réduit notre engagement dans les opérations extérieures de plus de 5 000 hommes en deux ans. Cela mérite d'être souligné.
Cependant, le taux de projection des forces françaises reste significatif. Il traduit la contribution constante de notre pays à l'effort de la communauté internationale pour assurer la stabilité mondiale. Il ne s'agit pas uniquement d'assumer les responsabilités d'un membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi d'éviter que ne se développent des menaces pour nos intérêts stratégiques, pour nos concitoyens et pour les valeurs que la France défend, y compris dans des zones laissées à l'écart de la mondialisation.
Pour que ce panorama soit complet, je voudrais à présent aborder un sujet qui vous préoccupe autant que nous et qui a fait l'objet d'un rapport en 2009 de la mission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale : le surcoût des opérations extérieures. Au-delà des questions de sémantique, cette expression recouvre bien la même réalité que ce que ce rapport place sous le vocable de coût : je parle bien du coût net, du coût supplémentaire que génèrent ces opérations.
En 2009, il devrait s'élever à 873 millions d'euros, en augmentation de 5 % par rapport à 2008. Certes, la réduction de notre dispositif a généré une économie globale de l'ordre de 82 millions d'euros, dont 56 millions d'euros pour les rémunérations et charges sociales. Toutefois, cette économie a été contrebalancée, entre autres, par les dépenses liées à la réorganisation du dispositif français sur le théâtre afghan, laquelle s'est traduite par une augmentation de 105 millions d'euros.
Ces 105 millions d'euros résultent, d'une part, de l'augmentation des effectifs, qui induit un surcoût de 29 millions d'euros, et, d'autre part de l'accroissement des dépenses hors rémunérations et charges sociales pour un montant de 76 millions d'euros. Il s'agit principalement des dépenses liées à l'effort de la protection de nos forces – en hausse de 29 millions d'euros – et à la mise en place de matériels importants de dernière génération, notamment les canons Caesar, les Tigre et les véhicules de l'avant blindé à tourelleaux téléopérés (VAB TOP). Le transport – pour neuf millions d'euros – et la maintenance – pour douze millions d'euros – de ces matériels représentent 20 % du surcoût supplémentaire de 2009 pour nos opérations en Afghanistan.
Je souhaite souligner que 2009 a été une année particulière en termes de financement des surcoûts OPEX. En effet, pour la première fois, les dispositions prévues dans la loi de programmation militaire ont été mises en oeuvre. La troisième loi de finances rectificative pour 2009 a attribué au ministère de la défense des ressources supplémentaires à hauteur du montant des crédits gagés dans le cadre du décret d'avance. Ainsi, les crédits d'équipement du ministère n'ont pas été amputés au titre des surcoûts des OPEX.
Le second point que je voudrais aborder concerne les enseignements que nous pouvons tirer des opérations extérieures actuelles.
J'en distingue essentiellement quatre.
Le premier enseignement réside indubitablement dans le durcissement de nos engagements, lequel résulte de l'évolution de nos adversaires. Aujourd'hui nous sommes confrontés à des adversaires dont nous avons plus de mal à déterminer les ressorts idéologiques. Nous ne pouvons pas appréhender leur action avec nos propres repères intellectuels. Si nous voulons les comprendre et donc les combattre efficacement, nous devons changer de cadre d'analyse. C'est ce que nos unités ont appris à faire et qui se traduit par une pensée tactique chaque jour renouvelée et plus dynamique, ce que je tiens à souligner. En outre, nos adversaires s'adaptent à ce que nous sommes. Les pirates ne s'arrêtent plus après nos tirs de semonce, les insurgés afghans posent leurs armes pour échapper à la rétorsion. Nous sommes devenus prévisibles, transparents et nos adversaires savent agir sur la détermination de nos nations.
Ainsi, face à la puissance de nos armes, nos adversaires choisissent le combat asymétrique. Qu'il s'agisse de l'orchestration de mouvements de foules, de l'utilisation de boucliers humains, de l'emploi d'engins explosifs improvisés ou de la mise en scène d'actions spectaculaires, leur imagination, comme on le voit régulièrement à Kaboul, est sans limite.
Le deuxième enseignement réside dans la place majeure qu'occupe aujourd'hui la communication dans la conduite des opérations en gestion de crise. En effet, toutes nos opérations se déroulent sous les yeux du monde. La communication est devenue à la fois un outil et un acteur : un outil, car elle conditionne notre perception des événements ; un acteur car les journalistes, par leur simple présence, influencent le cours des événements.
Outre ce double aspect d'outil et d'acteur, le développement des moyens de communication crée également une pression nouvelle sur notre articulation politico-militaire. Les délais de réaction du politique se sont considérablement réduits face aux événements. L'opinion publique est en prise directe avec le récit qui lui en est fait et elle est en prise de plus en plus directe avec le politique. Elle exerce ainsi un contrôle intermittent de l'action de l'État.
Nos chaînes de commandement intègrent désormais la nécessité de fournir un renseignement objectif dans les délais les plus courts. Toutefois, satisfaire à ce nouvel impératif n'est pas si simple.
Le troisième enseignement que nous pouvons tirer des opérations extérieures actuelles réside dans la nécessité d'avoir une approche globale. Le règlement des crises actuelles n'est pas purement militaire. Cela implique d'aborder chaque crise comme un cas particulier, de l'analyser dans son ensemble et de déterminer les éléments qui peuvent avoir une influence. Cela implique aussi d'être capables de coordonner finement sur le terrain les actions de sécurisation et celles de développement.
À cet égard, pendant la phase la plus dure de stabilisation, c'est bien le chef militaire, et personne d'autre – ce qui n'est pas facile à faire comprendre à tout le monde –, qui est le plus à même d'assurer cette coordination et d'orienter les actions de développement en fonction de la situation du moment. C'est ce type d'approche que nous nous efforçons de mettre en oeuvre en Afghanistan comme dans le traitement de la piraterie au large de la Somalie, au travers de l'établissement d'un cadre juridique et de la formation des forces de sécurité régionales.
Enfin, quatrième enseignement, nos interventions se déroulent dans un cadre international. La notion de « guerre juste » est aujourd'hui liée à l'approbation de nos actions par la communauté internationale. La recherche de cette légitimité passe le plus souvent par la mise en oeuvre d'une coalition. Ainsi, nos forces sont engagées de façon croissante au sein de dispositifs multinationaux. Il y a dix ans, 35 % de nos opérations étaient sous commandement national contre 17 % en 2010.
Aujourd'hui, 74 % de nos effectifs déployés sur des théâtres d'opérations extérieures le sont dans un cadre multinational, dont 49 % dans le cadre de l'OTAN, 18 % dans celui de l'ONU, 5 % dans celui de coalitions ad hoc et 2 % dans celui de l'Union européenne. Cette dimension internationale doit être conservée à l'esprit tant elle conditionne la définition de la stratégie comme la conduite des actions. À cet égard, les armées françaises doivent s'adapter en permanence pour maintenir l'interopérabilité nécessaire à l'intégration de leur action dans celle d'une coalition.
Au-delà de ces quatre enseignements, je souhaite à présent évoquer les conséquences de l'évolution des conditions de nos opérations extérieures pour notre outil de défense.
En premier lieu, je constate que, dans une période où le coût des opérations est devenu un principe directeur dans la prise de décision, leur durcissement a de fortes conséquences sur les budgets et sur la préparation de l'avenir.
Ainsi, la nécessité d'engager nos meilleurs équipements, de les adapter aux évolutions des menaces et de disposer d'infrastructures plus sûres pèse, entre autres, sur les surcoûts OPEX. Le coût annuel d'un soldat déployé en Afghanistan est de 105 000 euros alors qu'il est de 57 000 euros pour son camarade qui participe à l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Nous devons tenir compte de cette réalité car elle nous conduira à faire des choix, soit en volume, soit en durée, et elle imposera un recours plus fréquent à des arbitrages relevant directement du chef des armées.
En outre, l'exigence d'un théâtre comme l'Afghanistan nous a conduits à être plus réactifs en termes d'équipements. Cette réactivité se traduit par des achats en urgence opérationnelle qui permettent à nos troupes d'accroître leur efficacité et d'agir dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Cet effort d'adaptation réactive des armées aux besoins des forces s'est traduit par l'acquisition d'équipements pour un montant de 270 millions d'euros en 2009 – dont 23 ont été reportés sur le plan d'équipement 2010. Ce montant est à mettre en regard des 195 millions d'euros engagés sur la période 2006-2008.
Près du tiers de ces dépenses concernent les moyens d'acquisition du renseignement, notamment les drones, ce qui illustre à la fois la clairvoyance du Livre blanc et sa mise en oeuvre. Ces drones, dont nous avons amélioré l'interopérabilité, ne sont, je le dis en permanence, qu'une extension des sens du chef. Les drones ne mènent pas la guerre : ils ne peuvent pas remplacer les soldats dans le règlement des crises actuelles, même si leur appui est devenu essentiel.
Les armées doivent donc trouver un juste équilibre entre le financement de besoins indispensables à la réussite des opérations en cours et les investissements nécessaires à la construction de l'outil de défense qui, demain, permettra à notre pays de disposer d'armées aux capacités renouvelées, aptes à relever les défis et à affronter les menaces qui pèseront sur nos valeurs et nos intérêts. Cet équilibre est toujours délicat : nous ne devons pas tomber dans la fascination du présent, qui conduirait à bâtir un outil de défense fondé exclusivement sur nos engagements actuels, à moins de prendre le risque d'être surpris par l'avenir. Je l'ai souvent répété : l'histoire est une succession de surprises stratégiques et les armées doivent être en permanence en mesure de faire face à une brutale aggravation de la situation sécuritaire. C'est ce qu'essaient de faire les armées aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'elles entretiennent des capacités qui peuvent apparaître inutiles dans une vision à court terme. Et c'est pour cette même raison qu'elles se préparent à mener des combats qui ne correspondent pas toujours à la réalité de nos engagements du moment. Ce point est essentiel.
La seconde conséquence liée à l'évolution de nos opérations réside justement dans la préparation de nos forces.
En effet, le durcissement des opérations nous a conduits à adapter l'entraînement de nos unités. Ainsi, une unité de l'armée de Terre se prépare durant six mois avant d'être engagée en Afghanistan. Elle se prépare au travers d'exercices réalistes, tirés de cas concrets et d'une instruction dispensée par des personnels qui rentrent de ce théâtre d'opérations. Le retour d'expérience est ainsi systématiquement exploité en boucle courte. L'ouverture sur la culture et l'environnement de l'action militaire est recherchée afin de permettre à nos soldats de réagir correctement dans un combat particulièrement délicat.
Cette préparation renforcée est exemplaire et mérite d'être soulignée. Elle est tout aussi exemplaire que le sas de décompression qui permet à nos soldats engagés dans des actions dures de retrouver les repères d'une situation de paix avant de rejoindre leurs garnisons et leurs familles. Cette préparation a des conséquences en termes de ressources disponibles pour le reste de nos activités d'entraînement.
Néanmoins, ce choix demeure le plus adapté si nous voulons donner aux hommes et aux femmes que nous déployons sur les théâtres d'opérations tous les moyens pour remplir leur mission dans de bonnes conditions.
Enfin, la troisième et dernière conséquence que je souhaite évoquer concerne le poids du nombre de nos opérations sur notre outil de défense.
En effet, la multiplication des théâtres d'engagement et leur dispersion géographique créent des tensions sur un certain nombre de capacités, notamment sur nos moyens de commandement, nos moyens de projection aérienne et nos capacités médicales. Cela pose également une délicate équation en termes de soutien logistique. À cet égard, je tiens à souligner que la politique des armées en matière de maintien en condition opérationnelle des équipements est tout à fait efficace. La priorité accordée aux opérations nous a permis de remplir toutes les missions qui nous ont été confiées. Je n'ai jamais eu à annuler une mission pour des raisons de disponibilité de nos équipements, même si cela se fait parfois – et même souvent – au prix de fortes contraintes sur nos capacités et que notre marge de manoeuvre est souvent très réduite en termes de moyens disponibles.
Enfin, je voudrais aborder deux défis que les opérations extérieures nous obligent à relever.
Le premier réside dans le soutien de notre opinion publique à nos engagements. En effet, l'une des conditions du succès d'une opération militaire demeure la détermination de la population. Or, placés à l'abri de l'insularité stratégique qu'ont su créer le succès de l'Union européenne et la fin de l'affrontement des blocs, les Françaises et les Français ont de plus en plus de difficultés à établir le lien entre leur propre sécurité, l'intérêt national et des engagements qui se déroulent à des milliers de kilomètres de leur sol. Face à des opérations qui s'inscrivent dans la durée, le maintien du soutien de la population constitue un objectif essentiel. À cet égard, la représentation nationale a, je le crois, un rôle éminent à jouer.
Le second défi résulte de la « judiciarisation » de nos opérations militaires, laquelle s'exprime sous deux aspects. Elle s'exprime d'abord vis-à-vis de nos adversaires. En effet, que devons nous faire d'adversaires qui méprisent le droit de la guerre ? Que faire des pirates arrêtés au large de la Somalie, des insurgés que nous capturons dans les montagnes afghanes ? Chaque théâtre d'opérations nécessite une réponse adaptée et une réflexion. C'est ce que nous nous efforçons de faire.
Le second aspect de cette judiciarisation concerne nos soldats en opération. Bien évidemment, les militaires ne sont pas au-dessus des lois. Ils ne l'ont jamais été et ne demandent pas à l'être. Leur action sur les théâtres d'opérations doit être encadrée, comme elle l'est aujourd'hui. Cependant nous devons veiller à ce que la tendance de la société à vouloir tout ramener dans le cadre du droit commun ne vienne pas nier la finalité même de nos armées. Un fait d'arme n'est pas un fait divers, pour reprendre la formule du Président de la République. Si nous voulons maintenir l'efficacité de notre outil de défense, nous devons préserver le caractère extraordinaire que constitue l'emploi des armes de la Nation tel qu'il est formellement affirmé par le statut général des militaires. Nous devons laisser aux seize soldats qui l'année dernière ont conduit leur mission jusqu'au sacrifice ultime le sens de leur engagement : celui d'hommes et de femmes qui ont librement accepté de porter les armes de la Nation avec les responsabilités, les devoirs et les risques que cela suppose.
Pour conclure, je voudrais souligner que le travail des armées et l'effort de défense demandent de la constance. Cela montre tout le rôle que le Parlement et en particulier les membres de votre commission vont avoir à jouer dans les années à venir.
En outre, les succès que nous constatons ainsi que l'adaptation de nos armées aux conditions de leurs engagements traduisent parfaitement la grande qualité de notre outil de défense ainsi que la force morale qui singularise nos militaires – ce point est capital.

Nous assistons aujourd'hui, semble-t-il, à un « décrochage » de notre opinion publique envers nos engagements extérieurs, lequel serait a priori lié à nos pertes récentes en Afghanistan. Si la représentation nationale a bien sûr un rôle à jouer, quelles actions le ministère de la défense compte-t-il engager ?

Mon général, pensez-vous disposer des armements nécessaires à vos missions ? Ressentez-vous au contraire des insuffisances, par exemple en matière d'hélicoptères de manoeuvre ou encore de transport aérien ? Il semble aussi que nos missiles filoguidés exposent les militaires qui les servent.
Le « décrochage » du soutien de l'opinion aux opérations que nous pouvons observer concerne quasi-exclusivement les opérations en Afghanistan. Il est difficile de faire comprendre que l'action menée par les troupes de la coalition depuis 2001 a, sinon conduit à l'éradication de la menace terroriste qui s'exerce sur nos pays, au moins eu un impact positif en ce sens. Comme toujours, alors que, sur notre sol, cette menace s'estompe, et que le nombre des soldats victimes en opérations augmente, la population ne comprend pas la poursuite de notre déploiement dans ce pays.
Pour moi, la réponse à apporter à ce « décrochage » ne relève pas des armées, mais du pouvoir politique, pour qui c'est la mission par excellence. C'est aux politiques d'expliquer pourquoi la France est présente en Afghanistan et pourquoi elle doit y rester.
La France est présente en Afghanistan pour une seule raison : les événements du World Trade Center et les actions d'Al Qaïda. Avec nos amis Américains et ceux de l'OTAN, nous sommes intervenus dans ce pays pour éradiquer les camps d'entraînement d'Al Qaïda, mettre à bas le régime taliban et permettre à la société et à l'État afghan d'acquérir un niveau de stabilité suffisant pour pouvoir prendre en main leur sécurité. Les missions que nous assurons en Afghanistan relèvent assez largement des Afghans eux-mêmes !
Dans toutes les guerres contre-insurrectionnelles, les rébellions misent sur la fragilité des opinions publiques des pays d'origine des armées qui y combattent. En exerçant une pression sur les dirigeants politiques, les opinions publiques qui ne soutiennent pas l'action des armées, affaiblissent la participation de celles-ci, font le jeu – consciemment ou inconsciemment – des rebelles – en l'occurrence les talibans – et rendent notre tâche sur le terrain plus difficile. Pour moi, le seul moyen d'action sur les opinions publiques consiste en une pédagogie active dispensée par les responsables politiques, par les parlementaires et par tous ceux ayant pour mission de prendre la parole publiquement sur ces questions. Selon le dernier sondage disponible, la part de l'opinion publique favorable à notre engagement en Afghanistan est désormais passée sous la barre des 50 %.
Depuis le début de l'année, quatre soldats français sont morts en Afghanistan. Nos pertes sont très inférieures à celles des américains. On compte plus de 800 tués pour les Américains, plus de 300 pour les Britanniques et 40 pour les Français.
Cependant, je n'observe pas de lien fort entre l'évolution de l'opinion publique et celle du nombre de tués. L'opinion publique a tout à fait compris que les militaires avaient pour métier le danger et que le déploiement de forces sur le terrain leur faisait risquer leur vie. Au fond, la question est celle de la perception de la légitimité de l'action.
En matière d'équipements, je crois pouvoir dire qu'au regard de la mission qui est la nôtre, et de ceux dont l'adversaire dispose, nos armées sont globalement bien équipées.
La menace principale qui pèse sur nos forces est celle des engins explosifs improvisés (EEI). C'est contre elle que se mobilisent toute la matière grise, l'ingénierie, les directions générales de l'armement des pays membres de la coalition. Pour lutter contre les EEI et déceler leur présence, de nouveaux moyens ont été ajoutés : outre les moyens de brouillage électromagnétique dont nous avions déjà équipé nos VAB par le passé, nous avons déployé sur le théâtre afghan des dispositifs spécifiques, comme les Souvim – systèmes d'ouverture d'itinéraires minés –, ou les moyens du Génie, pour détecter le plus en amont possible la présence d'EEI.
Ces moyens techniques atteignent vite leurs limites. Il faut être capable, dans une zone donnée, de détecter les personnes qui, au sein de la population, vont déployer des EEI et faire ainsi peser une menace directe sur nos soldats. Pour cela, l'élément capital est le renseignement. Nous réussissons à peu près à savoir, dans une zone donnée, qui est susceptible de faire peser une telle menace. Toutefois, l'affaire n'est pas simple : alors que les talibans payent des personnes pour déployer des EEI – avec un tarif plus élevé lorsque l'explosion provoque des pertes –, à l'inverse, lorsque des contingents s'essaient à payer des Afghans pour qu'ils indiquent les emplacements où se trouvent ces explosifs, il peut arriver que certains, pour toucher la prime, les posent eux-mêmes préalablement ! C'est la guerre de contre-insurrection !
Globalement, nos moyens de combat d'infanterie sont adaptés. Le VAB résiste plutôt bien à la menace. Avec les Tigre, nous avons déployé des hélicoptères d'attaque performants. Nous disposons aussi, avec les Caracal, d'hélicoptères extrêmement fluides et manoeuvrables. N'oublions pas que, comme les autres nations présentes, nous bénéficions aussi des moyens de la coalition : soutien, appui en aviation, appui-feu indirect, drones, hélicoptères. Les manoeuvres des unités françaises en Kapisa ou en Surobi peuvent être appuyées par des moyens d'autres membres de la coalition, mis à disposition de la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS).
Le mauvais procès fait à l'été 2008 sur le niveau d'équipement de nos forces est derrière nous. Notre niveau d'entraînement et d'équipement nous permet d'assurer les missions qui nous sont confiées.
Certes, tout n'est jamais parfait. À propos des missiles filoguidés, je pense, monsieur Marty, que vous avez à l'esprit la polémique avec MBDA. Pour ne pas exposer nos tireurs, nous voulons que le successeur du missile filoguidé Milan soit un missile « tire et oublie ». Nous sommes navrés, alors que nous faisons la guerre, que le bon sens ne s'impose pas d'emblée.
Pour autant, je ne constate pas de difficultés majeures.
La sécurité – active et passive – de nos personnels est pour moi une préoccupation permanente. La sécurité passive regroupe l'ensemble des actions destinées à conforter la sécurité de nos bases opérationnelles avancées. À cette fin, nous déployons des éléments du Génie, parfois de façon temporaire, pour mettre les casernements à l'abri des Chicom, ces roquettes utilisées par les talibans, ou encore pour mettre nos bâtiments à l'abri des tirs de mortiers. La sécurité active regroupe quant à elle les mesures prises en matière d'équipement des nos soldats, de Souvim et autres dispositifs anti-EEI. Le matériel dont nous disposons nous permet d'assurer plutôt correctement cette fonction. Au regard des autres contingents, nous n'avons pas à rougir.

Mon général, j'adhère totalement à votre remarque sur le soutien de l'opinion publique et la judiciarisation, car nos adversaires ont connaissance de notre situation et savent en tirer les conséquences.
Par ailleurs – et je tiens à le souligner car cette évolution a eu lieu pendant que vous étiez aux responsabilités –, en Afghanistan, les alliés, en particulier les Américains, nous regardent désormais comme des frères d'armes.
Les moyens que nous mettons en oeuvre pour former les officiers et les hommes de l'armée nationale afghane sont-ils adaptés ? Avons-nous eu raison de procéder au déploiement de 150 gendarmes ?

Vous avez rappelé, mon général, le rôle du politique en matière d'engagements extérieurs, mais le politique, lui, a besoin de votre expertise.
Que pensez-vous des conclusions de la conférence qui s'est tenue à Londres le 28 janvier, en particulier de la demande du président Karzaï d'organiser une Loya Jirga qui aboutirait à modifier la Constitution, aux frais de la coalition ?
La main tendue aux talibans « modérés », qui permettra sans doute leur retour au Gouvernement, risque de nous amener à douter de notre action et à nous demander si nous n'avons pas fait « tout ça pour ça ! »
Enfin, que pensez-vous de la proposition de M. Karzaï d'ouvrir la conscription générale, y compris aux femmes, et de supprimer la professionnalisation ? S'il y parvenait, quel serait notre rôle en matière de formation, sachant qu'il ne s'agirait plus de former des volontaires ?
La formation de l'armée afghane a été évoquée dès 2001, lors de la Conférence de Bonn. Nous ne sortirons du théâtre des opérations que lorsque les Afghans seront en mesure de prendre en compte leur propre sécurité, avec leurs propres forces armées et leurs propres forces de police. Cette affaire est en bonne voie. Aujourd'hui même, le général Lechevallier, adjoint français de l'ISAF Joint Command Headquarters (IJC), m'indiquait à quel point les choses avaient évolué. Lors de la grande opération lancée dans la région du Helmand décidée par le général Mc Crystal, avec des troupes américaines et britanniques, il a pu vérifier la qualité de la participation des officiers afghans, qu'il s'agisse du placement des officiers sur le terrain ou de la prise en compte des opérations par les généraux. Nous voyons aujourd'hui des soldats afghans piloter des hélicoptères, ce qui était impensable il y a seulement trois mois. À cet égard, le rôle des OMLT – Operational Mentoring and Liaison team – et des POMLT – Police Mentoring and Liaison team – est essentiel et s'avère plutôt efficace.
Je me rends tous les trois mois en Afghanistan. À chacun de mes déplacements, je constate les progrès substantiels de l'armée afghane, en particulier ceux des officiers dans leur capacité à traiter des problèmes tactiques. Le nombre des désertions a diminué, les instructions sont mieux ressenties, et la présence des officiers plus constante.
La conférence de Londres a réuni les ministres des affaires étrangères des nations concernées, en présence du président Karzaï. Parmi les propositions faites par le chef de l'État afghan – formation de forces de sécurité et de police ; restauration d'une certaine gouvernance, opération qui a pris beaucoup de retard ; actions de reconstruction et de développement réalisées dans le cadre de l'effort international – celle consistant à tendre la main aux talibans modérés me paraît incontournable.
En effet, les talibans sont recrutés pour l'essentiel dans les tribus pachtounes ; or celles-ci représentent plus de la moitié de la population afghane. On voit mal comment ce pays pourrait retrouver une vie normale si tous ses citoyens ne se décident pas à vivre ensemble.
On peut en effet se demander pourquoi avoir fait tout cela pour en arriver à une réconciliation nationale ! Pour ma part, je ne vois pas les choses se terminer autrement que par une réconciliation, sous une forme ou sous une autre, associant les talibans les plus modérés à l'exercice des responsabilités, notamment à la gouvernance. Cette proposition ne me choque pas, elle est d'ailleurs encouragée par l'OTAN et par les responsables internationaux.
Parmi les décisions prises au cours de la conférence de Londres, la plus importante consiste à faire en sorte de mieux coordonner, sur le terrain, les actions militaires et civiles, sachant qu'il appartient aux chefs militaires, dans la phase initiale, de coordonner l'action civile. Lorsque les militaires organisent une action ou une Choura et s'aperçoivent qu'il manque une route ou un hôpital, il faut que la décision de financer les travaux permettant de les construire puisse être prise sur place et très rapidement, faute de quoi nous ne gagnerons pas la population au gouvernement Karzaï. C'est cette coordination-là qu'il faut mettre en place entre la mission des Nations unies en Afghanistan (UNAMA), la FIAS et les différents acteurs de terrain. Il faut que cessent les chikayas entre diplomates et militaires pour savoir qui fait quoi. On en arrive parfois à cette situation étrange dans laquelle un général de tel pays coordonne plus facilement les moyens financiers venant d'un pays autre que ceux provenant du sien. Sur ce plan, la conférence de Londres a marqué une évolution saluée par tout le monde.
Il a également été décidé de fixer une échéance de cinq ans pour stabiliser la situation en Afghanistan. Il est clair que nous avons vu surgir, au cours des derniers mois, une dynamique positive à l'échelle internationale.
J'en viens à la question du service militaire. Il ne me paraît pas anormal que le président Karzaï, compte tenu de l'état dans lequel se trouve son pays, sollicite la mobilisation de l'ensemble des personnes qui se trouvent sur place. Quel est le réalisme de cette proposition, alors même que la mise en place de l'armée afghane est difficile et que les armées de l'OTAN peinent à fournir les instructeurs nécessaires ? Les OMLT fonctionnent bien, mais pour nous, Français, fournir une OMLT de 50 soldats revient à « mettre sur cales » un régiment dans sa presque totalité, car, faute de réserve, nous devons prélever les officiers sur nos forces. Nos limites sont vite atteintes. Et collectivement, il nous serait difficile de former la totalité des jeunes Afghans, d'autant que la difficulté serait aggravée par l'illettrisme qui sévit dans ce pays.

Selon le président Karzaï, les Afghans assureront un jour eux-mêmes leur formation, d'ailleurs le programme est déjà planifié.

Dans un pays où la tribu prend le pas sur la Nation, la conscription pourrait permettre de créer un creuset contribuant à donner naissance à un sentiment national.

Mon général, quelques mois après le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, quel regard portez-vous sur les conséquences de cette réintégration dans la manière dont notre pays conduit les opérations extérieures ? Avez-vous le sentiment que nous sommes davantage associés que nous ne l'étions à la définition des orientations stratégiques des opérations les plus importantes et à leur mise en oeuvre opérationnelle ?

Nous participons à des opérations de maintien de la paix et de gestion de crise en faisant en sorte de rallier les populations locales. Vous avez évoqué les « chikayas ». Pouvons-nous vous aider à mieux valoriser ces opérations ? Quelle politique, quelle stratégie devons-nous mettre en oeuvre, avec quel financement, quelle planification des opérations et quel lien avec les autres pays et institutions ?
L'une des raisons pour lesquelles nous avons repris pleinement notre participation au sein de l'OTAN, c'est précisément que nous prenions part à toutes les opérations, sans toutefois faire partie des états-majors de conception. Sur le plan strictement pratique, sur le théâtre afghan, notre pleine participation n'a rien changé ; notre accès aux moyens était déjà complet. Sous l'angle des opérations, nous étions déjà pleinement dans l'OTAN.
Ce qui a changé, c'est le regard que nos partenaires portent sur nous. En participant aux opérations de combat, nous payons le prix du sang, ce qui n'est pas le cas de nombreuses nations européennes. Nous ne sommes plus suspectés de manoeuvres dilatoires par rapport aux décisions de l'OTAN.
En revanche, le fait de participer pleinement aux réflexions sur la mise en place du concept stratégique et la réorganisation des états-majors de l'OTAN est extrêmement positif. Nous ne subissons plus les décisions prises sans nous : nous participons aux débats et nous sommes très écoutés. Nous représenterons à terme 13 % des effectifs militaires du commandement suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) – soit l'un des premiers effectifs de l'état-major. Le général Abrial est chargé, à la tête du commandement suprême allié de la Transformation, de faire des propositions de réflexion sur le concept stratégique. Nos alliés observent tout cela avec beaucoup d'intérêt. Sur le plan militaire, notre pleine participation est extrêmement bénéfique. C'est sans doute plus complexe sur le plan politique ou diplomatique.
J'ai discuté récemment avec l'amiral Stavridis, actuel SACEUR, et avec les Français membres de l'état-major de l'OTAN. Régulièrement, je réunis les principaux responsables français intégrés dans l'OTAN pour leur donner des instructions, vérifier qu'ils ont bien compris leur mission et qu'ils se comportent comme partie intégrante de l'OTAN.
Tout cela nous a placés d'emblée dans l'OTAN, aux côtés des Britanniques et naturellement des Américains, comme un interlocuteur majeur. Cela ne laisse pas de m'étonner, tout comme m'étonnent la performance et la compétence de nos officiers d'état-major. Mais comme je l'ai déjà dit : « Quand je suis à Paris je me désole, quand je vais à l'extérieur je me console ». En fait, le niveau d'instruction de nos armées est très supérieur à ce que l'on peut observer dans la plupart des pays européens.
J'en viens à votre question, monsieur Beaudouin, qui est très complexe. En 1997, alors que j'étais colonel, nous réfléchissions déjà sur le sujet. Avant tout, il faut admettre que, dans la phase initiale d'une opération, c'est le militaire qui est responsable. Les agents économiques et diplomatiques doivent accepter d'être placés sous son autorité – j'observe que cela suscite encore beaucoup de réticences. Il faudra bien à terme régler ce problème psychologique.
Plus que d'autres, dans notre pays, nous avons beaucoup de mal à trouver des agents civils – juges, douaniers, et tous métiers constitutifs du fonctionnement d'un État – pour remplir des missions extérieures, les effectifs de notre fonction publique étant naturellement taillés à l'aune des besoins français.
Si vous le dites, monsieur le député… Si nous avions des responsables administratifs disponibles dans les domaines de la finance, de l'économie, de l'agriculture, de la justice, de l'équipement et de la santé, cela irait beaucoup plus vite ! Mais nous avons toujours du mal à libérer des effectifs. Si nous voulons installer la gouvernance en Afghanistan, il faut faire venir des instructeurs de gouvernance. Or ces personnels ne sont pas disponibles, pas plus que les financements. Nous butons depuis toujours sur cette difficulté, qui, à mon sens, ne peut être réglée au seul Quai d'Orsay. Il s'agit pour moi d'une problématique interministérielle qui doit être résolue par le Premier ministre et le Secrétariat général de la défense et la sécurité nationale.

Vous avez, mon général, évoqué la distanciation du lien entre l'armée et la Nation. Pourtant, depuis l'engagement de notre pays en Afghanistan, un certain nombre d'associations, d'anciens combattants ou patriotiques, cherchent à apporter un soutien moral à nos troupes engagées sur le front, mais ne savent pas comment faire. Il me semble que les armées ne s'emparent pas assez de cette volonté des associations. Qu'en pensez-vous ? L'armée ne pourrait-elle pas faciliter de parrainages ou des opérations de ce genre pour montrer à nos soldats que l'opinion, tout au moins une grande partie de celle-ci, est derrière eux ?

Un projet de loi prévoit de supprimer le tribunal aux armées de Paris. Pourtant celui-ci, dans le respect des conventions internationales, apporte une sécurité juridique aux militaires qui font l'objet d'une procédure engagée par le parquet. Ce tribunal traite près d'un millier d'enquêtes, sous l'égide du parquet, et une trentaine d'informations judiciaires. Je souhaite connaître votre avis sur cette question, et j'attends de vous une parole libre.
Nos armées, monsieur Meslot, n'attendent pas un soutien aussi direct. S'il est toujours bienvenu d'adresser des colis aux soldats, le problème n'est pas là. Je n'ai pas parlé de distanciation du lien entre l'armée et la Nation mais de « décrochage » du soutien à la légitimité de l'opération. Ce qui est important, c'est que le soldat qui intervient sur un théâtre d'opérations où il risque sa vie ait le sentiment que le pays dont il est citoyen est derrière lui.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'un soutien au principe même de la nécessité d'une armée, à la légitimité de notre action, c'est d'une reconnaissance de notre valeur et de la valeur morale que représente l'engagement militaire.
Madame la députée, je suis totalement favorable à la suppression du tribunal aux armées.
Elle l'est. Je vais vous expliquer pourquoi je suis favorable à cette suppression, avec le devoir de réserve qui s'impose…
Le tribunal aux armées a été créé lorsque la justice militaire a été supprimée, pour traiter des affaires concernant les soldats français déployés hors du territoire national. Le tribunal aux armées va être supprimé mais le code de justice militaire, lui, demeure. Or, c'est lui qui apporte des garanties au soldat puisqu'il stipule qu'un militaire ne peut être condamné, lorsqu'il se trouve au combat, que s'il n'a pas respecté les diligences normales ! En tant que chef d'état-major des armées, j'ai considéré que, dans l'affaire d'Ouzbine, il n'y avait pas lieu de sanctionner, les diligences normales ayant été respectées. Les événements d'Ouzbine ont donné lieu à une polémique à propos des percuteurs qui n'auraient pas été placés sur les mortiers. Si les percuteurs n'avaient pas été en place, nous aurions été dans le cas de non respect des diligences normales, ce qui aurait mérité sanction de ma part. Mais tel n'était pas le cas.
Je vois plutôt d'un bon oeil la suppression de ce tribunal, car désormais les militaires auront affaire à des procureurs et des magistrats qui seront totalement libres par rapport aux affaires qu'ils traitent.
Ils trouveront naturellement leur indépendance à l'égard de la hiérarchie militaire, libérés de la crainte d'être instrumentalisés.

Votre position est courageuse, mon général, les juges libres ayant toujours suscité une certaine méfiance.

Ne nous avez-vous pas dit un jour que nous avions tendance à vouloir normaliser l'institution militaire en lui appliquant le droit commun ?
J'en suis conscient, c'est pourquoi il faut maintenir le code de justice militaire. Il aurait été dramatique de le supprimer et d'appliquer aux armées le code pénal classique.

Pour réformer le code de justice militaire, nous avons tenu compte de la réforme du code de procédure pénale. Cela facilite les procédures et constitue une garantie pour les militaires.

Pas tout à fait, car le tribunal aux armées de Paris, en étant spécialisé, apporte une garantie aux armées. Avoir affaire à un magistrat habitué à traiter des opérations délicates constitue une garantie, car il est mieux à même d'apprécier les événements que celui qui ne l'a jamais fait. C'est particulièrement vrai en matière d'opérations extérieures.
Je maintiens que le code de justice militaire se différencie du code de procédure pénale. C'est heureux, car le jour où les morts au combat relèveront des faits divers, cela voudra dire que nous n'avons plus d'armée. L'essentiel est donc de maintenir la spécificité du code de justice militaire.
Au demeurant, depuis que je suis colonel, j'ai été confronté à un certain nombre d'affaires et je peux vous dire que la garantie que vous évoquez n'a pas nécessairement joué dans le sens que vous avez indiqué.

Je partage totalement votre point de vue, mon général, sur le tribunal aux armées.
L'OTAN est en train de revisiter son concept stratégique. L'une des contreparties attendues de notre retour plein et entier au sein de l'organisation est d'insuffler une nouvelle dynamique à la défense européenne. D'autre part, le traité de Lisbonne, qui est entré en application le 1er janvier, contient une disposition très importante pour la défense européenne, qui, pour la première fois, existe de façon institutionnelle à travers la coopération structurée permanente – même si celle-ci n'est pas encore en oeuvre et ne le sera sans doute pas avant longtemps. Peut-on imaginer que le concept de coopération structurée permanente et les dispositions du traité de Lisbonne seront pris en compte dans la définition du nouveau concept stratégique de l'Alliance, qui, si le calendrier prévu par Madeleine Albright est respecté, sera adopté à la fin de l'année ?
Nous avons le sentiment que les choses évoluent. Dans le Livre vert de la défense, les Britanniques invitent leurs militaires à coopérer davantage au sein de l'Europe, notamment avec les Français, présentés enfin comme étant des gens fréquentables. Le retour plein et entier de la France dans l'OTAN nous rend donc beaucoup plus crédibles.

Mon général, vous parlez d'approche globale, d'actions civilo-militaires, de restauration d'une certaine gouvernance, mais vous semblez porter un regard critique sur notre aptitude à les mettre en oeuvre. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Compte tenu des réticences des Américains et d'un certain nombre de nos partenaires, peut-on vraiment envisager que le contenu du traité de Lisbonne sera référencé dans le nouveau concept stratégique de l'OTAN ? N'oublions pas que le concept de 1999 ne contenait que quelques vagues formules reconnaissant aux Européens le droit de renforcer leurs moyens. Cela dit, le traité de Lisbonne ayant été ratifié par 27 pays européens, la situation est très différente de celle qui prévalait auparavant.
Il n'est pas possible ne pas tenir compte, dans le nouveau concept stratégique, de la nouvelle donne de la défense européenne. Vous oubliez que les États-Unis eux-mêmes ont reconnu la légitimité d'une défense européenne. Jusqu'à présent, le mécanisme le plus évolué qui existait était celui de « Berlin Plus » ; or j'ai entendu récemment des « personnes proches du dossier » expliquer qu'il était insuffisant car il y avait désormais le traité de Lisbonne. Quoi qu'il en soit, nous nous heurterons toujours à la difficulté de déterminer ce qui relève de la défense européenne et ce qui ressort de l'OTAN.
Il est très intéressant de parler de défense, de « Berlin plus », mais il faut d'abord parler budget. La réalité, c'est que la France et le Royaume-Uni consacrent 2 % de leur PIB à la défense, les autres pays 1 %, et les Américains bien plus. Tant que les Européens ne seront pas capables de construire eux-mêmes des capacités militaires, il sera difficile d'édifier quelque chose de concret.
J'en viens à la coopération civilo-militaire. C'est ainsi que, dans la zone de Kapisa-Surobi, pour faciliter la tâche du général français de la Task Force Lafayette, nous avons, mes collaborateurs et moi-même, pris un certain nombre d'initiatives visant à rationaliser notre coopération civilo-militaire. Il s'agit de mesures locales permettant d'associer davantage l'ambassade de France, qui dépend du ministère des affaires étrangères, et le général qui commande la Task Force en vue d'élaborer un schéma directeur. Cette décision concrète est d'une importance considérable. C'est cette perception qui doit primer. Nous espérerons que cela permettra de mieux coordonner les aides civiles dans la zone française. Des rapports mensuels seront établis, visés par les autorités compétentes, dont le ministère des affaires étrangères. Des projets plus consistants, à l'initiative de l'AfPak, seront directement dévolus au général, ce qui était impensable jusqu'à présent. Pour rendre ce dispositif opératoire, nous avons décidé de donner au général des collaborateurs civils, qui seront placés sous sa responsabilité et seront chargés de mettre en oeuvre les opérations. Cette décision a une importance considérable, et il est dommage qu'il nous ait fallu tant de temps pour y parvenir.
Par ailleurs, une dizaine d'experts civils seront détachés dans les ministères afghans, dans les domaines suivants : justice, intérieur, éducation, énergie, agriculture et finances. Ces instructeurs de gouvernance seront eux-mêmes conseillés par des experts civils spécialistes de la culture afghane. Car il est très important, dans un pays comme l'Afghanistan, de ne pas faire de contresens. Je suis très soucieux de préparer les militaires qui se rendent en Afghanistan à la connaissance et à la culture du pays. Il est important qu'ils sachent comment la femme est considérée, quels sont les usages, ce qu'est une tribu et une Choura…

L'Afghanistan est le premier théâtre sur lequel aient été déployés à la fois des drones tactiques et des drones de moyenne altitude et longue endurance (MALE). L'expérience a montré à quel point ces deux systèmes étaient complémentaires et sont aujourd'hui incontournables dans ce type d'opérations. Or, pour chacun d'eux, une rupture capacitaire est prévisible dans l'avenir. Les crédits qui leur sont consacrés par la loi de programmation militaire apparaissent limités.
Nous craignons donc que, pour des raisons financières, un choix soit opéré entre les deux systèmes. Je considère personnellement que le système intérimaire de drone MALE (SIDM) n'aura jamais la capacité d'appui tactique du système de drone tactique intérimaire (SDTI) ou d'un drone de ce type. Pouvez-vous nous confirmer très clairement que pour vous l'expérience impose la poursuite de l'investissement sur les deux systèmes ? En conséquence, le montant des crédits destinés aux drones devrait être revu.

Disposons-nous déjà de premiers résultats sur l'efficacité de la formation de soldats somaliens à Djibouti par les forces françaises ? Les premiers éléments formés sont-ils déjà arrivés à Mogadiscio pour soutenir le Gouvernement provisoire ?

Je me félicite de la diminution appréciable – de 5 000 hommes et femmes en moins en deux ans – du nombre de nos soldats engagés un peu partout dans le monde. En revanche, le conflit afghan continue à beaucoup nous inquiéter : la France est présente en Afghanistan depuis 2001, et nous y déplorons déjà plus de 40 tués. Ma position politique est que cette guerre n'est pas la nôtre et que la France n'a rien à faire dans ce pays. J'ai demandé l'élaboration d'un calendrier de retrait de nos forces et l'attribution d'un mandat à l'ONU.
Mon général, l'Afghanistan est en guerre depuis trente ans. La population française est hostile à notre présence dans ce pays. Vous avez répondu à certains de mes collègues que nos forces s'en retireraient lorsque l'armée afghane serait capable d'assurer l'équilibre de son pays. Mais quel délai envisagez-vous pour ce retrait ? Deux ans ? Quatre ans ? Dix ans ? Vingt ans ?
Monsieur Ménard, la formation du bataillon somalien à Djibouti est achevée. Il est maintenant revenu en Somalie. L'effectif de soldats somaliens à former est de 2 000.
Une nouvelle opération, lancée par l'Union européenne et placée sous responsabilité espagnole, est conduite en Ouganda. Le nombre de formateurs européens atteindra 100 à 150 ; la France devrait fournir 30 instructeurs.

Les soldats du bataillon formé par la France sont-ils revenus à Mogadiscio ? Sont-ils bien entraînés ? Doit-on déplorer des fuites vers le camp adverse ?
Les soldats sont revenus à Mogadiscio. À ce jour, aucune désertion ne m'a été rapportée.
Monsieur Candelier, je crois avoir déjà répondu assez largement à votre question. Il est difficile de fixer une date de retrait. Dans un discours à West Point, le président Obama a indiqué que le retrait des troupes américaines commencerait en 2011. Je crois qu'il se tiendra à ce calendrier et qu'il sera en situation de le faire.
Les succès recueillis dans le transfert aux Afghans de la responsabilité de la sécurité ne sont pas suffisamment soulignés. L'affaire des vingt kamikazes qui a tant occupé les médias il y a trois semaines a été réglée par les Afghans eux-mêmes, en sept heures. Les Afghans ont même refusé l'intervention de la force de réaction rapide turque de la FIAS malgré le contexte difficile. Contrairement à ce que l'écoute des médias a pu faire croire, le nombre des tués a été très limité.
Dans la zone sous responsabilité française, il est aujourd'hui possible d'envisager le transfert aux Afghans dans un délai raisonnable de la sécurité du district de Surobi. Le délai de quatre à cinq ans proposé par le président Karzaï pour le début d'un retrait substantiel ne me paraît pas une vue de l'esprit.
Monsieur Viollet, le SIDM et le SDTI sont en effet deux matériels de nature différente. L'affaire afghane nous montre que l'emploi des drones par les unités d'infanterie doit être suffisamment intuitif pour que le chef de section ou le commandant de compagnie puisse exploiter lui-même en temps réel les données recueillies : celui-ci doit donc être parfaitement à l'aise avec leur emploi. Nous y réussissons désormais assez bien, et les habitudes sont prises. Nous n'aurons plus sur le terrain d'unités qui ne soient équipées de drones tactiques. Il en est de même pour les SIDM.
Les crédits prévus pour les drones par la loi de programmation militaire sont loin d'être négligeables. Ils sont cohérents avec leur usage de l'époque.
Il n'est pas exclu que, dans les réajustements auxquels nous serons nécessairement amenés à procéder – une loi de programmation militaire est un outil non pas figé mais vivant –, nous devions revoir la question des drones. Cette révision se fera cependant forcément au détriment d'autres programmes – ce jour là, des parlementaires ne manqueront pas de poser des questions sur les réductions ou suppressions de matériels qui découleront de cette révision. L'équilibre du dispositif est toujours difficile à trouver.
À défaut de vous livrer des chiffres précis – je n'en dispose pas –, je peux confirmer l'intérêt qu'il y a à disposer de drones des deux types.
J'ajoute qu'en 2009, plusieurs drones tactiques ont été commandés en urgence.

Mon général, compte tenu des effectifs de forces déjà requis par les opérations extérieures – vous nous les avez précisément présentés –, si, demain, nous devions faire face dans l'urgence à une nouvelle menace, pourrions-nous procéder à un déploiement nouveau ?

J'observe que l'opinion n'accepte plus aujourd'hui les décès de soldats et se préoccupe aussi des conditions dans lesquelles ils combattent.
Les évolutions de matériels comme les drones ne sont-elles pas contraintes par la limitation des investissements ? Certains programmes, comme le système Félin, ne sont-ils pas trop audacieux ?
Monsieur Hillmeyer, la réponse à votre question se trouve dans les contrats opérationnels tels qu'ils sont définis dans le Livre blanc. Nonobstant les opérations extérieures actuelles, les armées doivent être en mesure d'engager un groupe aéronaval – il est actuellement disponible –, 30 000 hommes de l'armée de terre pour une opération substantielle dans la durée et 70 avions en ligne. À l'heure actuelle, je ne vois pas que les contrats opérationnels soient affectés ou remis en cause. Cela dit, ils demeurent modestes.
Monsieur Guilloteau, une loi de programmation militaire s'efforce de réaliser des équilibres entre différentes contraintes. Pour cela, il faut trancher, faire des choix. L'élaboration du Livre blanc a procédé d'une réflexion poussée. Il a été tenu compte d'un existant, des contrats opérationnels ont été définis et des programmations ont été décidées. Une forte priorité a été accordée aux moyens de connaissance et de renseignement : drones, satellites, capteurs de guerre électronique. En Afghanistan, la mise à disposition de moyens de guerre électronique à des lieutenants d'infanterie représente un progrès considérable.
Pourquoi le programme Félin suscite-t-il tant de critiques, voire de quolibets ? Il constitue pourtant l'une des conditions de la sécurité de nos hommes ! C'est toujours pareil : on nous reproche alternativement d'exposer nos soldats au danger – dans l'affaire d'Ouzbine, nous les aurions insuffisamment protégés, leurs gilets pare-balles n'auraient pas été assez récents… – puis, lorsque nous les protégeons, de les alourdir d'équipements inutiles et de gêner leurs déplacements sur le terrain. Il faut faire confiance aux experts ; or ceux-ci ont unanimement considéré que le dispositif Félin était adapté aux risques courus par l'infanterie, en termes de protection du soldat comme de moyens de communication, et qu'il constituait donc une aide au renseignement et à la sécurité.

Merci, mon général, pour cet exposé passionnant. En mon nom et en celui de tous mes collègues, je voudrais vous dire combien nous avons apprécié, outre la qualité de vos relations avec la commission, son président, ses rapporteurs et ses membres, la manière dont vous avez conduit nos armées. Je voudrais saluer le grand serviteur de la Nation et le beau chef que vous avez été.
La séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq.