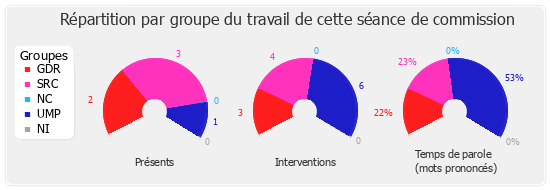Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
Séance du 10 février 2009 à 17h00
La séance
La mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a auditionné Mme Maryvonne Chapalain, commandant fonctionnel à la Délégation aux victimes de la direction générale de la police nationale, Mme Nicole Terck, vice-présidente, et Mme Sabrina Bellucci, directrice de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM), Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol, Mme Nicole Crepeau, présidente, et Mme Marie Bellanger de la Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF), Mme Evelyne Reguig et Mme Isabelle Bouclon, de l'Association VIFF SOS Femmes.

Nous vous remercions, mesdames, d'avoir répondu à notre demande.
Je vous propose d'organiser nos discussions autour de trois thèmes : l'accueil, dans les commissariats et les gendarmeries des femmes victimes de violences intra-familiales ; la protection des femmes pendant la procédure – hébergement, éviction du conjoint violent –; les solutions apportées en termes de logement, d'emploi et de protection des enfants. Sur tous ces sujets, nous aimerions avoir votre témoignage ainsi que vos propositions pour améliorer la situation ?
Je vous donne donc la parole pour évoquer tout d'abord l'accueil et l'orientation des femmes victimes de violences.
En tant que commandant fonctionnel à la Délégation aux victimes au sein de la Direction générale de la police nationale, je suis particulièrement concernée par cette question. La délégation est une structure mixte, composée de policiers et de gendarmes. Depuis sa création, en 2005, elle est chargée d'améliorer l'accueil et la prise en charge des victimes de toutes les infractions pénales dans les commissariats et les unités de gendarmerie.
L'accueil des victimes de violences conjugales est toujours délicat. Les plaintes sont complexes et il faut beaucoup de temps aux policiers et aux gendarmes pour les établir. Il leur faut évaluer le contexte psychologique dans lequel évoluent ces femmes et les mettre en confiance afin d'établir l'historique des violences subies, au-delà du fait récent qui les a amenées à déposer plainte. Il leur faut également identifier l'existence éventuelle d'autres victimes au sein de la famille, notamment des enfants, même s'ils n'en sont que les témoins. L'historique des violences commises au sein du couple permettra au magistrat de juger de leur gravité.
Je n'emploie pas l'expression « violences conjugales » car la loi du 4 avril 2006 concerne les violences entre les conjoints, les concubins et les pacsés, ainsi que celles émanant d'anciens compagnons. Nous parlons donc désormais de « violences au sein du couple ».
Dans 90 % des cas, les victimes de ces violences sont des femmes. Ces violences ne sont pas uniquement physiques, elles sont aussi psychologiques et sexuelles. De nombreuses femmes n'osent pas avouer qu'elles se font violer par leur mari. Pourtant, la loi d'avril 2006 reconnaît le viol entre époux et en fait une circonstance aggravante.
La complexité des plaintes a conduit à l'élaboration d'un questionnaire très détaillé à l'intention des commissariats et des unités de gendarmerie. Ce document vise à leur permettre d'appréhender la totalité des faits de violences qui ont pu exister au sein du couple, mêmes les faits antérieurs à la plainte, pour que le magistrat puisse évaluer la nature des violences. Il fait également état des violences financières et du vol de papiers d'identité, qui frappent particulièrement les femmes d'origine étrangère en les plaçant sous l'emprise de leur compagnon. En reconnaissant le vol entre époux, la loi de 2006 a beaucoup amélioré leur situation.
De récentes instructions ministérielles invitent à procéder à l'interpellation de l'auteur des violences très rapidement après l'audition de la victime afin d'éviter la poursuite des violences et qu'elle soit éventuellement suivie d'une mise en garde à vue immédiate de l'auteur des faits. Ensuite, pour répondre au souhait de nombreux magistrats, une confrontation est organisée entre les deux personnes – ce n'est pas chose aisée, car elles ont tendance à camper sur leurs positions respectives – enfin, elles sont présentées au magistrat. Il s'agit de la procédure simple.
Il existe également une procédure dite de la main courante, fort décriée. Cette simple déclaration d'une personne qui se présente dans un commissariat n'a pas la valeur d'une plainte transmise en justice et n'entraîne, en principe, aucune suite judiciaire. Cependant, nous recevons depuis plusieurs années des instructions de notre ministre de tutelle, mais également des magistrats, pour que les mains courantes informatisées des commissariats soient transmises à la justice, au même titre que les procès-verbaux de renseignement judiciaire de la gendarmerie.
Les instructions invitent à encourager les victimes à déposer plainte, car c'est pour elles le seul moyen d'être prises en charge et d'agir à l'encontre de l'auteur des violences. Certaines s'y refusent, préférant une simple déclaration « à toutes fins utiles ». Quoi qu'il en soit, le refus d'entraîner des suites judiciaires doit émaner de leur volonté et non selon de celle d'un fonctionnaire de police.
Lorsque les faits sont de faible gravité, les mains courantes sont conservées au commissariat de police. Après une main courante, instruction est donnée aux services de reprendre contact avec la victime, quarante-huit heures après sa déclaration, afin d'apprécier l'évolution de sa situation et de vérifier que la réitération des violences ne justifie pas de s'orienter vers une procédure.
Les forces de police interviennent également dans le cadre du flagrant délit. Le standard de police secours reçoit un appel, en général la nuit, d'un témoin, d'un voisin ou d'un membre de la famille qui dit entendre des cris. Les policiers se rendent au domicile où se trouvent une personne qui présente des marques de coups et son compagnon, souvent sous l'empire de l'alcool. Nous faisons d'abord en sorte de protéger les enfants.
Ensuite, si la victime veut déposer plainte, les policiers emmènent l'un et l'autre au commissariat pour enregistrer la plainte et l'auteur des faits est immédiatement placé en garde à vue. Dans le cas où la victime ne souhaite pas déposer plainte, la procédure de flagrant délit a ceci d'intéressant qu'elle permet aux policiers de constater l'existence d'un fait délictueux, ce qui dédouane la victime aux yeux de son compagnon. C'est la justice seule qui décide s'il y a délit et s'il convient de le réprimer. La procédure est la même que précédemment : les deux personnes sont emmenées au commissariat pour être entendues et l'auteur des faits est mis en garde à vue.
Les victimes doivent savoir que même si elles n'ont pas déposé de plainte, ou si elles l'ont retirée, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.
Bien souvent, une personne qui a subi des violences est traumatisée. Certaines arrivent au commissariat en chemise de nuit, avec leurs enfants sous le bras… Pour mieux les accueillir, nous intervenons en partenariat avec les associations spécialisées sur cette question auxquelles je rends hommage pour leur travail. Les fonctionnaires de police orientent les victimes vers les structures d'hébergement d'urgence qui connaissent bien ces problématiques. J'ajoute que depuis la loi de 2006, l'éviction du conjoint du domicile peut être diligentée. C'est un point très positif, mais il arrive aussi que la victime souhaite quitter le domicile commun pour être mise à l'abri au moins quelques jours.
Il existe aujourd'hui dans les services de police 150 permanences d'associations, faisant essentiellement partie du réseau INAVEM, dans lesquelles les victimes de violences intrafamiliales sont accueillies par des travailleurs sociaux et des psychologues.
Les services de police disposent par ailleurs de 120 travailleurs sociaux, recrutés localement, et, depuis deux ans, de psychologues, recrutés par le ministère de l'intérieur. Ceux-ci ne sont pas en concurrence avec les associations car leur rôle n'est pas de prendre en charge la victime mais de l'orienter vers les réseaux associatifs et les structures médico-sociales. La prise en charge des victimes est de mieux en mieux assurée et les psychologues peuvent aussi intervenir auprès des auteurs de violences. Nous aimerions d'ailleurs qu'ils soient en mesure de les orienter, en fin de garde à vue, vers des structures médicales.
Nous avons également la possibilité de contacter les correspondants départementaux chargés de l'aide aux victimes. Des partenariats se développent et de nombreuses structures sont mises en place pour assurer un meilleur accueil des victimes de violences entre époux. Des conventions ont été passées avec les réseaux de l'INAVEM, le CIDFF – Centre d'information sur le droit des femmes et des familles – et la Fédération nationale Solidarité Femmes.

Quant la victime a déposé plainte, que devient-elle pendant l'enquête, qui peut être longue ?
Ce problème n'est pas facile à résoudre. La victime est naturellement protégée pendant la durée de la garde à vue. Celle-ci n'est cependant que de vingt-quatre heures – quarante-huit heures en cas de prolongation. La suite dépend de la décision du Procureur de la République – ou, dans les cas d'une extrême gravité, du juge d'instruction – mais l'emprisonnement reste peu fréquent. Il s'agit le plus souvent d'une mesure d'éviction, visant à empêcher l'auteur de se présenter au domicile commun. Cela constitue bien une mesure de protection, encore faut-il que la victime en soit informée, car c'est pendant cette courte période qu'elle court un danger. Sa protection puet aussi être assurée par un hébergement de quelques jours en milieu associatif. Il arrive parfois que l'auteur des violences se présente à l'association, comme l'ont montré quelques situations dramatiques.

Je vous remercie, madame, d'avoir mentionné les avancées de la loi de 2006 qui a été votée à l'unanimité par le Parlement. Il est évident que ce texte a amélioré le dispositif existant, notamment en renforçant le rôle des policiers et des gendarmes, souvent premiers interlocuteurs de la victime.
Le travail de sensibilisation qui a été entrepris donne de bons résultats, mais un certain nombre de victimes disent encore avoir été invitées par les policiers ou les gendarmes à déposer une main courante plutôt qu'une plainte, au motif que cette dernière pourrait ne pas aboutir et finalement se retourner contre elle. Sur le plan des principes, c'est discutable, surtout en présence de violences psychologiques qui sont difficiles à apprécier mais tout aussi dévastatrices.

Je reconnais l'effort accompli par les forces de police et de gendarmerie en matière d'accueil des femmes victimes de violences, mais j'attire votre attention sur le problème que posent les rotations du personnel qui rendent moins efficace la formation dispensée.
La problématique des violences entre époux est abordée par les fonctionnaires de police et de gendarmerie au cours de leur formation initiale. En 2007, l'Observatoire national de la délinquance dénombrait 47 500 faits de violence contre les femmes, ce qui représente le quart de l'ensemble des violences commises sur personne de plus de quinze ans. Chacun d'entre eux y sera donc confronté un jour ou l'autre.
La main courante peut sembler insuffisamment protectrice, mais n'oublions pas qu'il faut toujours tenir compte de la situation, aucune violence n'est semblable aux autres : les victimes, les circonstances, les auteurs sont à chaque fois différents, les policiers le sont également. Cela dit, nous nous référons au code de procédure pénale et aux instructions que nous recevons du ministère de l'intérieur et des parquets, qui, de plus en plus, nous invitent à nous montrer répressifs à l'égard des auteurs de ces violences.
La main courante présente un grand intérêt, car si les violences persistent, elle aura été enregistrée et sera jointe à la procédure. J'ajoute que si nous insistons trop pour que les victimes déposent une plainte sans leur laisser la possibilité de faire une déclaration en main courante, elles risquent de ne rien faire du tout, et aucune trace ne subsistera alors des violences subies !
Certes, il existe encore quelques dysfonctionnements, mais il est vrai aussi que de nombreuses victimes ne savent pas exactement ce qu'elles veulent, que d'autres ont peur de ce qui pourrait arriver… Ces situations ne sont pas simples. Il convient de traiter la question dans son ensemble et d'aider chacune des victimes à prendre la meilleure décision.
Les personnels de police des commissariats parisiens souhaitent qu'il soit fait mention, dans la déclaration de main courante, de la volonté de la victime de ne pas déposer de plainte.
La Fédération nationale des associations d'aide aux victimes d'infractions pénales, dont je suis la directrice, regroupe 148 associations sur tout le territoire, qui ont pour mission d'intervenir auprès des victimes d'infractions pénales.
Je suis d'accord avec le rapporteur, notre dispositif législatif est remarquable. Le problème, c'est qu'il n'est pas appliqué. Il en va ainsi de l'article L. 53-1 du code de procédure pénale, qui énonce clairement que « les forces de police et de gendarmerie doivent donner une information éclairée à tout personne qui se présente » – c'est-à-dire, notamment, leur faire part de la possibilité qui leur est offerte de recourir à une association. Les professionnels de l'aide et de l'accompagnement des victimes savent faire comprendre que déposer une plainte est le début de la réparation et le retour de la liberté. Les représentants de la loi doivent garder à l'esprit que dans les domaines de la famille, du couple et des enfants, il faut faire du « sur mesure ».
Mme Chapalain semble nous dire qu'à partir du moment où la plainte est déposée, tout va bien. Je dirai pour ma part qu'au contraire, tout va mal, car la plainte est le début d'un parcours du combattant !
Je dit que dans ce cas c'est plus « facile » !
En effet, et les difficultés commencent car la victime qui a eu le courage de déposer plainte, se sent responsable – parfois même coupable – d'avoir enclenché une procédure.
Une autre disposition pourrait, si elle était appliquée, aider les victimes : il s'agit de l'article 41-7 du code de procédure pénale qui permet au parquet de saisir une structure habilitée dans le domaine de l'aide aux victimes pour porter aider et assistance aux victimes d'infraction pénales.
Ces deux dispositions doivent être mieux mises en ouevre par les forces de police et de gendarmerie et par le parquet.
Dans les cas de classement sans suite, qui sont très fréquent dans les cas de violences intrafamiliales, il est évident que l'on doit porter aide et assistance à la victime et lui dire que la réponse pénale n'est pas la seule. C'est pourquoi nous avons souhaité, au sein de l'INAVEM, établir des permanences associatives au sein des commissariats et les gendarmeries pour en faire des lieux privilégiés d'écoute et de conseil. Les victimes doivent être prises en charge par les associations le plus rapidement possible et pour une longue durée, en collaboration avec les réseaux spécialisés dans l'hébergement et le retour à l'emploi.

Dans la mesure où vous ne savez pas ce que deviennent les victimes, de quels moyens disposez-vous pour aider ces femmes, qui se sentent harcelées, à s'occuper de leurs enfants et à faire face à leur belle-famille ? Le monde associatif est une réponse mais ce n'est pas la seule. Ne pourraient-elles pas s'adresser à des familles d'accueil ?

Le maintien de la victime dans son logement est essentiel, pourtant sa première réaction est souvent de quitter les lieux pour se réfugier au sein d'une association ou de sa famille. Si son compagnon s'est vu notifier une mesure d'éloignement du domicile, de quels moyens disposent les forces de police pour la faire appliquer? Par ailleurs, il ne faut pas minimiser le rôle de la famille du conjoint : certaines femmes ont été harcelées au point de devoir quitter leur quartier, parfois leur commune.
Je suis amenée à accompagner les femmes victimes de viols et d'agressions sexuelles.
J'ai accompagné une femme dans un commissariat parisien, une note affichée sur le bureau de la policière rappelait qu'une dénonciation mensongère était passible de cinq ans de prison ! Je vous garantis que c'est très dissuasif ! Ce point de notre arsenal juridique doit être revu. En effet, la dénonciation calomnieuse est de droit en cas de classement sans suite, de non-lieu et de relaxe, et le violeur qui l'invoque gagne systématiquement. C'est un frein à la justice ! Il convient de corriger la loi, au moins en faisant en sorte que la dénonciation calomnieuse ne soit plus de droit.
Une autre fois, j'ai accompagnée une femme qui avait été violée par l'un de ses anciens compagnons. En état de choc, elle me téléphone un soir d'un commissariat de police de Seine-Saint-Denis, où elle avait été bien reçue – tout n'est donc pas négatif… Mais ensuite le commissariat l'a adressée aux urgences médico-judiciaires. Dans un premier temps, les urgences refusent de l'examiner à une heure aussi tardive et lui demandent de prendre rendez-vous. Elle se présente donc le lendemain matin, en ma compagnie. Je dois forcer le passage pour l'accompagner auprès d'un premier médecin, qui lui demande de se calmer au motif qu'il est aussi fatigué qu'elle. Lorsque je lui demande sur un ton assez vif s'il a aussi été violé, il menace de nous faire attendre « trois à quatre heures » !
Le deuxième médecin est très gentil, mais ne maîtrise très mal le français. Pour remplir un questionnaire, il est conduit à demander à sept reprises à la victime de préciser les détails du viol, avant de lui donner un seul cachet d'un médicament destiné à la protéger du sida, en lui recommandant de se procurer seule tous les autres.
Cette personne n'a pas été traitée d'une façon correcte. Est-il normal qu'une femme qui a subi un viol se voit infliger des examens gynécologiques dans des conditions pareilles ? L'accueil des femmes victimes de viol ou de violences physiques doit être impérativement amélioré. Les urgences médico-judiciaires de ce secteur emploient trente-sept vacataires, dont les vacations durent de quatre à six heures. L'organisation de ces structures est complexe, car elles dépendent à la fois des hôpitaux et des palais de justice, et plus personne ne semble vouloir assurer leur financement.
Il est question de dépénaliser ou de moins pénaliser les violences intrafamiliales et Mme Alliot-Marie a fait une déclaration en ce sens. Cela m'inquiète beaucoup.
En matière de viol, les dépénalisations sont permanentes. Quant à la loi Perben 2, que nous avions d'abord applaudie comme un progrès, car elle offre aux victimes la possibilité de donner leur avis sur la décriminalisation, il s'avère les faits se retournent finalement presque toujours contre elles. Récemment, pour la première fois, deux faits de mutilations sexuelles, l'un à Paris, l'autre en Seine-Saint-Denis, ont été correctionnalisés sous prétexte que les petites filles ne voulaient pas attaquer leurs parents !
Certes, les crimes correctionnalisés restent dans le champ pénal, mais la loi Perben 2 facilite la correctionnalisation.
La Fédération Nationale Solidarité Femmes regroupe soixante et une associations sur tout le territoire, qui toutes proposent un accueil de jour. Les deux tiers gèrent aussi des foyers d'hébergement, plusieurs d'entre elles assurent la prévention des comportements sexistes en milieu scolaire. Depuis 1992, la Fédération gère le numéro d'appel violences conjugales devenu en 2007 3919.
L'ensemble des associations assurent l'accompagnement global des femmes et les accompagnent dans leurs différentes démarches (dépôt de plainte, tribunal, hôpital, etc.).
En pratique, les fonctionnaires de police acceptent le dépôt de plainte dans les cas de violences physiques avérées, visées par un certificat médical. Cela leur est plus difficile s'il s'agit de violences plus insidieuses. C'est pourquoi le guide de l'action publique a établi un protocole pour décrire la nature des violences en prenant en compte leur contexte et leur antériorité. Il faut, en effet, prendre en compte le contexte global des violences, au-delà de l'acte isolé pour lequel la victime porte plainte. Ce document n'est pas toujours utilisé, pourtant il fournit des éléments utiles lorsque les violences se reproduisent Quant aux violences psychologiques, elles ne sont pas prises en compte dans tous les commissariats.
Notre travail au sein des associations consiste à accueillir les femmes, à les écouter, à leur faire prendre conscience qu'elles sont des victimes et à les aider à se reconstruire. En outre, nous les aidons à effectuer les démarches nécessaires, car nombreuses sont celles qui ont perdu confiance en elles, sont isolées et se sentent incapables de les entreprendre seules. Il faut savoir que 70 % des personnes que nous hébergeons sont mères de famille et se présentent avec leurs enfants en attendant qu'une décision soit prise concernant l'autorité parentalee.
Les associations réalisent un travail constructif au sein des commissariats en assurant des permanences et en sensibilisant les policiers à ce problème. Des progrès ont été fait dans l'accueil.
Par ailleurs, les procédures pénales sont mises en oeuvre plus rapidement – même si nous déplorons encore trop de classements sans suite – mais la sanction pénale qui interdit à l'auteur des faits d'approcher la victime ne concerne pas les enfants. De ce fait, les auteurs des violences retrouvent souvent les victimes et viennent les agresser, dans les permanences des associations et au sein des foyers d'hébergement. Il est difficile d'assurer la protection de la mère et des enfants entre la décision pénale et une éventuelle procédure civile sur le droit de garde et l'hébergement. Récemment, à Bobigny, un père de famille a agressé sa femme et pris de force son enfant à la sortie de l'école, alors qu'il avait été condamné à ne pas approcher la victime, mais il était aussi détenteur de l'autorité parentale.
C'est pourquoi nous proposons que dans les cas de violences grave entre époux, que la victime, mère de famille, ne soit pas tenue, en matière civile, de transmettre l'adresse de son domicile. Cela ne s'applique pas aujourd'hui dans le droit civil lorsqu'il y a les enfants, le père ayant autant de droits que la mère. Nous souhaiterions que la justice prenne en compte lle contexte de violence conjugale et puisse évaluer la dangerosité de l'auteur des violences pour décider provisoirement du maintien ou non du droit de visite.
La réponse pénale est une réponse à ces violences, mais elle ne suffit pas, l'augmentation constante du nombre des délits en témoigne. Les mentalités doivent évoluer, car tant que subsisteront des inégalités entre les femmes et les hommes, la loi ne sera pas appliquée de la même manière pour les unes et pour les autres. Nous avons des progrès importants à faire en termes de formation, de sensibilisation et d'éducation, mais également sur les plans de l'hébergement, de la santé et du travail.

Vous avez souligné à juste titre la relation entre le civil et le pénal et la difficulté qui en découle pour la protection de la femme et de l'enfant.

La question des dénonciations calomnieuses est très importante, mais il faut y parer sans sortir des limites constitutionnelles. En effet, le juge constitutionnel ne saurait admettre que la loi permette au bénéficiaire d'un non-lieu de poursuivre en dénonciation calomnieuse dans tous les cas, sauf dans celui des violences conjugales.
Le texte dispose que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ». Il suffirait de supprimer le mot « nécessairement ».

La solution devra être assez solide juridiquement pour que le résultat ne soit pas contraire à celui que nous souhaitons tous.
Pour ce qui est de la question du logement et de l'éloignement du conjoint violent, nous rencontrons tous des femmes qui ont finalement préféré quitter leur domicile parce qu'il aurait été plus compliqué pour elles d'y rester. La loi ne doit pas s'appliquer seulement pour certaines femmes et quand les circonstances le permettent : il s'agit d'une décision de principe. La victime n'a pas à subir la double peine que représente l'éloignement de son lieu de travail – et, pour les enfants, celui, toujours douloureux et difficile, du changement de leur lieu de scolarité –, sans parler du jugement de sa belle-famille et du voisinage, pour qui son départ prouve parfois qu'elle a quelque chose à se reprocher…
Nous devons trouver ensemble les moyens d'éloigner le conjoint violent. Il est d'ailleurs plus facile de trouver une chambre pour un homme violent qu'un appartement pour une femme accompagnée de plusieurs enfants. C'est précisément pour cette raison que l'intervention des services sociaux désireux de se protéger de difficultés futures peut avoir pour effet que la femme victime soit séparée de ses enfants. C'est là un sérieux motif de préoccupation. Il a été très justement souligné que la prise en charge des auteurs laisse beaucoup à désirer. Il faut à la fois prévenir la récidive et procéder à un travail de reconstruction sociale de la victime dont l'identité est mise à mal.

En effet, peu de choses sont faites du côté des hommes violents et, lorsque c'est le cas, l'approche médicale adoptée n'est pas forcément la meilleure.
Nous intervenons souvent avant que des décisions judiciaires n'organisent le droit de garde, de visite et d'hébergement. L'autorité parentale est alors exercée par les deux parents et nous n'avons, en qualité de travailleurs sociaux, ni la légitimité ni les moyens nécessaires pour assurer la protection des victimes et des enfants, comme nous le font observer les pères qui viennent chercher leurs enfants durant cette période. Ce porte-à-faux peut durer quatre à six mois, voire davantage avec les vacances judiciaires de juillet-août. Nous sommes agréés par l'État pour notre action mais il nous est en principe impossible d'accueillir les enfants tant que le juge n'a pas pris de décision. On parle alors d'enfants « ping-pong », que leur père et leur mère viennent alternativement chercher à l'école. Souvent, la mère retourne au domicile pour leur épargner cette situation.
Les conséquences vont encore plus loin. Hier encore, après avoir accueilli en urgence une jeune mère d'un petit garçon, nous avons été dans l'impossibilité d'inscrire l'enfant dans l'école dont dépend le lieu d'accueil, car le directeur de celle où il est actuellement inscrit a refusé de procéder à sa radiation. Ce directeur y avait procédé dans un autre cas et a fait l'objet d'une plainte de la part d'un père pourtant signalé auprès du juge des enfants pour violences sur l'enfant.
D'importants efforts ont été faits pour l'information des victimes, mais, faute de soutien en amont, notamment de moyens pour l'écoute téléphonique, et de garanties de sécurité en aval, il reste bien des incertitudes quant au traitement des plaintes. Il est satisfaisant qu'elles ne soient moins classées, mais les victimes risquent encore trop souvent de rester seules face à leur agresseur et nous aussi. Certaines directions ont dû aller jusqu'en justice pour défendre les missions qu'elles doivent remplir. A mesure que s'élargit l'accès au droit, nous sommes confrontés à des pères qui utilisent tous les moyens pour récupérer leur conjointe.

Quelles que soient nos interrogations sur les disparités entre les parquets, la description que fait Mme Crépeau de la réception d'une plainte pour coups ou pour violences psychologiques s'accorde mal avec la présentation par Mme Chapalain de la formation des nouveaux policiers... En l'espèce, il est troublant qu'une plainte puisse être rejetée dès le commissariat au motif qu'elle ne concerne que des violences psychologiques et je souhaiterais, madame Chapalain, connaître votre avis de commandant de police sur ce point.
Les trois arrondissements de ma circonscription de Marseille comptent deux commissariats décentralisés, mais 80 % des administrés ne s'y rendent pas, faute d'accès facile par les transports en commun. Si, pour ceux qui font l'effort de s'y rendre, la manière de recevoir la plainte est variable, cela donne raison à Mme Buffet.
La réception des plaintes pour des violences seulement psychologiques – pourtant plus graves parfois que des violences physiques – pose problème. Certains policiers s'y refusent encore et, jusqu'à une date récente – un ou deux ans au plus –, je vous aurais moi-même répondu qu'elle était impossible. La pratique diffère également selon les procureurs. Le procureur de Douai lui-même – M. Frémiot, dont les pratiques innovantes sont bien connues –, refusait encore récemment de prendre en compte les violences psychologiques. Cependant, la situation évolue, car les médecins, notamment ceux des urgences médico-judiciaires, établissent de plus en plus souvent des certificats médicaux faisant état de retentissements psychologiques pour justifier une incapacité de travail temporaire.
Récemment, en réponse à une question parlementaire, la ministre de la justice indiquait clairement que la définition des violences au sens du code pénal comprenait les violences psychologiques. Si la justice accepte cette définition et si la loi pénale prévoit spécifiquement la prise en compte de ces violences, il n'y aura plus de problème et nous n'aurons plus à nous demander si nous pouvons ou non recevoir de telles plaintes. Il importe donc de légiférer pour clarifier cette question.

En 2006, nous avons été plusieurs à proposer, sans succès, que la violence psychologique figure parmi les sources créatrices du droit qui permettraient d'attaquer l'auteur. Le travail que nous sommes en train de faire grâce à vous devrait nous permettre de franchir cette étape.
La plate-forme téléphonique 3919, qui existait auparavant sous le nom de « Violences conjugales – Femmes info service », a été mise en place par les associations. L'État a pris le relais en 2007 en regroupant toutes les plates-formes d'écoute et en donnant les moyens d'une écoute nationale plus calibrée.
Les femmes appellent anonymement et gratuitement. La moitié des appels proviennent de femmes qui n'ont jamais parlé de cette question. Un grand nombre d'entre elles veulent vérifier si elles sont ou non victimes de violences conjugales, car elles souhaiteraient ne pas être concernées. Nous devons donc distinguer les conflits de couple des violences conjugales et nous donnons aux femmes qui nous appellent quelques clés à cet effet. Nous devons aussi les aider à se reconnaître comme victimes qui ont des droits et peuvent s'en saisir pour engager des démarches. Notre travail se situe donc en amont de celui de la police et des associations et consiste, une fois que la victime sait que des gens peuvent l'aider, que la loi est en sa faveur et qu'elle peut demander de l'aide à la police, à l'orienter vers les associations spécialisées par lesquelles nous savons qu'elle pourra être prise en charge.
Cet accompagnement est très lourd. L'accueil de jour et l'accompagnement des victimes auprès de la police, à l'hôpital et au tribunal prennent beaucoup de temps. Les associations sont trop peu nombreuses et débordées d'autant que nous souhaitons que ces accompagnements soient assurés exclusivement par des professionnels qualifiés. C'est pourquoi notre réseau travaille très peu avec des bénévoles – celles-ci doivent en tout état de cause avoir reçu une formation et être professionnalisées, même si elles ne sont pas salariées.
Sur 18 400 appels reçus en 2008, 70 % proviennent des victimes, dont 98 % sont des femmes. 30 % des appels proviennent de l'entourage des victimes – professionnels, famille, amis –, qui demande comment aider ces dernières. C'est souvent après ces appels que la victime elle-même ose appeler.
De très nombreuses femmes souhaitent quitter le domicile et ne croient pas à l'éloignement du conjoint violent. Elles ont encore peur et savent que la police n'a pas les moyens d'intervenir à chaque appel. Le déménagement, même s'il s'ajoute au traumatisme et conduit à un changement d'école qui retentit sur les enfants, permet au moins à la femme et aux enfants de redémarrer dans un nouveau lieu.
Les femmes demandent en priorité à être accueillies dans un centre animé par des professionnels et non dans des familles d'accueil. Sur cinq familles se proposant pour assurer par cet accueil, quatre appels provenaient en fait d'hommes seuls… La Fédération solidarité femmes s'est positionnée contre le recours à des familles d'accueil. La violence des hommes est déjà difficile à gérer dans les centres d'hébergement, mais on y dispose au moins de moyens de protection. Ceux-ci n'existent pas dans une famille qui a elle-même des enfants. Se pose, en outre, une question de légitimité.
Le nombre de femmes faisant état de violences psychologiques augmente considérablement. La plus grande partie de la population française sait désormais que les violences sont punies par la loi. Celles-ci se font donc de plus en plus insidieuses, revêtant par exemple la forme de chantage ou de harcèlement.
Oui, il s'agit là d'une violence psychologique qui a toujours existé.
Par ailleurs, les femmes sont réticentes à être identifiées comme victimes de violences conjugales et minimisent les faits. Elles adoptent le discours de l'auteur, à qui elles trouvent des excuses, et confirment d'une manière ou d'une autre qu'elles ont bien cherché ce qui leur est arrivé. Il nous faut démonter ces mécanismes, ce qui est parfois très long.
Il reste que les associations vers lesquelles nous cherchons à orienter les femmes en vue de leur hébergement souvent ne nous répondent pas, faute de place.
Notre association a deux activités. La première est celle d'un centre d'hébergement ; l'autre consiste en un service d'aide aux victimes, créé en 1989 et en un centre de documentation spécialisé sur la question des violences, notamment conjugales et intrafamiliales.
Dans le cadre du service d'aide aux victimes, nous intervenons au commissariat de Villeurbanne, dans des locaux de la maison de justice et du droit de Villeurbanne mis à notre disposition par la municipalité et au siège de notre association. Nous proposons aux femmes et aux jeunes victimes de violences un accueil spécifique qui reçoit 98 % de jeunes femmes ou de jeunes filles.
Des améliorations sont encore sans doute nécessaires sur le plan législatif. Les avis de classement sans suite ne sont pas toujours envoyés et les trames d'entretien évoquées par Mme Chapalain ne sont pas toujours employées par les services de police lors du dépôt de plaintes. J'ignore si l'on peut savoir combien de commissariats en France y ont recours. À Villeurbanne, ce qui compte est surtout d'assurer le plus rapidement possible l'accueil du plaignant par des policiers qui manquent de moyens. Nous organisons chaque année pour la préfecture trois ou quatre stages de formation interdisciplinaire de deux jours, avec des policiers et gendarmes, sur le thème des violences conjugales. Ces stages permettent aux professionnels de se rencontrer et d'adopter ultérieurement une autre dynamique de travail et de partenariat. Nous insistons systématiquement sur cette trame d'entretien et les participants sont très intéressés par l'usage qu'ils pourront en faire avec les victimes.
Plus globalement se pose la question de l'évaluation des situations. Malgré les progrès législatifs accomplis, de nombreux professionnels manquent de formation, qu'il s'agisse des réseaux associatifs – et même du nôtre, qui travaille depuis trente ans exclusivement sur cette problématique – ou des policiers et gendarmes, même si leur formation initiale prévoit certains éléments dans ce domaine.
Notre association a été un lieu de stage de découverte de deux mois pour les élèves de l'École nationale de la magistrature. Ce stage a été supprimé et les futurs magistrats n'ont plus désormais affaire, au cours de leur formation, qu'à des dossiers ou, au mieux, à des situations judiciaires dont l'instruction ou l'enquête ont déjà abouti. Avec nous ils passaient deux mois à plein temps sur le terrain et découvraient la réalité à laquelle sont confrontés les victimes de violences.
Certes, nous observons des évolutions depuis trente ans mais les moyens dont disposent les structures associatives et étatiques pour appliquer ces lois et leur efficacité en la matière ne sont pas à la hauteur. Le traitement des affaires en temps réel est, il est vrai, très difficile. Le plus souvent, les magistrats doivent prendre des décisions en communiquant par téléphone avec un gendarme ou un policier lui-même parfois tétanisé à l'idée d'appeler le Parquet. Le magistrat dispose de l'audition de l'auteur et de celle de la victime, parfois d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail – que la loi n'exige pas –. Il dispose rarement d'éléments relatifs au contexte ou à l'antériorité des faits de violence car il s'agit souvent d'une première plainte – étape difficile, qu'il a parfois fallu des années pour accomplir. Ainsi, les magistrats n'ont pas les moyens de l'évaluation et, dans de tels cas – c'est du moins ce qui arrive au TGI de Lyon –, de nombreuses plaintes se concluent par des mesures alternatives aux poursuites.
Pour ce qui est des interventions auprès des auteurs, je précise que notre service adhère à l'Institut national d'aide aux victimes à Paris, et à Citoyens et justice à Bordeaux. Dans le cadre de ce dernier réseau, nous participons à un groupe ressource sur les violences conjugales, dont nous assurons d'ailleurs la présidence. Nous sommes donc bien informés des initiatives mises en oeuvre dans notre pays en direction des auteurs, du moins au sein de cette fédération. À Marseille, par exemple, est menée une expérience très intéressante d'enquête sociale rapide, spécifique aux violences conjugales, destinée à donner au magistrat d'autres éléments pour prendre sa décision d'opportunité des poursuites. De telles actions demandent du temps et des moyens. Ainsi les cours d'appel doivent payer des missions socio-judiciaires aux associations. Il serait utile de recenser toutes les initiatives existantes, dont le manque de moyens limite l'efficacité.
Pendant la garde à vue. J'ajoute que les femmes victimes de violences sont parfois encore orientées vers des mains courantes. Certaines d'entre elles ont besoin d'être accompagnées avant même d'accomplir cette première démarche. D'autres se plaignent de ce que le secteur de gendarmerie dont elles dépendent n'utilise pas cette procédure. Nous sommes en contact avec des femmes qui ont vécu chez elles des choses terribles et qui ne veulent plus y vivre. Dans un domaine aussi complexe, les lois devraient pouvoir s'appliquer sans systématisme, ce qui suppose que les magistrats aient les moyens de l'évaluation.

Nous devrions étudier les moyens de généraliser par la loi l'enquête sociale rapide, même si celle-ci exige des moyens.
Les réponses doivent effectivement être variées. En Seine-Saint-Denis, j'ai tenté d'expérimenter, avec certains bailleurs, le transfert des locataires au sein d'un même parc immobilier sans perte du bail ou avec un bail établi au nom de la femme s'il était précédemment aux deux noms. Cette procédure épargne aux femmes la recherche d'un logement. Peut-être faudrait-il systématiser l'engagement des bailleurs, dont certains possèdent aujourd'hui un patrimoine très important et géographiquement diversifié.
Enfin, à côté du rôle essentiel des associations, il faut citer celui de l'État et de ses fonctionnaires. Quel devrait être l'engagement de l'éducation nationale en matière de formation et d'information en ces domaines ? L'âge de plus en plus précoce auquel on observe la violence et les pressions psychologiques est préoccupant et il nous faut travailler sur ce point.

Toutes les enquêtes montrent en effet une violence assez inattendue envers les filles de la part d'adolescents relativement jeunes.

Pouvez-vous, malgré l'anonymat, apprécier le niveau social des personnes qui vous appellent – qui, malgré ce qu'on croit parfois, ne se situent pas seulement au bas de l'échelle sociale ? Quelles sont, par ailleurs, les questions que posent les 2 % d'hommes que vous avez évoqués et les problèmes qu'ils rencontrent ? Que révèle le suivi des appels ? Vos correspondants vous appellent-ils plusieurs fois ? Quelle est, enfin, la vitesse de réaction de la justice ?
La plate-forme nationale d'écoute nous confirme que la violence conjugale concerne toutes les couches de la société. Dans le centre d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences où j'ai travaillé pendant vingt ans, la plupart des familles connaissaient aussi un problème de précarité. Au téléphone, nous recevons des appels de femmes de tous les milieux. Les chiffres par catégorie socioprofessionnelle reflètent la réalité de la population française. Les femmes victimes de violence sont aussi nombreuses dans les classes populaires que dans les milieux aisés. En revanche, dans les milieux aisés, les violences sont plus souvent psychologiques.
Parmi les 2 % d'hommes qui nous appellent, certains le font pour plaisanter ou pour s'informer, et il nous faut donc avant tout évaluer s'il s'agit réellement de victimes. Nous observons aussi que certains hommes qui se présentent comme victimes sont en fait des auteurs. Quant aux hommes victimes, ils présentent les mêmes caractéristiques que les femmes en termes d'estime de soi et craignent souvent de faire du mal à leur conjointe. Cela concerne, au demeurant, un très petit nombre d'appels.
Les deux. Cela met à mal l'idée préconçue que l'on frapperait parce qu'on est le plus fort : l'auteur commet des violences parce que la société et la culture ambiante l'autorisent.
Certaines victimes nous appellent plusieurs fois. En effet, tout en les orientant systématiquement vers une association, nous leur indiquons aussi qu'elles peuvent nous rappeler, car nous savons bien qu'elles auront peut-être besoin de le faire plusieurs fois avant d'entamer une démarche suivie. Cela ne concerne cependant qu'une petite minorité des appels.

Comme bon nombre de mes collègues ici présents, je reçois de toute la France de nombreux courriers, émanant de personnes qui, sachant que ces questions font désormais l'objet d'un intérêt public et que nous sommes chargés de les examiner, nous font part ce qu'elles vivent. Cela témoigne également d'une libération de la parole.
Au vu de votre expérience, le travail que la société a commencé à faire sur elle-même et cette libération de la parole se traduisent-ils par une diminution du phénomène ? Selon moi, si l'on parle aujourd'hui davantage des violences, ce n'est pas tant parce qu'elles seraient plus nombreuses que parce que leurs victimes sentent qu'elles peuvent désormais en parler et que leur démarche aura des suites.
Je dirige le centre d'hébergement de l'association VIFF SOS Femmes. Ce centre – l'un des premiers en France, créé à l'initiative de Mme Pascale Crozon – accueille les femmes dans des logements, selon une structure éclatée visant à éviter l'effet de ghetto et s'attache à apporter une réponse complémentaire à celle des structures collectives existantes. Cette forme d'hébergement permet à des mères accompagnées de grands enfants de quitter le domicile, alors que les limites d'âge imposées – on est considéré comme grand à partir de 13 ans – se traduisent ordinairement par un placement et donc par l'éclatement de la famille.
La question des enfants devrait être abordée plus systématiquement en cas de référé, lorsque des décisions doivent être prises en urgence pour autoriser une victime de violences à quitter le domicile. De fait, dans l'agglomération lyonnaise, il faut parfois attendre quatre à six mois une décision de la chambre de la famille.
L'idée selon laquelle un homme pourrait être « mauvais conjoint, mais bon père », encore répandue en France, doit être remise en cause. Au Canada, où l'on a constaté depuis longtemps que les pressions morales et psychiques augmentaient à mesure que la violence physique était interdite et condamnée, un père maltraitant envers la mère de ses enfants est considéré comme un père maltraitant envers les enfants eux-mêmes.
Il conviendrait de signifier au père, dès le départ de sa conjointe, que ses actes ont aussi touché ses enfants. Le fait que les conjoints violents puissent dire – dans le meilleur des cas – qu'ils n'ont « rien à faire » du départ de leur conjointe, mais qu'ils ont encore des droits sur leurs enfants montre aux petits garçons que la société admet le droit du plus fort. Le fait qu'un homme puisse venir récupérer ses enfants dans un centre d'hébergement sape la confiance chez toutes les femmes hébergées. Une position plus ferme est donc nécessaire pour ce qui concerne les enfants, et plus encore lorsque les enfants eux-mêmes sont victimes – notamment lorsque des garçons adolescents tentent de s'interposer pour protéger leur mère. Les femmes en seraient bien plus encouragées à exercer leur droit à porter plainte.
Si elle doit être proposée et facilitée, la mesure d'éviction du conjoint violent ne doit pas être systématique. Cette mesure peut éviter un départ en urgence de la victime et sa prise en charge par le SAMU social. Les modalités d'accueil de ce dernier sont très insuffisantes en raison de la fermeture du dispositif durant la journée qui contraint les femmes à faire le tour de la ville avec leurs enfants. Les villes qui ont la chance de disposer d'un accueil spécifique sont rares et les places y sont très peu nombreuses. Au demeurant, la majorité des femmes concernées ne souhaitent pas rester dans leur logement, où elles ont vécu des choses difficiles et où elles subissent le regard des voisins, voire l'emprise de la famille, ce qui leur rend presque impossible de recommencer une autre vie. En outre, le comportement de l'homme violent, souvent lié à un territoire, peut être exacerbé par la perte de celui-ci. Peut aussi se poser la question du coût du logement, parfois hors de portée de la femme qui se retrouve seule, notamment dans les milieux moyens et favorisés.
Aider les femmes et les enfants à recommencer leur vie ailleurs pose encore la question des places en centre d'hébergement. Souvent, les femmes ne portent pas plainte parce qu'elles n'ont aucune assurance d'avoir pu quitter le domicile lorsque leur conjoint recevra la convocation. L'exemple de la loi DALO montre que les meilleures idées se heurtent parfois à la réalité. Les logements sociaux sont peu nombreux et les femmes victimes, ne sont pas plus prioritaires que les occupants de logements indignes ou les personnes qui sont à la rue. L'IGAS a déjà consacré un rapport à cette question et a consulté notre association à ce propos.
La durée moyenne de séjour dans les centres d'accueil est passée de neuf mois à deux ans, voire deux ans et demi. Les sorties sont paralysées, car les bailleurs sont peu enclins à accueillir des mères de famille dont les enfants adolescents font peur dans les cages d'escalier. Or, moins les sorties sont rapides et plus le secteur de l'urgence est embouteillé. Ainsi, alors que notre connaissance de la problématique progresse, que les professionnels – y compris les policiers, dont ce n'était pas le métier de base – se forment, que les juges prennent en compte ces questions et que la réponse sociale se développe les femmes ne sont toujours pas des citoyennes de plein droit, car ce n'est pas être citoyenne que de devoir passer quatre ans dans un centre d'hébergement pour avoir osé dénoncer les violences dont on a été victime. À tout prendre, quand on s'occupait moins de ces questions, les femmes retrouvaient plus vite leur place de citoyennes !
L'insuffisance du logement social est une question majeure. Si les femmes avaient la garantie d'obtenir un logement, elles dénonceraient bien plus vite les violences, sans avoir peur d'être à la rue et d'entraîner leurs enfants dans ces difficultés. On a vu des pères obtenir la garde des enfants pour ne pas les faire changer d'école et parce qu'ils avaient un salaire, alors que leur mère ne pouvait leur garantir un toit. Les femmes sont confrontées à une triple victimisation. Cela ne se produisait pas quand l'emploi et le logement étaient un peu moins difficile et que ces questions faisaient l'objet d'un peu plus d'engagement.
En termes de moyens, l'écoute téléphonique, qui est l'une des premières possibilités offertes aux femmes d'être entendues et de voir s'ouvrir des portes, n'est pas financée. Les heures que nous consacrons au 3919 sont prises sur l'accompagnement social des personnes hébergées. C'est du bricolage associatif.
Même s'il est normal de donner la priorité aux familles en grande précarité, il n'en est pas moins préoccupant de constater que les femmes de milieux moyens et supérieurs sont moins nombreuses à solliciter notre intervention. C'est sans doute ce qui explique la multiplication des violences sur enfants dans des situations de huis clos familial qui perdurent. Si cet aspect du problème n'est pas réglé, les progrès accomplis par ailleurs resteront vains.
Je reviendrai d'abord sur la question des enfants et des visites. En Seine-Saint-Denis, nous organisons une manifestation chaque fois qu'une femme est tuée par son compagnon. Nous avons travaillé sur 24 homicides : dans la moitié des cas, l'assassinat de la femme avait lieu pendant l'exercice d'un droit de garde, devant les enfants ; dans un bon tiers des cas, la situation de violence était déjà connue de la justice et l'assassin avait déjà été jugé et condamné pour des faits de violence – mais il n'en avait pas moins le droit de visite… En Suède, les visites sont organisées dans des lieux de médiation accompagnée : un éducateur va chercher l'enfant au domicile de la mère, parle avec lui pendant le trajet et le ramène après la visite, ce qui permet de voir comment l'enfant vit cette situation et de sécuriser les visites. En France, les lieux de médiation ne sont pas sécurisés et sont dangereux. Les visites organisées devant le commissariat sont horribles et ne sont pas moins dangereuses, car l'homme peut fort bien attendre la femme au coin de la rue pour l'abattre. La dangerosité de ces hommes doit être sérieusement évaluée. Le port de bracelets avait été envisagé. On devrait, en tout cas, pouvoir s'assurer qu'ils ne sont pas là où ils ne doivent pas être.
Quant à savoir si le nombre de ces situations augmente ou diminue, il est encore trop tôt pour le dire. Selon l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes réalisée en 2000, les deux tiers des femmes évoquant des violences le faisaient pour la première fois devant l'enquêtrice. En 2006, une enquête a été menée en Seine-Saint-Denis par Maryse Jaspard, qui a interrogé 1 566 jeunes filles de 18 à 21 ans, soit la classe d'âge précédant celle qui avait fait l'objet de l'enquête de 2000. 23 % de ces jeunes filles ont déclaré avoir subi des violences physiques graves – coups, tentative de meurtre ou séquestration – et, pour les deux tiers, avant 16 ans, commises par un adulte de la famille. Treize pour cent d'entre elles ont déclaré avoir subi des agressions sexuelles et, dans deux tiers des cas, avant l'âge de 16 ans et de façon répétée de la part d'un adulte de la famille. Dans les deux tiers des cas, ces jeunes filles avaient déjà parlé. On constate ainsi que, six ans plus tard, grâce peut-être à l'important travail de sensibilisation mené en Seine-Saint-Denis – et sans doute aussi dans la population générale –, les femmes parlent davantage des violences subies.
J'ajoute que, parmi les deux tiers de victimes frappées ou agressées sexuellement de façon répétées par un adulte de la famille, celles-ci déclarent souffrir d'une maladie chronique trois fois plus souvent que dans la population générale ;15 % se trouvent en mauvaise santé contre 3 % dans la population générale ; 34 % déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide contre 6 % dans la population générale et 50 % déclarent ne pas utiliser de préservatif quand elles ont des rapports sexuels, ce qui représente le double de la proportion observée chez les autres femmes. Elles sont, en outre, trois fois plus nombreuses à avoir subi une nouvelle violence et à avoir déjà commis un acte violent. Un grand nombre de ces jeunes femmes avaient déjà subi des violences de la part de leur compagnon : le risque de rencontrer un homme violent est ainsi trois fois plus important pour les femmes qui ont été battues dans l'enfance et cinq fois plus important pour celles qui ont été agressées sexuellement dans l'enfance de façon répétée. Il faut donc penser la violence conjugale à l'échelle transgénérationnelle.
Les enfants victimes de la violence conjugale apprennent ainsi comment on traite sa femme. Je participe à la réparation pénale d'agresseurs sexuels « légers » – qui n'ont en fait de léger que leur âge, car les agressions commises sont graves. Entre 1997 et 2000, nous en avons rencontré 119 en prison : tous avaient subi, avant d'être criminels ou violeurs, des violences sexuelles graves, de la maltraitance ou un abandon grave de la mère, ou venaient d'un pays en crise où ils avaient assisté ou participé à un massacre ou connu une mort violente autour d'eux. En outre, pratiquement tous ont vu leur père frapper leur mère. Quand il n'y a pas de poursuite, ils sont aussi témoin de cette impunité totale.
Si l'on cherchait à savoir quelle violence subissent ou à quelle violence assistent ces enfants violents, on saurait mieux comment les prendre en charge. Nous avons accordé une grande attention à cette question dans notre département et c'est précisément le message que portent les affiches que nous avons diffusées : un dessin d'enfant représentant un homme qui bat sa femme et désignant la scène comme de la maltraitance. Un homme qui bat sa femme, ou qui même se contente de l'insulter, ne peut pas être un exemple pour ses enfants. À cet égard, une révolution culturelle est nécessaire dans les milieux médicaux. En effet, très fréquemment la violence physique commence pendant la grossesse et augmente avec son déroulement, mais personne ne s'en préoccupe. Quand la femme s'en va, l'homme continue à l'attaquer par le biais des enfants, mais on continue à lui confier ces mêmes enfants au nom du droit sacro-saint des parents biologiques. Quand nous avons besoin de mettre ces enfants à l'abri, nous n'en avons pas les moyens car ils relèvent de l'autorité parentale exercée par leur père. Nous avons à cet égard une vraie responsabilité. Le Collectif féministe contre le viol demande que l'autorité parentale soit systématiquement retirée au père violeur.
Par ailleurs, il n'est pas normal qu'en cas de meurtre de la mère par le père, que l'enfant soit, deux fois sur trois, confié à la famille de son père. En effet, l'homme violent ayant souvent commencé par prendre soin d'isoler sa femme : à la mort de celle-ci, les enfants sont confiés à la grand-mère paternelle, qui leur explique fréquemment que c'est à cause de leur mère qu'ils sont contraints d'aller voir leur père en prison… Je rappelle à ce propos que, lorsqu'on assassine sa femme, on en hérite, au détriment de ses enfants et beaux-enfants ! Peut-être une action législative serait-elle bienvenue en la matière.
Le logement et l'hébergement sont un problème prioritaire. En région parisienne les centres d'hébergement sont saturés. La durée de séjour de six mois est multipliée par trois faute de sorties et certaines femmes victimes de violences sont même en situation d'errance, faute de solutions d'hébergement. À l'exception des Yvelines, les départements de l'Île-de-France possèdent des structures d'urgence, mais celles-ci sont largement insuffisantes. La réponse est certes difficile, car il existe plusieurs publics prioritaires. Des solutions devraient être possibles grâce à un partenariat avec les bailleurs et avec les maires des communes. Il faut, en effet, surmonter l'attitude des bailleurs qui considèrent les femmes victimes de violences comme des sources de troubles de voisinage. Il arrive aussi, en amont, que les femmes découvrent qu'elles ont une dette de loyer à régler pour pouvoir résilier leur contrat et obtenir un logement. Ces démarches prennent parfois des mois.
La réduction des inégalités, la prévention des comportements sexistes sont des moyens pour éradiquer les violences faites aux femmes, ils supposent un travail sur les représentations sociales de l'homme et de la femme. Lors de mes interventions en milieu scolaire, je suis effarée par les stéréotypes et les préjugés qui me donnent l'impression de revenir une génération en arrière. Notre travail consiste à déconstruire ces stéréotypes. Des associations interviennent depuis plusieurs années dans les établissements scolaires et auprès de jeunes, parfois de parents et des acteurs de l'éducation.
Ce travail au niveau de l'éducation nationale demande une volonté politique forte et des moyens pour faire appliquer les circulaires, c'est indispensables pour faire reculer la violence. Je précise à ce propos que nous ne sommes pas financés par l'éducation nationale, mais par les communes, au titre de la « politique de la ville ».

C'est en effet essentiel. Une enquête récente réalisée auprès des jeunes adolescents a montré que l'objectif des filles de neuf ans est de plaire à leur amoureux. Cela ne témoigne pas d'un grand progrès de la société.
Souvent, les femmes dont le conjoint a été éloigné du domicile, au pénal ou au civil, se sentent coupables et le recherchent. Il faudrait étudier de plus près les raisons pour lesquelles dans le cas de l'éloignement du conjoint violent, il y a rarement récidive : en réalité, de nombreuses femmes dont le conjoint a été éloigné déclarent qu'elles ne déposeront plus jamais plainte. Il est donc primordial d'organiser la prise en charge de la femme victime quand le mari est éloigné du domicile. Une fois prise la décision d'éloignement, il doit y avoir un contrôle judiciaire socio-éducatif étroit de l'auteur, doublé d'un accompagnement social et psychologique.
Les alternatives aux poursuites, que j'ai déjà évoquées, sont peut-être inévitables, mais les professionnels, notamment les délégués du procureur et les médiateurs, ne sont pas formés à ces questions – sans parler des problèmes que posent les médiations pénales qui doivent aboutir coûte que coûte.
Je tiens aussi à évoquer aussi le cas des jeunes femmes victimes, de la part de leurs frères, oncles ou parents, de violences liées à des choix de vie, notamment aux mariages forcés. Les statistiques les font apparaître en croissance exponentielle. Or nous ne parvenons plus à obtenir de protections jeune majeur pour les nombreuses femmes, de plus en plus jeunes, qui sont victimes de violences de la part de leur « copain » – ce n'est guère possible que pour celles qui sont suivies depuis longtemps par des éducateurs, et encore est-ce très difficile à mettre en oeuvre.
Après 18 ans, la protection jeune majeur n'est pas de droit.
On nous répond même parfois que ces jeunes filles, nées en France, peuvent bien dire « non » à leurs parents !
Je voudrais préciser que le nombre des décès au sein du couple rapporté par l'enquête nationale que nous effectuons sera plus élevé en 2008 qu'en 2007. Par ailleurs, le chiffre de 47 500 faits de violences paraît particulièrement élevé mais cela peut en partie tenir au fait que la loi de 2006 impose désormais de prendre en compte les anciens concubins et pacsés.
Je fais partie d'un groupe de travail sur les hommes violents créé par le service du droit des femmes et auquel ont participé plusieurs ministères. Un bilan a déjà été réalisé et le groupe s'emploie à mettre en place un label de qualité à l'intention des associations travaillant dans ce domaine.
Ceux de toutes les associations – en fait, elles ont peu de moyens. Au demeurant, l'action en direction des hommes violents est plutôt de l'ordre du suivi psychologique que de l'hébergement, car les hommes sont souvent mieux lotis que les femmes en la matière.
En matière de logement, une démarche intéressante a été suivie en Île-de-France pour les 266 femmes battues qui, chaque année, dans cette région, ne trouvent pas de solution à leur problème de logement : le Conseil régional a adopté, lors du vote de son budget 2009, un dispositif d'aide simple consistant à mettre à la disposition des femmes victimes résidant dans les centres d'hébergement les 150 à 200 logements qui ne trouvent pas preneur parmi ceux que la région, en tant qu'employeur, réserve à ses propres agents. Les bailleurs sociaux ont des représentations négatives à propos des femmes battues, qu'ils considèrent comme dépourvues de ressources suffisantes et susceptibles de provoquer un trouble à l'ordre public si leurs conjoints les retrouvent.
C'est pure affaire de représentation. En effet, les problèmes de voisinage et d'endettement étaient bien plus aigus lorsqu'il y avait des difficultés dans le couple. Une enquête que nous avons réalisée montre que ces familles étaient capables d'habiter des logements sociaux et que le premier souci de ces femmes était d'assurer un toit à leurs enfants. Les impayés sont très rares – en partie aussi, certes, parce que nous sommes garant moral et sommes donc très attentifs à ce que tout se passe bien. En effet, nous savons que d'éventuels problèmes nous empêcheraient de nous adresser à nouveau aux mêmes bailleurs.

Le sens de ma question était plutôt de savoir si vous observez que les femmes victimes de violences manquent plus que d'autres de ressources propres faute de métier et de salaire,.
C'est en effet le cas de celles que nous hébergeons, car nous donnons la priorité à celles se trouvant dans les situations les plus difficiles, mais cela fausse l'observation. L'une des missions des centres d'hébergement est d'accompagner les femmes vers l'insertion professionnelle. Ainsi, l'an dernier, lors de leur sortie du centre d'hébergement, toutes les femmes avaient un emploi. Elles savent qu'elles doivent impérativement subvenir aux besoins de leurs enfants. Bien évidemment, plus la situation de l'emploi est difficile sur le territoire national, plus leurs emplois seront précaires. Les prestations familiales les aident aussi à faire face aux dépenses de loyer.
Il faudrait que le changement de bail au nom du mari intervienne le plus rapidement possible – par exemple devant le juge aux affaires familiales, lorsque les femmes victimes maintiennent leur décision de séparation ou de divorce –, afin que le mari en assume seul la responsabilité. Il arrive en effet que des jeunes femmes arrivées au centre d'hébergement sans aucune dette de logement se trouvent solidaires, au bout des deux ans de la procédure de divorce, d'une dette considérable accumulée, à raison de 500 ou 600 euros par mois, par leur conjoint qui n'a plus droit à l'APL. Mme Vautrin a déjà proposé aux bailleurs sociaux d'étudier ces situations. Dans le territoire lyonnais les décisions sont très inégales. Certains bailleurs sont attentifs à ce problème tandis que d'autres refusent de le prendre en compte sachant que ces femmes, étant à la recherche d'un logement, seront conduites à payer la dette pour pouvoir l'obtenir. Peut-être la loi pourrait-elle tenir compte de ce problème. Il faudrait au moins mettre en place une sorte de charte de bonne conduite, car le fait d'être redevable du loyer d'un logement qu'on a dû quitter est encore une forme de victimisation.
Pour avoir travaillé à l'insertion professionnelle des femmes victimes de violences conjugales, je confirme que l'attention apportée à ces femmes par les institutions publiques est insuffisante. Il importe de sensibiliser à leur situation les agents de l'emploi et d'assurer à ce corps la formation nécessaire. Le parcours professionnel d'une femme battue doit être abordé en tenant compte de ses spécificités, d'autant que l'emploi est l'une des démarches qui permet la reconstruction des personnes et leur indépendance économique.

Il faut favoriser ces démarches. Le relais de Sénart, dont je suis l'un des vice-présidents, a mené en l'espèce une action très positive, qui montre à quel point ces femmes peuvent se reconstruire grâce à une formation professionnelle.
Je souhaiterais savoir si vous pouvez déjà mesurer les conséquences de la disposition très importante de la loi de 2006 portant l'âge nuptial des jeunes filles de 15 à 18 ans. En effet, – et bon nombre de mes collègues l'ignoraient –, dans la France de 2006, un garçon ne pouvait pas se marier avant 18 ans, mais une fille pouvait le faire dès 15 ans.
Je m'occupe d'une campagne de prévention des mariages forcés en Seine-Saint-Denis. En effet, si le mariage civil n'intervient plus avant 18 ans, il a encore lieu chez l'imam ou au pays. Le problème se pose pour les femmes originaires d'Afrique subsaharienne désirant continuer les pratiques en matière de mutilation sexuelle, elles font preuve d'une très grande adaptabilité face à l'évolution des lois. La mutilation à un très jeune âge a été abandonnée du fait de la vigilance de la protection maternelle et infantile. Elle a ensuite été pratiquée entre 7 et 9 ans, à l'occasion du retour au pays. Les institutrices ayant constaté des changements dans l'attitude des enfants et procédé à des signalements, la pratique a encore changé. Elle consiste désormais à déscolariser les filles en fin de CM2 et à les renvoyer au pays, où elles sont mutilées et mariées de force, avant de revenir enceintes à 15 ans et demi pour accoucher avant 16 ans d'un enfant qui sera français, puisqu'elles sont elles-mêmes françaises. Personne ne semble se soucier du fait que l'exeat n'a pas été signé et que ces enfants ont quitté le primaire sans aller au collège. Il m'a fallu, quant à moi, rencontrer trois de ces jeunes filles abîmées et ne parlant presque plus le français pour comprendre cette situation, après les avoir prises, dans un premier temps, pour des primo-arrivantes…
Face à des pratiques archaïques remarquablement adaptables, j'ai donné pour consigne, dans les maternités du département, de signaler toutes les jeunes femmes mineures qui accouchent, car on n'a pas le droit de mutiler une mineure. C'est ensuite à la police de voir où elles sont nées et où elles ont été mutilées. L'enquête nationale sur la mutilation, dont les résultats seront connus prochainement, montrera que 10 % des jeunes filles sont mutilées sur le territoire national : il n'est même plus nécessaire de partir en vacances !
J'ai rencontré la semaine dernière encore, une jeune fille de moins de 17 ans qui m'a annoncé qu'elle allait se marier « comme au pays ». Personne ne semble gêné par l'obligation théorique de ne pas procéder à un mariage religieux avant le mariage civil. Cette question mériterait pourtant examen.

Vos témoignages montrent que, si les textes couvrent assez bien les problèmes qui se posent, la réalité vécue appelle un travail sur les moyens et sur l'évaluation des différents dispositifs.

Je tiens, mesdames, à saluer la qualité de vos expertises et du travail que vous réalisez sur le terrain.