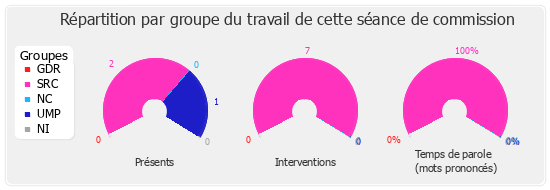Délégation aux droits des femmes et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Séance du 13 décembre 2011 à 17h00
La séance
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'audition du Syndicat national des chirurgiens orthopédistes : professeure Patricia Thoreux, chirurgien orthopédiste, professeur Alain Sautet, chirurgien orthopédiste et secrétaire général de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT), et Mme Aurore Debet, chirurgien orthopédiste.
La séance est ouverte à dix-sept heures trente.

Je souhaite la bienvenue à Mme la professeure Patricia Thoreux, chirurgien orthopédiste, M. le professeur Alain Sautet, chirurgien orthopédiste et secrétaire général de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT), ainsi qu'à Mme Aurore Debet, chirurgien orthopédiste. Je salue également la présence de plusieurs élèves de classe de troisième qui, dans le cadre d'un stage d'observation qu'ils effectuent pendant une semaine, assisteront à une partie de cette séance.
Alors que cette législature s'achève, la Délégation aux droits des femmes a souhaité réfléchir à l'exercice, par les femmes, de ces métiers que l'on dit d'hommes et aux difficultés qu'elles peuvent ou non y rencontrer. Comment leur intégration s'est-elle donc accomplie ? En l'occurrence, Mesdames, Monsieur, quel est le pourcentage de femmes qui exerce votre spécialité ?
Je précise qu'en ce qui me concerne, j'exerce dans un hôpital universitaire et que j'assume également des fonctions d'enseignement et de recherche.
Contrairement à d'autres pays européens, et, notamment, à l'Allemagne, notre spécialité implique à la fois l'exercice de la traumatologie et de la chirurgie de l'appareil locomoteur liée à des maladies chroniques comme, par exemple, l'arthrose.
M. Alain Sautet, professeur, chirurgien orthopédiste, secrétaire général de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT). Le ministère de la santé, Madame la présidente, fait état d'un pourcentage de 3,5 % de femmes dans notre profession mais ce chiffre date un peu puisque, au cours de ces dix dernières années, les études de médecine se sont considérablement féminisées au point que les jeunes femmes représentent aujourd'hui presque 75 % des étudiants. De plus en plus de femmes, dès lors, seront amenées à exercer des spécialités considérées comme pénibles : chirurgie, anesthésie, gynécologie-obstétrique.
Je précise, de surcroît, que la formation d'un chirurgien implique sept années de médecine, cinq ans d'internat et deux ans de post-internat. La statistique, reflétant la situation actuelle, vise des personnes qui ont commencé leurs études il y a plus de treize ans et ne peut donc pas tenir compte de la féminisation en cours.
Quoi qu'il en soit, les jeunes hommes préfèrent choisir d'autres métiers et la médecine, pour eux, est devenue moins attractive qu'elle ne le fut.
Je précise, quant à moi, que j'exerce principalement dans une clinique privée.
Les femmes ne sont pas très représentées dans la chirurgie orthopédique : sur 3 500 chirurgiens, ce qui n'est pas beaucoup, nous nous connaissons toutes ; le taux progressera, certes, mais nous sommes encore loin de la parité femme-homme.

Il en est de même, je crois, dans la chirurgie cardiaque et cela semble globalement valable pour l'ensemble des spécialités chirurgicales.
Connaissez-vous la vie que mène un chirurgien ? Lorsque j'étais interne, j'assumais en général dix gardes par mois puis, en tant que chef de clinique, dix gardes sur place - je passais donc 24 heures à l'hôpital un jour sur trois, soit, le tiers d'une année.
Et il fallait enchaîner avec le travail du lendemain puisqu'il n'était pas question, alors, de repos de sécurité ou d'aménagement du temps de travail.
Un tel rythme, pendant sept ans, n'est guère propice à l'organisation de la vie familiale et les femmes qui ont des enfants doivent être très aidées pour se permettre d'être absentes une nuit sur trois. Ce métier, en effet, est extrêmement pénible, avec de nombreuses nuits sans sommeil que nous passons au bloc opératoire ou aux urgences. Cela est bien entendu le cas pour l'ensemble des activités chirurgicales.
Lorsqu'une femme choisit de devenir interne et qu'elle est déterminée et volontaire, elle y parvient. En outre, des changements ont eu lieu : les gardes sont moins nombreuses, y compris les gardes sur place – nous nous sommes en effet rendus compte qu'il n'était pas forcément utile que les chirurgiens dorment à l'hôpital. La charge de travail a donc été modifiée même si l'internat demeure difficile et nécessite, il est vrai, d'être aidée.
Mère de deux enfants, j'ai accouché de l'un d'entre eux durant mon internat, période où je devais faire des gardes, et je suis donc parvenue à mener de front ma vie professionnelle avec ma vie de femme et de mère en étant aidée par ma propre famille ainsi que par mon mari, qui est d'ailleurs lui aussi chirurgien.
Une femme ne doit pas se laisser abuser par une vision exclusivement masculine de la chirurgie. Le parcours est difficile et semé d'embûches mais on y arrive. Peut-être parviendra-t-on d'ailleurs, progressivement, à faire en sorte que les jeunes internes soient peut-être un peu plus aidées. Il est vrai que lorsque la question de la garde de mes enfants s'est posée, je n'ai pas bénéficié d'une écoute très attentive au sein des hôpitaux publics pour m'aider à trouver une place en crèche. Des efforts doivent donc être accomplis en ce sens-là, et pas seulement pour les internes en chirurgie mais aussi pour les femmes internes en médecine. Il n'en reste pas moins, je le répète, qu'une femme peut fort bien embrasser une carrière de chirurgien même si cela demande beaucoup de volonté.
J'appartiens à une génération plus ancienne d'une quinzaine d'années environ par rapport à celle de Mme Debet. En ce temps-là, les femmes internes étaient moins nombreuses et la féminisation moins sensible.
J'ai eu quant à moi trois enfants mais assez tardivement, bien après mes années d'internat et de clinicat, à l'âge de 39 et 41 ans. Cela ne m'a pas empêchée, ensuite, de reprendre une carrière universitaire, de passer des concours et d'obtenir le titre de professeur. Comme dans tous les métiers où l'on s'investit beaucoup, la charge de travail est certes très lourde mais, en l'occurrence, les femmes doivent faire leurs preuves d'une manière peut-être plus importante que les hommes lors de leur prise de fonction. Les premières semaines d'évaluation passées, tout va très bien, le fait d'être une femme n'entraînant aucune difficulté particulière.
Par ailleurs, les mentalités ont changé – et pas seulement au sein du monde médical ou hospitalier : alors qu'il aurait été impensable jadis, pour un interne homme, de dire qu'il doit récupérer un enfant à la crèche ou qu'il a un problème de garde – cela aurait été encore plus difficile pour une femme –, c'est aujourd'hui devenu monnaie courante. Les jeunes internes, femmes ou hommes, sont désormais entrés dans une dynamique acceptée par tous où il s'agit de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Enfin, la réussite dans une spécialité n'a selon moi jamais constitué un problème. La charge de travail et les gardes nécessitent certes une certaine résistance physique mais c'est également le cas dans d'autres secteurs professionnels.

Les femmes françaises ont plus d'enfants que la moyenne européenne mais elles sont plus nombreuses à s'arrêter de travailler après la naissance de leur deuxième ou de leur troisième enfant puisque seules 40 % d'entre elles poursuivent dans ce dernier cas une activité professionnelle. La situation est-elle comparable dans le milieu hospitalier ? Aux Pays-Bas, où la culture protestante implique que les femmes se doivent d'aller chercher elles-mêmes leurs enfants à l'école et évitent de les mettre en crèche, les anesthésistes manquaient au point que les hôpitaux ne fonctionnaient qu'au quart de leur possibilité et il a fallu réfléchir à une meilleure articulation entre vie familiale et vie professionnelle !
Enfin, les femmes choisissent-elles des spécialités par goût ou par contrainte ? Il semble que les médecins femmes se spécialisent plutôt en dermatologie, par exemple, en raison de contraintes horaires moins fortes.
Dans le monde médical, la chirurgie orthopédique a assez mauvaise presse : la chirurgie de l'os implique en effet d'utiliser la scie, le marteau, le tournevis, le médecin orthopédiste étant considéré dans toutes les salles de garde comme une brute, un homme de Cro-Magnon ! La connotation, vous le voyez, est assez négative.
Père de trois garçons, marié à une femme médecin spécialisée en anatomo-pathologie, je tiens à préciser qu'elle m'a également beaucoup aidé tout en menant sa vie professionnelle, de mère et de femme. Je lui dois énormément.
Je ne connais pas de collègues qui se soient arrêtées de travailler après une grossesse tant il est impensable de cesser toute activité après six années de médecine, cinq années d'internat et trois années de clinicat.
En revanche, nous connaissons tous des étudiants qui, en fin de sixième année, ont suivi d'autres voies que la pratique médicale. Mais il est vrai qu'après avoir passé et réussi le difficile concours de l'internat, on ne s'arrête pas.
Les jeunes internes, hommes ou femmes, ont aujourd'hui plutôt tendance à délaisser les spécialités chirurgicales.
Ou les spécialités médicales qui impliquent des gardes.
Alors que la chirurgie a longtemps été considérée comme la spécialité reine que choisissaient les premiers reçus au concours de l'internat, même les plus brillants, aujourd'hui, la délaissent.
Vers des spécialités médicales moins contraignantes comme la dermatologie ou la psychiatrie.
Lorsque Mme Thoreux ou moi-même avons passé les concours pour être reçus en chirurgie, il fallait figurer à Paris parmi les 300 ou 400 premiers sur 4 000 candidats. Aujourd'hui, le dernier reçu en chirurgie sera classé trois millième sur 7 800. Cela ne signifie pas que les chirurgiens seront mauvais mais que la chirurgie n'intéresse plus et parmi elle, au premier chef, la chirurgie orthopédique : il s'agit en effet de la première spécialité mise en cause par les plaintes déposées dans un cadre pénal ou devant les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI). Cette judiciarisation de notre parcours professionnel – les mises en cause étant en outre toujours perçues comme injustes – diminue l'attractivité de notre profession.
Il serait intéressant de savoir si les femmes sont plus souvent mises en cause que les hommes, les patients pouvant parfois se montrer plus agressifs à leur égard. En ce qui me concerne, je ne souffre pas de cette judiciarisation même si elle est bien réelle.
On me pose souvent des questions sur ma manière de vivre ce métier en tant que femme. Un patient, au bout d'une demi-heure de discussion, m'a aussi demandé quand il allait pouvoir rencontrer le chirurgien ! L'image traditionnelle qui veut qu'un chirurgien soit un cinquantenaire installé plutôt qu'une jeune femme de trente-cinq ans – surtout en chirurgie orthopédique – est bien vivace !
Travaillant dans le secteur libéral, je regrette de ne plus avoir d'activité d'enseignement et de recherche mais je m'efforce toujours, lorsque j'en ai l'occasion, d'inciter les jeunes internes à choisir la chirurgie orthopédique. Une jeune femme m'a affirmé récemment ne pas vouloir se lancer dans une spécialité jugée aussi dure et masculine mais je l'ai conviée à assister à une opération en clinique et elle a changé d'avis.

Suite à des maternités successives et compte tenu de l'évolution rapide des techniques médicales, un arrêt de quatre ou cinq ans implique-t-il ensuite une remise à jour particulière ?
Personne ne s'arrête aussi longuement. En tant que salariée de l'hôpital public, j'ai bénéficié d'un congé maternité standard mais je n'ai pas pris de congé parental.
Les collègues installées dans le secteur libéral, en général, travaillent le plus longtemps possible jusqu'à l'accouchement et s'arrêtent ensuite un mois ou un mois et demi en utilisant même des jours de récupération.
La question d'une perte de technicité ou de niveau ne se pose pas : nous sommes dans une dynamique professionnelle – investissement personnel, recrutement d'une patientèle, projets universitaires - qui interdit un arrêt de plusieurs années. De plus, le choix de la chirurgie orthopédique témoigne d'une certaine résistance physique et psychologique ! Je me suis quant à moi arrêtée le moins de temps possible.
Les choix s'expliquent souvent à partir de rencontres. Étudiant en médecine, je n'étais pas du tout prédestiné à faire de la chirurgie mais les hasards de l'internat ont fait que j'ai commencé par effectuer un stage de chirurgie orthopédique et que j'ai finalement accompli toute ma carrière dans cette spécialité.
J'étais quant à moi certaine de ne pas vouloir faire de chirurgie ou de psychiatrie mais, très intéressée par le domaine sportif, j'ai cherché une spécialité médicale proche de la médecine du sport. Le hasard des rencontres m'a ensuite fait comprendre qu'être chirurgien plutôt que médecin du sport ou rééducateur me permettrait de maîtriser l'ensemble de la chaîne de la prise en charge de la pathologie traumatologique du sport.
Suite également à une rencontre, j'ai choisi une sous-spécialité de la chirurgie orthopédique, moins physique, où l'on utilise le microscope et où l'on opère en position assise : la chirurgie de la main.
Il convient de distinguer deux modalités d'exercice de l'enseignement : d'une part, celui, pyramidal, du système hospitalier où les internes - évidemment femmes ou hommes – donnent des cours aux étudiants en médecine et où les chefs de clinique dispensent un enseignement à ceux-ci et à ceux-là ; d'autre part, le professorat à proprement parler où la situation est très différente puisque, sur 75 universitaires de ma discipline, nous ne sommes que deux « professeures » en France.

Le fameux « plafond de verre », en l'état, demeure : dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personne. Ainsi les femmes constituent-elles 99 % des enseignants en maternelle et 95 % dans le secteur primaire alors qu'elles ne sont plus que 5 % à avoir des responsabilités dans l'enseignement supérieur. Combien de femmes président-elles des universités ? Une ou deux !
A l'hôpital Saint-Antoine, sur cinq internes et quatre chefs de clinique, deux sont des femmes dans chaque catégorie – même s'il est vrai que nous sommes loin de la parité en général puisque les praticiens hospitaliers et les professeurs sont majoritairement des hommes. La situation, toutefois, sera bien différente d'ici cinq à dix ans.
Les femmes ne choisissent pas toutes de se lancer dans des carrières jugées difficiles. Ainsi n'ai-je pas eu envie de poursuivre dans la voie universitaire même si je la trouve très intéressante : je voulais avoir davantage de temps pour moi, ce que permet l'exercice de la chirurgie dans le secteur libéral. Je ne crois pas que les femmes se voient opposer des barrières en chirurgie et à l'université ; une femme qui a décidé d'exercer à l'hôpital public, en médecine ou en chirurgie, ne sera pas brimée dans sa carrière.
C'est aussi mon avis.
Par ailleurs, la nomination d'un professeur repose sur plusieurs facteurs : la reconnaissance des pairs, certes, mais également un poste idoine. Ainsi le plus difficile a-t-il été, pour moi, de faire développer au sein de mon université la thématique très précise que je voulais adopter – mais je n'ai jamais eu l'impression que l'on me mettait des bâtons dans les roues.
Les jeunes internes sont très sensibles aux a priori concernant telle ou telle spécialité chirurgicale. Il faut leur montrer qu'ils sont faux et que l'on peut s'organiser pour avoir des enfants et mener une vraie vie de famille tout en exerçant notre métier. Nous ne sommes pas brimées.
En début de carrière, les femmes gagnent exactement le même salaire que les hommes.
Nous sommes tous rémunérés à l'acte selon un tarif identique mais, dans le secteur libéral, une femme peut très bien choisir de travailler moins, ce qui impactera son chiffre d'affaires. Cela, toutefois, n'a rien à voir avec le fait qu'elle est une femme, à la différence d'autres métiers.
Mme Thoreux et moi-même sommes membres de la fonction publique en tant que professeurs des universités employés du ministère de l'Éducation nationale. Notre grille de salaires est identique. Dans le secteur libéral, plus la clientèle est nombreuse, plus on gagne de l'argent : cela n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme.
C'est d'abord le problème d'une génération où les femmes étaient peu nombreuses dans cette spécialité. Dans la mesure où les femmes sont désormais plus nombreuses à la base, il y en aura aussi de plus en plus qui choisiront une carrière universitaire. La seule difficulté que j'ai rencontrée est un certain manque de souplesse : il m'est impossible de dégager une journée ou même une demi-journée dans la semaine pour mes enfants.
Le fait d'avoir des enfants n'a pas d'influence sur le choix d'une spécialité, car on se décide en général bien avant. En outre, il est tout à fait possible de concilier vie professionnelle et vie familiale, même s'il existe certains aléas. Pour ma part, j'ai eu des enfants à un âge relativement tardif et mon parcours universitaire s'est un peu ralenti – j'ai moins publié et j'ai été nommée professeure un peu plus tard que d'autres collègues.
Une autre évolution est la disparition des « grands patrons » un peu rudes et parfois tyranniques que nous avons connus il y a une trentaine d'années. Il y avait des rapports de force et, dans certains cas, des humiliations.
Les relations sont parfois un peu autoritaires, mais on apprend beaucoup et cela fait partie du jeu. Il y a une grande humanité et un sens du compagnonnage dans notre métier. Les patrons peuvent être durs, mais ils sont justes et je n'ai jamais vu de différence de traitement ou d'appréciation selon le sexe.
L'arrivée des femmes néanmoins a contribué à changer la situation. Lorsque j'étais chef de clinique au Kremlin-Bicêtre, j'ai vu pleurer une de mes premières internes, arrivée en retard au bloc opératoire, parce que je lui avais dit que je lui enverrais un carton d'invitation la prochaine fois. Un homme n'aurait pas eu la même réaction. Il a fallu modifier la façon dont nous nous adressons à nos collègues.
Bien sûr. Le métier reste très masculin, mais l'arrivée des femmes, il y a une dizaine d'années, a un peu changé la donne.
Je ne suis pas sûre que cette anecdote reflète vraiment la réalité : lorsque j'étais interne, les femmes se faisaient respecter parce qu'elles étaient capables de travailler autant que les hommes, voire plus, et au moins aussi bien qu'eux. A partir du moment où l'on avait acquis ses galons, les rapports avec les grands patrons changeaient. On savait ce qui allait se passer et on rentrait dans le moule.
Par ailleurs, les femmes peuvent être en retard, comme tout le monde, mais chacun a pu constater qu'elles sont globalement à l'heure et même plutôt en avance.
Le monde de la chirurgie est un monde dur, que l'on soit une femme ou un homme. Nous faisons un métier très curieux. Quand on choisit la chirurgie, on sait que ce sera difficile et qu'il faudra s'endurcir. Le cap de l'internat peut être rude, mais il permet d'apprendre beaucoup.
Les patients sont parfois étonnés que leur chirurgien soit une femme : ils se demandent si elle sera compétente. L'image du chirurgien homme reste tenace, mais la situation va évoluer avec le renforcement de la présence des femmes. Lorsque je travaillais dans l'équipe du professeur Sautet, trois femmes étaient internes et deux, chefs de clinique. Le chiffre d'environ 3 % de femmes parmi les chirurgiens orthopédistes ne rend pas compte de la réalité, même s'il reste du travail à faire pour atteindre la parité.
Il y a aussi des différences selon le type d'activité : le service dans lequel vous étiez faisait de la chirurgie de la main. Dans un service plus classique ou dans un service de chirurgie du rachis, les chiffres seront toujours moins élevés. En ce moment, par exemple, nous n'avons pas de femme chef de clinique. Les femmes sont plus nombreuses dans le domaine de la chirurgie de la main et dans celui de la chirurgie plastique et reconstructrice, qui peut être en partie réalisée par les orthopédistes.
Cela concerne aussi bien les femmes que les hommes. La chirurgie a mauvaise presse parce qu'on travaille davantage, et souvent la nuit. A cela s'ajoute une certaine judiciarisation : les procès y sont plus nombreux que dans le reste de l'activité médicale.
La situation reflète aussi des choix de société : 75 % des jeunes déclarent qu'ils voudraient devenir fonctionnaires ou salariés. Cela témoigne d'un manque d'ambition et d'une crainte de l'avenir. L'ambiance est aujourd'hui assez délétère.
Il y a aussi l'évolution du temps de travail. Nous ne bénéficions pas des 35 heures : pour les médecins hospitaliers, la durée maximale est de 48 heures par semaine, application faite du « repos de sécurité » qui interdit d'enchaîner une garde de nuit et une deuxième journée.
Pour ce qui est des jeunes, le temps de travail influe sans doute plus que la judiciarisation en cours. Sur ce point, il ne faut pas oublier que notre spécialité est « fonctionnelle » : comme les patients sont plutôt en bonne santé, ils supportent beaucoup plus difficilement un aléa thérapeutique que ceux souffrant d'un cancer ou d'une maladie très grave et qui, sans geste chirurgical, risqueraient de mourir.
La chirurgie orthopédique reste un beau métier. Nous ne vivons pas dans la crainte d'un procès et le rapport avec le patient demeure assez sain : on n'essaie pas systématiquement de se protéger, au cours de la consultation, contre un éventuel procès. Il n'y a pas encore eu d'américanisation sur ce plan.
Les procès résultent en grande partie d'une mauvaise compréhension entre le patient et le médecin, souvent à cause d'un manque d'explication ou d'un défaut d'écoute à un moment clef de la prise en charge. Or, les femmes prennent peut-être un peu plus de temps pour discuter avec leurs patients : si des chiffres existaient, ils montreraient sans doute qu'elles font moins l'objet de procès que les hommes.
Quand les étudiants en médecine passent dans nos services, nous leur montrons notre métier. Nous nous y obligeons, mais c'est aussi un plaisir. Nous les faisons ainsi venir aux consultations. Après l'examen classant national, qui a succédé à l'internat, de nombreux étudiants reviennent nous demander conseil pour le choix de leur stage ou de la ville où ils iront.

J'imagine que vos collègues essaient aussi d'attirer les étudiants vers les 49 autres spécialités que vous évoquiez tout à l'heure.
Bien sûr. Si nous avons choisi la chirurgie orthopédique, tous les trois, c'est à la suite d'une rencontre avec une personne charismatique. Il revient à chacun d'être aussi charismatique que possible pour attirer les jeunes.
Le seul bémol concerne les femmes qui choisissent d'avoir des enfants pendant leur internat ou leur clinicat : il faudrait les aider davantage pour trouver un mode de garde, quelle que soit leur spécialité et plus encore lorsqu'il s'agit de la chirurgie, où les gardes sont nombreuses.
Pour ma part, je pensais avoir accès à la crèche de l'hôpital, relevant de l'Assistance publique, où j'étais interne, mais j'ai été extrêmement mal accueillie. J'en garde un souvenir très désagréable.
A l'origine, les crèches n'étaient pas accessibles au personnel médical, mais la situation a progressivement évolué. Le problème est que les horaires sont calés sur ceux des infirmières : il y a l'équipe du matin et celle de l'après-midi ou de la nuit. Or, nous sommes à cheval sur ces horaires : il faudrait déposer les enfants entre 7 heures et 7 heures 30 pour les récupérer entre 20 et 21 heures. On m'a expliqué, à l'époque, que mes enfants ne supporteraient pas psychologiquement le changement d'équipe en milieu de journée. J'ai opté pour une crèche municipale et un complément de garde à domicile.
Encore faut-il avoir accès à une crèche municipale, ce qui est très difficile. La garde des jeunes enfants est un problème qui touche toutes les femmes en France, quel que soit leur métier.

Avoir des enfants dans notre pays est une vraie vocation. C'est très difficile quand il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui peut apporter une aide ponctuelle.
Malgré toutes les difficultés, je tiens à dire que je ne suis jamais allé travailler à reculons et que je ne me suis jamais ennuyé.
C'est un métier qui a de nombreuses facettes : il peut évoluer au fil des années, et l'on peut exercer des activités variées au cours d'une même semaine. On n'a pas le temps de s'ennuyer.
Elles représentent entre 100 et 130 heures par an, inégalement réparties dans l'année. Chaque semaine, je consacre une journée complète à la recherche et deux demi-journées à des réunions administratives ou à des activités d'enseignement. Je passe le reste du temps en consultation et au bloc opératoire.
Celles et ceux qui, comme moi, ont décidé de s'installer en secteur libéral n'ont plus d'activité d'enseignement, mais nous essayons de faire en sorte que les internes puissent être aussi formés dans les établissements privés. La situation commence d'ailleurs à évoluer : il y a aujourd'hui une clinique, à Paris, qui accueille un interne dans notre spécialité.

Quand vos enfants seront plus grands, pourrez-vous reprendre une activité d'enseignement ?
Malheureusement non. Quand on choisit une installation libérale, il faut tirer un trait sur sa carrière hospitalo-universitaire. C'est un choix de vie très différent, mais cela n'empêche pas de recevoir des étudiants à l'occasion. J'ai ainsi accueili, pendant une semaine, une jeune interne qui s'interrogeait sur la spécialité qu'elle allait choisir. Mais ce n'est pas encore organisé formellement.

Quelle est la répartition géographique dans votre spécialité ? Peut-on accéder aux soins dans un périmètre raisonnable ?
En dehors des centres hospitalo-universitaires, installés dans les grandes villes, la chirurgie orthopédique est parfois peu représentée : il n'y a pas forcément d'activité libérale dans toutes les disciplines et certains hôpitaux généraux n'ont pas de chirurgien orthopédiste à part entière – il existe encore des chirurgiens « généralistes ».
Ils sont moins nombreux qu'auparavant. Un autre problème est qu'il y a de moins en moins de chirurgiens de formation française dans les hôpitaux généraux à cause du numerus clausus. A Arras, à Arles ou à Nevers, par exemple, on trouve des médecins dont la formation n'a pas eu lieu en France et qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation.

Dans le territoire rural où je réside, il y a effectivement beaucoup de chirurgiens venus de Pologne ou d'autres pays, et les patients n'ont pas toujours la possibilité d'aller se faire à soigner à Valenciennes, à Lille ou à Amiens.

Ne se dirige-t-on pas vers une médecine et une chirurgie à deux vitesses, avec les risques que cela implique ?
C'est le résultat de choix politiques qui datent déjà d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Sur les 3 000 étudiants inscrits en première année à la Pitié Salpêtrière et à Saint-Antoine, seuls 300 deviendront médecins et 50 dentistes. Si l'on inclut la kinésithérapie, 400 pourront poursuivre leur cursus. Tous les ans, 10 000 étudiants ne parviennent pas à passer en deuxième année de médecine à Paris, situation qui est généralement vécue comme un échec épouvantable, car on ne choisit pas la médecine par hasard, sans une forte motivation.
Dans le même temps, certains établissements vont chercher à l'étranger des médecins qui sont beaucoup moins payés et qui ne présentent aucune garantie en matière de formation.
Il y a deux problèmes : le numerus clausus et l'envie de s'installer dans les zones rurales et dans certaines régions. La seule augmentation du numerus clausus ne garantira pas une répartition équilibrée.
C'est exact, mais le nombre de places offertes dans les villes de province augmente aujourd'hui et des postes de chef de clinique sont transférés de Paris vers la province. Or, quelqu'un qui passe sept ans dans une même ville y trouve généralement un partenaire et s'installe à proximité dans 80 % des cas.
J'ajoute qu'on fait aujourd'hui cours à des étudiants dont la très grande majorité va rester sur le carreau, ce qui n'est pas très valorisant : on s'adresse à des « collés ».
L'audition s'achève à dix-huit heures trente-cinq