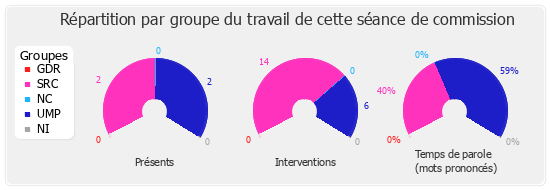Délégation aux droits des femmes et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
Séance du 8 novembre 2011 à 16h00
La séance
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'examen des conclusions du rapport d'information sur le genre et la dépendance (Mme Marianne Dubois, rapporteure).
La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq

L'espérance de vie des Français est passée, en 2009, à 84,5 ans pour les femmes et à 77,8 ans pour les hommes. Préoccupé par l'accroissement du nombre de personnes très âgées en situation de perte d'autonomie, le Gouvernement a lancé en février 2011 une réflexion nationale sur ce thème de la dépendance.
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a estimé que la future réforme de la dépendance ne saurait se faire sans une réflexion sur le rôle considérable des femmes dans les situations de vieillissement et de perte d'autonomie.
Je tiens à remercier Madame la présidente, Marie-Jo Zimmermann, qui m'a confié cette réflexion sur une réalité qui, bien que très présente, a rarement été mise en relief.
Les travaux que j'ai menés ont été éclairés par dix-huit auditions aux cours desquelles j'ai tenu à rencontrer des acteurs de terrain, des professionnels et des bénévoles – souvent anonymes.
Deux déplacements ont été effectués dans le Loiret ; l'un pour visiter un établissement d'accueil de jour pour personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ; l'autre dans une maison d'accueil rurale pour personnes âgées (Marpa).
Une phrase du rapport en résume le contenu : « Le temps de la vieillesse est le reflet d'une vie entière, d'une condition physique, d'une histoire familiale, d'une activité professionnelle, d'un milieu social, d'un ancrage local, de croyances religieuses, d'une génération et d'un genre. »
La difficulté vient du fait que ce sont les femmes qui subissent la dépendance mais que ce sont elles aussi qui prennent en charge la dépendance de leurs proches.
Les femmes âgées peinent à financer leur perte d'autonomie. Les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, que notre Délégation ne cesse de dénoncer, ont en effet pour conséquence que les femmes gagnent moins bien leur vie que les hommes ; cela se traduit par une inégalité des niveaux de pension qui creuse encore les écarts au moment de la retraite. Cette pauvreté, due notamment aux restes à charge trop élevés des frais qu'entraîne la dépendance d'une personne, est statistiquement démontrée et constitue, pour les femmes âgées, un facteur d'isolement.
Rester le plus longtemps possible à son domicile est le souhait le plus fréquemment exprimé par l'opinion publique lorsqu'elle est interrogée sur la façon dont elle envisage de vivre les années du grand âge. Une personne âgée préfère demeurer dans son environnement où le coût du reste à charge est d'ailleurs moins élevé.
Or le maintien à domicile repose sur les épaules des femmes, qu'il s'agisse d'aidantes familiales, souvent contraintes de remplir ce rôle, de professionnelles de l'aide aux personnes ou de bénévoles.
Selon la gravité de l'état de dépendance du proche, les aidants familiaux, qui sont majoritairement des aidantes, ont une charge de travail qui peut se révéler difficile à supporter ; d'autant que si les hommes aidants demandent volontiers de l'aide, surtout pour procéder aux soins du corps, les femmes ont tendance à éprouver un sentiment de culpabilité si elles ne vont pas jusqu'au bout de leur engagement.
Il n'est pas rare de voir des aidants s'épuiser à la tâche, tomber malade et disparaître avant le membre de la famille aidé. L'accompagnement d'un ascendant peut même conduire des couples à se séparer quand l'un ne supporte plus l'implication et les absences de l'autre ; et les femmes sont le plus souvent contraintes à un véritable numéro d'équilibriste entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Or on estime que le nombre d'aidants familiaux diminuera fortement d'ici à 2040 du fait des évolutions de notre société : mobilité et éloignement géographique des enfants, nouvelles situations de conjugalité, recompositions familiales, préoccupation grandissante des femmes seniors pour leurs petits enfants. De nombreux emplois à domicile devront donc être créés.
Aujourd'hui, les services d'aide à domicile se caractérisent par un taux très élevé d'emplois féminins et par des conditions de travail difficiles ; ce sont généralement des personnes appartenant à des milieux aisés qui y ont recours.
Conscient des enjeux économiques et sociaux que représentent ces services, le Gouvernement accompagne les partenaires sociaux et les professionnels du secteur dans leur démarche actuelle de revalorisation de leur activité.
Une convention collective de branche des services à la personne est en cours de négociation. Elle a pour objectif de rendre moins précaires les conditions de travail des salariés de ce secteur. Diverses mesures y sont discutées : mise en place d'une complémentaire santé ; meilleure prise en compte de l'ancienneté ; augmentation de la rémunération des heures en soirée ou le week-end ; prise en compte des temps de concertation dans le temps de travail effectif.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie participe au développement de formations et aux validations des acquis de l'expérience. Il s'ensuit un véritable relèvement du niveau de qualification.
Notre collègue, M. Laurent Hénart, président de l'Agence nationale des services à la personne, considère qu'il sera à terme inévitable de « faire tomber les barrières entre le sanitaire et le social » afin de donner aux femmes la possibilité de suivre des parcours de formation.
Enfin, le travail des associations dans le domaine social et humanitaire paraît incontournable, en particulier dans les services gériatriques et ceux dédiés à la fin de vie. Les bénévoles qui donnent de leur temps auprès des personnes âgées en très grande dépendance sont, là aussi, des femmes. Non que les hommes ne fassent pas de bénévolat mais ils préfèrent sont plus enclins à, par exemple, se rendre au chevet de grands malades ; la dépendance n'est pas de leur domaine.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale, a déclaré que la réforme de la dépendance se poursuivrait, même si les mesures financières les plus lourdes ont été reportées. En tout état de cause, la Délégation se montrera très attentive aux mesures qui seront proposées ou adoptées : elle veillera à ne pas faire peser l'entière responsabilité des situations de dépendance sur les seules familles, sans pour autant que la solidarité nationale se substitue entièrement à la nécessaire solidarité familiale.
J'en viens maintenant aux recommandations que pourrait formuler par notre Délégation.
La première porte sur l'organisation de grandes campagnes de sensibilisation auprès de nos concitoyens afin de les informer, de les mettre en garde sur les coûts des pertes d'autonomie et de changer le regard porté par la société sur la vieillesse.
La deuxième serait de partager, en cas de divorce, les droits à la retraite du conjoint qui n'a pas interrompu sa carrière pour élever les enfants du couple avec la mère ou le père de famille qui, pour s'occuper desdits enfants, n'a pas exercé ou a cessé d'exercer pendant la durée du mariage une activité professionnelle.
En troisième lieu, il conviendrait de mieux diffuser l'information en direction des personnes âgées et des familles en multipliant et en diversifiant davantage l'utilisation des nouvelles technologies, et en généralisant les expériences de guichet unique d'information afin de regrouper les différentes structures intervenant auprès des malades ou de leurs familles en un même endroit – ce qui faciliterait leurs démarches.
La quatrième préconisation souligne la nécessité de prévenir les états de dépendance des femmes par une proposition systématique faite aux seniors cessant leur activité professionnelle d'effectuer gratuitement un bilan de santé ; par le développement des centres multidisciplinaires de consultation en gérontologie ; par la prise en charge systématique par un gérontologue des personnes âgées admises dans les services d'urgence ; par l'organisation d'un dépistage gratuit de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées ; et par une formation initiale et continue des médecins généralistes plus importante sur la maladie d'Alzheimer et sur les maladies apparentées.
La cinquième recommandation encourage l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées par la mise en place d'aides à la vie quotidienne dans leur logement, le maintien de la vie sociale et des liens intergénérationnels, un renforcement de la professionnalisation et de l'organisation du secteur des emplois à domicile dont les intervenants, qui travaillent le plus souvent à temps partiel doivent obtenir un statut plus protecteur au sein d'une indispensable réforme de ce mode d'organisation du travail.
La sixième recommandation concerne le nécessaire soutien à apporter aux aidants familiaux. À cette fin, il est proposé de leur offrir davantage de possibilités de répit et de favoriser, sur le plan successoral, celui des membres d'une fratrie ou d'une parentèle qui rapporterait la preuve qu'il a supporté la charge d'une personne âgée au-delà des exigences résultant d'un devoir filial ou familial.
La septième préconisation consisterait à aménager les congés familiaux existants (congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé parental) en faveur des aidants familiaux et à créer un compte épargne temps familial cofinancé par les employeurs et les salariés pouvant être utilisé tout au long de la vie professionnelle afin de couvrir des absences liées à des impératifs familiaux.
Enfin, la huitième recommandation porte sur la nécessité de retarder l'entrée en structure d'accueil, quand le maintien à domicile n'est plus possible, en encourageant et en généralisant les différentes solutions existantes d'hébergement alternatives à l'aide à domicile : accueil familial, maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA), logement intergénérationnel ou maisons d'accueil.
Toutes ces propositions ne prétendent pas répondre à elles seules aux multiples enjeux de société que pose la prise en charge de la dépendance. Elles dressent un constat et on peut au moins espérer qu'elles aideront à une prise de conscience collective.

Il faudra absolument faire connaître le contenu de ce rapport, en organisant par exemple une conférence de presse. Car les propositions qui y sont formulées sont le résultat d'un travail de recherche considérable et pourraient servir de base à une éventuelle future loi. Elles sont expliquées sans langue de bois – dire les choses telles qu'elle sont, n'est-ce pas d'ailleurs le propre de notre Délégation ? – et toutes sont pertinentes.
La recommandation qui porte sur les successions me semble en particulier révolutionnaire ! Mais toute vérité est bonne à dire… Je suggère donc qu'on prenne contact avec les médias et qu'on communique le rapport au Gouvernement.

Je compte aussi en parler à l'occasion de l'intervention que je ferai, après demain dans l'hémicycle, lors de l'examen des crédits « Solidarité » du projet de loi de finances pour 2012.

Vous avez su traduire la réalité existante avec beaucoup plus d'exactitude que tout ce que j'ai pu lire sur ce sujet. Et ce rapport mériterait d'être transmis à tous les candidats à la prochaine élection présidentielle pour leur demander ce qu'ils comptent faire face à une telle situation.
À la différence du rapport d'information de Mme Valérie Rosso-Debord sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes – dont le contenu était davantage orienté sur les problèmes de financement de la dépendance – votre étude, Madame Dubois, dit les choses telles qu'elles sont.

Les recommandations que formule ce rapport sont concrètes et proches du terrain. C'est pourquoi elles sont très intéressantes et méritent d'être creusées. La mise en oeuvre de certaines d'entre elles n'aurait certainement pas un coût financier élevé ; mais il faut reconnaître que face à l'ampleur de l'enjeu financier que représente la dépendance, les choses n'avancent pas.
Si le rapport de Mme Valérie Rosso-Debord n'a pas connu de suite, la raison en est que le Gouvernement n'a pas voulu s'engager sur la voie qu'elle proposait d'un recours obligatoire à l'assurance privée pour garantir l'aléa de la dépendance.
Tous les professionnels regrettent que les promesses relatives à la dépendance, qui faisaient pourtant partie du programme du Président de la République, n'aient pas été tenues alors que la situation est encore pire aujourd'hui qu'il y a cinq ans.
Concernant la proposition relative aux successions, il ne faudrait pas qu'elle aboutisse à ce que les membres d'une fratrie se disputent la garde de la personne âgée dans le but d'être favorisés au moment du partage de l'héritage.
La recommandation relative au congé familial n'est pas sans faire penser à la proposition de loi de M. Jean Leonetti instituant une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. J'avais alors défendu l'idée d'instituer un capital temps que les salariés se constitueraient au long de leur carrière ; un tel dispositif donnerait également plus de disponibilité pour s'occuper d'une personne âgée.
En tout état de cause, c'est la montagne du financement qui reste à franchir. Le reste à charge pour les enfants dépasse souvent leurs moyens financiers, ce qui peut conduire à des situations dramatiques, notamment dans le cas des familles à enfant unique – d'autant que certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne bénéficient pas d'aide du département. On sait aussi que les associations d'aide à domicile sont en grande difficulté car les prix de revient de leurs prestations sont supérieurs aux sommes qu'elles reçoivent ; il en résulte une baisse du nombre des heures effectuées.

Une meilleure diffusion de l'information en direction des personnes âgées et des familles – qui fait l'objet du troisième volet de recommandations – me paraît indispensable : il faut globaliser la problématique et fournir à tous les informations nécessaires.
Le partage des points de retraite en cas de divorce reprend une proposition que notre Délégation avait faite à l'occasion de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites. Un dispositif équivalent existe en Allemagne et en Angleterre. Il évite aussi d'avoir à attendre le décès de l'ex-conjoint pour percevoir une pension de réversion.
Concernant le soutien à apporter aux aidants familiaux, j'avais interpellé la ministre sur le problème du financement des maisons de répit. Une structure de ce type a été ouverte à Villeurbanne : elle assure d'une part l'information des personnes concernées et de l'autre propose une structure d'accueil de la personne dépendante qui permet d'alléger la charge de l'aidant pendant deux ou trois jours.
Concernant l'accueil en famille, abordé dans la huitième série de recommandations, des garde-fous seraient à prévoir afin de prévenir la création de situations de conflit d'intérêts entre les accueillants et la personne âgée.

Si je mentionne peu de chiffres dans mon rapport, j'évoque cependant la question des économies que pourrait permettre un dépistage de l'ostéoporose. Un simple examen de densitométrie osseuse coûtant 40 euros, il doit être comparé au coût, par exemple, d'une fracture du col du fémur qui peut être estimé à 16 000 euros !
À la différence de ce que propose Mme Valérie Rosso-Debord dans son rapport, je préconise un dépistage de l'ostéoporose qui interviendrait suffisamment tôt ; on sait en effet que jusqu'à l'âge de 55 ans il est encore possible d'améliorer sa condition physique.
Un autre chiffre est particulièrement édifiant: on constate une surmortalité de plus de 60 % des aidants dans les trois années qui suivent le début de la maladie de leur proche.

Le fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes mais que leur espérance de vie en bonne santé diminue avec l'âge plus rapidement qu'eux, me paraît aussi être une donnée à retenir.
La nécessité de retarder l'entrée en structure d'accueil médicalisée me semble très importante. Il faut trouver des formules moins chères que les EHPAD qui ne devraient être que des solutions de placement de dernier recours. Il est par exemple dommage qu'il devienne si difficile de disposer de lits en foyer-logement, formule pourtant moins onéreuse.
Avec davantage d'imagination et de souplesse on pourrait concevoir des dispositifs conciliant l'autonomie et l'entraide. Des systèmes de colocation dans lesquels les personnes mettent en commun l'allocation adulte handicapé rendent possible l'emploi d'un aidant à domicile. En Belgique, par exemple, le système de béguinage est un mode d'habitat groupé qui permet à chaque personne de conserver une maison individuelle.
Pourquoi, dans les territoires qui se dépeuplent, lorsque des personnes âgées ne sont plus en mesure de demeurer dans leur domicile isolé à la campagne, les petites communes n'achètent-elles pas des maisons pour permettre aux personnes devenues dépendantes de vivre en colocation dans le centre bourg ?

Des maisons d'accueil existent déjà ; elles reçoivent trois ou quatre personnes qui logent au rez-de-chaussée, l'aide familiale vivant à l'étage.

De telles structures existent aussi pour les jeunes en situation de rupture avec leur famille.

Je reconnais que le rapport n'insiste probablement pas assez sur les disparités qui existent sur ce sujet entre le monde rural et les villes. Il y a peu d'aide inter-générationnelle à la campagne.

À Dijon et à Angers, des initiatives ont été prises pour encourager les liens inter-générationnels dans certains quartiers.
Les procédures de tutelle et de curatelle me semblent poser aussi un grave problème.

Le rapport ne soulève pas cette question ; le problème mériterait de faire l'objet d'une étude à part entière.
Pour conclure, je suggère de donner au rapport le titre suivant : Femmes et dépendance : la double peine.
Puis la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'audition de Mme Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pasteur.

Nous poursuivons notre cycle d'auditions sur la notion de genre. Je vous remercie, Madame, d'avoir accepté notre invitation et vous invite à nous faire part de vos réflexions sur le fonctionnement du cerveau.
Je suis très honorée de cette occasion qui m'est donnée de débattre avec vous de cette question qui nous taraude tous : le cerveau a-t-il un sexe ?
Les découvertes sur le cerveau ont commencé au XIXe siècle lorsque les médecins ont essayé de comprendre les relations entre l'intelligence et la taille et le poids du cerveau : c'était la grande époque de la crâniométrie et il paraissait naturel que le cerveau des hommes soit plus gros que celui les femmes, celui des blancs plus gros que celui des noirs, celui des patrons plus gros que celui des ouvriers. Le neurologue Paul Broca a défendu ces thèses après avoir pesé et mesuré de nombreux cerveaux. Ses expériences ont montré que le cerveau des hommes pesait en moyenne 1,350 kg et celui des femmes 1,200 kg, soit une différence de 150 g. Il a déclaré : « Nous nous sommes demandés si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps, pourtant il ne faut pas perdre de vue que la femme est un peu moins intelligente que l'homme ».
La relation entre la taille du cerveau et l'intelligence est totalement vaine car il n'existe aucun rapport entre eux. Nous le savions déjà au XIXe siècle grâce à quelques hommes célèbres qui ont donné leur cerveau à la science, ce qui a permis de constater que le cerveau d'Anatole France pesait 1 kg, celui de Tourgueniev 2 kg et celui d'Einstein 1,250 kg – soit le même poids que le cerveau des femmes ! De fait, en matière de cerveau, ce n'est pas la quantité qui importe mais la qualité des connexions entre les neurones.
Venons-en à des considérations plus scientifiques. C'est très tôt au cours de la vie utérine que s'effectue ce que l'on appelle la sexualisation du cerveau, lorsque la fabrication des organes sexuels – ovaire et testicules – libère des hormones qui, passant dans le sang du foetus, vont imprégner son cerveau. La région du cerveau la plus sensible aux hormones sexuelles est l'hypothalamus, qui se situe à la base du cerveau près de la glande hypophyse. Chez les femmes, on constate une activité périodique des neurones de l'hypothalamus au moment du déclenchement de l'ovulation, cette activité étant naturellement inexistante dans le cerveau des hommes. Il existe donc des différences cérébrales entre les deux sexes pour tout ce qui concerne les fonctions liées à la physiologie de la reproduction.
En ce qui concerne les différences entre les sexes dans les fonctions cognitives - l'attention, la mémoire, le raisonnement –, les idées reçues sont encore fréquentes.
La première est que les femmes seraient multitâches, douées pour faire plusieurs choses à la fois, la communication entre les deux hémisphères de leur cerveau étant plus développée chez elles que chez les hommes. Cette thèse est née d'une expérience publiée en 1982 : réalisée sur 20 cerveaux conservés dans du formol, elle a montré que la région du corps calleux – il s'agit du faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères – est plus épaisse chez les femmes que chez les hommes. Mais depuis, l'exploration du cerveau a beaucoup évolué grâce à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), qui permet d'étudier des cerveaux vivants et non plus uniquement ceux conservés dans le formol. L'observation par IRM du corps calleux montre qu'il n'existe aucune différence entre le cerveau des femmes et celui des hommes.
Autre idée reçue : les femmes seraient plus douées pour le langage que les hommes parce qu'elles activent pour cette activité leurs deux hémisphères. Un test de langage réalisé sur 20 sujets par IRM en a fait la démonstration en 1995. L'observation était intéressante pour les scientifiques et plusieurs équipes de recherche ont tenté de reproduire ce résultat. Mais depuis, on a réalisé une méta-analyse rassemblant toutes les expériences publiées entre 1995 et 2009 sur le langage, avec un échantillon de 2 000 femmes et hommes. Celle-ci a montré qu'il n'existe aucune différence significative entre les sexes dans la répartition des aires du langage. Cette méta-analyse montre que lorsqu' un grand nombre de sujet est analysé, les différences qui avaient pu être mises en évidence sur un petit nombre de sujets se trouvent gommées.
Au cours d'une autre expérience, on a demandé à des sujets d'effectuer un calcul mental. Tous ont obtenu les mêmes scores et dans le même temps. L'observation par IRM a montré que dans le groupe des femmes, certaines avaient activé les régions antérieures de leur cerveau, d'autres les régions postérieures. Cette variabilité se retrouvait également dans le groupe des hommes. Il s'avère que pour arriver à un même résultat, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes. Cette variabilité entre les individus d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité existant entre les sexes.
Il existe une autre variabilité bien connue des neurologues, celle de l'anatomie du cerveau. La morphologie du cerveau diffère d'un individu à l'autre qu'il s'agisse de ses circonvolutions – les sillons du cortex cérébral – ou des cheminements empruntés par les vaisseaux sanguins qui entourent le cerveau. En bref, nous avons tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe.
D'où vient une telle variabilité ? Notre cerveau est constitué de 100 milliards de neurones, reliés entre eux par un million de milliards de connexions, mais seulement 6 000 gènes s'expriment dans notre cerveau : ils ne sont donc pas suffisamment nombreux pour contrôler de façon détaillée la fabrication de milliards de synapses. Les gènes jouent un rôle très important lors du développement du cerveau et de la formation des hémisphères, du cervelet et du tronc cérébral. Ces gènes de développement sont indépendants des chromosomes sexuels X et Y, ce qui veut dire que la fabrication du cerveau n'est pas sexuée.
Le bébé humain, à sa naissance, possède 100 milliards de neurones, qui cessent dès lors de se multiplier. Des coupes très fines d'un cortex cérébral, réalisées chez un enfant à sa naissance, puis à un mois, trois mois, six mois, 15 mois et 24 mois, montrent que la densité des neurones ne change pas. Ce qui change, et de façon flagrante, ce sont les ramifications entre les neurones qui témoignent de la fabrication des connexions. On considère que dans le cortex cérébral humain un neurone est connecté à 10 000 autres – un cerveau est donc plus complexe qu'un ordinateur… Or 90 % de ces synapses se forment après la naissance. C'est donc sur la fabrication de ces connexions que l'environnement et l'apprentissage jouent un rôle très important. Pour décrire la façon dont le cerveau se construit en fonction de l'expérience vécue, on utilise le terme de plasticité cérébrale.
La plasticité cérébrale, si elle est flagrante chez les enfants, existe aussi chez les adultes. Je vais vous en présenter quelques exemples.
Dans le but de rechercher si une pratique intensive laisse des traces dans le cerveau, des chercheurs ont étudié un échantillon de pianistes professionnels. Leur étude a permis d'observer la présence d'un épaississement du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Ce phénomène d'épaississement, dû à la fabrication de connexions supplémentaires, est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance.
Dans une autre étude, on a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec trois balles. Lorsqu'ils y parviennent, après trois mois d'entraînement, on observe à nouveau ce phénomène d'épaississement dans les régions qui contrôlent la coordination motrice des bras et la vision. S'ils cessent de s'entraîner, les régions épaissies rétrécissent. Cela montre que les changements d'épaisseur du cortex peuvent être réversibles dès lors que la fonction n'est plus sollicitée. La même expérience menée chez des personnes de 60 ans a donné le même résultat, ce qui montre bien que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge.
Je voudrais à présent évoquer l'exemple exceptionnel de cet homme de 44 ans, marié, père de deux enfants, qui menait une vie professionnelle normale. Un jour, il s'est rendu en consultation à l'hôpital de la Timone, à Marseille, pour une légère faiblesse de la jambe. L'examen par IRM a montré que son crâne était essentiellement rempli de liquide céphalorachidien, et que son cerveau était réduit à une mince couche collée sur les parois crâniennes. Il s'avère que ce patient souffrait à sa naissance d'hydrocéphalie. On lui a donc posé un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès., Or le drain s'est bouché et la pression du liquide a progressivement refoulé le cerveau contre les parois du crâne, sans pour autant entraîner la moindre gêne pour cet homme, qui ne s'est jamais douté de rien. Et l'on peut supposer que la faiblesse de sa jambe n'était pas forcément due à la malformation de son cerveau.
Ce très bel exemple de plasticité cérébrale, qui n'est pas unique, met l'accent sur une question fondamentale en neurobiologie qui est celle de la nature des relations entre la structure du cerveau et son fonctionnement. Nous sommes encore loin de comprendre comment le cerveau de cette personne peut assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal.
La plasticité cérébrale fait que le cerveau se remanie en fonction des expériences vécues à tous les âges de la vie. Elle doit être prise en compte dans l'interprétation des clichés d'IRM. On peut constater des différences entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont présentes depuis la naissance, ni qu'elles resteront inscrites dans le cerveau. La découverte de la plasticité cérébrale permet de mieux comprendre l'influence de l'environnement social et culturel sur la façon dont se forgent nos identités de femmes et d'hommes.
Le bébé humain, à sa naissance, ne connaît pas son sexe. Très tôt, le jeune enfant peut distinguer le féminin du masculin à travers la voix et l'attitude des adultes, mais ce n'est qu'à 2 ans et demi qu'il est capable de s'identifier au genre féminin ou masculin. Or l'enfant évolue depuis sa naissance dans un environnement sexué – ses habits, ses jouets, la décoration de sa chambre – sans oublier que les adultes adoptent une attitude différente avec les bébés selon qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. C'est l'interaction de l'enfant avec son environnement qui va contribuer à forger son identité en fonction des normes du féminin et du masculin données par la société.
Venons-en aux idées reçues sur les différences d'aptitudes cognitives entre les sexes. Les hommes sont réputés supérieurs pour se représenter un objet dans les trois dimensions de l'espace, tandis que les femmes obtiennent de meilleurs résultats dans les tests de langage comme la fluence verbale où il s'agit d'énoncer un maximum de mots commençant par la même lettre . Compte tenu de la plasticité cérébrale, si l'on constate des différences de performances entre les sexes, cela ne veut pas de dire qu'elles sont innées. En l'occurrence, elles ne sont détectées qu'à partir de l'adolescence et disparaissent avec l'apprentissage : si on fait passer les tests,pendant une semaine, on voit les scores s'égaliser, ce qui prouve l'influence de l'éducation et de la culture dans les différences de scores entre femmes et hommes.
Le contexte dans lequel se passent les tests est aussi très important. Prenons l'exemple du test de rotation mentale en trois dimensions – les candidats doivent reconnaître deux figures identiques –soumis à des élèves dans une classe. Si avant le test, le professeur le présente comme un test de géométrie, les garçons ont de meilleurs scores que les filles. Si en revanche il annonce qu'il s'agit d'un test de dessin, les filles sont meilleures que les garçons. . Ce résultat montre l'influence des stéréotypes sur les performances. Les filles ont peu confiance en elles face aux tests de mathématiques : on leur a tellement dit qu'elles n'étaient pas douées pour cette matière qu'elles l'ont intériorisé de façon inconsciente.
Une autre étude intéressante a été menée pour illustrer les différences de scores en mathématiques. La présence des filles dans les filières scientifiques et les mathématiques est un enjeu important pour notre société ; il faut donc les encourager à se diriger vers ces filières. En 1990, une enquête réalisée aux États-Unis, sur un échantillon de 10 millions d'élèves, montrait que les garçons avaient de meilleurs scores que les filles aux tests de mathématiques. La même étude a été réalisée en 2008 : les filles ont obtenu les mêmes scores que les garçons. En vingt ans, les écarts de performances en mathématiques entre filles et garçons ont disparu. Ce résultat permet d'évacuer toute éventuelle raison biologique car il n'est pas possible qu'en vingt ans une mutation se soit produite dans le cerveau des filles pour les rendre bonne en maths ! C'est donc bien l'éducation, et non la biologie, qui explique les différences de scores entre les sexes en mathématiques et dans les autres disciplines.
J'en viens aux hormones, en particulier à leur action sur le comportement sexuel. Chez les animaux, les hormones jouent un rôle très important sur le cerveau en déterminant de façon précise les périodes de rut et d'accouplement qui correspondent à l'ovulation, donc à la réceptivité de la femelle. Chez l'humain, la sexualité et la reproduction sont totalement dissociées : les hormones ne jouent aucun rôle dans le moment des rencontres ni dans le choix du partenaire. Par exemple, il est reconnu que les homosexuels, femmes ou hommes, ne présentent pas de problèmes hormonaux et que les délinquants sexuels ne fabriquent pas un taux excessif de testostérone.
Autre idée reçue : les hormones sexuelles seraient impliquées dans les réactions de nervosité, d'agressivité, de dépression. Il convient de distinguer deux situations très différentes : dans les cas de bouleversements physiologiques majeurs, comme la grossesse, la ménopause, les traitements hormonaux de cas pathologiques avec un taux très bas ou très élevé d'hormones, il peut exister des corrélations avec les fluctuations de l'humeur. En revanche, dans les conditions physiologiques normales, aucune étude scientifique rigoureusement menée n'a permis de montrer que les hormones jouent un rôle déterminant sur l'humeur.
Pourquoi l'être humain, à l'inverse de l'animal, n'est-il pas sensible à l'action des hormones ? La réponse vient de l'évolution, qui a doté l'être humain d'un cortex cérébral exceptionnellement développé. Celui-ci s'est tellement développé en surface qu'il a dû se plier en circonvolutions pour arriver à tenir à l'intérieur de la boîte crânienne. Grâce à l'informatique, nous pouvons désormais modéliser le cortex cérébral et le déplier virtuellement : sa surface est de 2 m2 sur 3 mm d'épaisseur.
Le cortex cérébral occupe les deux tiers de notre cerveau et concentre les trois quarts des synapses. Sa surface est dix fois plus importante que chez le singe. Selon les spécialistes de l'évolution, c'est cette extension de la surface du cortex cérébral qui a permis l'émergence du langage, de la pensée réflexive, de la conscience, de l'imagination qui confèrent à l'être humain la liberté de choix dans ses actions et ses comportements. Dans sa vie personnelle et sociale, l'être humain utilise des stratégies intelligentes, basées sur des représentations mentales indépendantes de l'influence des hormones et des gènes.

Existe-t-il une différence de poids entre le cortex cérébral des hommes et celui des singes ?
Le quotient d'encéphalisation – le rapport entre la taille du cerveau et la carrure – est plus important chez l'homme que chez tous les autres vertébrés.
Oui, puisque le cerveau d'Anatole France pesait 1 kg, celui de Tourgueniev 2 kg.

Certes, mais cette différence de poids n'est pas liée à l'intelligence, tandis qu'entre le singe et l'homme elle est un facteur d'évolution.
C'est juste, mais ce sont deux espèces différentes. La différence, chez les êtres humains, illustre la variabilité des cerveaux.
Pour conclure mon exposé, je citerais cette phrase de François Jacob : « Comme tout organisme vivant, l'être humain est génétiquement programmé, mais il est programmé pour apprendre ». Citons aussi le peintre Francis Picabia, qui à sa façon avait tout compris de la plasticité cérébrale en disant : « Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction »,.

Notre collègue Alain Claeys a réalisé une étude sur « L'impact et les enjeux des nouvelles technologies d'exploration et de thérapie du cerveau ». Il me confiait que le fonctionnement du cerveau est une découverte majeure du XXIe siècle, mais qu'il reste encore beaucoup à apprendre. Quel est l'état de la recherche en France ?
Nous sommes toujours présents dans la compétition internationale mais c'est un combat de chaque jour. La recherche sur le cerveau relève de thématiques cliniques et de thématiques fondamentales. Or à l'heure actuelle, celles-ci sont moins dotées financièrement que les thématiques cliniques, ce qui incite les jeunes chercheurs les plus doués à partir à l'étranger pour trouver des financements. La fuite des cerveaux, qui a commencé massivement il y a une quinzaine d'années, se poursuit.

Financer la recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale est une erreur. Quel est votre domaine particulier de recherche ?
J'ai une "double vie". L'une concerne mon activité de recherche fondamentale à l'Institut Pasteur. J'ai étudié pendant de longues années les maladies neuro-dégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer – j'ai passé sept ans dans l'équipe de Jean-Pierre Changeux. J'ai abordé ensuite d'autres thématiques, notamment les effets de l'infection du virus du sida dans le cerveau. Plus récemment, j'ai abordé les mécanismes de la vie et de la mort des neurones dans la maladie de Creutzfeld-Jacob. Je m'intéresse aux modèles animaux pour tenter de mimer au mieux la maladie humaine – en l'occurrence des souris et des rats, qui développent des pathologies proches de celles que l'on peut observer chez l'humain. L'utilisation des souris a donné des résultats remarquables dans les recherches sur la maladie de Creutzfeld-Jacob, ce qui a valu d'obtenir deux prix Nobel. En revanche, il est plus difficile d'étudier la maladie d'Alzheimer car les souris vieillissantes ne présentent pas les symptômes de la maladie.
Ma deuxième vie m'amène à participer à la diffusion du savoir scientifique. Je m'intéresse au rapport entre sciences et société et j'essaie de lutter contre le regain des idées du déterminisme biologique des comportements humains. Je m'intéresse également à la neuro-éthique, en particulier aux dérives de l'utilisation de l'IRM, par exemple dans les cours de justice ou pour détecter les enfants turbulents considérés par certains comme futurs délinquants. En tant que neurobiologiste, ma mission est aussi d'informer le grand public sur l'état actuel des recherches sur le cerveau. Il est important d'expliquer ce qu'apporte l'IRM. L'IRM est un cliché instantané de l'état du cerveau d'une personne à un moment donné. Elle ne permet pas de prédire un comportement ni de reconstituer l'histoire d'une personne. Certains pensent que l'IRM permet aussi de lire les pensées dans le cerveau : c'est totalement faux.
Non, du fait de la plasticité cérébrale.
En tant que neurobiologiste, j'ai eu la chance d'assister à l'explosion des connaissances sur la plasticité cérébrale : j'ai à coeur de le communiquer à un large public. Expliquer que l'humain n'est pas programmé de façon irrémédiable et que tout peut évoluer est un message porteur d'espoir. Il arrive que des personnes me disent qu'en apprenant ce qu'est la plasticité cérébrale, ils ont trouvé le courage d'entreprendre une formation alors qu'elles ne s'en sentaient pas capables.. La plasticité cérébrale permet aussi de relativiser les idées déterministes que les médias nous assènent sur les femmes et les hommes.
Quant à l'utilisation de l'IRM, la prudence s'impose. Elle peut apporter le meilleur et le pire: le meilleur pour démontrer la plasticité cérébrale, le pire quand certains veulent l'utiliser pour détecter ceux dont le comportement ne correspond pas à la norme.

Il faudrait communiquer sur cette question pour mettre fin aux débats sur l'inné et l'acquis. Je suis convaincue de la prédominance de l'acquis, mais j'ai le sentiment que beaucoup pensent encore que nous naissons avec une tare qui ne peut que se développer tout au long de notre vie.
Vous serait-il possible de nous communiquer par écrit un aperçu de vos recherches ?
J'ai écrit quelques livres dont voici les titres : Cerveau, sexe et pouvoir, qui a reçu un prix de l'Académie des sciences morales et politiques, Hommes, femmes : avons-nous le même cerveau ? et Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Et je prépare actuellement : Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ?

On nous a inculqué que nous naissons avec un certain nombre de neurones que nous perdons tout au long de notre vie et qu'à partir d'un certain âge, il est plus difficile d'acquérir de nouveaux savoirs. Est-ce la réalité ?
Avez-vous le sentiment que les théories créationnistes et déterministes venues des États-Unis sont en progression en Europe ?
En ce qui concerne le vieillissement du cerveau, nos cent milliards de neurones cessent en effet de se multiplier dès notre naissance et nous en perdons ensuite un certain nombre. Mais cette perte n'est pas fondamentale dans le processus de détérioration des activités mentales dû au vieillissement. Les neurones ne meurent pas, mais ils sont moins fonctionnels : les messages chimiques et électriques qu'ils échangent entre eux sont moins efficaces. Cela dit, il existe en matière de vieillissement une variabilité individuelle très importante. Certaines personnes vieillissent du squelette, du colon, du coeur ou du cerveau, d'autres conservent très longtemps une grande clairvoyance. On ne peut pas dire qu'à chaque âge correspond un nombre de neurones. Selon son vécu, le cerveau d'une personne développe en permanence des phénomènes de compensation. Il n'existe pas de règle inéluctable en matière de vieillissement. La terre compte sept milliards d'individus qui ont tous des personnalités et des cerveaux différents.

Les différences que l'on constate entre deux personnes âgées sont-elles dues à la qualité des stimulations qu'elles reçoivent ?
Les stimulations jouent en effet un rôle important. Il existe une recette pour ne pas vieillir du cerveau : il suffit d'aimer la vie et de rester ouvert aux autres.
Le déterminisme biologique, qui consiste à penser que les caractéristiques de nos personnalités, de nos comportements, sont programmées dans notre cerveau, est inscrit dans l'histoire de la biologie. Cette idée connaît en effet un nouvel essor et je trouve cela préoccupant. Au XIXe siècle est née la phrénologie, théorie selon laquelle les bosses du crâne reflètent le caractère de l'individu. Pour les phrénologistes un grand front était le signe d'une poussée de la matière cérébrale, et donc un signe d'intelligence, d'ou la fameuse bosse des maths. Il était courant, à l'époque, d'utiliser la biologie pour justifier une hiérarchie sociale entre les femmes et les hommes, entre les blancs et les noirs, entre les classes aisées et les classes défavorisées. Ce n'est pas nouveau.
Nous avons récemment fêté le Centenaire de la découverte des hormones, qui fut une révolution pour les biologistes et les physiologistes. Cette découverte a permis de comprendre que les hormones étaient impliquées dans certaines fonctions et qu'elles étaient produites par différents organes du corps – le foie, le pancréas, l'intestin, l'estomac, mais aussi le cerveau grâce à la glande hypophyse, qui, en libérant des hormones dans le sang, influence l'ensemble du corps. La tendance de l'époque était de tout expliquer par les hormones.
Il y a une cinquantaine d'années, il y a eu l'essor de la génétique moléculaire. On a alors tout expliqué par les gènes : le gène de l'homosexualité, le gène de l'alcoolisme, le gène du bonheur.....
Depuis, la vogue du « tout génétique » est retombée car en décryptant le génome humain, nous nous sommes aperçus que l'humain ne possédait que 20 000 gènes, à peine plus qu'un ver de terre ! On ne peut plus désormais affirmer qu'un comportement humain est déterminé par un gène.
Depuis une vingtaine d'années, le cerveau est à la mode. Nous tombons dans les mêmes travers. Certains vont jusqu'à penser que l'IRM permet de discerner les zones de la délinquance, de l'homosexualité, de la dépendance aux drogues… Les recherches scientifiques doivent toujours être situées dans leur contexte social et leur époque.
La découverte de la plasticité cérébrale est une avancée extraordinaire. Elle est à l'oeuvre en permanence dans notre vie de tous les jours. Nous pensions autrefois qu'elle ne servait qu'à compenser les lésions, après un AVC par exemple, le cerveau formant de nouvelles connexions dans les zones adjacentes aux zones lésées. Mais nous ne savions pas que chaque jour, de nouvelles connexions sont fabriquées, pendant que d'autres se rétractent. Notre cerveau est un organe dynamique, qui évolue en permanence.
Tous les scientifiques n'ont pas pris en compte la notion de plasticité cérébrale. Certains persistent à penser que les différences entre les cerveaux des femmes et des hommes sont programmées à la naissance et immuables. Avec l'avancée des connaissances scientifiques, nous devons en permanence revisiter nos modèles.

Avez-vous l'impression que les théories créationnistes et déterministes sont en progression en France ?
C'est manifeste.

L'enseignement des sciences naturelles devrait être dispensé par un professeur ayant reçu une double formation de scientifique et d'historien. Il n'y a pas si longtemps, nous pensions qu'un enfant de trois ans était déterminé jusqu'à la fin de ses jours. La façon dont vous nous expliquez l'évolution des idées nous permet de comprendre pourquoi nous pensions ainsi.
La neuro-éthique est une nouvelle discipline dont le but est de veiller à ce que les neurosciences ne soient pas instrumentalisées à des fins autres que scientifiques. Vous avez certainement entendu parler du neuro-marketing, de la neuro-économie, de la neuro-informatique et maintenant de la neuro-justice… Cette « neurophilie » généralisée nous vient des États-Unis. La tendance est de vouloir expliquer le comportement des individus par leur cerveau, indépendamment du contexte social et culturel. Ainsi aux États-Unis, pour expliquer pourquoi on vote Républicain ou Démocrate , on fait passer des IRM à des électeurs pour examiner l'activation du cerveau lorsqu'on leur présente l'image de leur candidat.
Vous avez certainement entendu dire : « Si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, la banque n'aurait peut-être pas fait faillite ». Même Christine Lagarde, ministre de l'économie avait déclaré « La libido et la testostérone actionnent souvent les opérateurs de salle de marché» (Le Monde, 13 octobre 2010).
J'ai voulu comprendre pourquoi la testostérone était à l'honneur dans les discours économiques des politiques. Cela vient d'une expérience, publiée en 2008 dans une revue américaine de renom, réalisée chez des traders de la City of London. Les chercheurs ont mesuré le taux de testostérone de 17 sujets, le matin et après une journée de travail, en tenant compte de leurs performances, des risques financiers qu'ils avaient pris et de leurs gains en bourse. Ils ont noté une corrélation et en ont conclu qu'« un taux élevé de testostérone peut augmenter la prise de risque et perturber les capacités d'anticipation des marchés, cet effet étant susceptible de dévier les marchés financiers vers des choix irrationnels ».
Portons un regard critique sur cette expérience : tout d'abord, nous n'avons pas de preuve directe de l'action de la testostérone sur le cerveau des traders car cette dernière a été mesurée dans la salive - où elle n'est présente qu'à l'état de débris - ce qui ne permet pas de préjuger de sa concentration dans le cerveau ; par ailleurs, une corrélation n'est pas une relation de cause à effet ; enfin, l'étude portait sur 17 sujets, ce qui est peu représentatif de la population des traders. On ne peut donc pas conclure que l'effet de la testostérone sur le comportement économique est une réalité scientifique, néanmoins cet article a été repris par les médias du monde entier et ses auteurs continuent de publier des articles sur ce sujet.

Comment une célèbre revue scientifique peut-elle accepter une expérience effectuée sur 17 sujets ? Aucune critique ne s'est élevée pour dénoncer ce manque de rigueur ?
Lorsque vous lisez un article scientifique, il faut toujours consulter la section relative aux matériels et à la méthode utilisée.
Toutes ces expériences posent un problème de déontologie. Depuis une vingtaine d'années, les grandes revues scientifiques – Nature, Science – délaissant les critères d'excellence, ont tendance à publier les travaux qui seront médiatisés. Aux États-Unis comme en France, si l'on veut obtenir des crédits, il faut présenter un projet de recherche sur un sujet à la mode.
Autre exemple, le gène de la fidélité. Ce gène a été découvert chez les campagnols. Il existe deux types de campagnols, ceux qui vivent dans les prairies et ceux qui vivent dans les montagnes. Chez les premiers, le mâle est monogame et reste au nid après la naissance des petits ; en revanche, le campagnol des montagnes, lui, est polygame et quitte le nid. Que des animaux vivant dans des biotopes différents aient des comportements différents, rien de plus normal, mais cette caractéristique a intéressé des généticiens américains qui ont décidé de les étudier en laboratoire.
Ils ont observé des différences entre les cerveaux des campagnols au niveau de la région de l'hypothalamus, dans les structures sensibles à l'action d'une hormone appelée la vasopressine. Les chercheurs en ont conclu que ladite hormone jouait un rôle sur la fidélité des campagnols. Mais comment tester la fidélité en laboratoire? Les chercheurs ont placé un mâle et une femelle dans deux cages reliées par un tunnel. Ayant préalablement anesthésié la femelle pour qu'elle ne montre pas de signes d'attraction sexuelle, ils ont injecté au campagnol mâle quelques microlitres de vasopressine. Ils ont constaté que le campagnol des prairies reniflait la femelle pendant deux minutes, tandis que pour le campagnol des montagnes le reniflement ne durait qu'une minute. Voilà comment, à une minute près, le gène du récepteur de la vasopressine est devenu le gène de la fidélité !
Cet article, dont la rigueur scientifique est douteuse, a été néanmoins publié dans la revue Nature. Mais c'était en 1999, alors en pleine affaire Clinton-Levinski et ce n'est pas un hasard si cet article a été accepté pour publication à cette époque.
L'histoire de cet article est une illustration de la façon dont les règles déontologiques de publication dépendent des événements qui se produisent dans la société. La mode aujourd'hui est de parler des hormones de la fidélité, du coup de foudre, de l'amour. Cette description réductionniste de l'humain est inadmissible car elle ne correspond pas à la réalité scientifique. Prétendre que nos comportements sont dus à une hormone, c'est nier la spécificité et la diversité des êtres humains dans la vie psychique et sociale .

Si les scientifiques s'engagent dans telle ou telle recherche, c'est certainement pour confirmer une hypothèse de départ.
C'est souvent le cas
Un autre exemple nous est donné avec l'origine prétendument biologique de l'homosexualité. Dans une étude publiée par la revue Science en 1991, Simon LeVay a comparé la région de l'hypothalamus chez des hommes, des femmes et des hommes homosexuels à partir de cerveaux conservés dans le formol. Il a montré que chez les hommes hétérosexuels, un groupe de neurones avait un volume de 100 microns, c'est-à-dire 110ème de mm, alors que chez les femmes et les hommes homosexuels, le volume était de 50 microns. On peut dire que la différence est minime, sachant que 50 microns, correspond à environ 50 neurones. Comparés à nos 100 milliards de neurones, il est peu probable qu'une différence aussi minime puisse expliquer une préférence sexuelle. Cela n'a pas empêché Simon LeVay de conclure que l'orientation sexuelle avait une base biologique.
L'article n'a pas été très bien reçu par la communauté scientifique du fait de sa méthodologie discutable : les cerveaux des hommes homosexuels étaient ceux de personnes mortes du virus du sida, or cette maladie produit des lésions dans le cerveau – on ne peut donc les comparer avec d'autres cerveaux. D'autre part, chez les autres personnes, le statut d'hétérosexuel n'avait pas été contrôlé.
Deux ans plus tard, en 1993, une expérience, toujours publié par la revue Science, a été menée par un chercheur prétendant trouver un gène associé à l'homosexualité. Ses travaux n'ont jamais été reproduits et ont même été démentis à de nombreuses reprises. Mais leur couverture médiatique a été telle qu'ils sont toujours dans les esprits. En l'état actuel de nos connaissances, il n'existe aucun argument scientifique - qu'il s'agisse de l'anatomie du cerveau, des hormones ou des gènes - qui permette de dire que l'homosexualité a une base biologique.
Mais les années 1991 à 1993 étaient l'époque de l'épidémie de Sida aux États-Unis. Les homosexuels, qui en étaient les premières victimes, cherchaient à être reconnus en tant que minorité. Ce statut leur aurait permis de prétendre à un remboursement de leurs traitements. On ne peut comprendre une publication scientifique qu'en recherchant à quelle époque et dans quel contexte elle a été publiée.
Les neurobiologistes qui en sont conscients ne sont pas forcément majoritaires. Un certain nombre d'entre eux pensent encore que la science est neutre et n'a rien à voir avec le contexte social et économique.
Les discours des scientifiques reflètent aussi les convictions intimes des personnes.
Quant à la polémique sur l'enseignement du genre, il faut réaliser que le genre n'est pas une simple théorie, hypothétique et non scientifique. Le genre est un concept qui est le fruit des recherches menées dans un corpus de disciplines – la sociologie, la psychologie, l'histoire, l'anthropologie, la philosophie et la biologie – qui montrent comment l'environnement social et culturel forge nos identités de femmes et d'hommes.

Avez-vous lu les programmes de biologie de classe de première ? Nous avons auditionné les personnes qui les ont mis au point : nous n'avons pas réussi à leur faire admettre que l'identité sexuelle ne relève pas uniquement de la biologie.
Les programmes de l'Éducation nationale, leur traduction dans les manuels et la façon dont les professeurs les présentent relèvent des sciences sociales. La notion de genre repose sur un concept scientifique issu de nombreuses recherches en sciences humaines et sociales et désormais en biologie, avec la prise en compte des connaissances sur la plasticité cérébrale. La structure intime de notre cerveau est forgée par l'interaction avec l'environnement et l'expérience vécue l. Les notions de nature et de culture, d'inné et d'acquis, sont transcendées par la plasticité cérébrale. Un cerveau ne peut se construire que dans un environnement social. Les enfants sauvages et ceux qui ont été trouvés dans les orphelinats roumains souffraient d'importants retards mentaux. L'être humain est un être social. Pour que son cerveau se développe, il a besoin des autres. La façon de se vivre femme ou homme est le reflet de son interaction avec l'environnement social et culturel. Rien n'est fixé au départ, tout commence dès la naissance.
L'audition s'achève à dix-neuf heures quinze.