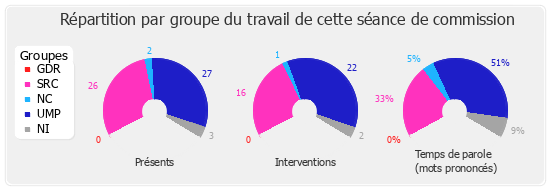Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république
Séance du 17 novembre 2010 à 10h00
La séance
La séance est ouverte à 10 heures.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission entend, dans le cadre d'une table ronde ouverte à la presse sur les jurisprudences relatives à la garde à vue, MM. les professeurs Yves Gaudemet, professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas, président du groupe de travail sur les aspects constitutionnels et conventionnels de la réforme de la procédure pénale, Didier Rebut, professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas, chercheur-associé à l'Institut de criminologie de Paris et Frédéric Sudre, professeur à l'Université de Montpellier.

Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la table ronde, ouverte à la presse, sur les jurisprudences relatives à la garde à vue. Nous entendrons dans ce cadre MM. Yves Gaudemet, professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas, qui a présidé le groupe de travail sur les aspects constitutionnels et conventionnels de la réforme de la procédure pénale, Didier Rebut, professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas, chercheur associé à l'Institut de criminologie de Paris, et Frédéric Sudre, professeur à l'Université de Montpellier. Messieurs les professeurs, je vous souhaite la bienvenue.
Si j'ai souhaité que la Commission des lois commence ses travaux sur la réforme en cours de la garde à vue par cette table ronde, c'est que l'évolution des règles relatives à la garde à vue est rendue nécessaire par la décision du 30 juillet 2010, dans laquelle le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions actuelles concernant les gardes à vue de droit commun « n'assuraient pas une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions ou la prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ». Il a toutefois décidé de reporter l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011, afin de permettre au législateur de revenir sur cette inconstitutionnalité.
De plus, depuis le dépôt du projet de loi qui découle directement de cette décision, trois arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont intervenus, qui devront être intégrés à notre réflexion avant le passage du texte en Commission des lois, prévu pour le 8 décembre prochain, et l'examen en séance publique, qui pourrait avoir lieu le 15 décembre, si la Conférence des présidents en décide bien ainsi.
Enfin, il importe au législateur français de connaître les implications précises des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), tant en matière de contrôle des mesures privatives de liberté que sur la question des droits dont bénéficieront les personnes gardées à vue.
Un questionnaire ayant été remis à chacun de nos invités, je vous propose de procéder en quatre étapes. Nous aborderons d'abord les implications des jurisprudences nationales et européennes sur le champ de la garde à vue, à partir de trois questions. Quel est, au regard des jurisprudences, le champ des infractions pouvant justifier un placement en garde à vue dans les affaires de droit commun ? Quels motifs peuvent justifier ce placement en garde à vue ? Le projet d'audition libre est-il compatible avec les différentes jurisprudences ?
Je vous remercie, monsieur le président, de la confiance que vous nous faites par provision en nous invitant : nous ferons tout pour l'honorer.
Le rapport dont vous avez eu communication est le fruit d'une initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors garde des sceaux, qui souhaitait être éclairée sur le cadre constitutionnel et conventionnel – il s'agit essentiellement, à ce dernier égard, de la Convention européenne des droits de l'homme – dans lequel il convient d'inscrire, dans le droit français, la réforme de la procédure pénale.
Il est vite apparu que la mise en oeuvre en France du contrôle prioritaire de constitutionnalité aurait pour effet d'harmoniser les exigences découlant de notre Constitution avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme : en effet, dès lors que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question touchant à la réforme de la procédure pénale, notamment de la garde à vue, maintiendrait une jurisprudence qui serait en deçà des exigences conventionnelles, la non-conformité de notre Constitution à ces mêmes exigences éclaterait aussitôt aux yeux de tous. De plus, l'actualité nous a servis au travers des deux arrêts « Medvedyev contre France » de la Cour de Strasbourg.
Je tiens, avant d'entrer dans le vif du sujet, à préciser que M. Frédéric Sudre est un des meilleurs connaisseurs de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, que M. Didier Rebut est un de nos grands pénalistes et que je suis, pour ma part, un constitutionnaliste. Le champ de la question est donc couvert par les trois branches du droit concernées.
Il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'implications directes et nécessaires des jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation ou de la Cour européenne de Strasbourg sur le champ des infractions pouvant justifier le placement en garde à vue.
Le projet de loi prévoit en revanche une organisation nouvelle qui, sans être directement commandée par ces jurisprudences, est inspirée du louable souci de limiter le nombre des gardes à vue. L'audition libre deviendrait ainsi la forme normale d'information en cas de soupçon, la garde à vue ne concernant plus que les personnes soupçonnées d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement – ce qui n'est pas le cas actuellement. De même, la prolongation de la garde à vue au-delà de vingt-quatre heures, jusqu'à quarante-huit heures, ne serait possible que si la peine encourue est égale ou supérieure à un an. Sans doute ces dispositions nouvelles sont-elles l'effet indirect du principe de proportionnalité, qui gouverne toute la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : pour celle-ci, en effet, toute mesure directement attentatoire à la liberté individuelle et entrant, de ce fait, dans le champ de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne doit être autorisée par la loi qu'en cas de soupçon portant sur une infraction susceptible, si elle est constatée, d'entraîner une peine d'une certaine importance.
La jurisprudence européenne ne permet pas de délimiter le champ des infractions pouvant justifier un placement en garde à vue. La Cour européenne a une conception très matérielle des choses : le critère à ses yeux essentiel, c'est la privation de liberté, laquelle entre dans le champ d'application de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 6 relatif aux garanties du procès équitable.
Or la garde à vue est bien une privation de liberté ou est, du moins, considérée comme telle : de ce fait, quelles que soient les infractions commises, elle entre bien dans le champ de la Convention.
S'agissant des motifs, le texte du projet de loi me paraît compatible avec la jurisprudence européenne : il ne peut y avoir privation de liberté que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction – tels sont, du reste, les mots utilisés dans le texte. Le texte respecte donc bien ce qui est, aux yeux de la Cour de Strasbourg, la condition sine qua non de la privation de liberté. Il convient également de noter que c'est le principe de proportionnalité qui fonde la jurisprudence de la Cour : s'il peut exister d'autres moyens que la privation de liberté pour assurer l'ordre public, il convient d'y recourir.
L'audition libre, telle qu'elle est prévue par le texte, n'est pas, en revanche, compatible avec les différentes jurisprudences, dans la mesure où ce dispositif permettrait d'échapper à l'application des garanties posées à l'article 6 de la Convention européenne. En effet, pour la jurisprudence européenne, toute mise en accusation en matière pénale entraîne l'application des garanties du procès équitable. De plus, la Cour a une conception toute matérielle de la notion d'accusation, très différente de celle de notre droit interne. Pour elle, toute personne soupçonnée d'une infraction, à partir du moment où ce soupçon peut avoir des répercussions importantes sur sa situation, doit être considérée comme accusée. Or, le texte le précise, une personne sera placée sous le régime de l'audition libre parce qu'elle sera soupçonnée d'avoir commis une infraction : la jurisprudence européenne la considérera donc comme accusée et cette personne devra relever, de ce fait, du champ des garanties prévues à l'article 6 de la Convention. Si la philosophie du projet de loi vise, par le biais de l'audition libre, à empêcher l'application des garanties dont doivent bénéficier les personnes placées en garde à vue, alors la disposition est assez radicalement contraire au droit européen.
Je tiens à préciser d'emblée que ni la Cour de cassation ni le Conseil constitutionnel n'ont joué un rôle moteur dans l'évolution de la jurisprudence relative à la garde à vue. Ces deux juridictions n'ont agi que sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vrai du Conseil constitutionnel, dont la décision ne peut être comprise qu'à la lumière de la jurisprudence européenne. C'est également vrai de la Cour de cassation qui, en matière de défense des droits de la personne gardée à vue, s'est contentée d'enregistrer les décisions de la Cour européenne et du Conseil constitutionnel, ce qui, évidemment, est très décevant de sa part. Elle n'a avancé sur la question que parce qu'elle n'avait plus le choix. Une telle attitude n'est pas défendable et justifie ma sévérité à l'encontre de cette juridiction dont les décisions ne font que reprendre celles de la Cour européenne.
J'ajoute que les jurisprudences nationales n'ont jamais abouti à délimiter le champ des infractions pouvant justifier le placement en garde à vue, tout type d'infraction pouvant donner lieu à un tel placement. C'est donc au législateur qu'il appartient de fixer un éventuel seuil. S'agissant de l'audition libre, il n'existe également aucune exigence en droit interne. Du reste, le droit européen ne prendra pas en considération les jurisprudences éventuelles de Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel en la matière : il jugera en fonction de ses propres critères. C'est lui seul qu'il convient donc d'interroger sur le sujet.
Il est vrai que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme nous « dépayse » à tous égards dans la mesure où sa démarche est casuelle : elle vérifie, pour chaque dossier, le respect de la proportionnalité ou de l'équilibre entre les atteintes à la liberté individuelle et les contraintes de la procédure pénale. Comme il est difficile de transposer en principes ses décisions, on ne saurait affirmer que, formellement, elle consacre ou interdit telle ou telle disposition, ce qui rend évidemment très difficile le travail du législateur.
Je tiens à souligner que l'audition libre a été introduite dans le projet de loi dans l'intention très louable de limiter le champ d'application de la garde à vue. Chacun s'accorde en effet à considérer que le nombre annuel des gardes à vue en France – près de 800 000 – est excessif, certaines d'entre elles étant du reste abusives, c'est-à-dire non justifiées par la politique pénale que conduisent légitimement les autorités publiques.
L'audition libre a donc été conçue comme une alternative douce à la garde à vue et cela n'apparaît pas illégitime dès lors que le principe de proportionnalité commande de réserver cette dernière aux personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions relativement graves puisque punies de peines d'emprisonnement. Cependant, est-ce bien d'alternative qu'il s'agit ?
Il convient en effet de noter que, de par son appellation même, « l'audition libre » est placée sous le signe de la liberté, ce qui en fait toute l'ambiguïté : puisque le présumé innocent demeure libre de ne pas se présenter à sa convocation devant les enquêteurs, son régime rejoint celui des témoins. Les textes lèveront-ils cette ambiguïté ou faudra-t-il pour cela s'en remettre à la pratique ? Je l'ignore.
Il n'en reste pas moins que si la vision qu'a M. Sudre de l'audition libre est exacte sur le plan juridique – elle est en effet fondée sur la Convention européenne des droits de l'homme –, elle doit être combinée au souci légitime de limiter le champ de la garde à vue, lequel est dicté par le principe de proportionnalité. Il convient en effet de recourir à un autre dispositif que la garde à vue à l'encontre de personnes soupçonnées de faits mineurs.

Monsieur le professeur Sudre, vous avez effectivement déclaré que l'audition libre, telle qu'elle est actuellement prévue dans le projet de loi, est contraire à la jurisprudence européenne : votre jugement porte-t-il sur le principe même de l'audition libre ou sur l'insuffisance des garanties protégeant la personne interrogée dans le cadre de l'audition libre ?
Mes propos ne visaient en aucun cas le principe de l'audition libre. Je tiens à rappeler deux choses : la Cour européenne a une démarche casuistique. De plus, elle ne s'arrête pas aux qualifications du droit interne mais à ce qu'elles recouvrent. Il en sera ainsi de la « garde à vue » et de l'« audition libre ». Elle vérifiera si le dispositif concerne le champ pénal et entraîne donc l'application des garanties afférentes à ce champ. L'arrêt Brusco du 14 octobre 2010 a, certes, condamné la France pour un régime antérieur de garde à vue, dans lequel la personne devait prêter serment. Toutefois, cet arrêt est intéressant dans la mesure où celle-ci avait été entendue comme témoin. Or, pour la Cour européenne, cette personne aurait dû être considérée comme accusée, au sens de la Convention européenne, dès lors qu'il existait des raisons plausibles de la soupçonner, et elle aurait dû bénéficier des garanties afférentes au procès équitable, alors que, pour le Gouvernement français, on ne se trouvait pas dans le champ de l'accusation. Aucune qualification de droit interne n'interdira donc à la Cour européenne des droits de l'homme de recourir à une qualification différente.
Ce n'est donc pas le principe d'un éventuel aménagement de la garde à vue qui est critiquable, mais le fait que la personne placée sous le régime de l'audition libre ne bénéficiera pas de la totalité des garanties qui doivent être accordées à toute personne considérée par la Cour européenne comme étant soumise à une accusation.

L'audition libre n'a pas pour objet de contourner la jurisprudence européenne. Cela reviendrait, du reste, à adopter une mesure susceptible d'être aussitôt attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle procède d'une volonté de faire de la garde à vue l'exception. La porte est étroite. Il est vrai que si l'audition libre est destinée à se dérouler, dans les faits, sinon en droit, dans les mêmes conditions que la garde à vue, sa création ne présente aucun intérêt. Selon vous, de quelle marge de manoeuvre le législateur dispose-t-il ?
La personne est convoquée mais elle est libre de se rendre ou non à son audition : telle est, je le répète, l'ambiguïté du dispositif. Ce qui fait la différence, toutefois, avec celui qui régit les témoins, c'est que, dans le cadre de l'audition libre, comme le précise le texte lui-même, la personne, tout en étant présumée innocente, est « soupçonnée », ce que la Cour européenne des droits de l'homme traduit par « accusée ». Cette personne devra dès lors bénéficier des garanties ou, du moins, dans un premier temps, de certaines des garanties requises par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il serait d'autant plus dommage que le mieux tuât le bien que l'intention des auteurs du texte est d'instaurer un dispositif moins agressif qui sera le seul moyen de limiter, à terme, le champ de la garde à vue. La Cour européenne devra se montrer sensible au principe de proportionnalité inscrit dans le dispositif. Du reste, elle n'est indifférente ni aux systèmes nationaux ni aux difficultés rencontrées par le législateur national, comme le montrent les deux arrêts Medvedyev.
Convient-il de tuer la garde à vue au nom des principes rappelés par M. Frédéric Sudre ? Je ne le cache pas : il sera difficile de concilier les garanties prévues par la Convention européenne et la spécificité de l'audition libre, qui repose sur le principe de liberté.
On peut avoir du mal à comprendre pourquoi des personnes sur lesquelles pèsent également des soupçons plausibles relèveraient de deux régimes différents. Par ailleurs, la modulation des garanties est une question d'autant plus délicate qu'elle n'a jamais été prise en considération par la Cour européenne. Aux yeux de celle-ci existent des garanties fondamentales, notamment la notification du droit de se taire et le droit à l'assistance effective d'un avocat dès l'arrestation, c'est-à-dire au premier moment de privation de la liberté, lequel précède la garde à vue proprement dite. Il convient de souligner que, même dans le cas de l'audition libre, la personne sera soumise à une contrainte. Il est donc difficile de prédire où la Cour de Strasbourg fera passer la frontière entre l'audition libre et la garde à vue. Je le répète : sa démarche est casuistique. C'est pourquoi, compte tenu de sa conception matérielle de l'accusation, je ne suis pas certain qu'elle soit sensible à la distinction subtile que le droit français opérera entre les personnes relevant de l'audition libre et celles relevant de la garde à vue. Ces personnes étant toutes soupçonnées, il s'agira à ses yeux d'une distinction purement formelle.
Ce principe entraîne une réflexion sur la modulation des garanties. Toutefois, la Cour européenne lie intimement le droit de garder le silence, qui est à ses yeux fondamental, au droit à la présence d'un avocat dès la première heure de privation de liberté, parce que c'est précisément l'avocat qui informe la personne de son droit à garder le silence. Il me paraît donc difficile de dissocier les deux garanties.

Ne pourrait-on pas soutenir que, sur le plan juridique, l'audition libre existe déjà ? C'est le régime des témoins. L'instauration d'un dispositif intermédiaire appelé « audition libre » ne me paraît donc pas pertinente. Du reste, une même personne peut passer du régime des témoins à celui de la garde à vue si des soupçons finissent par peser sur elle. Par ailleurs, l'audition libre risque de constituer un piège à nullité des actes de la procédure car elle ne fera que la compliquer davantage encore alors qu'il conviendrait au contraire de la simplifier.
Je suis frappé par la juridictionnalisation de la garde à vue, qui tend à reproduire ce qui s'est passé avec le juge d'instruction à la fin du XIXe siècle – présence de l'avocat, accès au dossier –, comme si les garanties d'un procès équitable devaient être appliquées dès la garde à vue. Or celle-ci, qui relève de la phase policière, diffère fondamentalement de la phase juridictionnelle. Il n'y a donc aucune raison d'anticiper dès la garde à vue le recours à la procédure prévue devant le juge d'instruction. Les garanties d'un procès équitable concernent-elles la garde à vue ? Celle-ci sert au lancement de l'enquête, qui peut être très complète. Des témoins sont également entendus. Il ne faut pas faire de confusion juridique entre les phases policière et juridictionnelle, même si le régime de la garde à vue doit garantir les droits des personnes suspectées comme des victimes.

Pourquoi anticiper sur la phase juridictionnelle ? Il ne convient pas d'appliquer à la garde à vue les garanties d'un procès équitable.

Prévoir un statut intermédiaire, permettant de se dispenser de certaines garanties, se heurte à une difficulté majeure.
Il ne convient pas, sous peine de favoriser certaines dérives, de distinguer une phase relevant de la police d'une phase relevant de la justice. En effet, la police agit en permanence sous le contrôle, voire sur l'injonction du juge. Personne n'est placé en garde à vue sans que le parquet, qui peut immédiatement s'y opposer, en soit informé. La garde à vue relève donc de la procédure judiciaire.
Je crains que le nouveau dispositif ne soit, dès sa mise en oeuvre, contesté par les instances mêmes qui nous ont conduits à réformer la garde à vue. Ce serait le contraire de ce que nos concitoyens attendent de législateurs responsables !
Peut-être nous manque-t-il, pour bien appréhender la question du champ de la garde à vue, une typologie précise des 800 000 gardes à vue annuelles. Monsieur le président, la Chancellerie ne pourrait-elle nous fournir toutes les informations nécessaires à ce sujet ? Combien de gardes à vue pourraient-elles être évitées si on se contentait de placer sous ce régime les personnes soupçonnées de délits pouvant entraîner une peine de prison ? Je me rappelle un ami placé toute une nuit par la police de Lille en garde à vue pour un taux d'alcoolémie de 0,6 gramme alors que, s'il avait été contrôlé en zone rurale, la gendarmerie l'aurait raccompagné chez lui ! Une typologie des gardes à vue permettrait certainement d'alléger le travail des policiers et des magistrats tout en respectant la logique de proportionnalité entre la privation de liberté et la nature des délits soupçonnés.

Par-delà son caractère quelque peu saugrenu, l'idée ayant présidé au dispositif de l'audition libre s'explique peut-être par la volonté de recourir à une double échappatoire.
La première consisterait, à la suite de M. Garraud, à inventer un nouveau concept reposant sur la distinction entre phase « policière » et phase « juridictionnelle ». Il conviendrait alors de préciser le plus tôt possible si les principes ayant entraîné les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation s'appliqueraient aux deux phases.
La seconde échappatoire est plus subtile : elle repose sur la proportionnalité. Les garanties de l'article 6 peuvent-elles être modulées selon l'adage : « À petit délit, petites garanties » ? Existe-t-il la moindre jurisprudence susceptible de nous encourager à suivre la piste suggérée par notre rapporteur, M. Gosselin ? Le principe de proportionnalité pourrait-il ouvrir la voie à un compromis en la matière ? Ce sont des questions de principe sur lesquelles la commission des Lois doit se pencher à la lumière des décisions de la Cour européenne.

À la fin du XIXesiècle, c'est vrai, l'autorisation donnée aux avocats d'assister leur client dans le bureau du juge d'instruction a été précédée d'un vif débat. M. Garraud se demande s'il est opportun d'abonder dans le sens d'une juridictionnalisation de la garde à vue. J'y suis personnellement favorable car elle permet d'augmenter les droits et les garanties de tous les citoyens. De plus, depuis quelques années, l'influence de la garde à vue sur la suite du procès pénal ne cesse de croître. Il est ainsi très difficile de revenir sur les aveux obtenus durant ce temps, alors même qu'ils ont été obtenus sous la pression ou dans des conditions contestables. Dois-je rappeler l'affaire d'Outreau ? Dans quantité d'affaires, lorsque la police commence à faire fausse route durant cette phase, même des magistrats compétents ne sont pas toujours capables d'orienter le dossier dans une nouvelle direction. Il est donc capital de favoriser la juridictionnalisation de la garde à vue.
Enfin, ne tourne-t-on pas autour du pot depuis des mois sur la question de la présence de l'avocat dès le commencement de la garde à vue ? Tous les pays européens, y compris l'Espagne qui est confrontée au terrorisme de l'ETA, prévoient cette présence, et la France, patrie des droits de l'homme, continue de s'interroger sur le sujet !

La décision du Conseil constitutionnel, si vous me permettez l'expression, ne « mange pas de pain » puisqu'elle ne concerne pas les dispositions relatives au terrorisme et à la criminalité organisée, notamment celles que j'ai fait adopter dans le cadre de la loi dite « Perben II ». La Cour de cassation a, quant à elle, fini le travail en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Ne nous trompons pas de débat ! Le vrai sujet n'est pas la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue : elle est acquise.

Il convient maintenant de l'inscrire dans la loi.
En revanche, la question porte sur les dispositions pratiques que le législateur, dans le respect de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, a le devoir d'adopter pour protéger la population, notamment des réseaux mafieux ou terroristes.

La voie est étroite, en raison notamment de la difficulté posée, en France comme dans d'autres pays, par des organisations criminelles qui disposent d'importants moyens, notamment des meilleurs avocats, pour rendre les enquêtes plus malaisées.
Pour préciser la suggestion de M. Roman, je propose que deux de nos collègues soient missionnés auprès du ministère de l'intérieur afin d'étudier la typologie des gardes à vue prononcées. Les ministres de l'intérieur successifs ainsi que les syndicats de policiers nous ont, bien sûr, expliqué qu'elles étaient toutes indispensables. Mais nous voyons bien que ce n'est pas le cas – on pourrait multiplier à l'envi les exemples. Ainsi, le dégrisement d'une personne ayant conduit sous l'empire d'un fort degré d'alcoolémie exige-t-il vraiment son placement en garde à vue ? On pourrait attendre que l'intéressé recouvre ses esprits. Une mission parlementaire serait donc utile pour clarifier les choses.
Un autre élément me paraît inquiétant du point de vue du respect des libertés publiques. Le recours aux enquêtes préliminaires tend à devenir systématique et celles-ci à aller de plus en plus loin. Auparavant, un magistrat demandait une telle enquête au procureur afin de savoir s'il existait des raisons objectives de considérer qu'une infraction avait été commise. Maintenant, dans un nombre croissant de cas, l'enquête de police se poursuit quasiment jusqu'à ce que l'affaire soit en état d'être jugée, et c'est seulement alors que les droits de la personne mise en cause sont ouverts. Je comprends parfaitement qu'en face d'un crime, une enquête soit nécessaire avant d'expliciter des soupçons. Pour autant, une personne placée en garde à vue doit savoir ce qu'on lui reproche, avoir au moins connaissance des déclarations proférées à son encontre. Car beaucoup de choses découlent de ce qui est dit en garde à vue. Cela entre dans notre thème de discussion relatif au nouveau rôle dévolu à l'avocat et à la possibilité pour lui d'accéder au dossier ou aux pièces de la procédure. Doit-il avoir accès à tout ? Nous devons travailler à cette question. Aujourd'hui une personne peut répondre à une simple convocation de police et se retrouver en garde à vue quelques instants plus tard sans aucun moyen de savoir ce qu'on lui reproche. Un traquenard judiciaire est ainsi facile à monter.
Le vrai sujet réside dans la méthode policière et dans ce qu'enseignent les écoles de police. Notre pays est l'un des rares, depuis des siècles, à pratiquer la culture de l'aveu plutôt que celle de la preuve, les indices servant surtout à obtenir le premier et non à établir la seconde : un dossier comportant un aveu est considéré comme définitivement bouclé. Le Parlement devrait donc exercer un contrôle sur la formation des policiers, notamment des officiers de police judiciaire, afin que l'orientation de leurs enquêtes vise moins à réunir des indices susceptibles de faire « craquer » un suspect qu'à faire concorder ces indices afin d'établir des preuves irréfutables.
Certes la jurisprudence de la Cour européenne s'impose à nous mais il faut parvenir à dissocier le crime organisé et le terrorisme des autres incriminations, peut-être à partir du quantum des peines encourues.

Coexistent deux principes et deux écoles pour les défendre. Le premier, auquel je suis très attaché, est celui de la liberté : il exige la présence immédiate de l'avocat. Le second réside dans la nécessité de prouver les éléments de l'infraction. Or on perçoit à cet égard une angoisse sous-jacente, provenant de la crainte que la présence de l'avocat ne rende plus difficile l'établissement de la preuve de la culpabilité. Autrement dit, plus la personne soupçonnée bénéficierait de droits et de protections, moins la vérité serait susceptible d'apparaître. Si l'on pousse ce raisonnement jusqu'au bout, cela conduit à considérer que la garde à vue empêche d'établir la vérité : c'est donc un raisonnement pernicieux.
La culture de l'aveu appartient à un temps révolu. Seule celle de la recherche des preuves matérielles doit prospérer, ce que rendent possible les progrès techniques dont bénéficie aujourd'hui la police judiciaire. Il ne faut donc pas rester arc-bouté sur de vieux schémas. Je maintiens donc que la présence de l'avocat s'impose dès la première heure.

Je soutiens la demande d'une typologie des gardes à vue. On se rendra alors vite compte de la dérive de cette procédure, devenue une facilité d'enquête afin d'extorquer des aveux le plus rapidement possible. Elle s'explique par le manque de moyens de la police judiciaire mais traduit aussi une certaine paresse dans la conduite des enquêtes : on considère que l'obtention d'aveux ne peut qu'accélérer l'instruction.
La présence de l'avocat dès la première heure n'est d'aucune utilité si celui-ci n'a pas accès au dossier. Il ne sert que de soutien psychologique et de réconfort moral jusqu'à la vingtième heure. Le système est même pervers car, le plus souvent, dans une affaire sérieuse, l'avocat conseille d'abord à son client d'en dire le moins possible afin de ne pas compliquer son travail ultérieur de défenseur. Le premier réflexe protecteur consiste à exercer le droit au silence, ce qui, parfois, peut contribuer à bloquer le déroulement d'une enquête. En effet, le dialogue peut contribuer à éviter, par la suite, des procédures trop longues.
Demeure la question lancinante des conditions matérielles de la garde à vue. Celles-ci constituent aujourd'hui un moyen de pression. Car, contrairement à tout ce que l'on a dit depuis dix ans, elles ne se sont pas améliorées. La nourriture est désastreuse. La venue du médecin intervient selon des modalités très discutables : on fait souvent appel à SOS médecins, qui effectue alors un ensemble de visites aux termes d'un contrat financier qui lie cet organisme à l'administration. Les praticiens ont tendance à passer sur un certain nombre de situations ou à se montrer extrêmement prudents. Il faut donc procéder à une analyse approfondie des conditions de déroulement des gardes à vue. On s'apercevra alors de la dénaturation de la procédure judiciaire, si même l'on ne peut pas parler d'une paralysie, du fait de la multiplication des actes de procédure visant à « détricoter » ce qui s'est passé durant la garde à vue.

Je m'associe à la demande d'inventaire et de typologie des gardes à vue, en fonction notamment de la nature des infractions concernées. Mais il faut étudier également les conséquences et, surtout, les modalités d'organisation de la présence effective de l'avocat dès la première heure. Dans les zones rurales, ou même dans certaines villes, on risque en effet de se heurter à des difficultés dans l'application de cette mesure. Or il est impératif d'assurer une égalité d'accès aux droits de la défense et au ministère d'un avocat sur l'ensemble du territoire. Nous devons en tenir compte au moment de légiférer : ne prenons pas le risque de faire une bonne loi dont la mise en oeuvre concrète ne pourrait être que critiquable !

Notre groupe parlementaire de la Gauche démocrate et républicaine avait déposé, en février 2010, une proposition de loi portant réforme de la garde à vue, qui n'a pas été retenue. Nous proposions notamment de rendre obligatoire la présence de l'avocat dès la première heure. Il s'agit évidemment d'une mesure nécessaire mais à quoi servirait-elle si elle se limitait à un entretien de trente minutes et si l'avocat n'avait pas accès au dossier pénal ? Par ailleurs, nous exigions la notification du droit au silence.
Je m'associe moi aussi à la demande d'un inventaire de la garde à vue, devenue une facilité inévitable pour compenser la réduction des effectifs de la police et, surtout, l'instrument d'une primauté de la police sur la justice. Nous suggérions donc, dans notre proposition, un certain nombre de pistes : il s'agissait en particulier de faire dépendre la garde en vue de la qualification de l'infraction et de la subordonner à une autorisation préalable de l'autorité judiciaire.
On ne peut donc que se réjouir du débat d'aujourd'hui mais il me semble qu'on tourne un peu autour du pot. Il est clair que notre droit n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a donc pas matière à se torturer les méninges pour découvrir comment tordre le cou à celle-ci ou comment échapper à ses prescriptions. Avancer l'idée de l'audition libre revient à prendre les parlementaires, les juristes et les magistrats pour des imbéciles. Dans cette Commission qui contribue à l'élaboration de l'État de droit, essayons plutôt d'élaborer un texte conforme à la Convention européenne, ainsi qu'aux principes édictés par les pères fondateurs de nos libertés. Cela implique notamment de garantir le droit au silence et de renoncer à des pratiques qui ont conduit à faire passer le nombre de gardes à vue de 250 000 à 600 000, évolution effrayante dans un État de droit comme le nôtre. Le justiciable doit bénéficier de toutes les garanties inscrites dans la Convention européenne.

Je ne suis pas certain de l'utilité d'un régime dérogatoire. Ne court-on pas le risque que, fût-il validé par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation maintienne sa jurisprudence ou bien que la Cour européenne invalide ce dispositif ? Si nous devons néanmoins travailler à un tel régime, où pourrait-on placer le curseur de la dérogation ? Quelles modalités prévoir ? L'idée de soumettre l'autorisation de dérogation à un juge du siège serait-elle acceptable, réserve faite des difficultés d'application ?

La typologie des gardes à vue dont nous aurions besoin devrait aussi retracer l'évolution du recours à cette procédure au fil du temps. Le nombre de gardes à vue s'est accru de 71% depuis 2002 parce qu'on a voulu faire augmenter artificiellement le taux d'élucidation des crimes et des délits. En effet, l'appareil statistique de la police nationale comptabilise les faits comme élucidés dès lors qu'une garde à vue est prononcée. Tel est l'effet pervers de la politique du chiffre, le ministre de l'Intérieur brandissant comme un trophée cette augmentation du nombre de gardes à vue.
La présence de l'avocat se révèle indispensable. Dès lors, se pose la question de savoir comment l'organiser matériellement et, plus largement, comment faire que la garde à vue se déroule dans des conditions enfin décentes. D'autres pays ont aménagé des bâtiments spéciaux comprenant, par exemple, un bureau pour les avocats, un service médical et des locaux d'interrogatoire modernes. Or, ce qu'il serait possible de faire en ville sur ce modèle pourrait ne pas l'être en milieu rural.
Il faut sortir de la culture de l'aveu. On invoque, pour justifier un régime dérogatoire, les affaires de terrorisme et de criminalité organisée. Cependant, il me semble que c'est plutôt lorsqu'ils sont confrontés à des faits de violences sexuelles ou familiales que les enquêteurs rencontrent les plus graves difficultés. Dans ce domaine spécifique, on ne dispose, le plus souvent, d'aucun élément de preuve matérielle. Or la pression psychologique exercée au cours de gardes à vue permet plus facilement d'établir la vérité en obtenant des aveux…
L'avocat étant présent, dans quelle mesure et à partir de quel moment peut-on considérer qu'il devient le garant du respect des droits de la personne incriminée ? Si ce point était acquis, on pourrait alors alléger les procédures écrites, actuellement très lourdes, en particulier s'agissant de prendre acte de la notification des droits de la personne entendue. Ne pourrait-on, par exemple, se contenter d'un procès-verbal de synthèse, à la fin des auditions ?

Voilà que nous relançons le débat général sur la garde à vue ! J'avais cru comprendre que l'objet de cette table ronde était plutôt de cerner des questions très précises.
Le projet que nous allons examiner est clair, le problème de la présence de l'avocat durant la garde à vue ne se pose plus.
Je voudrais cependant répondre à M. Dray et à Mme Batho sur la politique du chiffre, en rappelant que c'est la Cour de cassation elle-même qui, dans des arrêts de décembre 2000 et de juin 2003, a étendu sa jurisprudence en demandant le placement en garde à vue dans un certain nombre de cas, parce que le régime de celle-ci lui paraissait spécialement protecteur. Les 71% d'augmentation mentionnés ne résultent donc pas seulement de directives gouvernementales !

Nous avons, il est vrai, commencé ce débat par une discussion générale, mais elle était nécessaire. Je propose donc que nos invités répondent maintenant aux questions posées sur le champ de la garde à vue.
Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Le champ d'application de la garde à vue dépend de l'accusation, c'est-à-dire des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction. Mais on ne peut étendre le statut du témoin à quelqu'un qui ferait l'objet d'une suspicion. La Cour de cassation l'a clairement indiqué : dès lors qu'existe une suspicion, on doit basculer dans le régime de la garde à vue et le respect ou non de ce point engage la validité de la procédure ultérieure. Tel est l'état actuel du droit. Si donc on veut réduire le champ de la garde à vue, il faut trouver d'autres biais. Une des pistes possibles réside dans la formule de l'audition libre. Le droit interne est silencieux à cet égard mais, comme je l'ai dit, on peut glaner des éléments dans la jurisprudence européenne. En effet, si, en leur état actuel, les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel n'excluent pas une telle formule, ces deux hautes juridictions abordent ce type de question en considérant d'abord ce qu'a dit la Cour européenne, ne serait-ce que parce qu'elles n'aiment pas être censurées par celle-ci – même si la Cour de cassation en a un peu plus l'habitude que le Conseil ! Cela signifierait en effet, soit qu'elles défendent mal les droits de l'homme, soit que la Constitution française n'est pas assez respectueuse de ces droits. L'appréhension du régime de l'audition libre par nos juridictions nationales dépend donc des informations provenant du droit européen. Or, selon le professeur Sudre, à qui je m'en remets à ce sujet, le régime actuellement proposé serait contraire à la Convention européenne.
Celle-ci admet toutefois que l'on puisse renoncer à certains droits lorsqu'on en est informé. Mais est-ce valable pour tous les droits, et dans quelle mesure ? Je laisse à mon collègue le soin de se prononcer sur ces points.
Dès lors qu'existent des raisons plausibles de soupçonner une personne, on entre en effet dans le champ d'application de l'accusation en matière pénale, et des stipulations de la Convention européenne.
Le débat sur la juridictionnalisation est clos. Au regard de la Cour européenne, les garanties du procès équitable, notamment les droits de la défense, doivent être respectées dès la phase de l'instruction préliminaire et de l'interrogatoire de police. La jurisprudence de la Cour est constante en la matière.
Le projet de loi fait notablement évoluer le champ de la garde à vue : celle-ci ne pourra être prononcée que si la personne est passible d'une peine d'emprisonnement, et ne pourra être renouvelée que si cette peine de prison est égale ou supérieure à un an. Cela conduit à limiter le champ de la garde à vue et à réduire le nombre de ces mesures, comme tout le monde le souhaite. Seront ainsi éliminées les gardes à vue « disciplinaires », à des fins d'intimidation, utilisées parfois contre des gens qu'on ne soupçonne de rien – nous avons connu des exemples récents, dans lesquels il ne s'agissait que de punir des individus.
La connaissance de la typologie des gardes à vue nous aiderait grandement à apprécier dans quelle mesure le champ de cette mesure se trouverait ainsi restreint. Peut-être alors n'aurions-nous plus besoin de l'audition libre pour laquelle, visiblement, on n'est pas parvenu à un dispositif juridiquement équilibré. On reste en effet pris dans une contradiction : à partir du moment où une personne est soupçonnée, s'appliquent à elle les garanties protectrices des droits de l'homme et, cependant, on ne veut pas qu'il s'agisse d'une garde à vue « au petit pied ».
La chancellerie détient déjà des statistiques, dont certaines très précises – ainsi pour les gardes à vue consécutives à des infractions routières.
À côté de la question des garanties, se pose celle de la nécessité de la garde à vue, qui n'est pas toujours respectée. Pour qu'elle le soit davantage, s'offrent deux possibilités.
On pourrait, en premier lieu, invoquer le principe général de nécessité. Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation refuse aujourd'hui d'en contrôler le caractère substantiel. À la question de savoir si le juge pourrait remettre en cause une garde à vue au motif qu'elle n'était pas nécessaire, elle a répondu qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier ce point. On pourrait naturellement, par voie législative, contraindre la Cour à exercer ce contrôle, auquel elle se refuse pour des raisons tenant probablement à ce que la justice, redevable à la police du travail qu'elle effectue, ne souhaite pas froisser cette dernière…
On pourrait aussi essayer de contraindre la Cour en fixant des critères formels, par exemple en posant que seules certaines infractions peuvent donner lieu à une garde à vue et le juge serait alors obligé de constater, le cas échéant, que la nature de l'infraction n'autorisait pas un placement en garde à vue. Il en irait de même pour le renouvellement. La Cour de cassation se trouverait ainsi contrainte à exercer un contrôle de légalité formelle comportant des éléments de nécessité.

Nous en venons au deuxième thème de la table ronde : le placement en garde à vue et le contrôle de la mesure. Je rappelle les deux questions que nous avions formulées par écrit : faut-il faire évoluer le système actuel de placement en garde à vue par un officier de police judiciaire ? Faut-il confier le contrôle de la garde à vue à un magistrat du siège ?
La jurisprudence de la Cour européenne doit constituer la référence pour le législateur français : c'est elle qui fixe les standards. Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont ainsi dû accomplir un exercice de rattrapage, le premier ayant utilisé la possibilité de tenir compte d'un changement de circonstances pour revenir sur une loi, relative au régime douanier, qu'il avait déclarée conforme à la Constitution. Il revient au législateur national de s'aligner sur cette position.
Faut-il faire évoluer la jurisprudence concernant le régime actuel de placement en garde à vue par un officier de police judiciaire ? Et faut-il confier le contrôle de cette garde à un magistrat du siège ? S'agissant d'une mesure privative de liberté, la jurisprudence européenne impose aujourd'hui un tel contrôle, ce qui ne signifie pas que le parquet est dessaisi de la conduite de la garde à vue. Mais un magistrat du siège, disposant seul de la qualité de magistrat au sens de cette jurisprudence, doit intervenir, non pour en surveiller les modalités, notamment la conduite des interrogatoires, mais pour vérifier que l'atteinte ainsi portée à la liberté de l'individu est bien proportionnée à ce que requièrent l'ordre public et la politique pénale. Il remplit donc une mission particulière qui se surajoute à celle du parquet chargé de contrôler les opérations de garde à vue.
La qualité d'officier de police judiciaire permet de placer une personne en garde à vue. Cependant, si les OPJ étaient peu nombreux il y a cinquante ans, cette qualité, aujourd'hui extrêmement répandue, s'est diluée. Nous nous étions donc demandé si, pour certaines infractions, la décision de placer en garde à vue ne devait pas être réservée à une certaine catégorie d'officiers de police judiciaire pourvus d'une habilitation spécifique. Mais la réflexion n'a guère avancé sur ce point.
Il faut bien distinguer la décision de placement en garde à vue et le contrôle juridictionnel de celle-ci. Que la décision soit prise par un officier de police judiciaire n'est pas anormal, sous la réserve que vient d'indiquer le professeur Gaudemet et sous celle, peut-être, de préciser la qualité d'officier de police judiciaire. Mais la jurisprudence européenne exige que, dès l'instant où il y a privation de liberté, un contrôle juridictionnel s'exerce. Celui-ci doit remplir certaines conditions : la promptitude, l'automaticité – la personne ne doit pas avoir à solliciter elle-même un contrôle –, et surtout un contrôle exercé par un magistrat ou par une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Or, toute la jurisprudence de la Cour européenne démontre qu'en France, le procureur de la République n'a pas cette qualité : il n'est pas un magistrat. La Cour a déjà condamné plusieurs États sur ce fondement, en particulier l'Italie et la Roumanie. Dans son arrêt Medvedyev contre France, sans statuer directement sur la question, elle a néanmoins clairement rappelé ses exigences. D'une part, le magistrat, au sens de la Convention européenne, doit être indépendant de l'exécutif, ce qui n'est pas le cas du procureur de la République, placé dans une situation de subordination hiérarchique. D'autre part, ce magistrat doit pouvoir se prévaloir d'une impartialité fonctionnelle, c'est-à-dire ne pas être susceptible d'exercer ensuite des poursuites contre la personne qu'il aura lui-même placée en garde à vue, ce qui n'est pas non plus le cas du procureur de la République. Le contrôle de la garde à vue et de sa prolongation ne peut donc appartenir, aux termes de la Convention européenne, qu'à un magistrat du siège.

Il faut distinguer l'indépendance statutaire du procureur, dont je voudrais qu'il bénéficie un jour, et son indépendance fonctionnelle, que je ne souhaite pas lui voir accorder.
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a glissé de la notion d'indépendance organique à celle d'impartialité fonctionnelle. Elle considère qu'un magistrat engageant des poursuites ne peut, ensuite, contrôler le bien-fondé de la procédure correspondante. Ce qui pose aussi, en France, le problème du juge d'instruction.
Sur ce thème, nous n'avons pas d'indications particulières en provenance de la Cour de cassation. Le placement en garde en vue peut être décidé par un officier de police judiciaire ou par un « parquetier », mais son contrôle ne peut relever que d'un magistrat au sens de l'article 6 de la Convention européenne.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel est en retrait sur celle de la Cour européenne. Dans sa décision QPC du 30 juillet 2010 concernant la garde à vue, il a réaffirmé que l'autorité judiciaire comprenait à la fois les magistrats du siège et du parquet. C'est vrai en droit interne, mais non au regard de la Convention européenne.

Nous en venons au troisième thème de notre table ronde : les implications des jurisprudences nationales et européennes sur les droits de la personne gardée à vue, avec deux questions : « la notification des droits prévue par le texte est-elle conforme aux jurisprudences ? » et : « le rôle nouveau dévolu à l'avocat est-il suffisant ? Notamment, l'avocat doit-il pouvoir accéder au dossier ou aux pièces de la procédure et doit-il pouvoir poser des questions lors des auditions ? »
L'intervention de l'avocat est maintenant chose acquise. Mais il faut savoir que, dans deux cas sur trois, il ne vient pas. C'est un constat de fait que le législateur doit prendre en compte.
La présence de l'avocat exigée par la Convention européenne vise la présence « utile », consistant, non à participer directement à la défense de la personne gardée à vue mais à l'informer de son droit à garder le silence et, sachant ce qui lui est reproché et connaissant peut-être certains éléments du dossier, à lui assurer une assistance psychologique.
La jurisprudence de la Cour européenne, tout en étant très claire, laisse subsister une certaine incertitude. Si le texte de la Convention parle d'assistance, elle sanctionne de façon très nette l'absence de l'avocat. Elle exige donc sa présence physique, dès le placement en garde en vue et lors du premier interrogatoire de police. Une ambiguïté demeure cependant sur le rôle exact qu'il a à tenir, plus précisément sur la question de son accès au dossier.
La Cour européenne ne s'est jamais clairement prononcée à ce sujet mais elle a donné une définition du rôle de l'avocat laissant nettement entendre que celui-ci doit avoir accès au dossier. Ainsi elle a considéré qu'il doit pouvoir exercer librement « les éléments fondamentaux de la défense », qu'elle a énumérés en ces termes : « la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention. » J'incline à penser que les cinq premiers éléments mentionnés supposent un accès substantiel au dossier. Mais il règne, je le répète, une certaine incertitude à cet égard.
Par ailleurs, la jurisprudence européenne, affirme de façon constante en matière de garantie des droits communs, que le droit de se défendre implique pour l'accusé un droit d'accès à son dossier et à la communication des pièces de la procédure. À mon sens, il ressort donc de l'ensemble de la jurisprudence européenne que l'avocat doit avoir accès au dossier, au moins en partie, dès le début de la garde à vue.
Les récents arrêts de la Cour de cassation s'inscrivent tout à fait dans cette perspective. La Cour reprend bien évidemment les critères de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et ceux de la jurisprudence européenne, puisqu'il s'agissait d'examiner la conformité des règles de la garde à vue au droit européen. Se référant à la notion d'assistance effective, elle considère que l'assistance prévue par le droit français est aujourd'hui insuffisante. La décision du Conseil constitutionnel s'appuie sur la même notion, ce qui montre bien la pression exercée par la Cour européenne des droits de l'homme sur les deux juridictions françaises. On peut dire que les trois juridictions vont désormais dans le même sens : l'assistance de l'avocat doit être prévue dès la première heure.
Le récent arrêt de la CEDH, où il est clairement fait mention de l'« assistance pendant les interrogatoires », me semble mettre fin au débat sur le sens à donner au mot « assistance », débat à la faveur duquel certains voulaient repousser le moment où l'avocat est effectivement présent. Je ne vois pas comment cette assistance pendant les interrogatoires pourrait se faire par téléphone, ou de façon intermittente.
Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation sont également clairs sur ce point, le premier sans le dire car il n'est pas censé appliquer le droit européen, la seconde en le disant car elle est censée contrôler la conformité de nos textes à la Convention européenne des droits de l'homme. Dans ce domaine, la Cour de cassation a estimé que notre droit n'est pas conforme au droit européen parce qu'il ne prévoit la présence de l'avocat ni dès le début de la garde à vue ni pendant les interrogatoires.
En ce qui concerne l'accès au dossier, la jurisprudence de la CEDH peut paraître peu explicite mais il est tout de même précisé que l'avocat doit être en mesure d'accomplir sa mission. Celle-ci ne saurait se résumer au fait d'être présent et de réconforter la personne placée en garde à vue – d'autres qu'un avocat pourraient tout aussi bien remplir ce rôle. Elle vise, indique la Cour, à « construire une défense », ce qui suppose la connaissance d'un minimum d'éléments d'information.
Le débat porte sur le degré d'information nécessaire : l'avocat doit-il avoir accès à toutes les pièces, doit-on avoir la possibilité d'en retrancher certaines ? Dans certaines législations européennes, la possibilité de ne pas communiquer l'intégralité du dossier relève de la décision d'un magistrat.
Cette question nous mène à celle des régimes dérogatoires, que nous verrons par la suite.

Je vous propose d'y venir dès maintenant.
Le projet de loi se limite aux gardes à vue de droit commun, mais son champ devra être élargi à la retenue douanière et aux régimes dérogatoires. Quelles contraintes jurisprudentielles pèsent sur ces deux champs ?
Sauf erreur de ma part, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ne prévoit ni ne reconnaît les régimes exceptionnels en tant que tels. Elle admet cependant que, à titre exceptionnel et au cas par cas, on puisse faire reculer les garanties de droit commun pour des raisons d'ordre public. Il semble difficile de traduire cette position en termes de régime dérogatoire.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour ne comporte aucune indication concernant la durée et la reconduction de telles mesures à partir du moment où est garanti le contrôle d'un magistrat au sens de la Convention européenne des droits de l'homme – c'est-à-dire d'un magistrat du siège.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel, contrastée en apparence mais complétée par celle de la Cour de cassation, fait apparaître la nécessité conventionnelle d'étendre, dans leur principe, les garanties exigées pour la garde à vue de droit commun aux régimes dérogatoires. Mais cela n'exclut pas la possibilité de reconduction pour des durées plus longues dès lors que la garantie du magistrat du siège existe, et cela n'interdit pas, à titre exceptionnel – d'où la difficulté à l'inscrire dans la loi –, un équilibre un peu différent entre les garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme et les nécessités de la poursuite pénale et de l'ordre public.
La Cour européenne de Strasbourg ne s'est pas prononcée expressément sur le principe des régimes dérogatoires mais elle a eu à connaître de problèmes de garde à vue dans le cadre de tels régimes et a jugé qu'ils ne sont pas en eux-mêmes contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et que le code de procédure pénale peut parfaitement les prévoir. Mais la Cour estime qu'une législation ne peut faire obstacle de façon systématique à certains droits, dont celui à l'assistance d'un avocat pour les personnes gardées à vue. Aussi les régimes dérogatoires doivent-ils circonscrire très précisément les restrictions apportées aux droits de la défense, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui puisqu'ils s'appliquent de façon automatique et systématique.
Ce sont en effet l'automaticité et la systématicité qui sont contraires à la Convention européenne : selon la Cour, « une restriction systématique sur la base de dispositions légales pertinentes suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention ». Quant à savoir s'il peut y avoir des restrictions circonstancielles clairement définies, je crois qu'il faut être très prudent. La Cour, en effet, a durci sa position. Si, dans le passé, elle a pu admettre que l'absence d'avocat lors de la garde à vue, notamment en matière de terrorisme, était compatible avec la Convention européenne pour peu que les garanties du droit de la défense fussent respectées ultérieurement, elle a considéré dans une jurisprudence plus récente que l'absence de l'avocat a « irrémédiablement nui » aux droits de la défense même si la procédure ultérieure les a garantis, et elle a prononcé une sanction.
Bref, il n'existe pas d'incompatibilité radicale entre la jurisprudence de la Cour et les régimes dérogatoires, mais il me semble que les aménagements doivent être extrêmement prudents pour ce qui est de la garantie des droits de la défense.
Sur ce point, la position de la Cour de cassation se situe, une nouvelle fois, dans le prolongement de celle de la CEDH. S'appuyant sur la jurisprudence européenne, la Cour de cassation estime en effet qu'il est possible de déroger à la présence de l'avocat mais que cette exception doit être circonstanciée, c'est-à-dire qu'elle doit tenir à des raisons impérieuses. Or le régime dérogatoire français actuel s'organise autour de qualifications générales et c'est cela qui est récusé. Il n'est pas possible de disposer que toute infraction, sous le prétexte qu'elle est qualifiée de telle ou telle manière, doit entraîner le report de la présence de l'avocat : il faut circonstancier ce report en établissant une motivation au cas par cas.

Bien que l'intervention de l'avocat soit désormais acquise, on doit prendre en compte la situation de fait décrite par le professeur Gaudemet et par M. Dominique Perben : en règle générale, l'avocat ne se déplace pas. À l'instar du médecin, qui doit accéder aux analyses pour établir un diagnostic et défendre le patient contre la maladie, l'avocat ne pourrait-il, moyennant l'accès au dossier, trouver dans le sentiment de son utilité une véritable motivation ?

La présence, comme l'assistance, peut être seulement passive. Il faut préciser ces notions. L'avocat pourra-t-il poser des questions, répondre directement, parler, suggérer des réponses ? Quelle sera sa participation ?
Une explicitation des dispositions dérogatoires semble désormais nécessaire. Qui la fera, sinon le magistrat du siège ? Comment en établir les modalités pour respecter le cadre général ?

La jurisprudence européenne permet-elle aux avocats de demander un acte au stade de la garde à vue ? C'est un élément important de la philosophie du projet de loi, qui vise à permettre la préparation de la défense future dès la garde à vue.
Par ailleurs, il sera difficile d'assurer la présence physique de l'avocat dans certaines parties du territoire. Ne pourrait-on parfois substituer à cette présence physique une présence par visioconférence, comme on le fait aux États-Unis et en Grande-Bretagne ?

Le projet de loi devra préciser le cadre d'intervention dévolu à l'avocat. Dans le dispositif actuel, bien souvent, l'avocat n'est pas présent au début de la garde à vue pour des raisons matérielles, techniques, etc.
D'autre part, lorsque plusieurs personnes sont placées en garde à vue dans le cadre d'une même enquête, faut-il que plusieurs avocats aient accès au dossier, ce qui permettrait à un avocat de connaître des informations concernant un autre prévenu et pourrait poser des problèmes ?
Enfin, vous semblez avoir une interprétation assez large du principe de l'accès au dossier par l'avocat. Votre argumentation pourrait conduire à réclamer aussi la présence de l'avocat pendant les perquisitions.

Considérez-vous, messieurs les professeurs, que l'avocat doit assister à certains actes de procédure et d'enquête ? Cela ne risque-t-il pas de nuire à la conduite de l'enquête, dont nous sommes nombreux à penser qu'elle doit se dérouler dans des conditions décentes ?

Beaucoup d'intervenants ont posé la question des statistiques. Je tiens à préciser que j'ai demandé au ministre de l'intérieur, dans un courrier en date du 8 juin dernier, des statistiques au sujet de l'évolution du nombre de gardes à vue au cours des dix dernières années, en distinguant les mesures décidées dans le cadre du droit commun, celles qui concernent la criminalité organisée et celles qui concernent les infractions routières. J'ai demandé également la répartition par infraction des gardes à vue décidées en 2009, leur répartition en fonction de leur durée effective, ainsi que le nombre de confrontations avec des victimes.
N'ayant pas obtenu de réponse à ce jour, je vais relancer le ministère car les éléments de l'étude d'impact du projet de loi sont assez pauvres.
Lorsque le Conseil constitutionnel a eu à statuer sur ces questions et a ouvert la jurisprudence du changement de circonstances lui permettant de revenir sur une loi, il s'est fondé sur des données statistiques qu'il a recueillies auprès des ministères de la justice et de l'intérieur. Ces chiffres doivent être disponibles, puisque le Conseil justifie notamment le changement de circonstances par la multiplication des gardes à vue et a sans doute étayé sa réflexion sur une analyse assez fine de celles-ci.

L'idéal serait de disposer de chiffres par catégorie, par infraction, par chapitre de code. On saurait alors exactement le nombre de gardes à vue que l'on interdit lorsque l'on remonte le seuil ou le type d'infraction permettant le recours à cette procédure ou son renouvellement.

Ayant été garde des sceaux peu après les événements de New York et ayant beaucoup travaillé avec l'attorney general des États-Unis, je sais que nous devrons continuer à nous battre tous les jours contre le terrorisme. Au risque de choquer, je tiens à dire que si les procédures judiciaires devaient être trop contraignantes, nous risquerions de passer à des pratiques de type militaire. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Si les règles de droit ne permettent pas à un pays de se défendre, il se défendra en mettant ces règles entre parenthèses. Il n'y pas lieu de s'en réjouir, bien entendu, mais c'est ce que l'histoire nous enseigne. Les conversations personnelles que j'ai eues avec John Ashcroft au sujet de Guantanamo m'ont permis de bien comprendre pourquoi les États-Unis ont préféré rester sous statut militaire pour mener certaines actions plutôt que de se placer sous statut judiciaire. Ce n'est nullement un modèle – à l'époque, j'avais dit à l'attorney general ce que j'en pensais –, mais c'est un vrai sujet. Un pays peut se trouver à un moment donné dans la nécessité historique de devoir se défendre. S'il ne peut le faire dans le cadre du droit général, il le fera autrement.
Je reconnais volontiers que le problème se pose différemment pour la criminalité organisée, mais le travail mené sur ce sujet avec de grands policiers et de grands magistrats m'avait convaincu qu'il fallait faire quelque chose. Comme me le disait un jour un juge, il arrive que le seul choix de l'avocat montre que l'on ne s'est pas trompé... Il est notoire que certaines mafias ont des avocats en leur sein !

En général, la présence auprès de la personne gardée à vue est assurée par l'avocat qui se trouve disponible, pas nécessairement par celui qui prendra en charge sa défense par la suite. Cela ne risque-t-il pas de fragiliser la procédure ?

Des pays comme l'Espagne, pourtant confrontés au terrorisme, ne font pas de difficultés en ce qui concerne la présence de l'avocat. Je doute que la seule présomption de terrorisme suffise à justifier les règles dérogatoires prises au début de la garde à vue. On l'a vu avec l'affaire de Tarnac : ce qui était présenté comme un vaste complot terroriste s'est dégonflé à mesure que l'instruction avançait. Nous devons veiller à ce que d'éventuelles dispositions dérogatoires ne reposent pas sur la seule qualification de terrorisme avancée par les policiers au début de l'enquête.

Si le droit espagnol ne prévoit pas d'exclusion de principe de l'avocat dans les affaires de terrorisme, il existe en revanche une procédure d'agrément des avocats. Certains se trouvent donc écartés, peut-être pour les raisons évoquées précédemment.
En Espagne, c'est le barreau qui établit la liste des avocats pouvant intervenir dans ce type de procédure. La personne gardée à vue devra choisir dans cette liste. Au surplus, en matière de terrorisme, l'entretien avec l'avocat n'est pas confidentiel. Les restrictions sont donc importantes.
Pour ce qui est de la présence de l'avocat et de la possibilité que celui-ci demande un acte, la Cour européenne des droits l'homme n'apporte pas de réponse précise. Elle indique seulement que cette présence doit être effective et utile et que l'avocat participe à la construction de la défense. Son appréciation se faisant in concreto et in globo, elle ne dresse pas de liste : c'est au vu de l'espèce qu'elle considère si, globalement, les droits de la défense ont été respectés. Elle n'entre dans le détail qu'au moment de l'examen de l'affaire. De ce point de vue, on ne saurait dégager une démarche abstraite et a priori du juge européen.
Je crois néanmoins que la jurisprudence implique que l'avocat dispose des moyens de préparer efficacement la défense.
Par ailleurs, la Cour a déjà considéré qu'un procès mené par visioconférence était compatible avec la garantie d'un procès équitable. Elle ne s'est pas prononcée en matière de garde à vue mais ce moyen me semble incompatible avec ce qu'elle énonce. La raison principale de la présence de l'avocat dès l'interrogatoire de police est d'éviter que des aveux ne soient extorqués. On imagine mal une assistance effective par visioconférence à ce stade.
La Cour, monsieur Perben, n'interdit nullement les régimes dérogatoires – du reste, elle a été confrontée à la législation antiterroriste adoptée au Royaume-Uni. Elle précise seulement qu'il ne peut s'agir de régimes d'exception tels que la Convention européenne des droits de l'homme puisse être mise entre parenthèses. Certaines garanties doivent demeurer. Le régime dérogatoire ne peut découler automatiquement de la nature de l'infraction : il doit y avoir « des raisons impérieuses ». La difficulté tient donc à la définition des circonstances pouvant justifier le régime dérogatoire. En toute hypothèse, la Cour exigera la garantie de certains droits, dont, me semble-t-il, le contrôle juridictionnel sans lequel un régime dérogatoire n'est guère envisageable.

Les difficultés d'accès dans certaines régions et en certaines saisons rendront très difficile la présence d'un avocat. L'usage de la visioconférence est-il à ce point rédhibitoire ?
Pas rédhibitoire mais difficilement conciliable avec l'esprit de la jurisprudence européenne. La CEDH, déjà saisie de la question de l'usage de la visioconférence dans les procédures destinées aux mineurs, estime souvent que les preuves recueillies par ce biais ne sont pas compatibles avec les exigences du procès équitable. Là encore, elle n'interdit pas la visioconférence en tant que telle. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait.
S'agissant des régimes dérogatoires, la Cour européenne des droits de l'homme, tout comme la Cour de cassation, exige une motivation concrète. Le magistrat pourra rédiger cette motivation en quelques lignes : objectif d'efficacité aidant, on ne lui demandera sans doute pas de s'étendre sur plusieurs pages. Mais il ne pourra pas se contenter d'invoquer la nature de l'infraction pour justifier le report de la présence de l'avocat. Certes, un contrôle juridictionnel est nécessaire, mais je pense que le procureur de la République, sous l'autorité duquel la garde à vue a lieu, est tout à fait habilité à prendre cette décision.
Au-delà du problème de la visioconférence, la présence systématique de l'avocat impose une réorganisation de l'intervention de la défense. Tout un travail de recherche de moyens et d'organisation est nécessaire pour mettre en place le support matériel sans lequel la réforme ne connaîtra aucune application concrète.
Enfin – mais cela pourrait faire l'objet d'une autre table ronde –, M. Goujon a évoqué la présence éventuelle de l'avocat lors des perquisitions. Or toute une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme tend à étendre les dispositions de l'article 6 – droit à un procès équitable – à l'article 8, qui garantit le droit à la protection de la vie privée et familiale.
Je vous remercie, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, de la confiance que vous nous avez accordée.

Je vous remercie à mon tour. À l'issue de cette table ronde, nous avons une vision claire des données juridiques de la question.
Puis la Commission examine, sur le rapport de M. Didier Quentin, le projet de loi organique et le projet de loi relatifs au Département de Mayotte (n° 2918 et n° 2919).

Ces deux projets représentent l'aboutissement d'un processus de plus de cinquante ans, auquel notre commission des Lois a contribué au travers de l'examen des différents textes organisant l'évolution statutaire de Mayotte, ainsi que par plusieurs missions d'information, dont celle de février 2009 qui, présidée par René Dosière cependant que j'en étais rapporteur, a porté précisément sur les perspectives de la départementalisation.
Je ne reviendrai pas sur les liens anciens qui unissent Mayotte à la métropole, depuis son rattachement à la France en 1841, soit bien avant les trois autres îles composant l'archipel des Comores. Je préfère m'attarder sur la demande faite en 1958 : les représentants mahorais à l'assemblée territoriale des Comores avaient alors vainement plaidé pour que l'archipel choisisse le statut de département d'outre-mer (DOM), essentiellement régi par le droit commun, plutôt que celui de territoire d'outre-mer (TOM). Cette profonde divergence avec les autres îles de l'archipel – Grande Comore, Mohéli et Anjouan – se confirma lors du référendum du 22 décembre 1974, puisque le projet d'indépendance recueillit alors près de 95 % des suffrages dans ces îles, contre seulement 36,2 % à Mayotte. Le refus de l'indépendance fut plus tranché encore, lors de la consultation organisée à Mayotte le 8 février 1976 : 99,4 % des électeurs y affirmèrent leur volonté de rester au sein de la République.
Le retard de développement est longtemps apparu comme un frein à une pleine intégration. Cependant, en 2000, la proposition de transformation en « collectivité départementale » a marqué une première étape vers un statut de droit commun ; lors du référendum du 2 juillet de cette année, elle a recueilli 72,9 % des suffrages.
Cette adhésion s'est de nouveau exprimée, de manière plus éclatante encore, avec le quasi-plébiscite du 29 mars 2009 : la transformation de Mayotte de collectivité d'outre-mer (COM) en collectivité unique, exerçant les compétences dévolues au département et à la région d'outre-mer (DOM-ROM), a recueilli 95,2 % des suffrages, avec une participation supérieure à 60 % des électeurs inscrits. Tirant les enseignements de ce scrutin, la loi organique du 3 août 2009 a posé le principe de la transformation de Mayotte en DOM, à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général, en mars 2011.
Nos compatriotes de Mayotte voient dans l'appartenance à la France une promesse d'émancipation, de sécurité et de développement, et craignent périodiquement d'être « tenus à distance » des projets de la métropole, voire d'être abandonnés par celle-ci. À cet égard, le statut de territoire d'outre-mer, associé à la domination longtemps exercée par la Grande Comore, constitue un repoussoir, tandis que la perspective de départementalisation a toujours recueilli une large adhésion. Elle apparaît comme le meilleur rempart contre toute remise en cause de l'intégration de l'île au sein de la République.
Si le rattrapage amorcé a été engagé grâce à un effort particulier de la nation envers Mayotte, il convient aussi de souligner que les Mahorais ont dû et su remettre en question leur mode de vie, afin d'être en mesure de s'intégrer dans la communauté nationale. La révision de l'état civil, engagée en 2000, va permettre à chaque Mahorais de disposer d'un prénom et d'un nom patronymique ; depuis la loi de programme pour l'outre-mer de 2003, la polygamie a été progressivement supprimée, et les mariages polygames ont été définitivement bannis par l'ordonnance du 3 juin 2010, dont la ratification est prévue par l'article 28 du projet de loi ordinaire ; enfin, les cadis qui, en 2000 encore, géraient l'état civil et rendaient la justice dans les matières relevant du statut personnel, ont vu leur rôle réduit par cette même ordonnance à la seule médiation sociale.
On ne peut cependant nier que des problèmes subsistent : la révision de l'état civil est à ce jour inachevée ; les défis à relever dans le domaine de l'éducation demeurent considérables, car trois élèves sur quatre entrant en classe de sixième ne maîtrisent pas le français ; l'affirmation de l'égalité entre sexes ne suffit pas à revaloriser la place de la femme, encore largement dépendante des traditions.
Le Gouvernement a donc élaboré les deux présents projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, afin de déterminer, dans le prolongement de la loi organique du 3 août 2009, les conditions de la transformation de Mayotte de collectivité régie par l'article 74 de la Constitution en département régi par l'article 73 et donc soumis au régime de l'identité législative.
Ces textes visent tout d'abord à définir les modalités de fonctionnement des nouvelles institutions de l'île. Le Département de Mayotte – avec un « D » majuscule, conformément à la dénomination proposée lors de la consultation – sera appelé à exercer « les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer ». Ainsi, Mayotte deviendra la première collectivité à expérimenter les dispositions institutionnelles d'une collectivité territoriale ultramarine unique, prévues par le septième alinéa de l'article 73 de la Constitution – en attendant le tour de la Guyane et de la Martinique, qui se sont engagées sur la même voie lors des consultations des 10 et 24 janvier 2010.
Elle sera administrée par un conseil général, dirigé par un président, qui exercera les prérogatives prévues par le droit commun. Cette évolution aura peu de conséquences sur le mode de désignation des conseillers généraux mahorais, déjà élus selon le mode de scrutin uninominal à deux tours.
Comme le prévoyait la loi organique du 3 août 2009, ce statut entrera en vigueur à partir de la réunion du conseil général qui suivra son renouvellement, en mars 2011. Le mandat des nouveaux conseillers généraux expirera en mars 2014, date fixée pour le renouvellement général des conseils généraux et régionaux.
Dans un souci de rationalisation et de simplification, le projet de loi initial organisait la fusion des deux conseils consultatifs locaux, le conseil économique et social ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. La commission des lois du Sénat a souhaité appliquer strictement le droit commun des départements et régions d'outre-mer, qui prévoit l'existence de deux conseils distincts. L'examen des futurs statuts des collectivités uniques outre-mer sera cependant l'occasion d'envisager cette simplification administrative.
En deuxième lieu, le projet de loi ordinaire organise les règles d'applicabilité des lois à Mayotte, afin de passer au régime de l'identité législative. S'appliquera à Mayotte le droit commun de la République, de manière à la fois progressive et adaptée aux contraintes particulières de l'archipel, dans tous les domaines de la législation.
Le projet procède à l'application à Mayotte des dispositions de droit commun dans un certain nombre de domaines, et renvoie à des ordonnances le soin d'étendre l'application de nombreuses législations et de les adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de l'archipel. Ces ordonnances devront être prises, dans un délai de dix-huit mois, dans des domaines variés – législation du travail, du logement, de l'action sociale… –, ce qui conduira à supprimer des législations locales.
La date de passage au régime fiscal et douanier de droit commun est fixée au 1er janvier 2014.
En ce qui concerne les prestations sociales départementales, les ordonnances étendront à Mayotte celles qui n'y sont pas encore servies, à un niveau inférieur à celui de la métropole pour commencer, mais en préparant leur relèvement progressif, « sur une durée de 20 à 25 ans », comme pour les cotisations de sécurité sociale.
En troisième lieu, le projet de loi organise l'accompagnement de cette entrée dans le droit commun.
Celle-ci induisant des transferts ou des créations de compétences pour la nouvelle collectivité, il est institué un comité local pour l'évaluation des charges, qui sera invité à se prononcer sur les transferts de charges induits.
L'actuel « fonds mahorais de développement » est en outre remplacé par un « fonds mahorais de développement économique, social et culturel » destiné à soutenir des projets publics ou privés pour le développement des secteurs économiques créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement, ainsi que des actions sociales dans les domaines de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre. L'installation de ce fonds, initialement prévue pour le 31 décembre 2013, a été avancée par le Sénat au 31 décembre 2011, conformément aux intentions du Gouvernement qui a prévu un abondement de 10 millions d'euros dès le projet de loi de finances pour 2011.
Pour rapprocher davantage encore l'archipel du droit commun des DOM, le Sénat a également souhaité étendre à Mayotte l'application de l'octroi de mer, au plus tôt à compter du 1er janvier 2014, sous réserve de l'accession de l'île au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l'Union européenne. Cette accession et l'accès aux fonds structurels européens, qui font partie du Pacte pour la départementalisation, feront l'objet d'une demande officielle, puis d'une négociation avec la Commission européenne, en 2011. Cependant, l'admission au statut de RUP étant soumise à un vote à l'unanimité du Conseil, je serai moins optimiste que le Gouvernement sur le calendrier comme sur l'aboutissement de cette démarche. En effet, certains de nos partenaires européens ont, dans le passé, soutenu dans les enceintes internationales les revendications de l'Union des Comores sur Mayotte.
Enfin, les deux projets comportent diverses dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer ou aux départements et régions d'outre-mer.
Pas moins de seize ordonnances seront ratifiées, dont trois spécifiques à Mayotte, relatives respectivement à la protection sanitaire et sociale, au service public de l'emploi et de la formation professionnelle et à la modernisation du statut civil de droit local.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit la première utilisation par la Polynésie française et Saint-Barthélemy des dispositions statutaires permettant à certaines collectivités de demander au législateur de valider des sanctions pénales instituées par elles, sanctions qui ne doivent pas excéder les peines maximales prévues par les lois nationales pour les infractions de même nature.
À l'initiative de sa commission des Lois et de son rapporteur Christian Cointat, le Sénat a apporté quelques modifications, dont j'ai signalé les principales, à ces deux textes, sans en modifier les grands équilibres, puis il les a adoptés à l'unanimité le 22 octobre dernier.
Ces projets de loi donnent corps à une volonté cinquantenaire de rapprochement de Mayotte avec la métropole et à un engagement de l'État de faire bénéficier d'un plan de rattrapage ce territoire qui désire ardemment rester français et, mieux encore, être considéré comme appartenant de plein droit à la communauté nationale.
Compte tenu des délais de publication du décret de convocation des électeurs, les deux lois devront être promulguées avant la fin de l'année civile. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter ces projets tels qu'ils nous viennent du Sénat, afin que notre cent-unième département puisse voir le jour dès mars prochain.

Ce rapprochement de Mayotte avec la métropole était attendu depuis un demi-siècle. La République ne pouvant admettre l'existence de citoyens au rabais, il lui fallait légiférer. Ces deux textes ont été approuvés unanimement au Sénat. Un vote conforme de notre Commission – puis en séance publique – permettrait ne pas bloquer le processus et d'établir, dans les délais, les nouvelles institutions de Mayotte.

Je suis très heureux que les autorités nationales aient enfin pris en considération la volonté des Mahorais. Malgré tout, je regrette qu'on ait eu besoin de deux lois organiques – la première étant celle du 3 août 2009 – pour mettre en oeuvre cette départementalisation. Que ne s'est-on contenté d'une seule, comme ce fut le cas pour les « quatre vieilles » colonies en 1946, et pour Saint-Pierre-et-Miquelon ? Cela donne la désagréable impression que l'on a voulu revenir sur le principe de la départementalisation de droit commun.
Sur le projet de loi organique, je ferai trois observations.
Premièrement, le texte ne prévoit d'appliquer la fiscalité de droit commun à Mayotte qu'en 2014. Or aucun obstacle juridique ou technique ne s'oppose à ce que l'on soumette dès maintenant Mayotte, comme la métropole, à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. L'égalité devant l'impôt n'est pas assurée dans notre île. Attendre trois années encore, c'est attendre trois années de trop. On ne rappellera jamais assez qu'en France, la Révolution de 1789 a eu pour moteur la volonté d'égalité devant l'impôt ! On pourrait au moins expérimenter ces deux impôts à Mayotte avant 2014, date de son accession au statut de région ultrapériphérique (RUP). Une telle expérimentation fait d'ailleurs l'unanimité au niveau local ; le conseil général, qui se réunira le 22 novembre, a prévu d'adopter un voeu en ce sens. Et il ne serait même pas nécessaire de modifier le texte pour cela.
Deuxièmement, la loi organique du 21 février 2007 avait réservé six matières où l'on n'appliquait pas encore l'identité législative. La départementalisation sera l'occasion d'étendre celle-ci, par ordonnances, à toutes les matières sans exception. Il est en tout cas hautement souhaitable que ces ordonnances ne maintiennent pas la spécialité législative de Mayotte au-delà de 2012 ou de 2014, en particulier pour ce qui est du droit des étrangers. Le Gouvernement nous oppose que la Guyane connaît aussi, sur ce sujet, des règles spécifiques ; mais la conformité de cette législation à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Constitution est sujette à caution et si Mayotte devient RUP en 2014, la question de sa conformité au droit de l'Union européenne risque bien de se poser.
Troisièmement, le texte prévoit la création d'un fonds mahorais de développement économique, social et culturel, le 31 décembre 2011. Or le Gouvernement a déjà inscrit un montant de 10 millions d'euros – et 2,9 millions de crédits de paiement – dans la loi de finances pour 2011. Il serait logique que ce fonds puisse être mis en place dès le début de 2011 ou, au plus tard, en mars, au moment de la création de la nouvelle assemblée départementale. Nous ne voudrions pas que l'on nous reproche de n'avoir pas consommé ces crédits, si minimes soient-ils.
Ces observations faites, je tiens à préciser que je n'ai pas déposé d'amendements afin que les délais requis soient respectés et qu'en mars prochain, Mayotte puisse disposer de son statut de département.

Le groupe socialiste se réjouit de l'aboutissement du processus de départementalisation, lancé en 2000 par Lionel Jospin. Nous regrettons néanmoins la procédure utilisée. Certes, compte tenu des délais de convocation des électeurs aux élections de mars 2011, ces textes doivent être promulgués dans des délais resserrés. Mais avouez qu'il n'est pas très satisfaisant pour l'Assemblée nationale d'entendre qu'en fait, elle n'a plus qu'à adopter le texte du Sénat. Quand on sait que ce dernier est, en vertu de ce que j'ai qualifié à l'époque de « coup d'État constitutionnel », systématiquement saisi en premier lieu des textes relatifs aux collectivités locales, on doit bien constater que la marge de manoeuvre des députés est plutôt réduite.
J'en viens au fond. Notre collègue Aly nous a incités à être attentifs à la réglementation relative à la lutte contre l'immigration irrégulière, au regard des exigences de l'Union européenne, dès lors que nous allons demander à cette dernière de venir aider Mayotte. Soyez conscients que nous rencontrerons certainement quelques difficultés en la matière.
Mayotte n'en connaît pas moins une situation particulière, en raison de l'ampleur de son immigration – un tiers de la population –, ampleur qui s'explique en partie par l'existence de liens familiaux ou relationnels entre immigrants et Mahorais. D'autre part, comme nous l'ont dit le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Défenseure des enfants, les conditions de vie dans les lieux de rétention sont déplorables. Or, la répression, qui est d'ailleurs forte, ne suffira pas à régler cette question. Aussi longtemps qu'on ne fera pas l'effort de réduire l'écart des revenus, notamment entre Anjouan et Mayotte, tout l'argent consacré à cette répression, surtout dans la période récente, ne servira à rien. Chaque année, pour 15 000 personnes reconduites hors de Mayotte, 15 500 arrivent – ou reviennent !
L'état civil posera également des problèmes. À l'occasion de notre mission d'information, nous nous étions aperçus qu'à Paris on n'avait absolument aucune conscience de la situation, qui n'était en rien conforme à ce qu'on nous en disait. Je ne sais pas si notre rapporteur a eu des précisions, ni si l'état civil s'est amélioré. Car de sa qualité dépendent le succès de la départementalisation et la fiabilité des listes électorales. Or il y a de quoi s'interroger : de nombreuses élections municipales et cantonales organisées à Mayotte sont annulées ; les taux de participation sont suffisamment faibles pour que les quelques votants déterminent l'issue du scrutin.
Les mentalités devront évoluer, et l'on sait qu'elles n'évoluent pas toujours aussi vite que les textes. Mais il faudra également que les élus mahorais, qui considèrent volontiers que l'État ne fait pas assez, prennent leurs responsabilités. De nombreuses collectivités, y compris le conseil général, se trouvent dans des situations financières assez surprenantes. À chacun de donner l'exemple de la bonne gestion, même si les ressources sont par ailleurs limitées.
Je terminerai sur une question. La fiscalité de droit commun s'appliquera à Mayotte à partir de 2014 – du moins l'espère-t-on. Mais quelle fiscalité locale s'appliquera, maintenant que la taxe professionnelle n'existe plus ?

Notre collègue Aly a souligné que la législation sur les étrangers spécifique à Mayotte risquait de nous valoir des difficultés, eu égard à nos engagements européens. Je remarque pour ma part que les mineurs étrangers isolés étant pris en charge par les départements, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, la situation des finances du conseil général de Mayotte risque de s'aggraver après la départementalisation. C'est d'autant plus à craindre que cette question des mineurs isolés s'y pose de façon bien plus aiguë qu'ailleurs – que dans le Pas-de-Calais, par exemple. Et, au passage, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel vient de « retoquer », sur un recours formé par le groupe socialiste, l'accord passé avec la Roumanie, en raison des procédures prévues pour le raccompagnement des mineurs…
Quoi qu'il en soit, ne devrait-on pas prévoir des moyens spécifiques pour faire face à ce problème ? Certes, pour des raisons de délais, il nous est enjoint de voter le texte exactement dans les mêmes termes que le Sénat, mais cela ne nous interdit pas de soulever certaines difficultés particulières, que la solidarité nationale doit prendre en charge.

Je voudrais indiquer à notre collègue Aly que le groupe socialiste a pris l'initiative de présenter quelques amendements visant à mettre en oeuvre certaines de ses recommandations. Cependant, sur les cinq que nous avions déposés, deux d'entre eux se sont vu opposer l'article 40. Je tiens malgré tout à en dire un mot.
Le premier a trait à la question que vient d'évoquer Sandrine Mazetier. À la suite des rapports de Dominique Versini et de notre collègue sénatrice Isabelle Debré, qui s'est rendue encore récemment à Mayotte, nous avons pensé qu'il s'imposait d'aider nos compatriotes mahorais à résoudre le problème posé par les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en déshérence. Nombre d'entre eux ont pour parents des personnes reconduites à la frontière, qui les ont laissés volontairement derrière elles après les avoir confiés à des cousins ou à des amis du village ; ils se retrouvent le plus souvent déscolarisés, sans ressources et sans emploi. J'ai alerté Mme la ministre de l'outre-mer sur l'urgence qu'il y avait à publier le décret d'application, à Mayotte, du texte instituant le service civique. Dans la mesure où la loi du 10 mars rend celui-ci applicable de plein droit à l'ensemble de l'outre-mer, l'amendement que nous avions déposé en ce sens n'avait pas de fondement et a été écarté. Néanmoins, des dispositifs réglementaires d'adaptation restent nécessaires et nous insistons pour que le Gouvernement prenne ce décret qui conditionne l'adoption des deux arrêtés fixant, pour chaque département ou territoire, le montant de l'indemnité que les jeunes volontaires du service civique recevront de l'État, ainsi que la nature précise de la couverture sociale que l'État leur assurera.
Le deuxième de nos amendements déclarés irrecevables concernait les compétences assumées jusqu'à présent par l'État, et dont va hériter Mayotte en tant que département et région. Pour les lycées ou les collèges par exemple, le retard pris est énorme – l'État en est à construire des établissements en Algeco ! Nous considérons que l'État doit mettre à profit la période qui nous sépare de l'échéance de 2014 pour procéder aux rattrapages nécessaires dans les domaines de compétences qu'il transférera à la collectivité territoriale. Notre amendement rappelait cette nécessité.

Philippe Gosselin a insisté sur la nécessité d'aller vite. Voilà pourquoi nous appelons de nos voeux un vote conforme, sans qu'il y ait là ni injonction ni, a fortiori, de contrainte pour l'Assemblée nationale.
Abdoulatifou Aly a parlé d'égalité devant l'impôt. On peut le suivre à la rigueur s'agissant de l'impôt sur les sociétés, mais non pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, dont la mise en place est directement liée à la situation de l'état civil, que René Dosière et moi-même n'avons cessé de dénoncer – nous avions même relevé le cas d'une mère qui était officiellement plus jeune que son fils ! J'y reviendrai plus précisément tout à l'heure. Cela dit, je retiens l'idée de notre collègue consistant à expérimenter ces deux impôts à Mayotte avant 2014. Je serai à ses côtés pour demander au Gouvernement de s'engager en ce sens, lorsque le texte viendra en séance publique.
Six matières avaient en effet été mises à l'écart par la loi organique de 2007. Cette spécialité législative disparaîtra progressivement. Mais je tiens à faire remarquer que, dans certains domaines, nous avons été conduits, en quelque sorte, à protéger la collectivité contre elle-même. Mayotte a des contraintes très spécifiques et il ne faut pas aller plus vite que la musique.
S'agissant de l'octroi à Mayotte du statut de région ultrapériphérique, j'en ai pour ma part parlé avec quelque précaution, étant moins optimiste que le Gouvernement. Les propos de René Dosière sur la lutte contre l'immigration clandestine au regard des exigences de l'Union européenne ont retenu également toute mon attention. Une certaine Mme Viviane Reading pourrait en effet trouver à redire ! Nous allons devoir faire oeuvre de pédagogie, et expliquer que la situation n'est pas aussi simple que certains le croient. Nous nous sommes rendus à Anjouan et dans la Grande Comore : la situation sur place est en effet le plus triste échec de la décolonisation.
J'ai bien entendu l'appel généreux de René Dosière – « c'est grand, c'est beau, c'est généreux, la France ! » Il est évident qu'il faut essayer de réduire les écarts de niveau de vie entre Mayotte et ses voisins.

Nous les avons visités plusieurs fois. Nous n'avons pas à en être fiers, mais ils ne constituent pas non plus l'abomination que l'on décrit parfois. Et malgré des retards parfois considérables, Mayotte fait encore figure d'eldorado dans la région. Voilà pourquoi tant de malheureux Anjouanais tentent de la rejoindre de nuit, en kwassa-kwassa, et s'écrasent sur les récifs, de sorte que nous déplorons chaque année au moins plusieurs dizaines de morts.
Lors du récent débat budgétaire sur les crédits de la coopération, j'ai noté avec satisfaction un effort soutenu en faveur d'Anjouan. La coopération se met donc en place. Nous ne sommes bien sûr pas responsables du retard de l'Union des Comores, qui a connu vingt coups d'État depuis son indépendance en 1974. Il n'en faut pas moins essayer de réduire les écarts de niveau de vie, et la coopération peut y contribuer. Mais d'autres formules sont sans doute à trouver.
Le transfert des compétences s'accompagnera de la compensation prévue par la Constitution.
Le Comité local d'évaluation des charges aura pour mission d'apprécier ces compensations et les moyens spécifiques qui seront nécessaires, madame Mazetier, compte tenu du passage à une fiscalité de droit commun. M. Dosière a abordé la disparition de la taxe professionnelle. Qu'il se rassure, la fiscalité locale de droit commun sera appliquée à Mayotte.
Enfin, je répondrai à Bernard Lesterlin que le 23 novembre prochain, en séance publique, nous pourrons demander à la ministre de faire en sorte que le décret d'application du service civique et les deux arrêtés auxquels il a fait allusion soient publiés le plus rapidement possible.
Je terminerai par quelques chiffres. Les premiers portent sur l'activité de la CREC, la commission de révision de l'état-civil de Mayotte, à propos de laquelle nous avions interrogé Mme la ministre chargée de l'outre-mer et Mme la garde des sceaux.
En décembre 2009, la CREC avait pris 69 100 décisions donnant lieu, suivant les cas, à l'établissement de divers actes de naissance, de mariage ou de décès – en moyenne 3,5 actes par décision. En août 2010, elle avait encore 11 858 dossiers en stock : 3 627 dossiers incomplets – notamment détériorés par inondation ou submersion, et donc difficiles à déchiffrer – et 8 231 dossiers complets, en état d'être instruits. En outre, 3 000 décisions étaient en attente.
La CREC traite plus de 1 000 dossiers par mois. Comme nous en avions exprimé le souhait, ce rythme s'est sensiblement accéléré ces derniers mois. Depuis le 1er septembre 2010, un vice-président supplémentaire consacre à la commission la moitié de son activité. La CREC devrait donc atteindre ses objectifs d'ici à avril 2011 – cela pourrait justifier une nouvelle mission de la commission des lois à cette date !
D'autres chiffres sont intéressants. En 2009, Mayotte comptait 42 800 actifs, de quinze à soixante-quatre ans ; 35 200 occupaient un emploi, le reste, soit 7 600, étant au chômage. Le taux d'activité à Mayotte s'établissait à 41 % de la population âgée de quinze à soixante-quatre ans. Le chômage y est donc considérable, quoique légèrement moins élevé que dans les autres départements d'outre-mer.
La Commission passe à l'examen des articles du projet de loi organique relatif au Département de Mayotte
Article 1er(art. L.O. 1112-14-1, L.O. 1114-1, L.O. 1711-2, L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 3446-1, L.O. 4435-1, L.O. 4435-9, L.O. 4437-3 et L.O. 4437-6 du code général des collectivités territoriales) : Adaptation à Mayotte des dispositions organiques relatives au référendum local, à l'autonomie financière des collectivités territoriales et aux habilitations des départements et régions d'outre-mer à intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement : Actualisation des dispositions organiques relatives à ces habilitations :
La Commission adopte l'article 1er sans modification.
Article 2 (art. L.O. 6111-1 à L.O. 6176-2, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3, L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales) : Abrogation des dispositions constituant le statut organique de Mayotte en tant que collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution : Suppression d'une procédure de référé suspension propre à certaines collectivités d'outre-mer :
La Commission adopte l'article 2 sans modification.
Article 3 (art. L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461 et L.O. 465 à L.O. 470 du code électoral) : Abrogation de dispositions spécifiques du code électoral : Réduction à trois ans de la durée du mandat des conseillers généraux de Mayotte élus en mars 2011 :
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Article 4 (nouveau) (art. L.O. 253-8 du code des juridictions financières) : Abrogation de dispositions organiques du code des juridictions financières applicables à Mayotte
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi organique sans modification.
Elle procède ensuite à l'examen des articles du projet de loi relatif au Département de Mayotte
TITRE IER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre Ier Disposition modifiant la première partie du code général des collectivités territoriales
Article 1er (art. L. 1711-1, L. 1711-3 et L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales) : Application à Mayotte de la première partie du code général des collectivités territoriales, mise en place d'un comité local d'évaluation des charges et application différée des dispositions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours
La Commission examine l'amendement CL 1 de M. René Dosière.

Cet amendement vise à étendre à Mayotte la coopération décentralisée. Une récente mission effectuée par notre collègue et doyen Loïc Bouvard, par Daniel Goldberg et par moi-même, dans l'Union des Comores et à Mayotte, a conclu qu'une des causes essentielles de l'immigration clandestine tenait aux écarts de développement, et qu'il convenait de faire en sorte que les collectivités françaises de la région puissent engager des projets de coopération décentralisée avec les pays de la zone, et notamment avec l'Union des Comores. Cette idée semble faire l'unanimité chez les élus mahorais.

L'objectif recherché est d'ores et déjà satisfait par le droit en vigueur. L'article L.1722-1, qui prévoit une application partielle des dispositions du chapitre V relatif à la coopération décentralisée, a été abrogé par l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer. Depuis, en application du principe d'identité législative, l'ensemble des dispositions permettant à des collectivités territoriales et à leurs groupements de mener des actions de coopération transfrontalière ou d'aide au développement sont applicables de plein droit à Mayotte.
L'amendement CL 1 est retiré et la Commission adopte l'article 1er sans modification.
Chapitre II Dispositions modifiant la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
Article 2 (art. L. 2561-1, L. 2564-1 à L. 2564-71, L. 2572-1 à L. 2572-69 du code général des collectivités territoriales) : Application à Mayotte de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales : Transfert des dispositions relatives aux communes de Mayotte dans la division consacrée aux communes des départements d'outre-mer :
La Commission adopte l'article 2 sans modification.
Chapitre III Dispositions modifiant la troisième partie du code général des collectivités territoriales
Article 3 (art. L. 3441-1, L. 3441-5 et L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales) : Mention de Mayotte parmi les départements d'outre-mer et mises à jour de dispositions relatives aux négociations avec l'Union européenne intéressant les conseils généraux d'outre-mer :
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Article 4 (art. L. 3511-2 à L. 3511-4, L. 3521-1, L. 3522-1 à L. 3531-1, L. 3541-1à L. 3543-2 du code général des collectivités territoriales) : Organisation et finances du Département de Mayotte :
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Chapitre IV Dispositions modifiant la quatrième partie du code général des collectivités territoriales
Article 5 (art. L. 4432-9, L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-3-2, L. 4433-4, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6, L. 4433-7, L. 4433-10 à L. 4433-12, L. 4433-14 à L. 4433-15-1, L. 4433-17 à L. 4433-21, L. 4433-22 à L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28 et L. 4433-31 du code général des collectivités territoriales) : Mention de Mayotte parmi les régions d'outre-mer et mises à jour de dispositions relatives à la participation des régions d'outre-mer aux négociations européennes les concernant :
La Commission adopte l'article 5 sans modification.
Article 6 (art. L. 4437-1 à L. 4437-5 du code général des collectivités territoriales) : Application à Mayotte des dispositions générales concernant les régions :
La Commission adopte l'article 6 sans modification.
Chapitre V Dispositions modifiant la cinquième partie du code général des collectivités territoriales
Article 7 (art. L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales) : Application à Mayotte des dispositions relatives à la coopération locale :
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
TITRE II DISPOSITIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE
Article 8 (art. L. 451, L. 452, L. 460, L. 462, L. 463, L. 464, L. 471 et L. 472 du code électoral) : Alignement de Mayotte sur le régime électoral de droit commun :
La Commission adopte l'article 8 sans modification.
Article 9 (art. L. 125 et L.O. 276 du code électoral, tableaux nos 1, 1 bis et 5 annexés au code électoral, article 5 et tableau n °1 annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986) : Adaptation des dispositions relatives aux députés et aux sénateurs de Mayotte :
La Commission adopte l'article 9 sans modification.
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'application à Mayotte de diverses législations
Article 10 (art. 4, 10, 38, 40, 42–1 [nouveau] et 43 de la loi n° 2001–616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte) : Prorogation jusqu'au 31 décembre 2013 de certaines ressources propres aux communes de Mayotte et création du fonds mahorais de développement économique, social et culturel :
La Commission examine l'amendement CL 3 de M. René Dosière.

Pourquoi différer la création du fonds mahorais de développement économique et culturel ? Lors de l'examen des crédits de la mission « outre-mer », 10 millions en autorisations de programme et 2,9 millions en crédits de paiement ont été votés. Sauf à vouloir faire de l'année 2011 une année blanche, il convient d'avancer la date de la création de ce fonds – d'autant qu'en application de l'alinéa 11, il faudra encore attendre la sortie des décrets fixant les modalités de versement de ces aides. Nous proposons la date du 30 mai 2011, qui nous semble raisonnable.

L'adoption de cet amendement ferait gagner sept mois par rapport à l'échéance fixée par le Sénat – lequel avait déjà gagné trois ans par rapport au calendrier du projet de loi initial. Elle est cohérente avec l'inscription de 10 millions d'euros de crédits au projet de loi de finances pour 2011. Pour autant, je ne crois pas opportun de freiner l'adoption définitive de ce texte, pour toutes les raisons qui ont déjà été mentionnées.
Je rappelle que ce fonds remplacera un fonds existant, le fonds mahorais de développement. Lors de la séance publique, nous pourrions proposer au Gouvernement d'effectuer, avant la fin de l'année 2011, un virement de crédits pour que ces 10 millions d'euros ne se trouvent pas stérilisés.

Nous pensons utile de poser cette question. Au cas où l'amendement ne serait pas adopté par la Commission, nous le redéposerions en séance.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 10 sans modification.
Article 10 bis (nouveau) : Maintien de l'application à Mayotte au 1er janvier 2014 du code général des impôts et du code des douanes :
La Commission adopte l'article10 bis sans modification.
Article 10 ter (nouveau) (art. 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 37, 47, 49 et 51 bis [nouveau] de la loi n° 2004–639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) : Application à Mayotte de l'octroi de mer au plus tôt à compter du 1er janvier 2014 :
La Commission adopte l'article 10 ter sans modification.
Article 10 quater (nouveau) (art. 1er et 266 quater du code des douanes) : Coordinations dans le code des douanes :
La Commission adopte l'article 10 quater sans modification.
Article 11 (art. L. 223–1, L. 223–2, L. 231–7, L. 311–9, L. 554–13 et L. 731–1 du code de justice administrative) : Abrogation de dispositions du code de justice administrative du fait du changement de statut de Mayotte
La Commission adopte l'article 11 sans modification.
Article 12 (art. L. 212–12–1 [nouveau], L. 212–5, L. 250–1, L. 250–2, L. 252–1, L. 252–13, L. 253–13, L. 253–21, L. 312–1 du code des juridictions financières) : Coordinations au sein du code des juridictions financières rendues nécessaires par le changement de statut de Mayotte : Création d'une chambre régionale des comptes remplaçant la chambre territoriale des comptes à Mayotte :
La Commission adopte l'article 12 sans modification.
Article 13 (art. L. 610–1–1 [nouveau] du code de la mutualité) : Application immédiate et intégrale du code la mutualité à Mayotte
La Commission adopte l'article 13 sans modification.
Article 14 (art. 2492, 2495, 2498 et 2533 du code civil) : Application à Mayotte de certaines dispositions du code civil relatives à l'état des personnes :
La Commission adopte l'article 14 sans modification.
Article 15 (art. L. 920–1 du code de commerce) : Extension à Mayotte du régime des magasins généraux et d'une procédure d'injonction de faire en matière de consultation de l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire :
La Commission adopte l'article 15 sans modification.
Article 16 (art. L. 162–2–1 [nouveau], L. 262–1 et L. 972–3 du code de l'éducation) : Scolarisation à Mayotte des enfants de deux ans, attribution aux communes de Mayotte des compétences scolaires de droit commun et suppression en 2012 de l'institut de formation des maîtres de Mayotte :
La Commission adopte l'article 16 sans modification.
Article 17 (art. 9 de l'ordonnance n° 2002–149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte) : Application à Mayotte des modalités de droit commun de versement de l'allocation de rentrée scolaire :
La Commission adopte l'article 17 sans modification.
Article 18 (art. L. 811–1 du code de la propriété intellectuelle) : Application à Mayotte de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque :
La Commission adopte l'article 18 sans modification.
Article 19 (art. 52 de la loi n° 46–628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz) : Application à Mayotte de la quasi intégralité de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz :
La Commission adopte l'article 19 sans modification.
Article 20 (art. 46–1 à 46–6 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) : Application à Mayotte du droit commun en matière de service public et de tarifs de l'électricité, application de la tarification sociale :
La Commission adopte l'article 20 sans modification.
Article 21 (art. 53 de la loi n° 2004–803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) : Application à Mayotte de la séparation des activités de gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz et de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz :
La Commission adopte l'article 21 sans modification.
Article 22 (art. L. 655–5 et L. 655–6 du code de l'environnement) : Application à Mayotte du droit commun en matière de plans d'élimination des déchets par les collectivités :
La Commission adopte l'article 22 sans modification.
Article 23 (art. L. 713–1 du code de l'urbanisme) : Application à Mayotte des servitudes de passage des piétons sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime :
La Commission adopte l'article 23 sans modification.
Article 24 (art. L. 811–1 [nouveau] du code du travail applicable à Mayotte) : Application à Mayotte des dispositions du code du travail métropolitain relatives aux professions du spectacle :
La Commission adopte l'article 24 sans modification.
Article 25 (art. 81 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Création à Mayotte d'une caisse des règlements pécuniaires des avocats :
La Commission adopte l'article 25 sans modification.
Article 26 (art. 133–1 [nouveau] du code du travail maritime) : Application à Mayotte du code du travail maritime :
La Commission adopte l'article 26 sans modification.
Article 27 : Habilitation du Gouvernement, au titre de l'article 38 de la Constitution, à étendre ou adapter à Mayotte de nombreuses législations en vue de rapprocher les règles en vigueur à Mayotte de celles de droit commun :
La Commission adopte l'article 27 sans modification.
Chapitre II Dispositions diverses
Article 28 : Ratification de quinze ordonnances diverses relatives à l'outre–mer :
La Commission examine l'amendement CL 5 de M. René Dosière.

Les auteurs de cet amendement estiment que ce projet de loi n'est pas le bon cadre pour modifier les conditions d'éligibilité au RSA des non salariés agricoles outre-mer. On peut comprendre leurs réticences, mais les contraintes d'ordre du jour étant ce qu'elles sont, mieux vaut utiliser le véhicule législatif qui se présente plutôt que d'attendre un hypothétique projet de loi dédié à ces ajustements.
Une des ordonnances soumises à ratification par l'article 28 a précisément pour objet d'adapter les conditions d'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du revenu de solidarité active et du contrat unique d'insertion dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Or cette ordonnance n'a pas tenu compte d'une spécificité des départements d'outre-mer, qui concerne les non salariés agricoles. Il apparaît, selon le Gouvernement, qu'il n'est pas possible d'évaluer le bénéfice d'une exploitation agricole outre-mer. D'où la substitution du critère de superficie de l'exploitation, par dérogation au droit commun qui fonde le versement du RSA sur un critère de bénéfice agricole. Cette dérogation est d'ailleurs déjà en vigueur s'agissant du RMI.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 28 sans modification.
Article 29 : Ratification, sous réserve de modifications, d'une ordonnance relative au droit de la commande publique applicable dans certaines collectivités d'outre–mer :
La Commission adopte l'article 29 sans modification.
Article 30 : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur l'extension et l'adaptation du code des postes et de communications électroniques aux îles Wallis-et-Futuna et sur l'extension de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon :
La Commission adopte l'article 30 sans modification.
Article 31 (art 189-1 [nouveau] du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy) : Ratification d'un décret approuvant les sanctions applicables en matière d'urbanisme à Saint-Barthélemy :
La Commission adopte l'article 31 sans modification.
Article 32 : Homologation de peines d'emprisonnement prévues, en Polynésie française, par des lois du pays :
La Commission adopte l'article 32 sans modification.
Chapitre III Dispositions finales
Article 33 : Succession du Département de Mayotte à la collectivité départementale de Mayotte :
La Commission adopte l'article 33 sans modification.
Article 34 : Modalités d'entrée en vigueur de la loi :
La Commission adopte l'article 34 sans modification.
Puis elle adopte l'ensemble du projet de loi sans modification.
La séance est levée à 13 heures.