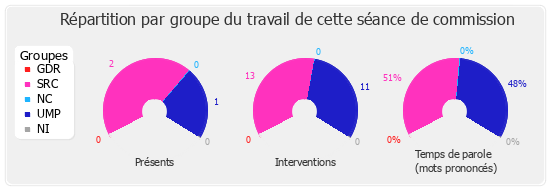Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
Séance du 13 mai 2009 à 17h00
La séance
La mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a auditionné Mme Marie-Pierre Chanlair, avocate spécialiste de la fonction publique.
La séance est ouverte à dix-sept heures quarante

Je suis heureux, Maître Chanlair, de vous accueillir parmi nous : votre intervention nous permettra d'approfondir des thèmes que nous avons jusqu'ici peu abordés, notre mission s'étant largement consacrée aux violences faites aux femmes dans le cadre domestique ou professionnel, mais seulement dans le secteur privé.
Je vous remercie.
Si les violences physiques faites aux femmes dans les fonctions publiques sont très peu courantes, il n'en va pas de même des violences morales qui, malheureusement, y prospèrent.
En la matière, les piliers que sont l'égalité de recrutement et l'égalité de traitement ne constituent en rien un rempart. En tant qu'avocate soit de collectivités locales, soit d'agents publics, je note que les fonctions publiques territoriale et hospitalière en particulier, sont un redoutable terreau sur lequel certaines violences sont florissantes. Ceci est du notamment au relatif cloisonnement de ces fonctions publiques : si un fonctionnaire d'État peut demander sa mutation dans un autre service, il est loin d'en aller toujours de même pour ses collègues, parfois menacés de mauvaises notations s'ils ne changent pas de dispositions. Dans ces conditions, la situation peut rapidement devenir perverse.
Par ailleurs, toute la fonction publique repose sur le principe hiérarchique, souvent entendu au demeurant sur un mode quasi-militaire : l'article 28 du Titre I du statut général de la fonction publique dispose ainsi que l'on doit respect et obéissance à ses supérieurs hiérarchiques. Le fait que l'ensemble du système – notation, évolution de carrière, avancement, construction de l'environnement de travail – repose sur la parole et l'action du supérieur hiérarchique peut éventuellement favoriser des « abus ». En même temps, la mission de ce dernier est précisément d'être responsable de l'action de son service et de faire travailler les agents qui le composent – ce qu'il doit d'ailleurs accomplir sans en avoir vraiment les moyens : je songe, par exemple, à la possibilité d'augmenter ou de diminuer le traitement de ses subordonnés en fonction de leur implication et de leurs compétences. Quoi qu'il en soit, plus le chef prend ses responsabilités, mieux cela se passe.
Les juges sont pleinement conscients de ces difficultés lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre des chefs de service et des agents, les premiers pouvant user à mauvais escient de leur pouvoir et les seconds, interpréter parfois une simple demande de travail – fût-il soutenu – comme du harcèlement. A cela s'ajoute que si les fonctionnaires sont très attachés à leurs droits, ils ont parfois tendance à minorer leurs devoirs à l'endroit de leur hiérarchie.
S'agissant, donc, de la violence morale ou psychologique qui s'exerce sur les femmes, deux axes doivent être principalement pris en compte : la définition précise des comportements punissables en termes de harcèlement ou de discrimination et leur dénonciation devant les tribunaux par les victimes. En l'occurrence, les obstacles sont autrement plus lourds dans la fonction publique que dans le secteur privé.
C'est parce qu'il était très difficile, en matière de discrimination, d'apporter la preuve qu'un chef de service ait voulu nuire à tel individu en tant que femme, handicapé ou homosexuel par exemple que la notion de harcèlement moral est très précieuse. Néanmoins, outre que sa définition est très large, le juge administratif est très réticent à l'utiliser, en raison de sa « dangerosité » : dans le secteur public, il est en effet normal que le chef donne des ordres et recadre parfois ses subordonnés.
Je me suis récemment intéressée à deux affaires fort éloquentes. Dans la première, il a fallu retirer le terme de « harcèlement » pour que l'Éducation nationale accepte de reconnaître que le cancer et la dépression de deux agents étaient imputables à ses services – comme l'avaient attesté les examens médicaux. Dans la seconde, il n'a pas été possible, faute d'avoir procédé au même retrait, de faire reconnaître par le juge que la grave dégradation de l'état de santé d'une directrice de crèche était due à la double pression exercée par ses supérieurs et ses subordonnés. Il en aurait été différemment, j'en suis persuadée, si nous nous étions contentés d'invoquer une sanction déguisée ; il est tellement plus facile d'arguer du comportement de la victime !
Le juge craint à ce point la remise en cause des prérogatives du chef de service que même lorsque le harcèlement est reconnu, le dédommagement de la victime est extrêmement faible. Il est particulièrement choquant de laisser ainsi entendre que le harcèlement pourrait être une réponse à la défaillance d'un agent, alors que des mesures disciplinaires existent par ailleurs et devraient être utilisées si une sanction est nécessaire. Une telle façon de faire est hélas entrée dans les moeurs, les juges considérant trop souvent que la victime est responsable de ce qu'elle subit.
La loi de 2008 est très claire en considérant comme discrimination « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner pour un des motifs mentionnés au premier alinéa un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition – c'est moi qui souligne –, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés ». Une telle restriction appliquée au harcèlement dans la fonction publique contribuerait par ailleurs à clarifier la situation, la propension à utiliser cette notion étant aussi parfois très exagérée.
Enfin, l'accès au tribunal pénal pour sanctionner des faits de harcèlement s'il est théoriquement possible, demeure extrêmement délicat : outre qu'un agent de la fonction publique aura du mal à poursuivre pénalement son supérieur, il risque de se voir accusé de dénonciation calomnieuse si ce dernier est blanchi. Il importe donc de faciliter l'accès au juge administratif, beaucoup plus approprié en la matière. Or celui-ci se heurte à trois obstacles majeurs : hors cas très spécifiques, il est impossible de faire appel de la décision du juge administratif ; le juge est unique et non collégial ; enfin c'est à l'agent de prouver qu'il est victime d'un harcèlement. Sur ces points, un alignement sur la législation régissant le secteur privé s'imposerait.

Considérez-vous que la féminisation de la fonction publique territoriale, y compris dans l'encadrement, ait entraîné une diminution des violences morales exercées à l'encontre des femmes ?
En outre, certains métiers de la fonction publique sont-ils plus propices que d'autres au harcèlement ?
Enfin, la violence sur le lieu de travail n'est-elle pas « pénalisable » en tant que telle ? Connaissez-vous des cas précis où des agents auraient porté plainte, au pénal, contre leurs supérieurs ?
La féminisation a peut-être fait évoluer les manifestations de violence mais elle ne les a pas fait disparaître. Plus une personne a de responsabilités, plus elle estime devoir faire ses preuves et plus la pression psychologique qu'elle exerce peut être forte. Dans la seconde affaire que j'ai mentionnée, la directrice des ressources humaines a pris toute sa part dans les violences exercées à l'encontre de la directrice de crèche. Il serait naïf de croire que les femmes seraient professionnellement angéliques !
Si je n'ai pas d'information sur la prégnance du harcèlement dans tel ou tel métier, je dispose en revanche d'un certain nombre d'exemples de plaintes portées au pénal, même si les procureurs et les juges d'instruction n'apprécient guère ces dossiers, surtout lorsqu'un élu est en cause. Quoi qu'il en soit, je répète que cela ne constitue pas, selon moi, une solution appropriée aux cas de harcèlement – à la différence des cas de violence physique, bien entendu. Lorsqu'un fonctionnaire attaque sa hiérarchie professionnelle ou politique au pénal, la confiance est irrémédiablement perdue et cela ne peut que laisser des traces, indépendamment du jugement rendu.

Je vous remercie d'avoir rappelé à quel point le milieu de la fonction publique est à la fois hiérarchisé et fermé.
En ce qui concerne la catégorie C de la fonction publique – dont les personnels sont largement féminins – il est souvent très difficile de déterminer la source d'un conflit et les syndicats ont le plus grand mal à peser sur les décisions d'un chef de service. Au sein des conseils de discipline, les avocats jouent quant à eux un rôle parfois ambigu : soit ils parviennent à des compromis, soit l'agent mis en cause est fautif.
Par ailleurs, la décentralisation ayant accru les compétences des collectivités locales dans les secteurs très délicats de la petite enfance, des jeunes en âge scolaire ou des personnes âgées, les conflits se sont multipliés entre agents et directeurs de service. Même avec les personnes chargées de l'entretien les exigences sont devenues considérables !
Enfin, la formation des fonctionnaires me paraît essentielle : outre qu'il serait sans doute opportun de réviser l'article 28 que vous avez mentionné tant il peut entraîner certaines dérives, la présence de garde-fous me semble s'imposer – peut-être cela pourrait-il être examiné dans le cadre d'une modification des lois de 2006 et 2008 ?

Je note que vous n'avez pas évoqué le rôle des syndicats dans la fonction publique pas plus que vous n'avez fait état de la double hiérarchie de cette dernière : administrative et politique. Vous semblerait-il utile de revenir sur ces questions ? Par ailleurs, je ne partage pas votre point de vue selon lequel la hiérarchie serait structurellement plus pesante dans la fonction publique que dans le secteur privé : ayant connu les deux, il me semble même que c'est l'inverse.
L'article 28, de plus, ne doit pas être un alibi. Le fait que la hiérarchie a le devoir de faire fonctionner l'administration dont elle est responsable, ne dispense pas la fonction publique de faire des efforts en matière de management participatif.
De surcroît, il me semble opportun de distinguer au sein de la fonction publique les violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes des autres discriminations, lesquelles doivent d'ailleurs être toutes éradiquées. Nous aurions également tout intérêt à préciser le sens du mot « harcèlement » en fonction de ses acceptions morale, psychologique, sexuelle ou de genre.
Enfin, comme l'a indiqué ma collègue, des efforts doivent être réalisés dans le domaine de la formation en insistant notamment sur la lutte contre toutes les formes de discrimination, laquelle relève de la responsabilité de la hiérarchie administrative, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une réécriture de l'article 28 : il faut tout de même penser à ces situations de stress au travail qui génèrent dépressions ou cancers! Une responsabilité mal assumée doit être blâmable, voire « pénalisable ».
Absolument : la responsabilisation de la hiérarchie est indispensable – dans le cas que j'ai mentionné, une procédure pénale est d'ailleurs en cours.
S'agissant des syndicats et du management participatif, j'attire votre attention sur l'article 9 du Titre I, aux termes duquel les fonctionnaires participent à la gestion de leur propre carrière à travers notamment les commissions administratives paritaires (CAP) – dont les conseils de discipline font partie – mais également à l'organisation de leur milieu de travail par le biais des comités techniques paritaires (CTP) ou des comités d'hygiène et de sécurité (CHS). Hors ces fonctions représentatives et largement formelles dans lesquelles les syndicats s'investissent beaucoup, il ne me semble pas que sur le terrain leur rôle soit à la hauteur de ce que l'on serait en droit d'attendre d'eux. Je participais ce matin à un conseil de discipline et… c'était navrant ! Ils utilisent sans distinction la notion de harcèlement sans se préoccuper de ce que le chef de service a lui aussi une tâche à accomplir ! Il leur arrive de défendre l'indéfendable sans s'interroger sur la légitimité de leur action !
La mission aensuite auditionné Mme Yael Mellul, avocate.

Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Yael Mellul, avocate, qui nous a adressé un document proposant une définition d'un délit spécifique de violences conjugales à caractère psychologique. Cette question a très souvent été au coeur de nos travaux et les versions de nos divers interlocuteurs ont été contrastées, ceux qui sont favorables à la nécessité d'avancer sur ce sujet étant un peu plus nombreux.
Nous avons acquis la certitude qu'il nous faut trancher cette question et nous ne voulions pas achever nos auditions sans vous avoir entendue, votre contribution étant probablement la plus aboutie parmi toutes celles que nous avons reçues.
Votre proposition de définition est la suivante : « Les violences à caractère psychologique sont constituées lorsqu'une personne adopte de manière répétée à l'égard d'une autre une série d'actes, d'attitudes et de propos, qui entraîne la privation de son libre arbitre et l'altération de son jugement. Les violences à caractère psychologique peuvent être caractérisées notamment par les menaces directes ou indirectes sur la famille, l'environnement professionnel et social, les pressions financières, le harcèlement, le chantage, l'insulte, l'injure, la diffamation, le dénigrement privé ou public, l'isolement social. »
Je vous remercie de me donner la possibilité de vous parler de ce projet consistant à donner une définition légale des violences à caractère psychologique, et pour lequel je me bats depuis près de deux ans.
En l'état actuel de la législation, seule la violence à caractère physique, est prise en compte dans le code pénal et dans le code civil. Or la violence à caractère psychologique est le ciment de la violence conjugale : aucune femme victime ne dira avoir subi de violence physique sans avoir, au préalable, subi l'emprise de son conjoint. D'une soumission par les mots, l'auteur passe à une soumission par les coups. Ce processus est irréversible.
Les lois ayant introduit les notions de violences en tous genres ou de violence mettant en danger la victime – soit une définition très large des violences –, il devrait normalement être possible de prendre en compte la violence à caractère psychologique. Or cette notion étant extrêmement complexe – elle comprend notamment des micro-violences –, il est impossible à un policier et un magistrat de la qualifier. Aucun de mes dossiers ne comporte une plainte enregistrée par un policier sur la base d'une violence à caractère psychologique. Si aucune plainte de ce genre n'est déposée, le juge aux affaires familiales ne pourra jamais asseoir sa décision sur cette base non plus. En matière pénale, selon le principe de légalité, le magistrat ne peut entrer en voie de condamnation si le délit n'est pas défini dans ses éléments. Or aujourd'hui, comment un magistrat pourrait-il le faire alors dans la mesure où la violence psychologique ne l'est pas ?
La situation actuelle est donc la suivante : la violence des coups est condamnée, mais la violence des mots n'est jamais abordée ! L'enquête ENVEFF – Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France démontre pourtant que les séquelles traumatologiques chez la femme victime de violences conjugales à caractère psychologique sont considérables et plus graves que les violences conjugales à caractère physique !
Définir les violences à caractère psychologique non seulement permettra à l'appareil judiciaire de les qualifier, mais aussi aidera les victimes à nommer ce qu'elles vivent. L'emprise psychologique induit l'impossibilité psychique chez les victimes de faire la distinction entre ce qui est tolérable et intolérable, acceptable et inacceptable. Or, les lois n'aident pas ces femmes à faire cette distinction et à prendre conscience de l'illégalité de la situation dans laquelle elles se trouvent. Une définition légale, claire et précise, le leur permettra : son intérêt fondamental est là.

Votre proposition est très intéressante, car elle s'efforce de sérier l'ensemble des éléments qui pourraient, ensemble ou séparément, constituer les violences psychologiques.
Comme vous le dites, l'utilité d'une définition est d'abord de permettre à la femme de savoir qu'elle est victime. Mais la question se pose de la preuve dans le cadre de la procédure pénale. Qui va prouver non seulement l'altération du jugement que vous évoquez, mais encore sa cause, sachant que les actes et autres propos, comme le « dénigrement » mentionné dans votre définition, sont toujours sciemment commis ou émis dans la sphère privée et jamais en public !
Ne risquons-nous pas d'ouvrir une boîte de Pandore en définissant les violences psychologiques ? L'espoir né de cette définition ne se heurtera-t-il pas à la difficulté de prouver ces violences, mais aussi au risque de procédures récurrentes de dénonciation calomnieuse à l'encontre des victimes et des associations, au risque d'aggraver la situation dans laquelle se trouvent ces femmes.
L'opportunité d'une définition se heurte effectivement aux problèmes de preuve et à la dénonciation calomnieuse.
Les violences conjugales ont effectivement pour spécificité de se produire à huis clos. Cependant des attestations de psychologues ou de psychiatres peuvent être produites. Dans le cadre de la procédure pénale ou de la procédure de divorce, une expertise contradictoire attestant l'altération de l'état mental ou des facultés de jugement de ces femmes peut être demandé. La femme peut enregistrer les menaces, les pressions car elles se déroulent sur une durée très longue ; une des spécificités des violences conjugales à caractère psychologique étant qu'elles ne sont pas un délit instantané.
Le problème de la preuve existe pour d'autres délits ou crimes, par exemple le viol, pour lequel c'est forcément la parole de l'un contre la parole de l'autre s'il n'y a pas flagrant délit ! Les menaces, les injures et les insultes sont aussi prouvées par des témoignages indirects.
L'isolement social peut être prouvé grâce aux amis ou aux membres de la famille s'ils n'ont pas vu la femme depuis de longs mois, voire plusieurs années ! Cet aspect n'est pas anecdotique, la violence conjugale à caractère psychologique ne pouvant s'instaurer sans isolement social de la femme par le conjoint.
Des témoignages indirects, très rarement directs, pourront donc prouver la violence psychologique : c'est ce qu'on appelle le faisceau d'indices, de preuves. Certes, c'est la seule manière pour la femme de prouver qu'elle est victime, mais ce problème n'est pas insoluble.
Les procédures pour dénonciation calomnieuse en cas d'insuffisance de preuves caractérisant les délits existent en matière civile et des dommages et intérêts sont demandés pour des procédures abusives. Mais on ne peut pas se fermer la porte parce qu'on sait d'avance qu'il y aura des abus ! Certes, on a souvent affaire dans ce genre de dossier à des pervers narcissiques, à des rois de la manipulation qui ne manqueront pas d'utiliser cette voie si, malheureusement, la victime n'apporte pas suffisamment de preuves. Néanmoins, une définition ouvre une porte à ces femmes car, en leur permettant enfin de sortir de cette spirale en amont – la violence psychologique, je l'ai dit, s'exerce en amont de la violence conjugale –elle leur épargne le stade de la violence physique : c'est aussi l'intérêt ! En outre, les procédures de dénonciation calomnieuse n'aboutissent pas forcément.

Merci beaucoup de votre éclairage. Les femmes savent très bien que ce qu'elles vivent est illégal, mais aussi que l'arsenal juridique pour les défendre n'existe pas. Je reviens sur le problème de la preuve, s'agissant des « pressions financières » et de « l'isolement social », mentionnés dans votre définition.
Avant la violence physique, le lot quotidien de ces femmes victimes est de se voir confisquer par leur conjoint leur carnet de chèque, leur carte bleue, leurs clefs de voiture pour qu'elles n'aillent pas travailler, que sais-je encore ? Or ces actes constituent des preuves, car la famille, les enfants qui grandissent, l'entourage, les amis finissent par s'apercevoir – à la longue – que quelque chose ne va pas. N'ayant pu téléphoner ou arrivant en retard de nombreuses fois, la femme dira à sa famille, ses amis : « mon mari avait débranché le téléphone » ou « mon mari avait caché mes clefs », etc. Les auteurs de violences, particulièrement pervers, s'imaginent qu'ils ne seront jamais pris, mais ce style de fautes finit par être repéré par les proches !

Je pense qu'il y a dans ces exemples matière à enrichir votre proposition de définition en s'appuyant sur ce type d'éléments car le chantage, les insultes, les injures seront toujours difficiles à prouver.

Il faut « ouvrir la porte » à ces femmes, comme vous le dites. Même si le problème de la preuve est difficile à régler, permettre aux femmes de verbaliser leur souffrance grâce à une caractérisation de ses éléments, enfin reconnus par la société comme condamnables, est la meilleure façon de le faire. Je ne pense donc pas que définir tout de suite la sanction pénale est forcément le moyen le plus efficace. Il faut d'abord aider par le droit à verbaliser cette souffrance car, comme vous l'avez parfaitement expliqué, la conséquence première de ces violences à caractère psychologique et répétées est l'incapacité pour la victime d'évaluer elle-même cette souffrance. La question essentielle est de savoir ce qui va permettre à la femme d'y procéder.
Votre définition comprend au moins deux qualifications pour lesquelles la preuve ne pose pas problème : la diffamation, qui est un délit de presse, un écrit, pour laquelle la preuve est tangible et le dénigrement privé et public : ce dernier est enregistré ou entendu par d'autres, et les témoignages sont faciles à rassembler.
Au-delà de l'identification des éléments de la souffrance, chacun étant constitutif d'un délit, puis de la verbalisation devant le juge, que préconisez-vous comme sanction ?
De mon point de vue, ce qui va déclencher une réaction chez la femme victime de violences conjugales sera de connaître l'existence d'un texte de loi condamnant les violences verbales du conjoint.
Je ne suis pas tout à fait d'accord lorsque vous dites que les femmes savent que ce qu'elles vivent est illégal. À l'issue de conférences sur cette proposition, les femmes victimes de violences conjugales viennent me voir en pleurs pour me demander pourquoi la violence des coups est condamnée et pas la violence des mots ! « Mes bleus se sont effacés, mes fractures se sont consolidées, me disent-elles, mais les mots dont j'ai été victime sont encore en moi. » Elles savent que ce qu'elles ont vécu n'était pas normal quand elles en sont sorties, mais souffrent toujours de ne pas voir reconnaître leurs souffrances passées.
Quant aux sanctions, j'avoue ne pas y avoir réfléchi, mais je penche pour des sanctions extrêmement dures, eu égard aux conséquences traumatologiques dont souffrent les victimes de ces violences. Sans parler de décès, les mots ont un pouvoir que la force physique n'aura jamais et les femmes en gardent une empreinte indélébile !
Là réside aussi l'intérêt d'une définition : dans l'esprit du conjoint violent, seules les situations d'extrême violence sont condamnables et, vu le silence de la loi, il pense que la femme n'ira jamais porter plainte pour des violences verbales !

On part du présupposé d'une chronologie entre la violence verbale et les violences physiques. Les violences physiques peuvent aussi exister en amont et légitimer la violence des mots qui s'installe après. Seules les violences physiques laissant des traces sont, de ce fait, vécues comme un interdit.
En plus de notre droit existant, vous voulez caractériser cette violence des mots car, étant difficile à prouver, dites-vous, elle n'existe pas ni comme interdit ni comme infraction.

Je fais partie de ceux qui aimeraient beaucoup trouver une définition solide et créatrice de droits positifs nouveaux.
La jurisprudence actuelle sur les notions de choc émotif ou de choc émotionnel constitue une avancée intéressante, susceptible d'être reprise dans une définition. Si nous imaginions un délit de violences psychologiques condamné par dix années d'emprisonnement, le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de nous rappeler le principe de proportionnalité ! Je le dis en écho à votre réponse sur la lourdeur de la peine, car il ne faudrait pas que nous proposions une nouvelle sanction pénale qui soit le témoignage d'une « vengeance légale » eu égard à tous ceux qui n'ont pas été incriminés pendant tant d'années ! C'est le premier risque.
Le deuxième est lié à la présentation des éléments constitutifs. Votre définition est intéressante, mais nous ne pouvons pas y conserver le terme « notamment » qui, en matière pénale, nous place obligatoirement sous le coup de la censure du Conseil constitutionnel. Cet adverbe signifie que cela peut être autre chose, mais si cette autre chose n'est pas définie, on ne peut pas s'appuyer dessus ! Il doit donc être banni de la loi pénale !

De la même manière, il ne faut pas écrire dans la loi pénale « peuvent être », mais « sont » !

D'autant plus que, parmi les éléments constitutifs de l'atteinte au libre arbitre et de l'altération du jugement, certains sont déjà pénalisables !
En reprenant à l'Assemblée, dans le cadre de la loi de 2006, la proposition de Mme Voynet visant à créer un délit spécifique de prélèvement de document administratif assorti d'un quantum de peines, j'avais fait valoir que le fait pour un mari, un concubin, un compagnon de prélever le carnet de chèque de son épouse ou du couple ou de lui prendre ses clefs est du vol ! Il faut appeler un chat un chat ! C'est la solution qui a été retenue et elle est aujourd'hui beaucoup plus efficace au plan pénal !
Votre définition comporte des éléments très intéressants, mais d'autres peuvent nous mettre en difficulté en nous emmenant dans une certaine précision, d'ailleurs pas forcément inutile. Les éléments énumérés doivent être prouvés, nous l'avons dit. Mais ce qui n'est pas énuméré ne peut pas servir de base constitutive du délit.
Devons-nous fixer un cadre général ? Ou avons-nous intérêt à être plus précis, au risque d'aller dans le mur à cause du problème de l'insuffisance de preuves, susceptible d'entraîner un grand nombre de classements sans suite et de décourager beaucoup de femmes de porter plainte, sans compter le problème de la dénonciation calomnieuse ? Dans ce cas-là, notre travail ne serait-il pas considérablement appauvri par rapport à la cause que nous défendons ?

Ne conviendrait-il pas, d'abord, d'inscrire dans la loi une liste d'éléments se référant à la violence psychologique telle qu'on la connaît, mais se rapportant seulement à des délits déjà identifiés ? Le vol en est un et mériterait, à ce titre, de figurer dans votre liste. Ne conviendrait-il pas, ensuite, de considérer cette violence faite aux femmes dans le cadre conjugal comme une circonstance aggravante par rapport au droit commun ? Un article de loi qui compléterait le code pénal pour caractériser la circonstance aggravante de délits déjà identifiés et punis lorsqu'il s'agit de violences faites aux femmes me paraît être une bonne porte d'entrée.

C'est le cas dans la loi de 2006 ! Si ce n'est que les violences psychologiques ne sont pas définies !

Nous pouvons préciser que ces violences peuvent avoir un caractère psychologique, écrire dans la loi les mots « infraction à caractère psychologique » et les définir pénalement comme étant une circonstance aggravante.

Appliquer le critère général de circonstance aggravante de la violence au sein du couple à certaines incriminations qui ne sont pas aujourd'hui identifiées comme pouvant exister en tant violence au sein du couple.
Je reviens sur deux points très importants.
La jurisprudence sur les chocs émotionnels porte sur les conséquences psychologiques, traumatologiques pour les victimes, mais absolument pas sur la violence psychologique. Or il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Lorsqu'Édith Sudre, du cabinet de Mme Rachida Dati, m'a informée qu'un projet sur les violences ayant un fort retentissement psychologique serait déposé, je lui ai répondu que les conséquences psychologiques sont déjà prévues dans les procédures pénales puisque des dommages et intérêts sont exigés pour le préjudice moral subi ! Et que par conséquent les choses n'auront pas plus avancé que cela sur la notion de violence à caractère psychologique !
Il faut faire état de ce qui existe déjà, dites-vous. Tout à l'heure, j'ai évoqué les contraventions qui existent déjà, mais ce sont des infractions instantanées. Or de mon point de vue, il est fondamental aujourd'hui de condamner tout le processus de la violence psychologique dans la loi.
Nous partons, dites-vous, du postulat de base selon lequel la violence des mots est un préalable à la violence des coups. Marie-France Hirigoyen en parle dans son livre Femmes sous emprise. Pour que la violence physique s'installe, il faut la violence des mots en amont, mais une fois la violence physique installée, la violence des mots ne s'arrête pas pour autant ! Et quand les deux s'exercent, il faut dix, vingt, trente ans à la femme pour s'en sortir !
Exactement.
Si la femme porte plainte au moment où elle subit seulement la violence des mots, seule la violence psychologique sera évoquée. Si elle porte plainte lorsque la violence physique est déjà installée, elle portera plainte sur la base des deux : violences physiques et violence psychologique.
Pour moi, une définition explicite est fondamentale. Pour que les femmes sachent que ce qu'elles vivent est condamnable, elle ne doit pas faire référence uniquement à ce qui existe déjà. Sinon, nous ne serions pas là pour en parler !

Pour ce qui existe déjà dans la société, nous pouvons dire que si des actes sont commis dans le contexte de l'enfermement conjugal à l'encontre des femmes parce qu'elles sont femmes, il y a circonstance aggravante pour caractériser le délit punissable. Cela me semble plus opérationnel pour contourner l'objection du Conseil d'État.
Il faudrait compléter votre liste, mais en commençant par renvoyer à des infractions déjà caractérisées et punies !

Qu'est-ce qui peut faire que des éléments pénalement répréhensibles au titre d'une contravention soient constitutifs non plus d'une contravention, mais d'un nouveau délit de violences psychologiques au sein du couple ? C'est justement leur conjonction et leur réitération.
La définition doit donc, me semble-t-il, porter sur des éléments qui ne sont pas caractérisés aujourd'hui en tant qu'infraction pénale, même à titre contraventionnel, et qui pourraient le devenir parce que, ajoutés à d'autres, ils viendraient constituer un délit de violence psychologique. En outre, si nous voulons que ce qui est pénalisable dans un cadre ordinaire devienne pénalisable de manière aggravée au titre d'une violence au sein du couple, nous devons, comme nous l'avons fait pour toutes les infractions commises au sein du couple, ajouter la notion de circonstance aggravante ! Je crois qu'il faut les deux !
Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que telle contravention est assortie d'une circonstance aggravante lorsqu'elle est commise au sein du couple. Il faut dire que la contravention, ajoutée à une autre contravention, constitue un délit de violence conjugale qui, parce qu'il s'exerce au sein du couple, est, par rapport à un autre délit de même nature, passible de la circonstance aggravante, c'est-à-dire de l'aggravation du quantum de la peine. C'est cela qu'il faut approcher !
Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas renvoyer uniquement à ce qui existe déjà. Il faut aborder le problème de la violence à caractère psychologique dans sa globalité. L'injure, l'insulte, la diffamation existent, mais ne constituent pas le délit de la violence à caractère psychologique, ce sont des éléments susceptibles d'être constitutifs de la violence à caractère psychologique !

Pour obtenir réparation, une personne victime de diffamation – délit qui figure dans votre liste –, invoquera un préjudice psychologique ! Lorsque vous êtes diffamé, vous êtes attaqué dans votre honneur et obtenez de la justice pénale réparation de ce préjudice qu'on qualifie de « moral », mais de nature essentiellement psychologique.
Si vous me permettez un conseil, certaines formulations de votre liste mériteraient d'être précisées.
« L'isolement social » est une notion floue. Il faudrait arriver à trouver une formulation plus proche de la violence, de la souffrance vécue par la femme à qui son conjoint interdit, par exemple, de voir ses amis, de suivre des cours, de faire des courses sans lui, de conduire la voiture… Sinon, on nous rétorquera devant un tribunal qu'il est impossible à prouver.
Qualifier l'infraction, la nommer en lui donnant un contenu, une définition est déjà beaucoup, mais il faut pouvoir la prouver concrètement.
La notion de « pressions financières » est également floue. Nous devons trouver une caractérisation plus précise. Il faudrait d'ailleurs vérifier que les éléments figurant dans le code civil, notamment s'agissant du mariage, ne nous limitent pas dans ces incriminations.

L'isolement social me semblant être davantage une conséquence qu'un acte en lui-même, il aurait sa place dans le premier paragraphe de votre définition qui serait ainsi rédigée : « Les violences à caractère psychologique sont constituées lorsqu'une personne adopte à l'égard d'une autre une série d'actes qui entraîne la privation de son libre arbitre, l'altération de son jugement et son isolement social ». Nous entrons dans le détail !
J'en suis très heureuse car, malgré tous les entretiens que j'ai eus dans tous les ministères, c'est la première fois que j'ai la possibilité d'entrer dans le détail de mon projet !
C'est la raison pour laquelle je vous rejoins en vous disant que, effectivement, la diffamation n'a pas sa place dans cette définition, car je vois mal comment elle pourrait s'inscrire dans le temps. Il faut la retirer.

Elle est ponctuelle !
En outre, il ne faut pas considérer que seules les femmes dont le jugement a été altéré sont victimes de violences à caractère psychologique, car elles peuvent sortir de cette épreuve saines d'esprit. Il ne faut pas limiter le recours à l'incrimination d'un nouveau délit à cet élément.
À ce moment-là, on ferme la porte à la preuve car, je l'ai dit, les certificats médicaux des psychologues et psychiatres attestant que l'état de la femme est déstructuré constituent des preuves. Force est de constater que toutes les femmes victimes de violences à caractère psychologique ont malheureusement un jugement altéré !

Il s'agit d'un problème de formulation. Il faudrait écrire : « série d'actes, d'attitudes et de propos de nature à entraîner conjointement ou séparément la privation du libre arbitre, l'altération du jugement et l'isolement social. » À mon avis, c'est ce vers quoi il faut aller si nous retenons ces termes.
Notre travail n'est pas de réécrire votre proposition de définition, mais de comprendre votre démarche. Cet échange nous l'a permis et nous avons eu réponse à nos questions.

Il ne vous aura pas échappé que, subrepticement, on donne une définition – car il est dans la liste – au harcèlement psychologique ! On peut enfin caractériser le harcèlement psychologique par ce biais !
Tout à fait. A cet égard, j'ajoute une dernière chose.
Les victimes vivent difficilement le fait que le harcèlement moral soit puni dans le cadre des relations de travail – même s'il n'est pas défini dans le code pénal et le code du travail, à charge pour les conseillers prud'homaux de le faire –, mais pas dans le cadre des relations conjugales, alors que les chiffres démontrent qu'une femme est beaucoup plus en danger chez elle qu'à l'extérieur !
La séance s'achève à dix-neuf heures cinquante-cinq.