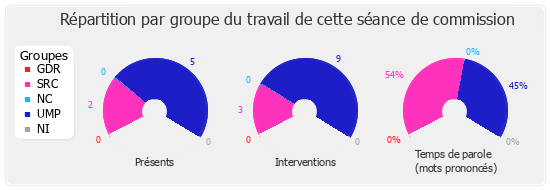Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république
Séance du 30 juin 2009 à 8h15
La séance
La séance est ouverte à 8 h 15.
Présidence de M. Dominique Perben, président d'âge.
La Commission poursuit ses auditions, ouvertes à la presse, sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (n° 1599) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur).
Audition de M. Nicolas MOLFESSIS, Professeur à l'Université Paris II

Mes chers collègues, je vous prie d'excuser le président Jean-Luc Warsmann qui a été retardé et m'a demandé de commencer notre série d'auditions. Nous avons tout d'abord le plaisir d'accueillir M. Nicolas Molfessis, professeur à l'Université Paris II-Assas.
Monsieur le professeur, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous avons transmis une série de questions reflétant les préoccupations de la Commission des lois à propos du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Je vous propose d'y répondre et de nous exposer votre vision de ce texte.
Permettez-moi, avant toute chose, de vous dire l'honneur que vous me faites en sollicitant mon intervention sur ce sujet, et ce d'autant plus que je suis professeur de droit privé. Votre initiative montre que le droit constitutionnel est en train de dépasser la frontière – pourtant si marquée dans notre système juridique – entre le droit public et le droit privé.
Cette frontière est toutefois encore présente dans le texte qui nous intéresse en ce qu'il présuppose, en quelque sorte, une infériorité de compétence de la Cour de cassation par rapport au Conseil d'État, si l'on en juge par l'instauration d'une formation spéciale, requise au sein de la première mais non du second.
L'exposé des motifs ouvrant le projet de loi organique place d'emblée la réforme opérée sous l'angle des droits des justiciables, en affirmant que la loi constitutionnelle a ouvert un droit nouveau à leur bénéfice. J'évoquerai d'abord un certain nombre de points sur lesquels le texte appelle une discussion avant de répondre plus explicitement aux questions qui m'ont été posées.
Tout d'abord, pourquoi imposer, comme critère du filtre opéré par la juridiction suprême saisie, que la question de constitutionnalité soulevée « présente une difficulté sérieuse » ? Ce critère est connu dans la procédure d'avis, mais il est ici inapproprié. À supposer que la disposition législative en cause soit de toute évidence inconstitutionnelle, la question soulevée ne présenterait pas de difficulté sérieuse, mais la transmission au Conseil constitutionnel serait d'autant plus justifiée. Au reste, si l'on prolonge le parallèle avec la procédure d'avis, qui est codifiée, c'est la question qui doit présenter une difficulté sérieuse et non, comme le prévoit la rédaction proposée pour l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constutionnel, la disposition législative critiquée. Au fond, qu'est-ce qu'une disposition qui « présente une difficulté sérieuse » ? Seul un problème, une question peut présenter une telle difficulté.
Au-delà, est-il si logique que les conditions de transmission au Conseil constitutionnel par la juridiction de cassation – Conseil d'État ou Cour de cassation – ne soient pas les mêmes que celles imposées au juge du fond ? Au vu de l'état actuel du projet, le juge du fond pourrait avoir raison de transmettre la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, et celle-ci pourrait être tout aussi fondée à ne pas la transmettre au Conseil constitutionnel. En pratique, la distinction entre les critères actuellement prévue par le projet n'aura donc ni sens ni portée. Évitons donc d'avoir à nous interroger, par exemple, sur la nature d'une question de constitutionnalité qui ne serait pas « dépourvue de caractère sérieux » – article 23-2 – mais qui, pour autant, ne serait pas nouvelle – article 23-5. Il serait plus simple d'affirmer que le Conseil d'État ou la Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues à l'article 23-2 sont remplies. Ce faisant, on réduirait d'autant le risque de « pré-jugement » de constitutionnalité dont il va être question tout à l'heure.
En troisième lieu, la référence à un « changement de circonstances » pour admettre que le juge puisse transmettre une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, quand bien même celui-ci aurait antérieurement déclaré la disposition en cause conforme à la Constitution, est ambiguë. On comprend que le texte vise l'hypothèse dans laquelle une réforme constitutionnelle serait depuis lors survenue, avec pour effet d'accroître la liste des droits et libertés à valeur constitutionnelle. On songe par exemple aux griefs d'inconstitutionnalité qui pourraient être formulés sur le fondement de la Charte de l'environnement à l'encontre de textes examinés antérieurement à son insertion dans la Constitution.
Mais un changement de jurisprudence de la part du Conseil constitutionnel – et il y en a beaucoup – constitue-t-il un « changement de circonstances » ? Et en est-il de même du changement dans l'interprétation de la loi par le juge ordinaire ? Il serait en réalité préférable de viser clairement ce que sous-tend la disposition, et à mon sens de faire référence à la seule hypothèse d'invocation de droits et libertés qui n'étaient pas constitutionnellement garantis à l'époque du contrôle de constitutionnalité a priori. Ce serait plus clair et moins susceptible de soulever des difficultés.
En quatrième lieu, la procédure prévue devant la Cour de cassation est, dans le projet, surprenante. Le premier président de la Cour de cassation préside la formation qui rend l'arrêt. Mais, lorsque la solution lui paraît s'imposer, il peut aussi choisir de renvoyer le cas devant une formation allégée, présidée par lui-même et composée « du président de la chambre spécialement concernée et d'un conseiller de cette chambre ». Le premier président et les présidents de chambre peuvent aussi choisir d'être suppléés par des délégués qu'ils désignent. Comment comprendre ces dispositions ? Le critère permettant la décision en formation allégée est-il pertinent dans la mesure où la question aura été préalablement jugée comme n'étant « pas dépourvue de caractère sérieux » ? En l'absence de précision, c'est aussi bien la conformité à la Constitution que la non-conformité à celle-ci qui peut paraître s'imposer au président de la Cour de cassation. Cela revient en réalité à faire de lui le juge unique de la question de constitutionnalité.
Et, dans le cas où la solution qu'il estimerait devoir s'imposer serait la transmission au Conseil constitutionnel, comment concilier cette hypothèse avec le fait que ladite transmission suppose d'être en présence d'une disposition législative qui « soulève une question nouvelle » ou « présente une difficulté sérieuse » ? De même, comment comprendre la référence qui est faite par le texte à la chambre « spécialement concernée », alors que l'on évoque ici une question de constitutionnalité supposée échapper à la compétence des magistrats de l'ordre judiciaire ?
Que signifie, enfin, cette référence à la chambre « spécialement concernée » alors que, dans un alinéa précédent, lorsqu'il est question de la formation normale, on prévoit d'y faire siéger deux conseillers « appartenant à chaque chambre spécialement concernée » ? Faut-il croire qu'il y ait des degrés dans le fait d'être concerné par une question de constitutionnalité qui permettrait de distinguer deux chambres, puis une, au sein de la Cour de cassation ?
En réalité, une question de constitutionnalité ne concerne pas une chambre. L'expression est maladroite, et d'autant plus malvenue qu'elle corrobore à son tour l'idée de pré-jugement par une chambre. Soyons donc simples et logiques : la question de constitutionnalité est toujours fondamentale et jamais évidente dès lors qu'elle a franchi le premier filtre. Elle doit relever sans exception de la formation évoquée à l'article 23-6, troisième alinéa, à savoir une formation présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des présidents des chambres et, sans doute – ce serait plus logique – d'un conseiller par chambre.
Je répondrai maintenant aux questions qui m'ont été posées.
S'agissant des principes constitutionnels les plus susceptibles d'être utilisés par des requérants, notamment en matière de contentieux devant le juge judiciaire, on peut sans doute s'attendre à ce que les plaideurs invoquent le principe d'égalité, parce qu'il a un rayonnement très large, qu'il est d'une imprécision justifiant qu'une partie tente sa chance, et qu'il présente sous l'angle du droit constitutionnel des attraits bien supérieurs à ce qu'il permet en matière conventionnelle, sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties devraient également fréquemment invoquer les diverses garanties que l'on range classiquement sous l'étiquette « procès équitable ». Enfin, on peut penser que la sécurité juridique devrait être invoquée, même s'il reste à s'entendre sur le point de savoir si un principe à valeur constitutionnelle comme celui de l'intelligibilité et de l'accessibilité du droit relève des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens de l'article 61-1 nouveau de la Constitution.
S'agissant, en deuxième lieu, de la portée de l'expression « disposition législative », on doit pouvoir considérer qu'elle englobe les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie. Quant aux termes « droits et libertés garantis par la Constitution », ils ne peuvent, me semble-t-il, viser une incompétence négative que pour autant qu'une telle incompétence traduirait une atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Toute incompétence négative n'entre donc pas dans le domaine du texte.
En troisième lieu, le fait d'exiger que la juridiction suprême saisie s'assure que la question soulevée est « nouvelle ou présente une difficulté sérieuse » conduit inévitablement à ce qu'elle procède à une forme de pré-jugement de constitutionnalité. Il ne peut pas en aller autrement à partir du moment où le filtrage conduit le juge à apprécier la pertinence de la question soulevée. Mais il est un moyen simple d'éviter d'instaurer un double contrôle de constitutionnalité – l'un qui serait officiel, explicite et autorisé, celui du Conseil constitutionnel, l'autre officieux, implicite et illégitime, celui du juge de cassation – : ne pas exiger une motivation de la décision de transmission ou de non-transmission.
En revanche, il faut souligner que la Cour de cassation applique depuis longtemps les droits à valeur constitutionnelle, et qu'il lui arrive même de les viser dans ses décisions. Si, depuis plus d'un siècle et demi, elle refuse avec constance de contrôler la constitutionnalité des lois, elle n'en reconnaît pas moins que les principes et droits à valeur constitutionnelle constituent bien des règles de droit, et elle en donne donc des interprétations. Ainsi, dans une décision du 28 novembre 2006, la Cour de cassation a jugé que « le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle ». La Cour en tire d'ailleurs des conséquences souvent importantes. Par exemple, dans un arrêt du 4 janvier 1995, elle a censuré la décision d'un juge qui, après divorce, avait imposé à une personne de consentir un bail rural à son ex-époux sur un bien qui lui était propre, en soulignant que « le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle, de telle sorte que l'obligation imposée à l'un des époux de consentir un bail rural constituait une restriction à son droit de disposer librement d'une parcelle dont elle était seule propriétaire ». S'il faut donc redouter une forme de pluralisme des contentieux concernant les droits constitutionnels, c'est parce que les juges conservent, et conserveront, la possibilité de les appliquer. S'ils ne peuvent déclarer une loi contraire à la Constitution, ils pourront toujours, évidemment, se référer aux droits à valeur constitutionnelle. Il faut espérer que le développement du rôle du Conseil constitutionnel contribuera à l'unité d'interprétation des normes constitutionnelles.
S'agissant de vos quatrième et cinquième questions, relatives au caractère préalable de la question posée – spécialement par rapport à la question de conventionnalité –, et au problème de contrariété entre le droit constitutionnel et le droit communautaire, il me semble possible de faire trois observations.
Tout d'abord, le caractère préalable dans le temps d'une question est une problématique chronologique. Ce truisme grossier est destiné à éviter de décalquer ce qui relève du traitement chronologique des questions sur des raisonnements menés en termes de hiérarchie des normes.
Ensuite, dès lors que la question de constitutionnalité est soulevée, il doit y être répondu. En aucune manière, la question de constitutionnalité ne peut être subsidiaire, ou encore seconde, comme pourrait l'être par exemple une question de bien-fondé par rapport à une question de recevabilité. On comprend très bien que, si la recevabilité n'est pas franchie, on ne puisse jamais examiner le bien-fondé. En revanche, une fois la question de constitutionnalité posée au juge, aucune autre question ne lui permet d'échapper à son obligation d'y répondre, qui n'est jamais que la traduction de son devoir de juger. Si la Constitution a consacré un droit nouveau au bénéfice des justiciables, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce n'est pas pour qu'ils s'en trouvent privés, ne serait-ce que dans certaines hypothèses.
Enfin, la question de constitutionnalité n'a pas le même objet que la question dite de conventionnalité. C'est une évidence, puisque la première peut conduire à l'abrogation d'un texte, mais pas la seconde. En répondant à une question de conventionnalité, on ignore la question de constitutionnalité, quand bien même les droits invoqués ici et là seraient les mêmes. De même, lorsqu'il répond à la question de constitutionnalité, le juge ne répond pas à la question communautaire.
De ces trois observations, il résulte que la question de constitutionnalité est effectivement préalable, sans quoi elle pourrait rester sans réponse, au risque de ruiner le mécanisme en pratique, et plus fondamentalement de méconnaître ce qui en fait l'essence même.
Il en résulte aussi qu'aucune raison ne doit conduire à admettre une priorité temporelle de la question de droit communautaire sur celle de droit constitutionnel et qu'il n'est absolument pas justifié de prévoir la réserve de l'article 88-1 de la Constitution. Il ne s'agit pas, en répondant à la question de constitutionnalité, de trancher la question de conformité au droit communautaire qui serait l'objet d'une question préjudicielle : il s'agit de trancher la question de conformité à la Constitution d'une disposition législative sans préjudice de ce qui sera jugé sur le terrain communautaire. La préséance chronologique de la question constitutionnelle n'est évidemment pas l'affirmation d'une primauté sur le droit communautaire ni un empiétement de compétences. À telle enseigne que, si la réponse à la question constitutionnelle devait être celle d'une conformité à la Constitution de la disposition législative, il resterait encore à statuer sur la question préjudicielle communautaire. Il serait en réalité justifié d'amputer l'alinéa 14 de l'article 1er de la référence à l'article 88-1 de la Constitution. La juridiction doit se prononcer en premier lieu sur la question de constitutionnalité ; il n'y a pas de réserve à prévoir puisque ce n'est pas elle qui se prononcera, à la suite d'une question préjudicielle, sur la conformité au droit communautaire.
Enfin, il faut souligner que le caractère préalable vaut évidemment aussi devant la Cour de cassation et le Conseil d'État. Il est d'autant plus important d'apporter cette précision que, comme l'indique le texte du projet de loi, la question peut être posée pour la première fois devant l'une ou l'autre de ces juridictions.
J'en viens à votre septième question. En cas de désistement de l'action ou de l'instance mettant un terme au procès, la question de constitutionnalité ne devrait logiquement pas prospérer. Cette question est soulevée à l'occasion d'un litige, et lui est liée, au point d'ailleurs que la question n'est transmise que si « la disposition contestée commande l'issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ». Dès lors, elle ne peut survivre à l'extinction de l'instance et à l'absence de litige. Elle est d'ailleurs conçue comme un droit du justiciable : s'il se désiste, ce dernier met également fin à la procédure qui conduit de la question à la réponse.
Répondant à la huitième question, je dirai que les juridictions n'ont pas de rôle jouer dans la formulation de la question soulevée, et ce d'autant moins qu'on leur refuse de relever d'office une question de constitutionnalité. En toute hypothèse, il ne m'apparaît pas qu'il leur appartiendrait de reformuler une question qu'elles estimeraient mal posée. Admettre l'inverse serait en réalité les faire participer directement au jugement sur la constitutionnalité de la disposition, et donc verser dans ce pré-jugement qu'il faut absolument éviter.
Le Conseil constitutionnel, en revanche, doit pouvoir reformuler la question, car c'est lui, comme le souligne la Constitution, qui est saisi de la question de la constitutionnalité et qui doit la trancher. Ce que doivent trancher les autres juges, c'est la question de la transmission de la question de constitutionnalité, ce qui est bien différent et doit le rester.
Vous vous interrogez également sur le point de savoir si l'abrogation d'une disposition en matière pénale et en matière de procédure pénale devrait s'articuler avec l'exécution des peines déjà prononcées. Cette question trouve déjà une réponse dans le droit positif, au second alinéa de l'article 112-4 du code pénal. À partir du moment où la disposition législative est déclarée inconstitutionnelle, il faut comprendre qu'elle est abrogée dans notre ordre juridique et qu'en conséquence elle disparaît. L'effet de l'abrogation d'une disposition législative qui prévoit une incrimination pénale est bien connu : soit la condamnation n'est pas encore définitive et, dans ce cas, la loi étant abrogée, cette condamnation ne pourra recevoir une exécution, comme lorsque l'on est en présence d'une loi pénale plus douce ; soit la condamnation est d'ores et déjà définitive, mais la peine n'est pas exécutée ou ne l'est pas entièrement, auquel cas elle cesse de recevoir exécution. Il n'y a donc pas de difficulté particulière sur ce point déjà prévu par l'article 112-4 du code pénal. En revanche, je laisse aux publicistes le soin de répondre à la question de savoir si le justiciable condamné sur le fondement d'une disposition considérée comme inconstitutionnelle peut invoquer la responsabilité de l'État.
Enfin, l'abrogation d'un texte qui avait remplacé un précédent texte pourra-t-elle avoir pour effet de faire revivre la disposition antérieure ? À cette très belle question d'école, il convient – c'est mon sentiment – de répondre par la négative. On ne peut pas faire revivre une disposition antérieure déjà abrogée, et ce d'autant moins que cette disposition pouvait elle-même être inconstitutionnelle – on peut même imaginer qu'elle l'était plus gravement que le texte qui l'a remplacée.

Nous sommes tous d'accord, je suppose, pour convenir que la question préjudicielle ne doit pas allonger excessivement la procédure. À cet égard, on peut penser que le double filtre n'est pas la solution la plus pertinente. Mais puisque c'est le choix retenu pour élaborer ce projet de loi, nous devons nous montrer attentifs à la question des délais.
Le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission de la question préjudicielle, et le Conseil constitutionnel dispose du même délai pour se prononcer. Quel est votre avis sur le temps imparti à la juridiction saisie pour se prononcer sur la recevabilité de la question ? J'imagine qu'il doit être bref, ce problème devant être résolu préalablement à tous les autres.
Par ailleurs, le texte ne prévoit aucune conséquence si la Cour de cassation ou le Conseil d'État ne se prononce pas dans le délai requis. De votre point de vue, cela signifie-t-il que la question est alors transmise d'office ?
Je répondrai d'abord à la deuxième question, la plus simple. Il faut en effet considérer, à mon avis, que si la juridiction ne se prononce pas dans le délai de trois mois, la question est transmise de plein droit au Conseil constitutionnel. La solution inverse reviendrait à priver de ses droits le justiciable qui l'a soulevée. Pour plus de clarté, cette conséquence pourrait toutefois être explicitement prévue par le projet de loi.
À votre première question, il ne m'appartient pas de fournir une réponse de lege ferenda. Le projet ne prévoit en effet aucun délai au stade du premier filtre, mais il vous appartient de combler cette lacune. Il existe deux options : l'une consiste à prévoir que la juridiction saisie doit examiner sans délai la question de constitutionnalité ; l'autre à encadrer la décision dans un délai précis. Selon moi, la première option est préférable.

Lorsqu'un texte qui avait remplacé un précédent texte est jugé inconstitutionnel, pourquoi ne pas revenir à l'ancien texte ? Et sur quelles dispositions peut-on s'appuyer pour le remplacer ?
La logique de l'abrogation d'un texte est de le faire disparaître de l'ordre juridique, sans conséquence sur l'état antérieur du droit. Pour autant, cela n'annule pas l'abrogation que ce texte avait entraînée. Si un texte nouveau, ayant remplacé un autre texte – qu'il abroge explicitement ou non –, est déclaré contraire à la Constitution, il disparaît sans faire renaître le texte antérieurement abrogé. Le caractère abrogatoire ne disparaît pas.
Au-delà de cet aspect relevant de la technique juridique, il peut ne pas être judicieux de faire revivre une disposition antérieure abrogée, car elle-même peut avoir des effets contraires à la Constitution ou être considérée comme anticonstitutionnelle.
C'est pour cette raison, me semble-t-il, que le constituant a prévu une modulation dans le temps des effets de la décision d'inconstitutionnalité.

Une question de constitutionnalité peut être soulevée devant « les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ». À votre avis, cette expression devrait-elle permettre de considérer qu'une question peut être soulevée par un tribunal arbitral, ou devant une autorité administrative exerçant un pouvoir de sanction et considérée comme une juridiction au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
L'interprétation de cet article 6 par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme porte davantage sur la notion de tribunal que sur celle de juridiction. Il me semble donc, dans l'état actuel des choses, que, lorsqu'un texte se réfère à une juridiction, c'est exclusif de la référence aux autorités administratives indépendantes. S'il fallait en décider autrement, il serait plus légitime de le souligner que de laisser aux interprètes le soin de gloser sur le terme « juridiction ». A fortiori, le raisonnement vaut pour les procédures arbitrales.

Monsieur le professeur Molfessis, je vous remercie.
Audition de M. Guy CARCASSONNE, Professeur à l'Université Paris X
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président

Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir M. Guy Carcassonne, professeur à l'Université Paris X-Nanterre.
Monsieur le professeur, je vous cède immédiatement la parole pour répondre aux questions que nous vous avons adressées.
C'est toujours un plaisir et un honneur de me trouver devant votre Commission.
Vous m'avez d'abord interrogé sur le périmètre de la question de constitutionnalité.
Quels sont les principes constitutionnels qui devraient être le plus souvent invoqués par les requérants ? Ce seront sans doute souvent les mêmes que dans le contrôle préventif, et en particulier le principe d'égalité. Peut-être un accent particulier sera-t-il mis sur ce qui, ailleurs, relève du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et que, ici, on appelle la garantie des droits, en particulier ce qui touche à l'équité d'un procès, au déroulement de la procédure et aux droits de la défense. Contrairement à d'autres, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à un déferlement d'actions, tout simplement parce que je ne crois pas que notre droit positif soit à ce point truffé de dispositions inconstitutionnelles. Depuis 1974, presque tous les textes posant problème ont déjà été déférés au Conseil constitutionnel ; les gisements de dispositions susceptibles d'être déférées sont donc antérieurs à 1974, et je ne pense pas qu'ils soient très nombreux. Mais il y a sans doute des « filons » : le droit fiscal et, surtout, le droit douanier sont très menacés. Les administrations concernées seraient d'ailleurs bien inspirées de devancer les censures, faute de quoi ces dernières risquent de faire l'affaire de fraudeurs et de trafiquants.
Les « lois du pays » entrent-elles dans le champ des dispositions susceptibles d'être contestées au titre de l'article 61-1 de la Constitution ? Pour moi, la réponse est clairement « non ». La locution « loi du pays » vise un objet juridique tout à fait différent des « lois » et des « dispositions législatives » qu'elles contiennent.
Pourra-t-on invoquer une incompétence négative du législateur ? La question est plus délicate, mais pour moi il ne fait aucun doute que la réponse est « oui ». En effet, je considère qu'à la lumière de l'article 61-1, qui crée au profit du justiciable un droit subjectif – notamment celui d'obtenir l'abrogation d'un texte inconstitutionnel –, l'article 34 crée un autre droit subjectif, celui de tous les citoyens à ce que le législateur exerce ses compétences, et surtout à ce que les compétences qui lui sont confiées ne puissent être exercées que par lui. Au demeurant, l'incompétence négative devrait la plupart du temps viser des textes antérieurs à 1974, et souvent à 1958 ; je ne pense pas que le grief puisse se rencontrer fréquemment, mais ne s'agirait-il que d'un seul cas, il est normal que le Conseil constitutionnel puisse le sanctionner.
Enfin, la disposition proposée pour l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et selon laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation procède au renvoi au Conseil constitutionnel dès lors que « la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse » est purement et simplement absurde. Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que vous allez la modifier. D'abord, l'emploi de l'expression « difficulté sérieuse » est désobligeant à l'égard du Conseil d'État et de la Cour de Cassation. Et surtout, cette disposition n'a pas de sens : la « nouveauté » est déjà une condition de la recevabilité de la question dans le dispositif de l'article 23-2. Quant à l'existence d'une « difficulté sérieuse », il s'agit d'un critère non pertinent : lors même qu'une inconstitutionnalité serait évidente, il faudrait néanmoins saisir le Conseil constitutionnel car c'est à lui qu'il revient de la sanctionner. Je suggère fortement que l'on s'en tienne dans la loi organique à la notion de « question sérieuse », en retirant ces deux ajouts qui n'ont aucune raison d'être : pour que la question soit transmise au Conseil constitutionnel, il faut et il suffit que la question soit sérieuse.
Votre deuxième groupe de questions concerne les rapports entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité.
Oui, bien sûr, la priorité de la question de constitutionnalité sur la question de conventionnalité est une nécessité. La première raison en est que, faute de cette priorité, l'article 61-1 serait mort-né. Les juridictions suprêmes sont en effet réticentes à l'égard de cette nouvelle procédure ; l'une des conditions prévues par le texte proposé pour l'article 23-2 de l'ordonnance étant que la disposition contestée commande l'issue du procès, le fait d'examiner d'abord la question de conventionnalité leur permettrait, le cas échéant, d'écarter l'application de la disposition au motif qu'elle est contraire à une convention internationale, et ainsi d'éviter de saisir le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité. Parmi les partisans de la nouvelle disposition constitutionnelle, on s'est d'abord inquiété que le filtre ne devînt pas un bouchon ; et on a découvert un autre risque, celui que le bouchon laisse la place à un canal de dérivation, détournant vers le contrôle de conventionnalité tout ce qui, en bonne logique, devrait relever du contrôle de constitutionnalité, lequel n'aurait alors plus aucun sens.
Indépendamment de ces raisons de politique jurisprudentielle, la priorité à donner à la question de constitutionnalité repose sur des raisons juridiques de fond : les effets des deux contrôles ne sont pas les mêmes. L'article 61-1 de la Constitution créant un droit subjectif à obtenir l'abrogation d'une disposition inconstitutionnelle, le justiciable doit être en mesure de le faire valoir, et il n'appartient à personne de se déterminer à sa place. Il peut arriver, dans le cadre de contentieux répétitifs, qu'il n'y ait aucun doute sur le fait qu'une disposition législative soit de nouveau déclarée contraire aux engagements internationaux de la France ; le justiciable a le choix entre cette issue certaine et la décision de poser d'abord la question de constitutionnalité.
D'ailleurs, le contrôle de conventionnalité, faut-il le rappeler, est lui aussi un enfant de la Constitution, puisqu'il est issu de son article 55. Que l'on commence par s'assurer de la conformité des lois à la norme suprême de notre ordre interne me paraît donc logique et naturel.
Si l'on ne veut pas que le contrôle de conventionnalité soit le moins du monde retardé par le contrôle de constitutionnalité, la seule solution est d'accélérer ce dernier. C'est la raison pour laquelle, à juste raison, ce projet de loi organique tend à créer en la matière une sorte d'autoroute : dès l'instant où une question sérieuse de constitutionnalité est posée, elle doit être tranchée rapidement. Le juge saisi n'en conserve pas moins la totalité de ses compétences au regard des questions de conventionnalité – que, s'il y a lieu, il examinera le moment venu, conformément aux principes fixés par l'arrêt Simmenthal rendu le 9 mars 1978 par la Cour de justice des Communautés européennes, et dans les délais habituels : ce contrôle n'est ni amputé ni différé en quoi que ce soit.
J'en viens aux dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Si, alors qu'une question de constitutionnalité a été soulevée, un désistement de l'action ou de l'instance met un terme au procès, que se passe-t-il ? Il est logique que, quel que soit le stade de la procédure, l'action relative à la question de constitutionnalité prenne fin : on ne peut pas à la fois soutenir qu'il s'agit d'un droit subjectif reconnu à « tout justiciable » et admettre l'idée que, le justiciable ayant disparu, l'action continue de manière autonome.
Les décisions de renvoi au Conseil constitutionnel doivent-elles être motivées ? Non, car le renvoi au Conseil est une motivation en lui-même : il signifie que la question est jugée sérieuse par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation, sans qu'il soit nécessaire de leur demander pourquoi – au risque de faire apparaître inutilement des nuances ou des désaccords au sein de ces hautes juridictions.
Celles-ci devraient-elles pouvoir reformuler les termes de la question ? Là encore, ma réponse est « non » car c'est au justiciable qu'un droit est reconnu ; c'est éventuellement lui que l'on pourra, dans le cours des débats, amener à reconsidérer les termes dans lesquels il a posé sa question, mais il n'est pas souhaitable qu'une juridiction se substitue à lui. En revanche, il va de soi que le Conseil constitutionnel, une fois saisi, formulera la réponse dans les termes qu'il estimera adéquats.
Nous en arrivons ainsi à votre dernière série de questions, relatives aux dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel doit-il être tenu par les termes de la question qui lui a été renvoyée ? Par la rédaction, sans doute pas, mais par l'objet, évidemment : il s'agit d'une disposition législative, contestée au titre d'un principe constitutionnel, et c'est dans ce cadre que le Conseil doit rendre sa décision.
Faut-il que le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question de constitutionnalité qui lui est soumise ? Je considère que oui. Il faudrait également prévoir que les présidents des deux assemblées informent les membres de celles-ci et reconnaître la possibilité de formuler des observations à soixante députés ou soixante sénateurs. Cela permettrait en particulier aux membres de l'opposition de faire valoir leurs arguments lorsque la disposition législative contestée a été adoptée à un moment où leur famille politique était majoritaire.
Enfin, la présentation contradictoire des observations des parties devant le Conseil constitutionnel ne transforme-t-elle pas la question de constitutionnalité en un litige incident ? En réalité, peu importe car ce litige incident sera réglé très vite, et là est l'essentiel.
Pour conclure, permettez-moi de souligner que la réforme gagnerait, et sans doute gagnerions-nous tous, à ce que cette procédure reçoive un nom de baptême, si possible de vous qui avez adopté la réforme constitutionnelle. Techniquement, il ne s'agit pas d'une exception d'inconstitutionnalité : en principe, c'est le juge de l'action qui est juge de l'exception ; il y aurait exception s'il y avait contrôle diffus, mais il y a contrôle concentré et il s'agit donc d'une question. Cette question de constitutionnalité n'est pas une question préjudicielle au sens classique du terme : celle-ci n'est examinée que si elle gouverne l'issue du procès, ce que l'on ne détermine qu'à la fin de l'instruction ; elle n'est donc considérée comme telle qu'une fois que le juge a répondu à toutes les autres questions. Il s'agit en revanche d'une question préalable. Voilà pourquoi je suggère de dénommer cette procédure « question préalable de constitutionnalité ». Si vous retenez une autre dénomination, l'essentiel est qu'elle caractérise précisément ce dont il s'agit.

Je voudrais vous poser plusieurs questions complémentaires.
Le filtre – ou le « bouchon », ou encore le « canal de dérivation » – a-t-il sa place dans une loi organique ? Ne serait-il pas plus prudent de renvoyer cela à une loi ordinaire ?
Il est prévu au texte proposé pour l'article 23-4 de l'ordonnance que le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer dans un délai de trois mois. Considérez-vous que l'absence de réponse dans ce délai vaudra transmission d'office au Conseil constitutionnel ?
Que pensez-vous du délai de « huit jours » dans lequel la décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ? Ne vaudrait-il pas mieux écrire, dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 23-2, « sans délai » ?
Ce texte relatif à ce que vous appelez la question préalable de constitutionnalité ne serait-il pas l'occasion de donner une reconnaissance à l'opinion dissidente au sein du Conseil constitutionnel ?
Enfin, le Conseil pourrait-il selon vous être saisi de questions relatives à des droits qui ne sont pas aujourd'hui expressément reconnus par la jurisprudence ? Je pense à ce que l'on appelle les « objectifs à valeur constitutionnelle », par exemple le droit à bénéficier d'un logement décent ou le pluralisme de la presse, ou encore le droit à la dignité, affirmé à partir d'un article de la Constitution de 1946.
En ce qui concerne votre première question, il me semble aller de soi, à la lecture de l'article 61-1 de la Constitution, qu'une loi organique est nécessaire.
La question des effets résultant du non-respect des délais est fort importante. Permettez-moi de vous suggérer à ce sujet de compléter l'article 23-4 de l'ordonnance par une disposition que l'on pourrait rédiger ainsi : « Si la Cour de cassation ou le Conseil d'État n'a pas statué dans le délai prévu au présent alinéa, l'intéressé peut saisir directement le Conseil constitutionnel. » C'est la logique du texte, et il vaut mieux que la faculté de saisir directement le Conseil soit reconnue au justiciable lui-même – car c'est lui qui est au coeur de l'article 61-1. On peut d'ailleurs concevoir que, dans certains cas, la Cour de cassation ou le Conseil d'État, sachant que son silence aura cet effet – protecteur des droits du justiciable –, préfère ne pas statuer. La rédaction de l'article 61-1, selon lequel le Conseil est saisi « sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation » autorise-t-elle cette lecture ? Je vous laisse apprécier.
Si les délais de trois mois sont utiles, la mention « sans délai » est en effet préférable au délai de huit jours que vous évoquez. Il conviendrait également d'introduire cette mention à d'autres endroits du texte, par exemple dans le deuxième alinéa de l'article 23-1, faute de quoi le ministère public pourrait bloquer la procédure en s'abstenant de donner un avis.
S'agissant de l'opinion dissidente, sans doute suis-je trop conservateur ou trop prudent, mais je pense que c'est au contraire lorsque la nouvelle procédure aura fait ses preuves que l'on pourra sans difficulté introduire l'opinion dissidente. Le contrôle de constitutionnalité est, je crois, encore trop récemment entré dans les moeurs françaises pour que l'on risque de le menacer par des opinions dissidentes, lesquelles sèmeraient le doute dans l'opinion. Ce que nous, juristes, savons être légitime exige, à l'égard du contrôle de constitutionnalité, un niveau de maturité que les Français, y compris dans leur système politique, n'ont sans doute pas tout à fait atteint. Le temps viendra, mais je crois qu'il n'est pas encore venu.
Enfin, la référence faite par l'article 61-1 aux « droits et libertés que la Constitution garantit » couvre à mes yeux les objectifs à valeur constitutionnelle. La Constitution n'est pas triviale, et par essence ce qu'elle contient est important ; le fait de tourner le dos à un objectif dont on a reconnu la valeur constitutionnelle me paraît porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution protège. Pour le reste, ce sera au Conseil constitutionnel de faire preuve du sens de la mesure nécessaire.

Monsieur le professeur Carcassonne, il nous reste à vous remercier de votre contribution à nos travaux.
Audition de M. Paul CASSIA, Professeur à l'Université Paris I

Nous accueillons maintenant M. Paul Cassia, professeur à l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.
Vous avez la parole, monsieur le professeur, tant sur le projet de loi organique que sur le questionnaire que la Commission vous a fait parvenir.
Je ferai deux remarques préliminaires, en réaction aux riches interventions de la semaine passée. Je veux, en effet, insister sur le fait que le projet de loi organique est limité – le professeur Carcassonne l'a souligné à l'instant – par le texte même de l'article 61-1 de la Constitution : le législateur organique ne peut pas faire ce qu'il souhaite.
J'en donnerai deux exemples, qui seront mes remarques préliminaires.
Premièrement, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il s'agit bien d'un contrôle diffus de constitutionnalité qui est organisé quand le juge rejette l'exception soulevée devant lui.
Dans une proposition de loi organique déposée en avril 2009, il était prévu que l'article 61-1 de la Constitution soit étendu à toute juridiction ne relevant ni du Conseil d'État ni de la Cour de cassation – comme, par exemple, le Conseil constitutionnel quand ce dernier statue comme juge électoral. Cela rejoint le souhait émis par Anne Levade la semaine dernière et semble opportun mais ce n'est pas juridiquement possible. Cela ne signifie pas que l'exception d'inconstitutionnalité soit interdite devant ces juridictions – elles peuvent se reconnaître la faculté de soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'elles-mêmes –, mais qu'elle n'est pas celle de l'article 61-1.
Une deuxième limite posée par le projet de loi organique a trait au relevé d'office par la juridiction de la question de constitutionnalité, proposé la semaine passée par Anne Levade et le président Le Prado. Il n'est pas possible que le juge ordinaire relève d'office la question de savoir si une loi est conforme ou non à la Constitution. Le texte de l'article 61-1 de la Constitution prévoit qu'il doit être soutenu que la loi est inconstitutionnelle. Le projet de loi organique va le plus loin possible en prévoyant que la question de constitutionnalité de la loi est un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé par les parties à tout stade de la procédure, mais il n'est pas permis de l'ériger en moyen devant être relevé d'office.
J'aborderai maintenant quelques aspects techniques du projet de loi organique, avant d'en venir à des propositions de modification plus substantielles.
En son état actuel, le projet de loi organique me semble devoir faire l'objet de « lissages » pour éviter des difficultés devant le juge ordinaire et les juridictions suprêmes.
Devant le juge ordinaire, il convient que le moyen d'inconstitutionnalité figure dans un « écrit » ou « mémoire » distinct. Je vous renvoie au document que je vous ai remis : il énumère les questions susceptibles d'être soulevées devant la juridiction ordinaire et sur lesquelles il serait souhaitable que le législateur organique prenne position au cours des travaux préparatoires. Elles concernent, certes, des aspects très techniques mais très utiles pour les justiciables.
Extrait des observations communiquées par M Paul Cassia :
Le projet de loi organique emploie indifféremment, s'agissant de la recevabilité du moyen tiré de l'exception d'inconstitutionnalité, les termes « écrit » ou « mémoire » distinct, On trouve également l'indication, s'agissant de l'appel d'une décision d'une cour d'assises, selon laquelle le moyen peut être soulevé « dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel » - il ne pourrait donc plus être soulevé postérieurement à l'appel.
Un terme unique doit être employé, celui de mémoire pouvant être privilégié..
Il faut avoir à l'esprit les difficultés pratiques que l'exigence d'une particularisation du moyen tiré de l'exception d'inconstitutionnalité de la loi peut soulever, et auxquelles il serait utile que le rapport sur le projet de loi organique réponde par avance ; le mémoire « ad hoc » doit-il être produit en même temps que le mémoire principal ? Ce mémoire ad hoc est-il recevable lorsqu'il est agrafé au mémoire principal ? Quid si le moyen d'inconstitutionnalité figure dans le mémoire au principal, mais dans une partie distincte de celui-ci (par exemple, au verso d'une feuille) ? Est-il recevable s'il figure dans le mémoire principal et dans un mémoire accessoire ? Doit-il faire l'objet d'un enregistrement spécifique par le greffe ? Quid si l'écrit comporte des moyens accessoires (autres que celui tiré de l'inconstitutionnalité) et des conclusions accessoires (frais irrépétibles pour sa rédaction) ?
Il faut également éclairer la question de la régularisation de cette irrecevabilité : une régularisation est-elle possible, et si oui jusqu'à quand ? Jusqu'à l'expiration du délai de recours ? La clôture de l'instruction, comme le laisse supposer la circonstance que le moyen tiré de l'exception d'inconstitutionnalité sera d'ordre public ? Le greffe doit-il adresser à la partie concernée une invitation à régulariser ?
Toute une série de questions techniques vont également se poser devant les juridictions suprêmes. Ne pouvant, faute de temps, toutes les énumérer, j'insisterai sur quelques points que le projet de loi organique ne tranche pas ou, plutôt, laisse dans l'ombre.
En premier lieu, quelle est la nature de la décision rendue par la juridiction suprême sur la question de savoir s'il faut saisir ou non le Conseil constitutionnel ?
Dans le texte proposé pour l'article 23-6 de l'ordonnance de 1958 – alinéa 29 de l'article 1er du projet de loi organique – le terme « arrêt » de la Cour de cassation est employé. On trouve ensuite le terme plus ambigu de « décision » du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Certains intervenants, la semaine passée, ont émis l'idée que la décision de la juridiction suprême soit un avis équivalant à l'avis contentieux actuellement utilisé devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Cette question n'est pas anodine : elle conditionne l'intervention des tiers – elle n'est pas possible dans la procédure d'avis contentieux – et le temps de parole accordé aux avocats – au Conseil d'État, même les avocats aux conseils ne peuvent plus reprendre la parole après l'intervention du rapporteur public quand celui-ci conclut sur une demande d'avis contentieux. Il est donc fondamental que le législateur organique tranche.
Étant favorable à tout ce qui peut permettre de renforcer le contradictoire, je serai d'avis que la décision de la juridiction suprême soit rendue selon la procédure applicable aux arrêts.
En deuxième lieu, quelles sont les conditions de la transmission par le juge ordinaire de la question de constitutionnalité à la juridiction suprême et du renvoi de cette question par les juridictions suprêmes au Conseil constitutionnel ?
Dans le projet de loi organique actuel, les critères diffèrent : le juge du fond doit vérifier que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; la juridiction suprême doit vérifier que la disposition contestée ou bien « soulève une question nouvelle », ou bien « présente une difficulté sérieuse ». Il est indispensable d'harmoniser les conditions de la transmission et du renvoi parce qu'il arrive que le Conseil d'État soit saisi en premier et dernier ressort. Je ne comprendrais pas qu'il soit soumis à des conditions de renvoi différentes selon qu'il est juge de premier et dernier ressort ou juge saisi par une juridiction ordinaire. En tout état de cause, l'alternative ouverte aux juridictions suprêmes – renvoi parce que la disposition contestée soit soulève une question nouvelle, soit présente une difficulté sérieuse – est redondante. Par définition, la question posée est nouvelle. Autrement, elle ne passerait pas le filtre de la deuxième condition présidant au renvoi au Conseil constitutionnel.
Je préconise un alignement des conditions du renvoi au Conseil constitutionnel par les juridictions suprêmes sur celles de la transmission par le juge ordinaire à ces dernières, c'est-à-dire de retenir le caractère sérieux de la question posée, ce qui rejoint la proposition de loi organique déposée en avril 2009.
En troisième lieu, la question de la recevabilité de la transmission de la question par le juge ordinaire à la juridiction suprême n'est pas abordée dans le projet de loi organique. Cette dernière pourra-t-elle vérifier que le moyen d'inconstitutionnalité n'a pas été soulevé d'office par la juridiction et qu'il figurait bien dans un mémoire ou un écrit distinct ? Ces points méritent d'être clarifiés au fil de vos travaux.
En quatrième lieu, comme cela a été indiqué par M. Carcassonne, le délai prévu dans le texte proposé pour l'article 23-2 pour transmettre la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation est trop long. Il faut remplacer, comme le proposait également le président Colliard la semaine dernière, les termes « dans les huit jours » par les mots : « sans délai ».
Enfin, il me semble nécessaire d'obliger la juridiction suprême à motiver sa décision sur le renvoi de l'exception au Conseil constitutionnel. Le justiciable doit pouvoir en connaître les raisons – de fait ou de droit. Cette motivation est, d'ailleurs, exigée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je renvoie sur ce point la Commission à un arrêt de cette Cour du 15 juillet 2003 – Ernst contre Belgique : chargée de vérifier si le refus de la Cour de cassation belge de transmettre une question de constitutionnalité à la Cour d'arbitrage, qui est une cour constitutionnelle, n'est pas entaché d'arbitraire, la Cour européenne des droits de l'homme conclut par la négative parce que le refus est motivé.
J'en viens maintenant à des appréciations plus substantielles.
J'exprimerai tout d'abord un sentiment général : il me semble que le projet de loi organique ne contribue qu'imparfaitement à l'attractivité du contrôle diffus de constitutionnalité de la loi promulguée. Il l'impose aux justiciables en donnant la priorité à l'exception d'inconstitutionnalité sur l'exception d'inconventionnalité. Je m'attacherai à le démontrer en me plaçant du point de vue, non pas du juge, de l'avocat ou du professeur de droit, mais du justiciable. Sous cet angle, le projet de loi organique me semble devoir être amélioré sur trois points, qui soulèvent des difficultés d'application prévisibles.
Premier point : quel est l'impact du contrôle diffus de constitutionnalité sur les procédures de référé ?
Les instances en référé relèvent-elles ou non du champ d'application de l'article 61-1 de la Constitution ? La réponse n'est pas claire à la lecture du projet de loi organique.
On peut lire, à la page 6 de l'exposé des motifs : « Les délais d'examen de la question de constitutionnalité par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, puis, le cas échéant, par le Conseil constitutionnel, ne sont pas compatibles avec certaines règles de procédure qui imposent que le juge statue dans un délai déterminé. » Cela semble exclure le contrôle diffus de constitutionnalité dans les procédures d'urgence.
Pourtant, des articles du projet de loi organique disposent qu'en cas d'urgence, la juridiction ordinaire peut statuer sur la question de constitutionnalité sans attendre la réponse de la juridiction suprême « si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ».
De fait, il va de soi que les procédures de référé entrent dans le champ d'application de l'article 61-1 de la Constitution. Le texte ne laisse pas le choix puisque les mots « à l'occasion d'une instance en cours » incluent les procédures de référé.
Dès lors, le projet de loi organique est lacunaire à deux égards.
D'une part, il prévoit qu'en cas d'urgence, la juridiction suprême ou le juge ordinaire peut décider le renvoi de la question au Conseil constitutionnel sans prononcer de sursis à statuer. Il est étonnant qu'une procédure puisse se dérouler devant le Conseil constitutionnel alors qu'elle est achevée devant le juge ordinaire. À l'égard de quels justiciables va-t-il rendre sa décision ? Il faut prévoir une réouverture automatique de l'instruction après que la juridiction suprême ou le Conseil constitutionnel s'est prononcé.
D'autre part, cette procédure ne concerne que les cas d'urgence et non les cas d'extrême urgence : je pense au référé-liberté et au référé-suspension devant le juge administratif. Pour ceux-là, il me semble indispensable de créer une procédure d'examen accélérée des questions de constitutionnalité sur le modèle de l'article 104 bis du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes, avec, par exemple, un renvoi au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans un délai de quelques jours, une simple consultation du rapporteur public, la réunion accélérée d'une formation avec trois juges devant le Conseil constitutionnel.
Deuxième question de fond : la représentation des parties devant la juridiction suprême et le Conseil constitutionnel. Cette question est essentielle du point de vue des parties car elle touche au coût du procès, qui peut devenir disproportionné pour la partie perdante si tous les frais irrépétibles sont mis à sa charge.
J'ai lu avec un peu d'amusement les points de vue exprimés la semaine passée par les représentants du barreau et des avocats aux Conseils. Il faut dépasser l'aspect corporatiste du problème.
La question de la représentation des parties n'a pas nécessairement à figurer dans une loi organique. Cela étant, qu'elle relève de la loi ordinaire ou du règlement, il appartient au législateur organique de prendre position sur ce point dans les travaux préparatoires, ne serait-ce que pour que cette question soit envisagée de la même manière devant les juridictions suprêmes et devant le Conseil constitutionnel, qui va devoir se prononcer à son sujet.
Il y a au moins deux solutions possibles.
La première est l'application des règles de droit commun. S'il n'y a pas de ministère d'avocat devant la juridiction ordinaire, il n'y en a pas non plus devant la juridiction suprême ni devant le Conseil constitutionnel. En revanche, si un avocat est prévu devant la juridiction ordinaire, il y a un avocat aux conseils devant la juridiction suprême ainsi que devant le Conseil constitutionnel.
La deuxième solution consisterait à appliquer des règles particulières. Si un avocat à la Cour est prévu devant la juridiction ordinaire, cet avocat – comme cela a été envisagé par les représentants du barreau la semaine dernière – pourrait suivre son client devant la juridiction suprême et devant le Conseil constitutionnel.
Après tout, l'avocat qui a soulevé le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi est tout à fait apte à poursuivre la procédure devant les juridictions supérieures. Les avocats à la Cour sont déjà habilités à le faire s'agissant du contentieux électoral. La proposition de loi organique déposée en avril 2009 prévoyait cette possibilité.
Je vous proposerai quant à moi une troisième solution, dans laquelle je change de point de vue par rapport à l'année passée. Il me paraîtrait bon d'instaurer dans tous les cas un monopole de la représentation par avocat aux conseils devant la juridiction suprême et devant le Conseil constitutionnel, à la condition que l'État prenne en charge les frais de la représentation par avocats aux conseils.
Pourquoi proposer un monopole par avocat aux conseils ? Pas pour des raisons de technicité juridictionnelle – on n'est pas dans le cadre d'un recours en cassation, où les moyens doivent être présentés d'une certaine manière, justifiant le savoir-faire des avocats aux conseils –, mais simplement pour des raisons de proximité géographique avec les juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel. Cela permettrait de limiter les coûts du procès. Il n'est, pour s'en convaincre, que d'imaginer un avocat à la Cour qui soulève devant le tribunal administratif de La Réunion un moyen tiré d'une exception d'inconstitutionnalité, qui sera transmis et renvoyé à la juridiction suprême ou au Conseil constitutionnel. Les coûts seraient excessifs. Les avocats aux conseils peuvent utilement servir de relais, comme ils le font souvent.
Ce monopole n'est envisageable qu'à la condition que l'État prenne entièrement en charge les frais de la représentation par avocats aux conseils. Cela ne doit pas entraîner de coût pour le justiciable. La rémunération de l'auxiliaire de justice doit être fixée par arrêté. Je ne propose pas une aide juridictionnelle, mais un mécanisme équivalent : celui de l'assistance judiciaire de plein droit, sans conditions de ressources, pour l'ensemble des parties, devant les juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel.
Ma troisième et dernière observation substantielle portera sur les rapports entre exception d'inconstitutionnalité et exception d'inconventionnalité.
Les champs d'application de ces deux mécanismes ne sont pas identiques.
Celui du droit international est parfois plus étendu que celui de la Constitution. Par exemple, le principe d'égalité n'a pas la même acception en droit communautaire et en droit constitutionnel.
Parfois, le droit constitutionnel est le seul applicable et sera le seul invoqué par les justiciables. Certains principes n'existent pas dans les conventions internationales, comme le principe magnifique – dont j'ai affiché chez moi la décision constitutionnelle afférente – d'indépendance des enseignants-chercheurs, ainsi que celui de libre administration des collectivités territoriales.
Il arrive aussi que le litige n'entre pas dans le champ d'application du droit international et que le droit constitutionnel soit le seul applicable. Je renvoie à cet égard la Commission à la décision de section du 7 février 2008 du Conseil d'État, Mme Boamar.
La règle de priorité instituée en faveur de l'exception d'inconstitutionnalité comporte un double effet pervers. Je vais donc plaider pour sa suppression.
Premier effet pervers : cette priorité dévalue l'exception d'inconventionnalité.
Elle est contraire à l'intention exprimée par le Président de la République lors du colloque du 3 novembre 2008 sur le cinquantenaire du Conseil constitutionnel. Il avait alors déclaré : « Pas de doutes, vous » – il s'adressait aux membres du Conseil constitutionnel – « rendrez l'exception d'inconstitutionnalité des lois aussi efficace que la contestation de leur conformité au droit international devant le juge ordinaire. » Il ne s'agissait donc pas de diminuer l'exception d'inconventionnalité, mais de faire en sorte que l'exception d'inconstitutionnalité soit au moins aussi efficace.
Le risque est que le justiciable ne soulève pas l'exception d'inconstitutionnalité dès lors qu'il lui apparaîtra possible de se prévaloir de l'inconventionnalité de la loi, afin que son litige soit tranché le plus rapidement possible.
Le second effet pervers de cette priorité donnée à l'exception d'inconstitutionnalité est qu'elle peut être contournée par le biais du droit communautaire, dont le droit de la Convention européenne des droits de l'homme fait partie intégrante.
Je note que, dans le projet de loi organique, l'exécutif a souhaité réserver un sort spécifique au droit communautaire.
La question de savoir s'il fallait que le droit communautaire bénéficie ou non d'une priorité d'application par rapport au droit constitutionnel a été débattue devant vous la semaine passée. Comme l'a indiqué le vice-président du Conseil d'État, les arguments défendus par le sénateur Delpérée ne sont pas recevables du point de vue du droit communautaire : la priorité d'application reconnue à la Constitution n'est pas comparable à la distinction recevabilitéfond devant le juge ordinaire, ni à la distinction moyen de légalité internemoyen de légalité externe. Ce n'est pas une règle de procédure, mais une règle de fond, qui implique que la Constitution a une valeur supérieure au droit international. Il me semble indispensable de prévoir que cette priorité ne joue pas en matière communautaire.
La question est presque tranchée par différents arrêts de la CJCE : l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, l'arrêt Mecanarte du 27 juin 1991, ainsi que l'arrêt Rheinmuhlen-Dusseldorf, moins connu, du 12 février 1974, qui indique clairement que l'efficacité du renvoi préjudiciel ne peut pas être diminuée par une règle nationale, quelle qu'elle soit.
La justification donnée à la page 5 de l'exposé des motifs de la priorité d'application de la Constitution ne va pas de soi. Il y est écrit : « Cette priorité d'examen est liée à l'effet erga omnes de la déclaration d'inconstitutionnalité qui conduira à l'abrogation de la disposition législative contestée. » Lorsque la CJCE, saisie par voie préjudicielle, déclare qu'une directive ou qu'un règlement est contraire au droit communautaire, le texte n'est pas abrogé. Il ne disparaît donc pas de l'ordre juridique. L'invalidité n'a d'effet qu'entre les parties. Pourtant, la procédure n'en est pas moins efficace. La CJCE a clairement indiqué que l'invalidité obligeait les institutions à reprendre le texte et à revenir sur la législation invalide. L'abrogation n'est pas nécessairement une bonne chose pour les pouvoirs publics car elle crée un vide juridique. Il me semble préférable d'obliger les pouvoirs publics à se ressaisir. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a déclaration d'inconventionnalité, le législateur étant en pratique tenu de réexaminer le texte.
Que faire ?
Comme la priorité d'application en faveur de la Constitution ne va pas dans le sens des intérêts du justiciable, je considère qu'il faut supprimer l'alinéa qui l'institue et laisser, comme le préconisait le président Le Prado la semaine passée, au justiciable le soin de choisir quel moyen il va soulever en premier – « à titre principal » ou « à titre subsidiaire » – ou au juge le soin de décider au cas par cas quelle norme doit être appliquée en priorité.
Si la règle de priorité de l'exception d'inconstitutionnalité devait être conservée, il faudrait lisser le projet de loi organique. Comme l'a relevé le professeur Mathieu, elle n'est pas appliquée au Conseil d'État lorsqu'il statue en premier et dernier ressort. Il faudra donc remédier à cette anomalie. À l'alinéa 14 de l'article 1er du projet de loi organique, instituant cette règle de priorité, l'emploi de l'expression « de façon analogue » est particulièrement obscur. Je signale qu'il n'y a jamais d'analogie entre exception d'inconstitutionnalité et exception d'inconventionnalité puisque, dans le premier cas, le justiciable réclame l'abrogation de la loi et que, dans le second, il demande que la loi ne lui soit pas appliquée. Par ailleurs, l'alinéa se termine par les mots : « sous réserve, le cas échéant, des exigences résultant de l'article 88-1 de la Constitution » alors que l'article 88-1 n'est pas le support d'un contrôle de conventionnalité de la loi. Je laisse le soin au secrétaire général du Conseil constitutionnel d'en parler.
En conclusion, je rappelle que l'objet de la révision constitutionnelle est de faire en sorte que les citoyens s'approprient la Constitution. Cela n'implique pas une règle de priorité au profit de cette dernière. L'appropriation devrait être la conséquence non d'un artifice procédural, mais d'une attractivité supérieure de la Constitution française. On pourrait imaginer d'y insérer des droits fondamentaux qui ne figurent pas dans les conventions internationales de façon que la Constitution devienne bien la référence première des justiciables de France en matière de droits et libertés.

Monsieur le professeur Cassia, nous vous remercions de votre contribution.
Audition de M. Marc GUILLAUME, Secrétaire général du Conseil constitutionnel

Nous accueillons maintenant M. Marc Guillaume, Secrétaire général du Conseil constitutionnel.
Je précise que mes propos n'engageront pas le Conseil constitutionnel, qui contrôlera la conformité de la loi organique à la Constitution.
Il me semble très important que ce texte relatif à l'application de l'article 61-1 de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui est la principale disposition donnant des droits nouveaux aux citoyens soit rapidement inscrit à l'ordre du jour du Parlement et adopté, comme l'ont déjà été d'autres projets de loi organique tendant à appliquer la révision constitutionnelle.
Je commencerai par répondre à vos questions concernant le périmètre de la question de constitutionnalité.
L'expression « disposition législative » suffit à permettre de contester la constitutionnalité d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie. L'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose en effet que les lois du pays ont « force de loi ». En outre, le Conseil constitutionnel les qualifie de « lois » dans sa décision n° 99-410 DC. Enfin, il n'y a pas de raison que ces lois du pays bénéficient d'une immunité constitutionnelle, au détriment des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, des amendements aux dispositions prévues pour les nouveaux articles 23-8 et 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 s'imposent.
Les termes « droits et libertés garantis par la Constitution » devraient-ils permettre d'invoquer une incompétence négative du législateur ? La question de constitutionnalité doit-elle inclure certains aspects du contrôle de constitutionnalité externe ? Sûrement pas pour la procédure parlementaire ou les éventuels empiétements de la loi sur le domaine réglementaire. En revanche, devrait pouvoir être soulevée la question du manquement à l'obligation faite à la loi de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. Il en irait de même dans le cas de l'incompétence négative du législateur. Le Conseil constitutionnel a récemment censuré une série d'incompétences négatives dont la plupart n'entreraient pas dans le champ des « droits et libertés garantis par la Constitution », notamment au travers de la décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009 concernant la censure du renvoi à un décret des taux d'un prélèvement sur les ressources financières des organismes HLM. L'incompétence négative ne pourra être invoquée que si la protection d'un droit ou d'une liberté est en cause.
Quels seraient les principes constitutionnels le plus susceptibles d'être utilisés par des requérants pour soulever des questions de constitutionnalité ? Il est bien difficile de faire un pronostic en la matière. Deux critères, l'un restrictif, l'autre extensif, peuvent guider ce pronostic. Dans les matières où les lois ont été systématiquement soumises au Conseil constitutionnel depuis vingt ou trente ans – il en va ainsi pour la procédure pénale ou le droit des étrangers –, il est probable que les saisines seront moins fréquentes. En revanche, dans les matières exclues du champ de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, on peut penser qu'il y aura davantage de saisines ; de même, le principe d'égalité n'a pas la même portée à l'article 14 de la CEDH et dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'État et la Cour de cassation ne risquent-il pas de prononcer des « pré-jugements de constitutionnalité » ? Cette question est importante ; elle renvoie à celle du bon fonctionnement du système. La France sera le seul pays dans lequel la saisine a posteriori de la juridiction constitutionnelle s'opérera par le filtre des cours suprêmes. Les deux seuls précédents qui ont existé, en Allemagne et en Autriche, ont très mal fonctionné, ce qui a rapidement conduit à supprimer le filtre – en Allemagne, il n'a existé qu'entre 1951 et 1956. Comment faire pour que la double spécificité de la France, caractérisée par l'existence d'un filtre et par son bon fonctionnement, n'empêche pas la réussite de la réforme ? Deux conditions devront être réunies.
D'une part, il faut bien s'entendre sur le rôle du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Ceux-ci auront à décider s'il leur apparaît qu'une loi présente un risque d'inconstitutionnalité. Pour exercer cette fonction, ni le Conseil d'État ni la Cour de cassation ne devront eux-mêmes faire oeuvre d'interprétation de la Constitution ; ils devront appliquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est le sens de la condition relative à l'existence d'une précédente déclaration de conformité « dans les motifs et le dispositif » d'une décision. Il ne s'agira pas seulement de l'autorité de la chose jugée mais également de la chose interprétée. Alors que le Conseil d'État, depuis décembre 2006, reconnaît aux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes l'autorité de la chose interprétée, il conviendra de faire de même pour les décisions du Conseil constitutionnel. Dans le futur, si le Conseil d'État et la Cour de cassation éprouvent un doute, ils devront renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Telle est la logique de la spécialisation des juges : le Conseil d'État et la Cour de cassation ne sont pas juges constitutionnels mais juges conventionnels.
D'autre part, toujours dans la logique de spécialisation des juges, le Conseil constitutionnel est renforcé dans sa fonction de juge constitutionnel par l'article 61-1, mais il maintient aussi depuis près de trente-cinq ans sa jurisprudence n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, dite « IVG ». Il est l'unique juge constitutionnel des lois et il n'est que cela. Toute la logique de la réforme est fondée sur cette spécialisation. Il est par exemple impossible que le Conseil d'État ou la Cour de cassation opère des déclarations de constitutionnalité sous réserve. En effet, si une loi était interprétée dans un sens la rendant conforme à la Constitution, la question ne serait pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Une telle orientation ferait du Conseil d'État et de la Cour de cassation des juges de constitutionnalité. Pour la même raison, le Conseil d'État devra réexaminer sa jurisprudence relative à l'abrogation implicite des lois antérieures à la Constitution, qui est désormais contraire à l'article 61-1 de la Constitution. À l'évidence, ces orientations nécessiteront un « self restraint ». Nul ne doute en effet de la capacité du Conseil d'État et de la Cour de cassation à imaginer la solution à diverses questions constitutionnelles qui leur seront soumises. Le Conseil d'État les traite même dans le cadre de ses formations administratives. Mais, ici, il n'en aura pas la compétence, ce n'est pas son métier. Le Conseil constitutionnel, qui a les capacités à régler les questions conventionnelles, sait résister à cette tentation.
Il faut faire confiance aux trois juridictions pour mettre en oeuvre cette spécialisation. Sinon, il faudrait soit supprimer le filtre, soit recourir à la solution avancée par Jean-Claude Colliard : que le Conseil constitutionnel se saisisse des questions de constitutionnalité qui ne lui sont pas renvoyées.
J'en viens à vos questions concernant le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité.
Est-il nécessaire d'instaurer la priorité de la question de constitutionnalité sur la question de conventionnalité ? Si le juge pouvait refuser de transmettre la question de constitutionnalité au motif que la loi contestée peut être écartée par un raisonnement de conventionnalité, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 serait triplement mise en échec.
Premièrement, compte tenu de la proximité entre, d'une part, la protection constitutionnelle des droits et libertés, et, d'autre part, la protection conventionnelle des droits et libertés, la quasi-totalité des questions de constitutionnalité pourraient être rejetées au motif que la loi contestée doit être écartée pour inconventionnalité. La question de constitutionnalité serait alors circonscrite aux seules spécificités de la Constitution française, comme le principe de laïcité. La réforme serait vidée de tout contenu ; elle aurait fait « pschitt ».
Deuxièmement, l'article 61-1 vise à réaffirmer la hiérarchie des normes, à remettre la Constitution au sommet de l'ordre juridique français. Il est en effet apparu anormal que tous les juges puissent écarter une loi nationale pour un motif d'inconventionnalité alors que le respect de la Constitution ne pouvait être invoqué devant eux. Si l'inconventionnalité devait faire écran à l'inconstitutionnalité, cette anomalie subsisterait ; pire, la Constitution deviendrait définitivement une norme seconde.
Troisièmement, la réforme du 23 juillet 2008 permet l'abrogation erga omnes de la loi. Si le contrôle diffus et relatif de conventionnalité devait primer sur le contrôle de constitutionnalité, la réforme n'aurait pas atteint son objectif. Comme l'a souligné devant vous Jean-Marc Sauvé, il en va de la qualité de l'ordonnancement juridique.
À ces trois considérations relatives à la hiérarchie des normes et à la spécialisation des juges, je voudrais en ajouter une, liée au requérant, un peu trop souvent oublié alors que cette réforme a pour objet de lui conférer un droit nouveau. Le requérant, avec ses conseils, doit pouvoir développer une stratégie judiciaire. Il peut souhaiter ne soulever qu'un moyen de conventionnalité, par exemple parce qu'il pense pouvoir gagner en s'appuyant sur une jurisprudence très établie de la CEDH. Il faut respecter ce choix et ne pas indiquer, comme en 1990 avec le précédent projet de loi organique, que « l'exception d'inconstitutionnalité présente le caractère d'un moyen d'ordre public ». Il est peut-être excessif d'interdire au juge de la soulever – ce que font les sixième et vingt-quatrième alinéas de l'article 1er du projet de loi organique – mais cela doit, en tout état de cause, être non pas une obligation, mais une faculté. Il en va d'ailleurs du respect de la lettre de l'article 61-1 de la Constitution. Dans sa stratégie judiciaire, le requérant peut au contraire poser la question de la constitutionnalité ou combiner les deux questions ; il demande alors l'abrogation de la loi. Il en ira notamment ainsi pour les personnes morales, association de consommateurs, ligue de contribuables ou défenseurs de la nature. Pour ces personnes morales, l'issue du litige est l'abrogation de la disposition législative. Il n'est constitutionnellement pas possible de donner satisfaction à ces requérants sans avoir statué sur la question de constitutionnalité, il en va du respect de l'article 61-1.
Au total, cet article a créé un droit nouveau, une procédure particulière, qui a un objet propre, différent de l'incompatibilité entre la loi interne et une convention internationale. Elle vise spécifiquement l'abrogation de la norme. C'est en quelque sorte un recours préalable en abrogation. Comme l'a très bien dit devant vous le professeur Bertrand Mathieu « La question de constitutionnalité est à la disposition du justiciable mais rien ne l'oblige à la poser. Mais si elle l'est, le juge doit répondre car on ne peut pas laisser sans réponse la demande d'abrogation formulée par le justiciable. »
Lorsqu'une disposition législative suscite à la fois une question de constitutionnalité et une question de contrariété au droit communautaire, comment peut se régler la priorité entre ces deux questions ? Cette question est la plus importante à mes yeux. Je distinguerai deux niveaux de réponse : la procédure et la hiérarchie des normes.
Le niveau procédural est très important car il permet de redire comment la question de constitutionnalité doit fonctionner. Le constituant l'a largement souligné, cette procédure doit être rapide. La logique du projet interdit que la question de constitutionnalité ne soit posée qu'à l'issue de toute l'instruction de l'affaire, lors de l'audience finale du jugement. Il ne s'agit pas, aux termes d'une instruction pénale de cinq ans, d'ajouter deux fois trois mois de procédure. Il ne s'agit pas davantage, alors qu'un jugement au fiscal du tribunal administratif de Paris intervient quatre ans après le dépôt de la requête, d'ajouter encore deux fois trois mois.
Le projet implique que la question de constitutionnalité soit traitée « sans délai », dès qu'elle est posée. C'est pourquoi elle fait l'objet d'un mémoire distinct et séparé. C'est pourquoi les conditions de renvoi données au juge de première instance ou d'appel sont simples à examiner. Il ne faut donc pas imaginer un juge ayant face à lui un dossier entièrement instruit avec, par hypothèse, une question de constitutionnalité et une question de droit communautaire, ce juge devant alors choisir entre elles. Le dossier que le juge a entre les mains n'est pas en état, notamment sur le moyen de droit communautaire ; il possède seulement en état le mémoire distinct et séparé sur la question de constitutionnalité. Ainsi, s'il pose cette question, les deux fois trois mois d'examen de la question vont s'imputer sur la durée de la procédure et non s'y ajouter. Il faut renforcer les orientations du projet de loi organique sur ce point.
Il faut réaffirmer que l'examen de la question de constitutionnalité s'effectue préalablement à la solution du litige : le juge doit, en vertu de l'article 23-2, premier alinéa, statuer « sans délai » sur cette question dès qu'elle lui est posée. C'est d'ailleurs, indépendamment de toute autre préoccupation, la seule façon d'éviter les actions dilatoires. À cet égard, j'ai été très sensible aux propos de Me Thierry Wickers, qui vous a indiqué avec honnêteté : « Il faut couper court à la tentation qui pourrait exister d'attendre que les choses se décantent, qu'une question de conventionnalité soit évoquée ».
Outre l'ajout de la précision « sans délai », il conviendrait, dans le même sens, de réécrire le premier critère de transmission – « commande l'issue du litige » –, qui traduit mal le caractère préalable de la question. Jean-Claude Colliard vous a proposé cette rédaction : « est en rapport direct avec l'issue du litige ». Elle rejoindrait la précision de vocabulaire qu'a déjà parfaitement avancée devant vous Jean-Marc Sauvé. La question de constitutionnalité n'est pas une question préjudicielle puisqu'elle doit être traitée avant les autres.
Le deuxième niveau de réponse à votre question est plus fondamental puisqu'il touche à la hiérarchie des normes. Cette loi organique concerne l'ordre interne, dans lequel la Constitution est au sommet de la hiérarchie juridique. Cette primauté de la Constitution est reconnue tant par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-505 DC, que par le Conseil d'État, dans son arrêt Sarran, et par la Cour de cassation, dans sa jurisprudence Mlle Fraisse. Cette primauté s'exerce bien sûr à l'égard du droit communautaire. C'est même pour cela que le Conseil constitutionnel a dégagé une jurisprudence sur l'« identité constitutionnelle de la France ». Bref, nous ne sommes pas, ou pas encore, dans un État fédéral, dans lequel les juges pourraient ne pas tenir compte de la Constitution pour faire mieux respecter le droit communautaire.
À ce sujet, j'ai été très étonné d'entendre l'une des personnes que vous avez auditionnées affirmer : « Le droit communautaire doit conserver sa primauté et si une question d'incompatibilité au droit communautaire est posée, elle doit prévaloir par rapport à la question de constitutionnalité. » Cette affirmation confond ordre juridique interne et ordre juridique communautaire. Il est faux d'avancer que le droit constitutionnel impose le respect de la primauté du droit communautaire. Je souhaite insister sur les deux conséquences très importantes qu'aurait cette affirmation fausse.
D'une part, elle impliquerait une nouvelle hiérarchie des normes, avec au sommet le droit communautaire, puis le droit constitutionnel, puis le reste du droit. C'est ce que Jean-Claude Colliard a relevé devant vous : « L'idée que le respect de l'article 88-1 impose d'abord de traiter la conformité au droit communautaire, voire de poser la question préjudicielle, porte le risque de l'affirmation d'une sorte de priorité du droit communautaire sur le droit constitutionnel national. » Une telle conception de la hiérarchie des normes est évidemment dénuée de tout fondement. Elle est démocratiquement et politiquement inacceptable, elle est juridiquement fausse.
D'autre part, cette assertion devrait conduire à la modification du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. Celui-ci devrait en effet faire respecter la règle de niveau constitutionnel, il deviendrait juge de la conventionnalité communautaire. L'article 88-1 inclurait ce contrôle, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous n'avons jamais identifié qu'une seule exigence constitutionnelle de l'article 88-1 : celle relative à la transposition des directives communautaires. Devenir juge de la conventionnalité communautaire accroîtrait certes le rôle du Conseil constitutionnel mais irait fondamentalement à l'encontre de la logique de spécialisation des juridictions, au coeur de la réforme de l'article 61-1.
Au total, les termes très malheureux utilisés à l'article 23-2, cinquième alinéa, tel qu'il résulte de l'article 1er du projet de loi organique, « sous réserve, le cas échéant, des exigences résultant de l'article 88-1 de la Constitution », ne peuvent être conservés en l'état. Ce que cet article semble chercher à préserver, c'est la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de Luxembourg. Mais il est très clair que les juridictions nationales doivent avoir cette possibilité; les juridictions statuant en dernier ressort ont même le devoir de saisir la CJCE des difficultés d'interprétation qu'elles rencontrent dans le droit communautaire. Elles ne peuvent au demeurant être privées de ce droit, en vertu de la fameuse jurisprudence Simmenthal, qui condamne une législation nationale imposant une saisine de la juridiction constitutionnelle pour faire respecter le droit communautaire. Vous voyez aisément que ce problème ne se pose pas avec le projet de loi organique. Il n'est pas question ici de réserver à une autre autorité que le juge saisi le soin d'assurer le respect du droit communautaire.
La règle générale de priorité de la question de constitutionnalité posée par le projet de loi organique n'est en rien contraire à ces règles communautaires. Elle n'interdit pas au juge, ni dans un premier temps, ni dans un second temps, de s'adresser à la CJCE. La question de constitutionnalité peut s'accommoder d'une question préjudicielle posée concomitamment à la CJCE.
L'article 23-2, cinquième alinéa, mérite d'être triplement précisé pour traduire ces idées. D'abord, le professeur Francis Delpérée vous l'a dit, il ne revient pas, comme il est énoncé pour le moment, à la juridiction saisie de se prononcer ; celui qui se prononcera sur cette question est le Conseil constitutionnel. Ensuite, le professeur Paul Cassia vient de le souligner, il faut supprimer les termes « de façon analogue », qui seront source de jurisprudences contradictoires sans fin. Enfin, il doit en aller de même des termes très ambigus « sous réserve des exigences résultant de l'article 88-1 ». Il convient soit de ne rien dire, comme c'est le cas chez tous nos voisins, car il n'est pas besoin de rappeler l'existence de la question préjudicielle à la CJCE, soit d'ajouter « sans préjudice de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne » pour rappeler cette faculté.
Il serait assez logique que le désistement d'instance ou d'action rende sans objet la question de constitutionnalité.
Extrait des observations communiquées par M. Marc Guillaume
Un argument, que j'ai déjà souligné, milite en ce sens. La réforme a entendu donner un droit au requérant, « à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction », pour voir trancher la question de la conformité à la Constitution de la disposition législative contestée. Un requérant ne peut pas être privé de ce droit, y compris en lui donnant satisfaction sur le fond de l'instance. En effet, l'intéressé demande également l'abrogation de la norme par le biais de la question de constitutionnalité. Une réponse à cette demande est nécessaire, ce qui interdit de régler l'affaire positivement à son profit en évitant de traiter la question de constitutionnalité.
Cette logique suivie par le constituant doit conduire à considérer que la question de constitutionnalité est abandonnée en cas de désistement d'instance ou d'action. Cette question n'existe pas par elle-même.
La motivation des décisions de renvoi de la question au Conseil constitutionnel est-elle ou non souhaitable ? Les juridictions devraient-elles pouvoir reformuler les termes de la question ? On n'imagine pas que le Conseil d'État ou la Cour de cassation, juges suprêmes de leur ordre juridictionnel, ne motivent pas leurs décisions. Pour autant, il s'agira seulement de pointer le critère qui n'est pas rempli, par exemple celui de la chose déjà jugée par le Conseil constitutionnel.
Je saisis cette question pour dire quelques mots sur le délai de trois mois laissé au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour que ces juridictions se prononcent. Tout laisse à penser qu'il sera respecté. Néanmoins, par hypothèse, quelle serait la sanction dans le cas inverse ? Le constituant semble avoir expressément prévu la réponse à l'article 61-1 de la Constitution, qui impose que ces juridictions « se prononcent dans un délai déterminé ». Cette précision, ajoutée par amendement lors des débats parlementaires, implique une sanction du non-respect du délai. Dès lors, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sous trois mois, la question de constitutionnalité doit être transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe.
Le Conseil constitutionnel sera-t-il tenu par les termes de la question qui lui a été renvoyée ? S'agissant de l'objet de la saisine, c'est-à-dire de la disposition législative contestée, le Conseil constitutionnel sera bien évidemment tenu par les termes de sa saisine. S'agissant des moyens soulevés, mutatis mutandis, il est dans la même situation que le Conseil d'État ou la Cour de cassation : il pourra reformuler les termes de la question.
Les observations formulées par les plus hautes autorités de l'État à propos de la constitutionnalité de la loi devront s'inscrire dans le contradictoire et être communiquées aux parties.
Je ne crois pas que la présentation contradictoire des observations des parties risque de transformer la question de constitutionnalité en un litige incident. Cette présentation contradictoire a pour seul objet d'assurer un bon déroulement du procès constitutionnel.
La dispense du ministère d'avocat devrait-elle s'appliquer en toute hypothèse devant le Conseil constitutionnel ? Le bon système serait que la représentation devant le Conseil constitutionnel soit facultative. Les parties seraient autorisées à désigner la personne de leur choix pour les représenter. Cette option présenterait l'avantage d'être identique à la règle applicable pour le contentieux électoral. Cela n'interdirait pas la présence de mandataires qui ne seraient pas avocats, par exemple pour les contentieux prud'homaux. Mais l'accès à la barre serait réservé aux avocats à la Cour ou aux avocats au Conseil car il n'est pas permis de penser que n'importe quel mandataire choisi par les parties puisse formuler des observations orales. Ces règles pourront être fixées, comme le prévoit l'article 3 du projet de loi organique, dans le règlement intérieur du Conseil, sachant qu'un décret est déjà prévu, par exemple, pour les règles relatives au montant des unités de valeur allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Pour le reste, les règles de droit commun s'appliqueront. Le projet de loi organique fait bien de prévoir des dispositions relatives à une formation spéciale au sein de la Cour de cassation, si ce choix est le vôtre. Plus exactement, si une telle formation doit exister, il faut le prévoir dans la loi organique, le recours à une loi ordinaire étant expressément exclu par l'article 61-1. En tout cas, le Conseil devra obligatoirement trancher ce point lorsqu'il sera saisi de la loi organique, quitte à déclasser lesdites dispositions.
S'agissant des conséquences d'une abrogation, je vous ai indiqué par écrit les rares jurisprudences du Conseil constitutionnel s'appuyant sur la technique de « déclaration d'inconstitutionnalité différée dans le temps ». Nous en ferions un usage limité, la stabilité des situations juridiques étant fondamentale.
Extrait des observations communiquées par M. Marc Guillaume
- D'une part, le Conseil a déjà reporté dans le temps les effets d'un manquement constaté à des dispositions ayant valeur constitutionnelle : lors de l'examen des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2006, il a ainsi reporté à l'année suivante la mise en conformité avec les exigences résultant de la loi organique applicable, dans un cas, « afin de laisser aux autorités compétentes le temps de procéder aux adaptations nécessaires et de surmonter les difficultés inhérentes à l'application » de la nouvelle norme (décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, cons. 26) et, dans l'autre cas, en raison de « l'intérêt général de valeur constitutionnelle qui s'attache à la protection sanitaire de la population » (décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, cons. 24),
- D'autre part, à l'occasion de l'examen de la «loi OGM », le Conseil constitutionnel a utilisé, dans les motifs et le dispositif de sa décision, la technique de la déclaration d'inconstitutionnalité différée dans le temps (n° 2008-564 DC du 19 juin 2008). Il a alors jugé que «la déclaration immédiate d'inconstitutionnalité des dispositions contestées serait de nature à méconnaître une telle exigence (de transposition en droit interne des directives communautaires) et à entraîner des conséquences manifestement excessives ; que, dès lors, afin de permettre au législateur de procéder à la correction de l'incompétence négative constatée, il y a lieu de reporter au 1erjanvier 2009 les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. »
Ces décisions soulignent que le Conseil prend en compte diverses exigences constitutionnelles pour opérer un report dans le temps. La stabilité des situations juridiques comme les conséquences d'une remise en cause d'une annulation sont également fondamentales. Il en ira de même demain dans le cadre tracé par l'article 62 de la Constitution, Cette faculté ne sera pas, le plus souvent, utilisée. Lorsqu'elle le sera, ce sera au vu de ces exigences. C'est tout le sens des jurisprudences des Cours allemandes et italiennes en la matière.
Si les peines prononcées l'ont été définitivement, elles ne pourront être remises en cause par l'annulation de la norme. L'abrogation d'une disposition législative par le Conseil constitutionnel aura le même effet que l'abrogation d'une loi par le législateur.
Je reprendrai volontiers la formule du professeur Mathieu : « La réforme de 2008 visait un triple objectif : purger l'ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles, permettre au citoyen de faire valoir les droits qu'il tire de la Constitution et assurer la prééminence de la Constitution dans l'ordre juridique. » De ce triple point de vue, le projet de loi organique qui vous est soumis va dans le bon sens. Il soulève encore des interrogations, ou, plus exactement, les interprétations auxquelles il donne lieu montrent que des précisions sont nécessaires dans deux directions.
Premièrement, aussi incroyable que cela puisse paraître, il semble nécessaire de réaffirmer la hiérarchie des normes : dans l'ordre interne, la Constitution est au sommet, ce qui signifie notamment que le constituant a la capacité de la changer. La Constitution prime, bien sûr, sur le droit communautaire, même si tout doit être fait pour éviter les contrariétés et même si, dans l'ordre communautaire, la norme européenne est au sommet. Cela signifie qu'un juge ne pourrait écarter une disposition constitutionnelle au profit d'une disposition communautaire, à moins que le constituant y ait lui-même consenti. Il ne paraissait pas nécessaire de rappeler ces évidences mais les malheureuses ambiguïtés nées de la mention de l'article 88-1 l'imposent.
Deuxièmement, le constituant a choisi une logique de spécialisation des juges : au Conseil constitutionnel un rôle unique, celui de juge constitutionnel ; au Conseil d'État et à la Cour de cassation celui de juge conventionnel. Il importe que cette répartition soit bien respectée par chacun, sans quoi notre système juridique, perdant toute cohérence, entrera dans une période troublée de compétition juridictionnelle. J'ai, pour ma part, foi dans la sagesse et le dialogue des juges.
Pour conclure, j'apporterai une précision complémentaire sur la question : la matière organique fera-t-elle partie du périmètre du contrôle de constitutionnalité ? Les ordonnances organiques prises en application de l'article 92 en 1958 et en 1959 n'ayant jamais été soumises au Conseil constitutionnel, leur conformité pourra être contrôlée, par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité. Par contre, toutes les dispositions des lois organiques adoptées depuis l'installation du Conseil constitutionnel, le 5 mars 1959, ont forcément été soumises au Conseil constitutionnel ; elles ne pourront par conséquent pas faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité, sauf en cas de changement de circonstances.

Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général.
Audition de M. Jean-Louis NADAL, Procureur général près la Cour de cassation

Nous accueillons maintenant M. Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation.
Parmi les innovations introduites par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, celle concernant l'article 61-1 nouveau de la Constitution, qui ouvre à tout justiciable la possibilité d'un recours en inconstitutionnalité de la loi, porte une véritable révolution juridique : désormais, dans le cours d'une procédure civile, pénale ou administrative, chacun aura la faculté de contester la loi qui lui est opposée s'il estime que celle-ci « porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ». Je rappelle l'importance que revêt pour nous cette réforme, à propos de laquelle certains ont pu parler d'un véritable « big-bang juridictionnel ».
Certes, la question de l'exception d'inconstitutionnalité avait été évoquée plusieurs fois dans le passé, notamment dans le programme présidentiel de François Mitterrand avant 1981, dans les propositions de Robert Badinter de 1990 et dans le rapport du comité Vedel de 1993. Certes, une telle exception existe déjà dans nombre de pays. Toutefois, telle qu'elle vient d'être instituée en France, elle peut être regardée comme une étape majeure pour la protection des libertés et la démocratie, ainsi que comme un réel bouleversement institutionnel, tant ses implications sont nombreuses.
Cette réforme vient compléter le contrôle de constitutionnalité a priori ou préventif, c'est-à-dire antérieur à la promulgation de la loi, réservé au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents des assemblées parlementaires et, depuis 1974, à soixante députés ou sénateurs. Elle y ajoute un contrôle a posteriori de la constitutionnalité, au stade de l'application des lois et à l'initiative des citoyens, devenu indispensable pour éviter que certaines lois inconstitutionnelles échappent encore à tout contrôle.
Cette réforme concerne toutes les lois promulguées qui n'ont pas été soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui pourrait concerner de nombreuses dispositions fiscales ou douanières, mais aussi pénales.
Le mécanisme de la question préjudicielle d'inconstitutionnalité est de nature à modifier profondément les rapports entre les juges judiciaires ou administratifs et le Conseil constitutionnel, puisque, par-delà le filtrage obligatoire des juges du fond, de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, qui devrait instituer un nécessaire dialogue des juges, c'est l'autorité ultime du Conseil constitutionnel sur le contrôle des lois qui est consacrée, autorité à laquelle le Conseil d'État et la Cour de cassation devront se soumettre. Le résultat pourrait être, nous le verrons, une remise en cause du contrôle de la conventionnalité des lois, largement utilisé par le juge judiciaire et le juge administratif.
Il va de soi que les incidences de cette réforme peuvent être très importantes sur le déroulement des procès, la durée des procédures et l'organisation de nos juridictions, en fonction du nombre de questions d'inconstitutionnalité qui seront soulevées par les justiciables ou par leurs avocats, encore impossible à mesurer. En ma qualité de procureur général près la Cour de cassation, je ne puis ignorer cet aspect.
Face à l'ensemble de ces enjeux, l'adoption du projet de loi organique, qui a pour objet de préciser les modalités de la mise en oeuvre de l'article 61-1 de la Constitution, revêt un intérêt primordial et appelle une attention toute particulière.
Je m'attarderai sur deux problématiques d'ensemble : le champ d'application de la question préjudicielle de constitutionnalité ; la mise en oeuvre juridictionnelle de la question préjudicielle de constitutionnalité.
La problématique du champ d'application de la question préjudicielle de constitutionnalité recouvre elle-même plusieurs questions.
Première question, quels sont les droits garantis ? Selon l'article 61-1 de la Constitution, une question préjudicielle de constitutionnalité ne peut être soulevée que si la disposition législative contestée porte atteinte « aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Que faut-il entendre par là ?
Il semble naturel que les droits et libertés énoncés dans les articles numérotés de la Constitution soient visés. On peut penser au principe de non-discrimination et à l'exigence de favoriser les femmes dans le cadre des élections politiques ou professionnelles, désormais consacrés à l'article 1er de la Constitution.
Mais la notion de « Constitution » renvoie-t-elle aussi au Préambule ? À vrai dire, il serait étonnant qu'il en soit autrement, d'une part parce que cela irait à rencontre de ce que le Conseil constitutionnel a consacré depuis sa décision du 16 juillet 1971, d'autre part parce que cela viderait de sa substance et de sa portée la réforme proposée. On doit donc conclure que la notion de « Constitution » inclut les droits économiques et sociaux du Préambule de 1946, auquel renvoie celui de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que les droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
Une ambiguïté demeure toutefois s'agissant des principes, exigences et objectifs à valeur constitutionnelle énoncés par le Conseil constitutionnel sans être expressément écrits dans le texte de la Constitution ou de son Préambule : mentionnons l'objectif à valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent ou les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs – primauté de l'éducatif sur le répressif, atténuation de responsabilité et principe de spécialisation de la juridiction pour mineurs. Là encore, par souci de cohérence avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d'attachement à l'État de droit et d'efficacité de la réforme, il serait fâcheux que de tels principes ou objectifs soient artificiellement mis à l'écart de ce que les constitutionnalistes appellent désormais le « bloc de constitutionnalité ».
Pour répondre plus précisément à votre interrogation sur les principes constitutionnels le plus susceptibles d'être utilisés par des requérants, notamment en matière de contentieux devant les juridictions civiles et pénales, je citerai : en matière pénale, les principes du respect des droits de la défense, de la légalité des délits et des peines, de la non-rétroactivité des lois pénales les plus sévères, de la proportionnalité des peines ; en matière civile, les principes de l'égalité devant la loi et la justice, de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion, de conscience, de religion, de communication, d'association, d'enseignement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit d'asile ; en matière sociale, le principe de la liberté syndicale, le droit au travail et à l'emploi, le droit de grève, le principe de la non-discrimination dans le travail.
Pour répondre à votre question concernant l'applicabilité de l'article 61-1 de la Constitution aux dispositions législatives des territoires d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, je pense que la réponse est affirmative, la Constitution s'appliquant dans les territoires d'outre-mer de la République française.
Enfin, j'aurai tendance à considérer que les règles de légalité externe ou du champ de compétence des lois ne devraient pas entrer dans le champ de l'article 61-1 de la Constitution.
Quelles sont les juridictions concernées ?
Le champ couvert par l'article 61-1 de la Constitution s'avère très large quant aux juridictions concernées : la question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance, devant toute juridiction, qu'elle relève du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, y compris, pour la première fois, en appel ou en cassation.
S'agissant des juridictions civiles, devraient être inclus dans le champ de l'article 61-1, par exemple, le juge de l'exécution, le juge aux affaires familiales, le juge de la mise en état, le juge des référés.
Cela m'amène à répondre à votre première interrogation : une question de constitutionnalité peut-elle être soulevée devant un tribunal arbitral ou devant une autorité administrative exerçant un pouvoir de sanction et considérée comme une juridiction au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Le tribunal arbitral n'étant pas une juridiction étatique, il ne me semble pas que l'exception d'inconstitutionnalité pourra être soulevée devant lui. En revanche, elle pourrait l'être devant la cour d'appel ou la Cour de cassation, amenées à statuer à la suite d'une décision rendue par un tribunal arbitral. La jurisprudence de la Cour de cassation considère au demeurant qu'une sentence arbitrale est une décision de justice et que les arbitres doivent respecter les règles impératives du droit, en particulier les principes de la contradiction ou des droits de la défense, sous le contrôle du juge de l'annulation.
Quant aux autorités administratives indépendantes, le même raisonnement m'amène à considérer qu'une exception d'inconstitutionnalité ne pourra être soulevée que devant la cour d'appel ou la Cour de cassation statuant sur le recours formé contre une de leurs décisions.
S'agissant des juridictions pénales, la question d'inconstitutionnalité pourra être soulevée au cours de l'instruction. En ce cas, elle sera portée devant la chambre de l'instruction, qui détient seule le pouvoir d'annuler un acte ou une pièce de la procédure d'instruction.
La question d'inconstitutionnalité devrait pouvoir aussi être soulevée devant les formations juridictionnelles en charge du contentieux de l'application des peines.
Le projet de loi organique, dans son dernier état, exclut en revanche la possibilité de soulever une question d'inconstitutionnalité devant la cour d'assises. L'exposé des motifs du projet de loi organique justifie cette restriction par la composition particulière de la cour d'assises et par l'intérêt qui s'attache à ce que les questions de droit et de procédure soient réglées avant l'ouverture du procès criminel, toute latitude étant ouverte en amont, dans la phase de l'instruction. Quels que soient les mérites de ces dispositions, malgré la spécificité de la procédure criminelle et de la composition de la cour d'assises, je m'interroge sur l'opportunité d'exclure un recours en inconstitutionnalité devant cette juridiction, y compris lorsqu'elle statue sans jurés, en première instance – notamment dans les affaires de terrorisme –, alors qu'elle intervient précisément, de façon directe, sur les libertés et droits fondamentaux de la personne.
Autre question, particulièrement délicate, comment s'opérera le choix entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité ?
Pour le justiciable, il ne sera pas facile de choisir entre l'invocation de l'inconstitutionnalité et l'invocation de l'inconventionnalité de la loi contestée. Il devra prendre en compte la durée prévisible de chacune des procédures et surtout la nature différente de leurs effets : dans le cas de l'inconstitutionnalité, le justiciable peut obtenir l'abrogation complète de la loi critiquée, tandis que, dans le cas de l'inconventionnalité, il peut gagner son procès, mais la loi demeure. Cela incite à penser que la voie de l'inconstitutionnalité pourra intéresser davantage des plaideurs institutionnels, des groupements ou des associations poursuivant des objectifs plus généraux ou collectifs.
La principale difficulté apparaîtra cependant dans le cas où seront invoquées cumulativement l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité de la loi contestée, lorsqu'une partie ou son avocat présenteront les deux moyens à la fois. En pareil cas, il m'avait semblé, avant que le projet de loi organique ne soit élaboré, qu'en l'absence d'indication à ce sujet dans l'article 61-1 de la Constitution, il n'était pas nécessaire de donner priorité à une question sur l'autre : il fallait laisser au juge le soin de retenir le moyen le mieux fondé, en se plaçant du seul point de vue de la qualité et de la pertinence juridique du moyen.
Toutefois, le projet de loi organique, dans son dernier état, s'est placé sur le terrain de la hiérarchie des normes et a considéré que la conformité d'une loi à la Constitution, norme suprême nationale, devait être examinée en premier, avant sa conformité à une convention internationale. La justification de cette adjonction tient, d'après l'exposé des motifs, à la « volonté de réappropriation de la Constitution par les justiciables » exprimée par le pouvoir constituant lors de la révision du 23 juillet 2008. Il s'agit là, sans doute, de répondre aux critiques formulées par certains contre le contrôle de conventionnalité, auquel il est reproché d'accorder aux normes internationales plus de poids et d'influence sur notre droit que notre propre Constitution, au détriment de l'« identité constitutionnelle française ».
Cette solution ne va cependant pas sans poser de problèmes, eu égard à l'applicabilité directe, en droit interne, du droit communautaire et de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi à l'évolution récente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État au sujet de la hiérarchie des normes internes et internationales, notamment communautaires. Le Conseil constitutionnel a en effet décidé que la théorie traditionnelle de la « Constitution-écran » ne pouvait plus contredire la primauté du droit communautaire et le Conseil d'État a établi que, conformément à l'article 88-1 nouveau de la Constitution, il existe une obligation constitutionnelle de transposition des directives de l'Union européenne. Au reste, le projet de loi organique a repris les conséquences que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont tiré des exigences de l'article 88-1 de la Constitution en matière de droit communautaire, en prévoyant une hypothèse de taille dans laquelle la primauté du contrôle de constitutionnalité ne jouera pas complètement : celle des lois de transposition des directives. Cette exception introduit une première brèche qui, me semble-t-il, réduit la cohérence d'ensemble, inspirée par la volonté de « réappropriation de la Constitution par les justiciables ».
Pour éviter ce conflit délicat entre le contrôle de conventionnalité et le contrôle de constitutionnalité, il convient d'effectuer un travail d'information auprès des parties et de leurs avocats afin de les convaincre de ne pas invoquer cumulativement les deux recours et de bien choisir celui qui est le plus efficace et le plus utile à leurs intérêts. Dès lors, plutôt que de faire prévaloir le contrôle de constitutionnalité sur le contrôle de conventionnalité, il convient de laisser le juge répondre de la manière plus efficiente.
En quoi est-il nécessaire d'instaurer la priorité de la question de constitutionnalité sur la question de conventionnalité ?
J'observe que le projet de loi organique, dans son dernier état, a réservé lui-même le cas de l'article 88-1 de la Constitution et du droit communautaire. Si le juge saisi constate que la question posée soulève une difficulté sérieuse d'interprétation du droit communautaire, il devrait d'abord poser la question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes.
La mise en oeuvre juridictionnelle de la question préjudicielle de constitutionnalité soulève elle aussi divers problèmes.
Le premier problème concerne la transmission de la question préjudicielle de constitutionnalité à la Cour de cassation par le juge du fond. À ce stade du processus déjà, plusieurs interrogations surgissent.
Première interrogation, quelles personnes ont qualité ou intérêt à soutenir la question préjudicielle ? La formulation de l'article 61-1 de la Constitution est large –« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » – et devrait permettre, en principe, à toute partie de soulever une question préjudicielle de constitutionnalité, qu'il s'agisse, par exemple, de la partie civile à l'occasion d'une instance devant le juge pénal ou du défendeur à une action civile à l'occasion d'un pourvoi en cassation.
J'estime évidemment que le ministère public doit pouvoir soulever une question préjudicielle de constitutionnalité mais aussi recevoir communication de toute question préjudicielle de constitutionnalité posée par un requérant. Quant au juge, la faculté devrait lui être reconnue de relever d'office une question préjudicielle de constitutionnalité, à l'instar de tout moyen d'ordre public ; il me semble en effet difficile d'admettre qu'un juge puisse appliquer une loi en la sachant inconstitutionnelle.
Je m'interroge dès lors sur la portée qu'il y a lieu de donner à la précision ajoutée dans le projet de loi organique, selon laquelle la question de constitutionnalité « ne peut être relevée d'office ».
Par ailleurs, en cas de désistement de l'action ou de désistement de l'instance avant la transmission de la question préjudicielle au Conseil constitutionnel, il m'apparaît que la question de constitutionnalité ne peut plus prospérer, puisque, s'agissant d'un incident concernant l'instance principale, le désistement met un terme à cette instance. Il n'y a plus lieu de statuer sur l'exception.
Deuxième interrogation, quelle est l'étendue du principe du sursis à statuer et ses exceptions en cas de transmission de la question par le juge ?
La règle du sursis à statuer en cas de transmission de la question préjudicielle par le juge, avec sa limitation du sursis de trois à six mois, ne me paraît pas poser de difficulté dans son principe. J'observe cependant qu'en prévoyant un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la constitutionnalité lorsque le juge du fond a statué sans attendre, le projet de loi organique confère un caractère suspensif au pourvoi en cassation quelle que soit la matière en cause, alors que le principe en matière civile est, selon l'article 579 du code de procédure civile, celui de l'absence d'effet suspensif.
Par ailleurs, le projet de loi organique a introduit un mécanisme complexe de dérogations au sursis à statuer, dans le but de garantir le bon fonctionnement du service public de la justice et de répondre aux situations d'urgence, en précisant notamment que le cours de l'instruction ne sera pas suspendu par la transmission de la question de constitutionnalité et que le juge pourra toujours prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Or certaines de ces dérogations peuvent soulever des difficultés.
En prévoyant, par exemple, qu'il n'est pas sursis à statuer « lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté », le projet de loi organique ne permet pas de déterminer de façon suffisamment précise quel type d'instance est concerné.
Par ailleurs, on ne peut exclure l'hypothèse dans laquelle le juge n'a pas sursis à statuer et où la personne qui a soulevé la question préjudicielle de constitutionnalité est condamnée pénalement sans former de pourvoi en cassation contre cette décision. En pareille situation, si la question préjudicielle d'inconstitutionnalité se trouve ensuite accueillie favorablement par le Conseil constitutionnel, il pourrait y avoir lieu d'ouvrir un réexamen de la décision de condamnation pénale.
Enfin, en énonçant qu'« en tout état de cause, le cours de l'instruction n'est pas suspendu et les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires peuvent être prises en toute instance », le projet de loi organique semble viser à la fois les domaines pénal et civil, sans préciser auquel des deux s'applique chacun des éléments de cette disposition.
Or il ne faut pas dissimuler les difficultés susceptibles de s'attacher à une telle absence de suspension, eu égard aux délais de prescription de l'action publique et de péremption de l'instance.
II peut être par exemple noté qu'en matière de presse, la transmission de la question préjudicielle de constitutionnalité pourrait se retourner contre les parties demeurées passives pendant la durée du sursis à statuer.
Face à la complexité du régime prévu pour les exceptions au sursis à statuer, tantôt obligatoires, tantôt facultatives, il me semblerait plus prudent de laisser au juge un certain pouvoir d'appréciation, en tenant compte des mesures d'urgence ou des mesures conservatoires nécessaires.
La décision du juge du fond de transmettre ou de ne pas transmettre une question préjudicielle de constitutionnalité à la Cour de cassation ou au Conseil d'État est-elle susceptible de recours ?
Le projet de loi organique exclut clairement tout recours contre la décision de transmission d'une question d'inconstitutionnalité à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. L'exposé des motifs justifie cette exclusion, à juste titre, par la nécessité d'éviter que la mise en oeuvre du mécanisme ne serve de prétexte à des manoeuvres procédurales. Il ajoute que la partie qui s'oppose à ce que la question soit posée pourra faire valoir son point de vue devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, en plaidant, le cas échéant, que les conditions posées par la loi organique n'étaient pas réunies.
Quant au refus de transmission de la question préjudicielle, il est précisé qu'il ne pourra être contesté qu'à l'occasion d'un recours portant sur la décision au fond. Il peut être observé que la possibilité de former un recours, même différé, à l'encontre de la décision du juge du fond est de nature à compromettre le système du double filtrage institué par la Constitution. Devant la Cour de cassation, le contentieux lié à cette faculté de recours risque en effet d'être plus important en nombre que celui de l'examen des questions préjudicielles de constitutionnalité transmises par les juges du fond ou soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation.
Le deuxième problème a trait au renvoi de la question préjudicielle au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation. Celle-ci peut être conduite à examiner une question de constitutionnalité dans deux hypothèses.
Première hypothèse, une juridiction du fond lui transmet une question préjudicielle après avoir elle-même procédé à un premier examen des trois points prévus : la disposition contestée doit commander l'issue du litige, la validité de la procédure ou constituer le fondement des poursuites ; elle ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux ; elle ne doit pas avoir été auparavant déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision, sauf changement de circonstances.
Seconde hypothèse, une partie forme un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a refusé de renvoyer à la Cour de cassation.
Deux questions méritent à mon sens une attention particulière : la formation appelée, au sein de la Cour de cassation, à opérer la transmission au Conseil constitutionnel ; les critères du filtrage.
S'agissant de la formation de la Cour de cassation chargée de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel, le projet de loi organique prévoit une formation nouvelle ad hoc de la Cour de cassation, inspirée de la formation existant pour les demandes d'avis en matière civile, composée du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers à la Cour de cassation appartenant à chaque chambre spécialement concernée. Le premier président pourra aussi, lorsque la solution paraît s'imposer, renvoyer la question devant une formation restreinte composée de lui-même, du président de la chambre spécialement concernée et d'un conseiller de cette chambre. L'exposé des motifs du projet de loi ajoute que le premier président et les présidents des chambres pourront être suppléés.
S'agissant du ministère public devant la Cour de cassation, il va de soi que le parquet général de la Cour de cassation doit pouvoir présenter son avis devant chacune des formations ad hoc concernées. Par ailleurs, le projet de loi organique n'ayant pas précisé le régime de la procédure devant cette formation ad hoc, les règles ordinaires relatives à la procédure devant la Cour de cassation s'appliqueront. II conviendra en particulier que la question préjudicielle soulevée a l'occasion d'une instance devant la Cour de cassation soit présentée dans un mémoire ou des conclusions spécialement rédigées à cette fin, de manière à faciliter le traitement de la question devant la formation ad hoc.
S'agissant des critères de transmission au Conseil constitutionnel, il résulte des dispositions du projet de loi organique que la Cour de cassation, comme le Conseil d'État, exercera un contrôle sur les trois critères mis en oeuvre par les juges du fond et qu'elle ne saisira le Conseil constitutionnel que si la disposition contestée « soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse ». Le caractère « alternatif » de ces derniers critères peut poser problème. Il aurait été préférable, sinon d'abandonner le critère de la nouveauté, du moins de rendre cumulatifs les deux critères, ainsi que le prévoit l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire pour les demandes d'avis. Le critère de la nouveauté ne me paraît pas pouvoir être pris seul en compte devant la Cour de cassation, au risque de favoriser la formulation de nombreuses questions fantaisistes.
Le troisième problème porte sur la représentation par avocat en matière de question préjudicielle de constitutionnalité.
La complexité en droit de la question de constitutionnalité ne permet pas d'envisager une dispense du ministère d'avocat devant la Cour de cassation, si l'on veut que les recours soient efficaces ou effectifs. Sous le bénéfice de cette observation, une distinction me semble devoir être opérée selon que la question préjudicielle de constitutionnalité est transmise par une juridiction du fond ou soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation.
Lorsque la question préjudicielle est transmise à la Cour de cassation par un juge du fond, deux types de solutions peuvent être envisagées : soit la simple transposition des règles applicables actuellement en matière de pourvoi en cassation ordinaire, prévoyant la représentation obligatoire en matière civile ; soit la généralisation de la représentation obligatoire pour l'examen de toutes les questions préjudicielles de constitutionnalité à la matière civile mais également à la matière pénale.
Lorsque la question préjudicielle est formée dans le cadre d'un pourvoi en cassation, la représentation obligatoire devrait suivre les règles applicables au pourvoi.
Le quatrième problème est relatif à l'octroi de l'aide juridictionnelle en cas de question préjudicielle de constitutionnalité. Il s'agit d'un sujet d'importance pour l'effectivité du droit d'accès à la justice des plaideurs les plus démunis désireux de soulever une question d'inconstitutionnalité.
Le dispositif prévu à cet égard par le projet de loi organique concerne la rétribution des auxiliaires de justice prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant le Conseil constitutionnel, mais il ne prend pas en compte spécifiquement le traitement de la question préjudicielle devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État.
Or, devant la Cour de cassation, l'attribution de l'aide juridictionnelle ne se posera pas de la même manière selon que la question de constitutionnalité sera soulevée à l'appui d'un pourvoi en cassation ou transmise à la Cour de cassation par une juridiction de fond : si la question est invoquée à l'appui d'un pourvoi en cassation, l'attribution de l'aide juridictionnelle devrait obéir aux conditions ordinaires, notamment à la condition qu'il existe un moyen sérieux de cassation ; si la question préjudicielle a été transmise par une juridiction du fond sans que le demandeur ait bénéficié jusque-là de l'aide juridictionnelle, le projet de loi organique ne permet pas, en l'état, l'octroi de cette aide devant la Cour de cassation. II serait souhaitable que l'aide puisse être attribuée au regard des seules ressources, en vue de la désignation d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'aide devrait, sous la même condition de ressources, être octroyée de plein droit au défendeur à la question préjudicielle de constitutionnalité.
Le cinquième problème concerne la décision de la Cour de cassation de transmettre ou de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel et ses suites.
La Cour de cassation, comme le Conseil d'État, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la transmission au Conseil Constitutionnel, ce dernier ayant ensuite lui aussi trois mois pour trancher.
Je considère que les décisions de la Cour de cassation devront être motivées. Un certain pouvoir de reformulation des termes de la question devrait même pouvoir être reconnu à la Cour de cassation et au Conseil d'État en cas de mauvaise rédaction, eu égard au pouvoir propre qui leur est reconnu de vérifier si la disposition contestée soulève une « question nouvelle » ou présente une « difficulté sérieuse ».
En revanche, il ne me paraissait pas nécessaire de prévoir un dispositif formel de transmission au Conseil constitutionnel d'une copie des décisions rejetant les demandes de saisine, dès lors que les décisions de la Cour de cassation revêtent toutes un caractère public et accessible. Je constate cependant que le projet de loi organique, dans son dernier état, en a décidé autrement, puisqu'il est précisé, à l'article 23-7 introduit dans l'ordonnance du 7 novembre 1958, que le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une question d'inconstitutionnalité. Faut-il y voir la volonté de consolider le rôle de juge suprême du Conseil constitutionnel, appelé à contrôler dans tous les cas les motifs pour lesquels la Cour de cassation et le Conseil d'État effectuent leur filtrage ? La question mérite d'être posée.
Le sixième problème porte sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel lui-même. Plusieurs interrogations importantes subsistent à cet égard.
Premièrement, quelle est la portée du pouvoir de modulation reconnu au Conseil Constitutionnel par l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, quant aux effets de sa décision d'inconstitutionnalité ? Il peut, par exemple, abroger une disposition déclarée inconstitutionnelle à compter d'une date ultérieure à la publication de sa décision et déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les effets produits par la disposition sont susceptibles d'être remis en cause. Selon moi, il n'est pas souhaitable que le Conseil Constitutionnel aille ainsi, indirectement, jusqu'à énoncer les conséquences à tirer sur l'affaire judiciaire en cours. Le contentieux judiciaire doit être laissé entre les mains du juge judiciaire.
Un large champ d'appréciation reste encore ouvert, il est vrai, notamment en ce qui concerne les effets de l'abrogation d'une disposition pénale ou de procédure pénale par le Conseil constitutionnel. Même si cette abrogation produit ses effets pour l'avenir, on ne peut exclure que des personnes déjà condamnées demandent le bénéfice de l'abrogation et réclament une indemnisation. Mais je me garderai d'anticiper sur les jurisprudences susceptibles de se développer.
Deuxièmement, l'abrogation d'un texte qui avait remplacé un texte précédent pourra-t-elle avoir pour effet de faire revivre la disposition antérieure ? La question est complexe. Néanmoins, à première vue, puisque le texte a été abrogé, il appartient au législateur d'adopter rapidement un nouveau texte rectifié pour régir les situations concernées.
Troisièmement, dans quelles conditions le Conseil constitutionnel, saisi d'une question préjudicielle, pourra-t-il réexaminer une loi précédemment déclarée conforme en cas de changement des circonstances ou de nouveauté de la question posée ? À cet égard, on peut se demander si l'autorité erga omnes dont sont revêtues les décisions du Conseil constitutionnel lorsqu'il se prononce au sujet d'une disposition législative ne peut pas faire obstacle à des revirements de jurisprudence au sujet de la constitutionnalité d'une disposition donnée.
Nous nous trouvons en présence d'une réforme assurément extraordinaire pour la protection des droits des justiciables, mais qui, à ce stade, soulève un champ immense de questions. L'avenir de la nouvelle procédure dépendra pour une large part de ce qu'en feront les juges chargés des filtrages successifs. Au fur et à mesure que la législation prospère, le rôle du juge se renforce et l'accès à la justice se développe. Par conséquent, la moindre faille sera exploitée. S'il s'agit d'améliorer les exigences du service public de la justice, tant mieux ; s'il s'agit de mener des manoeuvres dilatoires, la vigilance est de rigueur.

Les lois du pays votées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui ont valeur législative, seront-elles soumises à ce contrôle ?

Ce sera fait.
Monsieur le Procureur général, je vous remercie.
Audition de M. Vincent LAMANDA, Premier président de la Cour de cassation

Nous accueillons maintenant M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation.
Monsieur le premier président, au nom de la Commission des lois, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de nous faire part sans attendre de vos observations générales sur le présent projet de loi, ainsi que de vos réponses aux questions que nous vous avons transmises par écrit.
Tout d'abord, permettez-moi vous dire combien je suis honoré d'être entendu par votre commission sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, qui offre un nouveau droit au justiciable.
On ne peut que se féliciter de la présentation de ce texte qui concourt au renforcement des droits et libertés des citoyens. Il convient cependant de veiller à ce que les conditions de sa mise en oeuvre ne viennent pas bouleverser les équilibres juridictionnels patiemment établis et altérer l'exercice habituel de son autorité par l'institution judiciaire.
J'entends dire qu'il s'agit de créer une « Cour suprême » – qui imaginerait déjà l'extension de ses prérogatives, du fait des judicieuses décisions qu'elle prendrait ; qui serait appelée à subordonner, par un dialogue rénové, les ordres administratif et judiciaire ; qui établirait et modifierait à sa guise son règlement de procédure, à la différence de toutes les autres juridictions françaises. Serait-ce véritablement la volonté du constituant ? Le magistrat professionnel que je suis s'interroge, tout en se réjouissant de l'hommage indirect ainsi rendu au noble métier de juge.
Les choix à venir devront être soigneusement réfléchis. À cet égard, les questions que vous m'avez transmises manifestent votre volonté d'être préalablement éclairés. Je vais m'efforcer d'y répondre.
Vous m'avez tout d'abord demandé si une question préjudicielle pourra être soulevée devant un tribunal arbitral. Deux séries d'arguments militent pour exclure la juridiction arbitrale du champ d'application de l'article 61-1 de la Constitution.
En premier lieu, le tribunal arbitral n'est pas une « juridiction relevant de la Cour de cassation » : l'arbitre, détaché de tout lien avec un État, ne relève pas d'un ordre juridique étatique affirmé. Comme le souligne la jurisprudence de la Cour de cassation, « les arbitres (…) tiennent leur pouvoir du seul consentement des parties, et non de la puissance publique ». Ils n'ont donc pas leur place dans l'ordonnancement des juridictions dans la hiérarchie judiciaire.
En second lieu, l'arbitre, juge privé, n'est pas habilité à saisir une instance publique pour trancher une question de droit qui lui est soumise. D'ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes ne reconnaît pas aux arbitres le droit de lui poser une question préjudicielle, un tribunal arbitral conventionnel ne constituant pas selon elle une juridiction d'un État-membre.
Les autorités administratives indépendantes disposant d'un pouvoir de sanction, et assimilées, de ce fait, aux tribunaux au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent pas non plus être considérées comme relevant de la Cour de cassation, alors même que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de leurs décisions relèverait de la compétence du juge judiciaire.
L'Autorité de la concurrence en offre un exemple topique : la loi du 4 août 2008 la qualifie expressément d' « autorité administrative indépendante », ce qui exclut par principe qu'elle puisse relever de l'autorité judiciaire. Un raisonnement comparable peut être tenu à l'égard d'autres autorités de régulation, comme l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ou le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : en dépit de certaines attributions juridictionnelles, ces autorités administratives indépendantes ne constituent pas des juridictions relevant de la Cour de cassation. En revanche, la juridiction saisie d'un recours contre la décision d'une autorité administrative indépendante – en règle générale, la Cour d'appel de Paris – pourra valablement transmettre une question préjudicielle de constitutionnalité.
Quels seraient les principes constitutionnels les plus susceptibles d'être utilisés par des requérants, notamment en matière de contentieux devant les juridictions civiles et pénales, pour soulever des questions de constitutionnalité ?
Ma réponse à cette question sera nécessairement brève : il paraît en effet difficile de déterminer à l'avance les moyens que les parties pourraient envisager de soulever dans leur propre intérêt ; le champ des possibles est très vaste. Ce qui est sûr, c'est que le nombre des juridictions de l'ordre judiciaire et la diversité de leurs contentieux conduiront à ce que soient posées devant elles la majorité des questions. Elles vont donc s'y préparer activement, notamment grâce à un important programme de formation continue, auquel la Cour de cassation est associée. L'institution judiciaire jouera loyalement sa partition, soyez-en assurés.
Le terme de « disposition législative » suffit-il à permettre de contester la constitutionnalité d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie ? Il résulte de l'article 77 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, et de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999, que les lois de pays de la Nouvelle-Calédonie ont une valeur législative ; selon l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999, elles peuvent être déférées au Conseil constitutionnel. On peut donc les considérer comme des « dispositions législatives » au sens de l'article 61-1 de la Constitution.
Les termes de « droits et libertés garantis par la Constitution » permettraient-ils d'invoquer une incompétence négative du législateur à l'appui d'une question de constitutionnalité ? S'il faut entendre par là qu'il serait possible d'invoquer la carence du législateur, qui aurait refusé de faire application de son pouvoir législatif, il me semble que la lettre de l'article 61-1 doit conduire à une réponse négative. En effet, le dispositif mis en place par ce texte ne tend qu'à permettre à un justiciable d'obtenir que soit écartée une disposition législative qui porterait atteinte aux droits et libertés que le Constitution garantit. Autrement dit, si le constituant a conféré au justiciable la faculté, à l'occasion d'un procès, de contester la constitutionnalité d'une norme, il n'a pas entendu lui attribuer la possibilité de contester l'action même du législateur. De plus, je ne vois pas comment, concrètement, pourrait se traduire une telle contestation, puisque, par définition, il n'y a pas de « disposition législative », donc pas de texte à écarter.
Est-il nécessaire d'instaurer la priorité de la question de constitutionnalité sur la question de conventionnalité ?
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er, alinéa 14, du projet de loi organique édicte : « La juridiction doit en tout état de cause, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant, de façon analogue, la conformité de la disposition à la Constitution et aux engagements internationaux de la France, se prononcer en premier sur la question de constitutionnalité, sous réserve, le cas échéant, des exigences résultant de l'article 88-1 de la Constitution. » L'exposé des motifs précise que « cette priorité d'examen est liée à l'effet erga omnes de la déclaration d'inconstitutionnalité qui conduira à l'abrogation de la disposition législative contestée ». Il ajoute : « Elle s'inscrit dans la volonté de réappropriation de la Constitution par les justiciables exprimée par le pouvoir constituant lors de la révision du 23 juillet 2008. »
Je ferai à ce sujet trois observations.
En premier lieu, cette disposition repose sur une assimilation inexacte du « contrôle de conventionnalité » au « contrôle de constitutionnalité ». Ce dernier est un contrôle de légalité visant à vérifier la conformité d'une norme législative avec une norme supérieure, constitutionnelle ; il est réalisé de façon abstraite et aboutit à une décision de portée générale, qui peut se traduire par une abrogation.
Au contraire, le contrôle de conventionnalité, tel qu'il découle des jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme, tend, non à contrôler la légalité de la norme interne à la norme internationale, mais à s'assurer que l'application d'une loi nationale à une situation donnée n'entraîne pas une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit donc d'un contrôle concret, en fonction des faits de la cause, et à la portée limitée au cas d'espèce. Le même texte peut ainsi, suivant les circonstances, voir son application écartée ou approuvée par le juge judiciaire, comme l'indiquent les arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation sur la législation relative au désendettement des rapatriés. Si les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se rapprochent, de par leur contenu, des droits fondamentaux affirmés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, leur mise en oeuvre répond à des conditions différentes et ils ne peuvent nécessairement se confondre.
En deuxième lieu, la priorité instituée par le projet de loi est de nature à porter préjudice au justiciable. Par exemple, si une partie conteste l'inconstitutionnalité d'une loi en vertu de laquelle elle est privée de sa liberté et, concomitamment, à bon droit, l'inconventionnalité de l'application qui lui est faite de cette disposition législative, le juge ne pourrait, en vertu de l'article 1er, alinéa 14, accueillir immédiatement l'exception d'inconventionnalité et prononcer la remise en liberté. Au contraire, il serait tenu de transmettre la question à la Cour de cassation qui, dans un délai de trois mois, transmettrait au Conseil constitutionnel, lequel statuerait dans un délai similaire. Le justiciable devrait donc patienter six mois, alors qu'il pourrait être mis fin immédiatement à une privation indue de liberté !
Je rappelle que, selon l'article 66 de la Constitution, « nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » On peut se demander si cela n'impose pas au juge judiciaire de statuer en premier lieu sur la décision la plus efficace pour assurer la sauvegarde de la liberté individuelle contre l'arbitraire. Il serait paradoxal que l'institution du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception aboutisse à un recul dans la protection de la liberté individuelle !
Cette considération ne vaut pas qu'en matière pénale – bien qu'elle y trouve un écho particulier –, mais se vérifie chaque fois qu'une disposition législative, incontestable dans son principe, porte atteinte, à l'occasion de son application à un litige donné, et en fonction des circonstances propres à ce litige, à un droit fondamental ou à une liberté garantie. Les délais de procédure sont un bon exemple d'une telle situation : si le principe de sécurité juridique les justifie en théorie, leur application stricte peut, dans certaines circonstances, se traduire pour le justiciable par une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge. Le contrôle de conventionnalité peut alors se révéler plus efficace et mieux adapté que le contrôle de constitutionnalité pour assurer la protection effective des droits fondamentaux ; il a pour effet d'écarter l'application de la disposition litigieuse aux seuls cas d'espèce, sans la remettre en question pour tous.
Troisièmement, l'obligation faite au juge de statuer d'abord sur la question de constitutionnalité risque de se révéler inapplicable dans un certain nombre de cas. Il est en effet prévu à l'article 1er, alinéa 18, du présent projet de loi : « La juridiction peut (…) également statuer sans attendre la décision relative à la question de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer à moins qu'elle ne soit elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence. » Ce dispositif conduira le juge, dans les hypothèses prévues par ce texte – par exemple en matière de référé ou de rétention des étrangers –, après avoir transmis la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, à se prononcer sur l'exception d'inconventionnalité avant de connaître la décision du Conseil constitutionnel qui, le cas échéant, deviendra sans objet.
Pour toutes ces raisons, on peut se demander si les avocats ne seront pas tentés de ne pas soulever la question de constitutionnalité et de n'invoquer qu'une exception d'inconventionnalité lorsque celle-ci leur apparaîtra de nature à satisfaire immédiatement les intérêts de leur client. L'article 23-2 de l'ordonnance introduit par le projet de loi risquerait alors d'aboutir à un résultat opposé à celui souhaité par le constituant. C'est pourquoi il me semblerait plus opportun de laisser au juge la liberté de statuer en premier sur le moyen qui lui paraît le plus opérant et de nature à protéger le plus rapidement les droits fondamentaux des citoyens.
M. Philippe Houillon remplace M. Jean-Luc Warsmann à la présidence
S'agissant du droit communautaire, la CJCE, depuis l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, estime que « le juge national a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».
Si l'autonomie des systèmes judiciaires nationaux est reconnue par la Cour de justice, elle l'oriente néanmoins de telle sorte que l'efficacité du droit communautaire soit toujours préservée. Ainsi la Cour de justice a-t-elle affirmé que « serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité des normes communautaires. »
S'agissant du Conseil d'État et de la Cour de cassation, dans la mesure où leurs décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, ils ont l'obligation de saisir la CJCE d'une question préjudicielle dès lors que se pose un problème d'interprétation du droit communautaire.
Donner la priorité à la question de constitutionnalité sur le renvoi préjudiciel risquerait de placer le Conseil constitutionnel dans une situation délicate vis-à-vis de la Cour de justice sur le plan institutionnel, si leurs analyses se révélaient différentes. En effet, la Cour de justice ne s'estimera pas tenue par l'interprétation du Conseil constitutionnel. En outre, compte tenu de la jurisprudence que je viens de rappeler, le juge judiciaire, comme le juge administratif, pourrait difficilement se retrancher derrière la réponse du Conseil constitutionnel jugeant la disposition incriminée conforme à la Constitution pour justifier un refus de saisine de la CJCE.
Enfin, la Cour de cassation, en matière pénale comme en matière civile, juge que la demande qui tend au renvoi d'une affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire. Une partie qui poserait une question de constitutionnalité devant la Cour de cassation serait donc également recevable à soulever, à ce stade de la procédure, une demande de renvoi préjudiciel devant la CJCE, même si elle ne l'avait pas sollicitée devant les premiers juges.
Dans cette hypothèse, il importe là encore de laisser au juge judiciaire la faculté de choisir le renvoi préjudiciel si la réponse de la CJCE apparaît déterminante pour l'issue du litige, et de poser une éventuelle question de constitutionnalité ultérieurement, si cela demeure pertinent. On rappellera que, depuis l'instauration d'une nouvelle procédure d'urgence, la Cour de justice peut répondre dans de courts délais – moins de trois mois actuellement – aux questions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Les exceptions au sursis à statuer sont-elles satisfaisantes ? En tout cas, elles sont nécessaires.
Si le principe du sursis ne pose pas de difficulté particulière, le mécanisme de dérogation prévu par le projet de loi est particulièrement complexe. La formule selon laquelle il n'est pas sursis à statuer « lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance » ne permet pas de cerner avec suffisamment de clarté le type d'instance concernée par cette disposition. Cela concerne-t-il, par exemple, le cas de la personne privée de liberté avant jugement et maintenue en détention à l'occasion de l'instance au fond sur sa culpabilité ?
Dans le cas où la juridiction se sera prononcée sur le fond, ne pouvant surseoir à statuer, et aura néanmoins jugé opportun de poser une question de constitutionnalité, il faudrait prévoir, un recours n'étant pas nécessairement formé contre sa décision, d'ouvrir une possibilité de révision en matière civile, ou de réexamen en matière pénale. Si la question préjudicielle de constitutionnalité se trouvait par la suite accueillie favorablement par le Conseil constitutionnel, la personne concernée pourrait ainsi obtenir la remise en cause de la décision la concernant. Le juge naturel pour en connaître serait tout désigné ; il ne serait en effet pas convenable que, dans une hypothèse de la sorte – certes rare mais qui peut néanmoins se produire –, le Conseil constitutionnel soit conduit, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, soit à redresser lui-même la situation, ce qui paraît peu vraisemblable, soit, plutôt, à s'immiscer dans la désignation de la juridiction de l'ordre judiciaire devant le faire. Une personne détenue à titre provisoire devrait, en outre, être en mesure d'obtenir une indemnisation au titre de cette détention lorsque son maintien en détention aura été prononcé et que la question préjudicielle de constitutionnalité aura ultérieurement fait l'objet d'un accueil favorable par le Conseil constitutionnel. Il serait donc souhaitable que la loi organique prévoie l'insertion dans les codes de procédure civile et pénale des dispositions adéquates pour remédier à ces lacunes.
Selon l'article 1er, alinéa 16, du projet de loi, « Lorsque la juridiction décide de transmettre la question, elle sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires peuvent être prises en toute instance. » Ce texte semble en réalité appréhender à la fois les domaines civil – second membre de la seconde phrase – et pénal – premier membre de la seconde phrase. Pour plus de clarté, cette dernière disposition devrait être dédoublée en précisant à quel domaine s'applique chacun de ces éléments.
Enfin, l'absence de suspension des délais de prescription et de péremption pendant le cours de l'instruction peut être source de difficultés. En soi, le principe du sursis à statuer présente un antagonisme avec l'absence de suspension du cours de l'instruction. En matière de presse notamment, la transmission de la question préjudicielle de constitutionnalité risque de se retourner contre les parties qui demeureraient passives pendant la durée du sursis à statuer.
S'agissant de la procédure devant les juridictions, le libellé de l'article 61-1 de la Constitution paraît exclure implicitement la possibilité d'un relevé d'office de la question préjudicielle de constitutionnalité : l'emploi des termes « il est soutenu » semble réserver l'initiative de la question préjudicielle aux parties, à l'exclusion du juge.
Les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle font d'ailleurs ressortir que la question préjudicielle a été conçue et voulue comme un droit nouveau institué au profit du justiciable. En revanche, le ministère public, qui a toujours la faculté, s'il n'est déjà partie principale, d'intervenir dans toute instance en qualité de partie jointe, aura la possibilité de soulever une question de constitutionnalité.
Si, alors qu'une telle question a été soulevée, un désistement de l'action ou un désistement de l'instance met fin au procès, la question transmise à la Cour de cassation ou renvoyée au Conseil constitutionnel n'aura plus lieu d'être examinée. La lettre même de l'article 61-1 de la Constitution instaure en effet un lien indissoluble entre « l'instance en cours », « à l'occasion » de laquelle sera soulevée la question préjudicielle, et le sort de cette même question, une fois transmise à la Cour de cassation ou renvoyée devant le Conseil constitutionnel. L'examen de cette question n'aura plus lieu d'être si une cause d'extinction de l'instance survient avant la décision du Conseil constitutionnel. Une solution identique a été dégagée s'agissant de la question préjudicielle posée par une juridiction nationale en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne : la CJCE a jugé que « la justification du renvoi préjudiciel et, par conséquent, de la compétence de la Cour, n'est pas la formulation d'opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (…), mais le besoin inhérent à la solution effective d'un contentieux. » Un tel non-lieu à statuer devrait d'ailleurs intervenir quelle que soit la cause d'extinction de l'instance : transaction, acquiescement, désistement d'instance ou d'action, décès d'une partie dans les actions non transmissibles, péremption – dont la survenance serait toutefois peu plausible étant donné les délais impartis respectivement à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel – ou encore caducité de la citation, et ce conformément aux dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Devant la Cour de cassation, le ministère public sera systématiquement conduit à faire connaître son avis sur la question, les articles L.432-1 et L.432-3 du code de l'organisation judiciaire prévoyant que le procureur général près la Cour de cassation et les avocats généraux portent la parole devant les formations de jugement de la Cour.
Quels critères devraient me conduire à choisir le recours à la formation à trois juges pour examiner certaines questions ? La réponse est simple : je le ferai lorsque la solution paraît s'imposer – par exemple, lorsque la question est manifestement dénuée de tout fondement au regard des critères posés par la loi.
La dispense du ministère d'avocat devrait-elle s'appliquer à la question de constitutionnalité en toute hypothèse ? Les parties ayant été en mesure de discuter contradictoirement de la question de constitutionnalité devant le juge du fond, il ne paraît pas nécessaire d'ouvrir un nouveau débat devant la Cour de cassation, qui se bornera à examiner de nouveau la même question, telle que transmise par le juge : on risque d'alourdir encore la procédure et de retarder la transmission au Conseil constitutionnel.
En matière de demande d'avis, les règles relatives à la représentation des parties suivent celles applicables au pourvoi. S'il devait être néanmoins estimé nécessaire de permettre aux parties de présenter leurs observations devant la Cour de cassation à l'occasion de la transmission de la question de constitutionnalité, il serait opportun de prévoir, compte tenu de la technicité d'un tel contentieux, des dispositions similaires.
Comme le souligne justement le rapport Darrois, le recours à un barreau spécialisé apparaît, au regard du caractère très spécifique du rôle de la Cour de cassation – en la circonstance des critères précis du renvoi devant le Conseil constitutionnel – comme une nécessité. L'inverse comporterait le risque de voir la Cour de cassation submergée par un afflux de mémoires écrits ou d'exposés oraux, en demande et en défense, pour la plupart inopérants ou dépourvus de fondement sérieux, faute d'émaner de juristes hautement spécialisés. Ce foisonnement d'interventions serait de nature à entraver la mission confiée à la Cour de cassation de discerner, dans le très bref délai prévu par le texte, les questions propres à justifier la saisine du Conseil constitutionnel.
La motivation des décisions de transmission à la juridiction suprême ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel est-elle souhaitable ? De façon générale, toutes les décisions des juridictions sont motivées, à l'exception de celles portant uniquement administration judiciaire, ce qui n'est pas le cas de la question de constitutionnalité.
Les juridictions doivent-elles pouvoir reformuler les termes d'une question ? Dans la mesure où le juge n'aurait pas le pouvoir de relever d'office une question de constitutionnalité, il ne devrait pas davantage avoir celui de reformuler une question posée par une partie. S'il peut envisager de réécrire, dans un français plus clair, une question maladroitement formulée, le juge ne saurait cependant en dénaturer le sens dans la mesure où la loi lui fait obligation d'en vérifier la recevabilité au regard des conditions de fond qu'elle pose. En outre, on ne voit pas comment les parties, qui feront présenter leurs observations devant le Conseil constitutionnel, pourraient débattre devant celui-ci d'une question différente de celle qu'ils avaient initialement posée.
De même qu'en matière d'avis, la Cour de cassation s'interdit de répondre au-delà de la question posée par une juridiction, il conviendrait que le Conseil constitutionnel demeure dans les limites de la question le saisissant. Certes, pour le contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, le Conseil a fréquemment recours à des réserves d'interprétation qui s'imposent aux autorités administratives et judiciaires et lui permettent, tout en sauvegardant un texte, d'en marquer les limites d'application acceptables. Transposer ce mécanisme à la solution d'une question préjudicielle de constitutionnalité pourrait conduire le Conseil à répondre à des questions qui ne lui auraient pas été directement posées. Le chemin vers la Cour suprême, si séduisant pour certains, ne les incitera-t-il pas à tenter l'aventure ?
Pour terminer sur la procédure, les décisions de la Cour de cassation revêtant toutes un caractère public et accessible, il n'apparaît ni opportun ni nécessaire de prévoir dans la loi organique un dispositif spécifique de transmission au Conseil constitutionnel d'une copie des décisions rejetant les demandes de saisine. Rien n'empêche le directeur du greffe ou le président de chambre, directeur du service de documentation et d'études de la Cour, de transmettre au secrétaire général du Conseil constitutionnel une copie des décisions, à titre d'information. Mais imposer à la juridiction elle-même de transmettre directement au Conseil constitutionnel ses décisions de ne pas le saisir est de nature à laisser accroire que la Cour de cassation serait subordonnée à ce dernier, lequel serait en droit, à partir de l'analyse de ces décisions, de lui adresser des remarques. J'insiste sur ce point, certes symbolique, mais essentiel.
S'agissant des conséquences d'une abrogation d'une décision pénale déclarée inconstitutionnelle, l'article 6 du code de procédure pénale prévoit que l'action publique s'éteint notamment par l'abrogation de la loi pénale. Cette disposition d'ordre général a vocation à s'appliquer s'agissant de l'abrogation qui pourra être prononcée par le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 62 de la Constitution.
La jurisprudence est bien établie en ce sens : sauf dispositions législatives contraires expresses, une loi nouvelle, qui abroge une incrimination, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés. Par transposition de ce principe, l'abrogation, en vertu de l'article 62 de la Constitution, d'un texte pénal fondant les poursuites, devrait ne concerner que les faits n'ayant pas fait l'objet d'un jugement pénal définitif. Le pouvoir de modulation reconnu au Conseil constitutionnel par l'article 62 de la Constitution pourra néanmoins lui permettre de différer dans le temps les effets de cette abrogation.
Cet article prévoit : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »
Lorsqu'une loi est déclarée non conforme à la Constitution, elle est abrogée et disparaît de l'ordonnancement juridique à compter de la décision, y compris, en principe, au bénéfice des procédures en cours. Si cette abrogation devait avoir pour effet de faire revivre la disposition antérieure, qui avait été abrogée par le texte lui-même abrogé, une telle situation juridique serait de nature à entraîner, en matière pénale, une violation du principe de légalité des délits et des peines visé aux articles 111-3 du code pénal et 7, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle aboutirait à faire revivre un texte qui n'était pas en vigueur au moment de la commission des faits. De façon plus générale, elle risquerait aussi de réintroduire une norme dans un contexte juridique, économique et social auquel elle ne serait plus adaptée.
On peut citer, à titre d'exemple, l'affaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dans laquelle la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1990 déclarant une disposition du code de la sécurité sociale inconstitutionnelle a fait revivre une rédaction antérieure du même texte, que les juridictions du fond ont dû appliquer, jusqu'à ce que la Cour de cassation ne déclare cette application contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant que le refus d'accorder cette allocation à une personne en raison de sa seule nationalité portait atteinte, de façon discriminatoire, au droit au respect des biens.
L'expérience de nos voisins européens prouve que cette difficulté n'est pas théorique, tant la question des effets de l'abrogation d'une disposition législative est complexe. Ainsi, en Autriche, la Constitution avait prévu initialement un délai maximal de six mois avant abrogation de la disposition litigieuse pour permettre au législateur de la corriger ; des révisions successives l'ont porté à dix-huit mois en raison de la complexité de certains dispositifs législatifs. En Allemagne, cette difficulté a conduit la Cour constitutionnelle à fixer elle-même des délais et à recourir à des injonctions au législateur, par lesquelles elle définit les éléments de législation de substitution qu'elle estime constitutionnellement nécessaires.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je pense avoir répondu à vos quatorze questions et me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.

Monsieur le premier président, je vous remercie pour la richesse et la précision de votre contribution. Vous nous avez laissé entrevoir que la Commission des lois, et notamment son rapporteur, aura un important travail d'amendement à effectuer sur ce texte.
La séance est levée à 12 h 10.