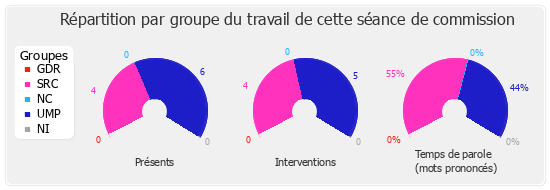Mission d’information sur les questions mémorielles
Séance du 14 octobre 2008 à 16h00
La séance
La séance est ouverte à dix-sept heures
La mission d'information sur les questions mémorielles a organisé une table ronde sur le thème « Le rôle du Parlement dans les questions mémorielles » avec les invités suivants : M. Serge Barcellini, professeur en politique de mémoire, associé à l'Institut d'études politiques de Paris, chargé par M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants, de coordonner l'ensemble des initiatives prévues pour le quatre-vingt-dixième anniversaire de l'Armistice de 1918 et ancien directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Mme Françoise Chandernagor, juriste, écrivain, vice-présidente et cofondatrice de l'association « Liberté pour l'histoire » ; M. Michel Diefenbacher, député, auteur en 2004 d'un rapport au Premier ministre intitulé « Parachever l'oeuvre de solidarité envers les rapatriés » ; M. Jean-Claude Gayssot, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, ancien ministre, ancien député, auteur de la proposition de loi à l'origine de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Mme Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l'université de Rennes I, vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel et de la Société des professeurs de faculté de droit ; Mme Nathalie Mallet-Poujol, juriste, chercheur au CNRS.

Nous voici réunis pour la dernière table ronde de notre mission d'information. Nous avons entendu depuis le mois d'avril des historiens, des intellectuels et de nombreux spécialistes. Il était logique que nous achevions notre travail en débattant du rôle du Parlement dans les questions mémorielles. Qui pourrait en effet sérieusement contester la légitimité du Parlement à s'interroger sur la difficile question des valeurs que nous devons transmettre à nos enfants à partir des leçons que nous pouvons tirer de l'histoire ? Chacun sait bien que l'unité d'une nation se construit autour de la mémoire commune. Au demeurant, il est important que le Parlement réfléchisse également au sens de nos commémorations publiques. Il est bon qu'il soit le lieu privilégié du débat sur ces questions, qui sont au coeur du pacte républicain.
Les médias fonctionnent selon un mode événementiel, souvent émotionnel, qui peut affaiblir la mise en perspective historique. Le traitement médiatique de l'histoire et la qualité de la recherche historique sont ainsi devenus de véritables enjeux de société, dont le Parlement ne pouvait pas ne pas se saisir. Il s'agit d'aider les Français à se souvenir, en gardant le sens de certains faits historiques propres à conforter le sentiment d'appartenance nationale. Il s'agit aussi de pouvoir, forts d'un passé assumé, nous projeter dans l'avenir. À cet égard, la dimension nationale des questions mémorielles ne doit pas nous faire oublier la perspective européenne.
Notre mission se devait de réfléchir sur les lois dites mémorielles, qui ont suscité de nombreuses controverses, en particulier au sein de la communauté des historiens et des chercheurs. Est-ce à la loi de qualifier tel ou tel fait historique ? Ce type d'intervention du Parlement ne vient-il pas concurrencer le travail des juridictions pénales internationales, qui ont d'ores et déjà vocation à qualifier, en termes de droit, certains faits historiques ?
La table ronde d'aujourd'hui revêt donc une importance toute particulière dans le cheminement de notre réflexion. Elle trouve même un ancrage dans l'actualité la plus récente, puisque les rencontres de Blois du week-end dernier, dont la presse s'est fait largement l'écho, ont ravivé le débat lancé en 2005 par l'association « Liberté pour l'histoire ». Elle devrait également nous permettre d'évaluer la pertinence du nouvel outil que nous a offert la réforme constitutionnelle de juillet 2008 avec les résolutions ; celles-ci permettront au Parlement de s'exprimer de façon solennelle sur tout sujet qui lui paraîtrait politiquement important, sans entrer pour autant dans une logique normative.
Je remercie chaleureusement nos invités d'avoir accepté de participer à cet échange autour de trois questions importantes : le Parlement reste-t-il dans sa mission lorsqu'il porte, par le biais d'une loi, une appréciation sur les faits historiques ? Quelles mesures peut-il adopter pour rassembler les Français autour d'une mémoire apaisée ? Quelle place accorder à la mémoire européenne ?
Je tiens d'abord à féliciter le Parlement du travail accompli par cette mission. J'ai lu le compte rendu de ses débats, qui ont été d'une tenue et d'une hauteur remarquables. Les missions parlementaires font un travail qui gagnerait à être plus connu du grand public.
Quels sont les problèmes que les lois mémorielles posent aux juristes ?
Il y a d'abord celui des « lois non normatives » – ce qui apparaît comme une contradiction intrinsèque –, que les magistrats qualifient d'ovnis : c'est le cas de la loi sur l'Arménie de 2001, limitée à une demi-ligne, sans indication du lieu du crime ni de l'identité du criminel. Mais ces ovnis sont susceptibles, à tout instant, d'entrer directement ou indirectement dans notre espace aérien avec du normatif lourd : c'est le cas de la proposition de loi complémentaire sur l'Arménie votée par l'Assemblée nationale en 2006, qui pénalise gravement la négation et surtout la contestation du génocide arménien. Cette pénalisation peut également être le fait d'une loi générale : sur le bureau de l'Assemblée ont été déposées cinq ou six propositions de loi portant sur des lois non normatives, antérieures ou non, qui les pénaliseraient toutes en une seule fois. Par ailleurs, une directive européenne, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, n'avait pas pour objet de dire l'histoire mais ce sera son effet.
Ces lois, bien que non normatives, sont déjà perçues et revendiquées comme telles par le public, que ce soit à l'appui d'actions fondées sur l'article 1382 du code civil, c'est-à-dire de la réparation du dommage moral, ou à l'appui d'actions pénales sur d'autres bases, comme les injures, le fait qu'il s'agisse d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité étant considéré comme une circonstance aggravante, ou encore dans le cadre de pressions préventives contre les éditeurs. Vous avez interrogé les historiens sur l'autocensure qu'ils pouvaient pratiquer du fait des lois mémorielles, mais il existe aussi une autocensure des éditeurs : je pourrais vous citer plusieurs cas où ils ont renoncé à publier des livres. Parfois, après trois ou quatre renoncements, un éditeur osait prendre le risque, mais en bravant les menaces venant d'associations mémorielles qui invoquaient des textes votés par le Parlement. Cela me semble assez grave.
Outre ces ovnis qui parfois se muent en missiles, il y a les articles inconstitutionnels. Certains le sont parce qu'ils interviennent dans le domaine réglementaire, notamment dans celui de l'enseignement et de la recherche : c'est ce qui a occasionné l'annulation de l'article 4 de la loi de 2005 sur les rapatriés. Je crois que si la loi de 2001 sur la traite et l'esclavage avait été déférée au Conseil constitutionnel, son article 2 aurait été annulé de la même façon. D'autres articles sont inconstitutionnels parce qu'ils remettent l'action publique entre les mains de catégories très mal définies. En matière mémorielle, le procureur de la République ne peut pas apprécier l'opportunité ou non d'engager les poursuites ; il est donc très important de savoir quelles sont les associations qui vont être plaignantes. La loi de 1990 parlait de l'honneur des déportés, ce qui était clair, les déportés étant une catégorie bien définie de la population, à laquelle on a donné des cartes de déportés. Il en va de même pour l'honneur de la Résistance, puisque des cartes de résistants ont été attribuées. Mais la loi de 2001 sur l'esclavage relève du mimétisme mémoriel. C'est un mimétisme à la René Girard : tu as quelque chose que je voudrais ; je ne t'empêche pas de l'avoir, mais je le veux aussi. C'est ainsi que dans cette loi, on a parlé de l'honneur des descendants d'esclaves : pour engager une action au pénal, il suffirait d'en être un.
Mais je me réfère à ce qu'a dit Claude Ribbe, qui est, comme je le suis aussi, descendant d'esclave. Pour dire que quelqu'un l'est, sur quoi va-t-on se baser ? Sur la couleur de la peau ? Cela n'a pas beaucoup de sens. Les descendants de Jefferson et de Sally Hemings, son esclave quarteronne – ayant un quart de sang noir –, sont noirs ; je ne le suis pas, mais j'ai néanmoins du sang de couleur. Et beaucoup de descendants d'esclaves ont du sang de négrier. Et puis, jusqu'à quand sera-t-on descendant d'esclaves ? Il faudra bien que cela s'arrête... Bientôt, il n'y aura plus d'anciens déportés ; en revanche, nous en sommes déjà à la sixième ou septième génération de descendants d'esclaves…
Ce mimétisme mémoriel est un phénomène frappant. A l'instar des fils et filles de déportés juifs, s'est constituée une association de fils et filles de déportés africains, à laquelle adhèrent des Africains directement immigrés en France, qui ne peuvent donc pas être d'anciens déportés africains et qui, parfois, non seulement ne sont pas des victimes de la traite négrière, mais encore peuvent descendre d'anciens esclavagistes africains.
Troisième problème : l'utilisation de concepts juridiques contemporains pour qualifier des évènements du passé. Le génocide et le crime contre l'humanité sont des notions modernes. L'une a été élaborée en 1944 par le philosophe polonais Raphaël Lemkin et a été introduite dans le droit positif en 1948 par l'ONU ; l'autre est apparue au moment du procès de Nuremberg. Il y a quinze ans, il aurait été impossible au Parlement de toucher à leur caractère exceptionnel ; mais avec la réforme du code pénal de 1994, on a généralisé ces notions. En en abusant, on est en train de les banaliser.
« Promener » ces notions très récentes dans le passé est un péché contre l'histoire, un péché d'anachronisme. Le passé est une terre étrangère où il faut aller avec les mêmes précautions que nous irions en Amazonie. Les Indiens d'Amazonie, avec leur culture propre, raisonnent différemment de nous ; maintenant, on l'a compris et on essaie de les protéger. Il en va de même pour le passé. Voici un exemple : certains historiens évaluent entre 500 000 et un million le nombre de Gaulois exterminés ou réduits en esclavage par les Romains ; pourquoi ce chiffre énorme ? Il se trouve que les esclaves gaulois étaient particulièrement méprisés et maltraités par les Romains, davantage que les esclaves noirs, qui étaient rares et chers. C'est qu'on ne saurait faire un lien entre l'esclavage et le racisme pour cette époque ; si les Romains méprisaient leurs esclaves, c'est parce qu'ils ne s'étaient pas suicidés et n'avaient pas tué leurs enfants. Il y avait alors, en effet, une extrême valorisation morale du suicide ; et les Romains considéraient qu'on était esclave parce qu'on le voulait bien, puisqu'il était fort simple de sortir de sa condition par ce moyen.
L'utilisation de concepts juridiques contemporains pour qualifier les évènements du passé ne convient pas davantage au droit qu'à l'histoire. C'est une forme très particulière de rétroactivité : on punit des délits connexes à un crime principal, qui est défini rétroactivement et dont les auteurs sont morts depuis longtemps – et qui est donc non punissable. Si l'on décrète qu'il y a eu crime contre l'humanité au XVe siècle, il est évident que le crime principal n'est pas punissable, mais on invente un délit connexe que l'on va punir : c'est assez curieux juridiquement ; dès que la réforme constitutionnelle aura été rendue applicable par une loi organique, il serait intéressant d'utiliser dans de tels cas l'exception d'inconstitutionnalité.
Autre problème : les cas de sanctuarisation d'un jugement. Certes je préfère qu'il y ait un jugement, donc une enquête, une instruction – procès de Nuremberg, tribunal international spécialisé comme pour la Bosnie ou le Rwanda, Cour pénale internationale – plutôt que rien ; mais il n'est pas dans la tradition républicaine de sacraliser un jugement vis-à-vis des historiens, c'est-à-dire de créer une vérité historique officielle.
J'en arrive enfin aux difficultés inhérentes à la décision-cadre introduite par la France en 2001, votée en première lecture par le Conseil des ministres européen de la Justice en avril 2007, et soumise pour avis au Parlement européen en novembre 2007. Son titre est relativement anodin, puisqu'elle est relative à « la répression de certaines formes de xénophobie et de racisme par les moyens du droit pénal ». Les historiens français que nous sommes ne la connaissaient pas du tout ; ce sont des historiens belges et italiens qui ont appelé notre attention sur ce texte, qui est une curieuse construction juridique.
Les articles 1-1°a) et b) ne posent pas de problème. Ils répriment l'incitation à la violence et à la haine raciale, à la xénophobie ou à la haine religieuse. La France a l'équivalent dans son code pénal, mais pour les États qui ne l'ont pas, c'est une bonne chose.
Le problème commence avec l'article 1-1°d), qui est une généralisation de la loi Gayssot et qui est donc axé sur les jugements de Nuremberg. Il faut préciser que vingt-trois pays sur les Vingt-sept n'ont pas d'équivalent de cette loi dans leur arsenal juridique. Cet article va-t-il plus ou moins loin qu'elle ?
Dans le sens « plus », il y a d'abord le fait qu'il retient la notion de « banalisation », plutôt que celle de « contestation » qui figure dans la loi Gayssot. J'aurais d'ailleurs préféré à l'époque de celle-ci la notion de « négation », plus claire juridiquement, celle de « contestation » renvoyant à l'idée de débat : au XVII° siècle, « avoir une contestation » avec quelqu'un voulait dire « avoir une discussion » avec lui. En tout cas, la notion de « banalisation » m'effraie. On parle même de « banalisation grossière » : qu'est-ce que cela signifie ? Pourrait-on être relaxé par le juge parce qu'on a banalisé la Shoah « finement »?
De plus, cet article vise les crimes de guerre, alors que la loi Gayssot s'en était tenue aux crimes contre l'humanité.
Dans le sens « moins », il y a le fait d'ajouter que le comportement visé doit avoir été exercé « d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine ».
Cet article fut sans doute le résultat de négociations assez complexes. Au total, je suis incapable, dans l'état actuel des choses, de dire s'il va plus ou moins loin que la loi Gayssot sur Nuremberg. Disons que c'est à peu près la même chose pour nombre de pays où, parfois, les historiens s'étaient opposés à l'adoption d'une loi nationale de ce type.
Mais le problème s'aggrave avec l'article 1-1°c), qui vise la banalisation de tous crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocides, sans préciser à quelle époque ils devront avoir été commis, ni par quelle autorité ils devront avoir été qualifiés. Il permet les incursions de n'importe quelle autorité politique dans l'histoire, et sans appui sur un jugement préalable. En France, il refermera automatiquement le piège ouvert par les lois non normatives : si cette décision-cadre est adoptée en seconde lecture par le Conseil des ministres européen, toutes les lois qui n'étaient pas encore assorties de sanction pénale le seront.
L'article 1-4° de la décision-cadre offre aux gouvernements nationaux une option, que les ministres de la Justice peuvent exercer lors du deuxième vote en Conseil des ministres – après, il sera trop tard. Elle consiste à limiter l'effet de l'article 1-1°c) etou d) aux crimes qualifiés par un tribunal international – Nuremberg, tribunaux constitués pour le Rwanda et la Bosnie, la Cour pénale internationale – ou, éventuellement, par un tribunal international et un tribunal national. On se demande pourquoi ce n'est pas cela le droit commun, et la solution maximaliste l'option.
Pour le moment, seuls sont visés les crimes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Mais déjà, les pays baltes ont demandé que les crimes du communisme le soient également, et la Commission s'est engagée à proposer quelque chose avant avril 2009 – ce qui inclurait donc le massacre de Katyn, le Goulag, la dékoulakisation et les massacres ukrainiens.
Cette décision-cadre provoque une mobilisation générale des historiens les plus renommés et les moins suspects de négationnisme dans quelque domaine que ce soit. Les historiens français souhaitent au moins que le Gouvernement exerce l'option de l'article 1-2°. Beaucoup d'historiens européens souhaitent un retrait pur et simple des articles 1-1°c) et d). Ils pensent non seulement à eux, mais aux historiens de l'avenir : les évènements du Rwanda, par exemple, ont été jugés par un tribunal spécialisé, mais il y a encore bien des choses à éclaircir, à commencer par les conditions dans lesquelles a été abattu l'avion du président hutu ; or avec un tel texte, les futurs historiens ne pourront pas travailler sur ces questions.
Pour beaucoup d'historiens, les lois mémorielles ne sont pas nécessaires ; pour réintégrer des évènements dans la mémoire collective, les commémorations, l'enseignement, les publications et la médiatisation sont plus efficaces que le procès contre tel ou tel individu. Au demeurant, certains évènements n'ont jamais été niés, ni n'ont fait l'objet d'apologie dans la période moderne : des négationnistes comme M. Faurisson ont nié totalement l'extermination des juifs – et non pas seulement des chambres à gaz –, mais la traite transatlantique n'a jamais été niée, et l'apologie n'en est faite par personne. S'il s'agit de défendre la mémoire des victimes contre les offenses qui leur seraient faites, nous disposons en France d'un arsenal pénal très important, qui réprime les incitations à la haine et à la violence, la diffamation, les injures et même l'atteinte à la mémoire des morts : ce n'est pas rien, et cela a permis de condamner la plupart des négationnistes, notamment Faurisson, Bardèche et Rassinier.
Alors, que peut faire le Parlement aujourd'hui ?
On ne peut pas toucher à ce qui a déjà été promulgué. Sur l'Arménie, la proposition de loi de 2006 n'a pas été votée par le Sénat et il faudrait en rester là ; en revanche, il ne faut pas remettre en cause ce qui est acquis car ceux qui sont concernés le prendraient pour une agression.
Pour l'avenir, et puisque la réforme constitutionnelle le permet, que le Parlement s'en tienne désormais à des résolutions. Cela lui offrira d'ailleurs l'occasion de rédactions plus larges, plus clairement motivées, plus lisibles pour le grand public que, par exemple, la loi d'une demi-ligne sur l'Arménie.
Il faut par ailleurs limiter la portée de la décision-cadre européenne, au moins en exerçant l'option.
Enfin, le Parlement doit agir sur ce qui relève spécifiquement du politique, comme les commémorations, les musées, les indemnisations ou les moyens financiers.
Je vais poser une série de questions, mais je ne veux pas que vous y répondiez tout de suite. J'ai entendu que si le Conseil constitutionnel avait été saisi, il n'aurait pas validé ces lois.
Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ? Les députés ne le peuvent-ils pas ? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Est-ce parce que ces lois ont été votées à la quasi-unanimité ? Je pose ces questions pour que tout le monde se sente responsable. Pour avoir été longtemps député, je suis de ceux qui pensent que le Parlement est dans son droit lorsqu'il travaille sur des domaines qui concernent la vie de la société, dès lors qu'il se réfère à la République et à la laïcité.
Je suis le premier signataire de la proposition de loi qui a abouti à la loi de 1990, dite loi Gayssot. Telle que nous l'avons écrite et votée, il ne s'agissait pas d'une loi mémorielle, mais d'une loi contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et c'est parce que le négationnisme est un des vecteurs principaux de l'antisémitisme que nous avons inclus dans la loi ce fameux article 9 qui a fait l'objet de débats et de controverses.
Il n'est pas nécessaire de revenir plusieurs siècles en arrière pour savoir si l'on peut ou non parler de « contestation ». Aujourd'hui, si je conteste quelque chose, cela veut dire que je ne suis pas d'accord, que je le nie. D'ailleurs, les juristes, dans les différents colloques qui ont eu lieu, ont mis le signe « égal » entre contestation et négationnisme.
Pour faire du négationnisme un délit, nous sommes partis de faits jugés par le tribunal de Nuremberg. Nous nous sommes immédiatement heurtés à tous ceux qu'on appelait alors les « révisionnistes » et qui, en France mais aussi en Europe et dans le monde, parlaient de « détail » et exprimaient l'idée que, finalement, il n'y avait pas eu de victimes, et donc pas de bourreaux. Ils ont pu vérifier ensuite que la loi Gayssot a apporté des moyens pour combattre le négationnisme !
Pourquoi se seraient-ils élevés contre cette proposition de loi avec une telle violence si, comme le disent certains, les dispositions préexistantes suffisaient ? La raison, c'est bien que, concernant le négationnisme, il y avait un vide juridique dans la loi sur la presse – qui nous a conduits à lui ajouter par cet article 9 l'article 24 bis.
Il ne s'agissait pas de réécrire l'histoire, d'écrire une histoire officielle ou d'imposer une vérité d'État, mais de condamner des propos et des actes qui contribuent à perpétuer l'antisémitisme. On me répondra que maintenant, tout le monde sait que la Shoah a existé ; mais plus on s'éloigne du moment où cela s'est passé, plus les parents et les proches des victimes quittent ce monde, plus on risque de se heurter à un discours pseudo-scientifique qui fait disparaître les bourreaux, rend les victimes responsables de ce qui leur est arrivé, incite à la haine et à la destruction. Voyez le président de l'Iran accueillir tous les négationnistes du monde et déclarer qu'il faut détruire l'État hébreu !
Le négationnisme est donc bien le vecteur principal de l'antisémitisme. En 1996, le Comité des droits de l'homme des Nations unies a déclaré avoir acquis la conviction que la loi Gayssot, telle qu'elle avait été interprétée et appliquée, était compatible avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; il précisait que la négation de l'holocauste était le principal vecteur de l'antisémitisme. Et en Europe, en janvier 1997, le Parlement européen a appelé les États membres à prendre des initiatives permettant de lutter efficacement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, contre la diffusion des thèses négationnistes, en instaurant ou en renforçant les sanctions et en améliorant les possibilités de poursuites judiciaires.
Mme Chandernagor a remarqué que vingt-trois pays sur vingt-sept n'avaient pas de procédures identiques à la loi Gayssot. Quels sont ceux qui en ont ? L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Suisse…
J'ai une vision universelle du problème ! Il me semble d'ailleurs que nous devrions nous interroger sur le rôle que pourraient jouer les Parlements, l'Europe et même l'ONU, s'agissant du Net. J'ai fait un cauchemar : une majorité, à l'Assemblée nationale, avait décidé de supprimer l'article 9 de la loi Gayssot ! C'était la fête chez les Faurisson et les Gollnisch ! On voyait dans les kiosques des croix gammées et, à la une des journaux, certains expliquaient qu'on ne pouvait pas être sûr de toutes ces histoires d'holocauste et de chambres à gaz. À Téhéran, des gens du monde entier participaient aux festivités.
Je vous en prie, ne cassez pas cette loi. Faisons en sorte qu'on puisse s'attaquer au négationnisme non pas seulement dans les écrits, mais aussi sur la Toile.
Laissons au Parlement la liberté de protéger, mais veillons aussi à ce qu'il protège la liberté. Il faut travailler avec les historiens sur les lois futures, éviter de sombrer dans le communautarisme ou dans des lois qui ne viseraient qu'à satisfaire une clientèle.
Enfin, je suis de ceux qui pensent qu'il faut défendre la loi Taubira. N'oublions pas que ceux qui ont proposé la solution finale étaient des gens instruits. Et lorsqu'un ancien prix Nobel de médecine affirme que les Noirs sont génétiquement inférieurs aux Blancs, on comprend qu'il y a encore du travail à faire pour combattre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie !
Mme Chandernagor ayant déjà traité de nombreux aspects particuliers de ces législations, je m'en tiendrai à l'exposé de grands principes juridiques, puisque le droit constitutionnel est avant tout l'expression d'une philosophie politique.
D'un point de vue général, un professeur de droit public de ma génération, encore formé par la doctrine juridique libérale de la IIIe République et par la jurisprudence du Conseil d'État, reçoit deux principes dans son biberon : le primat de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, et le respect de la liberté comme valeur cardinale de notre civilisation.
Le primat de l'intérêt général sur les intérêts catégoriels et particuliers fait partie de la culture d'un publiciste. Cela nous vient de la Révolution française, du principe de souveraineté nationale qui veut que la loi soit l'expression de la volonté générale, que chaque député soit le représentant de la Nation tout entière et non pas de factions, et que le Parlement ne soit pas, selon la formule d'Edmund Burke, un congrès d'ambassadeurs défendant des intérêts divers et hostiles. C'est cette tradition, reprise dans la Constitution de 1958, qui conduit le Conseil constitutionnel à refuser la reconnaissance de droits collectifs à des groupes, à sanctionner la catégorisation des électeurs et des personnes éligibles et à censurer systématiquement des dispositions indiquant par exemple que la Polynésie française, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin sont représentés au Parlement, seule la Nation française y étant représentée.
La liberté, comme valeur cardinale, est à la base de l'autodétermination des individus et des peuples. C'est l'héritage direct de la philosophie des Lumières et de la Révolution. C'est elle qui conduit le juriste libéral à toujours se montrer sourcilleux, notamment en matière pénale. Notre dogme est que la liberté est le principe, et sa restriction l'exception. Ainsi, les lois pénales doivent être limitées, écrites avec une extrême précision réduisant l'arbitraire du juge, qui doit toujours avoir à l'esprit qu'elles sont d'interprétation stricte : entre deux interprétations possibles, il doit systématiquement choisir la moins attentatoire à la liberté. La présomption d'innocence, le secret de l'instruction, la règle selon laquelle le doute bénéficie à l'accusé, la charge de la preuve, la proportionnalité des peines, l'immunité parlementaire sont autant de principes qui gouvernent les réflexes et donc les jugements des juristes formés au constitutionnalisme libéral. C'est aussi la libre communication des pensées et des opinions, qualifiée par la Déclaration de 1989 de « l'un des droits les plus précieux de l'Homme », qui rend le juriste libéral allergique à tout ce qui relève de la censure ou de l'endoctrinement. La Cour européenne des Droits de l'Homme a eu raison de rappeler dans une très belle formule cette évidence que « la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi et surtout pour celles qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent, soit l'État, soit une fraction de la population. » Confrontée à la fameuse affaire de l'outrage au drapeau, la Cour suprême américaine a rendu un très bel arrêt indiquant que « réprimer l'expression d'une quelconque opinion reviendrait précisément à mutiler ce que la bannière étoilée et la Constitution américaine symbolisent, c'est-à-dire la liberté. »
Le moins que l'on puisse dire est que le législateur français ne se conduit plus tout à fait selon ces grands principes. Beaucoup de parlementaires sont moins des représentants de la nation que ceux de lobbies en tout genre, tirant la couverture publique vers leurs intérêts catégoriels. La lecture des documents et des débats parlementaires fait souvent frémir, tant la « novlangue » et le totalitarisme orwellien s'y répandent. Celle des débats sur la loi de 2004 créant la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) et réprimant les propos prétendument sexistes, homophobes ou handiphobes est de ce point de vue assez terrifiante. C'est un lavage de cerveau, une obsession purgative et répressive, dont relève également la décision-cadre européenne de 2007. Comme dans tous les bons systèmes totalitaires, on ne se contente pas de réprimer, on éduque les enfants : les cerveaux des écoliers deviennent le lieu privilégié d'intervention de lobbies de toutes sortes.
À ces considérations générales de juriste, j'ajouterai une observation sociologique de bon sens : personne n'apprécie les individus narcissiques et égocentriques qui ne parlent que d'eux, qui conjuguent la vie à la première personne du singulier, qui saoulent leur entourage avec la contemplation de leur nombril. Il en est de même des groupes qui veulent conjuguer la vie collective à la première personne du pluriel, bomber le torse, exhiber leur fierté identitaire, exiger reconnaissance, repentance et réparation, souvent avec une certaine agressivité et des arguments de mauvaise foi. Le culturalisme est à l'esprit ce que le culturisme est au corps : une gonflette narcissique fortement antipathique. À donner raison à tous ces groupes qui cultivent ce qui sépare et non ce qui unit, le législateur n'apaise rien ; bien au contraire, il excite la détestation réciproque et propage la zizanie dans la société.
Quelques mots sur le questionnaire qui m'a été remis. D'abord, j'ai été choquée par l'expression « politique de la mémoire » : c'est une expression parfaitement orwellienne, qui évoque le lavage de cerveau. À quand la création d'un ministère de la mémoire, à l'instar du ministère de l'identité nationale ? Arrêtez-vous ! On va trop loin dans la manipulation de nos mémoires et de nos cerveaux, laissez-nous nous souvenir en paix.
Ensuite, on nous demande si l'intervention du législateur présente des difficultés sur le plan constitutionnel : évidemment oui. Ces difficultés sont de trois ordres, sans qu'elles revêtent le même degré de gravité.
Le premier cas est celui de la loi en faveur des rapatriés, qui concerne les interventions du législateur dans le domaine réglementaire des programmes scolaires. Le Conseil constitutionnel, depuis sa décision « Blocage des prix » de 1982, considère qu'une loi qui contient des dispositions réglementaires n'est pas, de ce seul fait, contraire à la Constitution. Simplement, le Gouvernement peut, par le biais de l'article 37, alinéa 2, demander au Conseil constitutionnel de constater qu'une disposition de loi est intervenue dans le domaine réglementaire ; dans ce cas, il pourra éventuellement la modifier ou l'abroger. Il n'y a donc pas inconstitutionnalité ; le président Mazeaud a néanmoins regretté cette évolution jurisprudentielle.
Il y a ensuite ce que nous appelons les « neutrons législatifs », à savoir les dispositions qui ne sont pas des normes, ne créent ni droits ni obligations, mais se bornent à reconnaître : c'est le cas de la première loi sur l'Arménie, de la loi Taubira. Depuis la décision de 2004 relative à la loi Fillon, le Conseil constitutionnel censure de telles dispositions qui se contentent de « bavarder », l'article 34 de la Constitution disposant que la loi fixe des règles et détermine des principes fondamentaux. Désormais donc, un « neutron législatif » pourrait être invalidé. On vient cependant d'introduire un « neutron constitutionnel » en reconnaissant les langues régionales comme appartenant au patrimoine national : on n'arrête plus les neutrons !
La question la plus grave est celle de l'atteinte portée par les lois pénales aux libertés – liberté d'expression, liberté de la presse, liberté scientifique et universitaire. Jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel n'a été saisi au fond que de la loi réprimant les outrages publics au drapeau et à l'hymne national, pour laquelle il n'a malheureusement pas fait preuve de la même éthique voltairienne que la Cour suprême américaine : il a laissé passer.
On sait cependant que le second texte de loi sur l'Arménie, qui tendait à réprimer la négociation du génocide et qui n'a pas été adopté par le Sénat, était attendu de pied ferme au palais Montpensier, où il allait de toute évidence se faire sanctionner ; j'ai même ouï dire que le président du Conseil constitutionnel de l'époque était très déçu de ne pas pouvoir en être saisi. Nous étions un certain nombre à avoir demandé à M. Jean-Louis Debré, qui était alors président de l'Assemblée nationale, de bien vouloir saisir le Conseil si ce texte venait à être adopté.
Nous avons été aussi interrogés sur les conséquences pénales des lois qui utilisent les notions de génocide ou de crime contre l'humanité. Ces conséquences sont évidentes : c'est la poursuite et la condamnation des auteurs de ces crimes ou génocides. En revanche, je considère que les délits de négation ou de minimisation de ces actes sont des délits d'opinion, notion inacceptable en démocratie libérale, à laquelle je demeure résolument hostile, comme beaucoup de juristes et d'historiens.
Pour moi, il n'y a pas de bonnes lois mémorielles : elles sont toutes mauvaises. Le Parlement doit rester à sa place, s'abstenir de gouverner nos mémoires et nos cerveaux. Cela éviterait de voir apparaître des textes un peu ridicules.
Quant à la décision-cadre de 2007, c'est la quintessence de ce qui se fait de pire au niveau européen, par une violation manifeste des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le nouvel arsenal dont disposent les parlementaires français pour faire sanctionner la violation de ces principes serait très utile. Cette décision-cadre comporte des dispositions très dangereuses, à commencer par sa définition du racisme, qui ouvre la voie à un « gouvernement des juges » à l'état pur. Ce serait folie que d'adopter un tel texte !
S'agissant du nouvel outil dont disposent les parlementaires, je dirai que mieux vaut une résolution inoffensive qu'une loi scélérate. J'attends cependant avec impatience la résolution qu'exigera certainement M. Marc Le Fur pour reconnaître le génocide culturel breton !
D'autres questions m'ont paru étonnantes, par exemple celle-ci : « Quel est le rôle du Parlement dans la célébration des grandes figures culturelles ? ». Ou encore celle-ci, sans doute inspirée par Mme Zimmerman : « Le Parlement peut-il demander que l'histoire des femmes fasse pleinement partie des programmes ? ». On frôle le ridicule. Que le Parlement reste dans sa fonction qui est de créer des droits et des obligations, et évite de trop gouverner nos esprits !
Pour comprendre l'inflation des lois mémorielles, il faut s'interroger sur leur histoire. Celle-ci comporte trois phases.
Dans une première phase, le Parlement s'est intéressé au « mort au combat ». La première loi mémorielle n'est pas celle relative au 14 juillet, mais celle de 1873 : il s'agissait de savoir quel type de tombe donner au soldat mort au combat. Elle fut votée à l'unanimité, comme le seront d'ailleurs toutes les lois mémorielles. Toutes les lois mémorielles qui suivront, jusqu'en 1914 – y compris les lois commémoratives, relatives aux cérémonies – concernent les morts au combat.
En 1915, la création par le Parlement de la mention « mort pour la France » a ouvert une deuxième phase : de 1915 à 1985, toutes les lois mémorielles – sur le 11 novembre, la journée de la déportation, le 8 mai – et toutes les cérémonies commémoratives sont liées au « mort pour la France ».
Enfin, le Parlement a créé, par la loi Badinter, en 1985, la mention « mort en déportation » pour les déportés juifs de la Shoah. À partir de cette date, il a voté toute une série de lois qui relèvent de ce « mort à cause de » : la loi Taubira, la loi sur l'Arménie, la loi Gayssot. On n'est plus dans le « mort pour ».
Il y a autant inflation interne dans les lois relevant du « mort pour » – sur l'Indochine, sur la colonisation, – qu'inflation de lois relevant du « mort à cause de » – qui conduit certains à parler de « conflit des victimes ». Dans ces conditions, le Parlement peut-il apaiser les mémoires ? La concurrence entre les deux notions rend la chose beaucoup moins aisée. Cet apaisement peut-il passer par une notion européenne ? Ce ne serait pas simple : l'Europe est actuellement sur le « mort à cause de », bien plus que sur le « mort pour ». Or le « mort à cause de » a le défaut majeur de poser le problème de l'enseignement de l'histoire, davantage que le « mort pour » : en filigrane de toutes les lois mémorielles, il y a une vision historique, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui parce que nous sommes dans une concurrence mémorielle.

Personne n'a relevé le paradoxe des lois mémorielles, qui paraissent vouloir consolider le passé, alors que la plupart du temps elles sont liées au présent. Bien plus, loin d'incarner l'intérêt général, elles expriment l'émotion momentanée d'une catégorie de la population. On fait ainsi du présent la cause véritable du passé ; ensuite, on ne touche plus à la loi mémorielle, toute remise en cause risquant d'être vécue comme un drame par la population concernée. Avec ces textes, que j'ai du mal à qualifier de lois, on est dans le pathétique, pas du tout dans le rationnel.
Madame Le Pourhiet, vous avez rappelé que la loi doit poursuivre l'intérêt général, et dit qu'il ne fallait pas de lois mémorielles. Mais visant l'intérêt général, la loi doit notamment bâtir et consolider des valeurs communes. Or, en dépit de leurs faiblesses, tel est bien le but des lois mémorielles. Mme Chandernagor, qui paraît comme vous opposée à l'idée de loi mémorielle, considère qu'il ne faut pas toucher à celles qui ont été promulguées. Considérez-vous qu'il faille aller jusqu'à les toucher ?

La loi doit servir l'intérêt général, mais certaines lois mémorielles peuvent alimenter une forme de communautarisme. J'ai eu ce sentiment à plusieurs reprises au cours de nos travaux, notamment – Mme Taubira me le pardonnera – lors de la dernière table ronde, où sont intervenus des représentants d'associations touchant à l'esclavage ; je me suis demandé si l'on avait le droit de promulguer, à l'avenir, des lois qui pourraient servir des intérêts particuliers. Pour ma part, je ne suis peut-être pas, comme Mme Chandernagor, descendante d'esclaves, mais je suis certainement descendante de serfs, dont la situation était inacceptable…
Je voudrais que le législateur puisse non seulement régler le présent, mais aussi se projeter dans le futur. J'ai eu la sensation, au fur et à mesure des semaines, que nous faisions le procès de ce que la classe politique n'a pas été capable de faire, c'est-à-dire d'assumer le passé. S'il devait y avoir encore des lois mémorielles, je voudrais qu'elles nous permettent d'enrichir l'avenir.

J'ai entendu des propos quelque peu surréalistes.
Lorsque j'entends dire que le débat sur l'esclavage a un aspect communautariste, je suis surprise car à ma connaissance, la condamnation de l'esclavage, c'est la volonté générale des Français ! Je ne comprends donc pas comment on peut nous expliquer que la dénonciation de l'esclavage concerne certains et pas d'autres. Comme l'a dit M. Barcellini, la loi Taubira sur l'esclavage a été votée à l'unanimité.
Madame Le Pourhiet, je vous ai entendue avec beaucoup d'intérêt à d'autres occasions, mais j'ai envie de vous dire cette fois que ce qui est excessif ne compte pas. Vous parlez de loi « scélérate », «bavarde », vous dites que le Conseil constitutionnel aurait été prêt à la censure sur des points dont il n'a pas été saisi : comment peut-on dire des choses pareilles ? Que je sache, le Conseil constitutionnel émet un avis quand il a été saisi ; nous ne saurions préjuger de cet avis. Je n'attendais pas cela d'un professeur de droit public tel que vous.
Par ailleurs, si tout ce qui limite la liberté d'expression doit, selon vous, être banni de notre système juridique, que faites-vous de la loi de 1881 sur la presse, appliquée depuis des lustres sans que personne n'y voie rien à redire ? Elle a limité la liberté d'expression en considération de valeurs qui semblaient plus importantes pour notre société, et donc interdit l'injure, la diffamation, la provocation à la haine. Elle traduit la recherche d'un équilibre entre nos valeurs et les libertés de la presse et d'opinion.
Si l'on veut débattre loyalement, il faut rappeler aussi que la loi Gayssot n'est pas tombée du ciel, mais a été votée dans la suite logique de la loi de 1972 contre le racisme, que tout le monde considère comme une bonne loi.

J'ai été très intéressé par l'incursion de la dimension constitutionnelle dans nos débats. Il se trouve que la donne a complètement changé depuis le 23 juillet dernier puisque, dorénavant, par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité, n'importe qui peut saisir nos juridictions, avec les filtres successifs jusqu'au Conseil constitutionnel, pour mettre en cause la constitutionnalité de n'importe quelle loi en vigueur, même votée il y a 200 ans. En matière de lois mémorielles, comment entrevoyez-vous l'éventuel bouleversement que peut représenter la possibilité de recours ainsi offerte à tout citoyen ?

Plus nous avançons dans nos réunions, plus je suis perplexe face à la diversité des interprétations. Un élément clé est oublié dans nos débats, ce sont les médias. Sans eux, nous serions entre gens qui ont une certaine culture pour les uns, une certaine expérience politique pour les autres ; mais le débat est faussé entre nous par le fait que la médiatisation induit une certaine banalisation, à tel point qu'on ne se comprend même pas sur les mots utilisés. Ainsi, la vision qu'a l'historien de ce qu'est une atteinte à la liberté du chercheur peut choquer au regard des vérités établies. De même, certaines considérations de nature juridique que nous avons entendues peuvent choquer.
On nous rappelle que ces lois ont été votées l'unanimité, mais qui aurait pris le risque d'être accusé d'hérésie et condamné au bûcher en ne les votant pas ?
Il est dérangeant, pour celui qui est dans une démarche de connaissance, de s'entendre dire que telle ou telle affirmation est incontestable. En matière historique en particulier, apparaissent régulièrement des interprétations nouvelles.
Bref, nous sommes « pervertis » par le projecteur des médias. Ainsi, l'éditeur ne voudra plus éditer un livre, craignant la mauvaise presse, la mauvaise interprétation qui pourrait en être faite. On le sait : certains historiens ont été mis en cause sur une interprétation. Jusqu'où va la légitimité du Parlement à prendre position dans ce domaine ? Quelle est notre limite ?
Le Parlement n'a pas à défendre des intérêts particuliers ou communautaristes. En votant des textes comme la loi Gayssot ou la loi sur l'esclavage, il défend l'intérêt général.
La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie relève de l'intérêt général ; et comme l'a dit Mme Pau-Langevin, la loi Gayssot est venue après celle de 1972 qui a permis que ce fléau de nos sociétés qu'est le racisme ne soit plus considéré comme une opinion, mais comme un délit : les injures et les actes racistes sont passibles d'une condamnation car ils ne relèvent pas du débat d'idées.
Je suis abasourdi, outré d'entendre dire qu'il s'agit de « lois scélérates » et que le négationnisme relève de la liberté d'expression !
Ce qui est interdit, ce n'est pas le livre, c'est d'y écrire que la Shoah n'a pas existé. Au juge d'apprécier le caractère délictueux des propos.
Concernant le Net, on ne sait plus que faire… C'est un vrai problème à l'échelle européenne.
Laissons au Parlement la liberté de protéger nos concitoyens, c'est son devoir !

Depuis presque six mois, nos débats ont lieu autant entre nous qu'avec nos interlocuteurs.
La loi Gayssot n'est sans doute pas une loi mémorielle ; le problème concerne les lois qui portent sur des événements passés, par lesquelles le Parlement sort de son rôle. Il n'a pas à juger l'histoire, ni à réécrire l'histoire ; Mme Chandernagor a bien illustré le risque d'anachronisme.
Des historiens viennent de demander dans l'appel de Blois qu'on les laisse écrire l'histoire et la réécrire. On fait en effet fausse route en affirmant que l'histoire est écrite une fois pour toutes : elle se réécrit au contraire en continu, à la lumière d'autres témoins ou d'autres sources, et à partir de nouvelles interrogations. Par exemple, l'histoire enseignée jusqu'en 1960 apprenait aux élèves que les Romains étaient de brillants civilisateurs, appréciés là où ils s'installaient, parce qu'elle avait été écrite à l'époque de la colonisation ; ensuite, on a remis en valeur la civilisation des Gaulois et des Celtes. Je souligne néanmoins qu'il n'y a pas, en Europe, de chaire d'études celtes.
J'aimerais vous entendre sur cette « liberté pour l'histoire » et sur la question de savoir si le Parlement est dans son rôle s'agissant des lois mémorielles.
Quant aux questions envoyées aux participants, j'avoue avoir sursauté en entendant celle relative aux femmes !
Compte tenu de ma spécialité, le droit de la presse, je voudrais évoquer le malaise provoqué par ces lois au regard de ce droit et de son équilibre.
Ces lois induisent des risques de poursuites contre les historiens, même si ces poursuites sont infondées et n'ont guère de chance d'aboutir. C'est leur effet pervers, qui entraîne, Mme Chandernagor l'a souligné, un risque d'autocensure de la part des historiens.
Au regard de la liberté d'expression, il faut distinguer le risque d'orientation du discours historique – dont je ne parlerai pas faute de temps –, et le risque de sanction de ce discours. Je vois trois risques de mise en jeu de la responsabilité des historiens.
D'abord, sur le plan administratif et disciplinaire : pourquoi n'envisagerait-on pas des poursuites disciplinaires contre certains historiens, au motif qu'ils n'auraient pas suivi des programmes de recherche ou des orientations historiques ?
Il y a ensuite, c'est évident, le risque de mise en jeu de la responsabilité civile de l'historien, c'est-à-dire d'actions fondées sur l'article 1382 du code civil, quelle que soit la loi mémorielle. Elles sont très diverses – certaines sont normatives, d'autres ne le sont pas, et pour ma part je n'y inclus pas la loi Gayssot –, mais il y a un risque d'inflation de poursuites en responsabilité civile, même si l'historien sort indemne de ces procès.
Le troisième risque, c'est la mise en jeu de la responsabilité pénale. Certes, dans les lois mémorielles que nous analysons, il n'y a pas de disposition pénale nouvelle ; mais le risque est là, et il est aggravé par la proposition de décision-cadre européenne. Avant d'en connaître l'existence, j'avais évoqué, dans un article sur les lois mémorielles non encore publié, l'appel d'air direct représenté par des propositions de loi tendant stricto sensu à réprimer le négationnisme ; et cette proposition de décision-cadre qui demande aux États-membres de réfléchir à une pénalisation des propos négationnistes constitue un deuxième appel d'air direct. Il y a enfin un troisième appel d'air, indirect, qui m'inquiète énormément : je veux parler des nombreuses propositions de loi tendant à reconnaître des crimes ou des génocides.
Pardonnez-moi d'être un peu impertinente : le Parlement manque cruellement de mémoire. Dans un premier temps, il vote un texte non normatif, refuse d'y adjoindre une incrimination en arguant de la liberté d'expression ; mais quelques mois plus tard, il propose une incrimination, en arguant du caractère non normatif du texte !
Il n'est pas question de remettre en cause la nécessité de sanctionner des propos négationnistes, mais il faut s'interroger sur les moyens juridiques de parvenir à cette sanction au regard de la cohérence du droit de la presse, lequel doit être un équilibre entre préservation de la liberté et protection des droits des personnes.
Je voudrais dissiper un malentendu sur la liberté d'expression. Le droit de la presse incarné par la loi de 1881, par définition, y porte atteinte puisqu'il en fixe les bornes admissibles. Mais la question qui se pose à vous est de savoir quelle est l'opportunité de nouvelles incriminations – je songe aux incriminations de négationnisme – et si elles sont proportionnées au regard des impératifs démocratiques.
A mon sens, la loi Gayssot de 1990, à laquelle j'adhère sentimentalement, procède d'un grand malentendu en raison de sa formulation et de son manque de lisibilité par rapport aux logiques d'incrimination du droit de la presse, notamment par rapport à l'incrimination de la provocation : les dispositions de l'article 24 bis auraient pu figurer à l'article 24 sur les provocations et apologies de crime.
Ce qui m'inquiète, c'est que ces délits de négationnisme ou de banalisation risquent de bousculer le fragile équilibre du droit de la presse en touchant à la subtile frontière entre des propos constitutifs d'une infraction et ceux qui restent une opinion. Ce qui me fait regretter l'existence de l'article 24 bis et de projets de textes de loi renvoyant à ce même article pour d'autres négations, d'autres crimes, c'est le spectre du délit d'opinion. Le législateur de 1881 avait voulu abolir le délit d'opinion, parlant de délit de tendance ou de doctrine ; or le négationnisme est une opinion, à la différence du racisme, même si elle est abjecte. C'est si vrai que le contentieux du négationnisme fait apparaître la condamnation non seulement de la négation, mais aussi du révisionnisme, c'est-à-dire des contestations, des minorations concernant les délits, les crimes, les victimes : un historien qui ferait sérieusement son travail pourrait être mis en difficulté. Ces délits de négationnisme risquent de rétablir une forme de délit d'opinion.
Or tout le panache du législateur de 1881 a été de marquer un coup d'arrêt à une inflation d'incriminations intervenues au gré des aléas politiques. En abrogeant bon nombre d'incriminations – attaque contre la Constitution, attaque contre le respect dû aux lois, provocation à la désobéissance aux lois, excitation à la haine et au mépris du gouvernement, excitation à la haine et au mépris des citoyens, outrage à la morale publique, à la morale religieuse –, le législateur a voulu conserver des délits qui le sont vraiment. Eugène Pelletan ne disait-il pas : mais qui donc pourrait oser faire la police du cerveau humain ? La loi de 1881 vise tout acte criminel ou délictueux qui porte atteinte à la sécurité publique ou à la liberté d'autrui ; elle comporte un très petit nombre d'incriminations, dont les plus importantes sont la diffamation, l'injure, une série d'offenses et toutes les provocations et apologies, sous-tendues par l'idée de prévenir le trouble social.
Aujourd'hui, le législateur achoppe sur le point de savoir s'il est légitime d'incriminer la provocation. Les travaux préparatoires montrent qu'on a pensé incriminer la provocation à des crimes, et non pas à des délits, la provocation non suivie d'effet pouvant être considérée comme une opinion. Nous sommes au coeur du sujet avec le délit de négationnisme. Le négationnisme est un déni, c'est donc une provocation ; cette assimilation est systématiquement faite par le juge, européen ou français, ainsi que par la doctrine. Mais le législateur, et c'est pourquoi je parlais de malentendu, n'a pas clairement fait ce parallèle avec la provocation : la loi Gayssot a dépassé une sorte de ligne blanche, d'où le malaise des juristes et des historiens ; l'incrimination, peu lisible, ne met pas en valeur la faute et le préjudice, et donne l'impression de recréer un délit d'opinion.
L'arsenal juridique existe, servons-nous en, quitte à le retravailler. Pour les propos les plus graves, utilisons l'arsenal pénal, les dispositions relatives à la provocation à la discrimination et à la haine raciale. Pour les propos les plus stupides, la bêtise relevant moins de la poursuite pénale que de la poursuite civile, utilisons l'arsenal civil sur le droit de la responsabilité, avec un débat intellectuel sur la fausseté des allégations.
D'ailleurs, le contentieux du négationnisme postérieur à la loi Gayssot a été actionné sur l'article 24, alinéa 6. Il n'est pas difficile, en effet, de débusquer dans les ouvrages et articles négationnistes des propos relevant de l'apologie de crime, de la provocation à la haine raciale et de la diffamation raciale. Dans les sinistres affaires Faurisson et Guyonnet, en 1997 et 2000, l'incrimination s'est fondée non pas sur l'article 24 bis, mais sur le droit de la presse classique. Quant au droit de la responsabilité civile, il s'est appliqué également dans l'affaire Faurisson, de même que dans l'affaire Bernard Lewis en 1995.
Aux personnes qui me disent que le négationnisme est trop grave pour se limiter aux procédures civiles, je réponds : le pénal pour le plus grave, le civil pour le plus stupide. Vous êtes vous-mêmes en train d'hésiter entre la voie civile et la voie pénale. La loi Guigou a procédé non pas à une dépénalisation, mais à un très fort adoucissement du droit de la presse, par le retrait de peines d'emprisonnement. La voie pénale est de moins en moins suivie par les victimes, qui préfèrent défendre leurs intérêts civils ; et elle est peu admise par la Cour européenne des droits de l'homme : en condamnant la France en raison du caractère disproportionné de la condamnation, elle la condamne non sur le principe de condamner, mais sur le fait de condamner au pénal. Enfin, la commission Guinchard songe à dépénaliser une partie du droit de la presse.
La création de délits de négationnisme est donc lourde d'inconvénients : elle alimente des réserves sur l'opportunité de cette incrimination ; c'est une épée de Damoclès pour les historiens ; elle risque de victimiser les négationnistes. De plus, la force dissuasive du délit est relativement modeste, les habitués du prétoire s'en servant comme tribune. Enfin, il me paraît plus important de réfuter ce type de discours sur un terrain scientifique.
Et pourtant, la proposition de décision-cadre européenne vise à réprimer l'apologie, la négation ou la banalisation de certains crimes.
Mon premier motif d'inquiétude concerne son champ d'application : le terme « banalisation », très vague, est contraire au principe de sécurité et de prévisibilité de la loi. Par ailleurs, entre la proposition du Conseil et celle du Parlement, la condition d'incitation à la haine a été supprimée, alors que c'était un bon garde-fou, permettant de faire la part entre le travail d'un historien et l'activité d'un négationniste.
L'amendement du Parlement, dont Mme Chandernagor a parlé, prévoit la possibilité pour les États de faire une déclaration afin de ne rendre punissable la banalisation que si les crimes ont été établis par une décision de justice – nationale ou internationale. S'il ne nous reste que cette solution, je l'approuve ; j'observe qu'elle élimine de fait les lois mémorielles, en ce qu'il s'agit de crimes reconnus par le législateur, et non par une décision de justice… Mais on risque de voir surgir un autre amendement tendant à ajouter « ou par la loi ».
Trop alambiquée pour être raisonnable, cette proposition de décision-cadre doit nous inspirer la plus grande vigilance.

Je voudrais m'éloigner du terrain juridique pour poser une question politique : comment les lois mémorielles peuvent-elles être reçues par nos concitoyens ?
Nous avons en effet parlé des politiques, des juristes, des éditeurs, des universitaires, des chercheurs, des médias, mais pas encore des citoyens. C'est difficile, car leurs opinions peuvent être différentes des nôtres. Le Parlement éprouve toujours beaucoup d'émotion à voter un texte mémoriel ; le citoyen en éprouve également beaucoup en le recevant. Si l'émotion du Parlement et celle du citoyen ne sont pas en phase, l'État manque son objectif, qui est de construire une mémoire commune ou de rappeler les valeurs communes qui y sont attachées.
Le fameux article 4 de la loi de 2005 – je parle sous le contrôle de Christian Vanneste – est un bon exemple. Ce qui me frappe, c'est qu'il ait été pratiquement impossible d'expliquer la volonté du Parlement. Une bonne partie de l'opinion publique a interprété cet article comme une apologie de la colonisation, voire une réhabilitation de l'esclavage. Or le législateur a simplement voulu dire que l'expansion française à l'extérieur de son territoire a été une oeuvre humaine qui, comme toutes les oeuvres humaines, a eu des aspects négatifs et des aspects positifs ; et que par conséquent, il importe que la mémoire véhiculée en particulier dans les livres d'histoire de nos enfants fasse état, à la fois, de ces aspects positifs et de ces aspects négatifs. Le Parlement n'a rien voulu dire d'autre. Cette disposition a été acceptée sans la moindre polémique dans l'hémicycle, adoptée sans la moindre observation par le Sénat, et la loi a été promulguée sans aucune réserve par le Président de la République. C'est plus d'un an après qu'à la suite de manifestations et de colloques, cette affaire a déchaîné les passions.
Le Parlement doit donc non seulement prendre des précautions sur le plan juridique, comme cela a été dit, mais également être attentif aux réactions possibles de l'opinion publique. En l'occurrence, la présentation de ce texte n'avait pas réellement été préparée ; la disposition dont il s'agit ne faisait pas partie du projet du Gouvernement, mais était un amendement parlementaire, que certains députés ont découvert en séance. Le deuxième problème, et je m'en excuse auprès des auteurs, c'est que sa rédaction n'était pas parfaite. Enfin, les politiques ont été totalement incapables, il faut le reconnaître, d'expliquer les choses.
A l'avenir, si le Parlement confirme son intention de voter des lois mémorielles – et personnellement, je n'y suis pas opposé –, il devra faire beaucoup plus attention. Cela veut dire qu'il faudra procéder à une vaste consultation avant, avoir un débat beaucoup plus approfondi dans l'hémicycle ou en commission, et avoir ensuite le courage d'expliquer.
En matière de commémorations, il est évident que le Parlement doit s'exprimer, et que ce faisant il ne porte pas seulement une appréciation juridique. La décision de commémorer les victimes de la guerre de 14-18 le 11 Novembre prend acte de la signification symbolique de la date du 11 novembre 1918 ; la décision de commémorer les morts de la guerre de 39-45 le 8 Mai met en exergue la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945 ; et lorsque des politiques, de droite comme de gauche, refusent la date du 19 mars pour commémorer les morts de la guerre d'Algérie, c'est que la date de la signature du cessez-le-feu n'est pas, selon eux, l'événement le plus important à retenir. Le Parlement prend ces décisions non pas sur la seule base d'éléments juridiques ; il le fait aussi en fonction d'une appréciation historique et d'une volonté politique, lesquelles font partie des attributions du Parlement. On ne saurait l'empêcher d'intervenir dans ce domaine : lorsqu'il le fait, il est vraiment dans son rôle.

Il ne faut pas confondre les lois mémorielles, les lois commémoratives, les lois de défense des droits de l'homme et de protection de l'humanité contre des dérives inacceptables.
Il n'appartient pas aux politiques d'écrire l'histoire. Chacun son métier. Il faut laisser aux historiens le travail de recherche sur l'histoire, qui n'est d'ailleurs jamais fini.
En revanche, il est normal de voter des lois commémoratives, pour signifier que certains événements forts de notre histoire nationale méritent un moment d'hommage et de reconnaissance. Personne ne peut contester la commémoration du 11 Novembre 1918, jour de l'Armistice, ou celle du 8 mai 1945, date de la capitulation nazie, donc de la fin d'un régime dont la barbarie avait commencé bien avant la guerre, les premiers camps de concentration ayant été ouverts en Allemagne, prioritairement pour des Allemands.
Sans vouloir rouvrir un débat qui n'est pas tranché, le 19 mars 1962 n'est pas la date de la signature des Accords d'Évian, signés le 18 mars, mais du cessez-le-feu. Une proposition de loi a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale sur le sujet. J'étais un de ceux qui pensaient, certainement à tort, que la Nation avait assez de recul sur cette période pour trancher.
Il peut exister aussi des lois mémorielles, mais je ne considère pas que la loi Gayssot en soit une, pas plus que la loi Taubira : l'une et l'autre protègent l'humanité et défendent les droits de l'homme. Leurs conséquences pénales sont très utiles. Lorsque des négationnistes contestent des événements historiques avérés, il y a trouble à l'ordre public, qu'on le veuille ou non ! On ne peut pas laisser affirmer que les camps de concentration n'ont pas existé.
La stupidité, évoquée par Mme Mallet-Poujol, ne peut tout excuser : certains mots peuvent tuer ; et comme l'a dit M. Diefenbacher, les citoyens ont droit à la protection de la loi, que nous avons le devoir de leur apporter. On ne peut pas excuser les propos négationnistes, qui peuvent mettre en danger l'ordre public, l'intégrité des citoyens, voire l'intégrité de la Nation elle-même, par la stupidité ! Il y a aussi des gens qui en tuent d'autres par stupidité : cela n'empêche pas qu'ils soient déférés au tribunal.
Je ne peux donc pas accepter l'adjectif « scélérate » pour qualifier des lois votées pour protéger les citoyens contre ces dérives et faire oeuvre de défense de la Nation.

Les propos de nos invités étaient plutôt une instruction à charge, à l'exception notable de celle de Jean-Claude Gayssot. Ils sont tout à fait intéressants pour nous car ils nous aident à réfléchir : nous tenons à entendre des points de vue différents.
Mme Chandernagor, qui mène ce combat depuis plusieurs années, demande que le Parlement s'en tienne là. Il est vrai que nous-mêmes demandons à être fouettés ! Nous nous interrogeons sur le rôle de notre institution – qui, il n'est pas inutile de le rappeler, émane du suffrage universel – et sur la délimitation du périmètre de nos compétences. Mais nul n'oserait parler de délimiter le périmètre de compétences des historiens et des juristes !
Madame Chandernagor, vous dites qu'il n'y a pas et qu'il n'y avait pas de négation de la traite et de l'esclavage. Pardon de vous démentir, mais le flot de courriers que je reçois et les propos tenus au cours d'émissions radiophoniques auxquelles j'ai participé m'obligent à le faire. La justice n'est pas nécessairement saisie par les victimes car elles ne savent pas toujours comment procéder, ou sont trop « cassées » pour le faire.
Madame Le Pourhiet, comme toujours, je vous ai écoutée avec beaucoup d'intérêt, mais j'avoue avoir été surprise car, après cinq minutes de la rigueur juridique dont vous savez faire preuve, vous nous avez servi une charge inattendue. J'ai découvert que nous vivions dans un régime totalitaire et que nous autres parlementaires n'avions qu'un plaisir, fabriquer des « neutrons législatifs ». Ce n'est pas tout à fait ce que je vis. Même s'il nous arrive de travailler mal, nous travaillons beaucoup et avec le souci constant de l'intérêt général. Même si je ne conteste pas l'existence de groupes de pression, ici comme ailleurs, nous sommes assez peu nombreux à avoir besoin de leçons sur l'intérêt général et lorsqu'un parlementaire s'en éloigne, il s'en trouve dix pour le rappeler à l'ordre.
Deux reproches contradictoires sont faits à la loi Taubira : elle est complètement insignifiante puisqu'elle se contente de reconnaître ; elle procède à du lavage de cerveau puisqu'il est question, en son article 2, d'enseignement de l'histoire. Il y est bien question d'enseignement de l'histoire, et même d'encouragement à la recherche : il serait tout de même singulier que les parlementaires, élus au suffrage universel, ne puissent pas s'interroger sur le contenu des programmes scolaires, lequel est défini par des structures dont les membres sont désignés ou nommés.
Monsieur Barcellini, votre effort de définition de catégories a malheureusement abouti à une confusion générale car vous avez passé tous les textes à la moulinette ; dans un premier temps je vous ai suivi, puis j'ai vu beaucoup moins clair. Quant au communautarisme, il faudrait peut-être prendre le temps de le définir, pour savoir de quoi nous parlons.
Madame Fort, l'esclavage, c'est l'histoire de l'Europe, de l'Afrique, des Amériques et des Caraïbes, ce n'est pas mon histoire à moi toute seule. Je n'ai précisément pas de réflexe communautariste : nous agissons dans l'intérêt général.
Madame Mallet-Poujol, vous avez prononcé les mots « malaise » et « inquiétude » : on peut les comprendre, mais la fonction des historiens serait-elle la seule fonction sans risque d'erreur, sans risque d'être contesté ? Dans les faits, l'unique cas qu'on nous brandit constamment est celui de cet historien qui n'a pas été poursuivi, qui a publié un livre largement diffusé en édition de poche, qui enseigne à Sciences-Po et qui a été primé par le Sénat ! Il y a des personnes plus inquiétées !
Ces lois ne visent pas et n'ont jamais visé les historiens, elles visent les négationnistes militants. Qu'elles provoquent de l'autocensure, c'est dommage, mais le cas de cet historien prouve que certains n'y cèdent pas. Je suis d'accord pour privilégier la réfutation sur le terrain scientifique, mais que faites-vous lorsqu'un négationniste profite du public captif des lycées ou des universités pour faire du prosélytisme ? Au demeurant, l'article 2 de la loi Taubira encourage la recherche.
En s'appuyant sur un socle de valeurs, en prenant la mémoire et l'histoire comme des objets de droit, les actes législatifs apportent des réponses à des débats qui ont lieu dans la société. Et lorsque Mme Chandernagor, dont je connais la rigueur et l'exigence, nous dit de ne pas toucher à ce qui existe, elle prend justement en considération les bruits et les grondements de la société.
Mais nous ne légiférons pas sur les bruits et les grondements, nous légiférons en connaissance de cause et en conscience, lorsque sont en jeu la cohésion nationale et l'identité commune. L'acte législatif permet que les mémoires fragmentées deviennent la mémoire de tous.
Le débat est parfois un peu compliqué par le choix des mots. Je préfère parler de « lois historiennes », que je critique parce qu'elles sont dangereuses, plutôt que de « lois mémorielles », concept plus large. Je ne suis pas critique, et les historiens ne sont pas critiques, à l'égard des lois instituant des commémorations : le politique est alors dans son rôle ; ce n'est pas celui de l'historien de choisir des dates de commémoration, même si le politique peut s'entourer de certains avis.
Cela dit, il ne faut pas multiplier les commémorations. Gouverner, c'est choisir. Pour lutter contre l'inflation des commémorations, il faudrait pouvoir en supprimer quand on en institue – ce qui n'est pas facile. En outre, il ne faudrait pas uniquement commémorer les crimes et les malheurs, il faudrait aussi choisir des héros.
Être victime, c'est un grand malheur, ce n'est pas un honneur. Il est bon de donner en exemple aux enfants des héros. S'agissant de l'esclavage, si l'on ne veut pas retenir à nouveau Victor Schoelcher, qu'on choisisse alors Louis Delgrès ou Toussaint Louverture.
Il me semble très important de convaincre les enfants que l'on peut toujours, même en étant victime, tenter de résister. De ce point de vue, le choix de Guy Môquet n'était pas un bon choix, car ce malheureux enfant exécuté était un otage, et pas vraiment un résistant ; on aurait pu donner en exemple Sophie Scholl, lycéenne aussi, morte pour avoir lancé un mouvement de résistance dans l'Allemagne nazie.
Le Parlement est également dans son rôle pour tout ce qui relève d'une action budgétaire. Ainsi, en introduisant dans la législation la notion de « guerre d'Algérie », il a permis le versement de pensions. Il est également nécessaire de faciliter l'accès aux archives et la mise en ligne, ce qui relève d'une action budgétaire.
Une mission parlementaire pourrait par ailleurs réfléchir à l'enseignement de l'histoire, peut-être en lien avec les comités de programmes ; dans l'immédiat, il serait nécessaire de réagir à la suppression de l'obligation d'enseigner l'histoire au lycée ! Je comprends que certaines matières puissent être optionnelles, mais tout de même, l'histoire est aussi une forme d'instruction civique !
Là, le Parlement serait dans son rôle. En revanche, la recherche historique ne doit pas être stoppée au prétexte que le Parlement dirait la vérité historique, dont nous savons qu'elle est changeante : c'est d'ailleurs pourquoi on a cessé d'employer le terme de « révisionnisme » pour parler de « négationnisme », l'historien étant naturellement révisionniste en fonction des nouvelles sources découvertes et des nouveaux regards portés sur les faits.
Enfin, j'attire encore une fois votre attention sur la décision-cadre de Bruxelles très brinquebalante, très « alambiquée » comme l'a dit Mme Mallet-Poujol, et très inquiétante dans sa rédaction.
Le terme « loi scélérate », qui apparemment en a choqué plus d'un, est banal pour ceux qui ont fait de l'histoire du droit. C'est l'appellation qui a été donnée aux ordonnances de 1830 de Charles X, qui étaient des lois de censure de la presse ; depuis, est baptisée loi scélérate toute loi qui instaure un délit d'opinion. C'est une tradition de qualifier de lois scélérates les lois qui portent atteinte à la liberté de la presse.
Concernant la remarque qui m'a été faite sur le Conseil constitutionnel, je dois dire que ses membres n'ont jamais respecté leur obligation de réserve. Chaque année, le Président Mazeaud profitait de la cérémonie des voeux au Président Chirac pour dire tout ce qu'il pensait. Sur la loi Arménie, l'opinion des membres du Conseil était connue par leurs déclarations. Les membres du Conseil participant à des colloques de droit constitutionnel, où ils échangent beaucoup avec des constitutionnalistes, leur opinion est dans bien des cas un secret de Polichinelle. Les avis du Conseil d'État sont eux-mêmes parfois lus à l'Assemblée nationale ou au Sénat par des personnes qui se les ont procurés.
Personnellement, je serais pour l'abrogation de toutes ces lois. Je reconnais que la loi Gayssot est bien mieux faite que les autres, mais son effet d'entraînement et de surenchère ne peut pas être nié. De même, le Collectif DOM s'est appuyé sur la loi Taubira ; le processus est comparable avec la Charte de l'environnement et le principe de précaution. On arme le bras d'associations militantes avec des textes qui apportent ce que Philippe Muray appelait « l'envie du pénal ». Désormais, la société résout ses conflits non dans l'isoloir, mais dans le prétoire.
A ce propos, j'ai une question à vous poser : pourquoi donnez-vous systématiquement à des associations la possibilité de se constituer partie civile au pénal ? Vous privatisez ainsi le ministère public.
C'est un mépris du principe d'égalité des citoyens devant la loi : pourquoi tel intellectuel est-il poursuivi et pas tel autre ? Pourquoi Finkielkraut et pas un autre qui a dit exactement la même chose ? C'est un problème auquel vous devez réfléchir : même s'il n'y a aucune chance qu'Olivier Pétré-Grenouilleau soit condamné, il a été empêché de vivre pendant un an, il a supporté des frais d'avocat, il a subi un harcèlement épouvantable. Drôle de protection des citoyens que de les exposer ainsi à la vindicte et à des actions judiciaires infondées !
Je terminerai par une observation de droit comparé. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait plus d'antisémitisme aux États-Unis qu'en France. Or aux États-Unis, jamais la loi Gayssot ne passerait, aucune loi restreignant la liberté de la presse n'étant possible.
Le débat entre lois mémorielles et lois commémoratives se résume à la différence entre mémoire et souvenir. Aujourd'hui, nous sommes passés dans le temps de la mémoire, qui va de pair avec la judiciarisation – laquelle était totalement absente dans la politique du souvenir.
Les lois commémoratives jouent un rôle fondamental dans la création du pacte républicain. Le texte de Renan Qu'est-ce qu'une nation ? définit avec précision ce que sera la politique du souvenir ; il énonce clairement que le Parlement va jouer un rôle dans cette politique, le souvenir étant un élément fondamental d'une nation. Mais il ajoute que la nation « oublie aussi », son idée étant que nous choisissons ce qui est commun et que nous oublions ce qui n'est pas commun, c'est-à-dire ce qui est fragmenté, pour utiliser le terme de Mme Taubira.
Mais ce pacte républicain construit sur le texte de Renan est aujourd'hui mis en cause, tout simplement parce que ce texte ne convient plus. Notre politique mémorielle traduit cette remise en cause du texte de Renan – qui, entre nous, est resservi à toutes les sauces et qu'on retrouve en filigrane dans de très nombreux discours.
Pour terminer, j'appelle votre attention sur le grand bouleversement que constitue l'appropriation des politiques de mémoire par les collectivités territoriales : entre le quatre-vingtième anniversaire de 1918 et le quatre-vingt-dixième, la différence est extraordinaire. Peut-on encore parler de politique nationale de la mémoire ? Cette montée des collectivités territoriales est aussi importante à considérer que la question de la mémoire européenne.
Je serais favorable à une forme de moratoire sur les lois mémorielles, compte tenu du malaise qu'elles provoquent. Ce moratoire serait d'autant plus légitime que la possibilité est ouverte au Parlement d'adopter des résolutions. On calmerait ainsi le jeu.
Cela nous permettrait d'anticiper les éventuelles conséquences néfastes d'un texte et de réfléchir à l'opportunité de nouvelles incriminations : certaines peuvent être justifiées, mais il ne faut pas prêter le flanc à la critique en laissant croire qu'on incrimine des délits d'opinion.

Je remercie chaleureusement ceux et celles qui ont bien voulu répondre à notre invitation et je souligne la qualité, la diversité et l'audace de leurs interventions. Il n'y a pas de sujet tabou et il faut pouvoir parler de tout à l'Assemblée nationale.
Je remercie également tous mes collègues de leur assiduité. S'agissant de la mémoire, ce ciment essentiel de la nation, il est bien normal que nous puissions nous retrouver sur des analyses qui transcendent les clivages politiques.
La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.