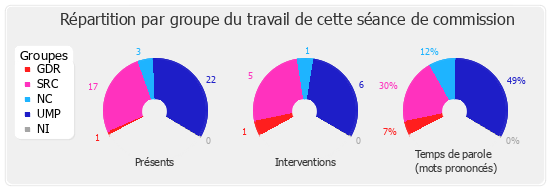Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
Séance du 25 mai 2011 à 9h45
La séance
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a entendu M. Jean-Paul Fitoussi, professeur émérite à l'Institut d'Études Politiques de Paris et directeur de recherche à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Jean-Paul Fitoussi, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris et directeur de recherche à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation.
Monsieur le professeur, c'est la première fois que notre commission vous auditionne. Nous souhaitons en effet davantage nous ouvrir sur le monde de la recherche et entendre des personnalités qui nous aident à approfondir nos réflexions.
Nombreux sont les sujets sur lesquels nous aimerions connaître votre position. Quels nouveaux indicateurs retenir dans le domaine de l'économie et en matière de développement humain ? Qu'en est-il de l'évolution des marchés internationaux ? Comment concilier développement économique et préoccupations environnementales ?
C'est un grand honneur pour moi d'être accueilli par votre commission, dont je considère qu'elle représente l'avenir des travaux du Parlement. Nous vivons en effet une rupture multidimensionnelle, dont l'aspect le plus important concerne notre capacité à avoir un développement « soutenable », et non un développement qui se brise à chaque étape sur le mur de la « soutenabilité ».
Un exemple particulièrement parlant nous est fourni par la crise que nous avons vécue. Cette crise nous dit que la croissance qui l'a précédée n'était pas soutenable. Si elle ne l'était pas, c'est tout simplement parce qu'elle était fondée sur une mauvaise évaluation du patrimoine global de l'économie.
Pendant un quart de siècle, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, 80 % des ménages ont vu leurs revenus croître à un rythme bien inférieur à la croissance – pourtant faible. La très forte augmentation des inégalités a conduit à un affaiblissement de la demande ; elle a donc été combattue par une politique monétaire expansionniste, fondée sur la baisse des taux d'intérêt. Il en est résulté, pendant une certaine période, une augmentation assez considérable de l'endettement privé. Celle-ci n'a pas suscité de grande inquiétude car dans le même temps, les marchés valorisaient les actifs de manière quelque peu exubérante. Dans le bilan de l'économie, il y avait certes, au passif, une augmentation de l'endettement, mais de l'autre côté, une augmentation de la valeur des actifs détenus. Le bilan était donc équilibré ; mais si le passif était bien réel, l'actif, lui, était illusoire… La crise s'est déclenchée lorsque le constat a été fait qu'au lieu de vivre sur nos revenus, nous vivions sur notre patrimoine : au lieu d'avoir maintenu le capital dont nous avions hérité, nous l'avions consommé – à travers l'endettement.
Cet exemple définit a contrario ce qu'est la « soutenabilité ». Une situation est « durable » – c'est le mot convenable – si chaque période livre à la suivante un capital au moins égal à celui dont elle a hérité.
Nous nous sommes fiés aux mesures données par les marchés financiers pour évaluer les actifs – donc pour évaluer la soutenabilité de la situation. Ce qui s'est passé plaide en faveur d'autres indicateurs. La Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, à laquelle j'ai participé aux côtés de Joseph Stiglitz et d'Amartya Sen, s'est employée à explorer de nouvelles voies, mais ce n'est pas simple. Au-delà du capital économique et financier, il convient d'apprécier le capital humain et le capital environnemental ; actuellement nous avons de mauvaises mesures du capital économique, nous n'avons pas de mesure du capital humain, nous en avons encore moins du capital environnemental – mais les recherches en cours devraient aboutir. Le secrétaire général de l'OCDE a promis de donner suite aux recommandations de notre commission ; le Président de la République a demandé à l'INSEE d'appliquer ses recommandations. De nombreux pays, conscients de l'enjeu, essaient d'établir une stratégie de recherche similaire – l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada – au point que ce foisonnement peut donner le sentiment d'un manque de cohérence : il ne faudrait pas que chacun invente son propre système de mesure, faute de quoi la comparaison entre les pays serait difficile.
Un deuxième exemple, celui du Japon, peut servir de métaphore des problèmes qui se posent à nous. Tout d'abord, la survenue dans ce pays d'un tremblement de terre puis d'un tsunami témoigne que la nature n'est pas spontanément amicale et que l'homme doit l'adapter à ses exigences. Il ne faut certainement pas faire de la soutenabilité une religion de la nature ! Le but n'est pas de maintenir la nature en l'état, mais de permettre le développement humain – ce qui entraîne diverses exigences, dont le maintien de certains éléments capitaux qui déterminent la capacité de bien-être des générations à venir.
En deuxième lieu, il se peut que la croissance japonaise soit glorieuse dans les années qui viennent, en raison d'un effort de reconstruction. Mais quel que soit le taux de croissance du PIB, le bien-être des populations aura nécessairement baissé : il faudra des décennies pour réparer les dégâts causés par cette catastrophe naturelle, doublée du problème nucléaire. Le PIB ne tient pas compte des destructions ; si l'on déduisait de ce produit intérieur brut le capital qui a été détruit, on arriverait à un produit intérieur « net » bien plus faible. Enfin, qu'adviendrait-il du modèle de croissance japonais si le nucléaire devait faire l'objet d'une remise en cause, si ce n'est en tant que source potentielle d'énergie, en tout cas dans le calcul de son coût ? Dans les choix qui seront faits quant au « mix » énergétique, il faudra tenir compte des dispositifs de sécurité à mettre en place, nécessairement coûteux.
Les directions explorées dans le cadre de la commission Stiglitz, ainsi que dans le livre intitulé La nouvelle écologie politique que j'ai publié avec Eloi Laurent, sont assez simples.
Première piste : réviser nos systèmes de comptabilité nationale. On sait bien, en effet, que le PIB est un instrument de mesure très approximatif : quand la violence sociale croît, le PIB croît, bien que le bien-être se réduise…
Deuxième piste : mesurer le bien-être, et cela en se fondant sur des déterminants objectifs, notamment l'emploi. On sait très bien – toutes les études le montrent – que le coût du chômage est beaucoup plus élevé que la perte de revenu due au chômage ; pourtant nous nous résignons à une situation où le chômage peut être élevé si la croissance est forte – ce qui est absolument contradictoire avec la poursuite du bien-être.
Troisième piste : mesurer la soutenabilité, en se gardant de toute naïveté, notamment en essayant de ne pas croire sans plus d'examen les discours selon lesquels nous sommes en train de consommer plusieurs planètes. Gandhi avait dit au roi d'Angleterre : il a fallu une demi-planète à votre pays pour se développer ; combien alors faudrait-il de planètes pour développer l'Inde ?

Il relève de la responsabilité des politiques, mais aussi des chercheurs, de comprendre et d'expliquer le monde actuel, de tracer une autre voie, de construire une autre société. Nous risquons malheureusement de laisser en héritage à nos enfants une terrible dette écologique, menace pour l'avenir de l'humanité. Le modèle ultralibéral propagé par la mondialisation, qui exploite les déséquilibres sociaux et utilise une énergie peu chère et très polluante, en est à nos yeux la cause. Il a montré son incapacité à répondre aux crises alimentaires, sanitaires et environnementales que connaît l'humanité depuis plusieurs décennies. Cette économie du profit, de plus en plus déconnectée de l'économie réelle, est le moteur d'une régression sociale sans précédent, dont les plus fragiles sont les premières victimes.
Le développement ne peut se fonder sur la spéculation, sur le pillage et la surexploitation de certaines ressources. Nombreux sont ceux qui aspirent à un autre projet, plus respectueux de l'homme et de la planète. Peut-être nous aiderez-vous ce matin à le préciser.

Au moment où la France assure la présidence du G8 et du G20, quelle est la place du développement durable dans les sommets internationaux ? Au début de l'année, vous avez réuni avec Joseph Stiglitz un groupe d'économistes pour évoquer avec le chef de l'État les priorités de la présidence française ; parmi les points évoqués figuraient la lutte contre le réchauffement climatique, l'aide au développement, la croissance verte et l'innovation. Pouvez-vous rappeler les propositions concrètes que vous avez formulées ?
Vous avez fait partie de la commission sur l'étude de la TVA sociale en 2007. Par ailleurs, dans ses travaux sur l'environnement, l'OFCE a consacré plusieurs études à la taxe carbone. Pourriez-vous nous présenter votre analyse de ces dispositifs controversés ?
Dans un entretien accordé en février dernier au magazine en ligne Capital.fr, sous le titre « Les politiques économiques menées actuellement conduisent à l'impasse », vous déclariez que, plutôt que de donner la priorité absolue à la réduction des déficits, la France et les autres pays européens devraient investir massivement dans des secteurs à fort potentiel – et vous citiez l'énergie. Pourriez-vous développer ce point de vue ?

Nous nous trouvons aujourd'hui devant une double exigence : il faut faire évoluer notre mode de production et, parallèlement, notre mode de vie. Nous sommes en effet confrontés au risque d'épuisement des ressources de la planète, même si la recherche scientifique et technologique – je pense en particulier à l'économie circulaire – peut apporter des solutions partielles ; nous devons donc revoir notre système économique fondé sur le profit, qui conduit à produire plus pour vendre plus. Et en même temps, il faut changer nos habitudes de vie, alimentées par la publicité, pour passer d'une société de l'avoir à une société de l'être. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que ces évolutions soient compatibles avec un système fondé sur l'argent ?

Moi qui suis un libéral, c'est-à-dire un philosophe, je voudrais rappeler à notre collègue Chanteguet, qui a évoqué l'ultralibéralisme, que la crise a trouvé son origine dans l'ultra-capitalisme et la spéculation financière, non dans l'aspiration à la liberté, telle qu'elle se manifeste notamment sur la rive Sud de la Méditerranée.
S'agissant de la mesure du capital économique et financier, ne serait-il pas temps de faire figurer, à côté des dettes publiques, les dettes privées ? On parle beaucoup de la dette américaine, mais beaucoup moins de la dette des particuliers américains ; or en cumulant les deux, on constate que ce pays est en cessation de paiements.
Quant au capital environnemental, la satisfaction des besoins alimentaires et la problématique de l'accès à l'eau, d'une part, et l'utilisation des matières premières fossiles ainsi que des terres rares qui fondent le développement technologique, d'autre part, conduisent nécessairement, même s'il y a recyclage, à l'entamer.
S'agissant enfin du capital humain, il faut soulever une question un peu taboue. Est-il raisonnable d'atteindre 9 milliards d'humains en 2050 ? Souvenons-nous de ce qui s'est passé à l'île de Pâques : après une période de développement, l'histoire s'est mal finie…

Quels sont les indicateurs de bien-être qui pourraient être retenus ? Que pensez-vous de l'économie circulaire, de l'économie de fonctionnalité, de l'économie sociale, dont le point commun est de ne pas rémunérer le capital ? Quel est selon vous l'avenir de ces formes d'économie ? Comment les valoriser au niveau mondial, au bénéfice du bien-être humain ?

Que pensez-vous du fait que la croissance soit au coeur de tous les programmes politiques, de droite et de gauche ? Comment cette croissance peut-elle s'inscrire dans un projet de développement soutenable ?
Pourriez-vous nous apporter votre éclairage sur le rôle des marchés financiers et des agences de notation, dont nous avons l'impression qu'ils dessaisissent les États et les responsables politiques de tout pouvoir de décision ?

L'endettement privé a fait la croissance et l'enrichissement de nos concitoyens. L'inflation a contribué à la valorisation des actifs et a permis d'amortir facilement cet endettement. Aujourd'hui, à cause de la crise, mais aussi du fait de la manière dont nous agissons depuis des décennies, nous vivons sur notre patrimoine plutôt que sur nos revenus. Quel est votre sentiment sur la volonté absolue de limiter l'inflation ?
S'agissant de l'évolution de notre système de comptabilité et de la prise en compte de l'environnement, avez-vous des propositions concrètes ?

Quelles que soient les difficultés de mesure du capital économique, du capital humain et du capital environnemental, il semble possible de calculer le « grignotage » du capital naturel. Ne pourrait-on en faire la base d'une nouvelle fiscalité, destinée à financer la reconstitution de ce capital ? Ne faudrait-il pas envisager de taxer non pas la valeur ajoutée, mais la valeur détruite ? L'impératif étant d'encourager tous les projets – qu'ils émanent des collectivités, des entreprises ou des individus – qui concourent au développement durable, ne serait-il pas opportun que les ressources fiscales ainsi collectées soient mobilisées dans ce but au niveau des régions ?

Très intéressant et très complexe, le sujet qui nous occupe est aussi très politique. Peut-on mettre tout cela en chiffres et en équations ? Selon les sondages, les Français ont un moral moins bon que celui des Afghans… Pourtant, la France a relativement bien surmonté la crise économique. Quant aux Japonais, leurs difficultés ne les empêcheront peut-être pas d'avoir un sentiment de bien-être dans les années à venir, parce que la nécessité de la reconstruction leur fournira un projet. Le bien-être n'a pas un caractère absolu, mais relatif. Sans contester l'idée de compléter les indicateurs économiques par des indicateurs environnementaux et humains, je crois difficile de tout traduire en indicateurs. Votre mission n'est pas simple, monsieur le professeur !

Si le principe de la « responsabilité sociale et environnementale des entreprises » avait été adopté au Japon, comme il l'a été en France, ce qui s'est produit à Fukushima n'aurait sans doute pas eu lieu : les indicateurs sociaux et environnementaux publiés par Temco auraient conduit l'opinion publique à réagir en lui demandant de réorienter ses investissements. La manière dont on établira à l'avenir la comptabilité des entreprises a donc un caractère stratégique. Mais s'il faut donner toute leur place aux grands besoins non marchands – environnement, éducation, santé –, le problème est de savoir comment financer. Faut-il prélever davantage d'impôts et de charges ? Doit-on parier sur une nouvelle gouvernance mondiale, fondée sur les nouvelles règles ? La croissance sera-t-elle suffisante pour réduire le chômage, objectif fondamental, et pour alimenter les ressources publiques afin de financer les nouvelles dépenses ?

Près d'un an après la remise du rapport Stiglitz, où en est-on de ses préconisations en matière d'indicateurs ?

Les questions dont nous parlons aujourd'hui sont débattues depuis une dizaine d'années. Ne pensez-vous pas que parallèlement, nous devons nous préoccuper d'assurer une nouvelle croissance, afin de répondre aux besoins d'une population en augmentation ? Cela passe par des efforts accrus en matière de recherche et développement.

La réforme de la comptabilité nationale doit-elle précéder la prise de conscience, ou celle-ci doit-elle l'accompagner, voire la précéder ?
La nature n'a pas seulement à être préservée pour des raisons éthiques ou esthétiques ; elle doit être considérée comme un facteur de production. Mais si l'on se préoccupe du capital parce qu'il a une rentabilité, du travail parce qu'il a une productivité, pour la nature l'approche est moins aisée. C'est pourquoi les réflexions sur la valeur économique de la biodiversité me paraissent très utiles. Quand les citoyens se rendront compte que la nature est productive, la raison les conduira peut-être à la préserver…
Une autre difficulté vient de ce que, alors que le propriétaire du capital est identifié – ce qui crée le lien entre le facteur capital et sa rentabilité –, de même que le travail est celui d'un individu – ce qui relie le facteur travail et sa rémunération –, on ne saurait dire qui est propriétaire de la nature. Il est donc plus malaisé de la regarder comme un facteur de production parmi les autres. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour ces questions passionnantes, qui sont autant de pistes de recherche pour le futur.
M. Chanteguet souhaite la construction d'une société qui ne soit pas fondée sur un modèle ultralibéral. Je veux rappeler que le libéralisme a deux aspects : le libéralisme politique, en faveur duquel je pense que nous sommes tous, fait partie des déterminants du bien-être – parmi lesquels nous rangeons la participation aux processus démocratiques et la possibilité d'influer sur les choix. Le libéralisme économique, qui est bien autre chose, est fondé sur des modèles le plus souvent fermés, c'est-à-dire ne permettant aucune projection dans l'avenir. Dans la doctrine qui préside aux politiques économiques, l'anticipation rationnelle constitue une hypothèse fondamentale, même si elle n'est pas explicitée par les hommes politiques. Or cette hypothèse, qui détermine par exemple les institutions européennes, ne vaudrait que dans un monde où ne se produirait jamais la moindre nouveauté. Une telle modélisation est contraire à la réalité du monde, tous les jours différent. C'est la raison pour laquelle je ne prends pas au sérieux le modèle du libéralisme.
Ce qui déconnecte de l'économie réelle, c'est la financiarisation de l'économie. À quoi sert le système financier ? Telle est la question que, avec Joseph Stiglitz et Amartya Sen, nous avons posée de façon récurrente. Dans la mesure du PIB, le système financier est-il un bien final ou un bien intermédiaire ? Nous pensons que c'est un bien intermédiaire, que l'on ne devrait donc pas compter dans le PIB : il n'a d'utilité que dans son rôle de médiation ; en soi, il n'est pas intéressant. Si le secteur financier fait 40 % des profits, c'est que le monde de l'économie marche à l'envers. Une régulation s'impose pour faire rentrer les marchés financiers dans le cadre dont ils n'auraient pas dû sortir. Ces marchés doivent remplir la mission d'ordre public qui leur a été confiée au service de l'économie réelle – et dont les gouvernements sont responsables. Ne pouvant pas laisser les banques faire faillite, les gouvernements donnent leur garantie ; mais le cahier des charges, resté implicite, doit devenir explicite.
Quant aux agences de notation, elles m'inspirent la plus grande incompréhension. On sait très bien qu'elles ont été co-responsables de la crise : elles notaient « triple A » Lehman Brothers à la veille de sa faillite ; elles ont donc mal orienté l'épargne et plongé les épargnants dans les difficultés. Mais elles n'ont pas le statut d'auditeur, et on ne leur reconnaît pas de responsabilité ; elles se réfugient derrière le premier amendement de la Constitution américaine : leurs évaluations sont des opinions – lesquelles sont libres. Il faudrait revenir à plus de logique et rendre les agences de notation responsables.
M. Barnier en avait parlé : pourquoi ne le fait-il pas ? On sait qu'il existe des lobbies, on sait aussi qu'aucun gouvernement ne peut attaquer une agence de notation, par crainte de voir sa note abaissée. Un Président de la République d'un pays de l'Est m'a raconté que, ayant besoin d'un emprunt, il avait fait venir trois agences de notation qui, toutes, ont tenu ce même discours : il y a le tarif normal, le tarif de luxe et le tarif super-luxe. Comprenez ce que vous voulez, a-t-il ajouté…
Il y a d'autres chemins vers le rétablissement d'une hiérarchie normale entre la finance et l'économie, dans laquelle la première soit considérée comme un moyen au service de l'économie, et non l'inverse.
La place du développement durable dans les sommets internationaux, sur laquelle m'a interrogé M. Demilly, a pour l'instant un caractère rhétorique.
Pour lutter contre le réchauffement climatique, la première solution est de taxer le mal plutôt que le bien, c'est-à-dire, par exemple, de taxer le carbone plutôt que le travail. Mais il faut une harmonisation fiscale, si ce n'est à l'échelle de la planète, du moins à celle des pays qui jouent le jeu ; le Gouvernement français a renoncé au projet de taxe carbone parce qu'elle aurait constitué un inconvénient pour la compétitivité des entreprises françaises, notamment par rapport aux entreprises allemandes. Il s'agit en fait de mettre en place une fiscalité « anti-catastrophe » – l'un des indicateurs que nous souhaitons construire étant précisément celui qui mesurerait la proximité d'un événement catastrophique. Une autre solution, le climat étant un bien public mondial, serait de créer un fonds mondial, dont la mission serait de développer les nouvelles technologies de l'énergie et de l'environnement. Il serait essentiellement financé par les pays riches, et les brevets seraient donnés gratuitement aux pays en développement – car les premiers bénéficieraient du fait que les seconds n'assoiraient pas leur développement sur une consommation énergétique aussi intense que celle qui avait permis leur propre développement.
Outre les pays de l'OCDE, on pourrait y classer les pays dont le niveau de revenu par habitant est, par exemple, supérieur à 20 000 dollars par an.
C'est un autre sujet, sur lequel je reviendrai.
M. Demilly m'a également interrogé sur la TVA sociale : j'en suis partisan, à regret, parce que je vois s'exercer une concurrence sociale et fiscale dont l'effet est d'aggraver les inégalités. J'ai montré dans des travaux récents que tous les systèmes de taxation, dans tous les pays, sont devenus infiniment moins progressifs qu'auparavant : en moyenne, le nombre de tranches d'imposition est passé de 25 à 5. Il en résulte une diminution des moyens susceptibles de financer les dépenses publiques.
Plutôt que de se fonder sur l'arithmétique des dettes et déficits publics, on pourrait se fonder sur celle des investissements rentables, capables de s'autofinancer. La croissance française d'aujourd'hui ne résulte-t-elle pas d'investissements décidés il y a trente ans, certes très coûteux, mais dont la rentabilité de longue période est très élevée ? À l'époque, on avait décidé d'investir dans les technologies les plus récentes, qu'il s'agisse du nucléaire, du TGV ou d'Airbus. Ce qui manque aujourd'hui, c'est ce courage d'avancer, dans une perspective de long terme.
Faut-il que notre mode de vie évolue, comme le demande M. Chassaigne ? En réalité, il est assez évolutif – la mode ne cesse de changer. Le désir d'identification et de reconnaissance s'appuie sur une différenciation qui croît avec les inégalités ; dans ce contexte, le jeu des marques contribue à un excès de consommation. On ne peut pas faire une leçon de morale au sujet d'un problème économique, mais je pense que les individus consommeraient différemment dans une société moins inégalitaire. Je ne prône pas l'égalité ; je suis pour des inégalités démocratiquement acceptées, légitimées par le mérite et non par la rente. Si l'on n'avait pas le sentiment d'une société de rente, les modes de vie et de consommation seraient fort différents.
Les exigences excessives en matière de retour sur fonds propres ne sont que l'un des symptômes de la financiarisation de l'économie. Chacun sait que sur longue période, le rendement moyen ne peut pas être supérieur au taux de croissance ! Les exigences d'un rendement à deux chiffres sont contraires à la réalité ; elles ne peuvent être satisfaites que dans de très courtes périodes. Elles empêchent de se préoccuper du futur donc font délaisser l'investissement – qui est une projection sur l'avenir. Le « court-termisme » nous empêche de construire le futur ; c'est ce qui me paraît le plus dramatique dans la situation actuelle, outre la croissance des inégalités qui est, à mes yeux, le symptôme d'une régression démocratique. Heureusement que la révolution dans le monde arabe vient affirmer le besoin humain de démocratie.
J'en arrive à la question de M. Paternotte sur les dettes publiques et les dettes privées. Je viens de terminer sur le sujet un travail que je tiens à votre disposition, portant sur un ensemble de pays. L'évaluation de la dette publique n'a pas beaucoup de sens : le problème est de calculer la dette nette ou le patrimoine net de la nation ; pour cela, il faut évidemment agréger dette publique et dette privée, patrimoine public et patrimoine privé. Imaginons un État qui décide de ne pas faire payer d'impôts, pour permettre aux habitants d'accumuler de l'épargne et d'acquérir un patrimoine ; cet État sera très endetté, mais les citoyens seront très riches. Un autre État peut décider au contraire de financer l'ensemble des dépenses publiques par l'impôt : les citoyens seront plus pauvres, mais l'État sera moins endetté. C'est en considération de ce lien que la soutenabilité d'une situation financière peut être appréciée. En Italie, le niveau très élevé de la dette publique s'accompagne d'un patrimoine privé très important – résultant notamment d'une pratique d'évasion fiscale – : le patrimoine net est neuf fois plus élevé que le PIB. Il est huit fois plus important que le PIB en France – qui est donc riche aussi. Il est indispensable d'agréger secteur public et secteur privé pour juger d'une situation financière dès lors qu'in fine, le secteur privé paiera les impôts nécessaires à la soutenabilité de la dette publique.
En ce qui concerne le capital humain, il faut distinguer la question du nombre et celle de la qualité. Nous allons vers un pic démographique de 9 milliards, mais ensuite la population mondiale ira décroissant.
Mme Gaillard m'a interrogé sur les indicateurs de bien-être. Jusqu'à présent, nous avons mesuré le bien-être par le PIB. On ne peut pas nier qu'il existe une certaine corrélation entre les deux, mais la question est de savoir si ce que nous mesurons dans le PIB est correct. Aujourd'hui, le PIB est composé à 80 % de services. Parmi eux, tous ceux qui sont assurés par les autorités publiques – éducation et santé par exemple – sont mesurés dans le PIB par la dépense correspondante ; on n'en mesure pas du tout la qualité. Or aujourd'hui, l'essentiel de notre croissance économique vient d'une amélioration qualitative, non d'un accroissement quantitatif. Les « prix hédoniques » visent à considérer une amélioration de qualité comme une augmentation de production. Nous intégrons déjà, pour un certain nombre de biens, cet effet qualité ; pour les services, nous ne savons pas le faire. Le fait qu'aux États-unis la dépense de santé représente 16 à 17 % du PIB, alors qu'en France elle représente 11 %, pourrait laisser penser que les Américains sont mieux soignés que les Français ; mais lorsqu'on essaie de retenir des indices de production, on aboutit au résultat inverse. Plus d'un tiers de la différence de niveau de vie entre la France et les États-unis est dû à la mauvaise mesure des systèmes de santé.
Une étude qui a été faite de façon tout à fait indépendante par le Bureau of Economic Analysis, équivalent américain de notre INSEE, a montré qu'après correction du PIB par des éléments figurant dans notre rapport, le niveau de vie français apparaissait très proche du niveau de vie américain – 95 %, au lieu de 70 % selon les chiffres du PIB.
D'ores et déjà, la qualité est un élément important de nos consommations. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) sont peu coûteuses en termes environnementaux. Elles devraient permettre des économies, non seulement de forêts, mais aussi de déplacements. C'est la raison pour laquelle Éloi Laurent et moi-même avions proposé de créer la Communauté européenne de l'énergie, de l'environnement et de la recherche : l'Europe peut fonder sa croissance sur ce qu'elle sait le mieux faire, en termes institutionnels et en termes industriels – car il s'agit peut-être du seul secteur où elle n'est pas en retard pour l'instant. Le lancement de la Communauté européenne du charbon et de l'acier était d'une intelligence exceptionnelle : on mettait en commun les moyens de la guerre. Si nous voulons refonder l'Europe, il nous faut avoir une ambition du même ordre ; la recherche doit être associée à l'énergie et à l'environnement, à la fois pour concrétiser le programme de Lisbonne et parce qu'il faut développer la recherche dans ces deux domaines. Le marché est mondial ; la création de cette communauté non seulement donnerait un coup de fouet à l'activité européenne, mais permettrait à l'Europe d'être à nouveau présente dans le monde en matière industrielle. Pourquoi ne le fait-on pas ? Je n'arrive pas à comprendre que depuis plus cinq ans, cette idée ne soit toujours pas concrétisée…
J'ai apprécié la question de Mme Branget sur l'inflation. Avec quelques amis, j'avais créé aux États-unis le club des inflation lovers. La religion du taux d'inflation bas a quelque chose de désolant. Dans les années soixante et soixante-dix, l'inflation a été un moyen formidable d'accès des classes moyennes aux biens durables. Ce moyen avait tenu sous tutelle les marchés financiers : la rémunération versée par les emprunteurs était, en valeur réelle, très faible. Je ne demande pas le retour à cette époque, mais il faut oser se poser la question de niveau d'inflation : après tout, avec un taux d'inflation de 3 %, nous serions peut-être tous beaucoup plus heureux, et l'économie réelle serait peut-être beaucoup plus facile à restructurer.
Oui, monsieur Lesterlin, il faut tenir compte de la destruction de capital, donc essayer de la mesurer, mais il n'y a pas de marché ; il faut bien, donc, que pour les biens naturels nous nous accordions sur un système de prix.
Non, monsieur Boënnec, tout ne peut pas se mettre en équations. Il s'agit de questions éminemment politiques. L'économie est politique. Quant à la « science économique », elle est née du complexe d'économistes qui voulaient se dire aussi scientifiques que les praticiens des mathématiques ! Mais ceux qui connaissent les mathématiques sont pour l'économie politique.
S'agissant du message à faire passer aux citoyens, Éloi Laurent et moi-même avions réalisé un e-book de campagne à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007.
Oui, pourquoi pas ?
J'espère que vous défendrez l'idée de construire une Communauté européenne de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. L'Europe va mal, donnons-lui un projet.
Membres présents ou excusés
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Réunion du mercredi 25 mai 2011 à 9 h 45
Présents. - M. Jean-Pierre Abelin, M. Yves Albarello, M. Philippe Boënnec, M. Maxime Bono, Mme Françoise Branget, M. Jean-Paul Chanteguet, M. André Chassaigne, M. Frédéric Cuvillier, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Stéphane Demilly, M. Raymond Durand, M. Paul Durieu, M. Philippe Duron, M. Albert Facon, M. Daniel Fidelin, M. André Flajolet, M. Jean-Claude Fruteau, Mme Geneviève Gaillard, M. Alain Gest, M. Jean-Pierre Giran, M. Daniel Goldberg, M. Didier Gonzales, M. François Grosdidier, M. Serge Grouard, M. Armand Jung, M. Jacques Kossowski, M. Pierre Lang, M. Thierry Lazaro, M. Jacques Le Nay, Mme Christine Marin, M. Philippe Martin, M. Bertrand Pancher, M. Yanick Paternotte, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, M. Philippe Plisson, M. Christophe Priou, Mme Catherine Quéré, Mme Marie-Line Reynaud, M. Martial Saddier, M. Philippe Tourtelier
Excusés. - M. Jean-Yves Besselat, M. Jérôme Bignon, M. Jean-Claude Bouchet, M. Christophe Bouillon, M. Christophe Caresche, Mme Claude Darciaux, M. François-Michel Gonnot, M. Michel Havard, M. Antoine Herth, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Jean Lassalle, M. René Rouquet, M. Max Roustan, M. Jean-Marie Sermier, M. André Vézinhet
Assistaient également à la réunion. - M. Bernard Lesterlin, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Francis Saint-Léger