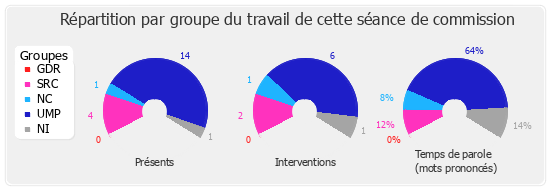Commission des affaires étrangères
Séance du 13 juillet 2010 à 11h00
La séance
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
La séance est ouverte à onze heures.

Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, dans le cadre des travaux que nous menons sur les perspectives économiques de l'Europe et de la zone euro et en prévision de la prochaine présidence française du G20.
Mais je tiens d'abord à vous demander, monsieur le président et mes chers collègues, de bien vouloir m'excuser de l'erreur d'horaire que j'ai commise lors de l'audition prévue le 30 juin dernier.
Vous êtes récemment intervenu, monsieur le président, dans le débat public pour vous inquiéter des difficultés à mettre en oeuvre votre mission de régulateur des marchés financiers en l'absence de moyens renforcés, et pour donner votre appréciation sur la situation économique de la zone euro. Vous avez plaidé en faveur d'une plus grande gouvernance européenne, estimant que l'Union devait évoluer vers davantage de simplification et d'intégration. Vous avez également considéré que le gouvernement économique de l'Union, avant de s'étendre à l'économie de ses vingt-sept États membres, devait d'abord se construire au sein de la zone euro. À cet égard, vous avez estimé que les réformes structurelles accomplies en Allemagne pouvaient être prises en exemple. Tous les pays de la zone euro peuvent-ils suivre ce modèle, qui fait reposer la croissance sur les exportations à destination, principalement, des autres pays européens ? Vous avez aussi considéré qu'une opacité excessive prévalait encore sur les marchés financiers en Europe et qu'il fallait agir plus rapidement en face des Américains, sans quoi nous risquerions de nous retrouver dans la dépendance des règles qu'ils auront édictées de leur côté.
La France doit prendre, en 2011, la présidence du G20. Aujourd'hui, les États-Unis prônent une relance massive, les Européens préconisent des avancées plus franches en matière de régulation et les Asiatiques se contentent de solutions minimales dans ces deux domaines.
Les Européens peinent à imposer l'idée d'une taxation générale sur les revenus bancaires, alors même que les établissements financiers ont été à l'origine de la crise actuelle et n'ont pas, depuis lors, modifié significativement leurs pratiques. Comment devrions-nous orienter les travaux du G20 pour faire émerger une vision commune ?
C'est toujours un plaisir de venir devant la Commission des Affaires étrangères de votre assemblée.
Les questions que vous m'avez posées, monsieur le président, me paraissent révélatrices de l'évolution récente de la situation économique et financière. Je ne crois pas, en effet, qu'on m'eût posé les mêmes il y a un an.
Certes, mais on ne se serait pas interrogé, il y a un an, sur la fin de l'euro, sur la façon dont l'Europe économique doit être gouvernée et sur les autres difficultés que vous avez évoquées, monsieur le président. On se disait alors que l'Europe capitaliserait sur de nombreux atouts : un nouveau traité, des présidences allemande puis française réussies, avoir été le moteur des premiers G20.
Aujourd'hui, l'état des lieux de la zone euro n'est guère réjouissant même si certains espèrent que le plus dur est derrière nous. Que le pire de la crise soit passé ou non, il est urgent que la maison Europe se remette en ordre. Enfin, que peut faire l'Europe sur le plan de la méthode comme sur le fond, qu'il s'agisse d'opacité, de régulation ou de taxation ?
L'état des lieux de la zone euro n'est pas très réjouissant. Les données macro-économiques sont claires et fournissent la mesure des tensions qui l'affectent : la crise a ébranlé son système institutionnel, politique et économique.
Les marchés restent très volatiles. Depuis le début du mois de juin, alternent des périodes de relative accalmie, avec des envolées ou des plongées brutales des marchés. Au total, depuis le 1er janvier, le CAC a perdu environ 13 %. Les indices boursiers mondiaux font apparaître une baisse de 11 %. Plus préoccupant pour le régulateur : la valorisation de près d'un tiers des sociétés du CAC 40 est aujourd'hui inférieure à leurs fonds propres.
Les marchés craignaient que la timide reprise économique ne soit étouffée par l'excès d'endettement public ou privé dans certains pays d'Europe. Il est vrai que les prévisions de croissance de la zone euro pour l'année 2010 restent très modestes par comparaison avec des pays tels que la Chine, qui avoisine les 12 %, ou même le Japon, qui n'est pas réputé bénéficier d'une croissance très forte, mais où elle atteint cependant 4,9 %, voire les États-Unis, qui sont autour de 3 % de croissance. Fin juin, la prime de risque sur les Credit Default Swap (CDS) grecs souverains à cinq ans avait atteint des niveaux jamais égalés, et, fait nouveau, le risque pays est désormais pris en compte par les investisseurs qui souscrivent les emprunts des entreprises et des banques européennes. Vous avez donc maintenant une corrélation entre le taux demandé sur les dettes souveraines et le taux sur les dettes d'entreprises.
Face à cette situation, des mesures d'austérité budgétaires sont intervenues, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Elles reposent sur des bases pluriannuelles, ce qui offre une certaine visibilité.
Le fait que les autorités grecques aient réduit leur déficit budgétaire a également favorisé une certaine détente sur les taux et sur les CDS depuis le début du mois de juillet.
La Banque centrale européenne a mis en oeuvre des mesures de transparence qui me paraissent justes, telles que les stress tests, même s'ils sont intervenus avec retard en Europe.
Par ailleurs, les interventions de la Banque centrale européenne qui totalisent 132 milliards d'euros, permettent de soutenir les perspectives bancaires. Il est important de noter que ces concours sont moins élevés que prévus, ce qui traduit une phase d'amélioration.
Toutefois, il faut se garder d'un trop grand optimisme car la volatilité de la situation actuelle ne permet pas d'écarter les scenarii en W, alternant hausses et baisses des cours, et considérés comme les plus vraisemblables par les experts.
L'euro se situe aujourd'hui à 1,26 dollar, soit une hausse de 6 % par rapport à son point le plus bas qui était de 1,19 dollar, observé le 7 juin dernier. Je rappelle qu'il était de 1,60 dollar il y a un an. Les craintes autour de l'euro sont paradoxales car celui-ci est un formidable amortisseur de la crise financière. C'est, en effet, une devise qui reste très attractive : sa part représente encore entre 25 et 30 % des réserves internationales. Les statistiques du FMI du premier trimestre montrent que les gérants des réserves de change n'ont pas cherché à se défaire de leurs euros pour acheter des dollars.
Je ne suis donc pas inquiet sur l'évolution de l'euro. Toutefois, c'est aussi une monnaie sans Etat et qui, faute d'intégration politique, pâtit d'un manque de gouvernance économique et monétaire, que l'urgence a trop souvent suppléé. Rien n'était prévu dans les traités pour assumer autour de la Banque centrale européenne (BCE) une supervision financière susceptible de prévenir les risques systémiques. Il n'existait pas non plus de réel mécanisme de solidarité visant à aider les États en quasi faillite. Ce défaut de gouvernance a immanquablement provoqué une nouvelle confrontation entre les pays les plus vertueux, comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et les pays scandinaves, et ceux souhaitant poursuivre une politique plus active de relance publique. De là ont résulté des tensions assez fortes sur la zone euro, aggravées par le fait que les différents pays d'Europe connaissent des situations différentes : celle de la Grèce n'est pas celle de l'Espagne, qui est elle, caractérisée par une prédominance de l'endettement privé. En Allemagne, c'est la situation des banques régionales qui inquiète…
Un certain « retard à l'allumage » de la part des gouvernements de la zone euro, notamment de l'Allemagne, a fait le jeu des anticipations à la baisse des marchés, qui ont ainsi profité du manque prolongé de coordination politique des États. J'en donnerai trois exemples.
Premièrement, nous n'avons toujours pas trouvé d'accord sur le traitement des hedge funds ayant des activités off shore dans le cadre de la négociation de la directive sur les hedge funds. De ce fait, ceux-ci ne sont toujours pas régulés par une directive européenne.
Deuxièmement, voilà plus d'un an que Jacques de Larosière a proposé un « paquet » sur la supervision financière, adopté en juin 2009 par les chefs d'États et de gouvernements. Or nous ne disposons toujours pas d'une agence de supervision européenne pour la banque, pas plus qu'il en existe une pour l'assurance ou pour les marchés ; il n'y en aura pas avant 2011 alors qu'un accord politique s'était dégagé il y a deux ans.
Troisièmement, enfin, des mesures unilatérales sont intervenues. Ainsi, le fait que les Allemands aient interdit de façon unilatérale les ventes à découvert pose un problème. Ce n'est pas une bonne mesure sur le plan technique car ces mêmes ventes s'opéreront sur d'autres places internationales que les places allemandes. C'est aussi un très mauvais signal politique car ce type de mesure doit être pris au niveau européen ou, à tout le moins, dans la zone euro, voire au niveau franco-allemand.
En bref, le résultat de ces flottements et de ces atermoiements est que nous sommes arrivés au G20 de Toronto avec l'image d'une Europe unie sur les moyens – la taxation des activités de marchés quelles qu'en soient les modalités – mais pas sur les objectifs d'organisation et de régulation des marchés. Au même moment, le Congrès américain se mettait d'accord sur un paquet historique – dont on peut certes contester la portée car elle n'est pas celle qu'avait annoncée le président des États-Unis – de refonte de la régulation financière, donnant à ce pays un avantage important pour prendre le leadership en la matière. Le G20 de Toronto l'a montré, l'Europe a pris du retard et a perdu de l'influence : ses idées de taxation n'ont pas été suivies par ses partenaires, américain et asiatiques notamment.
L'Europe doit donc remettre vite en ordre sa maison, et ce pour deux raisons.
D'abord, nous assistons à un déplacement formidable du centre de gravité des richesses, des pouvoirs et des activités au profit de l'Inde, du Brésil et de la Russie, qui représentent ensemble 25 % des terres habitables, 40 % de la population, 15 % du produit intérieur brut mondial et 40 % des réserves monétaires. Ils sont aussi les principaux financeurs de notre dette – il faut en avoir conscience. Mais pour eux, l'Europe n'incarne pas encore une réalité. Or, ils attendent beaucoup de la politique et de la coordination européennes car une partie de leur développement est liée à cette zone qui reste un très grand bassin d'épargne, possède une forte solvabilité et a un pouvoir d'achat élevé. Ces pays veulent une Europe non seulement plus lisible, mais aussi plus coordonnée et mieux structurée. Paradoxalement, tout se passe comme si ces pays nourrissaient plus d'ambition pour l'Europe que l'Europe n'en a pour elle-même.
Ce rééquilibrage de la planète pose un problème à l'Europe car, jusqu'à présent, elle avait réduit, dans les G7 puis les G8, ses relations à un tête-à-tête avec les États-Unis. Or, avec l'apparition des grands pays émergents dans le G20, l'Europe doit s'adapter à un nouvel environnement idéologique car, depuis la crise financière, nous n'avons plus de leçons de capitalisme à donner, notamment aux pays asiatiques. Elle doit aussi s'adapter sur le plan psychologique car nous ne pouvons plus nous définir exclusivement par rapport aux États-Unis ; les grands pays émergents, très heureux désormais de faire partie du club dont ils ont payé le droit d'entrée politique, sont assez indifférents aux règles que l'on peut fixer dans le domaine financier. Enfin, il nous faut nous organiser sur le plan pratique afin de répondre à une demande simple de nos partenaires tiers : qui est responsable pour l'Europe ? Quel est l'interlocuteur européen ? Nous avons besoin d'une plus grande unité de décision.
Nous devons également nous montrer plus réactifs parce que les marchés financiers sont devenus les juges de paix de la zone euro et, plus largement, de l'Union européenne – et c'est la deuxième raison pour laquelle nous devons réagir. Si l'on fait exception de la « re-régulation » qui a suivi la faillite de Lehman Brothers, les marchés gagnent en influence dans tous les pays. Le fait qu'ils soient fragmentés n'érode en rien leur capacité d'intervention transnationale et même globale. En revanche, leur opacité n'a en rien diminué depuis deux ans, ce qui pose un défi supplémentaire aux États qui peinent à interpréter les mouvements de ces marchés et, a fortiori, à encadrer ces derniers.
Deux phénomènes jouent à cet égard. Le premier tient à nous-mêmes : le marché unique européen nous soumet davantage aux pressions commerciales et financières, d'où qu'elles viennent. C'est le jeu de la compétition et de la libre circulation des capitaux. Les États sont aujourd'hui en partie tributaires des décisions de fonds de pensions ou de fonds souverains. Le second phénomène est lié à la part croissante dans la richesse nationale de l'industrie financière : les produits financiers représentent 12 % du PIB au Royaume-Uni, 6 à 7 % en France, soit davantage que notre valeur ajoutée agricole. La France est maintenant devenue une puissance bancaire et financière supérieure à l'Allemagne.
La montée en puissance des marchés est également liée à celles de l'endettement et des déficits publics. C'est pourquoi, il faut les réduire. Plus vous êtes endetté, moins vous disposez de marges et plus vous êtes dépendant des prêteurs, c'est-à-dire des marchés, sachant que les fonds dont vous allez disposer sont d'origine essentiellement étrangère. De plus, à un certain moment, vous êtes confronté à une limite qui vous empêche d'emprunter davantage.
Si nous avons besoin de plus d'Europe économique et financière, c'est parce que nous devons répondre aux interrogations des marchés sur la « soutenabilité » de la zone euro, mais aussi pour mieux nous armer dans le rapport de force qu'ils nous imposent. Il suffit de dire quand, comment, à quel rythme, nous allons réduire nos déficits, comme l'ont fait nos partenaires anglais et allemand. Les marchés sont attachés à ce que nous fixions, pour cela, un cadre prévisionnel et pluriannuel.
Que peut-on donc faire, sur la forme comme sur le fond ?
Nous devons d'abord partir du postulat qu'il n'y aura pas de relance de la dynamique européenne sans le moteur franco-allemand. Bien sûr, France et Allemagne, Français et Allemands, en dépit du traité de l'Elysée, restent très différents dans leur organisation politique et dans leur psychologie collective. Mais, malgré tout ce qui nous sépare, force est de constater que la France et l'Allemagne ont un intérêt objectif à travailler ensemble à la consolidation de l'espace économique et monétaire européen. Nos deux économies représentent ensemble 50 % du PIB de la zone euro. Elles reposent l'une et l'autre sur un socle industriel assez fort, ce qui les distingue d'autres pays européens, notamment du Royaume-Uni. L'Allemagne a besoin du marché intérieur européen, et c'est grâce à l'euro qu'elle jouit d'un environnement économique stable. Quant à la France, elle a besoin de l'Europe et de l'euro pour garder l'influence politique qu'elle a toujours ambitionnée en Europe et au dehors ; elle lie donc son sort à une Europe forte, qui n'a pas de sens que si l'Allemagne y prête son concours. Enfin, nos deux pays ont une même vision d'une économie régulée, sociale de marché, qui s'oppose à une vision plus « anglo-saxonne ». Il faut donc une volonté partagée, une intimité forgée, des projets communs, une confiance retrouvée dans les domaines économique, budgétaire et financier, laquelle fait encore aujourd'hui défaut, dès que les tête-à-tête entre le Président et la Chancelière sont achevés – je suis moins inquiet par ce qui est dit du tempérament de l'un et de l'autre que par le fait que tout remonte à leur niveau, y compris une question comme celle du régime des ventes à découvert, ce qui pose le problème de la concertation technique qu'il nous faut entretenir avec l'Allemagne et qui doit dépasser le cadre de la coopération traditionnelle.
Au-delà de la nécessité du moteur franco-allemand, il faut capitaliser sur les progrès enregistrés ces derniers mois pour consolider l'Union économique et monétaire. L'idée d'une forme de fonds monétaire européen est une bonne chose. Il est important, à la suite de l'accord trouvé le 9 mai sur la création d'un Fonds européen de stabilité financière, d'activer ce mécanisme. Je suis heureux d'entendre dire qu'il pourrait servir à soutenir les banques – il ne s'agit pas d'aider les banquiers, mais si nous ne répondez pas aux interrogations des marchés sur la recapitalisation de certaines banques, vous entretenez l'idée de possibles risques systémiques dans le cadre de la zone euro.
Il faut aussi conserver les méthodes d'intervention des banques centrales, notamment de la BCE.
Enfin, il convient d'introduire de nouveaux modes de gouvernance. Des progrès en matière de surveillance budgétaire ont été actés lors du Conseil européen du 17 juin. Les États devront présenter, à partir de 2011, des programmes de stabilité et de convergence pour les années suivantes, dans le cadre d'un « semestre européen ». S'agissant de la coordination économique, les Vingt-sept ont souhaité qu'un tableau de bord permette de mieux évaluer l'évolution et les déséquilibres en matière de compétitivité et de déceler rapidement les tendances non viables ou dangereuses. De même, un cadre de surveillance efficace qui tienne compte de la situation particulière des États membres de la zone euro devra être mis en oeuvre.
Cette nouvelle gouvernance aurait tout intérêt à se développer d'abord dans la zone euro. Toutefois, l'essentiel de ce qui a trait à la régulation financière ne peut être réalisé que dans le cadre de l'Union à vingt-sept, car vous ne pouvez en discuter sans les Britanniques, qui représentent la première puissance financière en Europe. Sur ce débat des Seize et des Vingt-sept, je dirai, en reprenant une formule fameuse, que la Chancelière a sans doute juridiquement raison…
… mais qu'elle est politiquement trop prudente. En effet, là encore, nos partenaires tiers nous demanderont davantage de lisibilité, de gouvernance et de coordination, d'abord au sein de la zone euro et ensuite pour les Vingt-sept – il ne faut pas inverser cet ordre de priorité.
Enfin, en matière de régulation, je plaide très fortement pour la mise en place rapide d'une Agence européenne de surveillance des marchés. Ceux-ci sont aujourd'hui très fragmentés, opaques, mais ils constituent des éléments incontournables de la régulation et de notre mode de fonctionnement économique, et même social compte tenu de leur poids dans le financement de nos dettes, publiques et privées. Il nous faut donc un gendarme européen au regard de leur développement technologique et de leur sophistication. Il faut savoir que 50 % des transactions internationales échappent à notre vision et que, sur les 50 % qui restent, nous ne pouvons en surveiller efficacement que les trois quarts. Le rythme des transactions est tel, parfois à la microseconde, qu'il faudrait disposer d'outils de surveillance qui ne peuvent se concevoir qu'au niveau européen ; le problème se pose de la même façon aux États-Unis. Les textes que l'on peut adopter en la matière, tel celui relatif à la régulation bancaire et financière qui vient d'être voté ici en première lecture – et qui est un bon projet de loi –, doivent s'appuyer sur des moyens de surveillance adaptés pour être efficaces.
L'Europe économique et financière doit donc réaliser des progrès pour asseoir son modèle de régulation et continuer, comme elle l'avait fait jusqu'à présent, à orienter les travaux du G20. Ce sera crucial durant la présidence française – le Président de la République l'a rappelé hier soir. Les enjeux sont de trois ordres : le premier est d'ordre monétaire ; le deuxième porte sur la régulation des marchés, notamment des matières premières et du CO2; le troisième, enfin, est relatif à une nouvelle organisation des marchés financiers. S'agissant de la taxation des activités de marché, j'y suis favorable dès lors qu'on en détermine la bonne assiette ; qu'elle intervienne au niveau européen ou multilatéral importe assez peu, car il faut bien commencer quelque part. En tout cas, cela ne suffira pas à épuiser le projet de la présidence française du G20 en 2011.
Il importe que nous conservions notre capacité d'influence non seulement face aux États-Unis, en comblant notre retard en matière de régulation et d'organisation des marchés, mais aussi face aux grands pays émergents. Il faut savoir que, ce matin, une agence de notation chinoise a décidé de dégrader les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ! Certes, il s'agit d'un acte symbolique mais il est politiquement révélateur : il signifie qu'on nous adresse un signal indiquant que le jeu ne sera plus le même qu'avant et que nous ne plus les seuls à maîtriser les règles du jeu. Nous devons donc nous adapter à cette nouvelle donne.

Si l'on en croit les spécialistes, l'absence de gouvernance économique pourrait mettre en péril la pérennité de l'euro. Les Français et les Allemands ne semblent pas avoir la même approche, Mme Merkel paraissant avoir réussi à imposer une forme de gouvernance à Vingt-sept. L'objectif de l'Allemagne n'est-il pas ainsi de peser seule sur cette gouvernance ? N'est-ce pas, de sa part, une stratégie à moyen terme, tant qu'elle considérera que la majorité des pays de la zone euro n'ont pas encore accompli les réformes nécessaires en matière de compétitivité et de contrôle des déficits publics pour « rentrer dans le rang » ?
Je partage votre sentiment. Nous entrons dans une nouvelle ère : celle de l'affirmation par l'Allemagne de son leadership dans les domaines économique, financier et politique. J'en veux pour preuve ce que j'entends sur les nominations à venir dans les institutions européennes : le nouveau secrétaire général du Conseil européen sera allemand et il est possible que le successeur de l'actuel président de la BCE soit aussi allemand, comme l'est déjà le directeur du nouveau Fonds européen de stabilité financière (FESF). Que ce soit dans le monde politique ou dans celui de l'entreprise, les nominations ne sont jamais neutres.
Je crois que l'Allemagne a besoin de l'euro et qu'elle y est attachée. Je suis frappé, à la lecture de la presse économique allemande, ou des travaux académiques allemands et des opinions de personnes proches du Conseil des sages, par le fait que soit ouvertement évoquée l'hypothèse d'une zone euro plus restreinte que celle d'aujourd'hui, assortie d'exclusions éventuelles des pays qui se comporteraient mal. Heureusement, cette idée n'a pas encore été exprimée au niveau politique. L'Allemagne étant probablement disposée à une certaine gouvernance de l'euro, on pourrait imaginer un trade off entre les mesures de stabilité qui sont nécessaires – la pression est telle qu'il faut de toute manière s'engager dans la voie de l'assainissement des finances publiques dans plusieurs pays – et le fait qu'une personnalité incarne l'Eurogroupe, et coordonne les politiques économiques et les projets nouveaux en la matière. Il faudrait obtenir de notre partenaire allemand la désignation de quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle. Actuellement, il est difficile de dire comment le président de l'Eurogroupe, M. Jean-Claude Juncker, et le président du Conseil européen, M. Hermann Van Rompuy, se répartissent les tâches avec le président de la Commission européenne. Cette confusion doit cesser.

Nous nous rejoignons sur la nécessité d'une régulation financière, quel que soit le système monétaire : à partir du moment où les transactions sont internationales, il faut un certain nombre de règles, tant au niveau européen qu'au niveau mondial. Or nous rencontrons un problème politique pour parvenir à mettre de l'ordre dans la jungle financière, compte tenu notamment de ce que vous avez dit sur la rapidité des transactions et sur la part de celles qui échappent à tout contrôle. Depuis vingt ou trente ans, l'équivalent de la masse monétaire mondiale change de mains tous les vingt jours. À défaut de rétablir un contrôle des changes, comme cela avait été envisagé par M. Camdessus lors de la crise économique birmane, que peut-on faire ? Sans aller jusqu'à créer une agence financière européenne, on pourrait imaginer la mise en place d'une institution commune s'appuyant sur les agences nationales, lesquelles lui serviraient de relais
Les Allemands se font des illusions s'ils croient pouvoir imposer leur vision à l'ensemble de l'Europe, ne serait qu'en raison de leur problème démographique majeur : l'Allemagne va perdre de huit à quatorze millions d'habitants dans les vingt à trente années qui viennent. Ce problème qui doit tarauder ses dirigeants explique peut-être une partie de son attitude.
Je crains que vous ne soyez gagné par la passion de l'euro – c'est d'ailleurs là que nous divergeons. L'euro est une monnaie inadaptée aux déséquilibres que nous connaissons en l'absence de zone économique optimale.
Vous plaidez en faveur de la recapitalisation des banques, éventuellement par le biais du Fonds européen de stabilité financière (FESF), mais les moyens dont il dispose – 750 milliards au total – sont insuffisants pour faire face aux besoins : ainsi, la dette souveraine s'élève à au moins 500 milliards pour les trois ans qui viennent, montant qui doit être doublé si l'on tient compte des besoins de recapitalisation des banques. À cela s'ajoute le fait que les Allemands ne veulent pas s'engager au-delà de leur contribution au FESF, qu'ils n'entendent pas être solidaires de leurs partenaires et qu'ils sont hostiles à une « Union de transferts ». Dans ces conditions, le système devient ingérable.
Vous avez dénoncé à juste titre le comportement des marchés. Mais le fait de demander des garanties a pour conséquence une augmentation des taux. En fait, la solution réside dans la monétisation de la dette, c'est-à-dire par la sortie du système monétaire et de celui de la dette publique des griffes du marché. On me rétorquera que je préconise le recours à la « planche à billets ». Mais, dans les années cinquante, c'est ainsi que le président Truman a réussi à désendetter les États-Unis. De plus, contrairement à une idée reçue, cela n'empêche pas les investissements. Faute de quoi, le système explosera. Dans ce cas, j'espère que nous ne finirons pas dans la même zone monétaire que l'Allemagne car cela signerait notre arrêt de mort.

On perçoit bien, en vous écoutant, l'ampleur des différences économiques au niveau mondial, ainsi que les effets de l'absence de gouvernance mondiale sur les marchés.
Vous avez plaidé pour une meilleure gouvernance européenne reposant sur la zone euro et sur le couple franco-allemand. Or, il ne faudrait pas oublier que la place financière de Londres, dont chacun connaît l'importance considérable, n'est pas dans la zone euro. D'où ces questions : quelle est la force respective des différentes places financières européennes ? Comment peut-on enclencher une gouvernance économique en partenariat avec la place Londres ? En dernier lieu, l'arrivée au pouvoir de M. Cameron a-t-elle eu ou aura-t-elle, selon vous, une incidence ?

Il me paraît urgent d'instaurer une autorité bancaire européenne pour faire face au basculement de la puissance économique et financière vers les pays émergents. Nous devons prendre conscience de cette situation très inquiétante et réagir avant qu'il ne soit trop tard.
En ce qui concerne les agences de notation, que pensez-vous de leur fiabilité et quel est, selon vous, leur impact sur les économies nationales et sur certaines évolutions ?
Non contentes de s'être livrées à des opérations spéculatives hasardeuses, comme le montrent leurs résultats, les banques ne soutiennent pas les PME, les PMI et les TPE comme elles le devraient. Elles prétendent le contraire, mais les entreprises éprouvent toujours autant de difficultés pour trouver les crédits dont elles auraient besoin. Ce sont pourtant elles qui créent des ressources et de la richesse dans notre pays, et participent ainsi à son redressement économique et financier. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Nous avons besoin d'une agence financière européenne agissant en liaison avec les régulateurs nationaux. Elle doit instaurer des règles communes, afin que l'on joue le jeu de la même façon à Londres, à Luxembourg, à Francfort, à Dublin ou encore à Paris, mais il reviendra aux instances nationales de décider quel sort sera réservé à telle ou telle société de gestion, et sur qui il faudra mener des enquêtes.
Bien que l'Allemagne soit réticente à l'idée d'opérer des transferts, un accord politique a été trouvé, et il doit être appliqué sans qu'il y ait deux poids et deux mesures. Je l'ai dit très clairement aux Allemands. Il n'est pas question que les Landesbanken bénéficient de transferts et que les caisses d'épargne espagnoles ne puissent pas en profiter.
Les marchés souhaitent qu'on envoie des signaux. Il ne s'agit pas de régler toutes les difficultés grâce au FESF : son rôle ne sera pas de recapitaliser tous les établissements qui se portent mal en Europe, mais d'exercer un effet de levier. Il existe, par ailleurs, des mécanismes de garanties entre les banques, et il ne faut pas non plus oublier le rôle joué par la BCE.
La question de la monétisation de la dette peut se poser, en particulier après la « révolution culturelle » réalisée par la BCE. Le problème est qu'il faudrait faire marcher la « planche à billets » dans des proportions considérables. Il y a un écart de 1 à 20, voire de 1 à 30, entre les besoins des marchés et ce que peuvent faire la BCE et les banques nationales, même en monétisant la dette.
Vous voulez dire beaucoup d'inflation – beaucoup plus qu'on ne peut en supporter. Les montants en jeu ont beaucoup changé depuis dix ans à cause des transferts de dettes considérables qui ont été réalisés vers les marchés.

Les États-Unis en étaient à 126 % du PIB dans les années 50 et 60. Nous en sommes à 140 %. La monétisation est inévitable.
Jusqu'à un certain point, on peut obtenir un effet de levier grâce à la monétisation, mais on ne pourra pas tout résoudre grâce à cela. Je le répète : les montants sont gigantesques. La situation qui en résulterait serait plus qu'inflationniste. Je sais bien qu'il y avait entre 10 et 13 % d'inflation dans les années 80…
Mais comment y arriver ? Quel serait l'effet sur les taux d'intérêt ? Et qui paierait ?
J'en viens à la hiérarchie des places financières. Celle de Londres est aujourd'hui la plus importante, avant celle de Paris, puis celle de Francfort. Chacune d'entre elles a ses atouts. La place de Londres se distingue ainsi par le volume des transactions réalisées, par ses fonds, ainsi que par son activité financière et ses marchés. L'atout de la place de Paris réside plutôt dans ses émetteurs : la moitié des grandes capitalisations boursières européennes sont françaises. C'est un atout qui n'est pas assez mis en avant, ni assez valorisé – c'est pourquoi nous essayons de faire en sorte que les grands émetteurs se remettent à emprunter et à se refinancer à Paris. La place de Paris bénéficie également d'une des industries de gestion d'investissements et de portefeuilles les plus actives d'Europe, voire de la plus active d'entre elles. L'avantage de la place de Francfort résulte dans son assez bonne organisation des marchés, des chambres de compensation et de la centralisation : le système en silo retenu par Francfort est un atout en matière de financement.
Pour le moment, l'incidence de l'élection de M. Cameron est assez neutre. Le nouveau Premier ministre britannique n'a pas poussé les choses depuis deux mois, mais il ne les a pas non plus bloquées. Le Royaume-Uni a adopté au G20 de Toronto une position peu habituelle pour les Britanniques en matière de taxation. Cela étant, il faut se souvenir de l'engagement pris par M. Cameron, pendant la campagne électorale, de refuser tout nouveau transfert de souveraineté vers l'Union européenne. Reste à savoir si les Britanniques considéreront que la création de nouvelles agences, dont le Conseil va débattre cette semaine, constitue un transfert de souveraineté ou bien une simple question d'organisation pratique. Dans la première hypothèse, la régulation financière est mal partie au plan européen, à moins de mettre le Royaume-Uni en minorité au Conseil, ce qui risque de ne pas être facile sur un tel sujet.
Vous avez entièrement raison, monsieur Dupré, sur la nécessité de créer une autorité bancaire européenne dotée de véritables pouvoirs. Son action ne devrait pas se limiter à faire circuler l'information entre les régulateurs.
Quant aux agences de notation, l'AMF vient de publier un rapport assez dur à leur sujet. Cela étant, il faut être conscient que tout le monde a recours à leurs services, aussi bien la BCE que les investisseurs et les banques pour la vente de produits financiers par l'intermédiaire des sociétés de gestion de portefeuilles. Les Allemands ont, en outre, exigé que l'on fasse appel aux agences de notation dans le cadre du FESF. Les entreprises font, par ailleurs, de même lorsqu'elles se prêtent mutuellement de l'argent, tandis que les régulateurs, dont l'AFM, agréent les SICAV en fonction de leur notation. Notre état de dépendance à l'égard des agences de notation est tel qu'une véritable désintoxication est nécessaire. Pour cela, il faut s'interroger sur les méthodes employées : il est inadmissible que les agences de notation interviennent pendant qu'un État adjuge des titres publics – c'est un abus de marché qui pourrait faire l'objet de sanctions.
Nous pourrions utilement nous inspirer de l'Allemagne pour le rôle joué par leurs PME dans la croissance, l'emploi et le maintien de l'activité. Les résultats des grands groupes se redressent, ce qui explique la situation actuelle des marchés, mais le problème est que l'activité de ces groupes s'internationalise. Ce sont donc les PME qui maintiennent l'activité et l'emploi sur le territoire national. Pour cela, elles doivent grossir et construire des réseaux – c'est la grande force des PME allemandes.
Si les banques prêtent moins aujourd'hui, c'est d'abord parce que nous passons de plus en plus d'un mode de financement par le crédit à un mode de financement par les marchés. La part du financement reposant sur le crédit était de 80 % en Europe – contre un taux de 80 % pour le financement par les marchés aux États-Unis –, mais il tend aujourd'hui à se réduire chez nous. Une seconde raison est que les règles prudentielles et comptables n'incitent aucunement les banques à prêter aux entreprises, a fortiori aux PME. C'est une autre grave erreur de régulation qu'il faudrait corriger au plan européen : nous devons inciter davantage les banques à prêter aux PME, tout en incitant ces dernières à se financer davantage sur les marchés. Les toute petites PME doivent en rester à un mode de financement traditionnel, mais on pourrait spécialiser les procédures pour amener les autres PME sur des marchés spécialisés. Il faudrait que les directions de la Commission en charge des marchés financiers et des entreprises prennent la question à bras le corps : il est urgent d'adopter un plan de financement des PME au plan européen.

La dette publique passe pour être la cause de la crise grecque, puis du fléchissement de l'euro. Or, elle ne dépasse pas 80 % du PIB en France, contre 220 % au Japon. Pourquoi le yen n'est-il pas attaqué, contrairement à l'euro ?
Quand j'étais étudiant en économie, on enseignait que les politiques de stop and go étaient une catastrophe. Et pourtant tous les pays ont fait de la relance après la crise de l'automne 2008, et il est maintenant question de mener des politiques d'austérité et de rigueur. On fait donc du stop and go.
Vous avez insisté sur la nécessité de l'unité du couple franco-allemand. Mais était-elle possible ? Sans aller jusqu'à 6 ou 7 % d'inflation, il ne serait pas mauvais pour l'économie que le taux d'inflation atteigne 4 ou 5 %. Or, les Allemands ne l'accepteront jamais pour des raisons structurelles et historiques. Par ailleurs, les tendances hégémoniques de l'Allemagne en matière de nominations ne favorisent pas l'équilibre de ce couple franco-allemand.

L'attention portée par les Français aux déficits publics constitue un bon baromètre des relations entre la France et l'Allemagne. Pour autant, pensez-vous qu'il est raisonnable de prévoir, comme le fait un récent accord, un retour aux règles du pacte de stabilité et de croissance d'ici à 2013 ? Cela ne nous expose-t-il pas à des risques déflationnistes considérables ? Je serais heureux que vous répondiez à cette question, systématiquement esquivée dans ce débat.
En second lieu, pouvez-vous nous apporter quelques précisions supplémentaires sur le paquet relatif à la régulation qui a été adopté aux États-Unis ? Que comporte-t-il de significatif ? Je rappelle que l'Union européenne rencontre, de son côté, des difficultés extrêmes pour adopter des mesures de régulation, qu'il s'agisse de créer une agence financière ou de faire passer la directive relative aux hedge funds. Le paradoxe du traité de Lisbonne est que l'adoption de certains textes est facilitée au Conseil par l'application de la majorité qualifiée, mais bloquée au Parlement européen, qui est en train de devenir le cheval de Troie du Royaume-Uni, à cause de la procédure de codécision.
Que pouvez-vous nous dire, en dernier lieu, sur le projet de taxation des transactions financières ? Le but est-il d'obtenir un consensus franco-allemand pour impressionner l'opinion publique, de procurer des ressources à l'Union européenne, ou bien est-ce le retour de la taxe Tobin ?

Le couple franco-allemand est-il toujours la pierre angulaire de l'Union européenne malgré l'élargissement et les évolutions de l'Allemagne ? La position française varie, pour sa part, au gré des vents : tantôt elle va chercher des amitiés ailleurs, tantôt elle se re-concentre sur le couple franco-allemand. Pensez-vous que l'Europe ne peut avancer que si le couple franco-allemand est solide, comme c'était le cas hier ?
A supposer que ce partenariat soit si important – ce que je crois –, sur quelles bases peut-il aujourd'hui reposer ? Hier, la situation était assez simple : l'Allemagne avait besoin de la France, car elle était divisée et affaiblie. La clef du couple franco-allemand était de troquer l'alliance politique contre un partenariat économique. Or, on ne sait plus très bien où on en est aujourd'hui : le volontarisme est sympathique, voire nécessaire, mais il ne suffit pas. Le partenariat franco-allemand doit avoir des raisons substantielles d'exister.

Quand on voit la force de l'économie chinoise – son taux de croissance est supérieur à 10 % –, on peut se demander pourquoi le yuan est si faible par rapport à l'euro. Comment l'expliquer ?

Le commissaire européen au marché intérieur avait fait sourire en évoquant la création d'une agence européenne de notation. Si l'Union est la propriétaire de cette agence, elle ne risque pas de dire du mal d'un pays européen, ce qui rend son indépendance peu crédible. En outre, qui pourrait-elle réguler ? L'agence Fitch, la seule agence qui est réputée française et qui est de loin la plus petite des trois ? Dans ces conditions, je vois mal l'intérêt du projet.
Puisque tout le monde s'adresse aux agences de notation, ne conviendrait-il pas plutôt de changer leur système de rémunération ? Le coeur du problème est que ce sont les clients qui les financent. J'ai le souvenir d'avoir vu un dirigeant d'une grande entreprise mondiale en tête-à-tête avec le directeur d'une grande agence de notation dans un très bon restaurant trois étoiles. C'est ce type de comportements qu'il faut éviter. Au lieu de créer un nouveau « machin » européen très coûteux en frais de fonctionnement, et dont la crédibilité est très entamée dès l'origine, pourquoi ne pas favoriser la constitution de nouvelles agences ?
Pourquoi notre endettement est-il surveillé, et non celui du Japon ? C'est que la dette japonaise est intérieure : ce sont les Japonais qui détiennent leur propre dette et leur taux d'épargne est très fort. Les Français ne finançant pas notre dette, nous sommes plus dépendants de l'extérieur. Cela fait longtemps que nous nous tournons vers les marchés pour nous financer, et nous le faisons d'ailleurs avec beaucoup de talent et de professionnalisme – je le dis d'autant plus facilement que je n'exerce plus de responsabilités au sein du Trésor. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de limiter nos spreads.
Vous avez raison, monsieur Labaune, en ce qui concerne le stop and go. Il faut l'éviter. Si le creusement des déficits et de la dette permettait d'obtenir de la croissance, on le saurait depuis trente ou quarante ans, car ce type de sport a été beaucoup pratiqué. Mieux vaudrait se mettre d'accord, au plan politique, sur un rythme de décélération qui permettrait de ne pas mettre en danger le minimum de croissance dont nous avons besoin. Les deux ou trois années qui viennent vont indéniablement être difficiles, mais nous devons nous efforcer de procurer de la visibilité aux acteurs et d'amortir les évolutions.
S'agissant de l'inflation, les Allemands n'accepteront jamais un taux de 4, 5 ou 6 %, comme je l'ai indiqué à M. Myard.
Je ne crois pas au risque déflationniste, monsieur Garrigue. Le prix des actifs, aussi bien immobiliers que financiers, se maintient. Nous devons apporter de la prévisibilité et favoriser la confiance : dans ce but, le secteur public doit réduire son déficit et sa dette. Les comportements des acteurs privés sont en effet très prudents, voire peureux, en Europe. Notre atout est d'être un fantastique bassin d'épargne – nous n'avons pas à rougir devant le Japon à cet égard –, mais cette épargne n'est pas mobilisée. La part des dépôts liquides n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Les gens ont peur, et il faut répondre à cette anxiété.
Le « paquet » adopté par les États-Unis comporte trois progrès. Il instaure, tout d'abord, une protection du consommateur et de l'épargnant qui était inexistante jusque là. Quoi qu'on en pense à Paris, il renforce également la distinction entre les activités bancaires de nature commerciale et de crédit et les activités de marché. De notre côté, il ne faudrait pas attendre deux ans pour nous demander si ce n'est pas une si mauvaise idée, comme nous l'avons fait pour les stress tests. Enfin, les États-Unis sont en avance sur nous dans le domaine des marchés grâce au développement des chambres de compensation, à la surveillance des transactions et à l'encadrement des ventes à découvert.
En ce qui concerne la procédure de codécision, ce ne sont pas les Britanniques qui créent un blocage au Parlement européen, même si la commission des affaires économiques et monétaires y est présidée par une Britannique. Les Français et les Allemands s'entendent assez bien au Parlement européen, qui fait plutôt avancer la situation malgré quelques excès, auxquels les représentants français ne sont pas toujours étrangers. Les retards sont surtout liés à la difficulté des relations entre le Parlement et le Conseil. J'observe, au passage, que les Britanniques pèsent davantage au Conseil qu'au Parlement.
Il ne me semble pas qu'une taxation sur les activités des marchés freinera beaucoup la spéculation. En revanche, elle peut rapporter de l'argent – c'est précisément le but de la fiscalité. Il est normal que les assiettes évoluent : nous avons connu des taxes sur les portes et les fenêtres, mais aussi sur le sel, puis la taxation du revenu a été instaurée après la Première guerre mondiale ; on a ensuite créé la TVA pendant les Trente glorieuses compte tenu de l'augmentation de la consommation. L'industrie financière se développant aujourd'hui, en particulier les activités de marché, c'est un gisement fiscal que nous devons exploiter...
La relation franco-allemande reste la pierre angulaire de la politique européenne. La première raison est que la France et l'Allemagne sont deux pays très importants en Europe. Je ne crois pas que l'élargissement soit le facteur qui ait le plus changé l'attitude de l'Allemagne par rapport à l'Europe, même s'il est vrai que ce pays aujourd'hui a moins besoin d'elle qu'hier. Quant à l'attitude de la France, elle varie au gré des circonstances, comme vous l'avez rappelé. Une deuxième raison tient à la puissance relativement inférieure des autres pays : les pays capables de contrebalancer la France et l'Allemagne sont moins en position de le faire aujourd'hui qu'hier. La situation économique du Royaume-Uni s'est dégradée, et ce pays expérimente aujourd'hui une coalition politique dont il n'a pas l'habitude. L'influence de l'Italie, qui était une des poutres maîtresses de la construction européenne, a décliné. L'Espagne traverse aujourd'hui des difficultés, même si elle rebondira. Quant à la Pologne, c'est un peu pays encore peu visible, même si cela pourrait changer à l'avenir.
La question des bases du partenariat franco-allemand est essentielle. Il faudrait passer de la coopération traditionnelle à une concertation plus régulière. Nous avons besoin d'un équivalent franco-allemand du Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) pour éviter que les dossiers remontent systématiquement au niveau des chefs d'État et de gouvernement dans les domaines techniques, et nous avons également besoin de projets franco-allemands en matière de recherche, d'innovation et de formation. Des terrains d'entente sont, en outre, possibles en matière économique et financière, comme dans le domaine de la politique extérieure. On pourrait notamment envisager de renforcer la reconnaissance internationale de l'Allemagne. J'ai été très frappé par ce qu'a dit le Président de la République à propos du Conseil de Sécurité de l'ONU. Il faut voir comment on peut négocier avec les Allemands sur ce sujet.
Les Chinois souhaitent une parité qui ne les gêne pas trop en termes d'ajustement et de croissance au niveau interne, et qui ne fasse pas souffrir leur modèle de croissance en termes de compétitivité, car il est en grande partie fondé sur les exportations. Ils se calent donc sur les États-Unis. Le yuan est aujourd'hui sous-évalué, mais ceux qui investissent en Chine n'ont aucun intérêt à ce que de fortes tensions sociales se produisent – ce n'est l'intérêt de personne –, ni à ce qu'il y ait une réévaluation trop rapide.
S'agissant de la création d'une agence européenne de notation, je suis du même avis que M. Clément, qui a parlé d'or : cela nous coûterait très cher pour un résultat bien modeste. Il serait préférable d'ouvrir le jeu à d'autres agences, bien que cette industrie, reposant sur un haut niveau de valeur ajoutée, soit très capitalistique – c'est pour cette raison qu'il n'existe aujourd'hui que trois agences de notation, voire deux et demi, si j'ose dire. Il faudrait, en outre, se montrer sans pitié à l'égard des conflits d'intérêts. Le gendarme européen que j'appelle de mes voeux devra porter une attention particulière à cette question, ainsi qu'aux changements de méthode des agences de notation – il n'est pas normal qu'elles s'appuient un jour sur les marchés, et un autre sur les fondamentaux.

Il me reste à vous remercier pour cette audition très complète et passionnante. Nous serons bien sûr très heureux de vous entendre de nouveau prochainement – je l'espère à la rentrée.

M. le président, deux de nos compatriotes, MM. Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, sont toujours retenus en Afghanistan ; je souhaiterais au nom de notre commission des affaires étrangères que nous exprimions à ces deux journalistes et à leurs proches un message de soutien et d'espoir en vue de leur libération.
Informations relatives à la commission