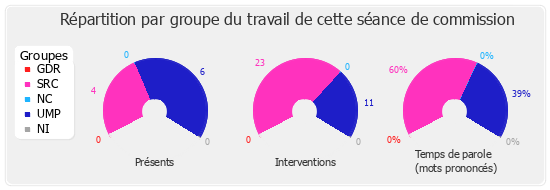Mission d'information assemblée nationale-sénat sur les toxicomanies
Séance du 19 janvier 2011 à 16h15
La séance
Mission d'information SUR LES TOXICOMANIES
Mercredi 19 janvier 2011
La séance est ouverte à seize heures trente.
(Présidence de M. Serge Blisko, député, coprésident et de M. François Pillet, sénateur, coprésident)
La Mission d'information sur les toxicomanies entend, en audition ouverte à la presse, M. Étienne Apaire, président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT).

La semaine dernière, M. Jean-Michel Costes, directeur de l'Observatoire français de lutte contre la drogue et la toxicomanie (OFDT), a dressé devant nous un tableau de la consommation actuelle de drogue en France ainsi que de ses principales tendances. Aujourd'hui, monsieur Étienne Apaire, vous nous exposerez la politique française de lutte contre les toxicomanies, dont la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) constitue la clé de voûte.
Lutter contre la drogue, c'est certes prévenir les usages, combattre les trafics, soigner, mais également mener la vie dure aux idées fausses : ainsi, il ne serait pas possible de soigner et de se soigner, rien ne serait fait contre les grands trafiquants, la drogue serait une fatalité qu'il faudrait accepter, certains usages en seraient raisonnables, seules leurs conséquences néfastes devraient être combattues et la dépénalisation ou la légalisation de l'usage seraient inévitables.
Pourtant, si toutes les politiques peuvent être légitimes, toutes n'entraînent pas les mêmes conséquences. Selon certains, le nombre d'usagers de drogues n'a aucune importance au regard de leur prise en charge sanitaire ; pour d'autres, l'enfer réside dans l'asservissement à la drogue et il faut tout faire pour l'éviter. Les questions qui se posent ne sont donc pas seulement techniques, mais aussi éthiques. En outre, si des convergences se font jour entre différents pays, chaque gouvernement est responsable des conséquences des politiques qu'il met en oeuvre.
Avec cette mission d'information, qui permettra de clarifier les différentes problématiques auxquelles nous sommes confrontés, vous faites d'autant plus oeuvre utile que le monde change et que les trafics et les usages de drogue n'échappent pas à la règle : de nouvelles drogues apparaissent tous les mois, la disponibilité de la cocaïne et de l'héroïne augmente, une partie de la jeunesse est de plus en plus vulnérable. Les sujets qui alimenteront vos réflexions dans les semaines à venir sont nombreux et je ne doute pas que vous contribuerez à inspirer utilement les travaux de préparation du prochain plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies pour la période 2012-2016.
Je suis d'autant plus ravi de m'exprimer devant vous que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer les différentes politiques qui ont été menées devant les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que devant la commission des affaires sociales de la Haute assemblée : en effet, il n'y a que des avantages à rappeler que c'est la drogue qui est interdite, non le fait d'en parler. Tous les décideurs, et a fortiori le législateur, doivent pouvoir évoquer ce problème à l'instar de tous les autres.
La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) est le bras armé du Gouvernement s'agissant des politiques de lutte contre la drogue puisqu'elle prépare les décisions qui sont prises et veille à la façon dont elles sont appliquées : chaque fois que l'un de ses responsables s'exprime, c'est en fait pour énoncer la politique gouvernementale mise en oeuvre. En l'occurrence, les arbitrages sont rendus par le Premier ministre et les politiques menées le sont en son nom, dans le respect des instructions données par le Président de la République. Plus spécifiquement, les vingt et un départements ministériels qui sont concernés témoignent de l'importance du dispositif gouvernemental. C'est 1,5 milliard d'euros qui est consacré à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, somme correspondant d'ailleurs à peu près au chiffre d'affaires des trafiquants, le seul trafic du cannabis leur rapportant 900 millions d'euros. Plus précisément, 529 millions d'euros sont dédiés à la prévention et à la recherche, 620 millions d'euros à la lutte contre les trafics et 335 millions d'euros à la prise en charge sanitaire des toxicomanes, une telle répartition attestant éloquemment du caractère équilibré de notre politique.
Le Gouvernement poursuit des objectifs clairs : faire reculer les usages en clarifiant le discours public, lequel doit rappeler l'interdit pesant sur l'utilisation des drogues illicites et le caractère nécessairement limité de la consommation d'alcool et de tabac en fournissant les informations nécessaires à la prise de conscience des dangers sanitaires et sociaux de ces drogues ; réduire ou retarder les expérimentations de consommation de stupéfiants par les plus jeunes en cessant de penser que ces derniers s'éduquent eux-mêmes : le premier agent de prévention n'est en rien un autre jeune, qu'il soit fonctionnaire ou membre d'un réseau associatif, mais un adulte et, notamment, les parents dès lors qu'ils ont pu bénéficier des bonnes informations.
Nous souhaitons également promouvoir une meilleure politique de soins et réduire les risques associés aux usages de drogue. Ce point n'est pas assez connu mais, en matière de lutte contre les addictions, la France dispose d'un système original articulé autour de structures médico-sociales spécialisées, anonymes et gratuites pour certaines. Aux 440 structures spécialisées dans le soin – les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) résultant de la fusion entre les centres spécialisés dans la prise en charge des alcooliques et ceux s'occupant des usagers de drogues illicites –, il convient d'ajouter 300 structures de consultation destinées aux jeunes consommateurs et 130 structures dédiées à la réduction des risques, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD). Je rappelle au passage que les célébrités victimes d'addiction ne devraient pas se croire obligées d'aller en Suisse pour se faire soigner puisqu'il existe plus de 3 000 places d'hébergement thérapeutique dans notre pays – il est ainsi possible d'accueillir les patients pendant deux ans dans les sept ou huit communautés thérapeutiques existantes –, auxquelles s'ajoutent plus de 2 700 places d'hospitalisation spécialisées en addictologie. Au total, plus de 5 000 places avec hébergement permettent donc à toute personne désireuse de se soigner de bénéficier de sevrages simples ou complexes. De plus, toutes ces structures bénéficient désormais de financements pérennes garantissant la stabilité et la visibilité de leur action. La part du budget de l'assurance maladie qui leur est dédiée s'élève à 278 millions d'euros, mais nous avons prévu d'aller plus loin puisque le plan gouvernemental a dégagé 9 millions d'euros supplémentaires afin de cibler des personnes plus fragiles telles que les femmes avec des enfants, les personnes sortant de prison et les consommateurs de cocaïne qui, faute d'expérience, étaient jusqu'alors peu pris en charge par les médecins.
La réduction des risques s'inscrit quant à elle au coeur de la politique française depuis quinze ans : 130 000 usagers d'héroïnes sont sous traitement de substitution aux opiacés et 15 millions de seringues sont distribuées chaque année. Cas unique en Europe : l'utilité de la politique de réduction des risques est reconnue par la loi – je tente d'ailleurs de l'exporter, l'ouverture de nos frontières et donc la situation sanitaire de nos voisins ne pouvant qu'avoir un impact sur notre pays.
En matière de drogue, nous ne sommes pas seulement responsables de la limitation de la demande : nous devons également combattre l'offre. C'est ainsi que le Gouvernement a décidé de mieux lutter contre les trafics et l'argent qu'ils génèrent. Avec les ministères de la justice, de l'intérieur et du budget, la MILDT a impulsé une nouvelle orientation des enquêtes vers la confiscation des patrimoines des trafiquants. L'objectif est simple : nous voulons montrer à nos concitoyens, et plus particulièrement à ceux qui subissent chaque jour le triste spectacle de trafiquants dont le niveau de vie est ostentatoirement élevé, que, si le crime a payé, ce n'est plus désormais le cas. Afin d'évaluer l'efficacité de cette action, nous disposons d'un indicateur simple et fiable : le fonds de concours dit « Drogues » alimenté par le produit de la vente des biens confisqués aux trafiquants, dont le montant est passé de 1,2 million d'euros en 2007 à 21 millions d'euros en 2010. Une telle progression me semble suffisamment éloquente. En cette période budgétairement délicate, où chaque administration discute avec Bercy de la pérennité de ses crédits, nous avons trouvé une source de profits considérables, les crédits provenant de la poche des trafiquants n'étant jamais gelés ni abandonnés. Les crédits du fonds sont affectés respectivement à hauteur de 60 % aux services de police et de gendarmerie, de 20 % à la justice, de 10 % aux douanes, de même qu'à la politique de prévention. Telle est la rançon que le crime paie à la vertu !
J'ajoute que les résultats d'une telle politique devraient être encore accrus puisque vous avez voté récemment la création d'une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la mobilisation des administrations de l'État devant permettre d'éviter à ceux qui ont mal agi de profiter de leur argent et de récidiver, tant il est insupportable qu'un trafiquant puisse continuer de gérer ses affaires en prison.
La mutualisation des moyens de lutte dont disposent les administrations contre le trafic de drogue s'exerce certes sur le plan régional, notamment à travers les groupes d'intervention régionaux (GIR), mais aussi sur un plan international puisque avec l'Union européenne nous avons créé des bases à Accra, au Ghana, et à Dakar, au Sénégal. L'agence dite « MAOC-N » (Maritime analysis and operations center for narcotics ou Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants) de Lisbonne vise, quant à elle, à lutter contre le trafic maritime en provenance d'Amérique du Sud en particulier, le Centre de coordination pour la lutte anti-drogue en Méditerranée (CeCLAD-M) de Toulon étant dédié à la répression du trafic contre le cannabis.
C'est un fait : seul, aucun pays n'est à même de lutter contre les trafiquants.
Enfin, il convient d'autant plus de moderniser les moyens dont nous disposons en matière de recherche et d'information que l'addictologie n'est pas enseignée dans les facultés de médecine. Nous avons donc mis en place un réseau associant une dizaine de facultés afin d'organiser des enseignements permettant à cette discipline d'être diffusée, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis. De la même manière, nous avons lancé des appels à projet dans le domaine des sciences humaines et sociales, puisqu'il n'existe à ce jour aucune enquête digne de ce nom consacrée à l'étude des problèmes liés à l'addiction au travail ou pendant la scolarité.
Certes, chacun est libre de considérer que ma présentation de la politique gouvernementale relève de la visite d'un appartement témoin, mais les résultats obtenus, qui procèdent également d'une action au long cours, n'en sont pas moins réels. Si, d'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), la consommation de cocaïne a augmenté dans notre pays depuis 2000 – on dénombre de 250 000 à 300 000 usagers –, elle n'en reste pas moins trois fois plus faible que celle de l'Italie, du Royaume-Uni ou de l'Espagne. Et si ce dernier pays entretient des relations privilégiées avec l'Amérique du Sud et si la mafia est implantée dans le premier, le Royaume-Uni ne cultive pas la coca, non plus que ses voisins immédiats. Cela montre combien les politiques publiques sont précieuses : contrairement à ce que l'on entend dire parfois, elles ne se valent pas toutes. Les États qui se montrent les plus tolérants en matière de consommation en paient aujourd'hui le prix. Le Royaume-Uni est tout de même le pays qui consomme le plus de cocaïne au monde ! En France, la mobilisation des forces de sécurité et de la justice ainsi que les messages de prévention ont entravé la diffusion de cette drogue : si les prix n'ont dès lors pas chuté depuis trois ans – le gramme vaut toujours 60 euros en moyenne, sauf pour les consommateurs qui disposent de facultés contributives plus importantes –, on ne peut pas en dire autant du degré de pureté : les stocks disponibles étant moins importants, les trafiquants sont obligés d'utiliser des additifs. Ce sont là autant de preuves de l'efficacité de notre action.
Je vous rappelle par ailleurs qu'au début des années 2000, la France était le premier pays consommateur de cannabis en Europe puisqu'un jeune sur deux âgé de dix-sept ans en avait goûté. Sans que l'on puisse prétendre avoir considérablement réduit la consommation, on ne peut que constater qu'ils ne sont plus aujourd'hui que 42 % : la normalité, c'est de considérer que 60 % des jeunes Français âgés de dix-sept ans n'y ont jamais touché.
D'autres succès sont à mettre à notre actif commun : la vague du crack qui inquiétait tant les autorités au début des années 1990 a été contenue, les surdoses d'héroïne ont significativement baissé, la méphédrone et la méthamphétamine – nouvelles drogues qui provoquent des ravages aux États-Unis ou en Europe de l'Est – sont tout à fait marginales. Espérons que ce sera le cas pour encore un certain temps !
J'attire également votre attention sur le développement rapide des « legal highs », drogues de synthèse en perpétuelle évolution du fait de l'imagination de chimistes peu scrupuleux, lequel nous obligera sans doute à modifier notre dispositif législatif puisque ces « drug designers » contournent l'interdiction de commercialisation de molécules classées parmi les produits stupéfiants en choisissant celles qui leur sont les plus proches, avant que ces dernières ne soient interdites à leur tour. Il faut en effet savoir qu'une nouvelle drogue apparaît environ tous les deux mois. Il n'a guère fallu plus de temps pour qu'au Royaume-Uni la méphédrone, d'abord légale, devienne le quatrième produit le plus consommé avant d'être classée comme stupéfiant.
Il me semble nécessaire de revenir sur deux thèmes importants.
Je parlerai d'abord des centres d'injection supervisés, ou « salles de shoot », dont certains proposent l'ouverture. Je me garderai bien de remettre en cause la légitimité des experts qui s'expriment à ce sujet, mais je vous prie de faire preuve de réalisme. Je crois que vous avez auditionné Mme Jeanne Étiemble, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Comment l'expertise de cet organisme s'est-elle déroulée ? Quels sont les experts extérieurs qui ont été entendus ? Si j'ai eu la joie de constater que ce fut le cas de Mme Nicole Maestracci, je n'ai quant à moi pas eu cette chance. Quoi qu'il en soit, ce fut une « expertise littéraire », tout le monde – à la différence de M. Philippe Goujon – n'ayant pas été sur le terrain.
Par qui, en effet, les articles considérés ont-ils été écrits – la question est importante en pleine crise du Mediator ? L'ont-ils été par des experts proches des structures en question ou par des personnes ayant bénéficié d'un certain recul leur conférant peut-être un peu plus d'objectivité ? À ce propos, je me réjouis que le ministère chargé de la recherche, conscient de la nécessité d'harmoniser les pratiques des organismes de recherche publics en matière d'expertise, ait récemment élaboré une charte nationale de l'expertise afin de répondre à ce type d'interrogations. Les solutions proposées sont-elles adaptées aux enjeux nationaux ? Sont-elles politiquement et économiquement viables pour répondre aux difficultés que vous connaissez bien dans vos circonscriptions ? Y seront-elles acceptées ? Qu'en est-il du rapport coût-bénéfice pour la santé ?
Les propos du Premier ministre, cet été, n'ont pas été bien compris : si, selon le Gouvernement, la mise en place de centres d'injection supervisés n'est ni utile ni souhaitable, il n'a jamais été question de ne pas en débattre ! Il a seulement argué de dispositifs existants et de principes éthiques pour contester l'idée selon laquelle ces structures constitueraient la seule et unique solution possible. Le Gouvernement, je le répète, se réjouit du débat qui a lieu car il est toujours sain d'évoquer les thèmes qui intéressent ou inquiètent les Français. Nous sommes en l'occurrence ravis de constater que notre position a été confortée par un vote massif des membres de l'Académie nationale de médecine, lesquels ont considéré que l'implantation de telles salles n'était pas souhaitable pour des raisons éthiques, mais également en raison de leur inadaptation à une bonne prise en charge des toxicomanes. En quoi la parole de quelques associations promouvant l'usage de drogues devrait-elle recevoir plus d'écho que celle de praticiens expérimentés ?
Je ne sais si M. Roger Nordmann, membre de l'Académie nationale de médecine, sera auditionné…
Parfait !
De telles salles ont été mises en place dans un nombre très limité de pays ou, plus exactement, de villes ou de provinces – Vancouver n'est pas plus le Canada que Bilbao n'est l'Espagne ou Genève la Suisse – connaissant des phénomènes extrêmes tels que les « scènes ouvertes ». L'exemple suisse est à ce propos particulièrement emblématique puisque les usagers d'héroïne y sont deux fois plus nombreux qu'en France. Je crains, d'ailleurs, que Genève ne soit plus exposée aux problèmes de drogues que d'autres cantons suisses en raison de la politique menée.
La France n'a quant à elle jamais connu pareille situation. Je le répète, 130 000 usagers bénéficiant de traitements de substitution aux opiacés et l'échange annuel de 15 millions de seringues ont permis de ramener à 70 000 le nombre de consommateurs effectifs d'héroïne, chiffre intéressant par rapport aux centaines de milliers de consommateurs d'autres drogues ou aux millions de fumeurs de cannabis. Même si nous sommes inquiets pour l'avenir, nous pouvons considérer que cette addiction, sans avoir hélas disparu, n'en est pas moins résiduelle. S'agissant donc de l'usage d'héroïne mais, aussi, des surdoses et des contaminations au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou aux hépatites, notre pays compte parmi ceux qui obtiennent les meilleurs résultats en Europe. Si nous devons les conforter en allant à la rencontre des usagers les plus fragiles, ne plaquons pas sur la réalité française des solutions inadéquates !
De surcroît, l'efficacité socio-économique de ces structures en ces temps de contraintes économiques et budgétaires est à tout le moins problématique, comme en atteste le rapport de l'INSERM. Une étude réalisée à Vancouver conclut que deux décès par an – voire un seul – dus au VIH ont pu être évités grâce à ces structures, dont le coût de fonctionnement annuel s'élève d'ailleurs à près de 3 millions de dollars. Il y a donc de quoi être perplexe !
La même étude montre également que la mise en place de ces salles n'a eu aucune incidence sur les transmissions du VIH ou des hépatites puisque les populations qui les fréquentent sont souvent très infectées. À moins de généraliser leur implantation sur l'ensemble d'un territoire, il sera difficile d'éviter ces infections très en amont.
À Vancouver, 38 % des personnes qui se rendent dans ces structures s'inscriraient dans une trajectoire de soins. Outre qu'il est un peu particulier d'aller dans un lieu pour s'injecter de l'héroïne et envisager ensuite de se soigner, le rapport précise que 38 % des usagers ont été « référencés à un système de soins ». N'étant pas médecin mais juriste, je me suis renseigné : cette formule signifie simplement qu'un médecin généraliste a communiqué à un patient les coordonnées d'un médecin spécialiste. Être « référencé », c'est être adressé à un système de soins. Or, seuls 17 % de ces 38 % s'y sont effectivement rendus. In fine, combien de personnes ont donc été désintoxiquées pour un coût aussi élevé ? Les traitements de substitution aux opiacés et les échanges de seringues sont autrement plus efficaces et moins coûteux !
Ensuite, comment prendre en charge les personnes très précaires ? Tout d'abord, j'observe qu'il est très difficile de cerner cette population puisque les études existantes – je songe à celles de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies sur les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues – se fondent sur ceux-là seuls qui fréquentent les centres de soins. On constate en l'occurrence que les sans-papiers sont nombreux, de même que les cocaïnomanes ou, plus spécifiquement, les « crackers » ainsi que les personnes présentant des troubles psychiatriques importants. Comment donc agir plus efficacement ? Sans doute pas en mettant héroïne – avec les « salles de shoot » – et cocaïne – avec les « snifferies » – à disposition !
Agir en faveur des personnes en situation de précarité, c'est mettre en place des maraudes, à l'instar de celles que M. Xavier Emmanuelli a organisées…
Je serai plus bref s'agissant du versant international de nos analyses.
Ni l'Armée du Salut, ni le Secours catholique, ni le SAMU social n'ont songé à soigner des alcooliques dans des caves à vin ! Avec Mme Nora Berra et M. Xavier Bertrand, le Gouvernement travaille donc à la mise en place d'autres mesures.
Il s'agit, en premier lieu, d'adapter les horaires d'accueil des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues aux habitudes des usagers. Il importe également que ces établissements signent des conventions avec les différents centres de soins existants pour pouvoir prescrire de la méthadone afin de réduire les délais d'accès au traitement. Il faut aussi développer des unités mobiles comprenant des médecins psychiatres. Enfin, sur le front de la prévention, nous avons, grâce au fonds de concours « Drogues », acquis des fibroscans qui permettent de dépister facilement des hépatites. De plus, nous voulons nous inspirer du « Plan crack » parisien en créant des unités de vie adaptées à l'extrême précarité, ces dispositifs ayant notamment permis de prendre en charge des « crackers » antillais et d'éviter que ce fléau ne se multiplie dans cette communauté.
Par ailleurs, nous entendons dire que la prévention est insuffisante. Le coeur de notre politique, en la matière, consiste à rappeler le caractère protecteur de la règle proscrivant l'utilisation de produits dangereux pour la santé et la société. Quel signal serait-il donc donné aux Français si des « salles de shoot » ouvraient leurs portes ?

Elles ne constituent pas, en tout cas, l'objet de notre mission, qui est consacrée, je vous le rappelle, aux toxicomanies.
J'ai cru comprendre que les deux thèmes étaient au centre du débat public.

Les degrés d'information dont disposent les parlementaires mais, également, le grand public étant très divers, essayons d'avancer.
J'aurais souhaité que le Gouvernement soit entendu à plusieurs reprises sur les différents aspects du problème. Si on lui donne le même temps de parole qu'à un certain nombre d'associations plus ou moins importantes…

Des représentants des services de police, de la justice et de la santé seront bien évidemment entendus.
En l'état, le Gouvernement est représenté par la MILDT, coordinatrice de sa politique, laquelle considère que, pour des raisons éthiques et politiques, l'ouverture de salles d'injection supervisées ne serait pas de bon aloi, comme semblent d'ailleurs le penser une grande majorité de nos compatriotes.
C'est un sujet important !

Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont souhaité que les parlementaires soient informés le plus largement possible. Votre opinion personnelle nous intéresse beaucoup, certes,…
Il n'en est nullement question ! C'est de celle du Gouvernement qu'il s'agit !

…ainsi que celle du Gouvernement, mais nous aurons l'occasion de recevoir, par exemple, M. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale. Vous ne représentez pas le Gouvernement à vous tout seul…
M. Frédéric Péchenard seul ne représente pas plus le Gouvernement ! La MILDT est chargée de présenter la politique du Gouvernement, telle qu'elle a été définie par le Premier ministre et rappelée cet été, sur la question précise de l'usage de l'héroïne.

Je vous prie d'autant plus de bien vouloir conclure que vous interviendrez tout à l'heure en tant que président du Groupe Pompidou, dont la dimension est européenne.
Je serai alors plus bref car nous sommes d'abord confrontés à un enjeu national. Je le répète : les enquêtes dont nous disposons montrent que les Français sont opposés à l'ouverture de « salles de shoot ».
Des questions se posent également quant à la dépénalisation de l'usage de certaines drogues.
Selon certains, outre que la dépénalisation aurait pour effet de limiter les troubles à l'ordre public, des dispositifs d'éducation à la santé permettraient de réguler les consommations. Or, pour connaître les effets de la dépénalisation, il est inutile de se rendre à l'étranger : il suffit d'observer le marché du tabac dans notre pays, lequel compte 10 millions de fumeurs, contre 1,2 million de consommateurs de cannabis.
De la même manière, nous connaissons fort bien les effets d'un marché « régulé » en ce qui concerne la consommation d'alcool.
Si l'une et l'autre de ces consommations diminuent grâce à la politique gouvernementale, nous savons que le tabac constitue néanmoins la deuxième source de financement de la camorra : toute régulation, en effet, entraîne le développement de la contrebande.
La légalisation de la production et de la consommation des drogues n'est en rien une solution miracle ! Lever l'interdit reviendrait à accroître la disponibilité du produit. Dans les Pyrénées-Orientales, département limitrophe de l'Espagne dont la politique en matière de stupéfiants est très tolérante, la surconsommation de tous les produits interdits – et, même, du tabac – est patente. La limitation de la répression des usages qui a été décidée en République tchèque a quant à elle été interprétée par la population comme une dépénalisation de fait, et ce pays est devenu le premier consommateur d'Europe d'à peu près tous les stupéfiants.
Les Français me semblent avoir un point de vue assez consensuel sur l'ensemble de ces questions et l'on se trompe si l'on considère que les demandes de certaines minorités sont représentatives. Je vous rappelle le slogan de la dernière campagne gouvernementale : « Contre la drogue, chacun peut faire quelque chose ! ».
Le Gouvernement vous remercie donc de vous associer aux efforts qui sont accomplis.

Je suis choquée par vos propos selon lesquels les Français seraient majoritairement opposés à l'ouverture de centres d'injection supervisés indépendamment du discours gouvernemental. Souvenez-vous que nos compatriotes étaient également défavorables à l'abrogation de la peine de mort et qu'ils la trouvent aujourd'hui légitime.

Dans le domaine de la santé non plus, la majorité n'est pas majoritaire !
En outre, je suis étonnée que seulement 10 % des biens confisqués aux trafiquants soient affectés aux politiques de prévention. C'est insuffisant !

Le barème d'affectation des crédits ne m'en semble pas moins fâcheux. À ce propos, monsieur Étienne Apaire, je souhaiterais savoir qui sont précisément ces trafiquants.
Plutôt que de centres d'injection supervisés, je préfère évoquer des centres « protégés ». Imaginez que, médecin dans un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, je donne à l'usager le petit kit de seringues et, comme il pleut, que je lui propose de s'asseoir et de lui expliquer comment pratiquer une injection dans les règles de l'art tant ses bras comportent de bleus. Nous serons alors dans un centre véritablement protégé. En l'état actuel des choses, si un usager meurt d'une embolie pulmonaire après s'être injecté un peu d'air, la non-assistance à personne en danger pourra être invoquée de plein droit !
Je comprends donc mal que le Gouvernement campe sur des positions aussi fermes alors que rien n'interdit dans la loi d'aller au-delà de l'échange de seringues, ni donc d'améliorer encore la prévention des risques en permettant une injection protégée.
Par ailleurs, vous avez mis en cause les experts de l'INSERM…
Leur méthodologie, pas leur personne !

Ce sont eux qui évaluent les travaux scientifiques du médecin hospitalier universitaire que je suis. La pratique rigoureuse de l'analyse des publications qui est la leur m'incite à leur faire confiance. À l'inverse, les personnes qui accèdent aux honneurs de l'Académie nationale de médecine sont souvent en fin de carrière et celle-ci ne compte aucun addictologue. Je m'interroge en conséquence sur votre prise de position.
Permettez-moi de faire une confidence personnelle : mon mari, fonctionnaire européen allemand, a travaillé jusqu'à une date très récente au Groupe Pompidou. L'avis des experts, tels ceux d'addictologues de Bordeaux, par exemple, dont la renommée est européenne, est unanime : la rentabilité de salles d'injection supervisées en termes de prévention des maladies infectieuses est certes faible, mais tel n'est pas le sujet dès lors qu'augmente le nombre de personnes qui, sans elles, n'auraient jamais accédé aux soins.
Pourquoi la mortalité par surdose a-t-elle diminué, sinon parce que les traitements de substitution aux opiacés se sont améliorés et que les personnes en situation de grande précarité ont été approchées de façon progressive ?
Mesurez-vous donc les dégâts qui peuvent être causés par une position aussi dogmatique que la vôtre alors que l'installation de centres d'injection protégés ne se ferait qu'à titre expérimental et que l'avis des experts et des personnes qui sont sur le terrain va dans ce sens ?

Nous abordons un sujet extrêmement complexe, sur lequel il me paraît très difficile d'avoir des certitudes.
Député des Vosges, pharmacien, maire d'une ville de 35 000 habitants, j'ai fondé voilà vingt ans une association de prévention et de lutte contre la toxicomanie, devenue un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Rapporteur pour avis sur les crédits de la mission « Santé » du projet de loi de finances pour 2007, j'ai essentiellement porté mes travaux sur l'efficacité du milliard et demi d'euros consacré à la lutte contre la toxicomanie et également énoncé un certain nombre de préconisations. Mon rapport évoquait aussi la question, que vous n'avez pas abordée, du détournement massif de l'usage des produits de substitution aux opiacés : aujourd'hui, la vente de Subutex est l'une de celles qui rapporte le plus aux officines pharmaceutiques, et ce produit est très présent sur le marché noir. Peut-on savoir dans quelles proportions ? J'espère en tout cas que la généralisation du dossier pharmaceutique permettra de lutter contre une telle dérive, dont nous avons tout intérêt à prendre la mesure.
J'ajoute que, à la fin de mon rapport, j'avais préconisé l'expérimentation – votée à l'unanimité par la Commission des affaires sociales – d'une salle de consommation à moindre risque car il nous importait d'aller au-devant de certains usagers déstructurés et perdus qui, dans de grandes agglomérations comme Paris ou Marseille, étaient de véritables laissés-pour-compte.
Enfin, je suis suffoqué de vous voir aussi sûr de vous. Quoique je sois investi dans ce domaine depuis quarante ans, je ne peux non seulement en dire autant, mais je dois avouer que j'ai également évolué : lorsque j'ai commencé à travailler, il était rigoureusement interdit de vendre une seringue, et puis, véritable révolution culturelle pour les praticiens que nous étions, cette vente a été autorisée.
Il convient donc d'éviter les caricatures !

Vous avez évoqué les maraudes mises en place par M. Xavier Emmanuelli. Mais comment améliorer encore le contact avec des personnes en situation de grande précarité dont vous avez dit qu'elles étaient les plus difficiles à atteindre ?
En outre, que pensez-vous du travail effectué par les communautés thérapeutiques – dont je ne sais d'ailleurs pas, monsieur le président, si leurs représentants seront auditionnés ?

J'ai eu l'occasion de vous auditionner en tant que présidente du groupe d'études sur la prévention et la lutte contre la toxicomanie, monsieur Étienne Apaire, et l'on ne saurait vous reprocher d'être versatile, reproche que je n'encours d'ailleurs pas moi-même.
En tant que responsable, à Toulouse, du réseau « Toxicomanie », je ne peux que m'associer aux propos de mon collègue et confrère Michel Heinrich. Il faut en avoir conscience : la toxicomanie n'est pas une maladie qui, comme l'angine rouge, se soigne en une semaine. Par ailleurs, il n'est pas possible, face à un phénomène aussi multifactoriel, de fixer des objectifs chiffrés. Je le dis et je le répète : la toxicomanie constitue vraiment un domaine particulier.
D'après le rapport de l'INSERM, « même si une partie non négligeable des usagers sont ou ont déjà été en traitement, certaines études montrent une augmentation du nombre d'usagers entrant en traitement pour leur dépendance ». Je suis donc d'autant plus étonnée que seulement 17 % des 38 % de personnes auxquelles vous avez fait référence s'engagent effectivement dans un parcours de soins que ce chiffre contraste fortement avec ce qui se passe sur le terrain. En France, dès lors que la buprénorphine haut dosage (BHD) est prescrite directement par le médecin généraliste, les patients, dont le nombre est en l'occurrence beaucoup plus important que celui que vous avez évoqué, ne sont pas dirigés vers un spécialiste.
Ils engagent un traitement de substitution.

Si, à la différence de la méthadone, le Subutex peut être directement prescrit par un médecin généraliste, il est un peu trop simple de considérer qu'il constitue à lui seul le traitement : d'ordinaire, cette prescription n'est que la première étape d'un processus. Un usager ne peut véritablement se « resocialiser » qu'une dizaine d'années après la substitution.
Si l'on considère qu'un toxicomane peut s'en sortir en un mois, arrêtons tout de suite les travaux de notre mission !
Vous êtes-vous mis en relation avec la sécurité sociale sur les conditions de commercialisation de la buprénorphine haut dosage ? Alors que la distribution de produits délivrés sur ordonnance au-delà de la date de validité de celle-ci déclenche à la sécurité sociale une alerte, tel n'est pas le cas pour l'achat quotidien de cette substance.
Quelles sont les politiques de lutte contre les nouvelles toxicomanies ? D'un bidon de gamma-butyrolactone (GBL), solvant vendu dans les grandes surfaces de bricolage, il est possible de tirer 800 doses individuelles. Or, l'utilisation du GBL provoque des dommages allant jusqu'au coma.
J'ai été très frappée par une des auditions de la commission « Addictions » de l'Académie nationale de médecine, à laquelle il m'arrive de participer, sur la pharmacologie de la cocaïne. L'ensemble des chercheurs auditionnés ont expliqué que la cocaïne dégradait à vie les réseaux synaptiques de ses usagers. Pourquoi, au lieu d'une communication devant un cercle restreint, ce type d'information ne serait-il pas l'objet d'un appel des chercheurs pour signaler les dangers que fait courir la cocaïne au cerveau ?
Est-il possible de créer des salles de consommation supervisées sans modifier la loi ? Si une nouvelle loi est nécessaire, serait-elle compatible avec les conventions internationales signées par la France ?

M. Étienne Apaire intervient ici ès qualités. Sur les salles de consommation supervisées, il nous fait part, non de son opinion personnelle, mais de la politique du Gouvernement, dont les grandes lignes ont été récemment rappelées par le Premier ministre. Si l'on se réfère à une enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes, dite « EROPP », régulièrement renouvelée, cette politique recueille l'accord de la majorité des Français.
Pour moi, l'objet de la politique de réduction des risques – à laquelle nous tous ici, je pense, sommes favorables – et celui de l'ouverture de salles d'injection supervisées ne sont pas les mêmes.
J'ai pu constater au Quai 9, à Genève, que, quelque admirable que soit le dévouement du personnel qui y travaille, ce centre – outre son coût exorbitant qui pourrait être consacré à d'autres formes de soins ou de prévention – attire un flux considérable de consommateurs, non seulement dans la salle d'injection, mais aussi dans son environnement immédiat. À Genève, ce flux, largement composé de Français, a permis l'implantation par une mafia d'un trafic tout autour de la salle, insuffisamment combattu aujourd'hui par la police et la justice.
Ce centre n'étant par ailleurs ouvert qu'aux heures de bureau, après dix-neuf heures les usagers problématiques se concentrent dans le quartier, sans soins particuliers. Il est facile d'imaginer comment la population vit la situation !
De plus, le contrôle, essentiel, de la qualité des drogues n'est effectué qu'a posteriori. En effet, lorsque les toxico-dépendants arrivent dans le centre, un échantillon de leur drogue est envoyé dans un laboratoire : mais le résultat ne revient qu'un mois plus tard. Ce mécanisme ne peut être considéré comme satisfaisant.
Enfin, les services de police et de justice du canton de Genève sont très déroutés : ils ne savent ni où ni comment intervenir.
Eu égard à ces considérations, quelles sont les actions que l'on pourrait développer à l'intention des personnes les plus marginalisées, celles qui ont le plus besoin de soins, et qui ne sont pas assez bien prises en charge, en France comme en Suisse ?
Enfin, notre législation permet-elle l'ouverture de tels centres en France ?

Au regard de l'ensemble de la politique de la MILDT, les salles d'injection me paraissent constituer un point relativement marginal.
Les effets de la politique de réduction des risques ont été positifs pour la diminution du nombre de surdoses et la limitation de la propagation du VIH et de l'hépatite C. Cependant, cette politique s'est beaucoup appuyée sur la substitution. Or, celle-ci ne concerne que les opiacés. Ce n'est que depuis peu que, pour traiter la dépendance aux autres substances – la cocaïne notamment –, on redécouvre le bénéfice du sevrage. Est-il envisagé de faire de celui-ci une priorité en France ? Des communautés fondées sur cette démarche obtiennent, dans notre pays comme à l'étranger, des résultats probants.
Ce sont 10 % du produit des confiscations de patrimoines de trafiquants, nous avez-vous dit, qui sont affectés à des actions de prévention. Les montants ainsi dégagés sont-ils suffisants ? Ne faudrait-il pas augmenter cette proportion ? Développer la prévention, c'est réduire la demande, et donc l'offre et les trafics.
Quels bénéfices pourraient être attendus d'un développement de la transformation des peines de prison en traitements, voire en sevrages ?

Quel bilan le magistrat bien informé que vous êtes dresse-t-il de la loi du 31 décembre 1970 et de l'injonction thérapeutique qu'elle a instituée ?

La France consacre 1,5 milliard d'euros à la lutte contre la drogue, dont 600 millions d'euros à la lutte contre les trafics. Les efforts des autres pays européens sont-ils équivalents ? Des dispositifs communs ont-ils été institués ? Des résultats peuvent-ils être cités ?
Alors que l'augmentation des crédits du fonds de concours « Drogues » est un signe de l'accroissement du trafic, vous nous avez exposé que la consommation de drogue diminuait. Comment expliquez-vous cette contradiction ?
Une véritable et efficace politique de prévention en direction des plus jeunes, au sein de l'éducation nationale notamment, ne pourrait-elle pas contribuer à une diminution de la consommation ? Aujourd'hui, ni eux ni leurs parents ne sont conscients des dégâts que peut provoquer la drogue. Comment améliorer l'information des parents pour leur permettre de faire eux-mêmes de la prévention auprès de leurs enfants ?
Ne faudrait-il pas aussi augmenter le nombre de places en centres de désintoxication ? Cinq mille places pour la France entière, ce n'est pas suffisant au regard de 250 000 drogués en 2006 et plus encore peut-être aujourd'hui – les listes d'attente en témoignent. S'il n'est pas possible de mettre immédiatement en oeuvre la décision d'un drogué de se faire soigner, il peut ensuite être trop tard.
Si des centres d'injection supervisés étaient créés, la MILDT serait-elle en situation de les contrôler ? Faudrait-il les insérer dans le dispositif des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues et des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ou au contraire les intégrer au sein de centres hospitaliers, où la prise en charge serait mieux organisée ?
Monsieur Michel Heinrich, madame Michèle Delaunay, en matière de méthodologie de santé publique, la prudence s'impose.
Ainsi, le rapport de l'INSERM expose qu'une étude coût-efficacité menée à Vancouver sur les modifications d'incidences du VIH a estimé à environ deux par an les décès qui auraient dû être liés au VIH et qui ont été évités.
La phrase suivante précise cependant : « L'estimation a toutefois été jugée un peu trop élevée […] ». Autrement dit, peut-être seul un décès par an aurait été évité. Après quoi, le rapport enchaîne : « […] sans que l'efficience économique du projet soit remise en cause par les auteurs ».
Je vous invite donc à analyser de plus près ce rapport, de façon à déterminer plus précisément ce qui est évité au regard du coût de ce centre où peu de monde est soigné, et dont la fonction est plutôt d'accompagner les usages.
Quelle peut être la valeur de l'expérimentation ? Pourquoi ne pas expérimenter aussi l'euthanasie active ?
Dans certains domaines éthiques, l'expérimentation n'est pas possible. Il faut choisir. Le Gouvernement est hostile aux salles d'injection. Il n'est pas question que nous nous lancions dans une expérimentation alors que nous disposons déjà d'autres solutions. À Vancouver, alors que les autorités locales avaient commencé à réfléchir sur la fermeture de la salle, il leur a été objecté qu'elles allaient répartir de nouveau dans la ville les usagers qui y affluaient en masse. C'est cette raison qui a entraîné le maintien de ce centre expérimental.
Par ailleurs, monsieur Michel Heinrich, si, dans une ville, la localisation des personnes en situation précaire n'est pas connue, l'implantation future du centre, quant à elle, est assez prévisible. Si une salle d'injection est installée à Paris, elle le sera rue de la Goutte-d'Or plutôt que place du Palais-Bourbon. Des associations pourront alors se plaindre de la « ghettoïsation » supplémentaire que créera pour eux cette implantation, laquelle leur amènera des personnes sans aucun avenir, puisque cette solution ne permet pas de sortir de l'usage des stupéfiants.
L'expérimentation des salles d'injection n'est donc pas une réponse.
Par ailleurs, les termes du débat ne sont pas les mêmes qu'en 2006. Depuis lors, des alternatives ont été mises en place. Aujourd'hui, 330 millions d'euros sont consacrés aux soins aux usagers qui s'injectent de la drogue, et 15 millions de seringues sont distribuées chaque année. Aux salles d'injection, nous pouvons opposer la méthadone, la BHD, une communauté d'addictologues, un dispositif de soins des plus performants. Il est possible de sortir de la drogue. Encore faut-il que ceux qui en sont dépendants acceptent de fréquenter les centres prévus pour les y aider.
Monsieur Patrice Calméjane, monsieur Philippe Goujon, voilà trente ans que je suis au contact des usagers de drogues. J'en ai reçu des milliers au parquet de Paris au titre des injonctions thérapeutiques.
Par ailleurs, madame Michèle Delaunay, je ne crois pas qu'il faille opposer l'Académie nationale de médecine aux addictologues : des regards complémentaires sont nécessaires.
C'est parce que j'ai admis la politique de réduction des risques et que j'accepte les échanges de seringues et la substitution – solutions pour empêcher la mort – que je ne suis pas obligé d'accepter les salles d'injection. Pour moi, elles ne sont pas des solutions. L'instrument pour privilégier une vie la plus libre possible est la substitution, et celui qui permet de lutter contre la diffusion du VIH est l'échange de seringues.
En revanche, il ne faut pas s'enfoncer dans l'accompagnement de l'injection. Un médecin ne pourra pas ne pas se poser la question de ce qui est injecté à l'issue de la fréquentation de la salle. Cette problématique nous amènera rapidement à celle de l'héroïne médicalisée, c'est-à-dire à la prescription par l'État, dans des structures sanitaires, de drogues qui seront ensuite remboursées par l'assurance maladie. Certes, l'Allemagne pratique ainsi ; mais la France n'est pas obligée de reprendre à son compte toutes les bizarreries expérimentales conduites à travers le monde. Nul n'est obligé de partager le projet de société auquel correspondent les salles d'injection. Même si je peux comprendre que certains puissent y être favorables, j'y suis personnellement hostile. La contagion n'est pas telle que nous soyons obligés d'y avoir recours.
Deux types de propositions sont sur la table pour les personnes en situation de grande précarité.
D'abord, qui sait où elles sont localisées ? Pourquoi choisir Paris ou de grandes villes pour ouvrir des salles d'injection ? La grande précarité se développe fortement en milieu rural.
Les personnes qui fréquentent les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sont plutôt en situation de comorbidité, consommatrices de cocaïne, et aussi, dans une proportion non négligeable, empêchées de fréquenter des centres de soins du fait d'une situation administrative irrégulière, notamment du fait de l'absence de papiers. Il faut d'abord envoyer des personnels de santé à leur contact. À Bordeaux, le préfet Dominique Schmitt a proposé d'envoyer des équipes de psychiatres là où les malades peuvent être en crise.
Le recours à la méthadone me semble préférable au recours à la BHD : il engage beaucoup mieux le patient dans un dispositif de soins. Les modalités de prescription de la méthadone, beaucoup trop rigoureuses et encadrées, devraient être simplifiées. Des bus mobiles permettant d'aller au contact des plus précaires pourraient être mis en place.
Un travail social doit aussi être conduit. On l'a vu avec le « Plan crack » à Paris : des personnes en très grande précarité peuvent être soignées dès lors qu'un toit et une certaine sécurité les « décollent du bitume », pour reprendre une expression de M. Xavier Emmanuelli. Il faut aller vers elles pour les ramener dans une vie où il sera possible de se préoccuper non seulement de leur intégration, mais surtout de leur situation psychique et des soins à leur apporter.
Monsieur le rapporteur, si des centres d'injection étaient mis en place, la MILDT ne pourrait pas les contrôler. Un dispositif de coopération interministérielle n'a aucune autorité sur la prescription de soins. Personne n'a le droit d'interférer dans la relation entre un médecin et son patient.
Pour en revenir à l'enquête de l'INSERM, certes un médecin peut considérer que la prescription de BHD n'est pas un vrai traitement médical. Il reste que la France a développé ce traitement comme tel. Le médecin qui le prescrit n'a aucune raison de se comporter comme une mécanique à distribuer des produits de substitution ; il inscrit bel et bien son malade dans un parcours de soins.
La lecture de la page 219 du rapport de l'institut montre que très peu d'usagers référencés dans les centres de soins entrent dans un parcours de soins. C'est assez logique : ils fréquentent ces salles d'injection non pour prendre un contact avec un professionnel du soin, mais simplement pour s'injecter ou « sniffer » le produit de leur choix dans un environnement sanitaire plus favorable.
Faute d'autre solution, j'admettrais l'intérêt de ces salles. Mais notre politique de pénalisation nous semble de nature à réduire les usages.
Par ailleurs, monsieur le coprésident François Pillet, monsieur Philippe Goujon, nous sommes liés par des conventions internationales. Prohibant la consommation de ces substances, elles ne nous incitent guère à nous lancer dans des expérimentations contraires à la loi. Alors que la communauté internationale compte cent quatre-vingt-dix pays, seules quelques villes, quelques régions, qui se comptent sur les doigts des deux mains, ont mis en place ce type de dispositif.
La MILDT va en revanche continuer à construire des communautés thérapeutiques. Elle ne reviendra pas sur la substitution. Elle est consciente du trafic de BHD : avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, elle a essayé de sécuriser les ordonnances afin de l'éviter.
Lorsque j'ai demandé quelle durée de traitement avait été prévue par l'autorisation de mise sur le marché de la BHD, il m'a été répondu que personne n'avait demandé au laboratoire d'y réfléchir. Pourquoi ? Le traitement est-il à vie ? La question ne mériterait-elle pas d'être posée ?
Les 10 % du fonds de concours au profit de la prévention s'ajoutent au budget de la MILDT, aujourd'hui de 22 millions d'euros par an, pour réaliser les campagnes télévisuelles et organiser des actions, notamment dans les écoles.
Nos enfants ont tous assisté, dans leur collège ou leur école, à une conférence d'un gendarme, d'un policier ou d'un représentant d'association. Ces actions de sensibilisation sont-elles utiles ?
Une vérification des connaissances auprès des enfants et de leurs parents sur les dangers des drogues et sur la loi qui s'applique à celles-ci a fait apparaître une maîtrise du sujet par les jeunes supérieure de 10 % au moins à celle de leurs parents. Nous en concluons que, ces dernières années, notre politique de prévention a négligé d'informer les adultes qui entouraient les jeunes. Pour combler cette lacune et faire en sorte que les adultes puissent répercuter nos messages, nous avons développé un dispositif dans leur direction. Il s'agit de les rencontrer dans les entreprises, les maisons d'emploi ou les mairies pour leur donner les éléments d'un discours clair vis-à-vis de leurs enfants.
Comment expliquer les distorsions entre l'accroissement du trafic et les chiffres positifs en matière de réduction de la consommation ?
Les organisations de trafiquants sont internationales et très riches. Leur chiffre d'affaires n'est pas entièrement réalisé en France.
Nous savons aussi que, malgré l'efficacité de notre action et la diminution de la consommation, chaque département français abrite deux ou trois grossistes en cannabis – il n'a pas été réalisé d'étude pour les autres drogues –, dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 et 500 000 euros par an. Cette situation n'est du reste pas sans impact sur le débat relatif à la dépénalisation.
Or, ces grossistes ne sont pas spécialisés. Tous les produits les intéressent. Lorsqu'ils constatent une baisse de consommation d'un produit, ils essaient d'en lancer un autre. À cet égard, nous avons déjà évoqué le GBL et les nouvelles drogues synthétiques.
En admettant – hypothèse hautement improbable – que le Gouvernement légalise la production de cannabis, du jour au lendemain les organisations criminelles essaieraient aussitôt de diffuser un autre produit.
Autrement dit, la diminution de la consommation d'un produit peut être contrebalancée par l'augmentation du trafic d'un autre, et donc ne pas être incompatible avec un maintien à haut niveau du chiffre d'affaires des trafiquants.
Fait nouveau cependant, le législateur – autrement dit l'Assemblée nationale et le Sénat – a récemment fourni aux forces de police et à la justice des outils leur permettant de s'attaquer franchement au patrimoine des trafiquants. Alors qu'autrefois confisquer le patrimoine d'un trafiquant était extrêmement difficile, le dispositif adopté – à l'unanimité, me semble-t-il – à l'initiative du président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, va rendre l'opération beaucoup plus simple pour les magistrats.
Enfin, si vous décidiez d'encourager le Gouvernement à s'engager dans des voies qu'il ne souhaite pas suivre, pourriez-vous faire l'économie d'un débat parlementaire ? Dans tous les pays où l'usage a été libéralisé, la décision a été précédée par un tel débat. L'Italie a même organisé un référendum ! Sans doute ne faut-il pas toujours suivre l'avis de la majorité : cette décision a mis l'Italie dans une situation invraisemblable, avec des taux de consommation énormes. Il reste que le peuple s'est prononcé.
Tous les parlementaires sont la voix de la France ; les faire débattre, si nécessaire, sur ce sujet ne me paraît pas complètement absurde. En tout état de cause, une telle proposition ne saurait pouvoir être négociée sur un coin de table, dans un bureau, à Matignon : elle doit être l'expression de la volonté de chacun.

Je vous rassure, monsieur le président, je ne crois guère possible, en France, de modifier la loi sans passer par le Parlement !
L'audition s'achève à dix-huit heures.
L'audition début à dix-huit heures.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend, en audition ouverte à la presse, M. Étienne Apaire, président du Groupe Pompidou du Conseil de l'Europe, M. Franck Zobel, rédacteur scientifique et analyste des politiques en matière de drogue à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), et M. Danilo Ballota, officier principal de police scientifique chargé de la coordination institutionnelle à l'OEDT.

Nous venons de nous pencher avec attention sur la politique française de lutte contre les toxicomanies. Nous souhaitons maintenant la replacer dans le contexte européen et international, afin d'en déterminer les spécificités et la comparer avec celles des autres pays d'Europe.
Je propose que MM. Franck Zobel et Danilo Ballota nous exposent, en une dizaine de minutes, les caractéristiques des toxicomanies en Europe et les principales catégories de politiques menées par nos voisins européens, en soulignant, lorsqu'elles existent, leurs différences les plus significatives avec la France. M. Étienne Apaire interviendra ensuite en tant que président du Groupe Pompidou du Conseil de l'Europe.
L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies collecte des données auprès de trente pays : les vingt-sept États membres de l'Union européenne, deux États candidats, la Croatie et la Turquie, et la Norvège.
Les thèmes couverts par notre observatoire sont au nombre de quatre : la consommation de drogues et ses conséquences, le marché des stupéfiants, les interventions visant à réduire la consommation de drogues et ses conséquences et, enfin, les législations, les stratégies et les dépenses publiques des États européens en ce domaine.
Depuis trente ans, au coeur de la problématique des drogues en Europe – au moins en termes de santé publique, la situation étant peut-être un peu différente en termes de sécurité publique et de criminalité organisée – figure la consommation d'opiacés, en particulier d'héroïne.
En Europe, la grande majorité des entrées en traitement et des décès due à la drogue est liée à l'héroïne. On estime à environ 1,35 million le nombre d'usagers problématiques d'opiacés, soit un adulte sur deux cent cinquante. La dépendance à l'alcool concerne, quant à elle, une personne sur trente.
Les problèmes liés à l'héroïne ont très sévèrement augmenté en Europe durant les années 1980 et 1990, avant de se stabiliser puis de diminuer vers la fin des années 1990. En revanche, depuis 2003 et 2004, on observe, de façon presque choquante, une inversion de tendance, la consommation cessant de diminuer avant de repartir à la hausse, alors que l'offre de traitements a été massivement accrue et les risques réduits.
Trois facteurs d'explication semblent se conjuguer.
D'abord, après avoir été exécrable pendant une dizaine d'années, l'image de l'héroïne auprès de certaines populations de jeunes semble être devenue relativement positive.
Ensuite, il faut tenir compte du vieillissement des consommateurs d'héroïne. Entre un quart et la moitié d'entre eux sont aujourd'hui âgés de quarante ans et plus, avec des « carrières » de consommation d'au moins vingt ans. S'ils ont survécu aux pires années de la consommation d'héroïne et de la diffusion du sida, leur état de santé est souvent celui d'une personne non consommatrice âgée de vingt ans de plus. Ce vieillissement des consommateurs se constate aussi à travers l'âge des personnes qui meurent par surdose en Europe, notamment en France.
Le troisième facteur d'explication est le développement de la polyconsommation. Depuis une dizaine d'années, la diffusion de la cocaïne en Europe a beaucoup augmenté. Les trafiquants sud-américains se sont davantage intéressés à notre continent ; ils ont ouvert de nouvelles routes, notamment via l'Afrique de l'Ouest. Le volume des saisies de cocaïne en Europe fluctue ces dernières années entre 60 et 120 tonnes, ce qui est considérable par rapport à celui d'il y a vingt ans. Cette disponibilité accrue de la cocaïne a eu un effet chez les consommateurs problématiques d'héroïne. En effet, ceux-ci la consomment désormais en sus de l'héroïne, de l'alcool et de médicaments comme les benzodiazépines. Or, les mélanges d'alcool et de cocaïne, ou encore d'héroïne et de cocaïne sont extrêmement dangereux.
La consommation de cocaïne a aussi augmenté de façon générale dans d'autres milieux, comme certains milieux dits « festifs ». Cette vague a cependant surtout touché des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie et le Danemark. Ailleurs en Europe, y compris en France, la hausse de la consommation, pour être réelle, est moins marquée.
La polyconsommation m'amène aussi a évoquer un phénomène nouveau, qui se développe depuis trois ou quatre ans : la diffusion de substances, naturelles ou synthétiques, proposées aux consommateurs comme des alternatives licites (« legal highs ») aux drogues illicites. Il s'agit par exemple de la méphédrone – un cathinone de synthèse – en remplacement de l'ecstasy ou de la cocaïne –, ainsi que de mélanges d'herbes exotiques auxquelles ont été ajoutés des cannabinoïdes de synthèse – en remplacement du cannabis.
Ce nouveau marché, très dynamique, s'est développé essentiellement sur internet. Nous avons recensé cette année cent soixante-dix commerces en ligne vendant ce type de substances. Les États peinent à suivre la rapidité de ce développement. Par ailleurs, les commerces s'adaptent rapidement aux mesures d'interdiction : chaque fois qu'une substance est interdite, ils en proposent de nouvelles en remplacement. Ce changement incessant de nom et de type des produits rend aussi très difficile la mesure de l'ampleur de la consommation de ces substances.
Le cannabis, enfin, est la substance illicite la plus consommée en Europe. Un quart des Européens environ en a consommé. Un jeune adulte sur huit en a consommé pendant l'année passée. La consommation de cannabis a fortement augmenté durant les années 1990, et l'on estime aujourd'hui que 4 millions d'Européens environ, soit 1 % de la population adulte, en consomment tous les jours. L'estimation pour la France est de 500 000 usagers quotidiens. Cette population présente des risques importants de troubles somatiques, psychosomatiques et sociaux.
La production indigène de cannabis en Europe s'est aussi beaucoup développée ; tous les États européens mentionnent aujourd'hui l'existence de plantations sur leur territoire.
Depuis 2003, tendanciellement, la consommation de cannabis en général – celle des adultes comme celle des jeunes scolarisés – a diminué en Europe. Si ce phénomène peut être rattaché au développement des mesures antitabagiques, une diminution de l'intérêt pour le cannabis a aussi pu être observée aux États-Unis et en Australie, avant même la diminution de la consommation en Europe. Toutefois, il faut rester attentif : les dernières données provenant des États-Unis indiquent un regain de la consommation de cette substance.
Au sein des institutions européennes, un consensus s'est établi sur l'absence de solution simple aux problèmes posés par la toxicomanie, et s'est exprimé le souhait d'une approche globale et intégrée, combinant à la fois réduction de l'offre – autrement dit lutte contre le trafic de drogue – et réduction de la demande – autrement dit prévention et prise en charge des difficultés dues à la drogue. L'observation de la législation et de son application fait apparaître une progressive convergence autour de la distinction entre le trafiquant de drogue, considéré comme un criminel méritant une peine de prison, et le consommateur, qu'il s'agit d'aider plutôt que de punir. Dans les faits, il semble que la grande majorité des usagers de drogues interpellés en Europe – essentiellement des consommateurs de cannabis – soient sanctionnés par un avertissement ou une amende, voire que les poursuites à leur encontre soient abandonnées. Il existe néanmoins des cas où des peines de prison sont infligées. Quant aux alternatives permettant de substituer un traitement à une peine de prison, si nous savons qu'elles existent dans la plupart des pays, nous ne connaissons ni leur nombre ni leur efficacité, très peu de données étant disponibles.
Nous n'avons également que très peu de données fiables et comparables en matière de réduction de l'offre – bref, sur le travail de la police, de la justice et des douanes. L'OEDT s'est engagé, avec la Commission européenne et Europol, à développer un nouvel ensemble d'indicateurs dans ce domaine.
Les données disponibles en matière de réduction de la demande sont plus nombreuses. Nous savons qu'en Europe, plus d'un million de personnes ont accès à un traitement lié à la toxicomanie. L'augmentation massive de cet effectif au fil des années 1990 et 2000 est due à la diversification des méthodes de soins et la multiplication des traitements ambulatoires.
La catégorie de traitement qui a connu la hausse la plus spectaculaire est celle de la substitution aux opiacés. Environ 670 000 personnes en Europe reçoivent ce type de traitement chaque année, soit sept fois plus qu'au début des années 1990. De 70 % à 75 % de ces traitements recourent à la méthadone et de 20 % à 25 %, pour la quasi-totalité en France, à la buprénorphine haut dosage. La morphine, la codéine et l'héroïne sont également prescrites en Europe, mais en très petites quantités, pour quelques centaines ou quelques milliers d'usagers.
Les autres types de traitement, destinés notamment aux usagers de cannabis ou de cocaïne, ont eux aussi connu une croissance rapide. Il s'agit avant tout de traitements ambulatoires combinés à une approche psychosociale. En effet, au contraire de la méthadone et de la buprénorphine haut dosage pour le traitement de la dépendance à l'héroïne, aucune molécule spécifique n'a montré d'efficacité pour le cannabis et la cocaïne.
Il est difficile de mesurer avec précision l'offre européenne de prévention. On peut toutefois en tracer les grandes lignes. Malgré les doutes qui pèsent sur leur efficacité, les interventions ponctuelles visant à informer les jeunes sur les dangers des drogues restent très largement majoritaires. En revanche, les programmes qui ont montré leur capacité à réduire la consommation de drogue – principalement des interventions structurées visant à améliorer les compétences sociales et à modifier certaines perceptions chez les jeunes – sont encore très rares.
La prévention sélective est également peu développée. Au lieu de s'adresser à l'ensemble des jeunes, y compris à ceux qui n'ont pas du tout l'intention de consommer des drogues, elle vise des populations à risque – jeunes en situation d'échec scolaire, jeunes délinquants, habitants de quartiers défavorisés –, chez qui la prévalence de la consommation de drogue est plus élevée. Quelques programmes néanmoins, conduits dans le domaine de la justice, se diffusent progressivement à l'échelle européenne.
Au bout du compte, les mesures phares mises en place en Europe au profit de la réduction des risques sont les traitements de substitution, déjà évoqués, et les programmes d'échange de seringues. Entre 40 et 100 millions de seringues stériles seraient échangées ou distribuées chaque année en Europe, soit en moyenne 80 seringues stériles par an et par injecteur.
Parmi les autres mesures, on peut citer la mise à disposition d'informations pour prévenir les infections ou les surdoses. Par ailleurs, depuis peu, un nombre restreint de pays teste la distribution de naloxone – un antagoniste qui permet d'interrompre l'action de la morphine – aux usagers de drogues et à leurs proches afin de leur permettre d'intervenir en cas de surdose.
Quatre pays de l'Union européenne – Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg et Espagne – ainsi que la Norvège et la Suisse ont aussi accepté la mise en place de locaux de consommation supervisés. Un peu moins de quatre-vingt-dix de ces structures ont été ouvertes en Europe dans environ soixante villes. Leur objectif est en général double : réduire non seulement les risques liés à l'injection de drogues, mais aussi les nuisances publiques, notamment la consommation de drogues dans certaines rues ou certains quartiers.
Enfin, différentes études ont montré que la population carcérale affichait souvent une prévalence élevée de consommation de drogues, avant, mais aussi parfois durant l'incarcération. Alors même que le milieu carcéral peut constituer une bonne opportunité de prise en charge des problèmes de drogue, l'accessibilité des services de traitement et de réduction des risques y est souvent faible. En outre, le taux de mortalité des consommateurs de drogues à la sortie de la prison est extrêmement élevé ; l'une des raisons en est le manque de suivi thérapeutique immédiat après la fin de l'incarcération. Il est donc possible dans ce domaine d'améliorer les réponses aux problèmes de toxicomanie. Des efforts sont en cours à l'échelle européenne.

Monsieur Franck Zobel, il semble ressortir de votre intervention, comme des propos tenus tout à l'heure par M. Étienne Apaire, que l'Allemagne pourrait être mieux protégée de l'augmentation de la consommation de drogues que les cinq États, dont le Royaume-Uni, que vous avez cités. Cette particularité pourrait-elle être due à des éléments spécifiques à ce pays ?

En France, l'État dépense 600 millions d'euros pour la lutte contre le trafic de stupéfiants. D'autres pays européens font-ils preuve d'une volonté aussi forte ?
Des campagnes communes contre la drogue, ciblées par type de public – jeunes, parents, accompagnants – pourraient-elles être organisées de façon synchronisée dans les pays d'Europe ?

Pour lutter contre les nouvelles filières de trafic de drogue, des coopérations en matière de répression sont-elles conduites ou envisagées avec les pays du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, en contrepartie des aides que leur apporte l'Union européenne ? Nous savons qu'aujourd'hui, plutôt que de continuer à habiter nos grandes villes et nos banlieues, les trafiquants s'y sont parfois expatriés.
Quelle est la position de nos collègues parlementaires européens en matière de lutte contre la drogue ? Des textes sont-ils en préparation ? Ils s'imposeraient en effet à nous une fois votés.

En Europe, nous avez-vous dit, la prévention à l'intention des jeunes est très rarement efficace. J'ai cependant cru comprendre que la méthode de prévention que la Suède avait réussi à mettre en oeuvre pour lutter contre l'accroissement de la consommation, en direction de sa jeunesse, obtenait des résultats. Qu'en est-il ?

Dans certains pays, des seringues stériles sont-elles distribuées dans les prisons?
Les jeunes Français ne comprennent pas du tout les messages de prévention qui leur sont destinés. Pouvez-vous faire état de situations inverses à l'étranger ?
Dans les pays où elle serait plus efficace, la prévention est-elle assurée, comme en France, par des conférences de gendarmes ou de policiers dans les écoles ? Cette méthode ne me semble pas la meilleure.
Contrairement à d'autres pays, la France préférerait de loin la buprénorphine haut dosage à la méthadone. Expliquez-vous cette situation par le manque de centres pouvant prescrire de la méthadone, ou encore par le droit qu'auraient ailleurs en Europe – au contraire de la France – les médecins de ville de faire de telles prescriptions, dans les mêmes conditions de précaution que celles respectées par les centres ?
Comment le sevrage des produits de substitution est-il organisé, dans les divers pays de l'Union européenne ? La possibilité de prescription de tels produits par les médecins sans limite de temps et sans contrôle de l'efficacité du produit, se retrouve-t-elle dans d'autres pays ?
Une définition du toxicomane par rapport au consommateur de drogues a-t-elle été formulée par les instances européennes ?

Existe-t-il un modèle européen de lutte contre la toxicomanie et de prise en charge des toxicomanes ? Si oui, est-il différent d'un éventuel modèle américain, à tout le moins nord-américain ? Pouvez-vous nous éclairer sur les éventuels débats entre les États-Unis et l'Union européenne sur ce point ?
Les niveaux de consommation de drogues en l'Allemagne sont comparables à ceux constatés en France.
Pour des raisons d'organisation politique des pays, il est très difficile de connaître le montant de leurs dépenses. Néanmoins, la plus grande partie de leurs budgets est affectée à la réduction de l'offre, c'est-à-dire à la lutte contre le trafic.
Nous n'avons aucune preuve de l'efficacité de la politique de prévention, majoritairement diffusée en Europe, visant à attirer l'attention des jeunes sur la dangerosité de la drogue. D'autres types d'interventions moins spécifiques – interventions auprès des écoliers pour les aider à renforcer leur capacité à agir dans la vie, à dire « non », à interagir avec les autres – ont quant à eux des résultats, y compris sur la consommation de drogues.
Pour des raisons historiques très fortes, la Suède mène une politique stable et très claire : elle souhaite une société sans drogue. Les Suédois ne comprendraient pas l'approche hollandaise, ou celle du Portugal où la décriminalisation et les locaux de consommation ont été envisagés. Par contre, si la Suède a des niveaux de consommation assez bas, comme dans la plupart des pays scandinaves et les pays du sud-est de l'Europe, et si elle arrive à éviter les consommations les moins problématiques, elle parvient difficilement à réduire les consommations qui engendrent le plus de mortalité et de morbidité.

En parlant de « consommations problématiques », pensez-vous aux personnes souffrant de problèmes de santé ?
J'entends les consommateurs réguliers de drogues dures ayant un impact sur leur vie professionnelle, sociale et familiale.

Considérez-vous la définition de « drogue dure » – sujet à caution dans le débat politique français – comme un concept scientifique ?
Je parle des drogues induisant les effets psycho-actifs les plus puissants, utilisées régulièrement et de la manière la plus dangereuse, à savoir par injection.
Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux IV (DSM IV) retient pour sa part quatre critères pour définir cliniquement la dépendance ou la consommation problématique : une consommation non contrôlée et qui modifie la vie, une consommation qui augmente au fil du temps, une tolérance à la consommation…

La première définition est soit subjective, soit restrictive s'il ne s'agit que de l'injection.
La seconde définition, clinique, permet de diagnostiquer un éventuel problème de toxicomanie. Dans la mesure où l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies procède à des observations populationnelles, il a été amené à distinguer différents types de consommation, et à utiliser la définition suivante : « l'usage répété de cocaïne, d'amphétamine ou d'héroïne, ou l'injection de drogue », d'où effectivement une certaine subjectivité.

À mes yeux, toutes les drogues – y compris licites – peuvent être très dangereuses pour la santé mentale. Or votre définition politique renvoie à la distinction entre drogues dures et drogues douces.
Nous avons décidé, il y a au moins cinq ans, d'apporter une définition, non pas politique, mais technique permettant de mesurer l'évolution « problématique » de la consommation, en particulier du cannabis. Et nous sommes en train de revoir cette définition pour coller à la réalité.
Dans les groupes de travail du Conseil de l'Europe, M. Étienne Apaire s'est toujours opposé à l'utilisation du terme « problématique ». Nous avons souhaité une définition technique afin de pouvoir mesurer les phénomènes, mais votre remarque est très pertinente, monsieur le député.

Les définitions sont inspiratrices de politiques, y compris celle distinguant les drogues dures et les drogues douces, tombée en désuétude dans notre débat politique, mais qui reste dans le grand public un paradigme pouvant induire bien des errements.
Aujourd'hui, certaines personnes dépendantes utilisent non pas un seul produit, mais passent d'une substance à l'autre en fonction de l'état du marché, de leur situation professionnelle, sociale ou familiale. Ce phénomène de la polytoxicomanie est-il observé à l'échelle européenne ?
Vous avez employé le terme « legal » à propos de la méphédrone au Royaume-Uni. Est-ce une réalité ou une mauvaise farce diffusée sur internet ?
Les « legal highs » désignent des drogues légales. À leur arrivée sur le marché, elles ne sont pas contrôlées. Elles ne sont pas mentionnées dans les conventions internationales.

Qu'elles ne soient pas encore interdites ne signifie pas forcément qu'elles soient légales.
Dans les six prochains mois, conformément aux instructions de la Commission européenne, tous les États membres devront mettre la méphédrone sous contrôle. Mais, comme l'a dit mon collègue, les offres de drogues sont si nombreuses et variées qu'elle sera certainement remplacée par d'autres substances.

Les « legal highs » sont dont des substances synthétiques fabriquées par des chimistes dévoyés.
…qui profitent des opportunités du « business » !
Dans ce domaine, la lutte contre l'offre ne fait pas l'objet d'une politique communautaire, mais les États se rencontrent chaque mois à Bruxelles dans le cadre du groupe horizontal « Drogue » pour partager les informations sur leur situation respective. Les Britanniques nous ont fait part de cette catastrophe : une drogue légale lancée comme un produit marketing, mais devenue le quatrième produit le plus consommé en un an, et qui engendre des problèmes sanitaires avec des consommations isolées ou associées. À la suite de ces informations, la commission des stupéfiants du ministère de la santé a décidé, au nom du principe de précaution, de proposer à la ministre chargée de la santé de l'époque, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, le classement de ce produit. Il est donc classé, même si son niveau de consommation n'est pas élevé en France.
Nous gérons avec Europol un système d'alerte destiné à identifier les nouvelles substances. Nous en avons identifiées dix chaque année de 2005 à 2007, trente en 2008, quarante en 2009, cinquante en 2010, et nous nous attendons à un nombre plus important cette année. Le phénomène est en plein développement.
Nous disposons de très peu d'informations en la matière. Souvent de type journalistique, elles renvoient à des pistes en Asie, où ces molécules sont facilement disponibles, et à de l'ingénierie plutôt européenne.
S'agissant des autres points soulevés, je préciserai que la polytoxicomanie est généralement la règle en Europe.
Quatre ou cinq pays européens, dont je vous communiquerai la liste précise, ont mis en place la distribution de seringues stériles en prison.
Dans d'autres pays, la méthadone, prescrite par les médecins généralistes, est plus accessible. Le rapport entre sécurité et efficacité de la buprénorphine haut dosage et de la méthadone fait l'objet d'un débat dans la mesure où la première est un peu plus sûre, et la seconde un peu plus efficace.
Les études britanniques sur le sevrage, s'appuyant sur le suivi de personnes en traitement, nous ont enseigné, au cours des deux dernières décennies, que la dépendance, particulièrement à l'héroïne, doit être considérée comme une maladie chronique dans la mesure où les consommateurs ont besoin d'énormément de temps pour s'en sortir.
Le gouvernement écossais a opéré un changement radical en passant d'une stratégie de réduction des risques à une stratégie orientée vers la guérison. En effet, après avoir passé en revue l'ensemble de la littérature traitant des moyens capables d'aider les gens à sortir de la toxicomanie, les Écossais ont observé deux choses : premièrement, les traitements de substitution sont les plus sûrs et les moins dangereux, et ils offrent le plus de chances aux personnes de s'en sortir ; deuxièmement, l'arrêt de la consommation et la réinsertion des toxicomanes dépendent, d'une part, du réseau social existant autour d'eux et, d'autre part, des possibilités de réinsertion qui s'offrent à eux. Ainsi, en l'état actuel des connaissances, le traitement de substitution, certes critiqué, reste le plus protecteur, non seulement pour le consommateur de drogues, mais encore pour la société – moins de crimes étant commis.
Si la France dépense 600 millions d'euros, nous ne disposons pas de montants pour les autres pays. Cependant, nous savons que les interventions mises en place par l'Europe pour lutter contre le déplacement du trafic de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud et l'Afrique ces cinq dernières années se sont révélées efficaces.
Le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (MAOC-N), structure intergouvernementale réunissant sept pays, dispose d'agents basés à Lisbonne chargés de surveiller le trafic de cocaïne transitant de l'Amérique vers l'Europe, l'Afrique de l'Ouest étant une zone de stockage. Les résultats sont intéressants : 45 tonnes de cocaïne ont été saisies ces trois dernières années. À l'occasion d'une réunion du groupe horizontal « Drogue » à Bruxelles, le directeur du MAOC-N nous a précisé que les trafiquants ne se donnent même pas la peine de dissimuler les paquets de cocaïne sur les navires : les hélicoptères peuvent les apercevoir stockés sur le pont et les photographier. C'est une « autoroute », comme le dit Europol. Elle a été « stoppée », et nous y avons constaté une baisse des saisies l'année dernière. Cependant, nous ignorons si cette baisse est due au fait que les trafiquants sévissent ailleurs ou si la fiabilité des données sur les saisies est relative.
Avec la mise en place du Centre de coordination pour la lutte anti-drogue en Méditerranée (CeCLAD-M), la France a dupliqué cette expérience dans la Méditerranée.
Le pacte européen contre les « routes » de la cocaïne et de l'héroïne, initié par votre ministre de l'intérieur il y a quelques mois, vise à faire travailler ensemble police et justice des pays de l'Union européenne afin de lutter contre le trafic de cocaïne depuis l'Amérique latine, mais aussi d'héroïne en provenance d'Afghanistan. Nous n'avons pas de données fiables, et la lutte n'est pas gagnée. En effet, les saisies de cocaïne dans les Balkans et en Afrique de l'Est sont sans doute la preuve que d'autres « routes » se mettent en place : c'est le « balloon effect ». Cependant, à la suite de la signature du Traité de Lisbonne et de l'adoption de la stratégie de sécurité intérieure, l'Union européenne s'est donné les moyens, y compris financiers, de lutter plus efficacement contre le trafic venant de l'extérieur de l'Union.
Les substances faisant l'objet d'un trafic problématique dans l'Union européenne sont, en particulier, les « legal highs », mais aussi le cannabis, dont l'ampleur de la production nous est inconnue.
En Afrique, le trafic concerne plutôt des pays situés plus au sud que le Maghreb, comme la Guinée et la Guinée-Bissau, cette dernière étant un terrain particulièrement fertile pour le trafic en raison de sa situation sociale dramatique : les établissements pénitentiaires y sont inexistants et le salaire d'un policier se limite à 10 dollars par mois. Des projets européens existent pour cette zone. Néanmoins, comment s'assurer de la fiabilité d'un gouvernement auquel l'Union européenne alloue 4 millions d'euros ? C'est un réel problème.
Dans son action contre les drogues, le Parlement européen pâtit de la diversité de ses couleurs politiques. Les Verts, notamment, réclament une dépénalisation, voire une légalisation, du cannabis. Le Parti populaire européen est, lui, attaché à la question du sevrage et de la réhabilitation des usagers. Le Parlement européen dispose néanmoins de deux armes : premièrement, en matière de programmes financiers, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dite « LIBE », peut décider de la nature et de la destination des fonds ; deuxièmement, l'Union européenne achèvera en 2012 son cycle stratégique de huit ans, lequel sera suivi d'une évaluation extérieure permettant de mesurer les résultats de la lutte contre les drogues. Et, grâce à une nouvelle stratégie pour 2013-2020, le Parlement européen sera appelé à jouer un rôle important en établissant des directives.
Deux fois par an à Bruxelles, nous rencontrons nos homologues américains. Avant l'accession au pouvoir de M. Barack Obama, les États-Unis privilégiaient la guerre aux drogues, y compris aux usagers. L'approche de l'administration actuelle est plus équilibrée : elle repose sur une politique axée sur les aspects sociaux et médicaux du phénomène, comme celle défendue en Europe depuis une dizaine d'années, même si quelques différences importantes subsistent, par exemple en matière de réduction des risques.

Quels moyens financiers l'Europe met-elle sur la table, à la fois pour lutter contre les trafics et développer sa politique en direction des États ?
Même un fonctionnaire de la Commission européenne aurait du mal à répondre à cette question, chacune des directions générales ayant son propre budget.
Toutefois, je peux vous dire que, en cinq ans, 21 millions d'euros seront déployés dans le cadre d'un programme de prévention et d'information de la direction générale de la justice, et que la même somme le sera, à raison de 3 millions d'euros chaque année, pour un programme « Santé » piloté par la direction générale de la santé, basée au Luxembourg. En outre, un programme de recherche porte sur des centaines de millions d'euros.
Il faut y ajouter les programmes extérieurs d'aide au développement et aux relations extérieures, qui mobiliseront également plusieurs centaines de millions d'euros, par exemple les aides à la communauté LAC (latino-américaine et des Caraïbes) et les projets menés en Afghanistan.
D'après une étude réalisée il y a quelques années, le volume financé par la Commission européenne représenterait 50 % de l'ensemble des financements de tous les pays de l'Union européenne.
Il m'est difficile de vous donner un montant précis dans la mesure où, aux financements des différentes directions générales de la Commission, s'ajoutent les contributions nationales. Cependant, nous avons estimé en 2009 la contribution de l'Union européenne à 700 millions d'euros.
De très intéressants changements de stratégie ont émergé en Europe, par exemple en Écosse, mais aussi en Angleterre, dont la stratégie est désormais plus conforme à celle de la France.
D'autres pays évoluent, comme les Pays-Bas, où le débat a conduit certaines autorités locales à souhaiter voir réservée la fréquentation des « coffee shops » aux seuls résidents réguliers. En outre, la distinction entre la consommation des majeurs et celle des mineurs y est désormais plus claire. Nous attendons la nouvelle stratégie de ce pays, qui doit nous conduire à être très prudents dans nos propositions.
La Californie, après un débat important, a renoncé à légaliser la production et la consommation du cannabis. On peut cependant se demander si ce n'est pas ce débat qui a abouti à faire croire aux jeunes Américains que le cannabis n'était pas si dangereux, alors que sa consommation avait baissé de 25 % ces dernières années aux États-Unis.
Autre évolution au plan mondial : les distinctions subtiles entre pays producteurs et pays consommateurs s'amenuisent considérablement. En effet, si les drogues chimiques sont plutôt l'apanage de pays développés, leur consommation se développe dans les pays asiatiques. En outre, les pays producteurs deviennent des pays consommateurs. Le débat international reposant sur l'idée d'un partage des responsabilités plutôt au débit des pays riches est donc en train de changer, sachant que les pays producteurs disposent de beaucoup moins de moyens pour se défendre. On compte un million d'héroïnomanes en Afghanistan, entre trois et quatre millions au Pakistan. Ces pays sont désormais tout autant victimes que nous de leur production. Au Sénégal, en Guinée et Guinée-Bissau, et maintenant au Maroc et en Algérie, la route de la cocaïne déverse aussi des drogues parmi les populations.
Nous devons impérativement, dans le cadre de nos coopérations, mettre nos savoirs – en particulier en matière de réduction des risques – à la disposition de ces pays. Pour ce faire, le Groupe Pompidou est très attaché à tenir compte de la présence, dans le cadre de la « Grande Europe », de trente-cinq pays fort différents les uns des autres en termes de culture, tels que l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine ou la Biélorussie.
Le Groupe Pompidou, dont la France a accepté de prendre la présidence, réunit en effet trente-cinq États : les vingt-sept membres de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent, notamment, la Russie, la Suisse, la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'ancienne république de Macédoine et la Serbie. Des accords d'association avec d'autres pays riverains – Maroc, Tunisie, Liban, Égypte et Jordanie –, notamment dans le cadre du réseau méditerranéen MedNet, permettent de mettre en place des dispositifs de formation, voire des échanges de savoir en matière de soins.
Le Groupe Pompidou permet de promouvoir une politique équilibrée, identique à celle de l'Union européenne, privilégiant à la fois la prévention, le soin et la lutte contre les trafics, et ce dans une franche affirmation du respect des droits de l'homme.
Le Groupe Pompidou a été à l'initiative de la création de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, repris par l'Union européenne. Nous souhaitons, dans le cadre de la présidence française, appuyer le caractère équilibré des politiques à mettre en oeuvre, mais aussi développer une logique d'observatoire pour tous ces pays, beaucoup d'entre eux ignorant les dangers qui les guettent : les trafics, mais aussi les conséquences désastreuses de l'usage des drogues.
La Russie, située sur la route de l'héroïne, est très désireuse de nous sensibiliser sur les dangers qu'elle court, mais également sur les possibles partages de savoir, notamment en matière de substitution et de traitement judiciaire.
Certains États membres du Groupe Pompidou, comme la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, disposent d'une panoplie étoffée d'outils de prise en charge des toxicomanes : programmes de substitution, d'échanges de seringues, communautés thérapeutiques. D'autres ont peu de moyens ; c'est le cas de la Macédoine, du Monténégro et de l'Albanie. D'autres encore s'interrogent sur les dispositifs à mettre en place. À cet égard, une des difficultés réside – comme pour toutes les enceintes – dans notre incapacité à définir les limites des concepts que nous employons. Cela renvoie d'ailleurs au débat national sur le regard des Français sur les dispositifs de réduction des risques. Certains pays fonctionnent comme le nôtre : s'ils estiment le concept précis, ils seront favorables aux échanges de seringues et à la substitution, mais s'ils se rendent compte que ces dispositifs s'accompagnent de l'existence des salles d'injection supervisées ou de la prescription médicalisée d'héroïne, ils feront un blocage et seront contre, et tout le dispositif de réduction des risques sera alors remis en cause.
Au sein de l'Organisation des Nations Unies, le même débat existe entre les partisans d'une définition des termes et ceux qui y sont opposés, souhaitant ne pas voir obérées les mesures mises en place à titre plus ou moins expérimental par certains pays. Je pense donc qu'il sera important à l'avenir de définir les termes employés.
Sans citer de pays, je dirai que toutes les expérimentations sont menées dans le monde, mais que toutes les politiques ne se valent pas. De ce fait, parmi les pays où la consommation de drogue est très importante, certains enregistrent un taux de transmission des maladies très élevé, alors que d'autres, beaucoup plus tolérants, connaissent une situation sanitaire moins grave. Il faut donc arriver à mettre en place des consensus minimaux : c'est ce à quoi la France va s'employer.
Les salles d'injection et les échanges de seringues en prison sont des dispositifs très minoritaires. Nous ne pouvons pas, dans des enceintes internationales comme le Groupe Pompidou ou le groupe horizontal « Drogue », penser que nos convictions sont obligatoirement partagées. Si nous voulons faire partager nos convictions sur certains dispositifs faisant consensus, comme l'échange de seringues et la substitution, il nous faudra avoir des ambitions plus raisonnables.
Il importe de considérer le phénomène au-delà du seul point de vue national. Pour passer beaucoup de temps dans les enceintes internationales, je sais que notre communauté scientifique souhaite voir mises en oeuvre des politiques fondées sur des preuves scientifiques. Cela implique de mettre en place des dispositifs destinés à recueillir l'opinion des populations sur les mesures existantes. L'enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes est une des rares qui existent à l'échelle européenne. L'Italie a, certes, organisé un référendum sur la politique de dépénalisation, mais très peu de pays réalisent ce genre d'enquêtes d'opinion.
Je suis très heureux que ce débat ait lieu et que la presse y participe, car nous devons aussi progresser dans le domaine de l'information des populations pour faire de la lutte contre la toxicomanie un vrai sujet de société. Cette évolution répond aux souhaits des membres du Groupe Pompidou, au même titre que le partage des politiques en matière de prévention. Un clip antidrogue européen, réalisé à l'initiative du Groupe Pompidou, a été diffusé par ARTE et par plusieurs chaînes internationales. Sous la présidence française de l'Union européenne, nous avons proposé à nos amis européens de partager quelques films de prévention, mais nous nous sommes heurtés à des questions juridiques, liées à la protection du droit à l'image.
Sachant qu'un grand nombre de Français regardent de nombreuses chaînes de télévision, nous devrions utiliser nos dispositifs de prévention de manière plus complète. Nous allons essayer de le faire grâce au Groupe Pompidou car celui-ci a la chance, en tant que groupe d'États, de ne pas dépendre, comme nos amis de l'Union européenne, de mécanismes compliqués tant sur le plan politique que sur le plan financier. Au Groupe Pompidou, ce qui est décidé le 1er janvier peut être mis en place avant le 31 décembre.
Le Groupe Pompidou propose un certain nombre de formations : une formation d'addictologue nous a permis de proposer la substitution au Maroc, ce qui n'était pas facile dans un pays du Maghreb. En Algérie, nous proposons une formation commune destinée aux magistrats, aux éducateurs et aux policiers. Nous souhaitons, avec l'aide de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, mettre en place à très bref délai des observatoires dans chacun de ces pays ainsi qu'un observatoire méditerranéen, qui pourrait être situé à Lisbonne.

Il y a urgence à agir dans les pays producteurs dont nous connaissons l'instabilité politique – je pense notamment à l'Afghanistan – et qui deviennent à leur tour consommateurs. Il faut savoir que, dans certaines régions du monde, il est naturel de cultiver des stupéfiants. J'ai appris à ce titre que la ville de Toulouse, dont je suis l'élue, est celle où la culture du cannabis sur les balcons est la plus répandue.
Des pays se construisent et fondent en partie leur économie sur cette production. Cela me paraît très inquiétant.
Si j'ai bien compris, monsieur Étienne Apaire, en matière de lutte contre la toxicomanie, il n'existe aucun début de commencement d'harmonisation des législations sur le plan européen, contrairement à ce qui se passe en matière de droits commerciaux et de droits civils. Est-ce bien la réalité ?

Les pays qui adhèrent au Groupe Pompidou ne partagent pas tous la même philosophie. Ont-ils au moins les mêmes objectifs ? Chaque pays adhérent participe au financement du groupe, mais la participation de la France relève-t-elle du budget de la MILDT ?

Je viens de consulter le site internet du Groupe Pompidou : je suggère de noter ce lien dans notre rapport d'information car il contient des informations intéressantes. On y lit, par exemple, qu'il existe un prix européen de prévention des drogues, destiné à récompenser les initiatives les plus intéressantes prises en matière de prévention et de lutte contre les toxicomanies.
Madame Catherine Lemorton, vous évoquez à juste titre les pays en difficulté, mais il existe un certain nombre de pays qui se portent mieux. En Colombie, M. Àlvaro Uribe a trouvé un État détruit, où Pablo Escobar était quasiment aux commandes. Il a réussi à reconstituer un État de droit et une force de sécurité qui, petit à petit, a gagné des parts de marché sur les criminels, qu'il s'agisse des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ou d'organisations terroristes devenues des organisations criminelles. Voilà un modèle de reconstruction d'État !
Dans tous les pays frappés par le phénomène, on ne pourra regagner les coeurs et restaurer la sécurité uniquement par une coopération militaire ou policière. En Guinée-Bissau, il faut une prison civile, ainsi que des juges qui ne libèrent pas les criminels et dont on puisse garantir la sécurité. Mais on peut regagner du terrain pour une raison économique simple : le paysan qui cultive la coca, le pavot ou le cannabis est souvent exploité et profite en réalité très peu de sa production. Une mobilisation suffisante de la communauté internationale suffirait pour substituer à la production de produits stupéfiants une production de céréales, par exemple, transformant ainsi une économie malsaine en économie saine. Ces économies de substitution peuvent être développées grâce aux budgets européens.
Nous devons donc reconstituer les États. Avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'Union européenne, nous avons la volonté de développer cette « capacity building », c'est-à-dire de restaurer la capacité des États à être des États. Car ce n'est pas la drogue qui détruit les États : elle n'est qu'un révélateur de leur faiblesse. Dans certains pays qui se trouvent au coeur de l'actualité, les organisations criminelles se sont installées du fait d'un vide gouvernemental.
Concernant l'harmonisation des législations, nous nous heurtons à deux difficultés.
La première vient de ce que certains pays ne sont pas construits comme le nôtre. Dans les États fédéraux, en matière de salles d'injection, les compétences peuvent être régionales, voire locales, et on y observe parfois une très grande disparité entre les politiques mises en oeuvre. C'est le cas en Allemagne, où la politique de tel Land diffère de celle de son voisin. En Suisse, les cantons de Vaud et de Genève, pourtant peu éloignés l'un de l'autre, ne mènent pas du tout la même politique.
Seconde difficulté : le respect de la loi n'est pas le même partout. On trouve des lois « dures » associées à des pratiques « molles », et des pratiques « dures » associées à des lois « molles ». Dans ces conditions, il est très difficile pour l'observatoire d'évaluer la réalité. C'est pourquoi nous essayons de mettre en place des dispositifs minimaux. C'est ainsi que des pénalités minimales obligatoires ont été instituées sur le plan européen, obligeant chaque État à condamner les trafiquants à des peines planchers, ce qui n'était pas le cas par le passé. Cela traduit une évolution.
En outre, les mots n'ont pas partout la même signification. Dans certains États, une sanction administrative ressemble étrangement à ce que nous appelons une sanction pénale : la responsabilité a été transférée de la robe noire du magistrat à la blouse blanche du médecin, mais la sanction de privation de liberté existe tout autant. Il faut donc bien dégager les vraies différences. Nous disposons en Europe du groupe horizontal « Drogue » et du pacte européen contre la drogue : c'est bien, mais le meilleur moyen de convergence reste la population. Ce qui se passe aux Pays-Bas n'a rien à voir avec les mauvais compliments que la France adresse depuis trente ans à la politique de tolérance néerlandaise, mais doit être rapproché de l'attitude des citoyens néerlandais à l'égard de cette politique.
Nous devons être positifs, avancer vers ce qui nous rassemble et ne pas nous arrêter sur nos différences.
Les choses sont plus complexes avec les pays qui ne partagent pas notre sentiment d'urgence, dont certains d'ailleurs ne se trouvent pas à l'autre bout du monde. L'observatoire ne peut les mentionner, sous peine de se fâcher avec tous ces pays, mais il existe en Europe de gros différentiels de consommation. La France possède des frontières communes avec des pays qui comptent un million de consommateurs, tant à l'est, au sud-est, au sud-ouest qu'outre-Manche. En matière de trafic de cocaïne, par exemple, notre pays se trouve au centre d'une turbulence importante, car les substances doivent être véhiculées et la France est un grand pays de transit. L'avantage pour notre pays est que ces fortes consommations nous protègent. Nous sommes un peu dans la situation de l'appartement qui se trouve sur un palier en comptant plusieurs, mais qui seul possède une porte blindée. Cela dit, ceux de nos départements situés à la périphérie de ces pays – les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales – enregistrent des consommations importantes. La situation sécuritaire de ces pays devra être réexaminée car ils sont victimes d'organisations criminelles qui se sont installées sur leur territoire afin d'alimenter toute l'Europe en produits stupéfiants. Nous devrons sans nul doute avancer, dans le cadre des discussions que nous menons à Bruxelles, sur le plan des conséquences sécuritaires et sanitaires des politiques qui sont menées par nos voisins.
Dès 1997, le Parlement européen s'est penché sur l'harmonisation des législations en matière de drogue. En 2005, un rapport réalisé à la demande de la MILDT présentait la situation dans les différents pays membres en matière d'usage et de possession de drogue. Le rapport de 1997 du Parlement européen a donné lieu à une initiative de la Commission européenne, mais le Conseil, sous la présidence irlandaise, a souhaité l'assouplir. Le texte adopté vise l' « approximation » des législations, et non pas leur « harmonisation ». Il est clair, à la lecture de ce texte, que l'harmonisation des législations ne fait pas consensus. Les États membres ont choisi de ne plus parler de législation, mais seulement de se mettre d'accord sur les principes – le respect des droits de l'homme, par exemple –, les objectifs et les actions. Le Conseil a ainsi adopté un ensemble d'actions s'étalant jusqu'en 2020 et laissant chaque État agir selon sa propre volonté politique.
Madame Françoise Branget, le financement du Groupe Pompidou relève du budget de la MILDT. En dépit du fonds de concours « Drogue », nos budgets sont plutôt en baisse. Si vous pouviez faire en sorte qu'ils augmentent, nous en serions très heureux.

Je vous remercie, messieurs, pour votre participation. Nos collègues ont été heureux de recevoir des réponses précises à leurs questions.
La séance est levée à dix-neuf heures trente.