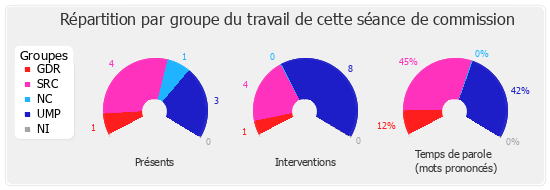Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale
Séance du 6 avril 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
Mercredi 6 avril 2011
La séance est ouverte à seize heures.
(Présidence de M. Christian Blanc, vice-président de la Mission d'information)
La Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale entend, en audition ouverte à la presse, Mme Anne Bucher, directrice des réformes structurelles et de la compétitivité à la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, et M. Gwenole Cozigou, directeur « industries chimiques, métalliques, mécaniques, électriques et de la construction ; matières premières » à la direction générale Entreprises et industrie de la Commission européenne.
Je remercie tout d'abord votre mission de nous avoir invités. Nous savons votre temps précieux et mesurons donc le privilège de pouvoir nous exprimer devant vous. Débattre avec des législateurs nationaux est toujours pour nous très enrichissant.
J'essaierai de vous donner un éclairage européen sur les questions de compétitivité et de financement de la protection sociale.
La France souffre-t-elle d'un problème de compétitivité ? Hélas, oui, les chiffres sont cruels. Depuis une quinzaine d'années, ses parts de marché se contractent et le déficit de sa balance courante se creuse, y compris dans le domaine des services, ce qui est nouveau.
Peut-on établir un lien entre cette détérioration et l'évolution du coût du travail ? La productivité a évolué de la même manière en France et en Allemagne, mais la politique de modération salariale menée par l'Allemagne, tout à fait exceptionnelle en Europe, explique la meilleure performance en matière de coût du travail outre-Rhin. Les coûts salariaux unitaires ont augmenté plus vite en France qu'en Allemagne, mais au même rythme que dans la zone euro en moyenne. La France étant en concurrence avec des pays à bas salaires, elle a bien entendu perdu en compétitivité de ce point de vue. Néanmoins, une fois pris en compte les taux de change effectifs, la dégradation est moins importante qu'il n'y paraît sur la seule base des coûts salariaux. Cela prouve que les exportateurs français se sont efforcés de préserver la compétitivité prix de leurs produits en réduisant leurs marges à l'exportation – ce qui, soit dit au passage, n'est pas viable à long terme. Le poids des charges sociales, dont le taux est parmi les plus élevés d'Europe, peut-il expliquer ce recul de la compétitivité relative de la France ? S'il peut être à l'origine de la difficulté à pénétrer certains marchés, il n'explique pas la perte de compétitivité constatée depuis une quinzaine d'années, car il n'a quasiment pas varié sur la période. Au total, la mauvaise performance de la France à l'exportation n'est donc pas imputable uniquement à l'évolution du coût du travail.
Il y a d'autres raisons, d'ordre plus structurel. Les indicateurs de compétitivité hors prix révèlent des faiblesses importantes du tissu productif français. Je n'en évoquerai que quelques-unes. Les petites et moyennes entreprises françaises sont beaucoup moins internationalisées que d'autres en Europe : le pourcentage de celles qui exportent est proche de celui des nouveaux États membres, très loin de ce qu'il est en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Toute une série de facteurs entrent en ligne de compte. Prenons l'exemple de la fiscalité. Le taux théorique de l'impôt sur les sociétés en France est le plus élevé d'Europe, avec 34 %, mais le taux effectif d'imposition est beaucoup plus faible du fait des niches fiscales. Il est de surcroît dégressif : proche de 30 % pour les petites et moyennes entreprises, il tombe à 15 %, voire 10 %, pour de très grandes entreprises. Cette fiscalité est pénalisante pour les petites et moyennes entreprises. Je n'ai pas le temps de développer ce point dans le temps qui m'est imparti mais nous analysons de la même manière l'influence d'autres facteurs : politique de recherche, fonctionnement du marché du travail…
De tout cela, quelles conclusions tirer ? La première est qu'une politique de renforcement de la compétitivité qui se focaliserait exclusivement sur les coûts salariaux serait inappropriée. D'une part, parce que la France n'a pas vocation à concurrencer des pays à bas salaires. D'autre part, nous l'avons dit, les faits ne permettent pas d'établir que sa perte de compétitivité soit liée à une évolution particulièrement défavorable des coûts salariaux, cotisations sociales comprises. Si on souhaitait réduire celles-ci pour gagner en compétitivité, il conviendrait d'ailleurs d'être prudent dans le contexte actuel car les prestations sociales ont joué un rôle de stabilisateur automatique durant la crise.
Une autre conclusion est que la France doit engager des réformes structurelles. Avec la loi de modernisation de l'économie, elle a pris diverses mesures qui auront une incidence positive à moyen terme. Ce n'est toutefois pas suffisant. Il faudrait s'attaquer rapidement au chantier de la fiscalité et aussi prendre des mesures complémentaires à la loi de modernisation de l'économie, pour éviter de pénaliser des secteurs nouveaux de croissance.
Enfin, j'y insiste, quoi qu'on fasse pour renforcer la compétitivité en France, la consolidation budgétaire demeure la priorité à très court terme. La France s'est engagée à ramener son déficit budgétaire à 3 % du produit intérieur brut d'ici à 2013. Diverses mesures ont déjà été prises en ce sens. D'autres n'ont pas encore été annoncées sur lesquelles nous pensons qu'une réflexion doit s'engager sans retard. Priorité devrait être donnée au démantèlement des niches fiscales dans les deux années qui viennent. Si on envisageait de réduire les charges sociales pour des raisons de compétitivité, les mesures devraient être neutres pour les finances publiques. Une part de la protection sociale devra donc être financée par d'autres ressources fiscales. Dans une perspective de consolidation fiscale, il faudrait privilégier un impôt du type taxe à la valeur ajoutée plutôt que l'impôt sur le revenu. Comme l'a montré l'expérience allemande, un impôt du type taxe à la valeur ajoutée est d'autant plus efficace que son assiette est large et son taux uniforme. Il faudrait donc s'attaquer aussi aux niches que constituent les taux réduits de taxe à la valeur ajoutée.
La France doit nous adresser le 15 avril son programme national de réformes (PNR), listant les initiatives qu'elle compte prendre pour atteindre les objectifs fixés par l'Union d'ici à 2020. Nous espérons qu'il comportera des mesures d'effet immédiat et des mesures structurelles allant dans le sens de ce qu'attend votre mission d'information.

Il est vrai qu'il n'y a pas de distorsion globale entre la France et l'Allemagne en matière de compétitivité. Il en existe néanmoins de très fortes dans certains secteurs – fruits et légumes, industrie agroalimentaire… –, notamment parce qu'outre-Rhin, toute une main-d'oeuvre étrangère est très faiblement payée. Quelles mesures pensez-vous qu'il conviendrait d'adopter pour contrer de telles distorsions ?
Tous les gouvernements sans exception ont approuvé la stratégie de Lisbonne. Quels sont les pays européens qui ont, selon vous, le mieux réussi dans l'application de cette stratégie ? Quelles sont les actions qui ont permis de s'approcher le plus de ses objectifs ?

Je vous remercie, madame, d'avoir souligné que l'impôt sur les sociétés en France, en dépit de son taux théorique élevé, ne pèse pas aussi lourd qu'on pourrait le croire. Ainsi, contrairement à une idée reçue, bien que le taux de l'impôt sur les sociétés ne soit que de 12,5 % en Irlande, la part de son produit dans le produit intérieur brut y était, du moins avant la crise, largement supérieure à ce qu'elle est en France. En Irlande, il n'existe ni crédit d'impôt recherche ni dispositif d'amortissements dégressifs et les entreprises n'ont pas la possibilité de jouer sur la localisation de leurs bénéfices, si bien qu'au final elles paient davantage qu'en France. En dépit de la réalité donc, on continue de dire, y compris parmi les spécialistes de fiscalité, que l'impôt sur les sociétés pèse lourd en France. L'image extérieure d'un impôt est donc considérable. De même, les charges sociales réellement acquittées étaient-elles, avant la crise, supérieures dans l'industrie automobile américaine à ce qu'elles étaient dans l'industrie automobile française. Mais en France elles reposent essentiellement sur des dispositions législatives et réglementaires, et non comme aux États-Unis sur des dispositions conventionnelles, ce qui, dans l'esprit de beaucoup, est tout à fait différent. La représentation d'un impôt finit par peser sur l'attractivité même d'un pays, qui est un élément clé de compétitivité.
Outre qu'on a tendance à réduire la question de la compétitivité à la compétitivité prix, on s'attache de surcroît à la seule part du coût du travail imputable aux salaires les plus bas. Beaucoup d'industriels que je rencontre jugent le coût du travail en Inde par exemple globalement très élevé. Certes, les salaires des ouvriers y sont bas, encore qu'ils ne le soient pas autant qu'on le croit par rapport à d'autres pays, mais ceux des managers y sont si faramineux toutes charges comprises – le double environ de ce qu'ils sont en France – que le coût du travail en devient en moyenne élevé, d'autant que la productivité est moindre et l'intensité capitalistique différente. La compétitivité n'est pas liée seulement au coût des bas salaires. Sinon plus rien ne serait fabriqué en France, ce qui est loin d'être le cas. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet.
Il faut aussi prendre en compte le prix des matières premières. Le prix du coton, qui représente 80 % du coût d'une pièce textile, a triplé. Il est donc beaucoup plus déterminant dans le prix final de cette pièce que le coût du travail qui n'en représente que 5 %. Le cours du dollar non plus n'est pas indifférent. Il a tellement évolué que la donne en est bouleversée. Pour analyser les problèmes de compétitivité, il faut donc construire des modèles plus fins que ceux généralement utilisés, assez caricaturaux. Nul ne nie néanmoins que la France a perdu en compétitivité.

Votre diagnostic, madame, est largement partagé. Vous n'avez pas évoqué le déficit de logistique et de force commerciale des petites et moyennes entreprises françaises, par rapport à leurs homologues étrangères, notamment allemandes et italiennes. Je finis par me demander si toutes les réformes qui se sont empilées au fil du temps, loin d'introduire des facilités, n'ont pas conduit à des dérèglements. Enfin, quid du comportement des banques vis-à-vis des petites et moyennes entreprises en France ?
Je l'ai dit, la performance de l'Allemagne est tout à fait atypique au niveau européen. D'une part, le pays pratique une politique exceptionnelle de modération salariale qui a fait l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. D'autre part, il a relevé son taux de taxe à la valeur ajoutée, ce qui lui a permis de financer pour partie son redressement budgétaire, pour partie une baisse des cotisations chômage. Le pays recueille aujourd'hui les fruits de réformes structurelles qu'il a engagées très tôt. De ce point de vue, la France a pris du retard.
L'Allemagne a résisté à la crise sur les marchés extérieurs et la demande interne commence maintenant d'y être l'un des moteurs de la reprise. S'inscrivant pleinement dans la stratégie de Lisbonne, certains pays ont mené des politiques qui leur ont permis d'échapper à la crise. Je pense aux pays scandinaves ou encore aux Pays-Bas dont les modèles s'appuient sur des dépenses de recherche élevées, une politique de l'emploi évitant la dualité du marché du travail et favorisant la mobilité.
S'agissant de l'impôt sur les sociétés, les chiffres attestent qu'il représente une part plus faible des recettes fiscales en France qu'ailleurs. La perception que cet impôt constitue un poids tient peut-être à sa complexité. D'après la Banque mondiale, la France se classe au vingt-sixième rang dans le monde s'agissant de l'environnement réglementaire pour les entreprises, ce qui est tout à fait honorable. Mais il est des points sur lesquels cet environnement y est considéré comme pénalisant : la fiscalité en est un. La complexité de l'impôt en France et la façon dont les entreprises ont à s'organiser pour tirer profit de toutes les niches fiscales donnent l'impression qu'il est lourd alors qu'il ne l'est pas tant que cela.
Les charges sociales sont élevées en France, c'est un fait. Mais avant de faire des comparaisons, encore faudrait-il veiller à comparer des choses comparables. Ainsi au Royaume-Uni, une part importante des retraites est-elle financée par des systèmes privés, ce qui ne se répercute donc pas sur le coût du travail.
Un mot de la compétitivité prix. La théorie économique invite à prendre en considération plutôt la productivité globale de l'économie que la seule compétitivité prix. Mieux allouer les ressources, faciliter la mobilité entre secteurs ainsi que sur le marché du travail, supprimer les effets dissuasifs de seuil en matière de salaires et d'impôts : autant de mesures économiques structurelles favorisant en général un potentiel de croissance qui se traduit, à terme, par de meilleures performances à l'exportation.

Si le coût du travail n'est pas globalement très différent en France et en Allemagne, la distorsion est néanmoins considérable dans certaines industries à forte intensité de main-d'oeuvre, dans la mesure où n'existe pas outre-Rhin de salaire minimum interprofessionnel et où, dans certains secteurs, qui d'ailleurs emploient en nombre des personnes d'origine polonaise ou tchèque, ne s'applique aucune convention collective. La pression est donc forte en France, par exemple dans les abattoirs ou le secteur des fruits et légumes, pour que des mesures soient prises afin que nous ne nous laissions pas trop distancer par notre voisin et concurrent.
La France est assez lente à transposer les directives communautaires – c'est toujours elle qui a, aujourd'hui encore, les délais de transposition les plus longs – et lorsqu'il y a des infractions, ce sont toujours les cas français les plus longs à régler. Elle essaie de se protéger de certaines mesures de modernisation adoptées par l'Union européenne et du jeu de la concurrence.

Quand elle transpose les directives, elle le fait avec plus de rigueur que certains de ses voisins.
C'est avec plaisir que je le dirai à nos amis britanniques !

Dans le document que vous nous avez remis, madame, il est indiqué que « la compression des salaires en partie causée par les réductions de cotisations sociales sur les bas salaires n'est pas favorable à l'investissement dans la formation des jeunes et pourrait avoir des conséquences néfastes sur la productivité ». Pourriez-vous développer ce point ? Pour ma part, je ne suis pas convaincu, tant s'en faut, de l'efficacité de la politique massive d'allègement de charges sur les bas salaires menée en France depuis une quinzaine d'années.
De l'étude que nous avons menée sur une dizaine de pays, il ressort que la France a le salaire minimum le plus élevé mais aussi le salaire médian le plus proche de ce salaire minimum, d'où un effet de trappe à bas salaires, entretenu par certains effets de seuil en matière de charges sociales. Que sur les salaires supérieurs à 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), les entreprises doivent s'acquitter des charges patronales à taux plein peut les inciter à maintenir les salaires à un niveau inférieur. Cela décourage à la fois la mobilité et les investissements en capital humain, tant du côté de l'offre que de la demande de travail.
Si vous le permettez, je traiterai essentiellement de l'industrie, qui est mon domaine de compétences à la Commission.
L'industrie manufacturière représente 20 % du produit national brut européen, les trois quarts des exportations communautaires et emploie un salarié du privé sur quatre. Et ces données sont inférieures à la réalité car des activités auparavant considérées comme industrielles sont désormais comptabilisées dans les statistiques parmi les services, sans compter que les services dépendent eux-mêmes fortement de l'industrie, si bien qu'en réalité l'industrie représente bien davantage. On est donc loin de la société post-industrielle, contrairement à ce qui a pu être affirmé il y a quelques années !
L'industrie est et demeure le moteur de la création de richesses. La productivité du travail dans l'industrie a augmenté en Europe de 46 % de 1995 à 2007 et 80 % de la recherche-développement du secteur privé sont réalisés dans le secteur industriel. L'industrie a certes été, comme le reste de l'activité économique, affectée par la crise. Certains secteurs ont vu leur production baisser de 30 %. Une reprise se dessine mais il faut encore être prudent. Cela étant, certains secteurs sont d'ores et déjà repartis. C'est le cas de l'industrie chimique, tirée d'ailleurs surtout par les marchés asiatiques.
Quelles leçons avons-nous retirées de la crise ? La première est que la mono-industrie est toujours très dangereuse et que lui est préférable une chaîne de valeur industrielle forte, compétitive et diversifiée.
La deuxième est que l'environnement économique mondial s'est profondément modifié : les pays longtemps dits « émergents » ont énormément progressé, y compris dans le domaine des produits à forte valeur ajoutée, et la vision que l'on en a est pour beaucoup dépassée. D'où l'importance croissante de la technologie et des qualifications. Il faudrait absolument qu'au lieu de s'orienter systématiquement vers le secteur financier, des compétences aillent aussi vers l'industrie, ce qui suppose de renforcer son attrait.
Une autre leçon est que le renchérissement du coût de l'énergie et des matières premières n'est pas l'effet seulement de mouvements spéculatifs mais une tendance lourde, du fait de l'accroissement de la demande mondiale.
Enfin, l'interdépendance des économies au niveau mondial est de plus en plus forte. L'idée de secteurs strictement nationaux n'est plus aujourd'hui que théorique. On l'a vu, les problèmes rencontrés au Japon après le tsunami et l'accident de Fukushima ont pu entraîner des difficultés d'approvisionnement dans d'autres pays. Les économies sont très interdépendantes, tout particulièrement dans l'Union européenne qui est encore la première puissance commerciale au monde.
Comment la Commission européenne approche-t-elle la politique industrielle ? Il faut tout d'abord rappeler que s'il s'agit bien d'une compétence communautaire, les instances européennes ne disposent pas de tous les instruments nécessaires, si bien que leurs décisions ont besoin d'être ensuite déclinées au niveau national et infra-national.
Premier volet de notre action : améliorer le cadre général. De ce point de vue, le marché intérieur constitue un outil essentiel. Ainsi la France réalise-t-elle une grande partie de son commerce extérieur avec les autres pays de l'Union et le marché intérieur des services est encore insuffisamment développé. L'environnement réglementaire est un autre élément-clé. La Commission a décidé dorénavant d'évaluer les incidences sur la compétitivité de toute nouvelle mesure législative. Elle souhaite également procéder à l'évaluation de la législation existante de ce point de vue. La même démarche pourrait être adoptée au niveau national. Dans cette démarche, il faut garder présent à l'esprit que les différents secteurs de l'économie ne sont pas cloisonnés : certaines mesures de réglementation financière peuvent ainsi avoir un impact sur l'accès au financement des entreprises. Enfin, lors de la négociation d'accords commerciaux avec des pays tiers, nous analyserons systématiquement le rapport coûtsbénéfices pour l'industrie européenne. Les infrastructures – transports, communications, fourniture énergétique… – sont un autre élément déterminant de la compétitivité. De ce point de vue, la France est assez bien placée. La Commission souhaite améliorer encore les infrastructures au niveau européen. Enfin, l'accès au financement des entreprises joue aussi un rôle essentiel dans le niveau de compétitivité.
Deuxième volet : renforcer les politiques industrielles. Certaines initiatives ont été prises dans différents États membres. Nous souhaitons faire porter l'effort sur les technologies clés comme les technologies de l'information ou les nanotechnologies, et sur les structures, en favorisant les réseaux et les clusters ou grappes d'entreprises. Les pôles de compétitivité tels qu'ils ont été créés en France répondent tout à fait à cette préoccupation.
Troisième volet : accompagner la mondialisation. Plusieurs de nos partenaires commerciaux entravent l'accès à leur marché intérieur par bien d'autres moyens que des barrières tarifaires et les pratiques déloyales sont fréquentes. Nous sommes déterminés à nous saisir du problème. Nous avons revu notre stratégie en ce qui concerne les matières premières et entendons nous attaquer par exemple aux restrictions injustifiées à l'exportation, notamment quantitatives, contraires au règlement de l'Organisation mondiale du commerce.
Quatrième volet : soutenir les transformations et les ajustements structurels. Ainsi, souhaitons-nous, pour relever le défi du changement climatique, accompagner la modernisation du tissu industriel.
J'en viens à la compétitivité française. La France avait encore un avantage comparatif de compétitivité prix il y a une dizaine d'années, qu'elle a perdu, parce que les coûts ont augmenté. La France ne décroche pas par rapport à la zone euro mais elle se situe quand même au-dessus de la moyenne – l'Allemagne, elle, étant très nettement en dessous. Cela dit, serait-il réaliste d'essayer de concurrencer sur les prix des pays comme la Chine ? Plus grave est que cette détérioration de la compétitivité prix n'est pas compensée par une amélioration de la compétitivité hors prix. Plusieurs signaux sont inquiétants. Si les dépenses publiques de recherche-développement sont au niveau de la stratégie fixée par l'Union pour 2020, ce n'est pas le cas des dépenses privées. Il faut absolument trouver les moyens d'orienter le capital privé vers l'investissement et la recherche rentables.
Pour répondre à la question sur le comportement du secteur bancaire en France, je dirais que la crise a certainement, hélas, accru son aversion au risque, mais la réglementation n'est pas neutre non plus. J'entends souvent des industriels français, notamment de petites et moyennes entreprises, se plaindre que les centres de décision sont très éloignés des besoins de l'entreprise – ce qui n'est pas le cas dans tous les États membres.
S'agissant de l'environnement réglementaire, l'important est d'avoir une approche systématique, même si elle est moins visible que des actions ponctuelles. Ce doit devenir une routine que d'évaluer l'impact sur la compétitivité de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire.
Les industriels déplorent un manque de compétences scientifiques et techniques. Ce n'est d'ailleurs pas propre à la France : en Allemagne aussi, on manque de techniciens, d'ingénieurs, de géologues – si précieux dans le secteur des matières premières. Il faudrait donc faire un effort en matière de formation scientifique et technique, d'autant que le système de formation français est réputé. Mais les industriels doivent aussi améliorer l'image de l'industrie pour renforcer son attrait : l'usine n'est pas quelque chose de sale, on ne le sait pas assez.
J'en viens aux difficultés des petites et moyennes entreprises françaises à l'exportation. Lorsqu'on fait des comparaisons, il faut savoir que les petites et moyennes entreprises allemandes fortement exportatrices ne seraient pas classées en France comme des petites et moyennes entreprises. Elles sont souvent plus grandes, sans qu'il soit d'ailleurs facile de déterminer si elles ont pu grandir parce qu'elles exportaient beaucoup ou si elles ont pu exporter parce qu'elles étaient déjà assez grandes.
En politique industrielle, l'important est de jouer sur tous les tableaux à la fois : amélioration constante du cadre général plutôt que des mesures ponctuelles, réglementation, infrastructures, accès au financement.

Vous avez mentionné le niveau assez faible de la recherche privée en France par rapport à la recherche publique mais vos chiffres datent de 2008. Depuis lors, le bénéfice du crédit impôt recherche, très utilisé par les entreprises, a été facilité et largement étendu. Disposez-vous de données sur les incidences du nouveau dispositif ?
Vous avez évoqué les effets de la réglementation, en effet déterminants pour les petites et moyennes entreprises, et parlé d'études d'impact. Pourriez-vous nous dire plus précisément ce qui est fait pour évaluer les incidences de la réglementation sur les petites et moyennes entreprises ?

Nous manquons de techniciens et d'ingénieurs dans l'industrie et cette pénurie s'aggrave, les compétences s'orientant en effet aujourd'hui plutôt vers le secteur financier. La Commission européenne ou certains pays ont-ils mené des campagnes pour « faire aimer » l'industrie ?
Le crédit d'impôt recherche est le type même de dispositif bienvenu pour aider à orienter le capital privé vers la recherche et la recherche-développement. Mais le déficit, ancien, était profond et sera donc long à combler.
En matière d'études d'impact, il existe déjà au niveau communautaire un dispositif d'évaluation économique, social et environnemental des mesures prises. Y sera ajouté un volet spécifique pour évaluer leur incidence en matière de compétitivité industrielle.
En dépit de son champ de compétences réduit en matière de politique sociale et de formation, l'Union européenne essaie d'agir en ces domaines. Dans le cadre de nos dialogues sociaux, j'ai ainsi eu l'occasion, il y a quelques années, de faire la promotion de secteurs comme l'équipement maritime, souvent considéré en déclin. Avec les employeurs et les organisations syndicales, nous en avons au contraire montré tout l'attrait. Une des leçons de la crise est précisément qu'il n'y a pas de secteur condamné. Chacun compte des entreprises performantes qui méritent d'être soutenues. La Commission va aussi saisir l'occasion que 2011 soit l'année internationale de la chimie pour mieux faire connaître l'industrie chimique et en revaloriser l'image. Souvent présentée comme polluante et consommatrice d'énergie, c'est pourtant une industrie-clé qui fournit des solutions y compris pour la préservation de l'environnement. Sans industrie chimique, il n'y aurait pas de panneaux solaires, mais qui le sait ? De même, comment fabriquerait-on des éoliennes sans sidérurgie ? Simplement on ne le dit pas assez. La Commission participe activement à ces actions de promotion. Elle regarde aussi ce que fait chaque État membre en fonction de sa propre culture. Des secteurs industriels, avec l'appui de régions particulièrement concernées et d'organisations professionnelles, organisent des visites d'entreprises, engagent des coopérations avec les universités et autres établissements d'enseignement pour adapter les formations et permettre aux jeunes de trouver des débouchés à proximité de leur lieu de formation. C'est tout l'intérêt des clusters et des pôles de compétitivité qui regroupent, dans un même bassin d'emploi, industriels, universitaires et chercheurs.
Un dernier mot, si vous le permettez, pour dire que Bruxelles est souvent critiqué à tort pour des directives handicapant les entreprises alors que ce sont les États qui, lors de la transposition, rajoutent de leur propre initiative des mesures qui ne figuraient pas dans les directives. Cela vaut tout particulièrement pour la France.

Nous aimerions beaucoup disposer d'une liste de tels exemples, qu'il serait très intéressant de faire valoir à notre administration.
La Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale entend ensuite, en audition ouverte à la presse, Mme Agnès Benassy-Quéré, directrice du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), et M. Hervé Boulhol, chef du bureau France au département des affaires économiques de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).
Après avoir posé un diagnostic sur la situation actuelle, je présenterai quelques priorités en matière de politique économique.
Si le diagnostic établi doit s'appuyer sur les excellents rapports du Conseil d'analyse économique – je songe notamment aux travaux de M. Lionel Frontagné –, qui relèvent les obstacles entravant la dynamique des entreprises et soulignent un positionnement en retrait en termes de gammes de produits, je les compléterai néanmoins, d'une part, en insistant sur le caractère général du problème posé par une insuffisance globale de la capacité de production de l'économie française et, d'autre part, en essayant de montrer que le concept de compétitivité appliqué à un pays est peu significatif – ce n'est pas là une simple considération sémantique puisque de ce diagnostic découlent les priorités de la politique économique. En bref, ce sont des réponses d'ordre général qui doivent être apportées à un problème général. Nous avons identifié quatre domaines de priorité : la fiscalité et les finances publiques ; le marché du travail ; l'éducation ; le secteur productif.
Plus que la dégradation du solde commercial, c'est la perte de parts de marché à l'exportation qui doit être au centre de notre réflexion. La situation française est comparable à celle des autres pays du Groupe des sept, l'Allemagne exceptée ; l'évolution pour la France est comparable à celle des autres grands pays développés, et cela s'explique en grande partie en raison du rattrapage salutaire effectué par les pays en développement. Il ne s'agit pas néanmoins de nier nos mauvaises performances à l'exportation, notre recul étant de surcroît plus prononcé que celui de l'ensemble des pays de la zone euro mais, également, que ceux de la Suisse, de la Suède ou du Danemark – seule l'Italie ayant des résultats aussi décevants que les nôtres.
Cela ne doit pas toutefois nous éloigner de l'essentiel : la richesse totale créée, soit le revenu national ainsi que sa répartition. Or, pour l'ensemble des pays développés, le lien entre la croissance des exportations et celle du produit intérieur brut par habitant – donc, le pouvoir d'achat – est peu évident. L'Allemagne, le Japon, le Danemark, la Suisse, le Portugal ont ainsi enregistré depuis dix ou quinze ans de bonnes performances à l'exportation sans que les retombées soient pour autant notables s'agissant du produit intérieur brut par tête. Autrement dit, la production pour l'exportation ne crée pas plus de richesse que celle destinée au marché domestique : il faut abandonner ce fétichisme-là. Depuis 1990, la croissance des exportations en Allemagne a été 20 % supérieure à celle de la France, mais la croissance du produit intérieur brut français a été de 7 % supérieure à celle de l'Allemagne en raison d'une augmentation de la consommation et de l'investissement domestiques 15 % plus élevés chez nous que chez nos voisins d'outre-Rhin. La comparaison avec ce pays est donc parfois fallacieuse. J'ajoute que la persistance d'un surplus élevé du solde commercial allemand suggère une sous-évaluation du taux de change réel – la modération salariale et l'atonie de la demande pourraient être ainsi la conséquence d'un déséquilibre.
S'agissant du diagnostic compétitivité-coût, l'évolution du coût du travail total en France ne semble pas être la cause première du décrochage des exportations, même s'il est vrai que la convergence des salaires minimaux liée aux trente-cinq heures a sans doute pesé. Chez nous, la part des salaires dans la valeur ajoutée est d'ailleurs restée stable, les salaires réels ayant suivi l'évolution de la productivité du travail. La compétitivité-coût ne s'est donc pas dégradée dans notre pays par rapport aux autres pays de la zone euro – à l'exception de l'Allemagne, où la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée peut difficilement être extrapolée. En revanche, le salaire minimum est chez nous élevé – relativement au salaire médian – et le coût du travail pour les bas salaires figure parmi les plus chers des pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), malgré les allégements de cotisations. Les conséquences de telles rigidités sur le marché du travail sont sans doute amplifiées par la globalisation, processus impliquant de forts ajustements structurels en fonction des avantages comparatifs.
En ce qui concerne le lien entre compétivité, productivité et production, il convient également de noter que la notion de compétitivité est floue et peu significative sur un plan normatif. La compétitivité-coût peut ainsi être associée à des salaires sous-optimaux et à une demande trop faible, la compétitivité-prix pouvant être quant à elle liée à une réduction trop forte des marges pénalisant l'investissement. La productivité et la production totale résultant de l'emploi et du temps de travail moyen constituent, en revanche, des concepts plus porteurs. L'économie française souffre d'abord d'un problème général de déficit d'emplois et d'un manque de gains de productivité. Dans un tel contexte, certaines mesures qui ont été récemment prises vont dans le bon sens – je vous renvoie à ce sujet au document détaillé que je vous ai communiqué.
Alors que nos finances publiques sont dégradées et que les coûts liés au vieillissement de la population augmentent, des priorités doivent être définies.
La première concerne la réduction de la fiscalité pesant sur le travail.
Le maintien d'un haut niveau de protection sociale – lequel semble faire l'objet d'un assez large consensus – passe par l'amélioration de la situation de l'emploi, une gestion rigoureuse des dépenses publiques ainsi qu'une structure fiscale efficace à la fois redistributive et favorable à la croissance. Dans notre pays, la différence entre le coût du travail et le salaire super net est plus élevée que dans les États membres de l'OCDE à l'exception de la Belgique, de la Hongrie et de l'Allemagne, le salaire minimum n'étant toutefois pas très haut dans ce dernier pays. D'où une double conséquence : d'une part, compte tenu de l'état des finances publiques, la baisse de la fiscalité pesant sur le travail passe par un renforcement de la discipline budgétaire, notamment en ce qui concerne le volet des dépenses ; d'autre part, pour pouvoir maintenir un haut niveau de protection sociale, le financement doit davantage porter sur des bases moins défavorables à l'emploi et à la croissance : propriété immobilière, environnement et consommation – je songe au taux réduit de taxe à la valeur ajoutée.
D'une manière générale, il faut rendre la fiscalité plus lisible et efficace, notre système favorisant ceux qui savent tirer partie de son opacité et de sa complexité. Cela passe par l'élargissement des bases, la suppression des niches fiscales et sociales les moins efficaces, la réduction des distorsions, notamment entre l'investissement résidentiel et l'investissement productif, la diminution du soutien à la construction et l'engagement d'une réflexion sur les distorsions engendrées par la fiscalité de l'épargne.
Deuxième priorité : combler le déficit d'emplois.
Au-delà de la perte d'emplois cyclique liée à la grande récession, le déficit structurel s'élève à environ 8 % des emplois dont 2,5 % de taux de chômage structurel et 5 % voire plus en termes de participation à la population active. Le déficit d'emplois concerne principalement les jeunes et les seniors, le taux d'emploi des trente-cinquante-cinq ans étant supérieur à la moyenne de l'OCDE. En outre, le nombre d'emplois manquants est du même ordre de grandeur que l'emploi industriel manufacturé total – 2 millions d'emplois contre 3 millions. Dans ces conditions, les gains de parts de marché à l'exportation ne suffiront pas : nous devons produire plus et tous azimuts en nous attaquant à un problème global. Je vous renvoie, à ce propos, au graphique qui figure dans le document que je vous ai remis et qui met en évidence le fait qu'il n'y a pas de corrélation entre la taille de l'industrie et le taux d'emploi total : ce graphique montre en effet que si le taux d'emploi et la taille des industries dans notre pays sont relativement faibles, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège, le Canada et les Pays-Bas, qui ont encore moins d'industries que nous, ont un taux d'emploi plus élevé, tandis que la Suisse et la Suède, qui sont des pays plus industriels, ont des taux d'emploi très élevés, l'Italie étant quant à elle un pays très industrialisé dont le taux d'emplois est très faible.
Troisième priorité : l'éducation.
Il convient de mieux former les jeunes pour accroître les perspectives à long terme et assurer une meilleure articulation entre les entreprises et la recherche universitaire. Il faut également limiter les situations d'échec scolaire, notamment à un stade précoce, et, enfin, assurer une meilleure adéquation entre les compétences qui sont requises par les entreprises et celles qui sont acquises à la sortie du système éducatif.
Quatrième et dernière priorité, enfin : l'amélioration de l'offre productive.
Cela passe par une adaptation de la fiscalité – en particulier celle de l'impôt sur les sociétés – et peut-être par le financement des petites et moyennes entreprises. Il convient également d'engager une réflexion sur les réglementations et la concurrence.
Je concentrerai mon intervention sur nos performances à l'exportation.
En la matière, je suis d'accord avec M. Hervé Boulhol : outre que ce sont les parts de marché et non le solde commercial qui mesurent la capacité d'un pays d'être compétitif à l'extérieur, le dynamisme des exportations constitue plus un révélateur de la bonne santé des entreprises qu'un but en soi.
Seules environ 100 000 entreprises du secteur manufacturé sont concernées par les exportations – leur nombre, d'ailleurs, diminue, ce qui ne laisse pas d'être préoccupant –, 10 000 d'entre elles exportant des services – curieusement, peu d'entreprises de services sont exportatrices. Dans les pays étrangers, le dynamisme des exportations reposant pour les deux tiers sur le nombre des entreprises exportatrices et non sur le volume des exportations, l'un des enjeux importants de la politique économique consiste à multiplier le nombre des entreprises qui exportent. J'ajoute que la plupart de nos entreprises exportant vers une seule destination – la Belgique –, un autre enjeu consiste à leur faire franchir une deuxième frontière.
Notre pays, de surcroît, ne comporte pas assez de « gazelles » ou d'entreprises de taille intermédiaire exportatrices, notamment par rapport à l'Allemagne.
Si nous devrions être bien placés en matière d'exportations de services, une étude réalisée par le Centre d'études prospectives et d'informations internationales montre cependant que le potentiel de développement de ce secteur est très lié à la déréglementation en Europe : si la Grèce, par exemple, alignait sa réglementation en matière de services sur celle qui est en vigueur aux Royaume-Uni, nos exportations en direction de ce premier pays doubleraient. Cela constitue également un enjeu pour les années à venir.
Parmi les clés du succès à l'exportation figurent les coûts de production par unité produite, lesquels doivent être comparables à ceux de nos concurrents dans les pays développés européens – et non par rapport à la Chine ou à l'Inde, bien entendu – ainsi que la capacité de répartir d'une façon optimale la chaîne de production. Nombre de travaux montrent, en effet, que l'importation de produits intermédiaires à bas coût peut considérablement aider les entreprises à finaliser des produits compétitifs sur le plan international. De ce point de vue-là, les Allemands ont mieux réussi que nous.
Il faut également compter avec les capacités d'innovation. Nous exportons essentiellement des hautes technologies et des produits haut de gamme – l'un n'étant pas nécessairement lié à l'autre comme en témoigne le vin. Produire de tels biens et investir massivement dans la recherche et le développement supposent d'associer travail qualifié et capital et, donc, d'envisager leur coût respectif.
Les arbitrages entre compétitivité et emploi ne sont pas encore clairement rendus, mais il faut savoir que ces deux questions ne sont pas nécessairement superposables. J'ajoute que le coût du travail peu qualifié est perçu comme relativement contraignant dans notre pays à cause du salaire minimum.
S'agissant des mesures préconisées afin de favoriser les exportations et, donc, les petites et moyennes entreprises, je me permets de vous renvoyer au rapport de l'OCDE.
Par ailleurs, le débat sur le coût du travail me semble très confus. En effet, il ne faut pas confondre le coût horaire et le coût par unité produite. Depuis une dizaine d'années, le coût du travail dans l'industrie manufacturière en France a augmenté plus vite qu'en Allemagne, mais nous disposions d'un avantage initial. Nous avons donc assisté à un rattrapage mais si la dynamique se maintient, le risque de dépassement est grand.
En revanche, s'agissant du coût unitaire et donc corrigé par la productivité, nous ne pouvons pas réaliser de comparaisons de niveau – la productivité étant un indice, il est par exemple impossible d'effectuer une mesure en euro. Selon l'année de base utilisée, le diagnostic variera. En termes de coût unitaire, nous nous situons au même niveau qu'en 1992 par rapport à l'Allemagne – mais quant à savoir si nous étions alors au-dessus ou au-dessous… En tout cas, il est certain que, depuis 2000, dans l'industrie manufacturière, le coût par unité produite a augmenté dans notre pays par rapport à celui de notre voisin.
Il convient également de différencier salaire de marché et salaire minimum. Pour les professions qualifiées ou hautement qualifiées, les salaires observés relèvent du marché et sont donc comme tels équilibrés sans qu'il soit possible de les considérer comme trop élevés ou trop faibles. S'ils sont plus hauts en France qu'en Allemagne, par exemple, c'est que la productivité est plus importante chez nous. Il n'en va pas de même s'agissant de la main-d'oeuvre peu qualifiée et du salaire minimum. Si une diminution des charges sociales patronales se répercuterait immédiatement sur le coût du travail peu qualifié, il n'est pas évident qu'il en irait de même sur le travail qualifié en raison, dans ce dernier cas, de la part de la rémunération liée au partage des gains entre l'entreprise et le salarié. Le salaire net des pays dont les charges sociales sont particulièrement élevées – dont la France – tend d'ailleurs à être relativement plus bas. Par ailleurs, lorsque l'on évoque le coût du travail, il faut tenir compte de l'impôt sur le revenu : un niveau plus élevé, comme c'est le cas en Allemagne par rapport à la France, doit se répercuter sur celui du salaire.
S'agissant de la compétitivité-prix dans le domaine manufacturé, les prix à l'exportation ont évolué d'une manière à peu près comparable entre la France et l'Allemagne sur le marché de l'Union européenne à quinze. Les prix français ont évolué légèrement plus vite que les prix allemands sur les marchés extra-européens mais sans comparaison aucune avec la situation italienne où cette évolution a été nettement plus rapide. Il est en revanche troublant que, malgré une telle situation, à la différence de l'Allemagne, nos parts de marché à l'exportation se soient fortement dégradées. En fait, la dégradation des marges des exportateurs français annonce peut-être la compétitivité-prix de demain puisque moins de marges implique moins d'investissements – un lien existe sans doute entre compétitivité-prix et compétitivité hors prix –, à moins que la hausse des prix en Allemagne ne soit liée à une augmentation de la qualité tandis que celle que nous avons connue en France ne le soit à la dégradation de la compétitivité-prix.
J'ajoute qu'il est moins question du coût du travail dans les services, celui-ci ayant explosé en France au cours des dix dernières années, notamment en raison du poids du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
J'en viens au financement de la protection sociale.
En ce qui concerne la main-d'oeuvre qualifiée, le transfert d'un prélèvement sur une autre base – cotisations employeurs ou employés, impôt sur le revenu ou taxe à la valeur ajoutée – ne modifierait guère la donne puisque, je le répète, nous sommes sur un marché avec des offres et des demandes, des pénuries dans certaines professions et des excédents temporaires dans d'autres. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la main-d'oeuvre peu qualifiée puisque le salaire net est rigide. Une baisse des cotisations versées par les employeurs peut donc contribuer à abaisser le coût du travail, l'impact final dépendant toutefois de l'indexation des salaires sur la taxe sur la valeur ajoutée – dès lors que la protection sociale serait financée par une hausse de cette dernière – et de la façon dont les pensions ou les revenus hors salaires sont indexés sur les prix à la consommation, donc, sur cette même taxe à la valeur ajoutée. Une indexation totale serait sans grand effet, une absence d'indexation rendant quant à elle impropre l'expression de « TVA sociale » puisque les gains de compétitivité obtenus le seraient au détriment du pouvoir d'achat de certaines catégories de la population. Une mesure comme la taxe sur la valeur ajoutée « sociale » doit avoir un effet redistributif entre salariés et non salariés mais, également, entre secteurs d'activité. Quoi qu'il en soit, même non profilée, une baisse de cotisation sociale diminue le coût relatif dans les secteurs qui emploient beaucoup de main-d'oeuvre non qualifiée. Si de telles mesures, comme en attestent certaines études, seraient favorables à l'emploi, il ne faut pas trop en attendre en revanche sur le plan de la compétitivité.

Selon le document que vous nous avez remis, monsieur Hervé Boulhol, le déficit de la balance courante pourrait en théorie s'expliquer par une forte attractivité du pays pour les investisseurs étrangers alors que les sorties d'investissements directs étrangers indiquent au contraire que la France souffre d'un problème d'attractivité. Considérez-vous donc que l'attractivité pour les investissements étrangers en France soit faible ou forte ? En outre, lorsque Mme la ministre de l'économie assure que les investissements étrangers en France sont importants et nous classent en deuxième position, s'agit-il d'investissements nets ou relevant d'achats de petites et moyennes entreprises qui, chez nous, se vendent beaucoup plus facilement que chez nos voisins, les investissements nets étant dans ce cas relativement faibles ?

Le document que vous nous avez remis, monsieur Hervé Boulhol, nous permet d'avoir des idées précises à la fois quant à votre diagnostic et aux propositions que vous formulez, sachant que les modalités d'application de chacune d'entre elles devraient faire l'objet de débats assez longs.
Je note un paradoxe dans vos propos concernant le diagnostic : la puissance d'exportation de l'Allemagne serait liée à la maîtrise des coûts sans que son produit national brut bénéficie pour autant de retombées notables alors que la France soutient ce dernier grâce à sa consommation interne. Comment maintenir une consommation interne permettant de soutenir l'économie et le produit national brut tout en ayant une balance extérieure à peu près équilibrée ?
Enfin, certaines filières économiques et industrielles disposeraient-elles d'une organisation particulièrement vertueuse qui les rendrait emblématiques ?

Quelle est la part de la dynamique démographique dans la compétition internationale lorsque l'on établit un parallèle entre les pays émergents – devenus « émergés », pour reprendre l'expression de M. Nicolas Baverez – comme la Chine, par exemple, une Europe dont la population vieillit et une France que certains considèrent, sur le plan de la démographie, comme « la Chine de l'Europe » ? Quelles peuvent en être les conséquences à moyen et à long terme en matière de compétitivité et de financement de la protection sociale ?

Monsieur Hervé Boulhol, vous avez évoqué une réduction de la fiscalité sur le travail, qui, en clair, signifie une réduction de l'impôt sur les sociétés ainsi que des cotisations sociales. À moins que cette formule ne recouvre d'autres perspectives, pensez-vous qu'une telle politique – pratiquée depuis des années – ait eu des résultats probants, ou bien qu'il faut aller encore plus loin – avec quelles conséquences fiscales et sociales ?
De plus, je m'étonne que sur la vingtaine d'auditions que nous avons réalisée la question des dividendes n'ait été abordée qu'une seule fois. Il me semble pourtant important de savoir ce que l'on fait des richesses produites et de mettre en évidence l'évolution qui a eu lieu pendant les dernières décennies s'agissant du partage de la valeur ajoutée entre salaires, cotisations sociales, dividendes versés aux actionnaires et intérêts bancaires. Les personnes auditionnées étant en revanche unanimes à considérer que l'amélioration de la compétitivité passe par la recherche et le développement, l'innovation, la formation et la qualification ainsi qu'un meilleur financement des petites et moyennes entreprises, une répartition différente des richesses créées par les entreprises ne s'impose-t-elle pas ?

La part du travail dans la valeur ajoutée s'est effondrée de huit points entre 1983 et 1988.
Une dynamique démographique constitue toujours un facteur d'attractivité pour les entreprises – lesquelles sont avant tout attirées par un marché –, même si un pays comme la Belgique demeure par exemple attractif en dépit de sa faible démographie, sa situation au coeur de ce grand marché qu'est l'Europe expliquant sans doute le phénomène.
De plus, dans le cadre d'un système de financement des retraites par répartition, la croissance démographique constitue le rendement des retraites : plus cette croissance est forte, moins la fiscalité pèse et plus la compétitivité s'accroît. Je précise toutefois, s'agissant de la Chine, que l'on y entend désormais des lamentations quant à la diminution programmée de la population – c'est déjà le cas de la population active qui, à l'horizon de 2050, équivaudra à peu près à celle de l'Inde, soit 700 millions de personnes –, à tel point qu'il est même question de remettre en cause la politique de l'enfant unique.
Enfin, dans un pays vieillissant, poser la question démographique implique de soulever celle de l'optimisation de l'épargne afin de compléter le système de retraite par répartition. L'Allemagne s'y applique rigoureusement puisque le solde extérieur d'un pays n'est rien d'autre que l'excès d'épargne sur l'investissement.
Les différences de soldes extérieurs au sein de l'Europe peuvent également refléter, en partie, des différences démographiques. Disposer d'un certain nombre de normes en la matière permettrait d'éclairer le débat quant à l'équilibre optimal entre demande interne et demande externe. Sans doute éviterions-nous dès lors de « tirer » systématiquement sur les Allemands, dont le problème démographique est bien plus important que le nôtre. Les Chinois, quant à eux, ne se privent pas de dire que leur excédent d'épargne s'explique par leurs problèmes démographiques même si, en l'occurrence, c'est faux.
M. Christian Saint-Étienne a coutume de dire que ce sont les retraités qui, en France, bénéficient des dividendes de la croissance – ce qui constitue d'ailleurs l'une des raisons de notre manque de dynamisme.
S'agissant des bénéfices réalisés par les entreprises, les économistes considèrent qu'il importe de tendre vers une neutralité fiscale entre les différents moyens de financement. Or, la distorsion est aujourd'hui très importante en matière d'investissements puisque les entreprises sont fortement incitées à se financer en s'endettant – cela contribue peut-être à expliquer notre attractivité, les investissements directs comprenant les flux de capitaux intra-entreprises. Une filiale française qui s'endette auprès de sa maison-mère étrangère réalise ainsi un investissement direct entrant, lequel n'est donc pas forcément lié directement à une création d'emplois. Dans ces conditions, outre que les entreprises risquent d'être sous-capitalisées, elles se mettront en quête de la meilleure optimisation fiscale possible en Europe. Il s'agit là d'une question politique dont la signification est claire : il faut « soigner » les actionnaires en faisant en sorte que le financement par actions soit taxé de la même manière que le financement par endettement ou l'autofinancement, même s'il est assez difficile de le faire comprendre.
Une entreprise qui souhaite investir peut s'autofinancer avec les bénéfices qu'elle a réalisés, s'endetter ou augmenter son capital sur les marchés ou grâce à un certain nombre de prêts. Or, le traitement fiscal de ces trois modes de financement diffère grandement puisque les intérêts d'emprunt sont déductibles du bénéfice imposable alors que les dividendes versés ne le sont pas. Les économistes préconisent en général un traitement fiscal neutre, ce qui implique une moindre taxation des dividendes perçus par les ménages, lesquels ont déjà été taxés à travers l'impôt sur les sociétés. C'est d'ailleurs ce à quoi tendent les prélèvements libératoires en vigueur dans un certain nombre de pays, même si, je le répète, cela est difficile à faire comprendre puisque seule une partie de la population profite d'un tel dispositif.
En ce qui concerne les flux nets d'investissements directs étrangers, monsieur Pierre Méhaignerie, les sorties nettes en France depuis les années 2000 représentent en moyenne 2,7 points de produit intérieur brut par an – ce qui est beaucoup – alors que, depuis 1995, nous n'avons compté aucune entrée nette.
S'agissant des flux bruts, il semble que 50 à 60 milliards d'euros d'investissements directs étrangers entrent en France contre 70 milliards avant la crise, mais l'étude de référence réalisée par la Banque de France pour l'année 2009 montre qu'il convient de corriger ces données en incluant les flux entre filiales. Dans ce cas-là, le solde net représente une sortie de l'ordre de 70 milliards d'euros, les entrées étant quant à elles nulles, les firmes étrangères rapatriant certains profits.

Une grande entreprise étrangère achetant une entreprise française disposant d'un réseau de distribution en France achète en fait des parts de marché de consommation. Il s'agit donc d'un investissement que nous avons tendance à ne pas mentionner comme tel, notre approche étant limitée aux investissements considérés comme strictement productifs. Comment distinguez-vous ces deux modes d'investissement ?
Nous avons en effet tendance à considérer que les investissements directs entrants concernent au premier chef la construction d'usines avec des créations d'emplois à la clé alors qu'ils sont minoritaires. En fait, une partie des investissements entrants correspond, comme cela a été dit, à des prêts entre filiales, une autre partie relevant des rachats d'entreprises françaises par des entreprises étrangères. Ainsi, de plus en plus de travaux économiques dédiés à l'attractivité et aux investissements directs concernent-ils non pas les flux de capitaux entrants ou sortants mais le nombre d'emplois créés dans des filiales d'entreprises étrangères.

Ces travaux sont en cours et les chiffres dont nous disposons ne font pas état de cette nouvelle situation.
Ce sont en effet les chiffres issus de la balance des paiements tels qu'ils sont établis par la Banque de France. Les chiffres concernant l'emploi proviennent quant à eux d'enquêtes qui impliquent un système statistique de collecte différent.

L'aspect théorique auquel M. Hervé Boulhol a fait référence dans son document décrit une situation où, pendant dix ans, de très importants investissements ont eu lieu afin d'acheter des entreprises dont les structures, une décennie plus tard, sont devenues très différentes.
Il faut être cohérent : si l'on s'émeut parfois des investissements de la Chine en Europe – lesquels accroissent la compétitivité des entreprises chinoises –, il convient également de reconnaître qu'il en est de même lorsque les entreprises françaises investissent à l'étranger. Pas plus que le nombre d'investissements directs étrangers entrants n'est un gage d'attractivité, le nombre d'investissements directs étrangers sortants ne témoigne d'un défaut d'attractivité : investir à l'étranger contribue également à renforcer les entreprises.
S'il convient, en effet, d'user avec précaution du terme d'attractivité, la crainte d'un rachat des entreprises françaises est excessive dès lors que, depuis vingt ans, c'est nous qui avons surtout racheté ou créé des entreprises à l'étranger.

Il n'en est pas moins vrai que les petites et moyennes entreprises qui emploient de 400 à 600 personnes dans des secteurs innovants sont presque systématiquement rachetées, notamment par des entreprises américaines. Les décideurs, quant à eux, ont besoin d'une approche qualitative de ces groupements.
La part des salaires dans la valeur ajoutée ne pouvant baisser indéfiniment, il est difficile d'extrapoler de ce qui s'est passé en Allemagne depuis une dizaine d'années. Mme Agnès Bénassy-Quéré a eu raison de faire état du rattrapage auquel nous avons assisté, l'évolution des salaires ayant été très dynamique en Allemagne après la réunification. En l'occurrence, monsieur Jean Grellier, nous pouvons nous attendre à un rééquilibrage en Allemagne en faveur de la demande domestique, laquelle profiterait beaucoup aux exportateurs français. Si la cause structurelle de la modération salariale relève donc, peut-être, de la correction de différents excès et, donc, d'un rattrapage – dans ce cas-là, nous nous approchons de la limite d'un tel exercice –, elle peut aussi résulter de réformes ayant modifié le rapport de forces en Allemagne à travers notamment l'affaiblissement durable des syndicats. De surcroît, la stratégie allemande reposant sur l'externalisation de la fabrication de certaines pièces intermédiaires, les menaces de délocalisations peuvent également peser sur l'évolution des salaires. Quoi qu'il en soit, la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée témoigne de ce que ces derniers ne suivent pas l'évolution de la productivité, d'où le déséquilibre.
En France, en revanche, nous mettons l'accent sur un renforcement de l'offre productive comme en attestent un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment et qui vont dans le bon sens, par exemple en matière de recherche et développement ou en ce qui concerne l'autonomie des universités.
Si le taux facial de l'impôt sur les sociétés, monsieur Jean-Claude Sandrier, est très élevé, le taux effectif n'en est pas moins, en effet, relativement faible en raison du nombre de niches fiscales. Une mesure budgétairement neutre consisterait à baisser le taux statutaire et à supprimer certaines niches fiscales qui profitent d'ailleurs plus aux grandes entreprises qu'aux petites et moyennes entreprises.
Le dynamisme démographique français, monsieur Pierre Morange, constitue quant à lui un atout. Mais il ne faut pas oublier le rôle des politiques publiques en la matière. À cet égard, une évaluation des politiques publiques familiales me semble néanmoins nécessaire afin de vérifier s'il est possible de parvenir à maintenir ce dynamisme mais à moindre coût. Outre que des économies peuvent être en effet réalisées, il convient d'ajouter que le coût du vieillissement est moins cher chez nous que dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne.
S'agissant de la fiscalité du travail, nous préférons parler de « coin fiscal » pesant sur le travail, soit, de la différence entre le coût du travail supporté par les entreprises et le salaire net des salariés. Cela comprend en l'occurrence l'ensemble des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. La teneur idéologique de ces questions est importante, mais nous considérons que les allégements de cotisations sociales sur les bas salaires constituent une bonne mesure puisque ces 22 milliards rapportés au coût par emploi brut – tout en tenant compte des effets de bouclage – ont permis de préserver entre 600 000 et 800 000 emplois. Toutefois, il importe qu'une telle politique se limite aux seuls bas salaires afin de contourner les problèmes liés à un salaire minimum relativement élevé par rapport au salaire médian.
Comme l'a dit Mme Agnès Benassy-Quéré, les difficultés principales concernent les services où notre situation diffère grandement de celle de l'Allemagne. Le coût du travail d'un employé dans une boulangerie allemande et celui d'une personne travaillant dans une boulangerie française, par exemple, comporte des écarts extrêmement importants à la différence de ce qui se passe dans l'industrie.
Il s'agit davantage d'un problème lié au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) qu'à la fiscalité car si les Français paient plus de cotisations sociales, ils s'acquittent d'un moindre impôt sur le revenu quand les Allemands font l'inverse.

Existe-t-il donc des filières économiques ou industrielles vertueuses sur lesquelles nous pourrions-nous appuyer ? Cette question me paraît d'autant plus importante que nous sommes à la veille de la construction de nouvelles filières liées aux énergies renouvelables, à l'éco-construction ou aux économies d'énergies.
L'OCDE considère que c'est au marché, et non au politique, d'allouer au mieux les ressources entre les différents secteurs, qu'il s'agisse du capital ou de l'investissement. Si, en l'état, il est très difficile d'identifier ceux d'entre eux qui seraient les plus porteurs, il importe en effet au premier chef d'éviter de créer des distorsions fiscales entre secteurs d'activité ou entre entreprises d'un même secteur.
En revanche – et là, il y a peut-être consensus –, il convient de privilégier la recherche et le développement ainsi que l'innovation afin d'engager une dynamique positive. D'où l'importance de l'autonomie des universités, du rapprochement entre la recherche universitaire et les entreprises ainsi que du crédit impôt recherche – même s'il faut vérifier qu'il n'y a pas d'abus en la matière compte tenu de son coût budgétaire. Quoi qu'il en soit, nous sommes plutôt favorables à ce type de mesures globales.
La séance est levée à dix-huit heures dix.