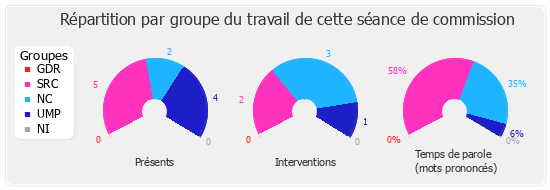Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale
Séance du 2 mars 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
Mercredi 2 mars 2011
La séance est ouverte à seize heures quinze.
(Présidence de M. Marc Laffineur, vice-président de la Mission d'information)
La Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale entend, en audition ouverte à la presse, Mme Anne-Marie Brocas, directrice de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), membre du Conseil d'analyse économique et professeur associé à l'École normale supérieure de Cachan, accompagnée de Mme Catherine Zaidman, sous-directrice des synthèses, des études économiques et de l'évaluation ; M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), membre du Conseil d'analyse économique et du Conseil d'orientation pour l'emploi, accompagné de M. Pierre-Alain Pionnier, chef de la division croissance et politiques macroéconomiques à la direction des études et synthèses économiques ; M. Antoine Magnier, directeur de la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES), accompagné de M. Sébastien Roux, sous-directeur « salaires, travail et relations professionnelles » et de M. Julien Deroyon, chargé de mission.

Nous poursuivons aujourd'hui les auditions de notre mission chargée de réaliser une étude comparative sur la compétitivité de notre économie et de notre système social, en particulier vis-à-vis de nos principaux concurrents et amis au sein de l'Union européenne.
Avant de vous entendre, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de modifier la date de votre audition et je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. le co-rapporteur Jérôme Cahuzac.
Le financement de la protection sociale affecte-t-il la compétitivité de l'économie française ? Cette question resurgit périodiquement dans le débat public et les économistes ont tendance, dans l'ensemble, à y apporter une réponse négative. Lorsqu'elle s'est posée avec acuité au début des années 1990, elle concernait surtout les charges sociales pesant sur les bas salaires, ce constat ayant conduit à les alléger fortement. Si le coût du travail peu qualifié dans notre pays est jugé relativement élevé par des institutions comme le Fonds monétaire international (FMI) ou l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce n'est pas en raison du poids des charges sociales, qui est quasiment inexistant.
Par ailleurs, lorsque l'on considère la compétitivité-coût de l'économie française dans son ensemble, on n'observe pas de handicap manifeste. Les faiblesses de notre compétitivité se situent ailleurs, du côté de la qualité et de l'adéquation aux attentes des acheteurs.
Le bon révélateur en matière de compétitivité structurelle réside dans la comparaison entre la France et l'Allemagne. Cependant, je voudrais, tout d'abord, revenir sur le diagnostic, établi au cours des années 1990, qui avait conduit aux politiques d'allégement de charges sociales.
Était apparue, alors, une spécificité française en matière de coût du travail peu qualifié : entre les hausses du SMIC et les accroissements de charges patronales, la France semblait compter parmi les pays où le travail peu qualifié était le plus onéreux – en pourcentage du salaire médian – au risque éventuellement de susciter, ou de conforter, un chômage de masse des travailleurs les moins qualifiés. La situation était en revanche différente pour les salaires supérieurs au SMIC où la hausse des charges sociales avait surtout conduit à freiner la progression des salaires nets. D'une certaine manière, le SMIC a été utilisé comme un instrument de politique de revenus, dans le but de stimuler la croissance des salaires, plutôt que comme un seuil défensif visant à éviter la pauvreté au travail.
Face à un tel constat, les pouvoirs publics se sont engagés dans une politique d'allégements des charges sociales sur les bas salaires – allégements dits « Balladur » puis « Juppé » – portant sur la plage salariale comprise entre 1 et 1,3 SMIC. À ces baisses de charges offensives, visant à réduire le coût du travail peu qualifié et à stimuler l'emploi, ont succédé des diminutions de charges défensives tendant à limiter les hausses de coût du travail associées au passage aux 35 heures. La plage salariale des allégements s'étend désormais de 1 à 1,6 SMIC et le taux de ces prélèvements est devenu résiduel au niveau du SMIC. Les effets de ces politiques sur l'emploi sont encore débattus, mais le débat porte désormais davantage sur leur ampleur que sur leur existence. Un certain consensus existe, en effet, pour considérer que ces politiques ont bien soutenu l'emploi des travailleurs non qualifiés, comme en témoigne l'arrêt de la diminution de la part de l'emploi peu qualifié dans l'emploi total qui avait été observée jusque-là.
Si la France a encore un problème de compétitivité lié à son coût du travail, ce n'est plus guère en modifiant le financement de la protection sociale qu'elle peut espérer le résoudre. La seule option envisageable serait d'agir sur le niveau du SMIC lui-même, éventuellement en compensant une diminution de ce dernier par des baisses de charges pour les salariés, mais toute la difficulté serait alors de trouver des sources de financement alternatives. Par ailleurs, la compétitivité ne se réduit pas aux coûts : il faut mobiliser d'autres explications pour rendre compte de la détérioration de notre position sur les marchés extérieurs, en particulier vis-à-vis de l'Allemagne.
Dans le débat public, la notion de compétitivité est souvent limitée à une seule acception : celle de la compétitivité-coût. On se demande alors si les coûts de production français ne sont pas trop élevés et s'ils ne nuisent pas à la capacité de notre pays à exporter. La problématique de la compétitivité ne doit pas être entendue de manière étroite, comme la recherche d'excédents extérieurs : un pays peut être en déficit extérieur et être parfaitement compétitif. Si, par exemple, l'on cherche à investir dans une économie très prometteuse, il en résultera une appréciation du taux de change et un déficit commercial mais qui constituera la contrepartie du mouvement de capitaux entrants.
L'étalon en matière de performance économique demeure la croissance du produit intérieur brut (PIB) et celle du revenu par habitant. Le revenu par habitant permet véritablement, en effet, de comparer le dynamisme de deux économies. De surcroît, la croissance du PIB et du revenu par habitant dépendent, in fine, des gains de productivité et donc de l'innovation. Dans un tel contexte, les performances à l'exportation ne sont pas une fin en soi mais, en raison de l'intensité de la concurrence internationale, elles peuvent être un indicateur pertinent de la capacité d'un pays à innover pour satisfaire la demande. On imagine mal, à long terme, comment une économie pourrait croître rapidement et satisfaire sa demande intérieure tout en étant incapable d'exporter.
Dans cet esprit, la comparaison avec l'Allemagne semble particulièrement instructive pour apprécier l'évolution de la compétitivité française. En effet, nos deux pays sont confrontés à l'appréciation de l'euro et à la concurrence des pays émergents. Ils sont également en concurrence directe sur la plupart des marchés à l'exportation : la probabilité pour un exportateur français d'être en concurrence avec un exportateur allemand vendant le même produit sur le même marché est aujourd'hui proche de 75 %.
Entre 2000 et 2006, on a constaté un décrochage des exportations françaises par rapport aux exportations allemandes. On a observé, en outre, une nette dégradation de la balance commerciale française, qui est passée d'un excédent de 0,9 % du PIB en 2000 à un déficit de 1,3 % du PIB en 2006. Au cours de cette même période, la balance commerciale allemande s'est redressée de façon spectaculaire, passant d'un excédent s'élevant à 0,4 % du PIB en 2000 à 5,7 % en 2006.
Les spécialisations géographique et sectorielle des exportateurs français et allemands sont très proches. En Allemagne, les coûts salariaux unitaires dans l'industrie manufacturière ont baissé entre 2000 et 2006, alors qu'ils sont restés stables en France et ont augmenté dans d'autres États membres de la zone euro : en Allemagne, la baisse a été de 9,3 % ; en France, les coûts ont été stables ; en Italie, la hausse a été de 17,2 % et en Espagne de 16,2 %.
La baisse des coûts salariaux unitaires en Allemagne a été obtenue au moyen d'une politique de modération salariale et de l'externalisation d'une partie de la production vers les pays d'Europe centrale et orientale. Du côté allemand, l'amélioration de la compétitivité résulte donc de processus de marché. En revanche, la stabilisation des coûts salariaux unitaires en France a été obtenue grâce à des allégements de cotisations sociales, des gains de productivité horaire et une modération salariale. L'État est donc intervenu pour préserver la compétitivité des producteurs français, alors qu'en Allemagne les gains de productivité ont eu lieu spontanément, par le libre jeu de la concurrence.
Malgré cette dégradation relative de la compétitivité-coût en France, les exportateurs français se sont efforcés de conserver des prix compétitifs, mais, pour cela, ils ont vraisemblablement sacrifié une partie de leurs marges et d'autres ont simplement disparu. Nous mesurons, donc, en France, la « compétitivité des survivants ».
Même si la France et l'Allemagne exportent globalement des produits identiques vers les mêmes pays, les deux nations ne se positionnent pas toutefois sur la même gamme. L'Allemagne bénéficie d'une part de marché trois fois plus élevée que celle de la France pour les produits haut de gamme. En revanche, ce ratio n'est que de deux pour les produits bas de gamme. Ces écarts de parts de marché pour les produits haut de gamme se sont encore renforcés depuis 2000. Ils pourraient être liés à des différences d'efforts de recherche et de développement à long terme. Les dépenses moyennes de recherche et de développement sur la période 2000-2006 s'élèvent à 2,5 % du PIB en Allemagne contre 2,2 % du PIB en France. Ces écarts sont plus significatifs si l'on se restreint aux seules entreprises privées : les dépenses de recherche et de développement ne s'élèvent alors qu'à 1,1 % du PIB en France, contre 1,7 % en Allemagne.
Une étude menée par l'institut COE-Rexecode permet également d'apprécier, de manière plus qualitative, la perception de l'évolution des produits exportés. Même si le prix des produits français semble globalement compétitif par rapport aux produits allemands, leur contenu technologique et les services rendus par nos entreprises paraissent nettement moins bons. Les entreprises françaises souffrent également d'un déficit de notoriété par rapport à leurs concurrentes allemandes dans le secteur des biens intermédiaires et des biens d'équipement. Il semble qu'il y ait donc eu une dégradation des performances françaises au cours de la dernière décennie pour la plupart de ces critères.
Ces éléments fournissent des pistes pour expliquer nos pertes de parts de marché par rapport à l'Allemagne. Cela étant, l'étalon allemand reste très exceptionnel, ce pays étant le seul à avoir su maintenir ses parts de marché à l'exportation dans un contexte où le marché mondial explosait. Se comparer à lui, c'est peut-être se montrer indûment ambitieux.
La compétitivité-coût de la France semble donc à peu près raisonnable, mais la qualité de nos produits étant sensiblement plus faible, nous souffrons d'un problème de compétitivité structurelle avéré.
L'emploi, le travail et la formation professionnelle constituent le champ de compétence de la DARES. En complément des propos de M. Jean-Philippe Cotis, que je partage largement, je souhaite vous livrer quelques éléments d'appréciation sur la situation conjoncturelle de notre marché du travail.
L'analyse des développements récents doit se faire au regard de la récession, d'une ampleur exceptionnelle, que nous avons subie en 2008 et 2009, même si elle a été moins forte en France que dans la plupart des pays industrialisés. Notre PIB a reculé de 2,5 % en 2009 contre 3,5 % pour l'ensemble des pays industrialisés, 4 % pour la zone euro et près de 5 % pour l'Allemagne et l'Italie.
La récession s'est traduite par d'importantes pertes d'emplois salariés marchands en France : 187 000 postes ont été détruits en 2008 et 334 000 en 2009. Ce recul s'est toutefois révélé nettement moins marqué que ce que laissait envisager le recul de l'activité. Au-delà des mesures ciblées de soutien à l'activité et au pouvoir d'achat, les mesures spécifiques de soutien conjoncturel prises par le Gouvernement dans le domaine de l'emploi, ainsi que celles relatives à l'emploi des seniors, ont limité les pertes d'emplois. La hausse du nombre de contrats aidés et le dynamisme persistant de l'emploi non salarié ont également permis de les atténuer dans l'ensemble de l'économie.
Une particularité notable des évolutions récentes en matière d'emploi, distincte de celle des récessions passées, est la très bonne résistance du taux d'emploi des seniors, qui a continué de croître sensiblement au cours des trois dernières années malgré la récession. Corrigé des effets de structures démographiques, le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans a augmenté d'un peu plus de quatre points entre le quatrième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2010. Cette bonne performance doit être corrélée aux mesures vigoureuses que le Gouvernement a prises ces dernières années pour stimuler l'offre et la demande de main-d'oeuvre de cette catégorie de la population.
Après une stabilisation à la fin de 2009, l'emploi salarié marchand a commencé à se redresser au début de 2010, les dernières statistiques faisant état de 55 000 créations nettes de ce type d'emplois au premier et au second semestres de l'an passé, soit un total de 110 000 créations nettes sur l'ensemble de 2010. Dans ses dernières prévisions publiées au mois de décembre, l'INSEE estime que les créations d'emplois totales, dans l'ensemble de l'économie, se sont élevées à environ 175 000 l'an passé, après 230 000 pertes en 2009.
De même qu'en début de récession l'essentiel de l'ajustement de l'emploi s'était porté sur l'intérim, le redressement récent de l'emploi a été principalement porté par un rebond soutenu et régulier de l'emploi intérimaire, initié dès le printemps 2009. Ce sont 103 000 postes d'emplois intérimaires qui ont ainsi été créés au cours de l'année passée, soit une hausse de 21 % sur un an. Hors intérim, les destructions d'emplois se sont en outre sensiblement atténuées dans les secteurs de l'industrie et de la construction tout au long de l'année passée. Dans le tertiaire, hors intérim, l'emploi s'est progressivement redressé en gagnant près de 84 000 postes l'an passé.
Certaines évolutions récentes en matière d'emploi ont étonné les économistes et les conjoncturistes.
La première évolution surprenante réside, comme je l'évoquais précédemment, dans la bonne résistance de l'emploi, inattendue au regard du recul de l'activité pendant la récession. Cette résistance demeure, après prise en compte des estimations très conventionnelles que l'on peut faire des effets des mesures de soutien conjoncturel prises par le Gouvernement dans le domaine de l'emploi.
La deuxième évolution qui a étonné la plupart des instituts de conjoncture, c'est qu'à la suite de la récession, l'emploi s'est redressé, à partir du début de l'année 2010, de manière sensiblement plus précoce et plus vigoureuse que ce que laissait envisager le rythme modéré de la reprise d'activité.
Ces deux bonnes surprises en matière d'emploi ont néanmoins une contrepartie : une évolution de la productivité plus faible que celle que l'on pouvait anticiper, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations quant à la capacité des entreprises à restaurer leur profitabilité au cours des prochains trimestres.
Troisième évolution surprenante : le chômage a plus augmenté en 2009 que ne le prévoyaient les estimations d'emplois et l'appréciation de la plupart des conjoncturistes sur le dynamisme de la population active. Cette mauvaise surprise reflète, en contrepartie, une hausse inattendue de l'activité en particulier des seniors, ce qui peut être de bon augure dans une perspective à moyen terme.
Nous manquons encore, cependant, de recul pour interpréter et apprécier les conséquences de ces bonnes surprises en matière d'emploi et de leur contrepartie plus négative en matière de productivité. À ce stade, les estimations de croissance et d'emploi restent provisoires. Nous ne disposons pas encore d'éléments très précis quant à l'ajustement à la baisse des heures travaillées par salarié pendant la récession mais, selon la plupart des indicateurs, il semble qu'il n'ait pas été très marqué – ce qui expliquerait l'essentiel des bons résultats en matière d'emploi. De même, le redressement de l'intérim au cours des derniers trimestres ne suffit pas à expliquer celui de l'emploi en 2010. Ne disposant donc pas d'explications totalement satisfaisantes sur les évolutions récentes de l'emploi et de la productivité, nous nous interrogeons, comme la plupart des instituts de conjoncture, sur les facteurs qui en sont à l'origine et sur le caractère temporaire ou durable de ces dernières.
Pour schématiser à l'extrême, deux pistes d'explication s'offrent à nous.
Sur un registre négatif, on ne peut exclure que les évolutions positives en matière d'emploi soient le reflet d'un affaiblissement plus ou moins durable de notre potentiel de production suite à la crise : elles refléteraient ainsi un redressement conjoncturel de l'activité plus marqué que celui qui avait été estimé par la plupart des instituts de conjoncture, mais autour d'une tendance qui serait à l'inverse moins vigoureuse qu'escompté.
Sur un registre positif, à l'inverse, il est possible que nous ayons assisté, au cours des derniers trimestres, à un réel enrichissement de notre croissance en emplois et que nous ayons sous-estimé l'impact bénéfique sur l'emploi des mesures de soutien qui ont été prises par le Gouvernement ces dernières années ou des réformes de structure qui ont été mises en oeuvre avant et pendant la récession : renforcement du dialogue social ; stimulation des revenus liés au travail tout en promouvant une modération du coût du travail pour les entreprises ; renforcement de l'accompagnement et du suivi des demandeurs d'emploi ; fluidification du marché du travail ; stimulation de l'emploi des seniors.
Aujourd'hui, le principal enjeu reste de poursuivre et de parachever ces réformes afin de stimuler les taux d'emploi – en particulier pour les jeunes et les seniors – et de réduire le dualisme de notre marché du travail, dans un contexte de consolidation des finances publiques plus contraignant que celui que nous connaissions il y a quelques années.
Si la DREES suit, notamment à travers les comptes de la protection sociale, l'évolution des dépenses de protection sociale et des conditions de leur financement, elle ne dispose cependant pas d'expertise propre quant à l'impact économique de la protection sociale, pas plus que sur les questions de coût du travail qui relèvent de l'INSEE et de la DARES.
C'est pourquoi mon propos sera modeste et se bornera à rappeler quelques constats sur l'évolution de la protection sociale et de son financement.
Premier constat, la France a, rapporté à son PIB, un niveau de dépenses sociales élevé – ce qui est important en matière de compétitivité, la question de la structure des financements étant quant à elle, d'une certaine façon, seconde. Cependant, la croissance de ces dépenses en part de PIB a été relativement maîtrisée depuis le milieu des années 1990.
Avec un ratio de dépenses de prestations sociales de 29,3 points de PIB en 2008, notre pays se situe à un niveau aussi élevé que celui des pays d'Europe du Nord. Toutefois, si l'on raisonne en termes de prestations sociales par tête et en parité de pouvoir d'achat, le diagnostic diffère assez sensiblement puisque nous nous trouvons alors derrière ces derniers, nos dépenses s'étant élevées à 7 900 euros en 2008 contre 9 000 à 10 000 euros dans les pays d'Europe du Nord. Nous situant à un niveau très proche de l'Allemagne – 7 700 euros par tête – sans doute sommes-nous plus confrontés à un problème de production que de niveau de protection sociale.
Les dépenses liées à l'ensemble des prestations sociales – assurance chômage, régimes complémentaires, ensemble des régimes de sécurité sociale – qui représentaient 15 points de PIB en 1959, s'élevaient à 28,6 points en 1993, à 29,3 points en 2008 et à 31,3 points en 2009, cette dernière augmentation étant due à l'évolution du PIB lui-même et à celle des prestations pendant la crise, notamment de chômage. Deux ans après le choc subi par l'économie, nous pouvons nous attendre à un rythme de progression assez proche de celui que nous avons connu antérieurement.
Deuxième constat, la structure du financement de la protection sociale a été fortement transformée au cours des trente dernières années : mesures de déplafonnement des assiettes des cotisations sociales – branches famille, maladie, accident du travail ; création de la contribution sociale généralisée et élargissement de la taxation à des revenus qui ne l'étaient pas, ou faiblement, tels que les revenus de remplacement, certains revenus salariaux et les revenus de l'épargne ; développement à partir des années 1990 des exonérations de cotisations des employeurs portant sur les bas salaires, compensées aujourd'hui par des impôts et des taxes affectés à la protection sociale.
Si l'on considère la structure du financement de la protection sociale par type de ressources en distinguant les cotisations des employeurs et salariés, les impôts et taxes affectés ainsi que les contributions publiques, la part de la protection sociale financée par les cotisations sociales des employeurs et des salariés a baissé de 17 points à partir des années 1990, baisse qui a été compensée par une augmentation de 21 points de la part des impôts et des taxes affectés au financement de la protection sociale, dont il convient de déduire une diminution de 5 points des contributions publiques – des taxes affectées venant compenser des exonérations de charges.
Cette diversification des sources de financement de la protection sociale doit être cependant relativisée, puisque la principale assiette demeure les salaires, avec une part de 72,5 % en 2009 contre 76,5 % en 1990 – cette diminution étant d'ailleurs considérable compte tenu des masses financières concernées. C'est ainsi que, entre 1990 et 2009, la part de financement assurée par la taxation des revenus de remplacement a été doublée, avec 2,5 % du total de la protection sociale, et la part imputable aux revenus de l'épargne des ménages a été multipliée par trois, avec 2,5 % du total, les financements assis sur la consommation des ménages étant stables, représentant environ un dixième du financement de la protection sociale.
D'autres transformations sont également assez sensibles et, tout d'abord, la progressivité des prélèvements sociaux pesant sur les salaires en raison des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, le niveau de taxation s'élevant à 69 points pour le salaire moyen contre 40 points pour le SMIC.
Par ailleurs, la baisse sensible de la part du financement directement payé par les employeurs est notable avec les 17 points que j'ai déjà évoqués.
J'ajoute qu'une certaine convergence est observable entre les différents pays européens, puisque ceux dont le financement était très largement fiscalisé, comme le Danemark, ont augmenté la part de financement sous forme de cotisations sociales tandis que nous, nous augmentions la part assurée par la fiscalité.
En outre, cette évolution de la taxation des diverses assiettes tend à améliorer l'équité des prélèvements sociaux entre les diverses catégories de revenus – salaires et revenus de remplacement –, jusqu'à parvenir à une certaine parité de situation entre les actifs et les retraités.
Troisième constat, enfin : s'interroger sur la compétitivité de l'économie implique de réfléchir au contenu et à l'efficacité des dépenses sociales comparativement aux pays voisins, en particulier l'Allemagne. Or, sur la période récente, la France se distingue des autres pays européens puisque le taux de pauvreté a été réduit alors qu'en Allemagne, il a progressé. Nous nous distinguons également s'agissant du taux de fécondité et du dynamisme démographique, grâce à une prise en charge complète des familles – services de garde d'enfants, congés permettant aux hommes et aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle. Enfin, la protection sociale me semble aussi jouer un rôle important en matière de cohésion territoriale.
À en croire la presse depuis plusieurs semaines, le différentiel du coût horaire du travail serait de l'ordre de 20 % entre la France et l'Allemagne. Comment se fait-il, Monsieur Cotis, que l'INSEE n'ait pas réagi plus rapidement dès lors que, selon vos propos, le coût horaire dans l'industrie ne serait pas significativement différent ? Serait-il possible de réaliser des microanalyses dans la mesure où la comparaison avec l'Allemagne est extrêmement délicate, tous les secteurs ne bénéficiant pas de conventions collectives et les Länder ayant des politiques très différentes les uns des autres ? En outre, Monsieur Cotis, vous n'avez pas abordé les problèmes liés à la rigidité du marché du travail en France et, plus globalement, au caractère inhibiteur de la réglementation française pour l'esprit d'entreprise.
Madame Brocas, si les prestations par tête s'élèvent à environ 10 000 euros par habitant dans les pays d'Europe du Nord et à 7 900 euros chez nous tout en représentant globalement 31,3 % du PIB – nous avons dépassé la Suède l'année dernière –, comment expliquez-vous une telle différence compte tenu des dépenses de vieillesse, de santé et des 24 prestations que nous délivrons entre la naissance et la mort ? Enfin, alors que ces prestations ont continué à augmenter chez nous au rythme de 3,5 % par an, ont-elles été stabilisées dans les pays scandinaves ?

La diminution des marges des entreprises à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur Cotis, est-elle continue depuis une dizaine d'années ou s'agit-il d'une adaptation des entreprises à la crise, afin de moins licencier ?
En outre, avez-vous le sentiment que nos entreprises accomplissent des efforts en matière d'innovation et de recherche et de développement depuis trois ou quatre ans ?
Enfin, un taux de pauvreté nettement inférieur dans notre pays à celui de l'Angleterre et de l'Allemagne ne nous a-t-il pas permis de traverser la crise dans de moins mauvaises conditions ?
Nous nous sommes trompés sur le décompte des heures travaillées en envoyant aux responsables de l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre et la structure des salaires (ECMOSS), coordonnée par Eurostat, des chiffres traduisant des coûts salariaux trop élevés par unité produite, tandis que nos collègues d'Eurostat ne semblent pas avoir procédé à l'harmonisation des données qu'ils sont censés réaliser. Outre qu'elles avaient un retard de près de six mois, nos équipes auraient évidemment dû avoir la curiosité d'esprit d'établir un ratio par rapport au coût du travail d'il y a quatre ans – puisque telle est la fréquence de cette enquête – et de constater ainsi combien cette croissance était beaucoup trop élevée. Je précise que l'inspection générale de l'INSEE réalise un audit très approfondi sur ce qui s'est passé et que, lorsque j'en aurai pris connaissance, je reviendrai devant vous, si vous le souhaitez, afin de vous faire part des constats et des solutions envisagées. Incontestablement, un tel épisode ne peut que rendre très modeste un directeur général de l'INSEE.
Par ailleurs, les rigidités du marché du travail pèsent effectivement sur la compétitivité d'une économie et impactent également les performances de notre commerce extérieur.
Si nous pouvons considérer que la France demeure globalement compétitive, puisqu'elle a aligné ses prix sur ceux de ses concurrents, les coûts, eux, demeurent plus élevés et les marges des entreprises en pâtissent. Il importe donc que la compétitivité-prix soit maintenue avec une préservation ou une augmentation des bonnes parts de marché.
Même si l'évolution du commerce extérieur français traduit un problème de compétitivité structurelle qui nous pénalise dans la compétition internationale, la comparaison avec l'Allemagne n'en demeure pas moins problématique puisque, avec des gains de parts de marché exceptionnels, ce pays occupe la première position en ce domaine et que nous ne l'égalerons probablement pas dans les années à venir. Nos problèmes de compétitivité, je le répète, relèvent plus de la qualité de nos produits que de leur coût, les prestations délivrées par l'Allemagne étant en moyenne de bien meilleure qualité que les nôtres. Alors que, compte tenu de la croissance rapide du marché mondial, il est quasiment impossible pour un pays de conserver ses parts de marché, les Allemands y sont, seuls, parvenus.
Par ailleurs, avec 0,6 ou 0,7 point de PIB, les surplus de productivité annuelle globale sont très faibles dans notre pays, ce qui peut être inquiétant. En effet, si les effectifs des entreprises ont été maintenus pendant la phase basse du cycle – les destructions d'emplois ont donc été moindre –, le nombre de recrutements a beaucoup augmenté pendant la phase de redémarrage, ce qui ne laisse pas de surprendre et qui induit que nos gains de productivité, déjà faibles, ont peut-être encore baissé, au point de devenir marginaux.
En outre, les économies émergentes exerçant une pression forte sur la demande en matières premières, leurs prix augmentent considérablement, ce qui laisse augurer de la possibilité d'une croissance sans pouvoir d'achat – je rappelle que, dans le passé, le cycle des matières premières était corrélé avec la situation conjoncturelle en occident. Là encore, je suis inquiet.
Dans ce contexte, caractérisé par des gains de productivité anormalement bas et des prix des matières premières trop élevés, les entreprises françaises réduisent donc leurs marges pour survivre, se plaçant ainsi sur la défensive, à la différence de leurs homologues allemandes.
Les pays qui disposent d'un PIB élevé ont un ratio dépenses de protection sociale rapporté au PIB plus faible que des pays dans lequel le PIB par tête est moins important : tel est le facteur principal expliquant la différence de diagnostic selon que l'on raisonne en part de PIB et en masse financière ou en dépenses par habitant en parité de pouvoir d'achat.
Plus précisément, le montant des prestations de protection sociale par tête est de 8 800 euros en Suède, 10 000 en Norvège, en Suisse et au Luxembourg et 7 900 euros en France. La prestation « vieillesse » est de 3 700 euros par tête en Suède contre 3 630 en France, celle de la maladie de 3 640 euros contre 2 820 euros. Cependant, notre couverture « chômage » demeure plus élevée.
Si, sur les dix dernières années, le ratio des prestations sociales rapporté au PIB des pays d'Europe du Nord et de l'Union européenne est en légère baisse, celui de la France a connu, lui, une petite hausse. Plus précisément, de 1996 à 2006, ce ratio a baissé de 2,6 % en Suède, alors qu'il a augmenté de 0,1 % en France.

Je suis heureux que Monsieur Cotis ait affirmé que l'on comparait la compétitivité des survivants. J'ai également apprécié ses propos sur la compétitivité des prix : l'affaiblissement des marges conduit à long terme à une diminution évidente de notre compétitivité structurelle.
La situation de l'économie française fait songer à ce que disait Sacha Guitry en mourant : « si je comprends bien, messieurs, je meurs guéri ! ». À en croire les commentateurs, tout ne va pas si mal… Nous n'en affichons pas moins un déficit structurel du commerce extérieur de 50 milliards, une croissance minable et une industrie qui s'étiole.
Nous parlons de compétitivité des produits, et même – pour l'essentiel – de compétitivité-prix des produits. Or la compétitivité-prix de l'industrie allemande ne va pas de soi. D'autres facteurs interviennent donc dans la compétitivité allemande. Il s'agit de ce que les économistes appellent la différenciation du produit : les marchés étant imparfaits, la qualité du produit ou les réseaux commerciaux jouent largement autant que la compétitivité-prix.
Nous oublions aussi un débat fondamental : celui de la compétitivité des territoires. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce de vendre plus ou mieux, ou de fabriquer chez soi ? Je pense que l'essentiel est que notre territoire reçoive beaucoup d'investissements productifs lui permettant de créer de l'emploi. Prenons le cas de la Chine et du Japon : le Japon possède un tiers de l'industrie chinoise, ce qui est considérable ; mais c'est en Chine que les investissements sont accomplis et les emplois créés, tandis que le Japon connaît une crise sociale et crée moins d'emplois. Peu importe donc, à la limite, qui possède l'industrie. Il m'est indifférent que M. Mittal soit indien, chinois ou turc, pourvu qu'il laisse ses industries chez nous – ce qu'il n'a, hélas, apparemment pas l'intention de faire.
La compétitivité du territoire répond à des critères très différents, beaucoup plus complexes et difficiles, que celle des produits, qui ne doit pas être non plus réduite aux prix. Les notions de stabilité, de sécurité et de psychologie de l'environnement jouent un rôle plus important que la comparaison à un moment donné. Si un investisseur à dix ans a le sentiment que le niveau des charges ne va guère varier au cours des dix prochaines années, il investira ; en revanche, s'il anticipe que ce niveau, même bas, va augmenter brusquement – ce qui sera immanquablement le cas en France –, les choses seront plus délicates. J'ai rédigé dernièrement sur cette question de la compétitivité des territoires un rapport intitulé « L'attrait de la France pour les investisseurs étrangers », que je verse volontiers au débat.
Venons-en au problème des salaires. Certaines choses bougent tout de même, et je me réjouis que Monsieur Cotis nous rappelle que la compétitivité vis-à-vis du reste du monde demeure aussi importante que la compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne. Prenons l'exemple de l'Inde et de la France. Je puis vous garantir qu'en Inde, un ingénieur très qualifié a un pouvoir d'achat bien supérieur à son homologue français. De même, un jeune diplômé de l'Indian institute of management d'Ahmedabad gagne pratiquement deux fois plus, en euros ou en dollars, qu'un diplômé d'HEC.
Comparons maintenant les charges sociales avec les États-Unis. Les charges sociales légales sont évidemment plus faibles outre-Atlantique, mais il est probable que dans les années qui ont précédé la crise, les charges sociales réelles – qui tiennent compte des charges conventionnelles – dans l'industrie automobile américaine ont été égales ou supérieures à ce qu'elles étaient en France. Le coût du travail dans l'industrie était à mon avis beaucoup plus lourd aux États-Unis qu'en France, mais les statistiques ne tiennent compte que des charges sociales obligatoires ou légales. Les charges conventionnelles considérables qui existaient dans l'industrie automobile américaine expliquent peut-être qu'on continue encore, un peu, à fabriquer des automobiles en France, alors qu'on n'en fabrique presque plus aux États-Unis et que toutes les industries automobiles américaines aient dû être nationalisées.
Restent les facteurs de compétitivité de long terme, en particulier la recherche et le développement. Je m'insurge contre le raisonnement selon lequel on pourrait sans dommage augmenter l'impôt sur les sociétés et supprimer le crédit impôt recherche. Je crains que nous ne finissions nous aussi par mourir guéris, comme Sacha Guitry.

L'agriculture fait partie intégrante de l'économie française. Charles de Courson et moi-même avons conduit sur ce sujet un travail de huit mois qui a débouché sur une proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture française.
Le constat est effrayant. Avec un SMIC horaire de 8,80 euros, et un taux de charges compris entre 41 % et 42 %, l'agriculture française est largement en tête en Europe pour le coût du travail. Non seulement le SMIC est beaucoup plus bas – voire inexistant – dans certains pays, mais, de plus, les autres pays ont mis en place de nombreux dispositifs d'exonérations de charges. Ce constat a des conséquences très concrètes, notamment dans la compétition entre la France et l'Allemagne, sur la répartition des parts de marché agricoles : nous reculons partout. Quelle est votre analyse de la situation ? Quels conseils donneriez-vous au législateur ?

Les constats que nous dressons s'inscrivent dans le droit-fil de ceux que nous établissions la semaine dernière. Contrairement aux idées reçues, le coût du travail n'est pas nécessairement un facteur fondamental de la compétitivité de l'économie française. Cette dernière souffre en revanche de problèmes structurels majeurs – et bien connus – qui touchent à l'innovation, en particulier dans le secteur industriel, au niveau de gamme des produits – lequel tendrait à baisser par rapport à l'Allemagne –, à la dimension des entreprises, avec un manque de PME performantes, et à un certain problème de formation, en particulier des techniciens supérieurs.
Dispose-t-on d'indicateurs mettant en évidence, par exemple, l'apport des pôles de compétitivité, dont l'objectif était de développer l'innovation et les réseaux d'entreprises ? Pour avoir participé aux états généraux de l'industrie, je sais que cette réflexion est menée à l'échelle nationale mais quid des relations avec les territoires ? Il semble qu'il y ait un vrai décalage entre les réflexions conduites et leur application dans les territoires, là où se construisent les capacités d'innovation, les réseaux d'entreprises et les compétences qui peuvent contribuer à renforcer notre compétitivité.

J'insiste à mon tour sur l'importance de la dimension territoriale. J'ai été – il y a déjà quelques années – à l'origine des pôles de compétitivité, dont la mise en oeuvre n'a, il est vrai, pas été conforme à ce que j'avais imaginé : il y a eu une dissémination, avec près de soixante pôles de compétitivité, là où j'avais proposé de commencer par cinq judicieusement choisis. J'ai donc longuement réfléchi à la territorialité du développement économique. C'est ainsi que je tiens à faire observer combien est considérable le poids du Bade-Würtemberg et de la Bavière dans l'économie allemande. Je vous suggère d'ailleurs, monsieur le président, que nous passions quelques jours en Bavière à la fin de nos travaux pour confronter nos conclusions à la réalité de secteurs dont le fonctionnement est très éloigné de nos habitudes.
L'expression « réseau d'entreprises » m'interroge. Historiquement, nous avons raisonné en France en termes de réseaux, alors que la notion de territoire est bien plus forte pour produire des synergies. Ma question s'adresse à tous, en particulier à M. Cotis que j'avais eu l'occasion d'écouter lorsque nous participions tous deux, il y a quelques années, à la commission « Pébereau » sur la dette publique. Comment appréhendez-vous la notion de territoire dans un pays aussi jacobin que le nôtre, marqué par une structure pyramidale de l'administration ?
L'INSEE n'a pas d'expertise très pointue sur les clusters et la dimension territoriale. Les expériences existantes montrent cependant que la formule peut se révéler adéquate pour améliorer nos performances en termes de commerce extérieur et de développement économique. Toute la question est de savoir comment s'y prendre sur le plan institutionnel pour assurer leur existence propre et leur soutenabilité à long terme. Outre l'Allemagne, on en trouve des exemples en Italie du nord ; mais nous avons du mal à transposer ce type de dispositifs en France.
Je reviens maintenant sur l'enquête sur le coût de la main-d'oeuvre et la structure des salaires. Nous disposons de données robustes sur les coûts de production et le coût du travail dans les comptes nationaux. Cette enquête, conduite tous les quatre ans et coordonnée par Eurostat, sert surtout à nous renseigner sur la structure des coûts. Sachez, même si cela n'excuse pas le bug qui s'est produit à l'INSEE, qu'il ne s'agit pas d'une source d'information que nous utilisons pour calculer nos coûts.
Je ne dispose pas d'expertise particulière sur l'agriculture. Je rappelle simplement que, comme le reste de l'économie marchande, ce secteur est éligible aux allégements de cotisations patronales ciblés sur les bas salaires.
Plusieurs interventions ont mis en avant le fait que le coût du travail n'est qu'un facteur parmi d'autres de la compétitivité. Je souscris à cette analyse. Du point de vue du marché du travail, la maîtrise du coût du travail peu qualifié reste cependant un enjeu essentiel dans la phase de reprise que nous connaissons.
La proposition de loi du groupe Nouveau centre qui vise à alléger les cotisations sociales pour le secteur agricole ne constitue pas, à mon sens, la bonne réponse. C'est probablement nécessaire pour les fruits et légumes, mais ni pour l'élevage, ni pour les productions céréalières, qui a un taux d'emploi familial très élevé et un système social plus avantageux que chez nos voisins.
Pour les productions d'élevage et les productions hors sol, c'est le système réglementaire qui est facteur de blocage en France. Pour installer un atelier de méthanisation, il faut au minimum quatre ans ! Quant à l'agrandissement d'un atelier hors sol, c'est presque mission impossible avec les enquêtes publiques. Ne nous trompons donc pas de diagnostic.

On peut faire confiance à Charles de Courson pour que cette proposition ne coûte pas un euro aux comptes sociaux. Le financement de la protection sociale est aujourd'hui assuré à plus de 72 % par des prélèvements assis sur les salaires, et la fiscalité tend à s'alourdir. Plus vite on réduira la part des prélèvements sur les salaires, et mieux la France se portera.
Je reconnais, cher Pierre Méhaignerie, que notre proposition intéresse d'abord les secteurs qui, comme ceux des fruits et légumes ou de la viticulture, emploient une nombreuse main-d'oeuvre. Pour autant, il y a tout de même des emplois permanents dans le secteur des cultures céréalières. Quand la main-d'oeuvre est rémunérée 13 euros de l'heure dans notre pays contre 1,60 euro en Pologne et un euro en Roumanie, se pose un problème de fond depuis que ces pays ont intégré l'Union européenne. Si l'on veut éviter un désastre économique, il faut donc supprimer les cotisations sociales sur le travail agricole. Nous devons rapidement engager ce débat au sein du Parlement.

Contrairement aux Allemands, qui ont amélioré leur compétitivité, nous n'avons pas su procéder à la restructuration de nos exploitations d'élevage, qui restent trop petites. Je regrette que nous ayons fait le choix de les multiplier.

J'indique à M. Giacobbi qu'une étude économique de 2009 suggère que l'État providence serait plus développé aux États-Unis qu'en Europe en moyenne, pour des raisons qui tiennent à la fois au traitement des benefits, au rôle des fondations, au montant des dons par habitant – de l'ordre de 700 dollars par an –et au niveau des taxes sur la consommation, dont les taux sont moins élevés que ceux de notre TVA. Ces éléments conjugués font que l'État providence serait plus développé aux États-Unis qu'en Europe. C'est une thèse étonnante, mais qui a sa part de réalité.
Ce que M. Giacobbi a appelé les avantages conventionnels constitue une forme de protection sociale qui revêt parfois un caractère d'obligation aussi fort que notre protection sociale obligatoire. Elle est particulièrement développée aux Pays-Bas, mais aussi dans des pays qualifiés de libéraux, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Sa prise en compte est un élément important dans les débats sur la protection vieillesse que nous avons à l'échelle communautaire. Dans les grandes entreprises britanniques, cette part d'accords conventionnels assure en effet des couvertures sociales dont les caractéristiques sont peu éloignées de celles de notre protection sociale obligatoire. Nous devons parvenir à une vision aussi objective que possible à la fois de la protection assurée aux individus au titre des divers risques sociaux et des charges qui pèsent sur les ménages et les entreprises.
La séance est levée à dix-sept heures quarante.