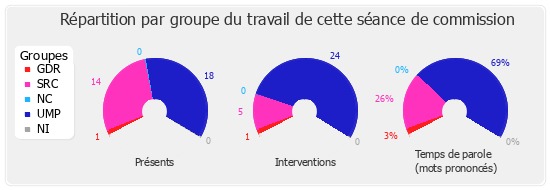Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Séance du 12 janvier 2011 à 14h30
La séance
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi Bioéthique
Mercredi 12 janvier 2011
La séance est ouverte à quatorze heures quarante.
(Présidence de M. Alain Claeys, président)
La Commission spéciale se réunit en vue de procéder à l'audition de M. Jacques Testart, biologiste, directeur de recherches honoraire à l'INSERM.

Nous sommes heureux d'accueillir M. Jacques Testart, docteur ès sciences, directeur de recherche honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).
Disposant d'une formation d'agronome et de biologiste, vous vous êtes consacré tout au long de votre carrière aux problèmes de procréation naturelle et artificielle chez l'animal et chez l'homme, en tant que chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) de 1964 à 1977 – où vous avez notamment travaillé sur la question des « mères porteuses » chez les bovins – puis à l'INSERM, de 1978 à 2007.
Considéré comme le père scientifique des premières fécondations in vitro (FIV), vous avez activement contribué au développement de l'assistance médicale à la procréation (AMP) en France. Vous avez également été l'un des pionniers de la conservation des embryons par congélation et de la fécondation in vitro avec injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde, l'ICSI – sujet dont je souligne au passage que le législateur n'a jamais débattu, la technique étant déjà expérimentée au moment où s'écrivaient les lois de bioéthique.
Dès 1986, dans L'oeuf transparent, vous avez alerté l'opinion publique sur les risques de dérives liées à « la rencontre de la médecine prédictive avec la médecine procréative », quelques années avant que ne soit autorisé en France le diagnostic pré-implantatoire (DPI). Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur les questions de procréation assistée et de bioéthique, en particulier De l'éprouvette au bébé spectacle, paru en 1984, Le désir du gène en 1992, Pour une éthique planétaire en 1997, Des hommes probables – de la procréation aléatoire à la reproduction normative en 1999, Procréation et manipulations du vivant en 2000, Au bazar du vivant en 2001 et Le vivant manipulé en 2003.
La mission d'information sur la révision des lois de bioéthique vous avait entendu en mars 2009. Cette commission spéciale vous entend aujourd'hui alors que l'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de révision qui devrait être examiné en séance publique en février.
Notre commission a décidé de centrer ses travaux sur trois thèmes : la recherche sur l'embryon, pour laquelle le projet de loi pérennise le régime actuel d'interdiction assorti de dérogations ; la gestation pour autrui, qui n'est pas traitée dans le texte mais fait débat dans notre société ; enfin, l'anonymat du don de gamètes, qui fait l'objet d'un titre du projet de loi autorisant l'accès à des données non identifiantes sur le donneur et, si celui-ci en est d'accord, à son identité.
Nous souhaitons donc que vous vous exprimiez sur ces sujets, notamment sur le régime de la recherche sur l'embryon, thème que vous aviez largement abordé lors votre audition par la mission d'information. Les dispositions du projet de loi vous paraissent-elles satisfaisantes ?
Je vous remercie de votre invitation. Je vous redirai à peu près ce que je vous ai dit lors de mes auditions précédentes, mais n'est-ce pas le cas de tous ceux que vous avez auditionnés à plusieurs reprises ?
Je vous donnerai surtout mon point de vue sur ce qu'on appelle la recherche sur l'embryon. Si le législateur prend au sérieux la dignité de l'embryon humain, partout réaffirmée, la loi devrait exiger que des expérimentations préalables sur l'embryon animal aient conduit à des avancées indiscutables, avant de passer à des expérimentations sur l'embryon humain. Sinon je comprends mal ce qu'on entend par dignité.
La loi devrait aussi privilégier des voies de recherche présentant moins d'implications éthiques que les cellules souches embryonnaires, comme c'est le cas des recherches sur les cellules adultes reprogrammées, les iPS (induced pluripotent stem cells), qui constituent bien une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques. Rien n'ayant démontré que les recherches directement conduites sur des cellules embryonnaires humaines seraient plus efficaces que sur les iPS ou les cellules embryonnaires animales, ce prérequis me paraît indispensable.
Pour plus des trois quarts, la recherche sur l'embryon ne consiste pas en des recherches sur des embryons, mais sur des cellules issues d'embryons. Aucune application thérapeutique des cellules embryonnaires n'a encore été trouvée chez l'animal. On a pourtant souvent invoqué, devant vous et dans le débat public, l'urgence qu'il y aurait à autoriser la recherche sur les cellules embryonnaires humaines. L'Agence de la biomédecine invoque des arguments thérapeutiques. Les chercheurs font, eux, plutôt valoir que cette autorisation serait nécessaire pour que les industriels réalisent en France les gros investissements qu'implique le criblage (screening) moléculaire et ne soient pas tentés de délocaliser leurs activités. À ce sujet, soit il y a un partage des tâches, soit l'Agence chargée d'expertiser les protocoles de recherche ne poursuit pas le même but que les chercheurs. Certains, évoquant les perspectives thérapeutiques, dramatisent car je ne vois pas en quoi l'apport de quelques chercheurs français dans la recherche mondiale serait si urgent et si indispensable pour la santé de l'humanité.
Il faut ici rappeler que l'équipe du professeur Yamanaka au Japon, qui a découvert les cellules iPS, reprogrammées à partir de banales cellules somatiques adultes pour retrouver la multipotence des cellules embryonnaires, a d'abord travaillé sur l'embryon de souris, et a fabriqué des iPS de souris avant de fabriquer des iPS humaines – ce qui est la démarche habituelle. Et ces iPS permettent d'obtenir un bien plus grand nombre de lignées beaucoup plus diverses que les cellules embryonnaires, ce qui devrait permettre de répondre aux enjeux économiques des tests de toxicité des molécules pharmacologiques.
Parmi les quarante-neuf protocoles de recherche autorisés par l'Agence de la biomédecine, sept portent réellement sur l'embryon. Ces recherches visent soit à faire progresser les connaissances, soit à améliorer les résultats de l'AMP. Pour ce qui est de la connaissance, qu'il me soit permis de dire que la qualité scientifique d'une recherche menée avec quelques embryons humains disparates est bien moindre que celle qu'on peut obtenir avec des embryons d'animal, matériel biologique standardisé, aux conditions d'obtention optimale, pouvant faire l'objet d'essais répétables à volonté.
Un mot de la pertinence scientifique de ces projets. Sur ces sept protocoles, qu'il est d'ailleurs difficile d'analyser car on n'en connaît que l'intitulé et non le contenu, trois au moins me paraissent douteux. L'un d'entre eux porte sur l'inactivation du chromosome X. L'inactivation de l'un des deux chromosomes X existe chez toutes les femelles de mammifères. En quoi une recherche sur l'embryon humain permettrait-elle d'en mieux comprendre les mécanismes alors qu'il est possible de mener le même travail sur l'embryon de souris, de lapine ou de vache ? Un autre vise à étudier la différenciation des cellules germinales – ovules ou spermatozoïdes selon le sexe. Or, cette différenciation se produit bien après l'implantation de l'embryon. Cette recherche est vraisemblablement menée sur des avortons issus d'IVG, et c'est un abus que de la classer comme concernant l'AMP. Un troisième évoque la création de chimères homme-souris. Les chercheurs britanniques, qui se sont livrés à de telles expériences il y a quelques années, ont abandonné cette voie de recherche, en l'absence de projet crédible.
Pour ce qui est d'améliorer les résultats de l'AMP, il faut rappeler que les chercheurs britanniques – qui sont depuis longtemps leaders mondiaux en médecine de la reproduction et nous ont tout appris en ce domaine –, n'ont effectué aucune nouvelle découverte majeure, théorique ou pratique, depuis vingt ans, et ce bien qu'il soit possible dans leur pays de créer spécifiquement des embryons à des fins de recherche.
Il a été dit ici ou là que les résultats de l'AMP stagneraient en France parce que la recherche sur l'embryon y est interdite. C'est absurde. Il n'y a aucun secret entre praticiens dans l'AMP et rien n'est caché. De nombreux congrès internationaux se tiennent chaque année, d'innombrables articles sont publiés : s'il y avait vraiment du nouveau, cela se saurait ! Dans les laboratoires d'AMP, ont lieu quotidiennement des « études » – que la loi de bioéthique distingue des « recherches » – consistant à modifier les conditions de fécondation, à faire varier le pH du milieu de culture ou la durée de culture, ou encore à agir sur l'utérus récepteur et à en observer les conséquences. Comme ces « études » ne portent pas atteinte à l'embryon, aucune autorisation de l'Agence de la biomédecine n'est requise. Cela n'en permet pas moins des progrès dans les pratiques.
Il n'existe en revanche aucun moyen « d'améliorer » un embryon qu'on jugerait déficient. Pour améliorer les résultats de l'AMP en agissant sur l'embryon, il faudrait tout d'abord produire de meilleurs embryons. En premier lieu, en procédant à des études sur la gamétogenèse, en particulier la maturation des ovules, encore mal connue, de même que sur les incidences des stimulations ovariennes, l'induction simultanée de nombreux ovules étant réputée aboutir à des ovules de moindre qualité. Il n'est pas nécessaire de travailler sur l'embryon pour créer de meilleurs embryons.
Pour faire progresser les résultats de l'AMP, on peut aussi sélectionner parmi tous les embryons créés simultanément, ceux jugés « bons ». Et se profile là l'extension du DPI à des critères non plus seulement génétiques, mais métaboliques. Des travaux ont en effet montré qu'en étudiant certains métabolites embryonnaires, on pouvait attribuer à chaque embryon un score de chance de survie, sans rapport avec ses caractéristiques génétiques. Cela mènerait à un DPI systématique : tous les embryons mériteraient de faire l'objet d'un tel diagnostic, au nom même de la performance de l'AMP.
Les véritables problèmes éthiques posés par la recherche sur l'embryon sont liés à ce qu'on entend véritablement par « respect de l'embryon ». Pourrait-on accepter de sacrifier des embryons pour améliorer la santé humaine ? Ce serait, selon moi, un moindre mal, ou bien s'agit-il de participer à la compétition économique, avec dépôt de brevets et enjeux de propriété intellectuelle à la clé ?
La priorité doit être, selon moi, de conduire les recherches avec les cellules iPS humaines et avec les cellules embryonnaires animales, en continuant bien entendu de mener des recherches fondamentales sur l'embryon animal. On a déjà obtenu à partir de cellules embryonnaires de souris au moins soixante lignées de phénotype différent, ce qui permet de très nombreuses recherches. On disposerait par ailleurs déjà en France de plusieurs dizaines de lignées de cellules embryonnaires humaines. Je ne vois pas l'intérêt d'en créer davantage s'il s'agit réellement de recherche fondamentale.
Le prérequis de l'expérimentation animale me paraît relever à la fois d'un principe scientifique et éthique. Je ne vois pas en quoi son respect pourrait être apprécié par une agence technique.
Il faut, me semble-t-il, anticiper les problèmes éthiques que peuvent soulever les nouvelles techniques et s'interroger, à chaque feu vert donné sur le plan législatif ou réglementaire, sur ce à quoi il peut conduire. Prenons l'exemple de la congélation des ovocytes. Cette technique n'a aucune chance d'améliorer le taux de réussite de l'AMP – bien au contraire –, par rapport à la congélation des embryons. Elle permettra en revanche la multiplication des dons d'ovocytes, plus ou moins contrôlés, le développement de grossesses chez des femmes ménopausées et, plus grave, rendra possible la création d'embryons « clandestins » échappant à tout contrôle. En effet, les gamètes ne sont pas individuellement répertoriés et ne font pas l'objet de la même traçabilité rigoureuse que les embryons. Il existe des parades, me rétorquera-t-on. Sans doute, mais il conviendrait d'y réfléchir avant d'autoriser la technique.
L'important – je ne suis certes pas juriste – ne me paraît pas de trancher entre interdiction des recherches sur l'embryon assortie de dérogations ou autorisation de ces recherches sous conditions puisque, de toute façon, les recherches seront possibles dans les deux cas. Ce débat me paraît donc assez vain. L'important me paraît plutôt d'évaluer les promesses des scientifiques : souvenons-nous du « flop » du clonage thérapeutique et de celui du « bébé-médicament », ainsi que des désillusions provoquées par la thérapie génique dont on assurait qu'elle allait révolutionner la médecine. Tout cela devrait nous amener à défendre l'idée d'une expertise indépendante des promesses médicales et des conflits d'intérêts qui y sont assortis. Il peut en effet y avoir confusion entre des intérêts médico-scientifiques et des intérêts commerciaux ou promotionnels.
Les recherches sur les cellules iPS et sur les cellules embryonnaires animales constituent une alternative aux recherches sur l'embryon humain. La loi doit en tenir compte.
Enfin, des limites seront toujours nécessaires. S'il n'y en avait pas, dans un souci à la fois sanitaire et d'efficacité médicale maximale, tous les embryons devraient faire l'objet d'un DPI génétique et métabolique. La FIV pourrait ainsi être généralisée dès que ses servitudes seront allégées, c'est-à-dire dès que l'on pourra obtenir des embryons nombreux par une production abondante d'ovules ex vivo.
Pourquoi, alors que ce sont là des conclusions d'évidence, la réflexion éthique avance-t-elle beaucoup moins vite que la science ? Lors des États généraux de la bioéthique, le panel citoyen de Marseille avait proposé que lors d'un DPI ne puisse être recherchée qu'une seule maladie, afin d'éviter un screening inconsidéré des embryons. Il est significatif que dans le rapport de ces États généraux, il soit seulement indiqué que les citoyens se sont inquiétés des risques de dérives eugéniques, sans qu'on en tire aucune conséquence. Notre code civil interdit toute pratique eugénique organisant une sélection des personnes : peut-on dès lors tolérer une sélection des personnes potentielles que constituent les embryons ? Je me demande bien pourquoi cet avis citoyen a été écarté et qui cela gênait qu'on prévoie dans la loi qu'un seul variant génétique pourrait être recherché lors d'un DPI… Certains projets seraient-ils tus ?
En matière de bioéthique, l'évolution va toujours dans le sens d'une plus grande permissivité. Le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a ainsi proposé qu'on détecte la trisomie 21 lors de tous les DPI. C'est parfaitement logique mais où s'arrêter dans cette logique ? De même, certains des scientifiques que vous avez auditionnés, venus exiger que les recherches sur l'embryon soient autorisées, sans d'ailleurs définir précisément ce qu'ils chercheraient, parlent déjà de créer des embryons pour la recherche. Il n'y a qu'un pas de la recherche sur des embryons surnuméraires à la recherche sur des embryons spécifiquement créés à cette fin.
Résister à cette instrumentalisation de l'humain n'est pas l'apanage des catholiques, ni, d'une manière plus générale, des croyants. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis simplement tenant d'un humanisme laïc. Je n'ai aucune opposition de principe à la recherche sur l'embryon humain mais je souhaiterais que l'on y procède seulement après avoir apporté la preuve de son absolue nécessité. Sinon la dignité de l'embryon n'a pas de sens. De même, ce n'est pas pour empêcher que les embryons soient éliminés au travers du DPI que je me méfie des perspectives ouvertes par cette technique, mais bien pour protéger les survivants de ce tamis génétique qui aboutira à une société de plus en plus eugénique.
Humaniste laïc, je milite pour une science de qualité, demeurant à l'écart des pressions commerciales et déjouant les mystifications. Je rappellerai seulement en conclusion que le professeur Philippe Menasché, qui réclame que soient autorisées les recherches sur l'embryon, a déclaré ici même que la loi actuelle n'empêchait pas ces recherches mais qu'elle freinait les investissements industriels. Le professeur Axel Kahn, pour sa part, vous a expliqué que les cellules embryonnaires humaines ne sont pas nécessaires à la médecine régénérative et que les cellules iPS sont plus prometteuses.
C'est la seule technique d'AMP qui n'a pas été préalablement expérimentée sur l'animal. Des équipes belges l'ont pratiquée d'emblée chez l'homme.

L'utilisation des cellules iPS poserait, selon vous, moins de problèmes éthiques que celle des cellules embryonnaires. Êtes-vous sûr qu'elle n'en soulèvera pas demain ?
Enfin, ne pensez-vous pas que la recherche sur les cellules souches embryonnaires a été utile pour mettre au point les cellules iPS ?
Je ne le crois pas. Le professeur Yamanaka travaillait sur la souris. Il a d'abord créé des cellules iPS chez cet animal, puis a utilisé la même méthode chez l'homme, suivant le cheminement classique de l'expérimentation animale puis humaine.

N'y aurait-il pas des problèmes éthiques si demain ces cellules reprogrammées pouvaient être différenciées en gamètes ?
Si, bien sûr. Je dis simplement que les recherches sur ces cellules évitent de détruire des embryons, ce qui constitue pour beaucoup un problème éthique.

Faut-il procéder à des expérimentations animales avant des expérimentations humaines ? La réponse va de soi – même s'il a pu y avoir quelques exceptions. Pour autant, les deux sont-elles strictement équivalentes ? Pas exactement. Beaucoup de produits ont été testés chez l'animal qui ne s'y sont pas révélés dangereux alors qu'utilisés chez l'homme, ils ont conduit à de très graves malformations – je pense à la thalidomide. Qu'il faille de préférence expérimenter d'abord chez l'animal, c'est évident. Cela ne donne pas pour autant une garantie absolue.
Il existe plusieurs modèles animaux. Si on les utilise successivement et que la réponse est dans tous les cas identique, on est à peu près sûr qu'elle sera la même dans l'espèce humaine. La thalidomide, dont on cite toujours l'exemple, avait été testée chez le lapin. Si elle l'avait été chez la souris, on se serait aperçu des risques qu'elle présentait. Si on ne relève aucun problème à la fois chez le rat, le lapin et la souris, on minimise le risque autant qu'il est possible.
La recherche sur l'humain permet plus facilement qu'une recherche sur l'animal de publier, même un mauvais article, dans des revues de meilleure réputation et d'être invité à des colloques prestigieux à l'autre bout du monde. Elle ne permet pas de faire de la science. Si on veut véritablement approfondir la connaissance en embryologie, il faut travailler sur l'animal. Le développement de l'embryon suit les mêmes étapes chez tous les mammifères, qu'il s'agisse de la souris, du lapin, de la vache ou de l'homme, avec seulement un timing légèrement différent.

La loi doit-elle disposer que la recherche sur l'embryon humain n'est autorisée qu'après que la preuve a été apportée qu'il n'est pas possible de faire une expérimentation identique équivalente chez l'animal ? Pourquoi pas ? Ma réticence vient du fait qu'il n'existe pas de stricte équivalence entre expérimentation chez l'animal et chez l'homme. Il y a toujours un fossé, aussi minime soit-il.
Mais il n'existe jamais non plus de parfaite équivalence entre deux embryons animaux, non plus qu'entre deux embryons humains. Les résultats d'une expérimentation sur certains embryons humains ne vaudront pas pour d'autres.

Faut-il rétablir la condition relative à l'impossibilité de faire des expérimentations sur les cellules embryonnaires si une expérimentation animale équivalente est possible ?
Dans la loi de 2004, l'animal n'était pas cité.

La loi actuelle dispose que « les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles d'apporter des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. » Ne convient-il pas de remplacer « progrès thérapeutique » par « progrès médical » ? Par ailleurs, est-il opportun de garder la référence à une méthode « d'efficacité comparable » ? Personnellement, je n'y suis pas favorable car cela sous-entend qu'il est possible de faire autrement de manière équivalente, ce qui n'est pas vrai.

Mieux vaudrait alors dire préalablement qu'autrement.
Ma deuxième question porte sur les iPS. Les iPS vont-elles permettre de se passer des cellules embryonnaires humaines ? Par principe, je trouve toujours gênant de fermer une voie de recherche. Il pourrait s'avérer un jour que les recherches sur les iPS ne donnent pas les résultats escomptés. Il faudrait alors rouvrir la voie antérieure des cellules embryonnaires. Qu'en pensez-vous ?
Axel Kahn souligne, et je partage son avis, qu'il existe une différence de nature entre un embryon, potentialité de personne humaine, et une cellule issue de cet embryon. Se gardant de confondre le tout et la partie, ne pourrait-on pas prévoir une protection contre les dérives évoquées, différente pour l'embryon et pour les cellules embryonnaires ?
Le débat entre interdiction avec dérogations et autorisation avec encadrement ne vous paraît pas avoir grand sens. Je l'ai longtemps pensé aussi. Je ne suis plus si sûr qu'en pratique cela revienne au même. Pas un seul des chercheurs que nous avons auditionnés n'a dit que la France avait pris du retard en raison du régime d'interdiction avec dérogations qui prévaut dans notre pays. Pour réclamer la libéralisation des recherches sur l'embryon, certains ont avancé des arguments ayant trait davantage aux investissements industriels qu'à la recherche scientifique. Faut-il conserver l'actuel régime d'interdiction assortie de dérogations, tout en levant l'hypothèque que faisait peser le moratoire de cinq ans, comme nous le proposons avec un régime dérogatoire pérenne, ou mettre au point un dispositif ad hoc d'autorisation, non pour faire progresser plus vite la connaissance scientifique mais pour permettre une industrialisation des procédés ?
Enfin, un mot du dépistage de la trisomie 21 lors de tout DPI, préconisé par le CCNE – je ne suis pas totalement étranger à cette proposition et je m'en suis expliqué avec les familles. Je m'interroge de manière apaisée sur le sujet, sans en faire un combat idéologique. Lors d'un DPI, autorisé, je le rappelle, seulement dans le cas d'une maladie génétiquement transmissible « d'une exceptionnelle gravité », doit-on proposer à la mère que soit réalisé, si elle le souhaite, en même temps un dépistage de la trisomie 21 ? Il me paraît logique de lui poser la question, tout en la laissant libre de son choix et en lui permettant de choisir de faire ce dépistage avant ou après l'implantation de l'embryon. Il me semble qu'une femme chez qui aurait été implanté un embryon ayant fait l'objet d'un DPI et qui découvrirait, lors du dépistage systématiquement proposé en cours de grossesse, que son foetus est trisomique, serait en droit de dire qu'elle aurait aimé qu'on lui proposât ce dépistage préalablement et non pas seulement a posteriori.
Si, comme cela semble être le cas, la trisomie 21 n'est pas plus fréquente chez les personnes ayant un risque élevé de présenter une anomalie génétique d'une exceptionnelle gravité, cela créerait une inégalité entre les futures mères recourant à une FIV. Celles qui n'ont pas d'anomalie génétique aimeraient, elles aussi, pouvoir détecter la trisomie 21 in vitro. Ce serait de fait inciter à un DPI généralisé, pour tous ceux qui le souhaiteraient. Par ailleurs, pourquoi se limiter à la trisomie 21 ? Si on cherche seulement aujourd'hui à éviter le pire, n'en viendra-t-on pas à rechercher le meilleur, le bébé parfait ? Lorsqu'il a fait cette proposition, le CCNE n'a fixé aucune limite.
S'agissant des autres questions posées, il est possible qu'on s'aperçoive un jour que les cellules iPS posent des problèmes, notamment parce que pour les reprogrammer, il faut y insérer des gènes spécifiques par le biais de rétrovirus. Il faut donc parallèlement continuer de travailler sur les cellules souches embryonnaires, mais, je l'ai dit, sur les cellules embryonnaires animales, en recherchant des applications thérapeutiques d'abord chez l'animal. Il ne faut pas faire de recherche sur les cellules embryonnaires humaines mais sur les cellules embryonnaires animales et sur les iPS.

Quel argument non religieux, fondé seulement sur la raison, opposer pour interdire les recherches sur les cellules embryonnaires humaines – après avoir travaillé sur les cellules embryonnaires animales ?
Si des recherches sur les cellules embryonnaires animales apportent la preuve qu'elles permettent des progrès thérapeutiques, il faudra bien évidemment passer à un protocole chez l'homme. Profondément laïc, je m'efforce néanmoins de respecter toutes les opinions, notamment celles des personnes qui accordent à l'embryon une valeur que personnellement je ne lui accorde pas. Je dis que c'est chercher à « taquiner les catholiques » que de vouloir absolument travailler sur l'embryon humain lorsque ce n'est pas nécessaire.

Je rappelle qu'en France, le principe est l'interdiction de la recherche sur l'embryon, avec possibilité de dérogations, notamment en l'absence de méthode alternative d'une efficacité comparable. Vous paraît-il nécessaire que la loi dispose également « et après recherche préalable sur l'animal » ?
La distinction entre recherches « à visée thérapeutique » ou « à visée médicale » vous paraît-elle importante ? Comment l'appréciez-vous ?
Enfin, que pensez-vous du fait que dorénavant les lois de bioéthique ne seront plus révisées périodiquement ?

Il n'y a pas dans tous les cas d'expérimentations sur l'animal avant expérimentations sur l'homme. Et sur l'homme, il est possible de mener des recherches à tous les stades de la vie. L'expérimentation post mortem a même été autorisée. La seule interdiction concerne les cellules embryonnaires humaines. Il faut bien entendu continuer de travailler sur les cellules embryonnaires animales – ceux qui aujourd'hui prônent le recours aux cellules iPS devraient se souvenir de la brebis Dolly, née d'une cellule reprogrammée. Je considère pour ma part, que cela pose au moins autant de problèmes éthiques que les cellules embryonnaires. En effet, qui peut assurer que la reprogrammation est complète et qu'on fait vraiment repartir l'horloge de zéro ? On ne peut pas, en tout état de cause, le savoir sans comparaison avec les cellules souches embryonnaires.
Je partage totalement l'analyse d'Axel Kahn sur la différence de nature entre un embryon et des cellules embryonnaires. Je vous rejoins en revanche, monsieur Testart, pour ce qui est des applications des recherches, souvent en avance sur les recherches elles-mêmes. C'est sur ce point qu'il faut prévoir dans la loi les garde-fous nécessaires.
Que l'on n'ait pas obtenu de résultats probants depuis vingt ans avec les cellules embryonnaires ne me paraît pas un argument pour stopper les recherches.
S'agissant du DPI, je crois en effet préférable sur le plan éthique de se limiter à la recherche d'un seul variant génétique. Je comprends que certains puissent vouloir qu'on dépiste aussi la trisomie 21 mais dès lors qu'on autoriserait un dépistage supplémentaire, pourquoi se limiterait-on à celui-là ? Quantité d'autres maladies graves pourraient être dépistées. Mieux vaut, je pense, ne pas mettre le doigt dans l'engrenage.

Il est proposé dans le projet de loi de substituer progrès « médical » à progrès « thérapeutique ». Voyez-vous des risques à cette évolution sémantique ?
En matière d'AMP, faudrait-il, comme cela se fait en Allemagne et en Italie, limiter le nombre d'ovocytes fécondés au nombre exact d'embryons nécessaires à l'implantation ?
Que pensez-vous de la gouvernance actuelle en matière de bioéthique, notamment des rôles respectifs du Comité consultatif national d'éthique et de l'Agence de la biomédecine ? Faut-il renforcer les pouvoirs de ces instances ou, au contraire, mieux les contrôler ?

Des évaluations ont-elles été réalisées sur les jeunes hommes aujourd'hui adultes nés après ICSI ? Leurs spermatozoïdes sont-ils normaux ou présentent-ils les mêmes anomalies que ceux de leurs pères ?
La congélation des ovocytes vous paraît-elle une technique d'avenir, qui permettrait de limiter le nombre d'embryons surnuméraires ? Étant entendu que les ovocytes devraient être répertoriés et faire l'objet d'un suivi aussi rigoureux que les embryons congelés aujourd'hui, afin de ne pouvoir donner lieu en effet à la conception d'embryons « clandestins ».
On dispose aujourd'hui de très nombreuses lignées de cellules souches embryonnaires humaines. Distinguez-vous entre les recherches sur des lignées déjà existantes et celles qui, pour extraire de nouvelles lignées, amèneraient à détruire de nouveaux embryons ?
Un dernier mot à l'intention du rapporteur. La différence entre un régime d'interdiction avec dérogations et un régime d'autorisation sous conditions n'est pas seulement économique mais juridique, comme l'a souligné le Conseil d'État.

Tout à fait. J'ai seulement dit qu'on avait surtout entendu des arguments économiques pour demander le passage à un régime d'autorisation.

Vous avez évoqué, monsieur Testart, de possibles conflits d'intérêts industriels, commerciaux et financiers. À quoi pensez-vous plus précisément ? Que faudrait-il faire pour prévenir tout conflit de ce type ?

Comme Jean-Sébastien Vialatte, je pense que la différence entre un régime d'interdiction avec dérogations et un régime d'autorisation sous conditions est d'abord juridique. J'ajoute que la protection de l'embryon renvoie à l'article 16 de notre code civil qui dispose que la loi « garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. » Il est heureux que notre loi protège ainsi l'embryon – sans toutefois en donner de définition précise, ce qui pourrait soulever d'autres problèmes.

Dans un monde théorique idéal, on pourrait imaginer que tout soit toujours préalablement testé chez l'animal – encore qu'il faudrait pour ce faire amadouer certaines associations ! Mais de fait, dans la réalité, tout ne peut être testé chez l'animal. Lorsqu'il y a trente ans, nous avons pratiqué chez des malades souffrant de déficit immunitaire les premières greffes de cellules souches prélevées sur des foetus humains âgés de huit-neuf semaines, il n'existait pas de modèle animal sur lequel le procédé aurait pu être préalablement validé. Les cas ne sont pas rares où le premier pas ne peut être fait que chez l'homme. Il faut simplement prévoir alors l'encadrement nécessaire.
Comme le rapporteur, je trouverais choquant qu'on ferme la voie de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines sans argument éthique majeur, au seul motif qu'il existe désormais les iPS. Aucune solution ne s'impose d'évidence. Nous sommes abusés par le fait qu'on désigne sous le terme générique de cellule souche des cellules aussi différentes que les cellules souches embryonnaires, les cellules souches adultes et les cellules reprogrammées iPS. Parmi toutes celles-là, en tout cas aujourd'hui, seules les cellules souches embryonnaires sont totalement neuves, peuvent se répliquer à l'infini et se différencier en tous les types cellulaires. Se priver de ces propriétés irremplaçables au motif qu'il existerait des cellules vaguement équivalentes serait se priver de la possibilité d'applications majeures. Celles-ci ne sont certes pas encore légion en thérapeutique humaine, encore que les cellules souches hématopoïétiques soient très couramment utilisées pour guérir des milliers de malades. Mais la frontière entre recherche et développement est assez floue. Or, les laboratoires industriels ne se lanceront pas si cette recherche n'est pas expressément autorisée. Il y a de ce point de vue une grosse différence entre interdiction avec dérogations, régime qui limite nécessairement l'engagement industriel des laboratoires publics et privés, et autorisation sous conditions.
Je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses à toutes les questions qui m'ont été posées. Je ne répondrai donc qu'à quelques-unes d'entre elles.
Monsieur Mariton, vous distinguez entre alternative et préalable. C'est à la recherche sur les cellules embryonnaires humaines qu'il faut trouver une solution alternative. C'est lorsqu'on passe à l'application thérapeutique qu'il faut avoir mené des expérimentations préalables sur l'homme.
Monsieur Le Déaut, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de recherches conduites sur l'homme sans recherches préalables sur l'animal. En tout cas, il ne devrait plus y en avoir, depuis que l'on sait créer à volonté des souris ou autres animaux transgéniques présentant telle ou telle pathologie. Dès lors qu'on maîtrise la technique, pourquoi s'en priver ?
Je ne nie pas que les cellules iPS pourraient, à terme, poser plus de problèmes que les cellules embryonnaires humaines, du fait notamment de leur reprogrammation. Ce n'est pas moi, qui ne suis pas favorable aux OGM, qui prétendrait qu'on est à l'abri de toute mauvaise surprise. Mais il s'agirait de problèmes techniques, qui devraient être expertisés et traités par les chercheurs dans le cadre des recherches, alors qu'il est ici question d'éthique et de dignité de l'embryon, ce qui n'est pas du même ordre.
Que depuis vingt ans, aucun résultat n'ait été obtenu avec les cellules embryonnaires en Grande-Bretagne, non plus d'ailleurs que dans aucun autre pays, ne justifie pas qu'on s'abstienne de nouvelles recherches, dites-vous. Il est tout de même significatif que les Britanniques, leaders mondiaux en médecine de la reproduction depuis des siècles, qui ont inventé la FIV et le DPI, pratiqué, les premiers, le transfert nucléaire et le clonage chez l'animal, n'aient fait aucune découverte probante. En outre, je le redis, je ne comprends pas que l'on ne mène pas les recherches nécessaires à la connaissance fondamentale comme à la thérapeutique, sur l'embryon de mammifère animal, qui présente les mêmes caractéristiques que l'embryon humain.
Monsieur Breton, la limitation du nombre d'embryons créés lors de chaque FIV est une question ancienne et grave. Limiter le nombre d'ovocytes fécondés, c'est aussi, hélas, limiter les chances de grossesse. On me rétorquera qu'avec la congélation des ovocytes, on pourrait ne féconder qu'un seul ovule à chaque fois. Mais il faut compter d'une part avec le fait que la technique ne marche pas toujours, d'autre part avec le coût que cela représenterait pour la Sécurité sociale, à laquelle l'AMP coûte déjà très cher…
Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas accepter les arguments économiques quand ils sont avancés par les industriels pour développer le criblage moléculaire et les refuser lorsqu'il s'agit de l'équilibre de la Sécurité sociale !

Nous sommes cohérents. Nous cherchons toujours à faire prévaloir l'éthique sur l'économique.
Monsieur Vialatte, je l'ai dit, l'ICSI est la seule technique d'AMP qui ait été pratiquée d'emblée chez l'homme, sans avoir été expérimentée préalablement. Je l'ai pratiquée en France un an après les équipes belges. Axel Kahn m'a alors reproché « d'expérimenter sur l'homme ». Mais des centaines d'enfants étaient déjà nés en Belgique de cette technique. Même si nos collègues belges avaient fait une faute éthique, ce que je ne me suis pas privé de leur dire, les résultats étaient là !
Il y a en effet eu des transmissions d'anomalies. C'est indirectement l'ICSI qui a permis de s'apercevoir que les hétérozygotes porteurs sains du gène de la mucoviscidose présentaient des anomalies de la sécrétion de mucus dans les canaux déférents, entravant l'expulsion des spermatozoïdes par ailleurs normalement produits. Nous nous sommes en effet aperçus qu'il y avait davantage de bébés atteints de mucoviscidose parmi les bébés conçus par FIV que dans la population générale : cela tenait au fait que les hommes pour lesquels il fallait recourir à l'ICSI en raison de leur stérilité ou de leur hypofertilité étaient porteurs sains du gène de la maladie. De nombreux rapports montrent que, d'une manière générale, certaines caractéristiques sont sur-représentées ou sous-représentées chez les enfants conçus par FIV. On l'a mis en évidence pour la mucoviscidose, mais il y a sans doute d'autres pathologies n'ayant apparemment rien à voir avec la procréation, qui interviennent.
Pour le reste, je pense que les lignées de cellules souches embryonnaires existantes sont déjà bien assez nombreuses pour permettre de faire de la recherche. Il n'est pas besoin d'en créer d'autres… à moins que l'on ne veuille faire autre chose que de la science.
Pour ce qui est des conflits d'intérêts, monsieur Nesme, il est évident que lorsque des personnes ont monté des start-up, passé des contrats notamment avec des firmes, américaines en particulier, dans le but d'obtenir des brevets, elles ont un conflit d'intérêts lorsqu'elles viennent vous demander de développer ces technologies à échelle industrielle. Il faudrait expertiser ces conflits d'intérêts. À ma connaissance, ils ne l'ont pas été jusqu'à présent.
Monsieur Touraine, il existe aujourd'hui des modèles animaux pour toutes les maladies, génétiques en particulier. Si la loi disait qu'il faut préalablement mener des recherches sur l'embryon animal, l'Agence de la biomédecine pourrait vérifier qu'il en a bien été ainsi et ne délivrer d'autorisation pour un passage à l'humain qu'après qu'aurait été démontré quelque chose sur l'animal avant. Elle serait là pleinement dans son rôle quand elle ne l'est pas tout à fait lorsqu'elle « oriente » la loi.
Il ne faut pas se priver des propriétés uniques des cellules souches embryonnaires. Certes, mais ce n'est pas une raison pour mener aujourd'hui des recherches sur ces cellules. Commençons par faire des recherches sur les cellules embryonnaires animales.

Je souhaiterais faire une mise au point. Les personnes auditionnées qui ont défendu devant nous un régime d'autorisation plutôt qu'un régime dérogatoire n'ont pas avancé seulement des arguments économiques et industriels. Elles ont aussi évoqué le manque de visibilité juridique créé par le moratoire, qui décourage les jeunes chercheurs de s'installer en France, et expliqué que la position de notre pays était difficilement compréhensible à l'étranger.
Monsieur Testart, je vous remercie de votre contribution à nos travaux.
Puis la Commission entend M. Alain Privat, biologiste, professeur en neurobiologie à l'Université de Bilbao.

Monsieur Privat, vous êtes professeur en neurobiologie à l'université de Bilbao, docteur en médecine et biologie humaine, spécialiste des neurosciences. Vous avez orienté vos recherches sur les possibilités offertes par les cellules souches adultes. À ce titre, vous avez été entendu par la mission d'information sur la révision des lois de bioéthique.
Nous sommes à présent chargés d'examiner les dispositions projet de loi relatif à la bioéthique. La Commission spéciale a axé ses travaux sur trois thèmes : le régime de la recherche sur l'embryon, pour laquelle le projet de loi pérennise le régime actuel fondé sur le principe de l'interdiction avec dérogations, la gestation pour autrui, qui n'est pas traitée dans le texte mais fait débat dans notre société, et l'anonymat des dons de gamètes.
Après une présentation de vos travaux, nous souhaiterions que vous nous donniez votre point de vue sur ces sujets et sur la manière dont le projet de loi les traite.
Je vous remercie de m'accueillir et de me donner l'occasion de m'exprimer. Lorsque mes recherches ont débuté, il y a une quarantaine d'années, on ne parlait pas encore de « cellules souches » au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des cellules capables de se multiplier et de se différencier en cellules matures fonctionnelles. Nous savions seulement que, dans le cerveau des rats et des souris adultes, des cellules étaient susceptibles de se multiplier dans des zones particulières, comme la paroi des ventricules latéraux (la zone sous-ventriculaire).
Avec mon maître de l'époque, Charles Leblond, nous sommes parvenus à montrer que les cellules situées dans cette région étaient capables de se multiplier chez l'adulte et de donner naissance à des cellules gliales, les cellules accessoires des neurones. Le chercheur américain Joseph Altman a par la suite démontré que ces cellules pouvaient migrer vers la partie antérieure du cerveau, vers les bulbes olfactifs, et donner naissance à des petits neurones. Plus tard, nous avons découvert que, chez les petits mammifères, une autre région du système nerveux central, l'hippocampe – directement impliquée dans les phénomènes d'apprentissage et de mémorisation – pouvait elle aussi contenir des cellules capables de se multiplier et de se transformer en neurones.
Depuis, notre recherche s'est orientée vers des domaines plus appliqués. L'unité de l'INSERM que j'ai dirigée pendant plus de vingt ans a centré son travail sur une région particulière du système nerveux central, la moelle épinière pour deux raisons. En premier lieu, il s'agissait d'une question de santé publique : les lésions de la moelle épinière, provoquées par les accidents sur la voie publique, touchent un millier de personnes par an, souvent jeunes, et l'on dénombre en France 40 000 paraplégiques et tétraplégiques. La seconde raison est que cette région du système nerveux central était susceptible de constituer un marchepied pour la compréhension de phénomènes plus complexes qui se situent au niveau du cerveau : s'il est difficile d'évaluer les effets chez l'animal d'une lésion cérébrale en termes de déficits fonctionnels, il est relativement aisé de mesurer les conséquences d'une lésion ou d'une section de la moelle épinière sur la motricité ou sur la sensibilité d'un petit mammifère. Nous pouvions ainsi essayer de comprendre la physiopathologie des lésions, et, éventuellement, tenter de modéliser des stratégies thérapeutiques.
Nous avons ainsi pu montrer il y a une vingtaine d'années que la greffe de cellules nerveuses foetales au niveau d'une moelle épinière lésée pouvait permettre de rétablir un certain nombre de fonctions. Cela nous a amenés à remettre en cause le dogme selon lequel le système nerveux central ne pouvait être ni réparé ni régénéré. Nous avions utilisé, pour ce faire, des cellules nerveuses foetales animales, ce qui ne posait pas de problème éthique. Mais nous savions que pour tenter d'appliquer cette recherche à des pathologies humaines, il fallait réfléchir en termes d'outils thérapeutiques, le terme « thérapeutique » ayant ici toute son importance. Il n'était évidemment pas question d'utiliser des cellules embryonnaires humaines, puisqu'il aurait fallu en prélever des millions, voire des dizaines de millions, sur des embryons ou des foetus.
Entre autres alternatives, nous avons réfléchi à la possibilité de stimuler la régénération du système nerveux central, sans apport de cellules nouvelles. Contrairement à ce qui était communément admis depuis les travaux de Santiago Ramón y Cajal, prix Nobel de médecine en 1906, le système nerveux central des mammifères est capable de se régénérer spontanément. Mais les phénomènes cicatriciels qui apparaissent après une lésion et qui permettent dans un premier temps de reconstituer l'homéostasie du tissu nerveux, deviennent ensuite obstructifs et empêchent toute régénération.
Des études menées sur des souris transgéniques nous ont permis de découvrir qu'en inactivant les protéines responsables de la cicatrisation, il était possible d'obtenir une régénération spontanée chez l'animal. Nous réfléchissons aujourd'hui à des thérapies géniques chez l'homme qui permettraient non pas de toucher au génome mais à l'ARN interférent – l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine – pour bloquer la synthèse, de façon ciblée dans le temps et dans l'espace.
Il y a deux ans, nous avons pu mettre en évidence des cellules souches dans la moelle épinière d'humains adultes. Avec l'autorisation de l'agence de la biomédecine (ABM), nous avons réalisé des études anatomiques et des cultures de cellules provenant de moelles épinières prélevées chez des personnes en état de mort cérébrale : nous avons ainsi pu montrer que ces cellules pouvaient se multiplier et se différencier en neurones, en oligodendrocytes (cellules responsables de la formation de la gaine de myéline, autour des axones) et en astrocytes (cellules responsables de l'homéostasie dans le système nerveux central).
Notre objectif, à terme, est de réaliser, avec des outils de thérapie génique, un ciblage de ces cellules intrinsèques pour leur permettre de se différencier dans un type cellulaire bien particulier : un neurone dont le neurotransmetteur sera connu. Ainsi, des cellules souches intrinsèques adultes, issues de la moelle épinière mais aussi d'autres régions du système nerveux central, pourront être utilisées à titre thérapeutique.
Je ne parviens pas à comprendre s'il reconduit le statu quo antérieur sur la recherche.

Le texte pérennise le régime de l'interdiction, assorti de dérogations, tout en supprimant la limite de cinq ans fixée à son application.
Par ailleurs, il prévoit que les recherches sont autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux, et non plus « thérapeutiques », majeurs.
L'expression « progrès médicaux » pose question. Nous savons à quoi peut mener une recherche thérapeutique basée sur les cellules souches humaines embryonnaires : c'est inefficace et dangereux. La société américaine Geron conduit actuellement une étude clinique sur l'utilisation de cellules souches embryonnaires destinées à réparer une lésion du système nerveux central, malgré les forts doutes de la communauté scientifique sur l'efficacité et sur l'innocuité de cette recherche. D'une part, les cellules qui seront greffées sont destinées à se transformer en oligodendrocytes qui permettent de myéliniser les axones, alors que les axones n'existent plus au niveau de la lésion, les patients présentant une section complète de la moelle épinière. D'autre part, il a été démontré que les cellules souches humaines embryonnaires en lignée continue pouvaient induire la formation de tumeurs, raison même pour laquelle cet essai, présenté depuis des années, a toujours été repoussé jusqu'alors. Aucun élément scientifique nouveau ne permet de justifier cette autorisation : les travaux pré-cliniques ont été conduits chez des animaux qui présentaient des lésions incomplètes – contrairement aux patients, qui présentent des sections – et aucune étude chez les gros mammifères ne permet d'avoir un recul suffisant sur la formation de tumeurs. Dans ce domaine, il semble que le principe de précaution devrait s'appliquer.

Vous évoquez les applications thérapeutiques, tant il est vrai qu'hormis deux ou trois cas, il existe peu d'essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires. Vous qui travaillez sur les cellules souches matures, pensez-vous que la recherche fondamentale sur les cellules souches embryonnaires présente un intérêt quelconque ? Que pensez vous des cellules souches pluripotentes induites (iPS) ?
La donne a changé de façon radicale depuis les travaux de Shinya Yamanaka en 2008 et la mise au point de la technologie permettant d'obtenir des iPS. Ces cellules présentent des avantages incontestables : contrairement aux cellules souches embryonnaires, elles ne nécessitent pas l'utilisation et la destruction d'embryons. D'autre part, elles peuvent être obtenues à partir de cellules de patients sur lesquelles seront ensuite testées les molécules thérapeutiques.
En termes de recherche non, pour autant qu'il s'agit de cribler des molécules thérapeutiques. Une équipe de l'université du Connecticut a pu, à partir de cellules prélevées chez des patients atteints du syndrome d'Angelman ou du syndrome de Prader-Willi, obtenir des cellules nerveuses différenciées et commencer à tester des stratégies thérapeutiques sur celles-ci. Les cellules iPS permettent non seulement de modéliser mais d'être directement au contact d'une pathologie.

Le maintien d'un régime d'interdiction assorti de dérogations présente-t-il un handicap pour les recherches futures ?
Je pense que le handicap n'est pas important. La nuance entre progrès thérapeutique et progrès médical n'est pas que sémantique. L'utilisation à visée médicale de cellules souches embryonnaires pourrait conduire à les soumettre à l'action de différentes molécules, à un screening à visée pharmaceutique. Or cela peut être réalisé dans les mêmes conditions avec des cellules iPS.

Si le terme « médical » a été préféré, c'est qu'il correspond davantage à certaines recherches pour lesquelles il s'avère difficile de déterminer précisément un objectif thérapeutique sur une pathologie particulière ; recherches qui, par le passé, n'en ont pas moins été autorisées par l'ABM.
Cependant, la possibilité de disposer de cellules iPS rend caduque la question de l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines.
Tout au moins dans celles que je connais qui concernent le système nerveux central.

La plupart des personnes auditionnées nous ont indiqué qu'il fallait mener de front les recherches sur ces deux types de cellules souches.
Dans la recherche fondamentale sur le système nerveux central, les cellules iPS peuvent suffire. Elles pourraient même être utilisées dans les applications thérapeutiques. Elles sont supérieures aux cellules souches embryonnaires humaines dans la mesure où elles permettent de réaliser des recherches sur des cellules de patients atteints de pathologies spécifiques et de tester directement des molécules thérapeutiques ou des approches moléculaires. Il doit pouvoir en être de même pour beaucoup d'autres organes.

La mission d'information n'avait pas fait apparaître la distinction entre recherche sur l'embryon et recherche sur les cellules souches embryonnaires. Cette distinction, dont nous prenons conscience aujourd'hui, est-elle opérante d'un point de vue scientifique ?
La démarche est la même, que l'on travaille sur les cellules souches embryonnaires ou sur l'embryon : elle en implique la destruction.

Avec l'essai de la société Geron sur les cellules souches embryonnaires, vous avez démontré que l'on pouvait beaucoup s'éloigner de la thérapeutique. Il semblerait que d'autres essais aient lieu, notamment dans le domaine de la dégénérescence maculaire.
Vous dites que les cellules iPS sont moins dangereuses que les cellules souches embryonnaires. Pourtant, elles présentent les mêmes risques de formation tumorale, peut-être même des risques augmentés, du fait qu'elles ont été bricolées, parfois avec un vecteur viral.
Garder le terme « thérapeutique » dans la loi ne reviendrait-il pas à interdire toute recherche sur les cellules souches, dans la mesure où les visées thérapeutiques sont si lointaines qu'aucune équipe de chercheurs ne peut fournir de véritable protocole ?
Nous commençons tout juste à découvrir les cellules iPS et leurs potentialités. Il faut laisser le temps à ces recherches de se développer et prévoir périodiquement une révision de la loi, afin de tenir compte des progrès accomplis ; lorsque la précédente loi a été votée, en 2004, les cellules iPS n'existaient pas !
Nous savons aujourd'hui que nous pourrons maîtriser de façon plus précise les cellules iPS que les cellules souches embryonnaires, dans la mesure où ce sont des cellules dont on aura déjà contrôlé un certain nombre de fonctions, en particulier les fonctions de multiplication par l'introduction de ces fameux gènes de reprogrammation. Sans doute pourrons-nous un jour nous affranchir complètement de l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines.

Il est évident que la différence entre la recherche sur les cellules souches embryonnaires et celle sur l'embryon est majeure. S'il est certain que l'on aboutit dans les deux cas à la destruction de l'embryon, la question est plutôt de savoir si les cellules souches provenant d'embryons qui, de toute façon, sont destinés à être détruits, peuvent être utilisées à des fins de recherche.
Les travaux sur les cellules iPS montrent que l'on ne sait pas jusqu'où va la reprogrammation par les gènes. Dans le cas de Dolly, la reprogrammation a échoué puisque la nouvelle brebis est née vieille ! Des recherches sur le processus de vieillissement des cellules iPS doivent être menées, mais en comparaison avec celui des cellules souches embryonnaires.
Par une sorte de casuistique, d'aucuns en sont venus à affirmer que la possibilité de travailler à partir de cellules iPS rendait inutile toute recherche sur les cellules souches embryonnaires. Comme toujours, l'on imagine que ce qui est nouveau permettra de résoudre l'ensemble des problèmes. Mais certains reviennent aujourd'hui sur cette affirmation, y compris devant notre commission, reconnaissant qu'il est important de travailler de manière comparative sur toutes les cellules souches. Comme pour les nanotechnologies et les biotechnologies, les cas sont très divers. C'est cela même qui rend complexe notre tâche de législateur.
J'entends parfaitement vos objections. Le progrès sur les cellules iPS va entraîner des questionnements. Il pourra alors être utile de lancer, sur des questions précises posées par l'utilisation des iPS, des recherches comparatives et de reprendre, avec les dérogations nécessaires, des études sur les cellules souches embryonnaires dans une optique de comparaison sur des questions spécifiques.
Malheureusement, la France a raté le virage des iPS, que nous connaissons depuis trois ans maintenant. Les instances, en particulier l'Agence nationale de la recherche (ANR), n'ont pas incité les laboratoires à travailler dans ce domaine ; ceux-ci se sont focalisés sur les cellules souches embryonnaires humaines, domaine dans lequel le pays avait fortement investi. Les Britanniques, les Canadiens ou les Américains ne nous ont pas attendus sur ce terrain.

Les iPS ont-ils apporté dans le domaine qui est le vôtre un espoir thérapeutique plus « sécurisé » ? Étant novice sur ces questions, j'aimerais que vous nous disiez simplement pourquoi il n'est plus utile de travailler sur les cellules souches embryonnaires humaines. Est-ce vrai pour tous les domaines de recherche ou seulement pour le vôtre ?

Avec tout le respect que je vous porte, monsieur, je crois déceler dans vos propos un raccourci un peu rapide. Vous nous dites que l'essai Geron provoquera inévitablement des phénomènes tumoraux ; vous affirmez aussi que l'on n'utilise pas assez la technique des cellules iPS. Or l'on sait – et nous n'en sommes, comme vous le dites, qu'au début de nos connaissances dans ce domaine – que celles-ci sont très probablement cancérigènes.
La démarche scientifique n'exige-t-elle pas précisément de laisser du temps aux recherches sur les cellules souches embryonnaires, strictement encadrées, en attendant le jour où leur utilisation sera supplantée par celle des cellules iPS et où les problèmes éthiques seront ainsi résolus ?
Nous disposons aujourd'hui d'un corpus considérable de données sur les cellules souches embryonnaires humaines. Il nous faudrait d'abord acquérir un corpus semblable sur les cellules iPS. Ensuite, et si d'autres questions se posent sur les cellules iPS, nous pourrions éventuellement lancer des études comparatives.
Le grand intérêt de cette nouvelle technique est, contrairement aux cellules souches embryonnaires, de pouvoir tester directement sur des cellules provenant de patients souffrant de pathologies spécifiques des stratégies thérapeutiques, des molécules pharmacologiques. Cela ouvre la voie d'un progrès considérable et l'espoir peut-être de pouvoir suppléer l'utilisation des cellules souches embryonnaires.

La réponse absolue que fournit M. Le Déaut à l'interrogation éthique sur les cellules souches embryonnaires – de toute manière, l'embryon est destiné à mourir dans un certain délai – ne me paraît pas s'accorder aux infinies précautions dont nous usons pour aborder ces sujets.

Il est vrai que le législateur a attaché bien plus d'importance à accepter la recherche à partir de ces embryons. Il a mis plus de temps à l'accepter qu'il n'en a pris pour entériner la destruction des embryons surnuméraires…

Un généticien célèbre n'a-t-il pas dit ici même qu'il préférait un embryon détruit à un embryon destiné à la recherche ?

Paul Jeanneteau rappelle souvent que le corpus du droit français défend et protège l'embryon, dont tout le monde peut s'accorder à dire qu'il représente une potentialité humaine et qu'il inspire le respect, quelles que soient nos croyances.
Mais le droit prévoit deux transgressions à ce principe. D'une part, l'absence de projet parental conduit à la destruction de l'embryon, dans une construction juridique curieuse, qui veut que l'avenir d'un être en devenir, incapable d'exprimer sa volonté, est déterminé par des personnes extérieures. D'autre part, la loi Veil prévoit que la fragilité de la femme, personne humaine avérée, peut être mise en balance avec la fragilité de l'embryon ; l'absence de projet maternel justifie alors l'avortement.
Il paraît donc curieux que le prélèvement de la cellule sur l'embryon destiné à la destruction apparaisse comme une transgression importante, alors que c'est bien la destruction de l'embryon qui constitue la transgression. Toute choses égales par ailleurs, c'est un peu comme si l'on refusait d'effectuer un prélèvement de sang sur un condamné à mort ! C'est l'intentionnalité qui importe dans le droit français : or l'embryon va être détruit. Je continue à être persuadé que l'embryon doit être protégé dans notre droit laïc…

… probablement… mais que la recherche sur la cellule issue d'un embryon destiné à être détruit doit être plus largement autorisée.

Monsieur Privat, vous avez expliqué que, dans les lésions de la moelle épinière, la régénération était bloquée par le tissu cicatriciel. Les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines ne pourraient-elles pas permettre de découvrir les facteurs de multiplication des cellules souches in situ et d'avancer ainsi dans la voie de la stimulation de ces cellules souches ?
Non, la cellule souche adulte, qui se trouve dans la moelle épinière du patient, est confrontée à un environnement obstructif, complètement différent de l'environnement permissif dans lequel se trouve la cellule souche embryonnaire, qui donne lieu à une croissance tous azimuts.
Mais, effectivement, l'un de nos objectifs est d'utiliser les cellules souches locales pour faire en sorte de contrôler le tissu cicatriciel et permettre ainsi la régénération du système nerveux central « par lui-même ». C'est le grand espoir que nous avons, et il pourrait concerner d'autres organes.
Nos recherches sont menées à 99,9 % sur l'animal. Elles devraient nous conduire à proposer des essais cliniques dans les trois ans qui viennent. Notre attitude a toujours été de ne proposer un essai clinique que lorsque nous sommes en mesure de prouver l'efficacité et l'innocuité de notre approche. Nous l'avons fait pour les petits rongeurs ; nous sommes en train de le démontrer chez les gros mammifères.

Monsieur, je vous remercie.
Enfin la Commission spéciale reçoit M. Jean-Paul Moisan, professeur de génétique médicale, président-directeur général de l'Institut génétique Nantes-Atlantique.

Nous recevons à présent M. Jean-Paul Moisan, professeur de médecine et directeur de l'Institut génétique Nantes Atlantique. L'IGNA, créé en 2003 et élargi en 2008, est le premier laboratoire français de génétique humaine, et vous avez souhaité nous faire part de vos préoccupations concernant la réglementation des tests de paternité.
Merci d'avoir accepté de m'entendre. Je suis professeur de génétique médicale et, en tant que tel, très sensible à l'importance des lois de bioéthique, d'autant que notre discipline a été reconnue comme telle par M. Mattei, qui est à l'origine de ces lois. Il s'agit d'une discipline qui a engendré beaucoup de progrès et d'espoirs en médecine, mais aussi suscité beaucoup de questions.
J'ai créé les premières empreintes génétiques de France en 1988, au sein du CHU de Nantes, dont j'étais le chef du service de génétique. En 2003, en accord avec le CHU et l'université de Nantes, j'ai créé une société spin off du CHU, l'Institut génétique Nantes-Atlantique (IGNA), qui est devenue le leader en France en matière d'empreintes génétiques demandées par la justice – elle est également devenue le leader en Europe en 2010. Nous employons maintenant une centaine de personnes, et notre activité recouvre notamment les tests de paternité.
L'encadrement juridique des tests de paternité n'est actuellement pas satisfaisant, tant sur le plan de l'efficacité des examens que d'un point de vue éthique. Les lois de bioéthique prévoient que les tests de paternité ne peuvent être faits qu'à la demande de la justice – il s'agit surtout de tribunaux civils, parfois de magistrats de l'instruction. On ne peut donc demander à titre personnel un test de paternité. Mais les lois de bioéthique ont été pensées à la fin des années 1980. Depuis, avec Internet, on peut demander un test de paternité depuis son salon : il suffit d'avoir un numéro de carte bancaire pour recevoir un kit de prélèvement salivaire. La loi est donc contournée massivement. Pour 3 500 à 4 000 tests de paternité officiels par an en France, il y en aurait, selon les professionnels, 15 000 faits par d'autres voies – soit en ayant recours à Internet, soit en allant à l'étranger. La loi n'est donc pas appliquée. Pire, on en est arrivé à l'opposé de ce que souhaitait le législateur : ces tests de paternité sont effectués par des laboratoires à l'étranger qui échappent à tout contrôle. Certains sont de qualité, d'autres notoirement insuffisants. J'ai vu sur M6 des reportages qui montraient combien il est facile de faire un test de paternité, avec notamment cette société espagnole qui a 80 % de clients français et qui sous-traite ses analyses au Panama. Si je faisais mes analyses de la même façon en France, je vous assure que j'irais en prison !
Quant à l'éthique de la pratique, elle est aussi déplorable, dans ce cas, que la qualité des prestations. En France, on ne peut procéder à une analyse génétique qu'avec le consentement de la personne. Si l'on passe par Internet, il suffit de récupérer une petite cuillère ou un mouchoir utilisée par une personne pour faire réaliser une enquête de paternité sur celle-ci. On est donc très loin de ce que souhaitait le législateur. Celui-ci a refusé la libéralisation des tests de paternité par crainte d'une explosion des drames familiaux ; or, les pays occidentaux où ces tests de paternité ont été libéralisés n'ont pas connu ce genre de débordements – la France non plus d'ailleurs, malgré l'augmentation du nombre de tests de paternité sauvages. Bref, cette loi est contreproductive.
Par ailleurs, et sans vouloir faire de provocation, j'estime que les tests de paternité ne relèvent pas de la bioéthique mais relèvent plutôt d'un problème de société, un peu comme le divorce par exemple.
En tant que médecin, généticien, j'ai conscience de l'importance des lois de bioéthique. Pour autant, on ne peut pas mettre au même niveau le trafic d'organes, les manipulations sur les embryons, les mères porteuses et les tests de paternité ! Au reste, le citoyen moyen fait la différence. Mme Morano, lorsqu'elle était secrétaire d'État à la famille, s'est opposée à la libéralisation des tests de paternité en prétextant qu'ils deviendraient des tests de fidélité – je précise que, dans la pratique, l'infidélité est de loin le cas minoritaire ! Son propos montre bien que la question relève plus, comme celle du divorce, de l'équilibre familial que du problème de l'essence de la vie. Les tests de paternité ne relèvent donc pas, comme d'autres pratiques médicales, de l'encadrement moral mais plutôt d'une politique de transparence dans une société de plus en plus ouverte et demandeuse de vérité. Ce qui me semble très important, c'est que le législateur encadre la manière dont cette vérité est dévoilée.
Enfin, il ne faut pas oublier l'aspect économique des choses – car je suis aussi chef d'entreprise. Il est important que nos sociétés de biotechnologie créent de la richesse pour la France, tout comme il est important que je puisse assurer les salaires de mes employés. Or l'état actuel de la loi provoque une grande distorsion de concurrence.
Non, mais je travaille très différemment : je ne peux répondre qu'aux demandes de la justice.
Je propose de libéraliser les tests de paternité, en encadrant les laboratoires qui peuvent les pratiquer. En France, les laboratoires qui travaillent sur les empreintes génétiques sont agréés par une commission émanant du ministère de la justice. L'agrément est délivré pour cinq ans aux laboratoires ou aux personnes, suivant un cahier des charges défini par la loi et qui tient compte de l'équipement, de la formation du personnel ou encore des protocoles utilisés, autant d'éléments de qualité qui doivent être inhérents à notre pratique. Le dispositif est comparable à celui utilisé pour les laboratoires de biologie. En outre, l'AFSSAPS contrôle deux fois par an – à l'aveugle – nos prestations.
Autoriser les tests de paternité dans des laboratoires agréés permettrait de garantir deux points qui me semblent essentiels : d'abord, la qualité des prestations, qui inclut l'accompagnement des personnes – aujourd'hui, des gens viennent me demander de leur expliquer des résultats en anglais auxquels ils ne peuvent rien comprendre ! –, et, ensuite, le respect de cette règle éthique qui veut que les analyses ne soient pas pratiquées à l'insu des personnes, sans leur consentement.
Certes, mais la majorité des gens qui passent par Internet veulent en fait éviter une procédure trop longue et trop coûteuse – pour ce type d'analyses, la moitié de notre coût de revient est un coût administratif ! Par Internet, tout est beaucoup plus simple. Il est clair que la solution que je propose n'aboutira pas à éliminer les tests de paternité sauvages, mais elle permettra de les encadrer – peut-être à 90 %. Toute proportion gardée, parce que la gravité n'est pas la même, on peut faire une analogie avec l'interruption de grossesse.

J'ai déjà eu le plaisir de vous auditionner, monsieur Moisan, et je connais vos arguments.
Cela dit, on ne peut pas considérer qu'il faut forcément faire chez nous ce qui, de toute façon, peut se faire ailleurs – ou alors, ne nous donnons pas la peine d'écrire des lois françaises de bioéthique.
Par ailleurs, la question relève bien de la bioéthique : elle touche bien sûr à la biologie, mais aussi à l'éthique, puisque vous avez vous-même souligné que certains laboratoires ne la respectaient pas. L'éthique entre en ligne de compte, et pas seulement pour ce qui est de la fiabilité de la pratique mais aussi d'un point de vue sociétal. La bioéthique est intrinsèque à la société : nous trouvons normal que nos lois de bioéthique parlent des mères porteuses, alors qu'il s'agit plus d'un phénomène de société que d'une découverte scientifique.
Enfin, il ne s'agit pas de savoir qui est fidèle ou infidèle, mais ce que recouvre réellement la recherche génétique en paternité. L'enfant qui a été élevé par un père et une mère n'est-il plus leur enfant s'il est démontré que l'un n'est pas son géniteur ? Je crois qu'il l'est toujours.
Notre droit, notre République sont fondés sur le droit du sol, l'éducation et le transfert humain, pas sur le génétique ou le transfert de la race.
Si les gens passent pas Internet pour faire réaliser des tests de paternité, nous devons les avertir à la fois du manque de fiabilité de ces tests et de leur inutilité politique et philosophique. Mais les autoriser sur le territoire français serait un signal fort en faveur de l'importance du facteur génétique. Par effet de dominos, la possibilité deviendrait vite un droit : pourquoi tous les nouveaux-nés n'auraient-ils pas droit à un test de paternité, pour que leur authenticité génétique puisse être avérée ? Je ne pense pas que ce soit conforme à l'esprit du droit français et c'est pourquoi je n'y suis pas favorable. Ce qui ne m'empêche pas de reconnaître l'extrême qualité de votre travail scientifique ainsi que l'intérêt de disposer de tests fiables lorsque la justice en a besoin.

La loi n'est pas faite pour des intérêts particuliers, aussi respectables soient-ils – car ils le sont – mais pour la société tout entière ; autrement dit, elle est faite dans l'intérêt collectif.
D'un point de vue non pas de chef d'entreprise, mais de professeur en génétique médicale et de citoyen, quel est l'intérêt pour la société de libéraliser ces tests, étant entendu que cela n'empêchera pas de passer par Internet et que certaines personnes, pour des raisons de prix, préféreront s'adresser à l'Espagne plutôt qu'à Nantes ? Il est de notre devoir d'informer et d'alerter la population sur les tests sauvages. Pour le reste, si je vois l'intérêt de cette libéralisation pour votre entreprise, je ne la vois pas pour la société.

Quelles sont les motivations des particuliers qui demandent des tests de paternité ? Cela relève-t-il plus du conseil génétique ou de la simple curiosité ?

Tout cela dépend largement de l'évolution de la société et de la vision de l'enfant. Si l'enfant n'est plus celui d'un couple censément stable, mais l'aboutissement du droit à l'enfant d'une seule personne, on peut prévoir l'explosion de votre marché. Peut-être est-ce à cela que vous cherchez à répondre.

Quelle est la motivation des gens qui demandent un test de paternité ? La curiosité ? Des intérêts économiques ? Des histoires de divorce ou de succession ?
Il est clair que le test ADN de paternité ne définit pas la paternité telle que nous la concevons. Je suis le père de mes quatre enfants sans éprouver le besoin de vérifier que j'en suis le père biologique. Le père, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. Les prestations ADN que je fournis ne répondent pas à cette question-là. Les analyses que me demande la justice concernent souvent un père qui se défausse de ses responsabilités et auquel la mère demande de reconnaître ses devoirs, ou un père qui veut prouver, au moment d'un divorce, qu'il est bien le géniteur de l'enfant qu'il a élevé pour pouvoir continuer à le voir – car le droit français fait clairement appel au test ADN dans ces questions familiales. Il y a par ailleurs des cas médicaux, comme ces jeunes fiancés qui se sont rendu compte qu'ils avaient peut-être le même père naturel. Enfin, il y a les cas, que l'on voit régulièrement mais qui sont de loin les moins nombreux, des gens séparés du fait de guerres par exemple, et qui se retrouvent vingt ou trente ans plus tard – j'ai vu récemment des Cambodgiens ayant fui le génocide des khmers rouges et qui pensaient être frère et soeur.
Quant aux personnes qui ont recours aux tests sauvages, leurs motivations me semblent pour l'essentiel se ramener à un problème de liberté. Certains veulent savoir, pour des raisons qu'on ne peut pas forcément s'expliquer : il y a ceux qui ont un doute sur leur père ou leur mère, ceux qui recherchent une identité, les enfants adoptés qui veulent avoir une idée de leur origine ethnogéographique. Tel qu'ils me l'expliquent, c'est d'abord un problème de liberté individuelle – ils ont envie de savoir et estiment ne pas avoir à se justifier – et ils n'ont pas forcément d'autre raison, pécuniaire ou autre. Pour ce que j'en sais, je pense qu'il s'agit fondamentalement d'un besoin de savoir qui regarde chacun et qui n'est pas forcément amoral.
La séance est levée à dix-sept heures.