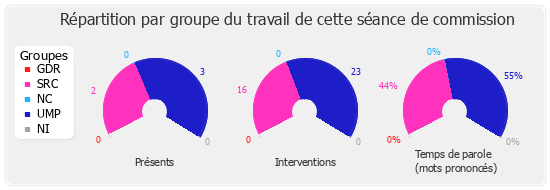Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Séance du 4 octobre 2007 à 9h00
La séance
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a procédé à l'audition, ouverte à la presse, de Mme Anne-Marie Brocas, directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale. Avant de donner la parole à notre rapporteure, je vous propose de présenter brièvement les missions qui sont les vôtres dans le domaine du médicament qui fait actuellement l'objet des travaux de notre mission.
En ce qui concerne le médicament, la DREES conduit deux types d'approche.
La première est une approche comptable, à travers l'analyse des comptes de la santé, qui sont des satellites des comptes de la nation et qui permettent de décrire l'ensemble des dépenses du secteur de la santé. Nous développons ainsi des analyses sur l'évolution de chacun des secteurs, en particulier sur le poste des médicaments pour lequel nous analysons les évolutions des prix et des volumes et nous recherchons quels sont les financeurs. Il y a donc d'un côté l'analyse des dépenses et de l'autre celle des recettes. C'est là que l'on trouve les données qui font l'objet de nombreux commentaires, c'est-à-dire celles qui ont trait à la part prise en charge par la sécurité sociale et par les organismes complémentaires et à celle qui reste à la charge des malades.
Cette année, nous avons mené des travaux sur la rétropolation afin d'établir de manière cohérente des séries chiffrées concernant les 55 dernières années. L'intérêt est de tracer une perspective historique afin de voir comment, au sein des dépenses de santé, la structure entre les différents postes a été déformée au fil du temps.
Cependant nous avons aussi une seconde approche, à partir des données issues des remontées statistiques des administrations ou des enquêtes, en particulier des informations émanant des banques de données propres au secteur du médicament.
À partir de là, la DREES analyse chaque année l'évolution du marché des médicaments remboursables. Depuis deux ans, à la suite d'une préconisation du Conseil national de l'information statistique (CNIS), elle s'efforce également d'analyser les chiffres relatifs aux types de médicaments qui font l'objet d'une rétrocession de la part des hôpitaux. Ce travail est encore récent mais on peut espérer que l'on disposera à l'avenir d'analyses plus détaillées.
Toujours à partir des données statistiques de l'industrie du médicament, des comparaisons sont effectuées entre le marché français et les marchés étrangers afin de mieux comprendre les ressorts propres à l'évolution de ce secteur en France.
À ces études générales s'ajoutent des analyses plus précises sur un produit ou sur une classe thérapeutique, comme l'étude conduite récemment sur les statines.
On le voit, il s'agit d'un travail d'études et d'analyse, mais il n'appartient pas pour autant à la direction que je dirige d'entrer dans le champ des préconisations en matière de politiques publiques.

Je vous remercie pour cette présentation synthétique du périmètre de votre action.
Quelles sont les relations de la DREES avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS, et avec la Haute Autorité de santé, la HAS ? Des données sont elles échangées avec ces organismes ? Travaillez-vous de manière interactive ? Votre direction leur apporte-t-elle des informations pour qu'elles les traitent ? À l'inverse, alimentent-elles vos travaux ?
L'AFSSAPS dispose d'une base de données administrative puisque c'est elle qui est à l'origine des autorisations de mise sur le marché (AMM), qui donne son avis au titre de la commission de la transparence et qui recueille les déclarations administratives obligatoires des laboratoires. Jusqu'à présent, il était difficile de mobiliser ces informations, le CNIS l'avait d'ailleurs noté dans un rapport de 2005. La DREES a désormais passé une convention avec l'Agence afin de disposer de cette base de données, qu'elle utilisera à l'avenir.
Pour l'heure, les bases que la DREES peut le plus facilement mobiliser sont celles qui sont produites par l'industrie du médicament sur l'activité des laboratoires pharmaceutiques : le GERS – le groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques – et l'IMS - Intercontinental Marketing Services. Ces données ne transitent pas par l'AFSSAPS. Les organismes qui les collectent sont totalement indépendants. La DREES paye pour pouvoir les utiliser.
Pour sa part, la HAS n'est pas une source de données, même si chacun constate bien évidemment les effets de ses actions, en particulier de la production des références de bonnes pratiques médicales, lorsque sont conduites des études sur certains secteurs ou sur le remboursement.
En fait, pour caractériser les relations de la DREES avec ces organismes on peut dire que les études que réalise la DREES, qui montrent des inflexions pour certaines classes thérapeutiques spécifiques, permettent à la Haute Autorité de santé, mais aussi à d'autres acteurs comme les caisses d'assurance maladie ou la direction du ministère de la santé chargée du médicament, de mesurer l'impact de telle ou telle action.

La DREES rencontre-t-elle des difficultés particulières pour collecter les informations nécessaires à l'exercice de ses missions ? Quelles mesures concrètes, de nature législative ou réglementaire, conviendrait-il d'adopter afin qu'elle dispose de l'ensemble des données ?
La démarche de collecte des données n'est pas entravée par des obstacles juridiques. Cela ne signifie pas que des progrès sont impossibles et la DREES s'efforce d'en réaliser, notamment en ce qui concerne le secteur des médicaments à l'hôpital, pour lequel elle manque d'informations, les données qu'elle collecte par les bases de données privées étant très focalisées sur la médecine ambulatoire. Si, en ville, grâce aux systèmes des prix administrés, elle dispose d'informations sur les prix et sur les volumes, à l'hôpital en revanche les prix peuvent varier de façon importante puisque les établissements hospitaliers sont libres de négocier l'achat des médicaments avec les laboratoires pharmaceutiques. Dans ce dernier cas, les remontées d'informations sont donc plus compliquées.
Il est vrai que, depuis deux ans, des données sur les volumes et sur les prix sont collectées dans les remontées sur les dépenses hospitalières mais nous n'avons pu présenter pour l'instant de publications que sur des données globales car nous ne disposons pas d'un recul suffisant pour apprécier le degré de fiabilité de ces informations. Il serait pourtant extrêmement utile de pouvoir mener des comparaisons sur les prix et sur les volumes entre les établissements hospitaliers, mais aussi entre la pratique hospitalière et la pratique de ville.

Ces remontées récentes d'informations sont-elles le fruit d'une collecte de données macroéconomiques et macrosanitaires ou s'agit-il de l'addition des informations provenant de chaque structure hospitalière ?
C'est bien d'une addition d'informations qu'il s'agit, qui permettront, à l'avenir, de se livrer à des analyses assez fines. Cependant, au préalable, une itération est nécessaire pour s'assurer de la fiabilité des données.

La DREES dispose-t-elle de remontées d'informations quant aux effets de la politique des achats groupés ?
Non. C'est l'un des sujets qui doivent être étudiés.
Ces données doivent aussi permettre d'analyser la rétrocession hospitalière, qui consiste à ce que des médicaments soient revendus aux malades par les hôpitaux qui sont eux-mêmes remboursés par la sécurité sociale. Dans les données qui émanent des hôpitaux, a été individualisée la part de cette rétrocession et la DREES dispose d'informations sur les types de médicaments qui en font l'objet, sur les volumes et sur les dépenses. Une analyse historique montre que le point culminant de cette rétrocession a été atteint en 2004, avec un montant global d'environ 2,5 milliards d'euros. Depuis lors, diverses mesures ont été prises et l'on observe une décrue.
Le premier exercice en la matière a porté uniquement sur les centres hospitaliers universitaires (CHU) et sur les centres de lutte contre le cancer. Sans surprise, il a été constaté que les antirétroviraux faisaient le plus fréquemment l'objet une rétrocession dans les CHU et les traitements contre le cancer dans les centres de lutte contre cette maladie.
Cette année, la DREES a pu étudier les informations en provenance de l'ensemble des centres hospitaliers et des cliniques privées. Pour l'instant, elle dispose de données sur les masses globales de dépenses et a réalisé une analyse sur les types de médicaments qui constituent les postes de dépenses les plus importants à l'hôpital, dans les centres de lutte contre le cancer et dans la rétrocession des hôpitaux.

La DREES a-t-elle également étudié l'impact, en termes de volumes et de prix, de la sortie de la réserve hospitalière ? Il faut rappeler, en effet, que la rétrocession concerne souvent des médicaments pour les traitements lourds comme la trithérapie ou l'interféron, qui sont initialement prescrits à l'hôpital mais que le malade peut ensuite se procurer en ville.
On mesure l'impact de ces traitements dans les études annuelles sur le marché du médicament. Ce sont en effet souvent des molécules très coûteuses qui font l'objet de cette sortie de la réserve hospitalière et les effets sur la dépense en ville sont donc forts.

Les médicaments sortis de la réserve hospitalière représenteraient 20 % de la dépense des médicaments délivrés en ville. Est-il possible de confirmer ce chiffre ? Ces dépenses en ville, mais dont l'origine se trouve dans une prescription hospitalière, ont un impact sur l'évolution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ambulatoire. Peut-on le mesurer ?
La DREES n'a pas réalisé de chiffrage mais elle regarde comment répondre précisément à cette question. Pour l'instant, elle se contente d'observer l'impact sur le marché global mais sans ventilation par produit.
Elle analyse la contribution à l'augmentation globale des dépenses des dix classes thérapeutiques qui y ont joué le rôle le plus important. Ce ne sont pas toujours les mêmes et l'on voit bien apparaître, en fonction des années, certaines molécules qui font l'objet d'une plus large diffusion. Ainsi, en 2005, nous avons constaté un fort impact de l'érythropoïétine, l'EPO, à hauteur de 1 % sur une croissance totale de 6,7 %. C'est très important !
Dans la mesure où l'on souhaite pouvoir distinguer ce qui incombe à la ville de ce qui relève de l'hôpital, la DREES doit vérifier si les outils dont elle dispose lui permettent de réaliser cette analyse.

Au-delà du confort que représente pour le malade le fait de pouvoir se procurer à la pharmacie de son quartier le médicament qui est sorti de la réserve hospitalière, il est important de vérifier si le fait de lui permettre d'aller voir son généraliste une fois qu'il est muni de la prescription hospitalière initiale est en soi un gage d'économie pour l'assurance maladie, s'agissant de traitements qui coûtent souvent plus de 1 500 € par mois.
L'assurance maladie affirme que les médicaments coûtent de plus en plus cher en médecine de ville, mais il ne faut pas oublier que les sorties de la réserve hospitalière alourdissent le panier de soins en ville.
Pour le vérifier, il faudrait analyser l'évolution de quelques molécules significatives au cours des dernières années.
On peut d'ailleurs rapprocher cette question de celle, plus générale, de la dynamique du marché du médicament : si l'on se demande ce qui tire ce marché vers le haut, on constate, année après année, que la dépense est tirée par les molécules les plus récentes. En moyenne, plus de la moitié de la croissance des dépenses est imputable aux molécules de moins de cinq ans. Et il y a bien là un lien avec la sortie de la réserve hospitalière, qui vise souvent des molécules récentes et coûteuses.

Vous avez rappelé, à juste titre, que chaque site hospitalier a sa propre stratégie d'élaboration des prix ; mais que se passe-t-il lors de la sortie de la réserve hospitalière ? Il paraîtrait logique que l'effet volume entraîne une diminution du prix de vente en ville. Avez-vous des informations à ce propos ?
La DREES ne dispose pas d'éléments de comparaison des prix, mais c'est un objectif qu'elle poursuit, car il paraît essentiel de disposer de telles données pour se comporter en acheteur avisé. À partir des données dont elle dispose, elle s'efforcera de fournir un éclairage pour une ou deux molécules.
Chaque année, un faible nombre de classes thérapeutiques explique les mouvements du marché, mais ces derniers sont en partie contrebalancés par la montée en charge des génériques. Celle-ci demeure sans doute insuffisante, mais elle évite une trop forte polarisation du marché : si les nouvelles molécules expliquent 50 % de la croissance aujourd'hui, elles en représentaient 80 % au début des années 2000. On observe, outre les effets du volume de vente et du prix des génériques, que l'existence de ces derniers conduit souvent les laboratoires à aligner le prix du princeps.

Lors de l'audition de la semaine passée, il a été demandé aux représentants de la Cour des comptes s'ils disposaient d'informations sur les économies globales réalisées grâce aux génériques. Depuis 2002, de nombreuses molécules à fort taux de rentabilité – les blockbusters – sont tombées dans le domaine public et ce mouvement va se poursuivre jusqu'en 2010. Les économies potentielles réalisables sur les médicaments récemment tombés dans le domaine public ont été estimées à plus de trois milliards d'euros. Pouvez vous confirmer ce chiffre ? Avez-vous fait des prévisions d'économies pour l'assurance maladie pour les deux ou trois années à venir ?
Aucune analyse prospective n'a été menée sur ce point.
En revanche, des analyses rétrospectives de la DREES sur la contribution des génériques à l'évolution des dépenses montrent que leur effet est très marqué.
Elle s'est également intéressée à la place des médicaments génériques dans les pays étrangers et a constaté que la France se caractérise par l'étroitesse de son répertoire de médicaments génériques et par une part des génériques dans le volume global des ventes jusqu'à cinq fois inférieures à ce que l'on constate chez nos voisins européens.

La DREES a-t-elle comparé l'importance du phénomène de contournement des génériques dans les différents pays ? C'est sans doute un des éléments qui expliquent que le taux de pénétration ne progresse guère en France. On sait en effet que certains laboratoires, dès lors que leur princeps tombe dans le domaine public, en sortent une autre forme galénique, par exemple en remplaçant un effervescent par un orodispersible, sans que le service médical rendu ne soit amélioré. Ce phénomène a-t-il été évalué ? Alors que les pharmaciens ont beaucoup fait pour le développement des génériques, ces contournements font un peu mal au coeur…
La DREES ne dispose pas des outils nécessaires et ne compte pas assez de médecins dans ses équipes pour mener des études aussi pointues, qui relèvent sans doute davantage de la HAS ou de l'AFSSAPS. Toutefois il n'est pas certain que les choses se présentent de façon différente chez nos voisins car les stratégies des laboratoires y sont sans doute identiques.

Avez-vous mené des études sur les conséquences économiques et sanitaires des déremboursements ? Ces derniers entraînent-ils des modifications dans la stratégie de prescription au profit de médicaments remboursés, avec les effets financiers que l'on imagine ?
Les déremboursements ont un impact comptable. On observe ainsi une nette rupture dans l'évolution des dépenses à la suite des mesures prises en 2006, la croissance du poste médicament n'ayant été que de 0,9 % alors qu'elle était comprise entre 5 et 7 % depuis une dizaine d'années.
En 2004, afin de mettre en lumière la stratégie des laboratoires à la suite de déremboursements et les effets de ces derniers sur la prise en charge des malades, la DREES a mené une étude sur quelques molécules ayant fait l'objet d'un déremboursement : anti-diarrhéiques, enzymes anti-inflammatoires, vasodilatateurs cérébraux et périphériques, anti-acides. En fait, cette étude a montré qu'il n'y avait pas de réponse unique à votre question et que les choses variaient en fonction du produit. Ainsi, pour les vasodilatateurs, la structure de consommation a peu changé, le prix a varié de façon limitée et il n'y a pas eu de transfert vers d'autres produits. En revanche, pour les antiacides, a été observé un effet de substitution par des produits remboursés. L'évolution tient donc à la nature même des produits et aux pathologies traitées et l'on ne peut pas parler de transferts systématiques vers des produits plus coûteux.

Les vasodilatateurs sont fréquemment prescrits chez des personnes âgées, pour des affections de longue durée (ALD) prises en charge à 100 %. C'est sans doute parce que les complémentaires ont accepté de compléter le remboursement qu'il n'y a pas eu de changement de comportement dans les prescriptions. En revanche, pour les veinotoniques, le déremboursement a entraîné un transfert vers des produits de contention veineuse, plus onéreux.
La DREES n'a pas étudié les veinotoniques. Sur les cinq classes thérapeutiques auxquelles elle s'est intéressée, elle a constaté une forte diminution globale de la consommation des produits déremboursés, mais avec des variations selon les classes, sans doute pour des motifs comme celui que la rapporteure a indiqué, qui tiennent en particulier aux types de malades et à la prise en charge assurancielle.

Les déremboursements affectent fortement l'homéopathie, dont le taux de remboursement, qui est actuellement de 35 %, tomberait à 8 % avec la franchise de 50 cents par tube de granules. Si aucun système assuranciel ne vient prendre en charge cette différence, il y a un risque de transfert vers l'allopathie et de surcoût, comme celui qui a été observé en 2003 et 2004. La DREES dispose-t-elle d'une analyse à ce propos ?

Les laboratoires interviennent dans plusieurs États et la réglementation est de plus en plus européenne. Les comportements envers les génériques varient selon les pays et les effets de contournement ne sont pas les mêmes. Est-il possible d'en savoir davantage à ce propos afin que l'on puisse mieux comprendre d'où viennent les problèmes ?
Les exercices de comparaisons sont assez globaux. Ils montrent que la France se caractérise par un volume de médicaments consommés très supérieur à celui de ses voisins et que les prix y sont plutôt inférieurs.
S'agissant des volumes, si l'on regarde les ventes moyennes de médicaments aux officines, comptabilisées en unité standard par habitant, on obtient un chiffre de 750 pour l'Italie, de 1 000 pour l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, et de 1 500 pour la France.
Quant au prix moyen par unité standard, il est de 0,18 à 0,19 € en France, en Espagne et au Royaume-Uni mais il atteint 0,23 € en Allemagne, où le système de forfait par classe ne couvre que 60 % du marché, les prix étant libres par ailleurs. Le prix moyen est encore plus élevé en Italie puisqu'il atteint 0,27 €.
Le volume de médicaments vendus en France conduit à placer notre pays en tête de tous les pays européens pour la dépense de médicament par habitant. Ainsi, le chiffre d'affaires des ventes aux officines par habitant est de 284,40 € en France, contre 244 € en Allemagne et environ 200 € dans les autres pays.
On constate également qu'en France 8 ou 9 consultations sur 10 débouchent sur une prescription de médicaments alors que ce taux tombe à 1 sur 2 au Royaume-Uni.
Une analyse plus qualitative montre que la répartition par classe thérapeutique varie beaucoup selon les pays. Ainsi, la France est en tête pour les antibiotiques, tandis qu'en Allemagne d'autres médicaments sont beaucoup plus vendus. Les Allemands pourraient donc se poser à propos d'autres produits les questions que nous nous posons quant à la pertinence de la prescription des antibiotiques ou des antidépresseurs.
Au Royaume-Uni, on observe une forte consommation de médicaments peu consommés en France, comme ceux qui sont destinés à la lutte contre l'obésité ou au sevrage tabagique, ce qui s'explique par une action forte les pouvoirs publics en la matière.

Outre les études selon les classes thérapeutiques, la DREES procède-t-elle à des analyses en fonction du service médical rendu (SMR), par exemple sur la substitution de produits de contention et de conseils d'hygiène à la prescription de veinotoniques ?
Par ailleurs, la DREES a-t-elle déjà eu l'occasion de travailler sur la possibilité récemment offerte aux professionnels paramédicaux de prescrire eux-mêmes un certain nombre de produits, en particulier du petit matériel ?
La DREES n'a pas conduit d'études prenant en compte le SMR. Cela relève plutôt de l'AFSSAPS ou d'autres organismes. Elle ne dispose pas non plus d'analyses sur la substitution aux prescriptions de veinotoniques. Ce phénomène de substitution, étudié à l'occasion de certains déremboursements, varie beaucoup en fonction de la classe thérapeutique envisagée.
L'autorisation de prescrire du petit matériel vient d'être donnée aux professionnels paramédicaux et la DREES n'a pu l'étudier pour l'instant. De manière plus prospective, il semble que l'évolution démographique des différentes professions conduira probablement à un déplacement du partage des compétences.

La DREES dispose-t-elle d'informations sur l'implantation dans les pays voisins de logiciels d'aide à la prescription, dont la diffusion est encore embryonnaire en France ?
La DREES n'a pas travaillé sur ce sujet. En revanche, il a été constaté que, par des mécanismes très différents, en particulier par l'action des associations de médecins et par le conventionnement, la prescription médicale est bien davantage orientée en Allemagne et au Royaume-Uni qu'elle ne l'est dans notre pays.
En la matière, l'organisation de la pratique médicale joue un rôle très important : un très gros cabinet de groupe anglais n'a rien à voir avec un généraliste français. En Allemagne, la situation est encore différente avec une forte présence des paramédicaux au sein des cabinets. Il est plus facile pour des cabinets importants que pour un médecin isolé de recourir à un logiciel d'aide à la prescription.

La philosophie du système de santé mais aussi les modes de financement des médecins diffèrent beaucoup entre ces trois pays.
Effectivement, mais l'organisation concrète de la pratique est également importante, de même que le rôle particulier que joue l'hôpital dans notre pays.
Toutefois cela ne contredit par l'enquête de la DREES sur les prescriptions des médecins généralistes et leurs déterminants en France. Il n'a pas été trouvé de différences majeures selon que l'on exerce en cabinet de groupe ou de manière individuelle. Peut-être cela tient-il au fait que, en France, ouvrir un cabinet de groupe consiste surtout à mettre en commun une secrétaire et des logiciels.

En Italie, on consomme donc moins de médicaments, mais les prix y sont plus élevés. A-t-on pour autant constaté que cela induisait des différences en termes de santé ?
On dit souvent que le système français est le meilleur. Il faut pour le vérifier disposer des statistiques relatives à l'espérance de vie. Elles seront communiquées à la MECSS. Cela étant, on a du mal à établir une corrélation effective entre consommation de médicaments et de soins d'une part, espérance de vie d'autre part.

Je vous remercie d'avoir répondu de façon aussi précise à l'ensemble de nos questions et je vous invite à faire parvenir à la Mission toutes les précisions, commentaires et propositions susceptibles de nourrir sa réflexion.
J'ai pris bonne note des questions auxquelles il ne m'a pas été possible de répondre de façon complète et je ne manquerai pas de vous faire parvenir les compléments de réponse par écrit.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale a ensuite procédé à l'audition de M. Jean Marimbert, directeur général de AFSSAPS, et de M. Michel Pot, secrétaire général.

Pouvez-vous définir le périmètre des missions de l'AFSSAPS et préciser ses relations, en termes d'échanges d'information, avec la Haute Autorité de santé et la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Comment pourrait-on harmoniser les différentes missions qui sont imparties à ces organismes ?
L'AFSSAPS est l'héritière de l'Agence du médicament. C'est une autorité sanitaire déléguée. Elle a reçu une très large délégation de l'État pour accomplir des tâches d'évaluation des produits de santé, notamment l'évaluation du bénéficerisque, avant la mise sur le marché, et après la mise sur le marché.
L'Agence exerce également des missions de puissance publique, dans la mesure où elle est chargée de prendre des décisions publiques de gestion du bénéficerisque : octroi des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments, suspension, retrait, modification du régime du médicament au fil des modifications qui peuvent se produire dans sa vie, en raison de l'évolution de la connaissance scientifique et des informations fournies par les conditions réelles d'utilisation de ce médicament, par des milliers, voire des millions de personnes ; en effet, le rapport bénéficerisque ne peut être qu'approché au moment de l'AMM.
Autre mission de puissance publique : l'inspection des sites. Il peut s'agir des sites de production, des laboratoires, des essais cliniques en France ou à l'étranger, des sites où se déploient d'autres types d'activités, comme la thérapie cellulaire.
Dernière mission, qui a pris de l'importance ces dernières années : le contrôle de qualité des produits en laboratoire. Il est bon que des laboratoires publics puissent pratiquer des contrôles, soit de façon aléatoire, soit de façon plus ciblée, en fonction d'une analyse de risques, en fonction de signaux qui leur parviennent par ailleurs, pour vérifier que les produits contiennent la quantité normale de substances actives, que leur qualité pharmaceutique est bonne et éventuellement qu'ils ne comportent pas de substances toxiques, comme on l'a vu dans certains cosmétiques importés.
Ces missions s'exercent au travers de quatre séries de métiers : l'évaluation avant et après l'AMM, l'inspection, le contrôle en laboratoire et la production d'informations touchant au bénéficerisque du médicament.
J'ai été nommé à la direction de l'AFSSAPS en février 2004, quelques mois avant le vote de la loi sur l'assurance maladie, qui a créé la Haute Autorité de santé. Le législateur a décidé de transférer les fonctions d'évaluation du service rendu à la HAS, fonctions qui étaient jusqu'alors rattachés à l'Agence, après l'avoir été au ministère de la santé. Il a donc fallu construire des articulations avec la HAS sur deux points principaux.
Le premier a été le suivi post AMM. Les études post AMM sont utiles pour mieux informer, à partir des données de la vie réelle, pour apprécier le rapport bénéficerisque du médicament – notamment le suivi de la toxicité des produits – et la réalité du service rendu, ce dernier domaine relevant de la commission de la transparence qui fait partie de la HAS.
Au deuxième semestre 2005 a été mis en place un mécanisme de coordination : d'un côté les équipes AMM et du suivi post AMM, de l'autre les équipes de la commission de la transparence. Elles se réunissent très régulièrement, environ tous les quinze jours, pour échanger sur les dossiers et les besoins d'études post AMM en fonction des produits concernés par l'évaluation. En cas d'évaluation française, les produits obtiennent l'AMM et passent ensuite à la transparence. En cas d'évaluation européenne, il faut anticiper les besoins en études post AMM avant même l'obtention de l'AMM européenne.
L'idée est de ne pas faire de demandes dispersées aux laboratoires et d'éviter que ces études ne fassent double emploi. On essaie de configurer des études post AMM susceptibles d'atteindre les deux types de résultats : les données sur le bénéficerisque actualisées en vie réelle et les données sur le service rendu et l'intérêt de santé publique ; ou bien l'on articule les demandes d'études de manière qu'il n'y ait pas de chevauchements.
Cette première collaboration est complétée par des réunions avec la Direction générale de la santé, qui ont lieu deux ou trois fois par an. On n'examine pas l'ensemble des dossiers post AMM, mais on se concentre sur quelques grands dossiers qui représentent un enjeu de santé publique ; Accomplia ou Gardazil, par exemple.
Le deuxième aspect de cette coordination avec la HAS concerne la diffusion de l'information dans le domaine des produits de santé. Il faut remarquer que le terme de « bon usage » a plusieurs significations. Pour le sens commun, c'est l'usage sûr ; c'est la manière d'utiliser le produit en maximisant ses avantages et en minimisant ses risques. Toutefois c'est aussi le bon usage du point de vue de la valeur thérapeutique : l'usage du médicament, dans une stratégie thérapeutique où il n'y a pas nécessairement que le médicament. C'est enfin le bon usage du point de vue du payeur public, dans le sens du meilleur coûtbénéfice.
L'idée a été d'échanger avec la Haute Autorité de santé pour produire des documents qui soient les plus complémentaires possibles et, dans certains cas, produire des documents sous double timbre, comme ce fut le cas pour Accomplia.
Aujourd'hui, le principal problème pour l'information publique du médicament est quantitatif. Il est lié à la capacité de produire une bonne information et de l'actualiser.
On peut citer l'exemple de coopération, hors AMM, avec la HAS et l'Institut national du cancer – INca. Lorsque le décret sur la tarification à l'activité – T2A – est sorti, il a été prévu que les hôpitaux devraient passer avec les agences régionales d'hospitalisation – ARH – des conventions portant notamment sur le bon usage des médicaments. Le ministère s'est aperçu que, pour que ces conventions réussissent, il fallait disposer de référentiels de bon usage. Le plus simple qui existe, et qui est actualisé, c'est l'AMM.
Cependant il y a de très nombreuses prescriptions hors AMM, notamment à l'hôpital et en cancérologie. Il était donc nécessaire de produire des référentiels publics qui permettent de distinguer, à l'intérieur du hors AMM, ce qui est scientifiquement acceptable, car, même si l'on n'a pas le niveau de preuve de l'AMM, on dispose de l'expérience clinique des soignants, et ce qui est scientifiquement moins acceptable, voire pas du tout. On s'est alors rendu compte qu'aucune des institutions prise isolément n'avait les moyens de produire très rapidement l'ensemble des référentiels dont on avait besoin. On s'est donc réparti la tâche de façon pragmatique : la HAS commence à produire des référentiels sur les dispositifs médicaux ; l'INca des référentiels hors AMM en cancérologie ; l'AFSSAPS des référentiels de médicaments hors cancérologie, avec un mécanisme de relecture réciproque entre les équipes d'experts des différentes institutions.

Au-delà de cette répartition des tâches, existe-t-il une base de données commune ? Est-ce que, sur un seul et même site, se trouve l'ensemble des données qui colligent l'ensemble des domaines qui ont été répartis en fonction de cette ventilation ? A-t-on couvert, 70, 80 % ou 100 % de ce champ entre les trois secteurs qui ont été rappelés ?
Votre première interrogation renvoie à la question de la base de données sur le médicament. C'est un sujet lancinant, au sens où il est abordé dans un certain nombre de rapports parlementaires ou de la Cour des comptes depuis cinq ou six ans.
Il a été décidé de mettre en place une base publique du médicament. Celle-ci sera opérationnelle à la fin de 2008. Les médicaments représentent environ 16 000 produits autorisés dont 11 000 à 12 000 effectivement commercialisés. Pour chaque produit, existe un mode d'emploi et un relevé des caractéristiques, avec la particularité qu'ils ont été autorisés au fil du temps. On se trouve donc devant une masse d'informations dont la grande majorité n'est pas informatisée, se présentant parfois sous forme de pelures, qui ne sont pas très exploitables pour faire une base de données.
Un tel projet est très lourd : il consiste à reprendre les relevés des caractéristiques de produits, à les faire transcrire dans une forme informatiquement utilisable. Il faut les faire relire et valider par les pharmaciens de l'organisme public et, petit à petit, les mettre en ligne.
Il y a 5 000 produits en ligne et 3 000 validés et en interaction avec les laboratoires pour vérification.
D'ici fin 2008, les données de la base seront reprises sous forme informatique, en mode « base de données ». Pour y parvenir, il a fallu conduire, notamment en décembre 2005, des négociations budgétaires qui ont été âpres mais fructueuses.
Cette base est fondée sur des données de l'AMM. Évidemment, il serait utile d'utiliser cette base dans une logique d'intérêt public plus globale, dans un travail commun avec la HAS, pour y greffer des données autres que celles de l'AMM, en particulier sur le service médical rendu, ce qui profiterait aux médecins.
Pour greffer des données autres, il faut qu'elles existent et qu'elles soient accessibles. Le problème se pose de la même façon pour la HAS : l'historique du service rendu remonte à un certain temps, où les données n'étaient pas informatiquement utilisables et donc pas immédiatement disponibles. On ne pourra donc pas les intégrer où les renvoyer à des liens tant qu'elle n'aura pas fait le même travail sur le service rendu.

Quelles seront les données collectées et mises à la disposition des professionnels de santé à la fin de l'année 2008 ? Ces derniers auront-ils accès à la fiche de transparence du médicament, qui leur fait souvent défaut lorsqu'un visiteur médical d'un laboratoire vient au cabinet ou à la pharmacie, à l'AMM, au SMR ? Pourront-ils savoir si une étude post AMM est en cours ? Par qui ? De quelles informations pourront-ils disposer sur le prix ? Pourront-ils faire des comparaisons avec les prix des autres médicaments dans la même classe thérapeutique ?
Non, le chantier consiste d'abord à mettre en ligne les données dont dispose l'AFSSAPS : les AMM, les annexes aux AMM, les résumés des caractéristiques du produit – RCP. Les fiches de transparence ne sont pas à l'AFSSAPS, c'est la HAS qui est en train de les informatiser.

Il n'y a donc pas de travail d'articulation entre l'AFSSAPS, la HAS et l'INca pour la constitution d'une base de données commune qui permettrait de balayer le sujet du bénéficerisque, la logique du SMR et le domaine de la pathologie cancéreuse ?
L'AFSSAPS s'est engagée à mettre en ligne ses données et la HAS les siennes. Le jour où ce sera fait, il ne sera pas difficile de créer des liens sur les fiches de médicaments de l'AFSSAPS renvoyant aux fiches de transparence de la HAS – et inversement. Techniquement il n'y aura aucun problème. Le problème est d'abord de constituer la base de ses propres données.
Il faut distinguer l'AMM, qui consiste à évaluer le rapport bénéficerisque du médicament et à décider d'autoriser sa mise sur le marché, et l'évaluation du service médical rendu – on dit plutôt maintenant du service médical « attendu » – qui consiste à comparer la quantité d'effets des médicaments, dont le rapport bénéficerisque est déjà établi et positif, et à mesurer la valeur ajoutée thérapeutique.
La commission de la transparence est chargée de cette deuxième tâche. À partir de ce travail sur les produits qu'elle évalue, elle publie des fiches de transparence qui indiquent le service rendu par le médicament, ce dernier étant classé dans une des cinq catégories de SMR. Le niveau de remboursement et la fixation du prix se fondent sur cette évaluation de l'amélioration du service rendu.

En ce qui concerne les médicaments génériques, comment peut-on expliquer la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché à des laboratoires dont on sait que le princeps est génériqué ? Y a-t-il une raison cachée ? On peut citer l'exemple de l'AMM qui a été délivré à une Predmisolone orodispersible de même dosage que celle qui existait auparavant sous forme effervescente. Tous les professionnels de santé sont d'accord pour dire qu'elle n'a rien apporté de plus, si ce n'est qu'on ne peut plus génériquer le princeps.

Je précise que la Predmisolone est un corticoïde, avec un effet anti-oedémateux et anti-inflammatoire.
Globalement, le générique s'est développé ces cinq dernières années dans notre pays, même si on est parti de très bas.
Il n'y a pas de raison cachée au niveau de l'AFSSAPS, qui travaille dans l'intérêt de la santé publique, et qui cherche à être la plus transparente possible. C'est d'ailleurs la première agence d'Europe qui ait publié, début 2006, des comptes rendus de la commission de pharmacovigilance.
Je n'ai pas d'explication à fournir immédiatement concernant le cas de la Predmisolone, mais je vais me renseigner pour la donner à la Mission. Il faut néanmoins remarquer que, dans l'octroi de l'AMM des génériques, l'AFSSAPS est soumise à la législation européenne et doit respecter la définition européenne du générique qui est transposée dans la loi française.
Les critères sont intangibles : même composition et même forme thérapeutique. Si un produit ne remplit pas ces critères, on ne peut pas le traiter comme un générique, lequel bénéficie d'un régime très allégé. Dans le cas d'un générique, on n'exige pas des études cliniques, simplement la preuve de leur bioéquivalence, au stade de l'évaluation de l'AMM. Dans le cas contraire, on doit demander au laboratoire qui dépose le dossier d'apporter des éléments de preuve clinique, dans la mesure où il ne peut pas se situer par référence aux études cliniques faites pour un produit princeps.
Par ailleurs, au stade de l'AMM, on n'a pas à juger. On ne peut pas refuser l'autorisation parce que tel produit n'apporte pas un plus thérapeutique par rapport au précédent. La seule question à laquelle il faut répondre est : a-t-il plus d'efficacité que de risques ? La législation sur l'AMM n'empêche donc pas, en France comme ailleurs, l'entrée sur le marché des me too, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas plus efficaces que les précédents et qui en sont très proches, même si on ne peut pas parler de génériques.
C'est en aval qu'on peut réguler les me too, au stade du travail de la transparence, de l'évaluation, de la comparaison entre médicaments. L'autorité publique peut très légitimement fixer un taux de remboursement ou un niveau de prix tenant compte du fait que le médicament n'apporte pas grand-chose par rapport aux générations précédentes ou à d'autres médicaments existants.
Il serait illégal, en revanche, de refuser une AMM sous prétexte qu'il existe déjà quatre ou cinq médicaments équivalents. Par ailleurs, les profils des patients sont très variés et ceux-ci ne réagissent pas de la même manière à des médicaments de la même classe, très proches sur le plan pharmaceutique et pharmacologique. L'un réussira à une personne, mais pas à une autre. Attention donc à une stratégie dans laquelle, sous prétexte que tel médicament n'apporte pas plus que les précédents, il ne faut pas autoriser sa mise sur le marché. On risque de réduire la palette thérapeutique des médecins.

Quelle instance peut décider qu'il y a ou non contournement du générique, phénomène connu de tous les professionnels de santé, et décider de ne pas délivrer d'autorisation ?
Il existe effectivement des stratégies de contournement. En 2005-2006, on s'est demandé si l'on pouvait modifier la définition du code de la santé publique sur les génériques, afin de faire figurer, dans la même catégorie du répertoire des médicaments génériques établi par l'Agence, davantage de produits. Ces tentatives ont échoué, le Conseil d'État ayant jugé que l'élargissement de la définition qui lui était proposé était contraire à la définition du générique, telle que prévue par la directive européenne.
Il peut exister des médicaments qui sont thérapeutiquement très proches du générique sans pouvoir être qualifiés de génériques, à cause de ce problème de définition. Il ne paraît pas exclu de réfléchir, dans ces cas-là, à la possibilité de permettre la substitution pour ces médicaments qui, à proprement parler, ne remplissent pas tous les critères très précis du générique. Mais il faudrait alors veiller à bien cadrer le système et poser une condition d'équivalence thérapeutique.
L'AFSSAPS est concernée par les polémiques sur la sécurité des génériques. Certains praticiens sont opposés à la substitution dans un domaine particulier, par exemple celui des épileptiques, où ils considèrent que la marge thérapeutique est beaucoup trop étroite. Des sociétés savantes françaises, et même étrangères, ont pris position contre la substitution.
Toute réflexion sur l'élargissement du répertoire, sur l'élargissement du champ de la substitution, doit prendre évidemment en compte les impératifs de sécurité. Si le générique s'est assez bien développé ces cinq dernières années, c'est parce que la population a globalement confiance dans le générique. Il ne faut pas porter atteinte à cette confiance par des accidents ou des manoeuvres mal maîtrisées.
Il est tout à fait compréhensible qu'on veuille réfléchir à la façon de contrer les stratégies de contournement, mais on aura du mal à le faire dans le cadre de la notion de répertoire des génériques à proprement parler, en raison du caractère très strict de la définition communautaire. La politique du générique doit être une politique de confiance et il faut être très attentif aux enjeux de substitution qui peuvent parfois poser, même marginalement, des problèmes de sécurité.

S'agissant des bases de données, il faut sortir d'une approche scientifique, le prescripteur n'étant pas du tout dans la même démarche, dans la mesure où il s'attache à la simplicité d'utilisation. Une base de données commune aboutirait à la création d'un logiciel d'aide à la prescription, que tout le monde appelle de ses voeux. En 2008, cela sera-t-il possible ? Aujourd'hui, 5 000 principes pharmaceutiques ont été informatisés. Est-ce que cela a été fait selon un classement alphabétique ou par ordre décroissant de prescription, ce qui serait plus utile ?
Par ailleurs, l'AFSSAPS a un rôle en matière de traçabilité sanitaire et, notamment, de fiabilité du médicament. Est-ce que l'ensemble des génériques qui sont vendus en France et en Europe est élaboré sur la plate-forme occidentale ? Certains sont-ils élaborés sur d'autres plates formes, notamment asiatiques ? On a en effet constaté que les unités de production de certains génériqueurs installés à l'Est du massif continental européen ont parfois montré le caractère aléatoire de la qualité de leurs productions.
À partir de 1999, l'Agence a commencé à archiver électroniquement ses fiches électroniques et à les entretenir. Ce sont elles qui sont sur le site in extenso, c'est-à-dire avec les RCP. Le site comporte 5 000 premières spécialités avec leur composition pharmaceutique. Il n'y a pas de base exploitable facilement dans la mesure où, effectivement, le travail n'est que chronologique. En revanche le travail de reprise est fait en priorité sur des spécialités commercialisées.
S'agissant des logiciels d'aide à la prescription, la stratégie actuelle consiste à dire que pour être certifiés qualité, ces logiciels doivent être reliés à des bases de données médicamenteuses, lesquelles, qu'elles soient publiques ou privées, ont signé une charte de bonne conduite définie dans des travaux menés conjointement par la HAS et l'AFSSAPS. Cette charte, qui a été publiée, a été élaborée avec des professionnels des bases. Ces bases doivent répondre à un certain nombre de critères, notamment en termes d'exhaustivité, en particulier sur les RCP, les fiches de transparence.
Dès lors que l'AFSSAPS sera à même de fournir ces données qui seront aisément absorbables par n'importe quelle base et que la HAS sera à même de le faire de son côté, la question sera réglée par le biais de l'adhésion des bases, quelles qu'elles soient, à la charte qui a été définie entre l'AFSSAPS et la HAS.
Pour faire une bonne base de données de données de médicaments, il faut d'abord faire les investissements préalables et mettre en forme utilisable pour une base de données tout le corpus existant. À partir de là, l'imagination peut être au pouvoir en matière de coopération, pour regrouper les données les plus utilisables et les plus accessibles pour les praticiens et les professionnels de santé, voire pour le public.
On peut citer l'exemple des dispositifs médicaux. L'AFSSAPS a des contacts avec la direction de la sécurité sociale depuis quelques mois. L'Agence dispose d'une source de données sur les dispositifs médicaux liée à la déclaration des dispositifs médicaux de trois des quatre classes ; elle concerne la mise sur le marché. La direction de la sécurité sociale souhaiterait que l'Agence mette dans cette base, dans un avenir le plus proche possible, des éléments sur l'inscription des dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations – LPP, c'est-à-dire l'équivalent d'éléments sur le service rendu. Le but est que soient accessibles sur une même base des données sur l'amont, c'est-à-dire sur la mise sur le marché du produit, et des données sur le statut du produit par rapport à la prise en charge. Cela signifie qu'à partir du moment où l'on dispose d'un outil à un endroit donné, on peut lui faire remplir un rôle qui dépasse les missions, dans une optique de bonne organisation du système.

Pouvez-vous revenir à la question de la fiabilité des génériques, leur traçabilité et le problème de la sécurisation quand la chaîne de production implique des sites lointains de l'extrême Est ?
Il faut être conscient que le fait d'utiliser des génériques, même produits sur le territoire national, pose des questions de traçabilité. À partir du moment où un médecin prescrit un médicament et ne s'oppose pas à sa substitution, un générique peut être substitué à ce médicament. En cas d'effets indésirables, on peut s'interroger sur la cause : est-ce que ces effets sont dus au produit princeps ou au générique ? Le pharmacien le sait, le patient aussi, mais pas le médecin. Des discussions ont eu lieu en commission de pharmacovigilance sur ce sujet. Il faut y travailler.
Ce qui est plus préoccupant, c'est que la chaîne de fabrication du générique est de plus en plus étendue. Certaines étapes sont de plus en plus souvent effectuées à l'étranger, parfois sur des sites très lointains. La fabrication des matières premières pharmaceutiques utilisées dans les génériques est à 80-90 % extra-européenne : Inde, Chine, Brésil et Amérique du Sud. Par ailleurs, les essais de bioéquivalence destinés à vérifier que le produit générique se diffuse dans l'organisme de manière comparable au produit princeps sont de plus en plus souvent effectués ailleurs, notamment sur des sites asiatiques. Dans ces pays, il y a des gens qui travaillent très bien, mais il y a aussi de vilains canards. Cela oblige à consacrer une partie de son temps à aller inspecter dans ces pays lointains, en particulier en Inde et en Chine, pour le compte de l'AFSSAPS ou de l'OMS. Il est évident que le contrôle de la qualité de l'amont de la chaîne, dans ces pays-là, dépasse les forces de n'importe quelle agence individuelle, même la FDA américaine.

Il faut rappeler le cas d'équipes d'experts qui étaient passées dans des territoires asiatiques. Ils avaient constaté que les chaînes de production étaient conformes aux normes exigées, mais, quelques semaines après, les mauvaises habitudes étaient reprises. Cela pose des problèmes, notamment pour les pays qui commandent des médicaments à bas prix sur la base d'un référentiel théoriquement correct. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres que leur population doit absorber des génériques mal élaborés.
On ne sera jamais à l'abri de ce qu'on pourrait appeler « le syndrome de Potemkine » : on met en place des décors accrocheurs qu'on enlève après le passage des hautes personnalités. Reste que, pour relever ce défi, une coopération de plus en plus accrue est nécessaire entre les services d'inspection des différents pays. De nombreuses agences font des contrôles, mais, ce qui compte, c'est qu'au niveau européen et mondial, des échanges d'informations aient lieu et que lorsqu'un problème est repéré par l'une d'entre elles, elle le fasse savoir aux collègues des autres pays.
Pour la deuxième fois, une réunion a été organisée avec une vingtaine d'agences. Parmi les thèmes identifiés on peut citer : les moyens d'améliorer la coopération pour lutter contre la contrefaçon, qui se trouve à nos portes, et la lutte contre la fraude dans le domaine des essais cliniques.
Autre aspect : le contrôle en laboratoire.
Depuis sept ou huit ans, l'Agence s'est mise à opérer des contrôles de routine sur les génériques, quelle que soit leur origine. C'est le moyen de détecter d'éventuels défauts de qualité sur ces produits.

Comment l'AFSSAPS travaille-t-elle avec les centres de pharmacovigilance ? Les pharmaciens sont amenés à participer à des recueils de données. Comment l'Agence procède-t-elle pour les recueillir et les traiter ?
Que pense l'Agence des ventes par Internet de médicaments soumis à AMM, au sens français ?

Les taxes que perçoit l'AFSSAPS constituent une part importante de ses ressources. Quelles sont vos propositions pour assurer une meilleure cohérence du financement avec les objectifs que poursuit l'Agence ? Ne faudrait-il pas simplifier le dispositif, qui est assez complexe ? Enfin, comment simplifier et améliorer le système de recouvrement de ces taxes, lequel représente une charge pour l'Agence ?
L'AFSSAPS a tenu une conférence de presse au mois de mai dernier, avec M. Jean Parrot, le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, sur la contrefaçon, qui n'est plus un phénomène réservé aux pays en voie développement. À cette occasion, il a été rappelé que la loi française ne permettait pas de réguler la vente des médicaments sur Internet. Le droit européen est un peu plus nuancé en la matière. En conséquence, on ne peut pas garantir la qualité des médicaments vendus par Internet. Il ne faut donc pas aller sur Internet pour acheter des médicaments.
Malgré tout, Internet est très présent aujourd'hui. Certaines personnes ont même pris l'habitude d'acheter certains types de médicaments, par des filières qui ne sont contrôlées qu'épisodiquement par des sondages, au coup par coup. Il y a donc lieu de s'interroger sur la législation en la matière.

On peut se demander si une simple mesure législative serait suffisante pour encadrer la vente des médicaments sur Internet. J'invite l'AFSSAPS à transmettre à la MECCS d'éventuelles suggestions, qui pourraient, le cas échéant, être intégrées, par voie d'amendement, dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Il faut aborder la question au niveau international et européen. On peut provoquer le débat au niveau européen sans même attendre une hypothétique régulation communautaire. Il conviendrait également de réfléchir à la manière d'organiser, sur le territoire français, la vente par Internet.
Trop souvent on s'adresse à des sites derrière lesquels il n'y a pas d'opérateurs pharmaceutiques sérieux, des sites dont les messages ne sont pas contrôlés, qui n'ont aucune accréditation et n'ont adhéré à aucune charte régissant la qualité de l'information délivrée au public. Certains pays voisins ont commencé à mettre en place des systèmes dans lesquels la vente sur Internet est possible, mais avec des opérateurs ayant pignon sur rue et répertoriés, offrant des garanties pharmaceutiques, dans des conditions de transparence et vérifiables par l'utilisateur. Une réflexion mériterait d'être lancée en ce sens.
Le système français de maillage territorial des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), qui n'est pas très répandu en Europe, suscite de l'intérêt lors des débats internationaux. Les collègues étrangers s'intéressent à l'articulation entre une autorité nationale publique jouant un rôle de coordination et de mise en oeuvre, l'AFSSAPS, et les centres régionaux qui constituent un appui. Ces centres de pharmacovigilance sont logés dans des CHU ; ainsi, les pharmacologues sont en relation avec les cliniciens. L'Agence a veillé, avec la direction des hôpitaux, à ce que, dans le cadre de la T2A, les missions des CRPV soient clairement identifiées comme des missions d'intérêt général.
Les CRPV sont assez fortement représentés au sein du comité technique de pharmacovigilance et de la commission de pharmocovigilance. On s'appuie en permanence sur eux. Par exemple, lorsqu'on met sur le marché un produit, on peut décider qu'en raison de certains risques identifiés lors des études cliniques, il faut mettre en place un plan de gestion des risques. Si, dans le cadre de ce plan, on prévoit un suivi renforcé de pharmacovigilance, on mandate généralement un centre régional qui deviendra pilote sur ce produit. Il sera chargé d'assurer la synthèse du suivi de tous les signalements qui remontent vers les centres, d'en faire rapport devant le comité technique de pharmacovigilance, puis devant la commission de pharmacovigilance, d'où l'importance de ce maillage et de ce travail avec les CRPV.
En ce qui concerne le financement de l'AFSSAPS, il y a fort à craindre d'un système de budgétisation totale de l'Agence, dans le contexte budgétaire d'aujourd'hui. Certes, le système actuel a des faiblesses. Une toute petite minorité de gens prétend que, parce que l'Agence collecterait elle-même des prélèvements obligatoires ayant pour la majorité la qualification de taxes fiscales prélevées par l'agent comptable d'un établissement public administratif national, au lieu de l'être par le receveur percepteur territorial, son financement deviendrait impur. Ce raisonnement est difficile à comprendre. En revanche, le système actuel comporte beaucoup d'avantages.
L'Agence dispose d'une ressource directement accessible ; c'est elle qui prélève les taxes pour le compte de l'État. Le taux de recouvrement des mandats émis est de 99,97 %, un quart de point supérieur au taux de recouvrement des impôts directs. De ce point de vue, le système est donc raisonnablement efficace.
Ensuite, il est beaucoup plus pratique que l'établissement public administratif perçoive directement, car l'assiette des prélèvements dépend de paramètres opérationnels liés aux AMM, par exemple la classification des AMM dont dispose l'Agence et dont ne disposerait pas un receveur. La vérification de ces paramètres en interne, au sein de l'établissement public, est donc très simple.
Enfin, personne n'a pu sérieusement soutenir que, sur la durée, le fait que trois quarts de ses ressources soient issues de prélèvements obligatoires sur les industries de santé – taxe sur le chiffre d'affaires perçue par l'établissement ou droits fixes perçus sur des dossiers – ait pu influencer significativement la ligne de santé publique de l'Agence. Je suis prêt à rendre compte du moindre des choix de l'Agence sur ce point-là, depuis mon arrivé à la direction de l'AFSSAPS, il y a quatre ans.
Le système de recouvrement fonctionne assez bien. Il est assez simple. Il a assuré, sur la durée, un financement correct des besoins d'exploitation et des besoins d'investissement de l'Agence. Or une agence des produits de santé ne doit pas être paupérisée. Elle doit pouvoir investir dans son système d'information, dans ses laboratoires.
Quand l'État a considéré qu'il y avait un fonds de roulement trop important, il en a repris l'essentiel, ce qui était normal. Quand les dépenses d'intérêt public sont inférieures aux ressources publiques affectées au fonctionnement de l'Agence, l'État peut les reprendre pour d'autres usages.
Il faut donc bien réfléchir avant de transformer ce système.

Vous validez donc le système en place. Nous vous remercions de transmettre à la MECSS toute information complémentaire ou suggestion de réforme et de bien vouloir répondre aux questions qui vous seront adressées par écrit à la suite de cette audition.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale a enfin procédé à l'audition de MM. Laurent Degos, président de la Haute Autorité de santé (HAS), François Romaneix, directeur, Gilles Bouvenot, membre du collège de la HAS et président de la commission de la transparence, et Étienne Caniard, membre du collège de la HAS et président de la commission qualité et diffusion de l'information médicale.

La MECSS s'intéresse à la politique du médicament dans le cadre de la maîtrise médicalisée des soins. Il serait donc intéressant que vous nous indiquiez quel est le périmètre d'action de la Haute Autorité de santé et quelles relations celle-ci entretient avec l'AFSSAPS.
La HAS est une autorité indépendante – ce qui implique de se plier aux règles de la transparence, sur le plan tant des résultats que des méthodes, le médicament étant au centre de tous les acteurs de la santé –, dont le caractère scientifique signifie, ce qui fait sa force, qu'elle ne travaille pas dans l'arbitraire, mais sur des bases scientifiques, conformément aux méthodes de l'evidence based medecine, c'est-à-dire la médecine par la preuve. Afin de renforcer cette indépendance, outre le fait qu'un guide de gestion des conflits d'intérêt existe, les déclarations de conflit d'intérêt, de la part aussi bien des experts, des membres du collège que des responsables de la HAS, sont rendues publiques, et un groupe extérieur, présidé par M. Vigouroux, conseiller d'État, intervient en matière de déontologie et de règlement de tels conflits.
Le périmètre d'action de la Haute Autorité comporte trois grands domaines.
Tout d'abord, l'évaluation des technologies de santé, ce qui consiste à évaluer les médicaments, les dispositifs et les actes, dans le dessein d'aider le décideur – dans le cadre du service médical rendu et de l'amélioration de celui-ci – ainsi que les professionnels – dans le cadre du bon usage ;
Ensuite, les recommandations de bonne pratique médicale en matière de santé publique et de sécurité des soins ;
Enfin, l'action, puisque la HAS dispose des moyens de certifier à la fois les établissements hospitaliers et, par le biais de l'évaluation des pratiques professionnelles, tous les médecins, et qu'elle joue également un rôle en matière de prise en charge des maladies chroniques et de certification de l'information, laquelle va jusqu'à la certification de la visite médicale, ce que la France est seule à pratiquer.
Dans cet esprit, quatre objectifs guident la Haute Autorité.
Le premier est celui de la transversalité, c'est-à-dire le souci d'une vision globale du médicament au sein de la stratégie médicale, ce qui permet de préconiser des recommandations, et, en matière d'action, d'intervenir au niveau de la pratique professionnelle, de l'information et de la prise en charge à 100 %. La vision globale permet ainsi de mettre en lumière certains problèmes, par exemple le fait qu'un médicament aux effets modestes, mais au service médical rendu (SMR) suffisant, entrant dans une médication d'affection de longue durée (ALD), soit automatiquement pris en charge à 100 %.
Le deuxième objectif tient à une approche plus globale de la qualité, qui permet de replacer le médicament dans son contexte organisationnel et économique, sans oublier l'aspect sécurité des soins. Outre le fait que l'aspect médico-économique ne rencontre plus d'obstacles d'ordre culturel de la part des médecins, l'appréciation du coût du médicament peut répondre à différents critères : une approche coûtutilité comme en Grande-Bretagne – combien d'années de vie difficiles le patient est-il prêt à sacrifier pour une année de vie en bonne santé ? – ; une approche subjective – combien le patient est-il prêt à payer pour que le médicament soit pris en charge ? – ; ou une approche nouvelle coûtefficacité, telle celle sur laquelle les Allemands travaillent, mais à condition de l'aborder de manière séquentielle, c'est-à-dire en examinant d'abord l'aspect médical et, ensuite seulement, l'aspect économique.
Le troisième objectif porte sur l'évaluation continue. En France, dès que l'AFSSAPS autorise la mise sur le marché d'un médicament, la HAS détermine si celui-ci doit être ou non remboursé et à quel prix, alors qu'à l'étranger les listes ne sont pas positives, mais négatives – c'est-à-dire qu'après deux ou trois ans de vie, il peut être décidé que tel médicament n'est plus remboursé – et le prix d'un médicament y est d'emblée fixé par l'industriel. Encore faut-il, une fois la mise sur le marché intervenue, surveiller le médicament : tel est l'objet des études post-AMM.
Le quatrième objectif, enfin, a trait au bon usage du médicament, ce qui oblige la HAS à être lisible – par le biais d'édition de fiches courtes et très simples – et visible – en faisant connaître son action dans différents organes de presse –, effort de lisibilité et de visibilité auquel la Cour des comptes a rendu hommage. Dans le même esprit, il revient à la Haute Autorité de changer la culture des médecins dans leur pratique, et de réfléchir aux moyens de permettre une appropriation par tous les acteurs. C'est sur la base de l'avis de tous les professionnels que, par exemple, un plan d'action en matière de psychotropes, qui sera conduit par la direction générale de la santé, a été défini.
La HAS, contrairement à l'AFSSAPS, a une vision globale du médicament. Elle peut donc procéder à une comparaison entre le médicament et les autres méthodes thérapeutiques – chirurgie, radiothérapie, etc. – et elle est consubstantielle à la solidarité, en ce sens qu'elle décide, face à un produit mis sur le marché national, s'il doit ou non être remboursé – travail qui, aux États-Unis, est effectué par les assurances. En revanche, il y a chevauchement pour tout ce qui concerne le bon usage et la pratique.

Quand la HAS, associée à l'AFSSAPS, pourra-t-elle fournir un guide informatique opérationnel tant au prescripteur qu'à l'assuré ?
La certification des logiciels d'aide à la prescription suit la même démarche que toutes les missions sur le médicament lancées par la HAS, à savoir être à l'écoute des besoins des prescripteurs – faire en sorte, par exemple, que l'ergonomie corresponde à la pratique des médecins.
L'étude des trois bases de données existantes – la mission donnée par la loi à l'AFSSAPS de constituer une base de données n'ayant jamais pu être totalement remplie – a montré qu'à quelques ajustements près elles répondent aux caractéristiques, notamment d'exhaustivité et de rapidité de mise à jour, que la HAS attend des logiciels d'aide à la prescription. L'action de la Haute Autorité a simplement consisté à publier une charte de qualité, au début du mois de septembre dernier. Ainsi, un logiciel ne sera certifié que s'il a été fait appel à une base de données médicamenteuses dont les éditeurs auront signé la charte.
Reste à savoir si l'utilisation d'un logiciel certifié modifiera réellement les pratiques et si les médecins seront suffisamment incités à utiliser un logiciel certifié plutôt qu'un logiciel non certifié. Ensuite, on pourra, le cas échéant, envisager d'instaurer une obligation de certification des logiciels.

Reste que, actuellement, la dimension médico-économique n'est pas prise en compte dans les logiciels d'aide à la prescription. Quand sera-t-il possible d'accéder aux fiches de transparence ?
Du fait de la demande pressante des ministres en charge de la santé, priorité a été donnée, à la fin des années 90, à la réévaluation des médicaments dits à SMR insuffisant, au détriment des réévaluations habituelles de classe. Comme il ne pouvait être question durant ces années de produire des fiches de transparence sur des produits qui pouvaient être déremboursés, ce n'est qu'une fois ce travail accompli, après que plus de 890 produits eurent été réévalués, que la HAS a pu reprendre son activité de réévaluation quinquennale des produits et de rappel pour réévaluation de classe, et donc d'édition de fiches de transparence.
Cependant, si les fiches de transparence apportent des informations, il n'est pas sûr qu'elles soient lues. C'est pourquoi l'accent a été mis, à la demande du Parlement, de la Cour des comptes et de l'IGAS, sur les fiches « bon usage du médicament ». La philosophie de la HAS n'étant pas de se contenter de lancer des actions, mais également de mesurer leur impact, les dix premières fiches publiées en 2007 – leur nombre devrait atteindre quinze par an –, feront l'objet d'une telle mesure d'impact, sans que cela se fasse au détriment de la production des fiches de transparence – celle sur les médicaments de la maladie d'Alzheimer est prête –, qui restent au coeur de la mission de la Haute Autorité, laquelle est de situer le médicament dans le cadre d'une stratégie globale de prise en charge.
En tout cas, à chaque fois qu'une dérive de prescription d'un médicament ou un risque de mésusage est possible, ou encore qu'un médicament est capable de modifier de façon très sensible l'organisation du système de soins, tels les nouveaux traitements de la polyarthrite qui ont fait exploser le nombre de séances en hôpital de jour, une fiche de bon usage sera éditée.

On estime que 12,5 % de la population française consomment 47 à 48 % des dépenses d'assurance maladie. Avez-vous publié des fiches de bon usage des médicaments pour le traitement des maladies chroniques ?
Au mois de juin 2007, 62 % des ALD étaient couvertes et 76 %, cancer inclus, par des fiches de bon usage. Le pourcentage de 100 % sera atteint, avec l'aide de l'INca, fin 2008.
La réflexion de la Haute Autorité de santé repose toujours sur l'étude des besoins des professionnels et des patients. À côté de la fiche de bon usage, de la fiche de transparence et des guides pour le médecin et pour le patient, existent également les fiches synthétiques qui préconisent des recommandations. Par exemple, si elles décrivent, pour l'hypertension, tous les moyens thérapeutiques existants, elles recommandent de commencer par les thiazides, qui coûtent moins cher. Cette action reste cependant discrète, faute pour la HAS d'avoir, jusqu'à maintenant, une compétence médico-économique.
L'enjeu est moins de disposer de fiches exhaustives que d'offrir un outil qui permette au médecin de s'approprier celles-ci dans sa pratique quotidienne. Plutôt que de donner une date à laquelle l'ensemble du champ sera couvert, mieux vaudrait parler de date à laquelle seront mis à disposition les outils permettant au médecin une approche globale.

Estimez-vous souhaitable de rendre obligatoire la certification des logiciels d'aide à la prescription et faudrait-il prévoir, dans cette hypothèse, une disposition réglementaire ou législative ?
La loi du 13 août 2004 oblige, selon son interprétation actuelle, à mettre en place une procédure de certification, non à utiliser des logiciels certifiés. Dans ces conditions si le dispositif qui sera mis en place dans les prochaines années fonctionne, c'est-à-dire si une vraie discrimination dans l'utilisation des logiciels intervient et si le marché suit, l'obligation de certification ne sera pas nécessaire. Dans le cas contraire, il faudra passer à la seconde étape.

Étant rappelé que les travaux de la MECSS visent à prendre en compte les enjeux financiers mais aussi les préoccupations de santé publique, il serait intéressant de savoir si des fiches de transparence relatives aux médicaments non remboursés sont également éditées par la HAS ou par d'autres instances.
La compétence de la Haute Autorité est limitée aux médicaments remboursés. L'évaluation des médicaments non remboursés manque à l'heure actuelle. La HAS, par exemple, ne peut être impliquée en matière d'automédication, faute de lien avec un quelconque remboursement.

Avez-vous mené des études comparatives sur la prescription de médicaments en France et dans les autres pays européens. Des liens ont-ils été tissés avec des instances étrangères ? A-t-on pu établir une corrélation entre le rôle que jouent les laboratoires pharmaceutiques dans la vie médicale – lesquels dépensent en France, en dépenses de promotion, 8 500 euros par médecin – et la surconsommation médicamenteuse, apparemment propre à notre pays ?
Tisser des liens avec des organismes similaires à la HAS a été mon tout premier souci. Les liens avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont été ainsi étendus au Danemark et à l'Irlande. Il vaut mieux, en effet, lutter à plusieurs que tout seul, ne serait-ce justement que vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique dont la pression se fait sentir tant dans le domaine de la visite médicale que dans celui de la régulation européenne. Celle-ci est en effet soumise à un point tel à l'influence de l'industrie que le guide diabète, par exemple, que Bruxelles voulait imposer a été rejeté par la Haute Autorité qui refuse une telle déviation de la vision des problèmes.
a fait remarquer que si le volume global des dépenses de promotion du médicament est comparable entre les différents pays, la part de la visite médicale dans le total est, en revanche, beaucoup plus élevée en France. Elle y représente en effet 75 % des dépenses promotionnelles contre 68 à 70 % en Europe et 57 ou 58 % aux États-Unis, les différences de stratégie de communication s'expliquant tant par la faiblesse de contre-pouvoirs à la visite médicale que par les spécificités culturelles de chacun des pays.

Je vous remercie pour ces précisions et vous demande de faire parvenir à la Mission toute suggestion ainsi que de répondre aux questions complémentaires qui vous seront adressées par écrit.