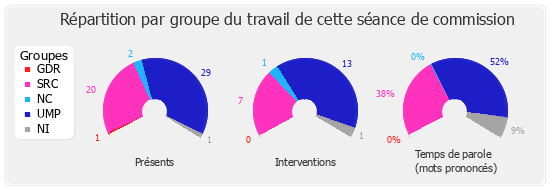Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république
Séance du 22 février 2012 à 10h00
La séance
La séance est ouverte à 10 heures.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
La Commission examine tout d'abord, en lecture définitive, sur le rapport de M. Philippe Goujon, la proposition de loi relative à la protection de l'identité (n° 4143 ; n° 4393).

Sur cette proposition de loi relative à la protection de l'identité, nous voici parvenus à l'étape ultime de la discussion. Je souhaiterais que, conformément aux positions précédemment prises par notre Commission, ce soit le texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale que nous reprenions en vue de sa lecture définitive.

Je rappellerai, quant à moi, au nom du groupe SRC, les fortes réticences que nous inspire ce texte.
D'abord, il ne correspond plus à l'objectif initial de la proposition déposée au Sénat, qui était de lutter contre l'usurpation d'identité. Vous avez en effet ouvert la possibilité de recourir à un fichier créé pour des enquêtes ne présentant pas forcément de lien avec cet objet – je pense notamment à un amendement que vous avez déposé lors de la précédente lecture, monsieur le rapporteur, autorisant l'utilisation de cette base de données pour l'identification d'un cadavre à partir de ses empreintes digitales. Je ne dis pas que la cause n'est pas louable, mais nous sommes loin de la lutte contre l'usurpation d'identité !
Ce faisant, vous tendez à élargir, de façon lente mais continue, l'utilisation de ce fichier central biométrique – lequel va concerner l'ensemble de la population française.
En outre, notre pays se singulariserait en Europe s'il se dotait d'un tel fichier. Si cela n'est pas en soi infamant, aucune démocratie occidentale ne l'a fait, a fortiori en retenant la technique des bases biométriques dites à « lien fort », associant une identité à une empreinte donnée. Récemment, les Pays-Bas, qui avaient un fichier de moindre importance pour les passeports biométriques, ont d'ailleurs décidé d'effacer l'ensemble des six millions d'empreintes qui y étaient enregistrées, faute de garanties suffisantes.
Pourtant, vous vous apprêtez à adopter à nouveau ce texte et ce, en dépit de l'hostilité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En effet, si nous avons pu avoir un temps le sentiment que celle-ci n'était pas opposée à la création de ce fichier, sa présidente, Mme Isabelle Falque-Pierrotin, a dit il y a quelques jours devant le Sénat la vive inquiétude que suscitait chez elle une telle mesure.
Enfin, il est une question à laquelle ni le Gouvernement ni l'Assemblée nationale ne répondent, qui porte sur la possibilité, ouverte par voie d'amendement, aux services chargés de lutter contre le terrorisme, d'utiliser ce fichier en dehors de tout contrôle judiciaire. Mesurez-vous bien toute la portée de cette disposition ? Si oui, n'envisagez-vous pas de la revoir ?
En bref, le groupe SRC s'oppose à un texte qui va créer un fichier ayant vocation à recueillir la totalité des données biométriques de la population. Nous estimons que, si tel devait être le cas, il faudrait assortir la mesure de garanties techniques de protection, définitives et irréversibles. Or vous vous contentez de garanties juridiques, que nous ne trouvons pas suffisamment solides. C'est la raison pour laquelle nous voterons à nouveau contre ce texte.

On connaît bien les arguments qui viennent d'être développés, pour les avoir déjà entendus lors des quatre examens précédents par notre assemblée.
Je le redis : je propose de reprendre le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et non celui élaboré par la commission mixte paritaire – je ne rappellerai pas dans quelles conditions une majorité de circonstance a cru devoir, au sein de cette commission mixte paritaire, adopter une version qui n'avait pas fait l'objet d'un compromis, alors que le principe des commissions mixtes paritaires est d'essayer, au contraire, de rapprocher les points de vue ! Outre que la commission mixte paritaire n'a pas permis un tel rapprochement – bien au contraire –, elle n'a été suivie d'aucune avancée de la part de la majorité du Sénat alors que la majorité de l'Assemblée nationale avait fait, elle, d'importantes concessions, comme l'ont d'ailleurs reconnu le président et le rapporteur de la commission des Lois de la Haute assemblée
Plusieurs députés du groupe SRC. Vous pouvez faire encore un effort !

Non, parce que la majorité sénatoriale et vous-mêmes voudriez supprimer le « lien fort », alors qu'il constitue l'un des points essentiels du texte ! Certes, la technique du « lien faible » – associant à une empreinte donnée un ensemble d'identités – permet de reconnaître une usurpation d'identité, mais en aucune façon d'identifier l'usurpateur !
Concernant cet article 5 qui reste seul en discussion, les garanties offertes sont nombreuses : si nous avons rétabli le « lien fort » supprimé par le Sénat, nous l'avons assorti de garanties juridiques en plaçant la consultation du fichier biométrique sous le contrôle d'un magistrat et en limitant la consultation judiciaire de la base centrale aux cas d'infractions relatives à l'usurpation de l'identité et, à la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, aux recherches de corps de victimes de catastrophes collectives ou naturelles – cela en respectant les recommandations de la CNIL et du Conseil d'État. Quant au nombre d'empreintes individuelles enregistrées dans la base, nous sommes passés de huit à deux. Nous avons de plus formellement interdit l'utilisation des procédés de reconnaissance faciale. Nous sommes donc allés aussi loin qu'il était possible d'aller sans altérer l'efficacité du dispositif retenu – lequel doit permettre de rechercher les usurpateurs d'identité dont sont victimes des dizaines de milliers de nos concitoyens.
Je rappelle enfin que la CNIL estime que l'introduction dans les titres d'identité et de voyage d'un composant électronique comportant des données biométriques est proportionnée à l'objectif du texte. Deuxièmement, elle admet que le traitement sous une forme automatisée et centralisée de ces données peut être autorisé à condition que des exigences en matière de sécurité ou d'ordre public le justifient. Or personne ne nie l'intérêt de dispositions protectrices de l'identité de nos concitoyens.
Suivant la proposition de son rapporteur, selon laquelle l'Assemblée doit examiner le dernier texte voté par elle et non celui établi par la commission mixte paritaire, la Commission adopte la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
M. Sébastien Huyghe, vice-président de la Commission, remplace le président Jean-Luc Warsmann à la présidence de la séance.
Présidence de M. Sébastien Huyghe, vice- président.
La Commission examine, en lecture définitive, sur le rapport de M. le Président Jean-Luc Warsmann, suppléant M. Étienne Blanc, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (n° 4397).

Je voudrais tout d'abord excuser M. Étienne Blanc, qui m'a demandé de le suppléer.
Une nouvelle fois, le Sénat a refusé de s'associer à la démarche de simplification du droit.
Plutôt que de contribuer à enrichir la présente proposition de loi en l'amendant, la majorité sénatoriale a choisi, en nouvelle lecture, d'adopter la question préalable présentée en séance publique par M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des Lois, et de rejeter ainsi le texte dans son ensemble sans l'examiner.
Dans le rapport qu'il a produit pour l'examen du texte en nouvelle lecture, M. Jean-Pierre Michel se contente de réitérer de façon peu persuasive les critiques incohérentes et infondées qui avaient été émises par certains de nos collègues sénateurs au stade de la première lecture, sans apporter de réponse constructive aux objections que notre collègue Étienne Blanc avait soulevées dans son rapport de janvier dernier.
Lors de l'examen en commission, le 15 février dernier, le président de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Pierre Sueur, a lui-même reconnu qu'il aurait « eu plaisir à discuter de certains articles » pour « supprimer certaines mesures et en ajouter d'autres ». Mais le Sénat a préféré couper court à la discussion en rejetant le texte.
La majorité sénatoriale n'ayant pu venir à bout de ses propres contradictions, nous ne pouvons que faire usage du dernier mot que le Gouvernement a souhaité donner à l'Assemblée nationale, conformément au dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, pour surmonter le désaccord entre les deux assemblées. Je vous propose donc que nous adoptions le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Je concentrerai mon propos sur l'article 40 de ce texte, qui pose une question politique majeure.
Cet article dispose que « la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine (…) par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail ». Cette rédaction, a priori anodine, recouvre en réalité une modification profonde des principes et du fonctionnement des relations sociales dans l'entreprise. On a là, non une simplification du droit, mais un antidote à une décision de la Cour de cassation, qui a appliqué encore récemment le principe général selon lequel, lorsqu'un accord collectif est signé, il doit être suivi de l'accord individuel du salarié, dans la mesure où des décisions collectives peuvent être incompatibles avec son mode de vie.
Chacun peut comprendre en effet qu'une extension des horaires d'ouverture d'une entreprise peut être inconciliable avec le mode de garde des enfants ou avec les modes de transport.
Nous avions soulevé ce problème dès l'origine. Le plus singulier est que cette disposition répond en fait à la question juridique de la portée des accords de compétitivité-emploi que le Président de la République appelle de ses voeux et qui ont fait l'objet d'une lettre aux partenaires sociaux – lesquels ont engagé des négociations la semaine dernière sur ce point.
Au stade de la nouvelle lecture du texte par notre Assemblée, je vous avais déjà indiqué qu'au-delà de la question juridique, cette disposition posait une question politique majeure, qui allait entraîner des réactions. Même si elle était au départ passée inaperçue, elle constituait en effet une sorte de provocation vis-à-vis des partenaires sociaux, qui ne pouvaient que constater qu'on les mettait devant le fait accompli avant même que la négociation ne s'engage. Vous ne pouvez ignorer que, depuis, l'ensemble des organisations syndicales ont découvert ce texte et que des lettres ont été adressées au Premier ministre par au moins deux secrétaires généraux de grandes organisations syndicales françaises, pour dire qu'il n'était pas normal de traiter ainsi les partenaires sociaux.
Nous partageons tout à fait cet avis. Non seulement nous désapprouvons sur le fond cet article, mais nous pensons qu'il constitue une erreur politique en raison de la nature des négociations engagées et dans la mesure où il donne à la proposition de loi une coloration politique qu'elle n'avait pas au départ.
Telle est la principale raison de notre opposition à ce texte.

Ma position sur ce texte demeure celle que j'ai exposée en séance publique, particulièrement s'agissant de l'article 59.

Concernant l'article 40, je souhaiterais apporter plusieurs éléments de réponse.
Premièrement, cet article est sans rapport avec la conclusion d'accords de compétitivité et avec les négociations ouvertes à ce sujet. J'en veux pour preuve le fait que cette disposition figurait dans le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dès juillet 2011 alors que l'initiative prise par le Président de la République ne remonte qu'à quelques semaines. Elle ne résulte donc d'aucun ajout auquel on aurait procédé ou d'aucun amendement voté au cours de la navette parlementaire. De plus, elle n'empiète pas sur les négociations que les partenaires sociaux ont entreprises puisque les accords de modulation du temps de travail ne portent que sur la répartition des heures travaillées sur une période donnée et sont, par conséquent, sans lien avec les conditions de rémunération.
J'ajoute que l'un des dirigeants nationaux d'un syndicat que j'ai eu au téléphone cet automne – au moment où nous examinions le texte en première lecture – n'a, à aucun moment, parmi les observations dont il souhaitait me faire part, abordé la question de l'article 40.
Deuxièmement, cet article n'introduit aucune disposition nouvelle. Il clarifie un point de droit : il ne fait que rétablir le droit tel que le législateur l'a souhaité en votant la loi du 20 août 2008, en l'occurrence l'article L. 3122-2 du code du travail, sur lequel il y avait une divergence d'appréciation à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010.
Enfin et surtout, cette disposition tend à défendre les droits des salariés, et non à les remettre en cause ! Il ne s'agit pas d'accorder à l'employeur un pouvoir unilatéral de modifier les horaires de travail mais de permettre à un accord négocié entre les partenaires sociaux de le prévoir, les représentants du personnel étant précisément là pour défendre les intérêts des salariés. C'est pourquoi je pense que cette possibilité, que nous confirmons, selon laquelle de tels accords négociés par les partenaires sociaux pourront prévoir des modulations d'horaires – à la condition évidemment de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la vie du salarié ni à l'équilibre du contrat de travail – est quelque chose d'extrêmement positif.
Pour le reste, le président de l'Assemblée nationale m'a transmis la copie de lettres de deux dirigeants syndicaux disant qu'ils auraient préféré que cet article n'existe pas, compte tenu des nouvelles négociations qui venaient d'être engagées.
Mais, au stade du débat auquel nous étions, il n'y avait qu'une possibilité : que le Sénat adopte le texte de la proposition de loi en votant en séance publique un amendement supprimant l'article 40. J'ai répondu par écrit à ces deux dirigeants syndicaux que, tout en maintenant ma position sur le fond – et je pense que c'est une bonne chose, qu'il fallait rétablir le droit – si le Sénat procédait à cette suppression, je proposerais à l'Assemblée de l'accepter.
Or le Sénat n'a pas cru bon d'agir ainsi, c'est dire si la gauche n'y voit pas un point fondamental ! Nous ne pouvons donc aujourd'hui, à ce stade de la procédure parlementaire, que confirmer le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sans y apporter le moindre amendement. Cela étant, j'ai pris l'engagement auprès des partenaires sociaux que, s'ils aboutissaient à un accord revenant à modifier la rédaction de l'article 40, nous nous rangerions à leur position, par respect pour ces négociations.
Mais, en l'état actuel des choses, pour toutes les raisons qui ont présidé à la rédaction initiale de cet article, auquel le Conseil d'État a donné un avis favorable, je vous propose de voter cette proposition de loi dans la version adoptée par l'Assemblée en nouvelle lecture.

Il est vrai que l'article 40 n'avait au départ aucun lien fonctionnel avec la négociation qui a suivi mais, d'un point de vue idéologique, il a certainement joué un rôle précurseur !
Je vous remercie, monsieur le rapporteur suppléant, pour votre intéressante démonstration : après avoir expliqué que cette disposition n'a rien à voir avec la négociation en cours, vous en venez à conclure que, comme celle-ci porte sur le même sujet, si elle aboutissait, nous changerions le texte ! C'est précisément ce que je souhaitais vous entendre dire !
Il est déraisonnable de maintenir ce texte en l'état. On peut avoir une appréciation différente sur ce que disent les responsables syndicaux, mais je ne crois pas que l'Assemblée ait pour rôle de perturber une négociation de cette importance. Ce que, nous, nous ne pouvons faire compte tenu de la procédure parlementaire, le Gouvernement ne peut-il le décider en déposant un amendement de suppression ?

Il n'y a que le Sénat qui aurait pu le faire en nouvelle lecture ! Monsieur Vidalies, d'abord, il ne s'agit pas d'idéologie, mais de permettre une modulation des horaires par un accord négocié dans une entreprise avec les représentants du personnel ! Préféreriez-vous que cela relève d'une décision unilatérale du chef d'entreprise ? N'est-ce pas plutôt un progrès que cela se fasse avec l'accord des représentants des salariés. Ce n'est nullement une question d'idéologie mais une question très pragmatique pour le fonctionnement de nos entreprises.
Deuxièmement, cet article n'entre pas dans le champ de la négociation qui s'est ouvert, puisqu'il ne comporte pas de lien avec les rémunérations. À cet égard, je vous remercie de reconnaître qu'il est bien antérieur à cette négociation – et qu'il n'a donc aucun rapport avec elle !
Enfin, je rappelle qu'à ce stade, le Gouvernement – pas plus que les députés – ne peut déposer aucun amendement, le Sénat ayant rejeté le texte en nouvelle lecture : il revenait donc au Sénat, s'il estimait qu'il s'agissait d'un point important, de faire son travail et de voter le texte en supprimant cet article, auquel cas nous aurions pu reprendre son amendement de suppression.
Cette disposition est, encore une fois, une mesure de clarification. Par la suite, si les partenaires sociaux parvenaient à un accord, nous aviserions et débattrions le cas échéant des dispositions législatives auxquelles il pourrait donner lieu.

Je rappelle les termes du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution : lorsque, après l'échec d'une commission mixte paritaire et une nouvelle lecture dans chaque chambre, le Gouvernement demande à l'Assemblée de statuer définitivement, « l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. »
La Commission adopte la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le président Jean-Luc Warsmann reprend la présidence de la séance.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.
Enfin, la Commission examine, en première lecture, sur le rapport de M. Jean-Paul Garraud, la proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants (n° 4168).

Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi, que j'ai déposée avec un certain nombre de collègues – nous sommes aujourd'hui environ 140 à l'avoir cosignée – et dont l'objet est double puisqu'il s'agit d'adapter la réponse pénale aux actes commis par les délinquants de nationalité étrangère, d'une part, et par les auteurs d'infractions multiples, d'autre part.
Je commencerai par les dispositions concernant les réitérants, à distinguer des récidivistes.
Les articles 2 et 3 de la proposition reposent sur un constat simple : en 2009, 38 % des condamnés pour délit avaient déjà été condamnés définitivement par le passé et se trouvaient soit en situation de récidive – c'était le cas de 10 % –, soit en situation de réitération – pour les 28 % restants. En outre, les auteurs de crimes ont fréquemment déjà été condamnés pour des délits d'une nature similaire : les auteurs de vols criminels sont près de 60 % à avoir déjà été condamnés pour une atteinte aux biens, les auteurs d'homicide ou de violences criminelles 18,2 % à avoir déjà commis des délits violents, et les auteurs de viol 12,4 % à avoir été condamnés précédemment pour une agression sexuelle.
Or, si notre droit appréhende désormais correctement, depuis la loi du 10 août 2007, la situation particulière des récidivistes – soumis au doublement de la peine maximale et à des peines minimales d'emprisonnement –, la situation des réitérants n'est, quant à elle, pas suffisamment prise en compte par notre droit pénal.
Les réitérants sont définis, depuis la loi du 12 décembre 2005, comme des personnes déjà condamnées définitivement pour un crime ou un délit, qui en commettent un autre sans être en état de récidive légale – bien qu'ils soient considérés comme des « récidivistes » selon l'acception commune du terme. Cette situation de réitération a pour seule conséquence juridique d'empêcher la confusion des peines prononcées.
Cet effet, fort insuffisant, semble peu à même de dissuader les personnes déjà condamnées de commettre de nouvelles infractions, y compris des infractions plus graves. Ainsi l'auteur d'une agression sexuelle délictuelle pour laquelle il a été condamné définitivement ne risque aucune aggravation de sa peine s'il commet ensuite un viol, malgré l'avertissement solennel que lui avait adressé la justice. On se trouve ainsi confronté à des cas curieux, où un individu réitérant des faits de même nature ne peut être juridiquement considéré comme un récidiviste et n'encourt donc pas de peine plancher : par exemple, l'auteur d'un vol avec violence, passible d'une peine de sept ans d'emprisonnement au plus, qui commettrait ensuite un vol criminel n'est pas en état de récidive légale.
Pour remédier à cette situation, la présente proposition de loi vise à instaurer des peines minimales pour les personnes commettant un crime ou un délit en situation de réitération, suivant un mécanisme calqué sur le système des peines planchers introduit en 2007 pour les récidivistes : les différents seuils de peines minimales sont compris entre un cinquième et un sixième de la peine maximale encourue, soit l'équivalent de ce qui a été retenu pour les cas de récidive – compte tenu du doublement de la peine maximale encourue – ou pour les cas de violences aggravées. Le principe constitutionnel de nécessité des peines est ainsi respecté.
Les articles 2 et 3 respectent en outre le principe d'individualisation des peines, puisqu'ils prévoient la possibilité pour la juridiction saisie de déroger à la peine minimale, à condition, en matière correctionnelle, qu'elle le fasse par une décision spécialement motivée. Je réfute ainsi préventivement toute accusation d'instauration de peines planchers automatiques.
Le dispositif proposé permet en définitive d'adapter la réponse pénale aux personnes qui font le choix de défier sciemment les règles de vie en société en commettant des infractions répétées, même si elles ne remplissent pas les strictes conditions de la récidive légale.
J'en viens maintenant au deuxième volet de la proposition de loi, qui concerne les délinquants de nationalité étrangère et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français (ITF).
Lorsqu'un individu commet un crime ou un délit, le fait qu'il soit étranger le place dans une situation particulière, dont la loi pénale et la justice doivent tenir compte. Ce fait a toujours été admis : la peine d'ITF existe depuis 1970 et n'a jamais été supprimée, même par la gauche.
L'article 1er de la proposition de loi se fonde sur deux constats indiscutables.
Premièrement, les statistiques judiciaires et policières mettent en évidence une très forte surreprésentation des étrangers parmi les délinquants : les personnes de nationalité étrangère représentent 5,8 % de la population vivant en France, mais entre 12 et 13 % des personnes condamnées pour crimes et délits. En outre, les étrangers sont particulièrement impliqués dans certains types de délinquance, en particulier les vols avec violence et les vols avec effraction. Enfin, les infractions commises par les ressortissants de certains pays sont en forte hausse au cours de la période récente : entre 2008 et 2010, le nombre de vols commis par des ressortissants roumains et par des ressortissants d'États de l'ex-Yougoslavie a respectivement augmenté de 50 % et de 60 %.
Deuxièmement, le nombre de peines ITF prononcées est très faible, par rapport au nombre total d'infractions commises par des étrangers et au nombre de condamnations pour des infractions pour lesquelles l'ITF était encourue ; en 2010 par exemple, 3 750 peines d'ITF ont été prononcées, alors que cette peine était encourue pour 13 500 condamnations, soit un taux de prononcé de 28 % seulement. Sachant que ce taux était de 49 % en 2003, on peut dire que la peine d'ITF est de moins en moins effective.
Cela résulte à l'évidence de la réforme de l'ITF intervenue en 2003, qui visait à prendre en considération les situations particulières d'étrangers condamnés à une mesure d'éloignement malgré les forts liens qu'ils avaient tissés avec la France, en particulier lorsqu'ils étaient parents d'enfants français. Cette réforme a abouti à empêcher le prononcé de l'ITF dans certains cas d'infractions graves.
La présente proposition de loi, si elle ne remet pas en cause les acquis de la réforme de 2003, tend à renforcer l'effectivité de la peine d'ITF, en prévoyant qu'elle devra être obligatoirement prononcée, pour une durée variant en fonction de la gravité de l'infraction, pour les crimes ou délits punis d'un certain quantum d'emprisonnement ; la proposition de loi initiale avait fixé ce dernier à trois ans au moins, mais je présenterai un amendement visant à porter ce seuil à cinq ans.
Là encore, conformément au principe d'individualisation des peines, la juridiction aura la possibilité d'écarter totalement l'ITF, à condition de motiver sa décision. L'objectif de la proposition de loi est d'obliger ainsi les magistrats à examiner l'éventualité d'une peine complémentaire d'éloignement du territoire, en fonction de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur. C'est la seule nouveauté introduite par un texte qui, par ailleurs, ne modifie en rien les régimes de protection, relative ou absolue, dont bénéficient certains étrangers en raison de leurs liens particuliers avec la France.
Ce texte s'inscrit donc dans la continuité des réformes de 1991 et de 2003, s'agissant de l'article 1er relatif à la peine d'ITF, et de la loi de 2007 sur la récidive, s'agissant des peines minimales prévues pour les réitérants. Il répond à la nécessité de mieux tenir compte des évolutions de la délinquance, dont une trop large part est aujourd'hui imputable aux étrangers et aux réitérants. Son objectif est d'adapter, dans le respect des principes constitutionnels, la réponse pénale à la situation de ces derniers. C'est pourquoi je vous invite à l'adopter.

Nous nous opposons vigoureusement à ce texte.
Tout d'abord, il sera examiné en séance publique le 1er mars et n'a donc aucune chance d'être adopté avant la fin de la législature. Que d'efforts pour rien !
Ensuite, pour apporter la preuve que la délinquance des étrangers a augmenté, l'exposé des motifs se réfère aux chiffres publiés dans son dernier rapport par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Or celui-ci avait indiqué que ces données devaient être interprétées avec prudence dans la mesure où elles reflètent également l'efficacité des services de police dans leur lutte contre certaines formes de délinquance ; par exemple, les arrestations de voleurs à la tire sont relativement fréquentes, ce qui peut avoir des conséquences sur la répartition en fonction des nationalités.
En réalité, ce texte n'a pas trait à la délinquance des étrangers en général, mais bien à celle de deux catégories particulières : les Roumains et les ressortissants de l'ex-Yougoslavie. S'agissant des premiers, leur délinquance est rapportée au nombre de Roms séjournant en France. Or la situation faite à ces derniers est absurde puisque, jusqu'au 1er janvier 2014, ils ont le droit de s'installer en France, mais pas d'y travailler ; la liste de 150 métiers qui leur étaient autorisés a été réduite à 75 et, pour travailler, ils doivent obtenir une autorisation et leur employeur doit s'acquitter d'une taxe. Quant aux mineurs isolés, la convention qui devait être passée avec la Roumanie a été annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle autorisait leur rapatriement sur la seule décision du procureur de la République. C'est à la Roumanie de les prendre en charge, mais cela suppose qu'un dispositif légal permette leur reconduction dans leur pays d'origine. Une fois encore, on ne dispose pas de l'outil nécessaire, et l'on attend du droit pénal qu'il règle des questions qui ne relèvent pas de sa compétence.
La délinquance itinérante est le fait de bandes qui réalisent des cambriolages « à la commande » ; or il n'y a eu aucun contact avec l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante pour connaître les besoins en la matière !
Par ailleurs, pour qu'une peine soit juste, il faut qu'elle soit nécessaire. Mais est-il vraiment nécessaire de prévoir une augmentation des peines et une peine plancher alors que l'échelle actuelle des peines permet de condamner en conséquence ceux qui l'ont déjà été ? Tous ceux qui ont fréquenté les tribunaux savent que les juges tiennent compte du casier judiciaire !
Je terminerai par deux questions techniques.
D'une part, il me semble qu'en matière criminelle, la notion de « réitération » est superfétatoire, dans la mesure où la récidive criminelle a une portée générale : de crime à crime, il y a nécessairement récidive – mais j'observe que vous avez déposé un amendement sur ce point.
Ensuite, vous ne rendez obligatoire le prononcé de la peine d'ITF que dans les articles généraux consacrés au sujet, et non dans ceux qui traitent des différentes catégories de délit, ce qui posera certainement des difficultés d'application. Par exemple, pour la plupart des cambriolages, qui ne sont punis d'une interdiction de séjour que lorsque la peine encourue est de dix ans, la disposition prévue ne pourra pas s'appliquer, contrairement à votre souhait !

Lundi soir, lorsque nous procédions en séance publique à la nouvelle lecture du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines, notre collègue Michel Hunault pensait qu'il s'agissait de la dernière occasion de traiter des questions de droit pénal durant la législature. Il avait tort : nous nous retrouvons, ce matin, sur le même sujet, avec le même rapporteur. Quelle constance, monsieur Garraud : les thèmes varient, mais pas vos idées.
Un journaliste a écrit qu'il s'agissait d'un sujet compliqué car, selon la thèse que l'on défend, on se voit accusé d'être soit un raciste pur et dur théorisant sur les prédispositions génétiques de la criminalité, soit un « bobo » bien pensant incapable d'accepter la réalité des chiffres. Je suggère que nous évitions ces postures caricaturales et que nous engagions un débat serein.
S'agissant des constats que vous prétendez indiscutables, votre initiative se fonde sur une augmentation des actes de délinquance commis par les ressortissants étrangers. Or, vous fondant sur le dernier rapport de l'ONDRP, vous entretenez la confusion entre les condamnations et les mises en cause. En effet, les chiffres de l'ONDRP ne concernent que ces dernières, qui, comme le précise le rapport, sont un concept statistique ne pouvant en aucun cas être confondu avec la notion de culpabilité. Être mis en cause ne veut pas dire être coupable : cela vaut aussi pour les étrangers !
L'ONDRP conclut par ailleurs son étude en estimant qu'il est impossible de déterminer dans quelle mesure la part des étrangers au sein des auteurs de vol a augmenté depuis 2008. Il déclare donc lui-même que ses chiffres ne doivent pas être considérés comme des certitudes.
Vous omettez aussi d'analyser en détail les chiffres de la Chancellerie, qui sont pourtant intéressants car ils portent, non sur les infractions constatées, mais sur les condamnations pénales prononcées par les autorités judiciaires – ce qui exclut les infractions concernant les sans-papiers, qui relèvent de la juridiction administrative. Surtout, ils prennent en considération un critère objectif, la nationalité, et non l'origine ethnique qui, chacun en conviendra, n'est pas un concept très rigoureux. Si vous n'utilisez pas ces chiffres, c'est parce qu'ils ne corroborent pas la vision apocalyptique que vous nous présentez : sur les trente dernières années, la part des étrangers condamnés par la justice, tous types de délits confondus, est restée stable, comprise entre 12 et 14 %. On est loin de la déclaration à l'emporte-pièce de Claude Guéant qui, sur RMC, le 10 janvier dernier, évoquait un taux de délinquance des étrangers deux à trois fois supérieur à « la moyenne » – à quelle moyenne faisait-il allusion, on l'ignore…
Vous l'avez reconnu, les délinquants « réitérants » sont une notion juridique récente, puisqu'elle date du 12 décembre 2005. Il s'agit d'une catégorie fourre-tout, créée pour contourner la notion de récidiviste que d'aucuns considéraient déjà, à l'époque, comme trop restrictive. Il convient donc de la manier avec la plus grande prudence.
Vous aviez tellement aimé les peines planchers en 2007 que vous les étendez aux réitérants ! Vous arguez de leur efficacité mais, à ma connaissance, celle-ci n'a été établie par aucune étude. Seul existe le rapport présenté le 9 décembre 2008 par nos collègues Guy Geoffroy et Christophe Caresche au nom de notre Commission, rapport qui restait extrêmement prudent sur ce point et même concluait à l'inadaptation du dispositif au regard de ses objectifs. Le fait est que la délinquance, notamment la plus violente, a continué à progresser en dépit de ces peines planchers, pourtant censées être dissuasives.
Pensez-vous vraiment que ce texte soit compatible avec les principes constitutionnels d'individualisation et de nécessité des peines ? Je rappelle que le Conseil constitutionnel avait été saisi de l'article 132-19-2 du code pénal, qui prévoit des peines planchers pour certaines violences, même lorsqu'elles sont commises hors état de récidive. Dans sa décision du 10 mars 2011, le Conseil a rappelé que sa fonction était de veiller à l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ; il n'a reconnu la conformité du dispositif à la Constitution que parce qu'il concernait des infractions d'une gravité particulière et spécialement désignées. Or le présent texte vise un large éventail d'infractions, qui ne sont caractérisées ni par l'état de récidive, ni par la moindre circonstance aggravante !

Cette proposition de loi s'apparente à un texte d'affichage, abondant dans le sens de l'actuel ministre de l'Intérieur, dont le propos est de stigmatiser une partie de la population qui vit sur notre territoire et, plus particulièrement, comme Dominique Raimbourg le soulignait, certaines catégories d'étrangers. Nous considérons que ce texte contribue à empoisonner le climat politique. Nous n'avons nul besoin de désigner des boucs émissaires alors que notre pays traverse une crise sans précédent, qui touche les plus vulnérables, qu'ils soient Français de souche, immigrés ou étrangers vivant sur notre territoire. Plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, nous devrions faire oeuvre de pacification.
Sur le fond, s'agissant du caractère obligatoire de l'ITF, je rappellerai que le Conseil constitutionnel a déjà censuré, en 1993, le prononcé automatique et indifférencié d'une sanction à caractère pénal, et que l'un des principes de notre droit est l'individualisation des peines et des sanctions. La gauche et les écologistes ont d'ailleurs pris l'engagement, si les Français choisissent l'alternance le 6 mai prochain, de revenir sur les lois relatives à la récidive et aux peines planchers, qui portent atteinte à ce principe.
Par ailleurs, en 2010, 1 693 ITF ont été prononcées par les tribunaux et 1 201 exécutées : la peine est donc presque systématiquement appliquée sur le terrain.
Ce texte est inutile. M. le rapporteur nous explique que, grâce à lui, le juge sera obligatoirement amené à se poser la question de la peine complémentaire d'interdiction du territoire en cas de crime ou de délit, mais il devrait savoir que tel est déjà le cas, puisque les procureurs la demandent quasi systématiquement dans leurs réquisitoires. De même, cette proposition de loi prétend renforcer l'effectivité de la peine, alors que celle-ci est déjà assurée : les préfectures, en coordination avec les greffes des établissements pénitentiaires, organisent les départs forcés depuis la prison.
Il s'agit, en outre, d'un retour à ce qu'on a appelé la « double peine ». D'ailleurs, certains collègues de la majorité ont déposé un amendement visant à supprimer l'article 1er, en rappelant ce qui avait été voulu par M. Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, en 2003. L'ITF existe depuis la loi sur les stupéfiants de 1970. Elle est aujourd'hui prévue pour plus de deux cents délits, qui relèvent d'une multitude de textes, qu'il s'agisse du code pénal, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du code du travail. Contrairement à ce que vous prétendez, ce texte revient sur les avancées de la réforme de 2003, car il prévoit une peine automatique pour les personnes étrangères, ce qui durcit de fait le dispositif initial – même si les protections prévues par les articles L. 131-30-1 et L. 131-30-2 du code pénal sont maintenues.
Vous estimez qu'au-delà de trois ans, un étranger en situation régulière peut avoir un certain nombre d'attaches privées et familiales en France. Or celles-ci s'évaluent en fonction de leur intensité, non de leur durée. Outre que ce délai de trois ans n'apparaît nulle part dans la jurisprudence française ou européenne, une personne venant sur le territoire français avec un visa, car mariée avec une ressortissante ou un ressortissant français, aura des attaches en France dès son arrivée ; une personne parente d'un enfant français aura des attaches en France dès la naissance de celui-ci ; une personne atteinte d'une pathologie grave pourra bénéficier d'un titre de séjour sans que la notion d'attache familiale soit un critère pour la délivrance de celui-ci. La loi actuelle prévoit que l'ITF implique la reconduite d'office et le retrait du titre de séjour, quels que soient la durée de validité de ce dernier et le temps passé en France. La nouvelle disposition n'a donc pas lieu d'être.
Enfin, la violation de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme sont autant d'autres motifs de rejet de cette proposition de loi.

Sur cette proposition de loi, à l'élaboration de laquelle Philippe Goujon et moi-même avons participé, notre collègue Urvoas a raison d'appeler à un débat serein, qui évite le double écueil de la stigmatisation et de l'angélisme.
La réitération est en jeu dans la plupart des phénomènes de délinquance : 19 000 personnes sont citées plus de cinquante fois dans le Système de traitement des infractions constatées (STIC), et 50 % des actes de délinquance sont commis par seulement 5 % des délinquants. Ce qui nous est ici proposé est donc tout à fait pertinent et vient heureusement compléter la grande avancée qu'a été la loi de 2007. Depuis que celle-ci a institué les peines planchers, 30 000 de ces peines ont été prononcées pour des cas de récidive légale. La LOPPSI (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) a étendu la mesure aux actes de violences commis avec circonstance aggravante et, si le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation à ce sujet, cette réserve ne s'applique pas à la présente proposition de loi.
La question de la délinquance d'origine étrangère soulève des débats passionnés. MM. Urvoas et Raimbourg ont tenté d'opposer les chiffres de l'ONDRP, qui concernent les personnes d'origine étrangère mises en cause dans des faits de délinquance, et les statistiques du ministère de la Justice, qui recensent les condamnations. Or ces données convergent sur un point : elles soulignent la surreprésentation des étrangers parmi les délinquants. En 2011, sur 600 000 condamnations, 73 000 ont frappé des étrangers qui, s'ils ne composent que 5 % de la population globale, constituent 13 % des délinquants et, selon l'ONDRP, 17 % des mis en cause pour atteinte aux biens.
Cette situation appelle des dispositions équilibrées, respectant les principes généraux du droit et de notre Constitution. Celles que nous proposons apporteront de vraies réponses à un problème qui ne cesse de s'aggraver.

Comment ne pas se réjouir que l'Assemblée adapte régulièrement le dispositif pénal à l'évolution de la délinquance, mesurée par les statistiques ? La répression de la réitération relève du plus simple bon sens : il faut frapper le noyau dur des délinquants, responsable de la plus grande partie des infractions pénales. La distinction entre réitération et récidive peut paraître floue, difficile à comprendre, voire aberrante à nos concitoyens. Ceux-ci ne comprennent pas toujours ces subtilités juridiques qui, parce qu'elles permettent à certains délinquants d'échapper à la justice, démotivent en outre les forces de police. Depuis leur instauration, les peines planchers ont fait leurs preuves. Il faut maintenant aller plus loin et, tout en respectant le principe d'individualisation des peines, frapper les réitérants. Dans Paris intra muros, on en compte plus d'un millier qui ont commis chacun cinquante à cent faits délictueux !
Ne nions pas non plus la surreprésentation des étrangers parmi les délinquants. Nos valeurs d'hospitalité, d'accueil et de générosité n'autorisent pas ceux qui séjournent en France depuis moins de trois ans à commettre des infractions. Si l'on s'en rapporte au STIC, le nombre d'étrangers mis en cause a augmenté de 40 % entre 2008 et 2010 et, en 2011, une personne écrouée sur six était également de nationalité étrangère.
La délinquance roumaine est particulièrement développée, surtout à Paris. Selon l'ONDRP, le nombre de mis en cause roumains en zone de police a augmenté de 65 % depuis 2008. À Paris, 8 245 ressortissants de ce pays, dont la moitié seulement étaient majeurs, ont été arrêtés en 2011, ce qui représente une hausse de 78 %. En un an, le nombre de mineurs arrêtés, principalement pour vols ou cambriolages, a augmenté de 109 % ! Pour lutter contre ce phénomène, le ministère développe sa coopération avec la Roumanie : une cinquantaine de policiers roumains ont été affectés à Paris pour identifier des réseaux criminels étrangers qui, à en croire le préfet de police, seraient presque mieux organisés que la police française…
L'adoption de cette proposition de loi, dont le rapporteur a montré qu'elle ne rétablit nullement la double peine, est indispensable pour améliorer notre dispositif répressif et frapper le noyau dur de la délinquance.

Utiliser le véhicule d'une proposition de loi est une manière habile de faire l'économie d'un avis du Conseil d'État et d'une étude d'impact, mais cela n'empêche pas que ce texte soit contraire aux principes constitutionnels d'individualisation et de nécessité de la peine. Pour le défendre, le rapporteur s'appuie sur des chiffres, d'ailleurs contestables. Mais on peut faire dire tant de choses aux statistiques ! Si le dépôt de lois d'affichage, la stigmatisation d'une population et la provocation constituaient des délits, il faudrait imputer à la fraction de l'UMP autoproclamée « droite populaire » une augmentation de 100 % de la délinquance ! Si vous tenez tant à adapter la législation aux statistiques, pourquoi ne pas durcir les peines prononcées contre les hommes, qui constituent 96 % de la population pénale ? Quand on se donne de telles bases, il est facile de perdre de vue les principes fondateurs du droit et de la justice… Les signataires de ce texte, auteurs récidivistes de lois d'affichage, assument-ils de compter parmi eux Christian Vanneste, qui annonce vouloir quitter l'UMP ?
Voilà trente ans que le nombre d'étrangers condamnés n'augmente pas, mais je ne suis pas surprise que, dans la droite ligne de votre politique constante, l'article 1er vise les étrangers. Il s'attache à ceux qui sont en situation irrégulière ou qui vivent en situation régulière depuis moins de trois ans. À quoi correspond cette durée ? Pourquoi ne pas avoir choisi un an, durée de validité du premier titre de séjour, cinq ans, délai à partir duquel on peut demander une carte de résident, ou n'importe quel autre chiffre, le caractère baroque de vos propositions de loi autorisant bien des fantaisies ?
Vous présentez comme une concession votre proposition de modification du texte consistant à élever de trois à cinq ans le seuil de condamnation exposant à une interdiction du territoire, mais l'adoption de cette disposition ne modifiera pas la portée du texte puisqu'un vol est puni de cinq ans d'emprisonnement dès lors qu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, ou qu'il se produit dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, ou encore dans des lieux donnant accès à un moyen de transport.

Pourquoi déplacer de trois à cinq ans le curseur en fonction duquel on encourra l'ITF ? À mon sens, un étranger qui commet dans notre pays des délits passibles de trois ans d'emprisonnement n'a rien à faire sur notre territoire, et j'aurais bien du mal à expliquer aux victimes de vols avec effraction ou violence que celui qui les a agressées peut commettre des actes beaucoup plus graves avant d'encourir cette peine complémentaire.

Monsieur Raimbourg, je vous confirme que, de crime à crime, il y a récidive, mais l'article 2 vise le cas où la première infraction est un délit et la seconde, un crime. Il existe à cet égard un vide juridique. Un vol criminel précédé d'un vol simple ne constitue pas une récidive légale, pas plus qu'un viol précédé d'une agression sexuelle. Même si ces faits sont mentionnés dans son casier judiciaire, leur auteur est considéré comme un primo-délinquant.
Pour l'heure, l'article 1er ne modifie pas le champ d'application de l'ITF, mais rien n'interdit de réfléchir ensuite au moyen de l'étendre.
Afin d'éviter toute contestation, je m'appuierai dans mon rapport sur les statistiques judiciaires des condamnations. Cela dit, les chiffres de l'ONDRP, qui portent sur les mises en cause, ne sont pas moins éloquents. Sans chercher à stigmatiser qui que ce soit, je rappelle qu'entre 2008 et 2010, le nombre de mis en cause de nationalité roumaine a augmenté de 114,4 % pour les vols, de 168,1 % pour les vols avec effraction, de 153,6 % pour les vols à la tire, de 162,1 % pour les vols simples et autre vols sans violence et de 300,3 % pour les vols violents sans arme.
La proposition de loi s'inscrit dans le droit fil de la loi de 2003, puisqu'elle ne modifie en rien la situation des étrangers protégés. Je veux bien admettre, monsieur Mamère, que les relations d'un homme avec la France devraient s'évaluer par leur intensité plus que par leur durée, mais le législateur doit s'en tenir à des critères objectifs. Par ailleurs, les juridictions étudient les dossiers au cas par cas.
Le texte ne vise nullement à rétablir la double peine. L'ITF résulte non d'une mesure administrative, qui serait décidée de manière systématique, mais d'une décision judiciaire, résultant de l'examen de chaque dossier. La proposition de loi respecte donc le principe d'individualisation des peines, ainsi d'ailleurs que celui de nécessité des peines puisque la réitération, après une condamnation définitive, constitue une circonstance objective de particulière gravité.
Le seuil de cinq ans que j'ai retenu s'explique par la nécessité de conforter les exigences constitutionnelles de proportionnalité des peines, le prononcé d'une ITF devant être réservé à des infractions d'une gravité suffisante.

Je ne partage pas le point de vue de M. Bénisti. Cependant, je m'étonne comme lui que le texte soit présenté comme destiné à s'appliquer aux voleurs et aux cambrioleurs alors qu'il ne leur sera en fait pas applicable, faute de modifier les articles du code les concernant. Il faut croire qu'il n'est pas au point techniquement ! Je ne suis pas sûr que ses auteurs aient perçu ce décalage entre leurs objectifs et son contenu.

Le texte prend en compte, non le vol simple, mais le vol avec une circonstance aggravante dont l'auteur encourt une peine de cinq ans. Or un cambriolage n'est pas un vol simple, puisqu'il est accompagné d'une effraction qui constitue une circonstance aggravante.
La Commission passe ensuite à l'examen des articles.
Article 1er (art. 131-30 du code pénal) : Instauration de peines minimales d'interdiction du territoire français pour les personnes de nationalité étrangère déclarées coupables de crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans
La Commission examine les amendements identiques CL 1 de M. Étienne Pinte, CL 2 de Mme Sandrine Mazetier et CL 5 de M. Noël Mamère, tendant à la suppression de l'article.

On ne s'étonnera pas que le député qui, en 2003, avait convaincu le ministre de l'Intérieur de renoncer au principe de la double peine, ce qui fut voté à l'unanimité, propose de supprimer l'article 1er.
L'interdiction du territoire français est une mesure judiciaire. Sa durée minimale est d'un an mais elle peut être définitive. Elle frappe des personnes étrangères condamnées à une peine de prison. Depuis la réforme de 2003, certains étrangers peuvent bénéficier d'une protection absolue ou relative. Quand il est soit détenu, soit à l'étranger, soit assigné à résidence, un étranger condamné à une ITF peut demander à en être relevé auprès de la juridiction qui l'a prononcée. En 2004, 5 000 ITF avaient été prononcées, dont la moitié ont été exécutées, mais, en 2010, pour 1 693 ITF prononcées, 1 201 ont été exécutées. C'est dire que les procureurs prennent déjà en compte cette possibilité d'interdiction du territoire, qui est exécutée de manière quasiment systématique, soit parce que l'intéressé n'appartient pas à une catégorie protégée, soit parce qu'il ne s'est pas prévalu de cette protection auprès du juge.
L'article 1er pose problème. Un étranger peut être en situation irrégulière en vivant en France depuis longtemps. Il peut, par ailleurs, avoir déposé une demande de titre de séjour. Il peut aussi vivre en France de manière régulière depuis moins de trois ans, mais y avoir résidé longtemps avant d'obtenir un premier titre de séjour. Enfin, nombre de citoyens d'origine étrangère ne sont pas en mesure de faire valoir la protection à laquelle ils ont droit : ainsi ceux qui sont jugés en comparution immédiate n'ont pas le temps de réunir des preuves.
Derrière une personne condamnée, il y a souvent une famille, une femme et des enfants. Après les événements de 2010, la France s'est engagée, comme d'autres États de l'Union européenne, à scolariser les enfants des Roms. Va-t-elle, en renvoyant chez lui un homme qui a commis des délits, voire des crimes, faire de sa femme et de ses enfants des veuves ou des orphelins sociaux ?
Je vous laisse méditer la réponse qu'a faite Emmanuelle Mignon, le 5 décembre 2009, à un journaliste du Figaro qui demandait quel combat mené aux côtés de Nicolas Sarkozy l'avait le plus marquée : « La suppression de la double peine a été un beau combat, inattendu. C'était une mesure de progrès, révélatrice de cette capacité de Nicolas Sarkozy à ne pas être enfermé dans les dogmatismes. »

Avis défavorable. Un étranger qui commet des infractions s'expose à des peines principales comme à des peines complémentaires, parmi lesquelles figure l'ITF. Celle-ci, qui existe depuis 1970, a vu son champ d'application considérablement étendu par la loi de 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France – j'ai d'ailleurs relu récemment avec intérêt les déclarations faites à l'époque par Michel Sapin, alors ministre délégué auprès du ministre de la Justice, par Alain Vidalies, qui était rapporteur de ce texte, ou encore par Jérôme Lambert, qui en était rapporteur pour avis.
Tout en renforçant l'effectivité de l'ITF, nous ne remettons pas en cause la loi de 2003. La protection de certains étrangers reste un principe acquis, et leur situation, surtout dans les cas évoqués par M. Pinte, sera prise en compte. Les magistrats étudieront les dossiers au cas par cas, dans le respect du principe d'individualisation des peines. Il n'y a donc pas lieu de parler d'une double peine, sauf si l'on utilise aussi cette expression, par exemple, pour le chauffard dont la peine complémentaire consiste à être privé de permis de conduire, pour le dirigeant de société ayant commis une faillite frauduleuse et qui est frappé d'une interdiction de gérer, ou encore pour le chasseur dont le permis de chasse est suspendu ou retiré.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine l'amendement CL 6 du rapporteur.

Pour renforcer le respect du principe de nécessité des peines, l'amendement vise à réserver l'ITF aux auteurs de délits punis, non plus d'au moins trois ans comme le prévoit le texte initial, mais d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 1erest ainsi rédigé.
Article 2 (art. 132-18-2 [nouveau] du code pénal) : Instauration de peines minimales d'emprisonnement pour les auteurs de crimes en situation de réitération
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 3 de M. Dominique Raimbourg, tendant à la suppression de l'article.
Elle est saisie de l'amendement CL 7 du rapporteur.

Pour compléter l'encadrement du dispositif de peines minimales institué pour les réitérants, je propose d'ajouter une condition tenant à la gravité de la première infraction commise. Pour que ces peines s'appliquent à l'auteur d'un crime, il faudra que le premier terme de la réitération soit un délit intentionnel puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 2 modifié.
Article 3 (art. 132-19-3 [nouveau] du code pénal) : Instauration de peines minimales d'emprisonnement pour les auteurs de délits en situation de réitération
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 4 de M. Dominique Raimbourg, tendant à la suppression de l'article.
Puis elle examine l'amendement CL 8 du rapporteur.
La Commission adopte cet amendement, ainsi que l'amendement de précision CL 9 du rapporteur.
Elle adopte l'article 3 modifié.
Article additionnel après l'article 3 (art. 215-2 du code pénal ; art. 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ; art. 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ; art. 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; art. 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ; art. L. 541-3 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec les modifications relatives à la peine d'interdiction du territoire français
La Commission adopte l'amendement CL 11 du rapporteur.
Article additionnel après l'article 3 (art. 362 du code de procédure pénale) : Information des jurés de cour d'assises sur les peines minimales encourues par les personnes condamnées pour un crime
La Commission adopte l'amendement CL 10 du rapporteur.
Elle adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
La séance est levée à 11 heures 45.