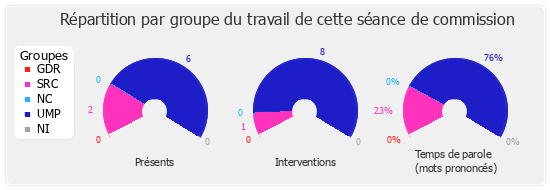Mission d'information assemblée nationale-sénat sur les toxicomanies
Séance du 29 juin 2011 à 14h00
La séance
Mission d'information SUR LES TOXICOMANIES
Mercredi 29 juin 2011
La séance est ouverte à quatorze heures dix.
(Présidence de M. Serge Blisko, député, coprésident, et de M. François Pillet, sénateur, coprésident)
La Mission d'information examine le rapport de Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Gilbert Barbier, corapporteur pour le Sénat.

Mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de six mois d'un travail aussi intense que riche en auditions de grande qualité – leurs comptes rendus figureront dans les annexes du rapport – même si le nombre de nos déplacements a été limité tant pour des raisons budgétaires que d'emploi du temps.
Je tiens à remercier M. François Pillet, qui a présidé à mes côtés la mission d'information, les deux corapporteurs, pour leur sagacité, ainsi que tous les membres de la mission pour leur assiduité.
Si je ne partage pas toutes les conclusions du rapport, celui-ci n'en reflète pas moins la réalité du travail que nous avons effectué. Nous y ajouterons, avec les sénateurs socialistes, une contribution des députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, membres de la mission, qui porte sur quelques points sensibles du rapport.
Je tiens moi aussi à remercier chacun du travail fourni dans le cadre de cette mission qui s'est déroulée dans les meilleures conditions en vue de collecter les renseignements que nous souhaitions obtenir. Des auditions aussi nombreuses qu'approfondies nous ont permis d'entendre un large éventail d'experts.
En dépit de divergences inévitables, ce rapport sur les consommations de drogues, substances dont personne ne conteste l'extrême nocivité, me paraît être le mieux documenté sur le sujet depuis de nombreuses années.
Je m'associe aux félicitations qu'a adressées M. Serge Blisko, dont chacun a pu apprécier l'ouverture d'esprit.

J'ai eu moi aussi beaucoup de plaisir à travailler au sein de cette mission d'information, notamment avec le corapporteur pour le Sénat, M. Gilbert Barbier. J'aurais aimé pouvoir approfondir davantage certains points ou élargir les sujets, mais le temps nous a manqué. Je m'associe aux remerciements formulés par MM. les coprésidents.
Mes chers collègues, vous avez pu prendre connaissance de notre rapport. Nous n'allons donc pas en exposer les nombreux éléments mais simplement donner des « coups de projecteur » sur certains points qui nous paraissent particulièrement importants.
Tous, nous partageons le constat suivant : les toxicomanies d'aujourd'hui ne peuvent être comparées à celles d'il y a trente ou quarante ans. La toxicité des drogues s'est fortement accrue ; la polytoxicomanie s'est répandue ; les réseaux de trafic se sont « professionnalisés ».
Nous estimons que la première des réponses doit être la prévention dès le plus jeune âge. La démarche actuelle nous paraît insuffisante : recourir à des gendarmes dans les écoles ne paraît pas le mieux adapté. Il faut donc, dès l'école primaire, conduire des actions centrées sur la promotion de la santé et l'estime de soi, pour apprendre aux élèves à dire « non » et à résister à la pression.
Il faut également mettre l'accent sur la détection précoce des jeunes à problèmes pour leur éviter de franchir le pas, en s'appuyant sur l'expérience des médecins et des infirmiers scolaires. Parallèlement, il convient de responsabiliser les adultes encadrant les jeunes en les formant à la prévention et de mieux associer les familles aux campagnes de sensibilisation. Enfin, il semble nécessaire d'intensifier la prévention dans l'entreprise.
Au-delà de la prévention, il faut également disposer d'une offre de soins variée et renforcée. Plusieurs voies doivent être exploitées, car il n'existe pas de réponse unique. La première consiste à développer, avec volontarisme, les communautés thérapeutiques. Celles-ci en sont au stade expérimental en France : on n'en compte que sept. C'est tout à fait insuffisant quand on constate les succès qu'elles remportent à l'étranger : non seulement elles orientent des toxicomanes vers l'abstinence, mais elles les aident à se réinsérer, sans pour autant les soumettre à un parcours médicalisé parfois sans fin. Nous fixons un objectif raisonnable : disposer d'une communauté thérapeutique par région.
Il faut également renforcer les capacités d'accueil et d'hébergement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, poursuivre la structuration de l'offre hospitalière, améliorer le maillage territorial en établissements médico-sociaux et faire mieux connaître les consultations destinées aux jeunes consommateurs. Il convient en outre de développer les passerelles entre les dispositifs de prise en charge car l'éparpillement des structures nuit à la continuité du parcours de soins des toxicomanes.
Enfin, le renforcement de l'offre de soins suppose d'améliorer la formation en addictologie des professionnels de santé et la recherche dans ce domaine pour dépasser les querelles de chapelle.
Le troisième pilier de la prise en charge des toxicomanes est la réduction des risques. Cette politique, qui a permis des progrès en matière de santé publique, doit être aménagée dans un esprit de responsabilité. À cet égard, nous nous interrogeons sur les traitements de substitution aux opiacés, qui posent trois problèmes.
Le premier est celui de leur durée : ils semblent devenir des traitements « à vie ». Quelle est la voie de sortie ? Il faut mener des recherches et faire le véritable bilan de ces traitements. Le deuxième problème est celui du trafic de Subutex. Nous proposons l'ouverture systématique d'un dossier pharmaceutique pour les personnes souhaitant s'en faire délivrer, non pour les stigmatiser mais pour mieux contrôler la délivrance de ce produit qui peut conduire à l'addiction. Le troisième problème est celui des décès, beaucoup trop nombreux, liés à la prise de méthadone. Nous proposons que la prescription soit encore plus encadrée lors de la reconduction du traitement en médecine de ville, en s'appuyant sur les réseaux ville-hôpital, et qu'un bilan médical régulier soit mené pour éviter les surdoses.
Dans le cadre de la réduction des risques, certains ont proposé l'expérimentation de centres d'injection supervisés. Nous y sommes défavorables, comme le sont plusieurs instances officielles reconnues, dont l'Académie nationale de médecine. Nous constatons que l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a lancé le débat de l'été dernier, est en réalité plus nuancée qu'on l'a laissé croire et que le consensus n'existe pas sur la question.
Notre visite de l'espace Quai 9 à Genève ne nous a pas non plus convaincus. L'efficacité de ces centres pour lutter contre la diffusion des virus de l'immunodéficience humaine et de l'hépatite C n'a pas été démontrée. De plus, ces centres ont été créés dans des pays qui connaissent des situations très particulières de « scènes ouvertes » de la drogue, phénomène dont l'ampleur est moindre en France.
Nous estimons donc que ces centres ne seraient pas adaptés à la situation française : les surdoses mortelles sont chez nous moins nombreuses, les scènes de consommation de drogues sont mobiles et diffuses et la réduction des risques a permis d'améliorer la santé des toxicomanes.
L'expérimentation de ces centres poserait en outre des difficultés juridiques puisqu'il faudrait accepter que, dans certains lieux, la consommation de drogues soit légale, ce qui serait contraire aux conventions internationales qui lient la France. Cela poserait également des questions difficiles à régler : quelle serait la responsabilité des professionnels de santé travaillant dans ces centres en cas de surdose ? Comment devraient agir les forces de l'ordre à proximité des centres ?
Enfin, nous jugeons que de tels centres donneraient un message extrêmement ambigu sur l'attitude des pouvoirs publics à l'égard de la drogue, ce qui ne pourrait qu'affaiblir la portée des actions de prévention. Nous ne pouvons l'accepter.
En réalité, ce qui compte, c'est moins d'offrir un espace d'injection que de nouer un contact avec des populations très fragiles. Nous proposons donc de multiplier les maraudes pour établir un premier contact avec ces populations et les orienter vers le système de soins.
Le corapporteur, M. Gilbert Barbier, va maintenant vous exposer notre point de vue sur d'autres questions, en particulier le régime juridique de l'usage des drogues.
Je tiens à remercier nos deux coprésidents, ainsi que la corapporteure, Mme Françoise Branget. Si nous présentons chacun une partie des conclusions, elles n'en sont pas moins communes. Je remercie également l'ensemble des membres de la mission, notamment ceux du Sénat, dont certains sont en fin de mandat, ce qui entraîne pour eux un surcroît d'activité ; ainsi, Mme Marie-Thérèse Hermange a présenté hier un important rapport sur le Mediator.
Après la présentation par Mme Françoise Branget des questions touchant notamment à la prévention et aux centres d'injection supervisés, j'aborderai une autre question qui me paraît centrale : le caractère effectif de la dissuasion par la sanction. Toutefois, je souhaite auparavant compléter les propos de Mme Françoise Branget sur un point important de la réduction des risques : la question de la disponibilité de seringues dans les prisons.
Le risque d'être contaminé en prison par le virus de l'hépatite C est dix fois supérieur à celui encouru en milieu libre, et le risque de transmission des virus de l'hépatite B ou de l'immunodéficience humaine est multiplié par quatre. Les partages de matériel sont en effet systématiques en milieu carcéral. Face à cette situation, le Conseil national du SIDA, dont je suis membre, a estimé dans un avis de septembre 2009 que le dispositif de réduction des risques devait bénéficier aux personnes détenues. La peine d'emprisonnement, a remarqué le conseil, est privative de liberté, non pas de soins ni de prévention. Nous partageons cette conviction et proposons en conséquence que soient mis en oeuvre des programmes d'échange de seringues en milieu carcéral.
La question des sanctions de l'usage des drogues illicites comporte deux branches. Faut-il sanctionner ? Si oui, comment faire pour que la sanction soit plus efficace ?
Le débat sur la sanction est ancien ; il a été assez peu abordé par nos interlocuteurs mais relancé récemment par notre collègue député, M. Daniel Vaillant, qui propose de supprimer les sanctions de l'usage du cannabis et d'instituer un régime juridique de la fourniture de cannabis aux usagers. Je suis fondamentalement hostile à cette proposition car, à mes yeux, les drogues illicites, y compris le cannabis, sont des poisons – les auditions l'ont confirmé – dont il faut absolument combattre l'usage, et plus particulièrement par la jeunesse.
Vous avez lu le rapport. Je rappelle simplement qu'il n'y a pas de drogue « douce » : tous nos interlocuteurs en sont convenus peu ou prou. Le cannabis est dangereux, à l'instar des autres drogues. Je n'y reviens pas.
Cela dit, la plupart des arguments favorables à la dépénalisation de l'usage du cannabis mettent en avant non pas une supposée moindre dangerosité du cannabis mais des effets connexes de la prohibition de son usage, notamment la morbidité causée par l'absence de contrôle de la qualité des produits et le lien de causalité entre prohibition et criminalité.
Ces arguments ne convainquent pas.
S'agissant de la qualité des produits, je rappelle que ce qui est nocif, c'est la drogue et non pas tant ce qui peut lui être ajouté, qui est peu appétissant mais rarement dangereux – c'est du moins ce qui ressort des auditions. En tout état de cause, les marchés clandestins des produits restés interdits, qui se reconstitueraient nécessairement à la marge du secteur dépénalisé, seraient vraisemblablement approvisionnés par des produits plus dangereux, notamment en principe actif, que ceux qui sont actuellement proposés aux consommateurs : ces produits seraient plus concentrés et plus violents pour être plus alléchants. L'argument de la qualité des produits disponibles en régime de dépénalisation me paraît donc un leurre.
Je tiens également à remarquer qu'on a entendu parler de dépénalisation et de légalisation : ce sont, à nos yeux, deux termes synonymes.
En ce qui concerne les trafics, ne soyons pas non plus naïfs : le lien de cause à effet entre la prohibition, d'une part, la petite et la grande criminalité, d'autre part, est complexe. Il ne suffirait pas de supprimer la cause – la prohibition – pour supprimer la conséquence – la criminalité liée aux trafics : rappelons-nous la suppression de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, qui a sans doute été largement à l'origine de la montée en puissance du trafic des stupéfiants et de la consolidation de la mafia. De la même manière, la suppression de la prohibition du cannabis susciterait l'apparition de nouveaux marchés clandestins contrôlés par les mêmes organisations criminelles ou mafieuses. J'ajoute, s'il en est besoin, que les engagements internationaux souscrits par la France ne permettent pas la légalisation de la consommation personnelle de quelque stupéfiant que ce soit.
Toutefois, ce n'est pas tout que de réaffirmer l'interdit, encore faut-il conforter son efficacité ; or notre législation laisse manifestement à désirer en la matière.
En principe, l'usage illicite des stupéfiants est sanctionné au maximum par une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 euros. Je pense que trop de sanction tue la sanction : est-il raisonnable de promettre à des jeunes s'essayant à un premier usage une peine de prison d'un an alors qu'ils ont du mal à se considérer comme de dangereux délinquants ? Du reste, on ne les traîne pas en prison lors de leur première interpellation en « situation » ou en possession d'une dose destinée à leur usage personnel, et c'est heureux. Ce qui l'est moins, et qui est même très regrettable, c'est que l'interpellation et la sanction épargnent ainsi des catégories entières de jeunes consommateurs – collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, jeunes dans la vie active –, c'est-à-dire toute une population qu'il faudrait dissuader de se lancer en toute impunité dans l'expérience de la drogue. Les sanctions doivent être vraisemblables, c'est-à-dire proportionnées, et effectives, c'est-à-dire appliquées. Or, quand il y a, rarement, interpellation suivie d'une sanction, celle-ci se borne la plupart du temps à un maigre rappel à la loi, oublié aussitôt qu'infligé. Qu'en est-il dès lors de la valeur de l'interdit et du respect dû à la loi ?
C'est pourquoi je propose une stratégie de dissuasion orientée vers l'usager expérimentateur, en sanctionnant la première consommation constatée de toute drogue illicite par une amende contraventionnelle. Cette sanction remplacerait l'inapplicable peine délictuelle actuellement en vigueur dès le premier usage. En cas de deuxième interpellation, le contrevenant retomberait dans le régime délictuel actuel.
Il s'agirait d'une amende de troisième classe, dont le taux maximum est de 450 euros. Conformément au régime juridique des contraventions, il serait possible au contrevenant, et c'est tout l'intérêt de la mesure, d'empêcher le déclenchement des poursuites en réglant une amende forfaitaire de 68 euros dans un délai de quarante-cinq jours. Une sanction simple, immédiate et donc effective et crédible pourrait ainsi être appliquée par les forces de l'ordre. Cette sanction serait en outre homogène, c'est-à-dire équitable, son montant ne dépendant pas de l'appréciation d'un magistrat ou de la politique d'un parquet. Elle serait également non stigmatisante pour le primo-consommateur sanctionné, les contraventions de troisième classe n'étant pas mentionnées au casier judiciaire. En un mot, il s'agit de créer une véritable dissuasion pour un segment de population particulier, mais essentiel et qui nous intéresse en priorité, la jeunesse, population pour laquelle la réponse pénale à la violation de l'interdit est actuellement lacunaire parce qu'inadaptée aux réalités quotidiennes de la consommation de drogues illicites.

J'ajoute que nous proposons d'intituler le rapport : « Toxicomanies : rejeter la fatalité, renouveler les stratégies ».

Je tiens moi aussi à saluer le travail effectué.
J'ai déjà eu l'occasion, en 2007, dans le cadre d'un rapport pour avis sur les crédits de la mission « Santé » du projet de loi de finances, d'aborder la question de l'efficacité des politiques menées en matière de lutte contre la toxicomanie. J'avais, à l'époque, préconisé les communautés thérapeutiques et les salles d'injection supervisées. Je me félicite que le rapport insiste sur la nécessité de développer les premières.
S'agissant des traitements de substitution aux opiacés, le mésusage du Subutex est un énorme problème – j'ai pu le constater en tant que pharmacien. Le dossier pharmaceutique apportera une solution efficace. Il faudra donc l'imposer afin de pouvoir suivre, dans le pays entier, tout patient prenant du Subutex, seul moyen d'éviter les prescriptions abusives.
À propos des salles d'injection supervisées, le rapport, à mon grand étonnement, évoque « des zones de non-droit » et « une politique de capitulation », ce qui laisse à penser que seule la vision « salle de shoot » et non « salle de consommation à moindres risques » a été retenue. Je tiens à rappeler que les salles de consommation sont réglementées, et supervisées par des professionnels. C'est une nouvelle main tendue à des usagers en grande précarité, à qui l'on permet d'entrer en contact avec des professionnels et d'entamer un parcours de soin.
Quant à dire du coût de ces salles qu'il serait trop élevé, c'est biaiser le débat puisque dans la salle Quai 9 de Genève, les intervenants sont deux à trois fois plus payés qu'en France et que de plus, le coût de cette salle – 2,8 millions d'euros – comprend également la prise en charge d'un bus d'échange de seringues. À titre de comparaison, la salle de consommation de Bilbao coûte 500 000 euros par an.
En ce qui concerne les surdoses, l'argument selon lequel elles sont moins nombreuses en France que dans les autres pays n'en est pas un : il en reste encore beaucoup trop !
Enfin, à la suite de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, ce rapport assure que les salles de consommation banaliseraient l'usage de drogues, entraînant une dépénalisation de fait. Je rappelle que ces mêmes arguments ont été utilisés par les opposants aux programmes d'échange de seringues en pharmacies lorsqu'elles ont été mises en vente libre en 1987, et par les opposants aux programmes de méthadone dans les années 1990.
La proposition, reprise de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, de remplacer les salles de consommation par des maraudes n'est pas satisfaisante. Du reste, ce sont les associations qui réalisent des maraudes – Gaïa, Charonne ou Ego –, qui demandent l'ouverture des salles de consommation parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre les usagers les plus vulnérables, d'autant que les maraudes n'empêchent pas les conditions d'injection déplorables dans les caves ou d'autres lieux. L'absence de « scènes ouvertes » n'est pas non plus un très bon argument : entre les gares du Nord et de l'Est, à Paris, les scènes ouvertes de consommation de drogue existent depuis quinze ans. Simplement, elle se déplacent d'une centaine de mètres en fonction des opérations de police.
Je regrette enfin que le rapport ne soit pas plus prolixe sur la réduction des risques, notamment en milieu festif ou à la campagne, où des problèmes relativement nouveaux se posent de manière importante.

Je tiens à remercier les deux coprésidents et les deux corapporteurs du travail fourni par la mission d'information.
Je n'appartiens pas au milieu médical : je suis simplement élu dans un département qui est très concerné par la consommation de drogues et ses conséquences pour l'ensemble de la population. Samedi soir encore, un trentenaire s'est tué en se jetant d'un sixième étage après avoir consommé de la drogue – j'ignore s'il entrera dans les statistiques des suicides ou des morts par consommation de stupéfiants.
L'expérience nous enseigne que nos prédécesseurs ont eu raison de prendre des mesures permettant de freiner le développement des virus de l'immunodéficience humaine ou de l'hépatite C grâce, notamment, à la mise à disposition de seringues. Je suis d'accord avec M. Gilbert Barbier s'agissant des efforts à fournir en matière de lutte contre la transmission de ces maladies dans les prisons, dont la population est, par définition, sous contrôle. Mme Françoise Branget a également eu raison d'insister sur le fait qu'il faut poursuivre, en matière de prévention, les efforts de sensibilisation à l'adresse de la jeunesse. Les auditions ont ainsi mis en évidence qu'il fallait accentuer l'implication de l'Éducation nationale en la matière : dans certains pays du nord de l'Europe, c'est dès la maternelle que les enfants sont sensibilisés aux dangers des stupéfiants.
Je regrette enfin que le débat sur la dépénalisation de l'usage de la drogue se soit immiscé dans les travaux de la mission d'information car il n'y avait pas sa place. Il est rappelé, dans la troisième partie du rapport, que « la dépénalisation de l'usage » est « une impasse éthique et juridique ». Une analyse raisonnée le montre : il faut poursuivre le travail entamé. Les effets des politiques anciennes conjugués à ceux des politiques nouvelles qui seront engagées à la suite de ce rapport permettront de conserver en France un taux plus faible de consommation de drogues que dans les autres pays et donc d'en limiter les dégâts. Il faut maintenir notre niveau d'hygiène et de soins, sans faiblir en matière de répression. Je suis également favorable à la proposition de M. Gilbert Barbier d'instaurer, pour la première interpellation, une amende de troisième classe avant de recourir au régime délictuel à la deuxième interpellation. Il faut en effet sensibiliser, dès la première fois, les jeunes aux conséquences de la consommation de drogues : nous sommes plusieurs élus à constater que dans nos départements la consommation de drogues ne fait plus l'objet de sanction. Le volet pénal n'étant jamais appliqué, la loi a perdu tout son sens.
Je souhaite que ce rapport permette d'en revenir aux fondamentaux en matière de lutte contre la drogue. Les parlementaires ne s'étaient pas saisis du sujet depuis de nombreuses années : il conviendra que, dans cinq ou six ans, ils fassent le bilan des actions qui, à la suite de ce rapport, seront adoptées par le Parlement et mises en application par le Gouvernement, notamment en matière de santé et de sécurité publiques.

Cette mission nous a permis d'auditionner la majeure partie des experts sur le sujet.
Je n'ajouterai rien aux propos de M. Michel Heinrich sur les « salles de consommation » qu'on ne saurait précisément réduire à de simples lieux de consommation de drogue. Elles permettent de créer du lien social. Pour avoir effectué des maraudes avec Médecins du monde, je puis dire qu'elles ne suffisent pas à détecter les plus désociabilisés des toxicomanes et à recréer du lien social avec eux.
Je regrette qu'on ne laisse pas les villes qui se sont portées volontaires – Paris, Marseille, Toulouse – expérimenter l'ouverture de telles salles. Je l'ai déjà dit : on ne peut pas distribuer des seringues stériles dans les pharmacies et accepter que, cinquante mètres plus loin, la personne se pique au vu et au su de tous sur des places publiques ou dans des parkings souterrains.
Je propose par ailleurs des corrections d'ordre technique, de peur que des spécialistes n'accusent le rapport d'avoir été mal écrit. Ainsi, page 109, le rapport évoque des substances « morphiniques » : en pharmacologie, on préfère parler d'opioïdes. Il est écrit à la même page que les traitements de substitution agissent sur les aspects « biologiques », alors qu'ils agissent en réalité sur les aspects « pharmacologiques ».
Par ailleurs, je m'étonne de lire page 116 que M. Jean-Yves Grall, directeur général de la santé, demande que soit menée « une étude épidémiologique approfondie afin d'étudier avec attention les décès liés à des surdoses de méthadone ». Comme je l'ai rappelé lors de la précédente réunion de la mission d'information, la méthadone est un agoniste total, qui sature tous les récepteurs des opioïdes ; si, donc, la personne prend aussi une autre substance opiacée, elle sera victime d'un surdosage. Le Subutex, quant à lui, s'adresse à des personnes moins stabilisées parce qu'il a, si l'on peut dire, l'avantage d'être un agoniste partiel : le consommateur qui prendra des substances non prévues par le traitement ne risquera donc pas de surdose puisque tous les récepteurs des opioïdes ne sont pas saturés. Un chef de service de l'hôpital de Toulouse, spécialiste de pharmacologie, me l'a confirmé hier au téléphone, devant M. Serge Blisko.
Par ailleurs, qu'est-ce que sortir une personne de l'addiction ? Il n'y a pas de règle générale et les corapporteurs ont raison de vouloir ouvrir toutes les possibilités de prise en charge des personnes. Est-il toutefois possible de sortir totalement de l'addiction une certaine frange de la population? Ma réponse est claire : c'est non. De même qu'on ne pourra jamais réintégrer dans le monde du travail la petite frange complètement désociabilisée de la population, de même, on ne réussira pas à sortir de l'addiction certains toxicomanes, ceux qui sont à trois grammes d'héroïne par jour depuis l'âge de quatorze ans et dont l'espérance de vie ne dépasse pas quarante ans. Tous les psychologues vous diront qu'ils ont déjà un pied dans la tombe. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la réalité du terrain, que j'ai connue durant quinze ans, comme M. Michel Heinrich, du reste.
S'agissant de la légalisation contrôlée, je répète ce qu'a dit M. Serge Blisko la semaine dernière : la position de M. Daniel Vaillant n'a rien à voir avec ce rapport parlementaire. Je regrette toutefois, en mon nom et au nom des signataires de la contribution des députés du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, que le débat sur cette question ne soit pas ouvert alors même que chacun d'entre nous reconnaît que si la loi était aussi efficace qu'on le prétend, le nombre de consommateurs ne serait pas aussi élevé, ce qu'ont souligné aussi bien M. Robert Henrion dans son rapport que M. William Lowenstein. Loin de préjuger de la conclusion du débat, je me contente de faire le constat suivant : quand une loi n'est pas appliquée de la même manière selon l'origine sociale ou territoriale des personnes en infraction, la justice des adultes perd toute crédibilité aux yeux des adolescents et des jeunes.
De plus, dépénalisation n'est pas légalisation – ce n'est pas M. Jean-Paul Garraud qui me contredira. Il convient de le préciser, parce que beaucoup de Français, et même des politiques, confondent les deux notions.
S'agissant du dossier pharmaceutique, le rendre obligatoire pour les toxicomanes serait instaurer une mesure d'exception contraire à l'égalité républicaine. Nous avons rendu compte ce matin de l'expérimentation faite à Toulouse sur les toxicomanes « mégaconsommateurs » : nous avons réussi à en faire baisser le taux sans rendre le dossier pharmaceutique obligatoire. Nous étions à la limite de la loi, j'en conviens : c'est pourquoi nous attendons une adaptation de la réglementation.
Je m'élève violemment, en mon nom et au nom de mon groupe, contre la volonté, manifestée pages 66 et 68 du rapport, de cibler dès leur plus jeune âge les enfants dont les comportements sont agressifs ou déviants. Attention ! Un enfant peut avoir un comportement agressif, par exemple en raison du divorce difficile de ses parents, il ne deviendra pas pour autant un consommateur de substances illicites. Je rappel que l'Unesco a demandé des comptes à la France à propos de la base de données constituée sur les élèves. Le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche sera intransigeant sur la question.
Je regrette enfin que la mission ait écarté la question de l'alcool. Il fallait certes définir un champ précis d'investigation ; toutefois, l'alcool se retrouve dans tous les cas de polyaddiction.

Madame Catherine Lemorton, nous convenons tous évidemment des liens existant entre polyaddiction et alcool.

Je partage, globalement, les conclusions d'un rapport qui fait, de nouveau, la lumière sur la complexité de la polytoxicomanie. Le toxicomane est un malade qui, dans le même temps, se trouve en infraction à la loi. Ses comportements sont souvent illégaux.
S'agissant des centres d'injection supervisés, le rapport en fait une analyse détaillée et objective, que je partage. C'était une fausse bonne idée, en dépit de la vision sanitaire de certains de nos collègues : en matière de toxicomanies, on ne peut pas séparer complètement le sanitaire du policier et du judiciaire, qui sont étroitement liés. Il faut également faire attention au message que la société envoie aux citoyens. De plus, cette mesure poserait, vis-à-vis des personnels de ces centres, des questions d'ordre juridique : qui imagine que l'État puisse organiser une consommation de stupéfiants, même sous contrôle médical ? Elle est d'autant plus inopportune que ces centres ne sont pas une réussite sur le plan médical et qu'à l'étranger, les communes qui en ont ouverts n'ont obtenu aucune diminution du nombre des surdoses ni aucune réduction du trafic des stupéfiants.
Il en est de même du débat lancé par M. Daniel Vaillant, plus que par le parti socialiste, encore que certains membres du parti l'aient repris. Peut-être le programme socialiste nous permettra-t-il de connaître la position officielle du parti sur la dépénalisation de certaines drogues. Une chose est certaine : les pays qui ont eu recours à la dépénalisation en sont revenus. Du reste, si les notions sont effectivement différentes d'un point de vue juridique, pour le citoyen, dépénalisation égale légalisation, puisque la dépénalisation équivaut à une véritable autorisation. Comment tolérer qu'un État distribue un produit dont la consommation est mauvaise pour la santé ? On compare souvent la nocivité du cannabis à celle de l'alcool ou du tabac : c'est oublier que la composition du cannabis n'a cessé d'évoluer vers une plus grande dangerosité.
Comment être efficace dans la répression ? Il est vrai, comme M. le corapporteur Gilbert Barbier l'a souligné, que trop de sanction peut tuer la sanction. Du reste, à l'heure actuelle, le simple usage n'est pas traité comme un délit et il ne mobilise pas le tribunal correctionnel. Toutefois, on ne saurait se pencher sur la question uniquement sous l'angle du toxicomane. Il ne faut pas oublier l'intérêt de la société qui est de lutter contre les réseaux mafieux de trafic de stupéfiants, d'autant que 70 % à 80 % des infractions sont liées, directement ou indirectement, aux stupéfiants. Remonter les filières est donc particulièrement important, et les placements en garde à vue de simples usagers, tout comme la perquisition de leurs domiciles, peuvent aider les enquêteurs. Or, si l'usager est soumis à une simple contravention, il ne pourra plus être placé en garde à vue. La contravention à la première interpellation empêcherait donc la police de remonter les réseaux. Pour avoir été directeur d'enquête dans de nombreuses affaires de stupéfiants, je sais que l'élucidation d'une grosse affaire de stupéfiants s'appuie presque toujours sur des indices recueillis lors de l'interpellation d'un simple usager. Rendre plus efficace la sanction à l'encontre de l'usager ne doit pas nuire à l'efficacité de la lutte contre les réseaux mafieux.
Je me demande si la mission a su toujours se concentrer sur son objet principal, mais il est vrai que la toxicomanie est une question complexe, presque inépuisable, qui met en jeu un grand nombre de problématiques.
Comme Mme Catherine Lemorton, je refuse la stigmatisation de certains enfants : ceux qui connaissent des problèmes ne deviendront pas tous des trafiquants, des drogués ou des voleurs ! Cette vision est simpliste.
Je n'appartiens ni au monde médical ni à la magistrature. Je ne suis donc pas spécialiste de la toxicomanie sous un angle professionnel. Toutefois, c'est la drogue qui a provoqué mon engagement politique car j'ai vécu cette question de près, dans les années 1980, lorsqu'elle est arrivée dans ma cité : trois quarts de mes amis ont commencé à fumer du cannabis. Alors qu'ils réussissaient assez bien à l'école, au fur et à mesure qu'ils en devenaient dépendants, ils se sont coupés des autres ; trop souvent les politiques favorables à la dépénalisation du cannabis oublient l'effet de bande. Une chose est de fumer lorsqu'on est un adulte installé dans la société, une autre quand on est un jeune appartenant à une bande dans une cité, car les petits trafiquants ne sont jamais loin : 50 % de mes amis qui ont touché à la drogue en sont morts, et seuls 30 % de ceux qui sont encore en vie ont réussi à s'en sortir complètement. Tous, sans exception, sont passés par les drogues « dures ».
Il est vrai que la dépénalisation de l'usage du cannabis n'entrait pas dans le cadre du rapport. Elle n'en est pas moins devenue le sujet d'actualité, comme le montre la une du journal La Provence aujourd'hui. La mission d'information est donc rattrapée par cette question. Or j'affirme que la dépénalisation ne mettrait pas fin au trafic de drogues dans les quartiers. À La Castellane, à Marseille, une cité de 8 000 habitants, le chiffre d'affaires de la vente de drogue est de 150 000 euros par jour, soit 4,5 millions par mois et 50 millions par an ! C'est une industrie. Les trafiquants sont devenus des chefs d'entreprise qui, pour faire face aux conséquences d'une éventuelle dépénalisation du cannabis, s'activent déjà pour organiser le trafic d'un cannabis plus nocif ou préparer leurs clients à consommer des drogues dites « dures ». Faudra-t-il alors passer à la dépénalisation de la cocaïne ou de l'héroïne ?
Bien des problèmes demeurent irrésolus. Ainsi, la question de l'éducation doit être posée : lorsque des professeurs absents ne sont pas remplacés durant plusieurs mois, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Or les trafiquants, qui sont devenus les premiers employeurs des cités depuis que la police n'y pénètre plus, connaissent parfaitement la loi : s'ils n'hésitent pas à employer des enfants de dix ans, c'est qu'ils savent que ces derniers ne seront pas inquiétés. Et pendant ce temps, les centres sociaux des cités sont laissés sans moyens.
Ce serait donc faire preuve d'angélisme que de croire que la dépénalisation suffirait à régler le problème. Il convient de lancer une mission d'information généraliste, car il faut donner des réponses globales, en termes d'éducation, de sécurité et d'accompagnement social mais aussi de rénovation urbaine – par le biais de l'Agence nationale de la rénovation urbaine – à des questions de société qui, à l'heure actuelle, nous dépassent.
Au sein du parti socialiste, chacun peut, démocratiquement, exprimer son point de vue, qui peut ne pas être celui de tous, monsieur Jean-Paul Garraud. Je m'associe aux remerciements adressés aux coprésidents et aux corapporteurs. J'ai relevé quelques « coquilles » aux pages 29, 42 et 43 du rapport ; je les signalerai précisément aux services et j'espère qu'elles pourront être corrigées avant la publication du rapport. J'approuve le propos de Mme Catherine Lemorton : comme elle, je considère l'alcool beaucoup plus toxique que le cannabis. Enfin, les sénatrices et les sénateurs socialistes et apparentés s'associent à la contribution des députés du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche membres de la mission. Mais, parce que prévention de l'usage des drogues et consommation médicamenteuse sont liés, ils souhaitent que le chapitre consacré à la prévention des risques soit complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée : « La prévention doit porter aussi sur la place et la perception du médicament dans notre société et lutter contre sa banalisation comme un objet de “consommation courante” ».
Je sais que, la fin de la session approchant, il aurait été très compliqué de trouver une autre date pour cette réunion, mais je déplore de n'avoir eu le rapport en main qu'il y a relativement peu de temps. Je n'ai, de ce fait, pu le lire en détail ; mon attention aurait été appelée, comme l'a été celle de Mme Catherine Lemorton, sur la préconisation tendant au « repérage » des enfants dits « à risque » dès le plus jeune âge.
Mme Samia Ghali nous a dit ce qu'elle a connu dans la cité où elle vivait adolescente s'agissant de l'usage de drogues. Dans celle où j'habitais, la consommation d'alcool, conséquence d'un mal-être – elle était le fait de gens en grande détresse, qui se sont trouvés au chômage après la fermeture des chantiers navals de La Ciotat –, a eu des conséquences qui n'étaient pas moins dramatiques : tentatives de suicide, séjours en hôpital psychiatrique, cures de désintoxication répétées et toujours infructueuses… Et pourtant, la consommation d'alcool est licite, et on continue, le plus légalement du monde, d'en faire la publicité !
Cela m'amène à dire qu'en France, la tolérance est à géométrie variable : on y accepte ce qui est culturellement acceptable. Sachant que dans d'autres pays, la drogue est tolérée et l'alcool interdit, on voit bien que la question de la dépénalisation de l'usage du cannabis ne peut être posée en termes binaires – « oui, il faut » ou « non, il ne faut pas » : le champ du débat est bien plus vaste. Alors que les toxicomanes sont aussi des usagers et des victimes qui ont besoin de soins et d'accompagnement, ils sont considérés uniquement comme des délinquants et des voleurs potentiels. Cette approche univoque est inadmissible. Je ne pense pas que la France soit prête à dépénaliser demain l'usage du cannabis, mais il faut à tout le moins ouvrir le débat, ce que le rapport ne fait pas, se limitant à proclamer que la dépénalisation serait une mauvaise chose.
Je ne le nie pas, mais je déplore que le débat n'ait pas au moins été ouvert. Sans doute une nouvelle mission d'information devrait-elle être créée à cet effet.
Je partage sans réserve l'opinion exprimée par Mme Catherine Lemorton à propos des salles d'injection. Le terme est d'ailleurs mal choisi, en ce qu'il donne une idée fausse de ce que doivent être ces lieux : des endroits où accueillir des personnes que la communauté nationale doit aider à se replacer dans un parcours de soin et à se resocialiser.

Certains des membres de la mission ayant des obligations impérieuses auxquelles ils ne peuvent se soustraire, je vous invite à vous prononcer maintenant sur la publication du rapport. La discussion se poursuivra ensuite.
N'est-il donc plus temps d'amender le texte, notamment pour ce qui concerne la préconisation relative aux enfants ?

Les corrections syntaxiques seront faites. Pour les questions de fond, il vous appartient de vous prononcer sur le texte en l'état.
La mission d'information autorise le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.

M. Heinrich ne pense pas que le nombre de surdoses mortelles en France soit inférieur à ce qu'il est dans les pays voisins. Nous avons cité à ce sujet, en page 167 du rapport, une étude publiée dans la revue Tendances de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies que nous n'avions aucune raison de remettre en cause.

Je n'en ai pas davantage. Mon propos était que, à supposer même que le nombre de surdoses mortelles soit inférieur en France à ce qu'il est dans d'autres pays, ce n'est pas une raison pour ne rien faire.
Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale. Mme Catherine Lemorton, pour sa part, s'est dite en désaccord avec notre évaluation de la toxicité de la méthadone. Pour faire état des décès attribués dus à l'absorption de cette substance, nous nous sommes référés aux données de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; mais pour tenir compte de cet avis, nous pourrions rectifier la rédaction adoptée page 116, en précisant que l'on parle de décès « dans lesquels est impliquée la méthadone ».

Sans doute avons-nous été elliptiques, mais il est difficile de résumer en une phrase des thèses volumineuses. Je vous propose donc d'en rester là.
Il aurait été préférable, par souci de rigueur, de citer page 116, en italiques, les termes exacts utilisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que les références précises de l'étude. De plus, en fermant la phrase par un point d'exclamation, on sort de l'énoncé de données scientifiques pour porter un jugement de valeur.
D'autre part, parler du « fichier des décès » de l'agence paraît un peu abrupt.

Il était difficile de donner un autre nom à ce qui est effectivement un fichier sur les décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances.
Par ailleurs, il aurait été judicieux de préciser, dans une note de bas de page, les conditions actuelles de prescription et de délivrance de la méthadone. Dans un autre domaine, si, suivant l'avis du directeur général de la santé, on conduit une étude épidémiologique, il faut l'assortir d'une étude clinique.
Il aurait été possible de donner suite aux remarques de Mme Virginie Klès en exposant, en page 8, que la mission d'information se concentrant sur les substances illicites, la question du médicament en tant que telle n'est pas abordée.
Enfin, au dernier paragraphe de la page 9, il aurait été bon, me semble-t-il, de compléter la phrase : « Ils ont souhaité que leur rapport soit empreint d'équilibre » par les mots : « sans stigmatisation, car nous sommes conscients, quel que soit le point de vue d'où l'on se place, qu'il en va de la vie d'hommes, de femmes, voire d'adolescents ».

Pour répondre aux remarques de M. Michel Heinrich relatives aux centres d'injection supervisés, je rappelle que M. Cédric Grouchka, membre du collège de la Haute Autorité de santé, a appelé notre attention sur l'absence d'évaluation médico-économique de ces centres. Par ailleurs, l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a clairement indiqué que ces dispositifs ne sont pas « coût-efficaces » dans la lutte contre la diffusion du virus de l'hépatite C.
S'agissant des salles d'injection supervisées, c'est la comparaison avec les pays étrangers qui pose problème. Sans rouvrir le débat de fond, je rappelle qu'un dispositif existe en France, fondé sur les maraudes ; il répond partiellement aux besoins et doit être amélioré.
Je pense, comme Mme Catherine Lemorton, que mieux vaudrait parler d'« opioïdes », page 109.
Je souhaite revenir sur l'hypothèse de la dépénalisation de l'usage du cannabis. J'ai entendu M. Julien Dray dire, il y a quelques jours, qu'il était contre la dépénalisation mais favorable à la légalisation. On sait ce que signifie « dépénaliser » : c'est supprimer les sanctions pénales, à laquelle peuvent être substituées des sanctions administratives. Mais que faut-il entendre par « légaliser » ? Si j'ai bien compris M. Julien Dray, cela voudrait dire que l'État entrerait sur le marché du cannabis. Mais qui le produirait ? Qui le commercialiserait, sous quelle forme et dans quel dosage ? Serait-il vendu dans les bureaux de tabac ? Serait-il interdit aux mineurs de dix-huit ans ? De quoi parle-t-on exactement en préconisant la « légalisation » de l'usage du cannabis ? Je suis d'accord avec l'idée que l'on puisse ouvrir le débat, mais la création d'une nouvelle mission d'information parlementaire ne peut se concevoir avant l'automne. Dans l'intervalle, il aurait été intéressant d'entendre aujourd'hui M. Daniel Vaillant défendre sa position devant nous ; je regrette qu'il ne soit pas là pour le faire.
Si la drogue est illicite, madame Isabelle Pasquet, c'est qu'elle est nocive pour la santé des individus. Il s'agit d'un problème de santé publique, notamment pour les plus jeunes. Il faut bien sûr soigner les toxicomanes cinquantenaires qui sont de grands malades, mais ce sont les jeunes gens qui me préoccupent d'abord, ceux qui ne sont pas encore des toxicomanes mais des consommateurs. Pour moi, la priorité doit aller à la lutte contre cette consommation d'une substance qui, depuis une dizaine d'années, est devenue nocive dès les premiers grammes.
M. Jean-Paul Garraud a dit son ambivalence à l'idée de la création d'une incrimination d'usage simple sanctionnée par une contravention de troisième classe, expliquant que la suppression des gardes à vue nuirait à l'efficacité des enquêtes visant à remonter les filières. Nous avons entendu cette objection dans la bouche de magistrats et de policiers. Cependant, M. Jean-Paul Garraud reconnaît lui-même qu'actuellement la moitié au moins des premières interpellations de consommateurs de cannabis ne donne pas lieu à poursuite. Ces affaires sont classées sans suite ; il n'y a donc déjà, pour celles-là, ni gardes à vue ni possibilité de remonter une filière.
La séance est levée à quinze heures quarante-cinq.