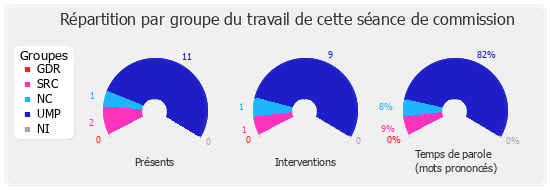Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale
Séance du 22 juin 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
Mercredi 22 juin 2011
La séance est ouverte à seize heures dix.
(Présidence de M. Bernard Accoyer, président de la Mission d'information)
La Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale entend, en audition ouverte à la presse, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Nous arrivons au terme des auditions de notre mission. Au cours de 18 réunions, nous avons reçu 90 personnes d'horizon très divers : des économistes, des chefs d'entreprise, des représentants syndicaux, des directeurs d'administration ou des chercheurs en sciences sociales. Le bilan de ce travail est considérable. Après avoir écouté la semaine dernière M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, nous recevons aujourd'hui M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé, dont plusieurs domaines de compétence recouvrent le sujet que nous devons traiter : comment assurer le financement de notre protection sociale tout en préservant la compétitivité de notre économie ?
La compétitivité de notre pays et le financement de la protection sociale se trouvent, en effet, au coeur des préoccupations de mon ministère. Et j'ai le sentiment que depuis 2007, conformément aux engagements pris par le Président de la République, nous avons mis en oeuvre des réformes importantes en ce domaine. En particulier, nous avons cherché à améliorer le fonctionnement du marché du travail, à ne pas augmenter le coût du travail et à garantir le financement de la protection sociale.
La réforme du fonctionnement du marché de travail visait, tout d'abord, à rendre celui-ci plus compétitif. Mais nous n'oublions pas que, dans la conception française, le droit du travail protège. Il existe des règles complexes – trop complexes sans doute, assorties de multiples seuils et souffrant d'une réelle instabilité juridique, mais dont la vocation reste de protéger les salariés. Nous devons en tenir compte.
Les mesures prises depuis 2007 ont été élaborées dans le cadre d'un dialogue social régulier, conformément à la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, dite loi « Larcher », qui oblige le Gouvernement, lorsqu'il veut engager des réformes dans certains domaines, à organiser préalablement une concertation avec les partenaires sociaux. La rupture conventionnelle, destinée à assouplir la rigidité des rapports de travail, a été adoptée dans cet esprit, de même que la mise en place du service minimum dans les transports qui évite le blocage économique de notre pays en cas de grève. La création de Pôle emploi a par ailleurs facilité la mise en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises à la recherche de main-d'oeuvre. La fusion entre le réseau des Assedic et l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) devrait permettre de lutter contre un phénomène inexplicable aux yeux de nos concitoyens, celui des métiers en tension. Le fait que près de 260 000 offres d'emplois ne soient pas pourvues dans le délai requis prouve d'ailleurs que la France sort progressivement de la crise et que la création d'emplois est relancée mais si nous ne faisons rien, 36,7 % des offres d'emplois seront très difficiles, voire impossibles à pourvoir naturellement. Cela constitue un frein à la compétitivité, car un salarié que l'on ne trouve pas, c'est aussi un marché que l'on ne peut pas prendre.
Si, sur tous ces sujets, nous avons avancé, nous devons aller plus loin et envisager de nouvelles réformes. Pour cela, je crois à la négociation collective, pas seulement parce qu'elle nous est imposée par la loi « Larcher », mais parce que c'est grâce à cette méthode que nous avons pu entreprendre la réforme du temps de travail et diviser par deux le nombre d'articles du code du travail dans ce domaine.
Le taux de chômage chez les jeunes ne constitue pas seulement un risque social d'une très grande importance mais aussi un frein à la compétitivité. Le développement de la formation en alternance, des contrats de professionnalisation et d'apprentissage participe donc de la même logique, car les jeunes représentent une véritable force pour le marché du travail.
Au coeur de la crise, le Gouvernement a mis en place le système de l'activité partielle – appelé dans d'autres pays chômage partiel. Il constitue une protection pendant la crise elle-même, mais permet surtout à l'entreprise de ne pas se séparer de salariés dont elle aura besoin sitôt l'économie relancée, et donc de s'épargner de nouveaux recrutements. Cela participe aussi de la compétitivité de notre économie.
Il en va de même de la sécurisation des parcours professionnels ou du système d'indemnisation du chômage. Certes, la convention d'assurance chômage a été reconduite à l'identique par les partenaires sociaux, ce qui était probablement, en période de crise, la meilleure solution. Mais la réflexion se poursuit, au sein de groupes de travail, sur l'élaboration d'un dispositif plus efficace, pour mieux inciter au retour à l'emploi. Les comparaisons internationales ne sont pas là, en effet, à notre avantage.
Ensuite, nous avons pris des mesures pour ne pas accroître le coût du travail. Depuis 2007, nous avons veillé à ce que l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) soit en phase avec celle de l'économie, en rompant avec la pratique démagogique des « coups de pouce » systématiques. Ils donnent le sentiment de faire plaisir à tout le monde, mais ils ne satisfont que 11 % des salariés et produisent un effet d'écrasement sur les autres salaires – sans parler de leur coût économique. La loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, que j'ai fait voter, a modernisé le mode de fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance : un groupe d'experts se prononce désormais en toute indépendance.
J'en viens à la question du temps de travail. Aujourd'hui, les 35 heures n'existent plus comme plafond dans notre pays : nous sommes sortis du système tel qu'il avait été bâti, et la limite maximale du temps de travail est la limite européenne, visant à préserver la santé des salariés. Lorsque l'on veut travailler plus, aucune autorisation administrative n'est nécessaire, il suffit de négocier au sein de l'entreprise. Les 35 heures ne représentent que le seuil de déclenchement de la majoration de salaire liée aux heures supplémentaires, dont profitent plus de 7 millions de salariés. Il en résulte une plus grande souplesse et une amélioration du pouvoir d'achat. Or, dans un pays comme le nôtre, la reprise économique repose certes sur l'investissement des entreprises, mais aussi sur la consommation des ménages. Pour un salarié payé au salaire minimum interprofessionnel de croissance, deux heures supplémentaires par semaine rapportent 100 euros par mois de plus, net de prélèvements, et donc 1 200 euros par an. Cela compte.
J'évoquerai brièvement, enfin, le financement de la protection sociale, qui constitue un droit dans notre pays. On a souvent tendance à la considérer comme une charge, mais elle est aussi un atout en matière de compétitivité, ainsi qu'un facteur de croissance. Le secteur de la santé, s'il est bien géré de façon à éviter les gaspillages et la fraude, participe à la croissance économique. En outre, la protection sociale a joué un rôle indéniable d'amortisseur pendant la crise.
Des réformes demeurent toutefois indispensables pour réduire les déficits et préserver notre système. La réforme des retraites qu'a portée M. Éric Woerth permettra de rétablir l'équilibre financier dès 2018 et sera un gage de croissance économique : nous avons fait le choix d'augmenter notre population active – alors que tant de pays ont du mal à en maintenir le niveau –, et surtout, nous avons refusé la hausse massive des prélèvements, qui nuisent à la compétitivité et à la croissance.
La révolution de l'emploi des seniors suit la même logique : la fin du système des préretraites dans le secteur public, la taxation des préretraites dans le privé, la libéralisation du cumul entre emploi et retraite vont dans le sens d'une meilleure compétitivité.
Il en est de même quand le Gouvernement parvient à tenir l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM). Certains voudraient une augmentation plus importante, mais je préfère demander des efforts en fixant une progression de 2,8 % plutôt que de devoir, un jour, exiger un véritable sacrifice en imposant une évolution négative.
Sur le long terme, la compétitivité d'un pays dépend également de sa natalité. Le taux de natalité actuel constitue un atout pour l'économie de notre pays, et notre politique familiale n'y est pas pour rien. Nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs taux d'activité des femmes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce que nous envient beaucoup de nos voisins, notamment les Allemands. Nous poursuivons également notre politique en faveur de l'égalité salariale et de la conciliation entre vie familiale et professionnelle.
Si, depuis 2007, plusieurs ministres se sont succédé, la politique de ce ministère est restée la même, et il a apporté sa contribution à la compétitivité de notre économie. Mais tout cela ne suffit pas, compte tenu de la compétition internationale. Nous devons continuer sur la voie des réformes pour que la France conserve sa position enviée dans le peloton de tête des nations industrielles.

La plupart des personnes que nous avons auditionnées ont bien voulu reconnaître les efforts accomplis en faveur de l'industrie et de la compétitivité : la réforme de la taxe professionnelle, les crédits d'impôts, la souplesse en matière de temps de travail, les valorisations de salaire… Mais tous ont également estimé que d'autres réformes étaient nécessaires, compte tenu de la concurrence mondiale et de ce que l'Allemagne a réalisé au cours des dix dernières années. Divers enjeux ont été identifiés au cours des auditions : l'innovation et la formation professionnelle ; le coût du travail, et en particulier le poids des charges sociales ; les rigidités excessives et la complexité juridique, notamment du code du travail ; l'aspect culturel, enfin : la France aime-t-elle son industrie ? Selon quelle hiérarchie classez-vous ces différentes priorités ?
Par ailleurs, 5,4 %de cotisations familiales pèsent sur le travail. Ne pourrait-on pas les transférer progressivement vers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou l'impôt sur le revenu ?
Enfin, nous avons beaucoup de mal à orienter les jeunes vers l'industrie. Comment la rendre attractive à leurs yeux ? Comment les convaincre que ce secteur a de l'avenir ? La pénibilité n'est-elle pas un élément qui désoriente les familles ?
Je rappelle que dans le bassin d'activité que vous avez récemment visité, 300 offres d'emploi ne font l'objet d'aucune candidature.

Des mesures comme la rupture conventionnelle ou le crédit d'impôt recherche ont été très favorables à notre compétitivité. Néanmoins, des efforts restent à accomplir, notamment sur les effets de seuil et la réglementation du travail. Celle-ci n'est-elle pas plus compliquée en France qu'en Allemagne ?
Une évaluation des différents systèmes d'exonération de charges sociales a été réalisée. Ont-ils tous le même effet sur l'emploi ?
Une réflexion est-elle en cours sur l'opportunité de transférer certaines charges vers la taxe sur la valeur ajoutée – ce que l'on appelle la « TVA compétitive » ?
Enfin, j'ai pu lire dans certains programmes politiques l'intention de revenir à la retraite à soixante ans, de créer 300 000 emplois-jeunes, de relancer le recrutement dans l'éducation nationale, la justice ou la police, de mettre en place une allocation d'autonomie pour les jeunes… Pensez-vous que de telles propositions soient en mesure d'améliorer la compétitivité de notre économie ?

Il existe plusieurs formes de compétitivité : la compétitivité prix – moins dégradée pour la France qu'il n'y paraissait –, la compétitivité hors-prix, et la compétitivité liée à la différence des règles sociales. M. Xavier Darcos, lorsqu'il était ministre du travail, avait lancé l'idée de simplifier le code du travail ; pour ma part, je n'ai pas eu la possibilité de poursuivre dans cette voie. Où en est-on aujourd'hui ? S'agit-il d'un faux sujet ou au contraire d'une piste à explorer ? Et dans ce dernier cas, que faudrait-il modifier ? La rupture conventionnelle a apporté un peu de souplesse, mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant.

De nombreux travaux ont été réalisés pour comparer les fiscalités et les économies allemande et française. La différence entre les deux systèmes concerne moins le montant global des dépenses, relativement similaire, si on le rapporte au produit intérieur brut (PIB) marchand, que l'origine des recettes. On fait plus appel à la solidarité – et donc à la fiscalité – en Allemagne qu'en France, où l'essentiel des ressources pèse sur la masse salariale. Or, les dépenses vont augmenter en raison de l'évolution démographique : le vieillissement de la population entraîne un accroissement des dépenses de santé. Dans ces conditions, il semble dangereux de faire dépendre des salaires l'environnement social de personnes qui, par définition, ne travaillent pas : l'assiette va fortement se réduire. Quelle assiette faudrait-il donc retenir ?
Par ailleurs, faut-il revisiter certaines politiques ? La politique familiale ne passe pas que par les allocations, puisque l'impôt sur le revenu est fortement lié au quotient familial. De manière générale, toute une série de politiques tournent autour de la famille.
Enfin, en tant que ministre en charge du travail et de la santé, vous discutez en permanence avec les organisations syndicales. Le mode de gouvernance des institutions de sécurité sociale a été établi à un moment historique fort pour notre pays, mais est-il toujours d'actualité ? Même si les lois sur les syndicats ont fait évoluer les choses, le mode de gestion paritaire des grandes organisations se trouve à la croisée des chemins. Faut-il faire évoluer la gouvernance à moyen terme afin de s'assurer du niveau de responsabilité des acteurs et de leur capacité à innover, tant pour ce qui concerne les politiques qu'ils gèrent que leur mode de financement ?

Nous avons réalisé de nombreuses réformes afin de relancer l'activité économique et donc l'emploi : le grand emprunt, le Fonds de soutien à l'innovation, OSÉO… Mais nos banques ne jouent pas le jeu. Elles sont gérées par des financiers, non par des chefs d'entreprise, et ne soutiennent pas l'activité économique. Dans l'ensemble, nous avons de bons résultats, mais ils pourraient être supérieurs si les banquiers avaient une meilleure compréhension de ce qu'est une entreprise. Or, les responsables locaux n'ont aucun mot à dire sur les demandes de prêt : la décision est prise au niveau régional ou national, et les dossiers n'avancent pas. Nous le constatons tous les jours.
Nous avons sauvé les banques, alors qu'elles sont privées. Ne pourrait-on mieux les contrôler ? Les banques constituent une forme d'administration. Mais alors que l'administration publique a beaucoup évolué, on ne peut pas en dire autant de l'administration bancaire, bien au contraire.

Comme vous l'avez rappelé, les éléments contraignants liés aux 35 heures ont tous été supprimés. Malgré cela, on assiste à des tentatives récurrentes de relancer ce débat, au risque de nuire à la souplesse acquise. Qu'en pensez-vous ?
De même, certains souhaitent ouvrir un débat sur la « TVA sociale ». Le véritable enjeu, pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, reste plutôt de faire en sorte que notre fiscalité favorise l'innovation et de réfléchir à une réforme de l'impôt sur les sociétés. En la matière, notre taux demeure le deuxième plus élevé d'Europe, après Malte, ce qui dissuade les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), de s'installer dans notre pays. En outre, d'après l'Observatoire français des conjonctures économiques, trois points de taxe sur la valeur ajoutée en plus conduisent à un point d'inflation supplémentaire. Il en résulterait également une réduction de revenu de 1,3 point pour les 10 % de ménages les plus modestes, et de 0,7 point pour les 10 % les plus aisés. Une telle hypothèse me paraît donc dangereuse pour notre croissance, pour le pouvoir d'achat des Français et donc pour la compétitivité des entreprises. J'aimerais connaître votre avis sur ce sujet.
Enfin, nous avons eu raison de supprimer la taxe professionnelle sur les investissements productifs, ce qui a fait baisser de 4,7 milliards, l'an dernier, les charges pesant sur les entreprises. Mais cette année, par d'autres biais, les charges ont de nouveau augmenté de 9 milliards. Le taux des prélèvements obligatoires sur les entreprises en France reste le plus élevé d'Europe : il atteignait 17,2 % du produit intérieur brut en 2006, soit 5,7 points au-dessus de la moyenne européenne. Cela me paraît contraire à la compétitivité, aux relocalisations, à l'emploi, et à tout ce que les États généraux de l'industrie devaient promouvoir. C'est également contraire à l'objectif de convergence fiscale avec l'Allemagne. Certes, je comprends la nécessité de réduire le déficit public, qui s'établissait à 150 milliards en 2010. Mais cela ne doit pas se faire au prix de l'innovation, de la compétitivité et de l'emploi.

Ce matin, sur Europe 1, un chroniqueur faisait état d'un classement des pays européens en fonction du revenu par habitant et exprimait sa surprise, au moment où nous sortons de la crise, de voir les Pays-Bas figurer en tête, avant l'Allemagne. Or, ce pays se caractérise par l'extraordinaire flexibilité de son organisation du travail, qui fait l'objet d'un consensus social très large. Là-bas, on évite de licencier, mais on n'hésite pas à baisser les salaires. Pensez-vous qu'il existe un lien direct entre les deux phénomènes : la flexibilité et le haut niveau de revenu par habitant ? Notons que la flexibilité a été mise en place à partir de mécanismes simples. Je me méfie toujours de la complexité et de l'avis technique des experts, qui font perdre l'essentiel de vue.

Il est difficile, sur certains territoires, de mettre en adéquation les offres et les demandes d'emploi, ainsi que l'a relevé tout à l'heure M. Pierre Méhaignerie. Vous avez évoqué, monsieur le ministre, la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et du réseau des Assedic et de leurs cultures respectives, le tout en pleine période de crise. Comment devrait évoluer Pôle emploi pour conforter son action, en particulier s'agissant de l'anticipation des besoins des entreprises et de la meilleure adéquation des formations et des compétences à la demande d'emploi sur les différents territoires ?
D'autres dispositifs ont été mis en oeuvre, comme les maisons de l'emploi, intégrant quelquefois les comités de bassin d'emploi et les missions locales. Quel bilan peut-on tirer de ces initiatives ? Est-il possible de renforcer le dialogue social au sein de ces institutions en intégrant les chefs d'entreprises, les élus, les représentants des salariés, les services de l'État, voire les structures d'insertion, de façon à donner plus de cohérence aux mesures prises dans les territoires concernés ?

Depuis quelques années, la compétitivité de notre pays a effectivement été améliorée en matière de formation, de recherche et développement et de l'indemnisation du chômage partiel, qui a permis de sauvegarder de nombreux emplois dans les régions industrielles.
Ce qui m'inquiète, c'est l'endettement de la France : à 86 % du produit intérieur brut, nous sommes dans une zone à risques. Comment s'en éloigner tout en préservant notre compétitivité, c'est-à-dire en continuant à investir dans les domaines essentiels que sont la recherche et développement ou la formation ?
Je m'exprimerai en tant que ministre du travail, de l'emploi et de la santé, mais pas uniquement, car vous m'avez posé de nombreuses questions ne relevant pas de mes attributions directes. Je vous livrerai donc certaines de mes convictions personnelles, d'autant plus que la compétitivité et le financement de la protection sociale seront, sans doute, au coeur de la campagne présidentielle.
Monsieur Gérard Cherpion, l'enjeu pour la France, dans les années qui viennent, réside à la fois dans la diminution des déficits et de la dette et la réduction du coût du travail, tout en gardant à l'esprit que les dépenses publiques génèrent en elles-mêmes de la croissance. Il faut donc faire très attention à celles que l'on réduit ou que l'on supprime.
Il en va ainsi des niches fiscales et sociales, dont il convient avant tout d'évaluer l'effet de levier. Supprimez l'avantage fiscal sur les emplois à domicile ou le taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit dans le bâtiment, et le travail clandestin se développera aussitôt. Il faut procéder à des évaluations très fines afin de déterminer si, oui ou non, ces mesures ont un effet positif.
Dans le même esprit, il convient de se demander si la puissance publique est la plus apte à gérer une activité au meilleur coût, car ce n'est pas toujours le cas. Les nombreux maires ici présents savent qu'il vaut la peine de « municipaliser » dans certains cas, mais pas toujours. Le pragmatisme doit nous guider dans la recherche d'une réduction des déficits et de la dette.
Nous devons faire face à des enjeux sociétaux : pour être acceptées, les réformes à venir devront être perçues comme justes. Et s'il faut lutter contre l'assistanat, ennemi de la valeur travail, il faut également lutter contre les injustices. Mais il existe aussi un enjeu économique : réduire les déficits et baisser le coût du travail. Les deux orientations ne sont pas antinomiques.
De même, monsieur Jean Grellier, la meilleure connexion entre les besoins des entreprises et les attentes des demandeurs d'emploi constitue un enjeu essentiel. Mais ce que vous appelez de vos voeux existe d'ores et déjà : ce sont les services publics de l'emploi. Il y a encore quelques mois, il s'agissait d'un outil très institutionnel : des réunions se tenaient irrégulièrement autour du préfet pour déterminer les attributions de chacun et évaluer les résultats. Mais nous sommes en train d'en faire une instance fonctionnelle et opérationnelle. Désormais, les services publics de l'emploi auront pour mission, dans chaque bassin d'emploi, de recenser les besoins et les problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande. Tous les mois, seront examinés les trois à cinq métiers les plus en tension, afin de savoir qui guide les demandeurs d'emploi vers l'emploi.
J'ai à coeur de réussir jusqu'au bout la création de Pôle emploi et de lui attribuer une nouvelle feuille de route en sortie de crise. Mais si c'est une mission locale ou une maison de l'emploi qui ramène les chômeurs vers l'emploi, cela me va aussi. Pôle emploi demeure certes l'opérateur principal, mais je recherche avant tout l'efficacité. Cette démarche pragmatique est d'ailleurs celle des services publics de l'emploi. J'ai indiqué moi-même aux différents acteurs – et notamment aux sous-préfets – qu'ils ont vocation à être les ministres du travail et de l'emploi dans chacun des bassins, en associant les élus et les partenaires sociaux.
Les propos de M. Christian Blanc me laissent songeur : je ne suis pas pour un arbitrage entre emploi et salaire. En effet, le niveau de salaire dans notre pays est moins élevé qu'ailleurs, à cause de la politique salariale, sans doute, mais surtout parce que nous avons arbitré entre le niveau de protection sociale et celui des salaires. La faiblesse de nombreuses pensions de retraite tient au déroulement des carrières, mais aussi à des niveaux de salaires qui ont pu être très bas – trop bas, dans certains cas. C'est pourquoi je ne crois pas à l'arbitrage entre emploi et salaire. Certes, le salaire pèse directement sur la productivité et la compétitivité, mais je crois profondément à l'extra-salarial : l'intéressement et la participation – sans parler de la « prime contre dividendes ». Il faut, avec les négociations annuelles obligatoires, donner de la visibilité en matière salariale. Mais il faut aussi développer les mesures qui associent réellement les salariés aux résultats et à l'évolution de l'entreprise : intéressement, participation, actionnariat salarié, accès des salariés aux leviers de décision de l'entreprise.
En revanche, il est un point sur lequel on doit continuer à progresser : la « flexisécurité ». Tout le monde est d'accord pour l'évoquer, mais les salariés entendent « flexibilité » plutôt que « sécurité ». Nous avons avancé avec le contrat de transition professionnelle, et désormais avec le contrat de sécurisation professionnelle, qui a été adopté par les partenaires sociaux et qui figurait dans la proposition de loi de M. Gérard Cherpion. Tout cela va dans le bon sens, mais nous devons aller beaucoup plus loin.
Je ne partage pas l'avis de M. Jean-Claude Trichet, qui affirmait qu'il fallait bloquer les salaires. Il est compliqué de dire à des salariés qui se sont serré la ceinture pendant la crise qu'ils devront continuer à le faire au moment où les résultats des entreprises et où certaines rémunérations progressent.
Mais nous n'avons pas la même histoire, et surtout pas le même niveau de protection sociale. En France, les dépenses dans ce domaine représentent 31 % du produit intérieur brut, contre 27 % dans les quinze pays de l'Union européenne qui se rapprochent le plus du nôtre. Les cotisations représentent 65 % du financement de la protection sociale, contre 58 % dans ces mêmes pays. Nous sommes donc largement au-dessus, ce qui explique la différence de salaires.
M. Christian Estrosi a évoqué les 35 heures et la « TVA sociale ». Selon moi, nous sommes sortis des 35 heures. Le système des heures supplémentaires que nous avons mis en place permet, grâce aux exonérations de charges sociales, de donner davantage de pouvoir d'achat aux salariés, sans que cela pèse sur les entrepreneurs. En effet, ce n'est pas l'État qui fixe les salaires, et nous n'avions donc pas la possibilité de convaincre qui que ce soit de les augmenter. Il a fallu trouver une façon de donner plus de pouvoir d'achat à ceux qui travaillent plus. Si nous décidons de changer le seuil de référence, en le portant à 37 ou 38 heures, aussi savante soit la négociation, cela aura pour effet de revenir sur la majoration de salaire liée aux heures supplémentaires, au détriment des salariés.
Si on veut alléger le coût du travail, il faut jouer sur le niveau et la composition des charges plutôt que sur le niveau de revenus – salaire et heures supplémentaires des salariés. Dans le cas contraire, non seulement ces derniers seraient pénalisés, mais la consommation s'en ressentirait, ce qui aurait un impact économique.
Le coût du travail n'est pas si différent en France et en Allemagne : si l'on prend en compte aussi bien le coût social que le coût fiscal, il est respectivement de 49,2 % et de 50,9 %. Pour autant, la nécessité de réduire le coût du travail reste une évidence : il faut transférer une partie des charges qui pèsent sur le travail, sans quoi tous les discours que nous tenons sur le sujet atteindront très vite leurs limites.
On peut suivre différentes pistes. Mais si on augmente la taxe sur la valeur ajoutée, on ne peut plus parler de convergence franco-allemande. Le taux en Allemagne est déjà de 19 %, contre 19,6 % en France. Si nous l'augmentons d'un ou deux points, l'écart sera encore plus élevé.
Mais en augmentant les taux intermédiaires, on pénalise les plus bas revenus. Vous aurez du mal à me convaincre de l'effet redistributif de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, M. Christian Estrosi a souligné l'impact d'une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'inflation.
Peut-être. Mais si on sait quand commence l'inflation, on ne sait pas à quel moment elle s'arrête. Cela fait peser un risque sur les salaires.
Du reste, la mise en place d'une « TVA sociale » devrait entraîner non seulement une réduction des cotisations sociales patronales, mais aussi la baisse des cotisations salariales, sans quoi le pouvoir d'achat serait remis en question. De même, les retraités seraient directement pénalisés ; comment interviendrait-on sur leurs pensions ? Lorsque l'on envisage de mettre en place la « TVA sociale », il faut donc en étudier toutes les conséquences. Vous l'avez compris, je suis réservé à ce sujet.
Que faire, alors ? Le transfert des cotisations familiales semble une voie intéressante : sur ce point, tout le monde est plutôt d'accord. Mais il existe d'autres pistes, comme l'alignement de la fiscalité des revenus du capital et du travail – qui n'a jamais été réalisé complètement, alors qu'il y a plusieurs milliards d'euros à la clé – ou le recours à la contribution sociale généralisée (CSG), beaucoup plus redistributive.
Le débat est certes légitime. Mais quel que soit le nom qui lui est donné – « TVA sociale », « TVA anti-délocalisation » –, cette mesure n'est pas une solution miracle. Elle est en outre très difficile à expliquer aux Français. Enfin, dans une économie mondialisée, elle aurait un impact négatif de 20 % à 25 % sur les importations.
Si on examine les chiffres bruts, monsieur Alain Moyne-Bressand, on peut dire que les banques financent l'économie. Mais il est évident qu'elles pourraient le faire davantage. Le problème reste que les centres de décisions sont éloignés des régions et donc du terrain. Dans la grande majorité des cas, les personnes sollicitées pour un prêt sont obligées d'en référer à un niveau supérieur. Sur ce point la France pèche par rapport à l'Allemagne.
Certaines banques, monsieur le Président, sont mieux ancrées dans les territoires et financent davantage le développement économique, par exemple, en Savoie et en Haute-Savoie. À cet égard, on voit parfois de vraies différences entre les réseaux mutualistes ou coopératifs et les grands réseaux.
Cela étant, nous pouvons aller beaucoup plus loin avec OSÉO, qui est sur le point de changer de vocation : elle peut devenir une vraie banque du développement et jouer un grand rôle dans les régions.
M. Olivier Carré s'est demandé s'il fallait revoir certaines politiques de l'emploi. Il est vrai qu'il faut savoir passer au crible certaines aides.
Pour les politiques sociales comme pour les politiques de l'emploi, il faut à chaque fois se poser la question de l'efficacité. Si je suis aussi engagé, depuis 2004, dans la lutte contre les fraudes et les gaspillages, c'est parce qu'elles représentent un coût dont nous ne pouvons plus nous permettre le luxe. Avec ces milliards d'euros dépensés en pure perte, je préférerais diminuer les déficits ou mieux rembourser certains actes. Le chiffre avancé par le rapport de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur la fraude sociale ne me surprend pas : j'ai toujours dit que la fraude, au sens large, atteignait 30 à 35 milliards d'euros. Or la fraude fiscale est passée de 15 à 16 milliards d'euros. Quant aux sommes que nous économisons grâce à la lutte contre la fraude, elles ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. S'agissant de la pertinence de certaines politiques, le débat n'est donc pas illégitime.
Les systèmes de gouvernance de la protection sociale sont-ils complètement obsolètes ? Je n'en suis pas sûr. Il faut maintenir le paritarisme, voire les négociations tripartites. Lorsque les partenaires sociaux se mettent d'accord entre eux et avec l'État, ils parviennent à trouver de bonnes solutions, comme pour le contrat de sécurisation professionnelle. Le système de gouvernance de l'assurance maladie, qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2004, me semble aujourd'hui concilier le respect des partenaires sociaux et l'exigence d'efficacité. Cela étant, des évolutions restent possibles. Faut-il rester dans un strict paritarisme ou faut-il établir des passerelles avec d'autres organisations ? L'essentiel demeure de ne pas adopter une approche idéologique.
La loi « Larcher » nous impose le dialogue social dans tous les cas. Mais il ne s'agit pas d'opposer la légitimité politique et la légitimité sociale. L'élection présidentielle sera l'occasion pour chacun d'exprimer la direction dans laquelle il souhaite aller, mais le meilleur moyen pour y aller reste la négociation. Ce qu'il faut, c'est la volonté d'aboutir.
Les effets de seuil sont un thème sur lequel la négociation doit avancer. Il existe aujourd'hui huit seuils, générant une quinzaine d'obligations différentes. Le fait que les petites et moyennes entreprises allemandes réussissent mieux que les françaises tient à plusieurs facteurs, dont l'efficacité du financement de l'économie régionale et le recours systématique à l'export – notamment vers les marchés émergents. Mais les seuils fiscaux, sociaux, voire psychologiques jouent également pour beaucoup. De nombreux entrepreneurs hésitent à passer de 48 salariés à 52. Ils savent qu'ils devront miser une certaine somme, parce qu'ils seront obligés de se mettre à niveau avant même de savoir s'ils obtiendront des marchés en accroissant leur taille. Faut-il un dispositif de lissage ou de gel temporaire des obligations, de façon à éviter cette mise de départ ? Seule la négociation peut permettre d'avancer sur le sujet. En tout état de cause, les effets de seuil font partie des freins qui entravent la transformation de nos petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire et les empêchent de rivaliser avec leurs concurrentes allemandes.
Nous ne devons pas compliquer la tâche de nos grands groupes, mais au contraire les aider à devenir des leaders mondiaux. Quant aux très petites entreprises, on peut désormais les créer beaucoup plus facilement. L'institution des auto-entrepreneurs a été, à cet égard, une mesure forte. De même, les dispositions prises par M. Renaud Dutreil en direction des « gazelles » ont permis de changer la donne. Mais il faut que les petites et moyennes entreprises deviennent beaucoup plus grandes. Or, elles doivent faire face à de nombreuses résistances.
J'en reviens à la question de la durée du travail. Nous devons augmenter la quantité de travail en France. Mais les règles actuelles en matière de droit du travail ne l'empêchent pas, contrairement à ce qu'affirment certains.
L'instabilité de la norme, qu'elle soit fiscale ou sociale, constitue un autre grand problème, dans notre pays. Chaque projet de loi de finances, chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale est un véritable concours Lépine : les administrations sont souvent tentées de ressortir des projets qui encombrent leurs tiroirs, et de nombreux parlementaires en rajoutent avec leurs amendements. Or, dans notre système médiatique, même si un projet n'aboutit pas totalement, il suffit à susciter une inquiétude et à donner le sentiment de remettre en cause l'état de la réglementation. De nombreux entrepreneurs regrettent que les règles changent aussi souvent, car pour investir, il faut de la visibilité, et donc de la stabilité.
Il faudrait faire en sorte de ne pas modifier les règles pendant une certaine période, sauf événement exceptionnel. Mais comment ? Conventionnellement ? Je n'y crois pas. Constitutionnellement ? Cela semble complexe, comme le montre la difficulté à mettre en place la « règle d'or » en matière de finances publiques. Il faudrait que chacun laisse de côté les réflexes idéologiques et partisans. Quoi qu'il en soit, il faut en finir avec une instabilité chronique dont les effets sont désastreux.
L'application du programme du parti socialiste, monsieur Marc Laffineur, représenterait un danger mortel pour notre économie et notre compétitivité. Je ne sais pas d'ailleurs qui en assume vraiment la responsabilité – on reste dans les grandes déclarations. Le retour à la retraite à soixante ans coûterait 20 milliards d'euros par an, et nous ne sommes pas en mesure de financer des emplois-jeunes, dont le coût serait probablement de plus de 5 milliards d'euros. Dans ces conditions, on peut oublier tous les discours sur la réduction de la dette.
Les exonérations de charges font l'objet de nombreux débats. Mais une étude du Conseil d'orientation pour l'emploi, dont les résultats n'ont jamais été démentis, chiffre à 800 000 le nombre d'emplois maintenus ou créés grâce aux allègements « Fillon ».
M. Pierre Méhaignerie me demande quelle serait ma priorité parmi des sujets tels que l'innovation, la place de l'industrie, la formation professionnelle et le coût du travail. Tout est lié, mais pour moi, le coût du travail reste une question fondamentale, si nous voulons maintenir et créer des emplois. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les autres préoccupations citées ne soient pas importantes.
Cela étant, nous devons aussi mener un combat international en faveur d'un socle de protection sociale et du respect des normes en la matière. Je lisais aujourd'hui une étude selon laquelle de nombreux pays en voie de développement atteindraient en 2017 des niveaux de charges et de salaires tels que la compétition ne serait plus disproportionnée comme elle l'est aujourd'hui. Mais, en attendant, nous devons agir vite sur le coût du travail.
Quant à l'attitude des Français à l'égard de l'industrie, elle ne relève pas de la fatalité. La logique qui a inspiré M. Christian Estrosi avec les États généraux de l'industrie doit être poursuivie. Ce n'est pas que les Français n'aiment pas ce secteur, mais de nombreux responsables économiques ont pensé naguère que l'on trouverait plus de valeur ajoutée dans les services. Les Anglais ont tenu ce raisonnement avec la finance, et les Espagnols avec l'immobilier. Mais dans un pays comme la France, où le secteur primaire compte toujours beaucoup, se priver du maillon essentiel de la chaîne économique qu'est le secteur secondaire serait une folie. Nous l'avons vu pendant la crise : ceux qui avaient mis tous leurs oeufs dans le même panier se sont retrouvés à genoux. L'intérêt de notre pays est de conforter son industrie en choisissant les marchés et en se développant dans les pays émergents.
En tout état de cause, on se tromperait lourdement si on pensait que le secteur tertiaire profiterait d'un affaiblissement du secteur secondaire. Si l'emploi industriel a reculé dans notre pays, c'est aussi, en effet, à cause des externalisations. Dans de nombreuses entreprises, la restauration, le gardiennage sont des emplois que l'on considérait hier comme industriels et qui ne le sont plus aujourd'hui. Dans une rue de ma ville, j'ai compté jusqu'à 5 000 emplois liés au textile ; aujourd'hui, il n'y en a plus que 50, tous dans le commerce. Tout a disparu avec l'industrie textile, mais il n'est pas trop tard pour relancer le secteur secondaire.

Vous avez parlé de négociations salariales. Ne serait-il pas possible d'intégrer quelques dispositions de simplification des effets de seuil dans la proposition de loi de simplification du président Jean-Luc Warsmann ? Et pour que les syndicats ne disent pas qu'il n'y a pas eu de négociations, ne pourrait-on entamer quelques approches concrètes sur la simplification du droit du travail et des effets de seuil ?

Une loi de simplification est par nature un « fourre-tout » et les dispositions qu'elle contient ne sont pas visibles. Or, nous avons besoin d'une approche cohérente de la compétitivité, afin de peser sur l'état d'esprit des entrepreneurs.
Je crois profondément à la simplification, s'agissant de la vie des entreprises comme pour tous les rapports sociaux. Mais les réformes, dans ce domaine, sont peu visibles et prêtent souvent à sourire. Les entrepreneurs sont souvent inquiets quand on leur parle de simplification, car ils s'attendent à un effet inverse. Ils sont tellement habitués à vivre avec la complexité qu'ils ont du mal à s'en débarrasser.
Le rôle des politiques n'est pas de créer de l'emploi, mais de créer les conditions pour que les entrepreneurs recrutent, ce qui implique de ne pas leur compliquer la vie. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie avait institué, pour la période allant de 2008 à 2010, une atténuation des effets de seuil liés à la participation à la formation professionnelle et au versement transport. Ce dispositif a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2011. Des évolutions sont donc possibles.
Parmi les mesures envisagées, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la proposition de loi de M. Gérard Cherpion, figurent la simplification de l'enregistrement des contrats d'apprentissage, la dématérialisation des échanges pour faciliter le recrutement des salariés en alternance, la simplification du bulletin de paie – qui est très facile à mettre en oeuvre – et celle du régime d'activité partielle. Mais comme l'a dit M. Éric Woerth, si de telles mesures de simplification sont prises de manière incidente, elles restent ignorées, parce que les administrations ont du mal à faire connaître les allégements de procédure. Nous avons besoin d'un grand mouvement d'ensemble en la matière. À cet égard, une négociation sociale ne ferait pas perdre trop de temps, mais pourrait permettre, de façon très pragmatique, d'atteindre une efficacité qui, en fin de compte, profiterait à tout le monde.
En 2010, nous avons compté 255 000 ruptures conventionnelles, et la moyenne mensuelle atteint 21 700 en 2011. Au total, 560 000 ruptures conventionnelles avaient été homologuées en avril 2011. Ce n'est pas une explosion : les ruptures conventionnelles représentent 10 % des sorties d'emploi, loin derrière les licenciements et les démissions. En proportion, elles ne touchent pas beaucoup plus les seniors. Mais le fait de se mettre autour d'une table pour discuter d'un départ plutôt que de rechercher l'adresse du conseil des prud'hommes le plus proche constitue, en France, une révolution. Cela n'enlève rien aux droits des salariés, mais cela favorise la fluidité du marché du travail. C'est donc une mesure qui va dans le bon sens.
La séance est levée à dix-sept heures quinze.