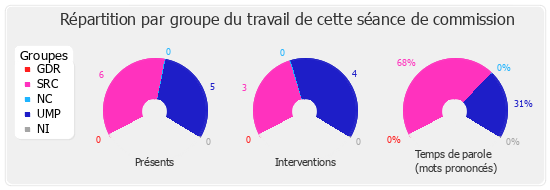Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale
Séance du 23 mars 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
Mercredi 23 mars 2011
La séance est ouverte à seize heures quinze.
(Présidence de M. Marc Laffineur, vice-président de la Mission d'information)
La Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale entend, en audition ouverte à la presse, M. Jean-Philippe Bourgoin, directeur de la stratégie et des programmes du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), M. Élie Cohen, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), professeur à Sciences-po et membre du Conseil d'analyse économique, et Mme Bénédicte Zimmermann, directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Le débat sur la divergence de compétitivité entre la France et l'Allemagne a été lancé par le dernier rapport du Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement de l'entreprise (COE-Rexecode), mais les thèmes de la compétitivité, de la désindustrialisation et, plus récemment, des délocalisations reviennent à l'occasion de chaque crise : en 1974 comme en 1979, en 1993, en 2002 ou en 2008.
Quelles sont, en la matière, les données les moins contestables ?
La première est que la part de marché de la France dans le commerce international s'est effondrée, passant de 5,8 % en 1995 à 3,8 % en 2010, tandis que celle de l'Allemagne demeurait de 10,1 %. Nous avons donc perdu près de 40 % de nos parts de marché ou, pour le dire autrement, notre produit intérieur brut (PIB) serait supérieur de 150 milliards d'euros à ce qu'il est aujourd'hui si notre part de marché était demeurée la même. On ne peut donc que constater la brutalité et l'accélération récente de cet effondrement, qui affecte tous les secteurs économiques et toutes les parties du monde, au-delà des seuls pays émergents.
Dans la mesure où près des trois quarts des échanges commerciaux internationaux portant sur les produits industriels, le fait que notre industrie ne représente plus que 15 % de notre valeur ajoutée a bien évidemment un impact direct sur nos exportations.
Le Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement de l'entreprise considère que, dans la mesure où il n'y a pas eu de variation majeure en termes de compétitivité hors coût, c'est en matière de compétitivité-coût que nous avons « décroché » au cours des dix dernières années. Cette affirmation a entraîné tout un débat sur la qualité et la fiabilité des statistiques utilisées. Cependant un consensus à peu près général se dégage autour de l'idée que nous avons perdu de 8 à 10 points de compétitivité-coût par rapport à l'Allemagne. Nous nous éloignons donc des leaders que sont l'Allemagne, la Finlande et l'Autriche : le fait que nous demeurions en avance sur des pays qui ont massivement décroché, comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, n'est qu'une piètre consolation.
La France et l'Allemagne ont les mêmes spécialisations et se battent sur les mêmes marchés. Il y a dix ans, il nous arrivait d'emporter des parts de marché grâce à un avantage de compétitivité-coût de 8 à 10 %. Dès lors que cet avantage a disparu, nous perdons systématiquement car l'Allemagne jouit d'une meilleure compétitivité hors coût liée à la plus grande capacité de différenciation de ses produits, qui sont perçus comme étant de qualité.
Pour autant, les dix dernières années, l'évolution du produit intérieur brut par habitant a été sensiblement la même dans les deux pays. Si la France a pu maintenir sa croissance en dépit de différentiels de coûts très importants, parce que celle-ci a été tirée par la consommation, qui a elle-même été surtout portée par des dépenses de redistribution très largement financées à crédit. Un tel système n'est absolument pas soutenable à plus long terme car la conjonction du déficit de balance courante et du déficit budgétaire met la France sur une trajectoire d'insolvabilité. C'est pour cela qu'il faut s'intéresser de près à la compétitivité, en particulier au sein de l'industrie, qui est le moteur de l'exportation.
Dans son dernier rapport en cours de rédaction, intitulé « Crise et croissance », le Conseil d'analyse économique s'est donc efforcé de comprendre le décrochage industriel de la France.
Le Conseil d'analyse économique a constaté que, les dix dernières années, les efforts d'investissement des entreprises non financières ont été similaires en France et en Allemagne. Cela tient peut-être au fait que l'économie française dispose de grosses entreprises remarquables, mais qu'elle n'a que peu d'entreprises de taille intermédiaire, tandis que ses petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) sont moins dynamiques que leurs homologues allemandes. De surcroît, nos entreprises de taille intermédiaire et nos petites et moyennes entreprises sont en situation de sous-investissement. De même, nous sous-investissons dans les secteurs les plus porteurs pour le commerce international, notamment les biens d'équipement, intermédiaires et de consommation. Pis : le fossé se creuse entre les investissements français et allemands dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, déterminantes pour la productivité de demain. La part de recherche et développement (R&D), des entreprises industrielles dans le produit intérieur brut a régulièrement baissé en France, tandis qu'elle augmentait systématiquement en Allemagne, au Japon et chez plusieurs autres de nos concurrents, ce phénomène ayant même tendance à s'aggraver, en dépit d'une certaine prise de conscience. De 2000 à 2008, l'effort de R&D par rapport au produit intérieur brut a été en moyenne de 2,3 % en France, contre 2,8 % en Allemagne, 3 % aux États-Unis, 3,4 % au Japon. Par ailleurs, la France dépose 2,5 fois moins de brevets que l'Allemagne.
Au total, on observe une sorte d'enchaînement délétère : les entreprises n'osant pas investir pour innover et pour exporter, elles ne croissent pas autant qu'elles le pourraient. Leurs marges s'en trouvent réduites et leur situation financière se dégrade, les contraignant à recourir à des financements externes qu'elles ont de plus en plus de difficultés à se procurer. La fin d'un tel processus est la cession d'une partie de notre tissu industriel à des investisseurs étrangers, tout simplement parce que la rentabilité de nos entreprises industrielles décroît et qu'elle est très inférieure à celle de nos concurrents européens. En insistant tant sur les profits « obscènes » des entreprises de la cotation assistée en continu (CAC 40), on oublie ce grave problème de rentabilité de nos entreprises industrielles.
Ma contribution sera davantage centrée sur l'apport de la R&D à l'innovation. Je serai un peu plus optimiste que mon prédécesseur, en lui indiquant que le pourcentage de son produit intérieur brut que la France consacre à la R&D est remonté en 2009 à 2,21 % et devrait être encore meilleur en 2010. Pour autant, on n'atteindra pas avant longtemps le taux de 3 % qui est l'objectif de l'Europe et des États-Unis, le Japon et la Corée ayant des taux encore supérieurs.
En 2009, la France se situait au onzième rang mondial en termes d'intensité de R&D et au sixième – derrière les États-Unis, le Japon la Chine, l'Allemagne et la Corée – en volume de dépenses. Elle demeure le sixième pays déposant de brevets.
Cette faible intensité relative de la R&D s'explique d'une part par la spécialisation sectorielle de notre industrie, principalement composée de filières peu intensives en R&D, et, d'autre part, par une démographie de nos entreprises en déficit de petites et moyennes entreprises importantes et d'entreprises de taille intermédiaire investissant dans la R&D. Combler le différentiel avec les Allemands prendra donc du temps et nécessitera que notre culture comme notre outil de production évoluent.
La France est très bien placée – au troisième rang après la Corée et le Canada, à égalité avec les États-Unis – pour le soutien public à la R&D, en particulier grâce au crédit d'impôt-recherche, qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur dispositif au monde, en excellente adéquation avec ses objectifs : améliorer l'attractivité de la France et favoriser à la fois la R&D dans les petites et moyennes entreprises, le partenariat public-privé et l'embauche de jeunes docteurs.
L'efficacité du lien entre amont et aval paraît particulièrement importante pour la dynamique de l'innovation fondée sur la R&D. L'innovation est de plus en plus le fait de grands clusters mondiaux, peu nombreux, qui atteignent une masse critique en matière d'innovation, de recherche et de formation, et qui irriguent les régions limitrophes. En leur sein, l'Île-de-France est au neuvième rang mondial pour le dépôt de brevets et Rhône-Alpes au vingt-neuvième.
J'en viens à l'apport de la R&D à la capacité d'innovation des entreprises. Exerçant le métier spécifique qui consiste à coupler la recherche en amont et en aval, les instituts Carnot et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives représentent respectivement 13 % et 8,5 % de la recherche publique et 45 % et 33 % de la recherche en partenariat public-privé. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est le premier déposant de brevets au monde qui ne soit pas une entreprise. Nous conservons donc quelques points forts dans la compétition internationale, et c'est ce qui m'incite à l'optimisme.
Il est essentiel de couvrir tous les niveaux de maturité de l'innovation technologique, depuis les idées jusqu'aux produits. Les organismes de recherche technologique facilitent le fonctionnement et l'intégration verticale au sein des filières. Ainsi, dans la micro-électronique, le laboratoire d'électronique des technologies de l'information (LETI) soutient, au coeur de l'écosystème d'innovation à Grenoble, un ensemble de 15 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects. En vingt ans, il a bénéficié de 500 emplois publics et l'on en mesure les effets puisque les jeunes entreprises qui ont été créées font aujourd'hui travailler 2 500 personnes. Ce laboratoire et ceux qui travaillent avec lui soutiennent directement la filière nationale de micro-électronique, qui représente pas moins de 70 000 emplois. Le rapport que M. Laurent Malier, directeur du laboratoire, a rendu au précédent ministre de l'industrie, M. Christian Estrosi, montre que cette filière est durablement viable, moyennant un soutien à l'investissement et à la spécialisation d'un certain nombre de sites.
L'exemple du solaire confirme l'importance de couvrir l'ensemble de la chaîne de maturité technologique pour stabiliser toute une filière. Ayant atteint une masse critique de deux cent cinquante chercheurs, l'Institut national de l'industrie solaire, créé en 2005 à Chambéry, figure parmi les trois meilleurs organismes européens et vise rapidement une des trois premières places mondiales. Il compte 156 partenariats actifs avec les entreprises nationales, soit avec les quatre-cinquièmes d'une filière qui représente 25 000 emplois.
Il est également très important d'être présent sur le terrain du développement des technologies clés habilitantes – les key enabling technologies – qui couvrent la micro-nano-électronique, la photonique, les biotechnologies, les matériaux, le manufacturing, les nanotechnologies. L'Union européenne, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Corée les ont identifiées comme indispensables à l'innovation. Leur marché, qui représentait en 2008 plus de 830 milliards de dollars, conditionne plusieurs millions d'emplois en Europe. Leur combinaison est une des clés de l'innovation, qui bénéficie aussi aux entreprises traditionnelles. Ainsi la société RYB, implantée en Rhône-Alpes et spécialiste des tuyaux en polyéthylène, est la première entreprise au monde capable de maîtriser et de vendre une canalisation plastique détectable et communicante, même enterrée. Une telle avancée devrait se traduire par la création de plusieurs centaines d'emplois.
Outre les avancées technologiques, l'innovation peut permettre d'améliorer l'organisation des entreprises. Ainsi, les constructeurs automobiles utilisent des simulateurs à retour d'effort pour former leurs personnels. Pour leur part, les sociétés d'assurance ont recours à des services liés à la modélisation du climat pour calculer le taux de leurs primes.
Dans le cadre des nouvelles méthodes d'innovation, nous avons créé, il y a dix ans, à Grenoble, un laboratoire d'idées qui fait travailler ensemble sciences humaines et sociales, technologues et usagers. Notre laboratoire de démonstration permet de montrer concrètement aux visiteurs les applications des nouvelles technologies.
Afin de maximiser l'effet de la R&D sur l'innovation, il me semble tout d'abord important que les moyens de soutien soient constants. Il faut ensuite accélérer la constitution des écosystèmes d'innovation, qui a été favorisée par les investissements d'avenir. Il est également indispensable de combler ce que l'on appelle la « vallée de la mort », c'est-à-dire de ne pas oublier qu'il faut passer de l'idée à la technologie, de la technologie au produit et du produit à sa fabrication en grande série. Cela suppose de réaliser les investissements nécessaires, y compris dans l'outil de production, en étant conscient que la recherche technologique est la clé de ces investissements.
Je vais m'efforcer d'apporter un éclairage socio-historique sur le modèle allemand et sur l'utilisation qui en est faite dans les débats actuels sur le différentiel de croissance entre nos deux pays.
Après m'être employée à dissiper quelques malentendus relatifs au modèle allemand, j'insisterai sur une dimension qui me paraît décisive dans la dynamique des sorties de crise de l'Allemagne – pas seulement aujourd'hui, mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – et qui, étonnamment, n'est jamais évoquée : il s'agit de la conception même de la relation salariale, de l'entreprise vue comme collectif de travail et, par conséquent, de la place des travailleurs dans le processus de production de valeur et de richesse.
Le modèle allemand tant évoqué depuis quelques mois est selon moi introuvable. En effet, on fait tout à la fois référence à un modèle historique et à toutes ses remises en cause récentes. Ainsi, la croissance allemande repose sur un mélange qui peut devenir explosif entre, d'une part, des pratiques héritées de l'économie sociale de marché, dans laquelle employeurs et salariés font converger leurs efforts en vue du bien commun de la nation lorsque la puissance de cette dernière semble menacée et, d'autre part, des politiques qui révisent à la baisse la protection et l'intégration sociales. Cette confusion fondamentale doit être levée.
D'un point de vue structurel, le modèle historique – qui date de la République de Weimar, qui a été consolidé par la Loi fondamentale de 1949 et qui est resté très actif jusqu'à la fin des années 1990 – s'appuie sur un tissu dense de petites et moyennes entreprises, en particulier au sud et à l'ouest du pays, et sur un système politique fédéral fondé sur le principe de subsidiarité, lequel favorise une gouvernance et une régulation décentralisées susceptibles d'être très finement adaptées à la spécificité des différents bassins d'emploi.
Au-delà, ce modèle repose sur la force du dialogue social dans les branches et dans les entreprises ; sur l'identification des employeurs et des salariés à une communauté de production, au niveau tant national que de l'entreprise ; sur un mode de gouvernance de l'entreprise fondé sur la codétermination et la participation des salariés, dans une optique de recherche de l'intérêt partagé et de la paix sociale ; sur le tripartisme, qui renvoie à une tradition de coopération entre entreprises, représentants de salariés et pouvoirs publics – le dernier pacte tripartite « pour l'emploi, la formation et la compétitivité », conclu en 1998 sous le gouvernement de M. Gerhard Schröder, a volé en éclats en 2002 – ; et enfin sur un système de protection sociale cofinancé par les employeurs et par les salariés au moyen de prélèvements sur les salaires.
Les indices de rupture de ce modèle sont d'abord perceptibles sur le plan structurel : la globalisation, les délocalisations et la sous-traitance ont bousculé la coopération entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises, de telle sorte que le nombre d'entreprises liées par une convention de branche diminue, tout comme celui des salariés couverts. Ce modèle est ensuite menacé sur le plan des principes politiques : en 2003, les lois Hartz ont provoqué un changement de paradigme dans la régulation du marché du travail. En effet, elles ont consacré le passage de l'État social au workfare dans lequel toute prestation sociale appelle un travail ; elles ont aussi marqué un basculement de la responsabilité collective à la responsabilité individuelle, notamment en cas de chômage. L'idée force est d'« activer » les chômeurs. Pour ce faire, l'allocation de chômage a été réduite à douze mois pour les moins de quarante-cinq ans, période à l'issue de laquelle le bénéfice de l'aide sociale est subordonné au retour à l'emploi. Dans le même temps, on a fortement incité à la création massive d'emplois à des conditions dégradées, tels que les emplois à moins de 5 euros nets de l'heure et à moins de 400 euros nets par mois.
Ces mesures ont mécaniquement fait chuter le taux de chômage, mais elles ont aussi considérablement augmenté la précarité et la pauvreté. Moins de chômeurs, mais plus de pauvres : est-ce un modèle enviable pour la France ?
En outre, ce basculement statistique du chômage vers la pauvreté s'accompagne d'une forte stigmatisation des chômeurs. Il en résulte un clivage social marqué entre les salariés en contrats à durée indéterminée et ceux qui évoluent aux marges du marché du travail.
La réduction des prestations sociales est peut-être en passe de devenir la marque d'un modèle allemand renouvelé. Mais est-elle compatible avec les autres aspects du modèle classique, que l'on a vus à l'oeuvre lors de la dernière sortie de crise, en particulier avec l'implication des salariés et des employeurs dans une communauté de production solidairement responsable ? On ne peut faire abstraction de cette question lorsque l'on analyse la dynamique de croissance allemande car la compétitivité ne saurait se concevoir sans l'engagement des salariés. Si la France a une chose à apprendre de l'Allemagne, c'est peut-être la capacité à développer des organisations du travail participatives qui favorisent la motivation et l'engagement des salariés plutôt qu'elles ne les découragent. Si les Allemands sont en la matière plus « forts » que nous, c'est parce que leur droit du travail repose sur une autre conception de la relation de travail, dont les juristes weimariens ont posé le socle. Ainsi Potthoff, d'obédience libérale-démocrate, écrivait en 1922 que « la relation de travail n'est pas en premier lieu une relation contractuelle, mais une relation sociale » : voilà une clé pour comprendre l'ensemble du système allemand des relations professionnelles, aujourd'hui remis en cause.
Comment motiver les personnes au travail ? Comment les impliquer solidairement dans un processus collectif de production ? L'Allemagne nous invite à nous poser de telles questions aujourd'hui, en amont des autres sujets, car, dès lors que la solidarité existe dans la communauté de travail, il devient plus facile de négocier sur les salaires et sur la protection sociale. Mais cela suppose d'ouvrir la « boîte noire » de l'entreprise.

Vous avez dit, monsieur Élie Cohen, que le produit intérieur brut aurait pu être supérieur de 150 milliards à ce qu'il est. Combien cela représente-t-il d'emplois qui auraient pu être créés et qui ne l'ont pas été ?
Vous avez aussi beaucoup parlé des petites et moyennes entreprises, dont on dit souvent qu'elles ont du mal à grandir dans notre pays. Quels sont pour vous les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées ? Quel rôle jouent l'impôt de solidarité sur la fortune et les difficultés de transmission des entreprises liées à la fiscalité ?
Vous avez pour votre part, madame Bénédicte Zimmermann, dressé la liste d'un certain nombre de différences entre les modèles allemand et français. J'ai été surpris que vous n'abordiez pas la question culturelle : on dit souvent que l'Allemagne aime son industrie tandis que la France aime mieux l'État que ses entreprises. N'y voyez-vous pas un élément essentiel, que l'on retrouve dans l'éducation, en particulier parce que le système éducatif français, très hiérarchique et aristocratique, fait passer la formation professionnelle tout au long de la vie largement au second plan ?

La rigidité de notre droit du travail n'est-elle pas également un frein à cette compétitivité ?
Le chiffre impressionnant de 150 milliards est en fait une construction intellectuelle : il s'agit de la part supplémentaire du produit intérieur brut qui aurait été obtenue si le rapport entre les exportations françaises et allemandes était resté ce qu'il était il y a dix ans. Je cherchais surtout à illustrer à quelle rapidité l'appareil exportateur français s'est atrophié. On peut en trouver un autre indicateur dans le taux d'extraversion, qui mesure l'insertion de nos deux économies dans l'économie mondiale. Les dix dernières années, la France est presque demeurée sur place tandis que l'Allemagne progressait fortement. De même, l'analyse de l'élasticité du commerce extérieur montre que la France réagit beaucoup moins vite que l'Allemagne ou l'Italie. Pourquoi n'avons-nous pas été capables de répondre au décollage de la demande des pays émergents entre 1999 et 2001 ?
Si l'on veut savoir pourquoi l'impact a été tel en matière d'emploi, la réponse à la question est simple : il n'aurait sans doute pas fallu détruire 800 000 emplois industriels depuis une dizaine d'années – le choc, en effet, a été rude. En l'occurrence, la désindustrialisation massive de notre pays s'est effectuée en deux temps. Entre 1979 et 1984, environ un tiers des emplois industriels ont disparu tandis que, les dix dernières années, la situation, pour avoir été moins violente, a perduré. Un tel phénomène n'a pas été observé en Allemagne, ni en Italie, alors que ce dernier pays ne compte pas parmi les plus dynamiques. Cela est d'autant plus bizarre que la France a beaucoup insisté sur la nécessité de développer des politiques industrielles et qu'elle a semblé vouloir en appliquer de nombreuses.
On parle beaucoup, en effet.
En 2004, j'ai été associé à une réflexion lancée par le Président de la République Jacques Chirac concernant les problèmes de désindustrialisation et de délocalisation. Je me souviens, lors d'une réunion à l'Élysée, de la multiplicité des points de vue qui avaient été émis par de grands industriels et d'importants responsables. Nos problèmes étaient successivement dus : à la perte de la magie du modèle colbertiste de grands projets et programmes – vous aurez reconnu les propos de M. Jean-Louis Beffa, dont le rapport avait entraîné la création de l'Agence pour l'innovation industrielle avant qu'elle ne soit supprimée quelques mois plus tard – ; à l'absence de développement de clusters d'innovation, au lieu, après appels d'offre, de compter cinq ou dix pôles de compétitivité, ce sont soixante et onze qui ont finalement été sélectionnés pour un budget de 500 millions, alors qu'un peu d'attention à la situation de nos voisins aurait montré que l'unité de compte est le milliard de dollars par grand pôle ; enfin, à la faiblesse des moyens permettant aux petites et moyennes entreprises de se développer malgré la fusion de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) et de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises (BDPME), qui donna naissance à OSÉO. Il ne faut pas s'attendre à de formidables succès si l'on retient l'ensemble de ces orientations en maintenant un budget qui n'est pas « à la hauteur ».
La France a la fibre industrielle et rêve de disposer d'une grande industrie, mais elle a raté plusieurs grands rendez-vous !
Nos efforts en matière de R&D, quant à eux, augmentent peut-être d'un dixième de point, mais il n'en reste pas moins qu'ils demeurent deux fois moins élevés par rapport au produit intérieur brut qu'ils ne l'étaient sous le général de Gaulle.

Les interlocuteurs auxquels je m'adresse considèrent tous que notre trajectoire a divergé d'avec celle de l'Allemagne à partir des années 2000. Quel choc est-il à l'origine d'une telle situation ?
Les facteurs sont nombreux.
D'abord, pour ce qui est de l'attitude vis-à-vis de la mondialisation, alors que la réunification supposait de très importants transferts, les Allemands ont compris que le choc de la globalisation mettait en péril leur modèle industriel et ont opéré un certain nombre de choix inconcevables dans notre pays. Si le taux d'extraversion de l'économie allemande a formidablement augmenté, c'est que les exportations et les importations ont été accrues, contribuant ainsi à réorganiser l'ensemble de la chaîne de production en Allemagne, certes, mais également dans les pays limitrophes. Dans le cadre de ce système de production élargi, la chaîne de valeur a été spécialisée et segmentée, l'intégration globale ayant été quant à elle maintenue. De la sorte, l'Allemagne a pu organiser la défense de son industrie automobile sur un espace étendu. A contrario, nous avons choisi de maintenir en France notre outil de production existant, tout nouveau développement étant organisé hors de notre pays.
Ensuite, nos grandes entreprises ne contribuent guère à tirer vers le haut l'ensemble de notre économie faute de trouver sur notre territoire national un certain nombre de conditions favorables. Ce n'est pas la loi sur les trente-cinq heures à laquelle certain d'entre vous pensent en particulier qui pose des problèmes.

La dureté des choix opérés par le chancelier Schröder aurait-elle été culturellement acceptée dans notre pays ?
Comme l'a dit Mme Zimmermann, les idées de communauté de travail et de codétermination ont permis à l'Allemagne de résister au choc de la mondialisation et au transfert de richesses massif de près de 1 300 milliards d'euros induit par la réunification. Ce pays a élaboré des compromis de crise dont nous sommes incapables.
Une telle situation s'explique par de profondes raisons historiques. La République de Weimar, l'expérience hitlérienne, la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, la réunification… À chaque fois, il a été fait appel à l'idée d'une communauté nationale de production soudée et solidaire.
S'il est certes possible d'évoquer un trait « culturel » allemand, je parlerai plutôt de la consolidation, inscrite dans le temps, d'un certain nombre de pratiques liées aux événements. Je ne crois pas à une conception essentialiste de la culture où l' « âme » allemande serait plus encline à susciter tel ou tel comportement que l' « âme » française. La culture d'un pays se forge sur la très longue durée.
En effet, il n'est pas question de culture, mais d'histoire. Au début du siècle, la conflictualité sociale était extrêmement violente en Allemagne, pays qui était alors bien loin d'une logique de consensus et de communauté de travail. La révolution bolchevique a failli y triompher ! C'est l'expérience historique – chute de la République de Weimar, régime hitlérien, modalités de la reconstruction, problèmes de la réunification – qui a forgé le compromis social de crise.
Lequel avait été aussi préparé par la Mitbestimmung des assurances bismarckiennes et par la Première Guerre mondiale où les racines du droit du travail allemand doivent d'ailleurs être recherchées.
De plus, si les Allemands, à la différence des Français, semblent préférer les entreprises à l'État, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de se méfier de ce dernier, leur histoire récente en atteste. Une telle circonspection a d'ailleurs contribué à développer un tissu associatif ainsi que des formes de concertation et de délibération qui passent par d'autres canaux et qui sont extrêmement productives, y compris dans le domaine du travail.
Pourquoi la France, quant à elle, n'aime-t-elle pas ses industries ? Est-ce en raison d'une hypertrophie de l'État ? Est-ce parce que les travailleurs n'y auraient pas trouvé un moyen de s'affirmer, de participer au développement économique et de faire reconnaître la part qu'ils ont prise à la production de richesses et de valeurs ? Cette question essentielle, à laquelle je n'ai pas de réponse toute faite, mérite en tout cas d'être posée. J'ajoute qu'il conviendrait peut-être aussi de s'interroger sur la gouvernance des entreprises et sur la façon dont, depuis plusieurs décennies, les Français appréhendent leur situation au sein du monde du travail.
À ce propos, la question de la formation et du développement professionnel est cruciale. En Allemagne, les entreprises facilitent ainsi les développements professionnels et les deuxièmes chances indépendamment du diplôme initial quand, en France, notre système est hiérarchisé et cloisonné, le diplôme constituant plus encore l'horizon indépassable de la qualification que ce n'était le cas lors des deux dernières décennies, comme le montrent plusieurs enquêtes.

Je voudrais signaler ici un réel paradoxe : la France est le pays le plus nombriliste du monde et il ne cesse de se chercher des modèles ! Voilà vingt ans, c'était le Japon – excellente référence lorsque l'on voit où se situe ce pays après la « décennie perdue » ! –, puis nous connûmes une petite crise danoise avant, donc, le syndrome allemand qui nous atteint aujourd'hui. J'attends avec impatience que nous succombions demain au syndrome indien.
Il convient également de rappeler que l'Allemagne connaît quelques difficultés : outre que les banques allemandes possèdent 900 milliards de créances recouvrables, la banque immobilière Hypo Real Estate pèse un peu plus sur les finances publiques de l'État allemand que la sécurité sociale sur les nôtres.
Par ailleurs, c'est une erreur d'affirmer que la compétitivité est exclusivement conditionnée par les prix et les coûts et je reconnais qu'aucun d'entre vous ne l'a prétendu. Lorsque je travaillais dans l'industrie, je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre un seul industriel se plaindre au premier chef du coût du travail. Un grand industriel de l'équipement automobile m'a confié que, lorsque l'on tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont celui de la productivité du travail, le coût du travail de ses 7 000 salariés employés en Inde est globalement égal à celui des Français, le coût des managers y étant en effet deux fois plus important que dans notre pays. J'ajoute que, depuis le début de cette mission et sur un plan plus théorique, la lecture de Nicholas Kaldor et Joan Robinson sur l'élasticité et l'imperfection des marchés me console.
Les industriels, en revanche, mettent en avant les problèmes de financement des petites et moyennes entreprises et de la désaffection des élites. Je veux vous compter une petite anecdote personnelle : si mon propre père était flatté que je fisse l'École nationale d'aministration, il déchanta lorsque je partis travailler dans l'industrie pendant sept ans : premier des Giacobbi à franchir le pas, j'étais un pauvre type perdu pour la République !
De surcroît, si nos exportations ne sont guère florissantes, c'est parce que nous sommes frappés de folie. Nous voulons ainsi vendre en Inde des Rafale – quand tel sera le cas, je serai cardinal – et des centrales nucléaires à Jaitapur – là, je serai pape. Or, cela implique que le gouvernement de l'Union indienne réussisse à faire voter une loi rectificative – alors qu'il n'a pas réussi à faire passer un seul texte depuis six mois – modifiant une loi de 2010 prévoyant la mise en cause du constructeur étranger en cas d'accident nucléaire. Pendant que nous nous concentrons sur l'exportation d'énormes bêtes, les Allemands vendent 10 000 machines-outils ! De la même manière, il n'y a pas de quoi sauter de joie lorsque nous vendons un Airbus quand il serait bien plutôt préférable d'exporter mille pièces qui servent à le constituer !
Enfin, j'invite notre mission à se rendre à Gurgaon, en Inde, entre le Silver Center et les malls, pour y voir éclore la modernité. Ce n'est pas en Allemagne que cela se passe !
L'Occident s'effondre ! Alors qu'en 2005 la production automobile chinoise était loin derrière celle de l'Europe et de l'ensemble États-Unis–Mexique, les prédictions pour 2015 faisaient état d'une production de 17 millions de véhicules pour ces deux derniers pays contre 16 pour l'Europe et 13 pour la Chine. La réalité, en 2010, était la suivante : la Chine a produit 17 millions de véhicules, contre 12 pour l'Europe et 14 pour l'Amérique du Nord.

J'ai apprécié ces trois exposés car ils ont bien cerné la nature du modèle allemand : ni la compétitivité-prix ni la durée du temps de travail ne sont en cause. En fait, l'Allemagne innove et investit dans la R&D plus que nous ne le faisons et ses petites et moyennes entreprises en profitent, à la différence de ce qui se passe en France, sauf peut-être au sein des pôles de compétitivité.
Le modèle français d'un État centralisé a été très performant lors de la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, grâce au lancement de grands programmes industriels. Mais alors que la politique industrielle est aujourd'hui plus complexe et s'enracine dans un tissu local, le fédéralisme allemand constitue un avantage certain. De surcroît, même si les Allemands n'en parlent guère, ils ont mis en place des clusters ou des pôles de compétitivité depuis très longtemps, de manière qu'une innovation locale profite à l'ensemble des petites et moyennes entreprises qui gravitent autour des grandes entreprises quand, chez nous, perdure une assez forte division entre très grandes et petites structures. Enfin, le dialogue social, autre point fort de l'Allemagne, constitue un important facteur de compétitivité.
Monsieur Élie Cohen, considérez-vous que l'Allemagne, parce qu'elle a ignoré l'étape des grands projets colbertistes, ait été structurellement plus apte que la France à mener des politiques industrielles fines et complexes ?
Il me semble, par ailleurs, que le problème n'est pas tant le regard porté sur les entreprises que sur les industries. Les Français semblent avoir été beaucoup plus fascinés par les banques et le système financier. L'Allemagne a toujours considéré qu'il est important de maintenir une base industrielle forte. Plus précisément, l'un des atouts de ce pays me semble d'avoir toujours veillé à ne pas dissocier innovation et fabrication. L'Allemagne, en effet, n'a jamais cru que la R&D et l'assemblage suffiraient à maintenir la force de son économie, la production pouvant être quant à elle déléguée à d'autres pays – même si elle a procédé ainsi, à certains égards, avec la Pologne. Globalement, elle a toujours été attentive au maintien de l'ensemble de la chaîne industrielle.

Au fur et à mesure que se déroulent les auditions, nous parvenons aux mêmes constats quant à la compétitivité de l'économie.
Monsieur Élie Cohen, quelles recommandations formuleriez-vous pour mettre en place une véritable politique industrielle ? La crise que nous traversons étant plus structurelle que conjoncturelle, à quelle échéance une telle politique produirait-elle des résultats ? Quelle suite donneriez-vous aux états généraux de l'industrie et quelle vous paraît devoir être l'évolution des pôles de compétitivité ? Enfin, comment notre politique industrielle pourrait-elle s'intégrer au sein de l'Europe ?
Monsieur Jean-Philippe Bourgoin, comment analysez-vous l'inadéquation entre une remarquable capacité de recherche dans le domaine solaire et une pratique industrielle qui n'est pas compétitive ?
Quatre types de problèmes doivent être traités.
Le premier est d'ordre macro-économique. Que les résultats de nos entreprises soient les plus faibles d'Europe pénalise l'investissement, l'innovation et l'exportation. Si l'on veut qu'il en soit autrement, nous devons améliorer sensiblement les conditions de leur exploitation, lesquelles passent probablement par des transferts de charges pesant sur le travail vers d'autres assiettes fiscales. On ne peut en effet considérer que le coût du travail dans l'industrie moderne, à la différence de l'économie de variété ou de la différenciation, ne constitue pas un paramètre important. Les chiffres sont très impressionnants : nous sommes confrontés à un problème de court terme en ce qui concerne les niveaux d'activité, de résultats et de taux de marges.
La deuxième difficulté relève de l'écologie d'entreprise : comment faire croître les petites et moyennes entreprises afin qu'elles innovent et exportent ? De véritables maquis de dispositions ont vu le jour avec OSÉO, les financements en fonds propres et le grand emprunt, mais ces mesures doivent être stabilisées et consolidées.
Troisième problème : l'érosion de nos spécialisations, par exemple dans les secteurs automobile, aéronautique, du transport terrestre, de la pharmacie, du nucléaire – nous ne fabriquons plus de machines outils depuis longtemps. Parce que nous avons « perdu la main », notamment en raison de choix malheureux, nous nous devons de renforcer nos compétences. Le grand emprunt me semblant constituer en l'occurrence une méthode assez intelligente et originale plutôt, je me félicite de l'adoption de procédures qui, pour être assez longues et frustrantes, n'en sont pas moins intéressantes.
Quatrième problème, enfin : l'extraversion économique. Les grandes entreprises allemandes n'ont pas choisi de se développer sur un plan international en conservant, sur un plan national, le degré d'intégration qui était le leur : elles ont réfléchi à l'éclatement et à la localisation des différents maillons de la chaîne de valeur en acceptant un certain degré de délocalisation afin de mieux maîtriser les processus d'ensemble. L'économie française, quant à elle, a véritablement connu une panne de développement.
Par ailleurs, ce n'est pas une lubie récente que d'être obnubilé par le modèle allemand. Dès 1870, nous regardions ce qui se passait chez notre voisin. En 1890, nous sommes allés y étudier le système d'apprentissage avec la volonté de l'importer ; à l'issue de la Première Guerre mondiale, les missions Clémentel ont observé la structuration de l'industrie germanique, ses rapports avec la formation et les laboratoires de recherche ; après la Seconde Guerre mondiale, c'était au tour de l'industrie lourde et de la chimie de constituer pour nous de véritables modèles. Bref, depuis un siècle, l'Allemagne est une obsession française : nous essayons de l'imiter, et nous y échouons.
Alors qu'il serait sans doute utile, aujourd'hui, de nous plonger dans le coeur brûlant des économies émergentes, la zone euro et l'Union européenne n'en demeurent pas moins notre espace économique de référence, où se creuse un écart de plus en plus grand entre l'Allemagne et ses satellites, la France, les pays du Sud, ce qui pose des problèmes de compétitivité et de soutenabilité, à terme, de nos finances publiques et de nos déficits. Nous sommes donc contraints de nous intéresser aux évolutions des relations franco-allemandes. L'observation de la balance commerciale montre que nous avons partout perdu des positions à son profit, y compris au sein de la zone euro. Même si la réindustrialisation paraît difficile, elle est donc nécessaire. Faute de pouvoir compenser la dégradation continue de notre balance de biens par une amélioration de la balance des services ou des transferts de revenus, nous sommes condamnés à avoir une balance courante en déficit permanent : nous sommes en conséquence obligés d'accroître notre dette extérieure et d'imaginer une situation dans laquelle les actifs français permettront de régler nos dépenses courantes.
Enfin, nous avons le plus grand mal à gérer le passage d'un modèle économique aux vertus éminentes à un autre que nous ne savons pas encore pénétrer. La France a inventé le modèle des grands programmes – sur lequel j'ai d'ailleurs écrit Le Colbertisme high-tech –, qui a connu un grand succès. Mais ce modèle est devenu obsolète avec l'ouverture économique mondiale dans le cadre de l'Organisation mondiale de commerce, puis de l'intégration européenne, avec la création de l'euro et celle du marché unique. Nous n'avons pas été capables d'opérer un redéploiement vers les écosystèmes d'innovation, non plus que de rendre notre recherche plus efficace et mieux organisée ou de venir en aide aux petites et moyennes entreprises.
Les comparaisons internationales en matière de R&D montrent que l'Europe a de grandes forces : une présence traditionnelle en matière de recherche fondamentale, de recherche appliquée et d'industrie. Chacun cherche à disposer de ce modèle, sachant qu'une faiblesse sur le maillon central de la recherche appliquée peut être compensée par un effort supplémentaire en faveur de la recherche fondamentale, comme à Taïwan, à Singapour ou aux États-Unis. De ce point de vue, la France et l'Allemagne doivent être classées dans le même groupe de pays, en dépit de leurs différences.
Mais l'Europe peine à faire émerger de nouveaux champions sur de grands secteurs économiques nouveaux. Si nous nous rapprochons du modèle allemand, nous ferons des progrès dans certains domaines, mais la compétition mondiale restera tout aussi vive !
Du point de vue des écosystèmes d'innovations constituées, l'Europe aujourd'hui n'a pas perdu. Dans certains secteurs, elle a eu tendance à faire produire ailleurs. Mais il reste encore, par exemple, une industrie automobile européenne – même si l'on peut souhaiter que la France y ait une place plus importante.
À ce sujet, je souhaiterais faire deux remarques. La première concerne les normes. La question de savoir qui va réussir à imposer la norme sur le véhicule électrique constitue un véritable enjeu : va-t-on voir émerger une protection vis-à-vis de l'industrie européenne produisant sur notre continent ?
Nous ne faisons pas à cet égard suffisamment d'efforts en France en matière de normalisation et de standardisation. Par comparaison, le Président Obama vient de déclarer qu'il voulait augmenter de 54 % les moyens consacrés à la National Science Foundation dans le domaine de la recherche fondamentale, au Department of Energy dans celui de la recherche sur l'énergie, et au National Institute of Standards and Technology concernant les standards et les normes. De même, j'ai visité un institut à Pékin, l'automne dernier, qui consacrait la moitié de son activité dévolue aux nanotechnologies à l'établissement de standards et de normes.
L'autre remarque est que, du point de vue des innovations, l'ensemble de notre système industriel doit suivre. Car le marché est confronté à l'arrivée de nouveaux « entrants » : le constructeur automobile chinois BYD indique clairement que, s'il n'a aucune chance sur un moteur électrique constitué de 1 400 pièces différentes, il a en revanche toutes ses chances sur un véhicule et un moteur électriques d'une centaine de pièces.
En ce qui concerne les freins à l'industrialisation européenne, la direction générale de la compétitivité n'a pas toujours facilité l'implantation de grands projets industriels sur notre continent. L'Europe a mis quelquefois jusqu'à deux ans pour donner son accord sur les projets relatifs aux applications industrielles et informatiques, risquant ainsi de conduire à une disparition complète de l'activité dans ce domaine, le secteur s'étant entre-temps reconstitué : la direction générale de la compétitivité s'est assuré que la compétition existait entre les pays européens, mais ne s'est pas posé la question de savoir si nous étions en train de perdre pied vis-à-vis de la concurrence extérieure.
Au sujet des exportations que vous qualifiez de « folies », monsieur Paul Giacobbi, il existe des contre-exemples de petites et moyennes entreprises françaises réussissant à vendre en Chine ou au Kazakhstan, tels certains équipementiers d'énergie solaire vendant des fours de fabrication de lingots. La question est de savoir comment on accompagne ces entreprises. À cet égard, la combinaison des pôles de compétitivité, des organismes de recherche technologique et du soutien de l'État, notamment au travers d'investissements d'avenir, va dans le bon sens.
À côté de la réponse macro-économique globale, notre compétitivité repose sur la défense de chaque entreprise, au cas par cas, et nous avons, sur ce point, des chances de gagner.
S'agissant du solaire, il faut prendre en considération la part de carbone qui peut être évitée. Or, la production du silicium coûte très cher en carbone. Les panneaux solaires chinois, largement vendus en France, dans la mesure où ils sont moins chers, sont neutres en carbone au bout de vingt-cinq ans et offrent une garantie d'une dizaine d'années, tandis que les panneaux français, certes un peu plus chers, sont neutres en carbone au bout de trois à cinq ans et sont garantis pour trente ans. Ce point peut constituer une donnée différenciante, même si ce n'est pas celle qui a prévalu jusqu'ici, du fait des incitations existantes.
Le différentiel de prix ne résulte pas d'une différence de coût de main-d'oeuvre – celui-ci représentant moins de 10 % du coût de production des modules solaires –, mais d'investissements dans les machines-outils et l'outil de production : les industriels chinois ont consenti ces investissements pour leur marché intérieur et leurs exportations, contrairement à l'industriel français, qui enregistre pourtant des performances remarquables. Nous ne souffrons pas d'un manque de couplage entre la recherche et l'industrie.

Le fait d'avoir acheté l'électricité au prix initialement prévu a-t-il incité à choisir le matériel chinois plutôt que le matériel français ?
L'État a pris conscience de ce différentiel de prix et le problème du taux de rachat a fait l'objet d'une compensation. Les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens : toutes les conditions sont réunies pour que nous disposions d'une filière nationale. La question est de savoir si une puissance de 500 mégawatts est suffisante ou si elle devrait être portée à 800 ou 1 000 mégawatts.
Je suis en désaccord, pour plusieurs raisons.
D'abord, le différentiel de coût entre le panneau chinois et le panneau Photowatt est important, puisqu'il représente plus du tiers du différentiel de prix. Ce facteur explique que le producteur national Photowatt – lequel dispose de sites vieillots, n'a pas investi, ni été capable d'évoluer comme l'ont fait notamment les industriels chinois – soit aujourd'hui nettement non compétitif.
Deuxièmement, les décisions prises ne vont pas dans le bon sens : elles ont eu pour premier effet de tuer la filière solaire française au moment où elle se constituait, puisque le seul projet d'usine avec des technologies modernes et des coûts permettant de fabriquer en France à des prix compétitifs vis-à-vis des concurrents étrangers a été avorté.
Toujours est-il que la logique consistant à amorcer la pompe du développement du solaire en important des panneaux pour commencer à apprendre le métier, puis à développer une filière industrielle française, a été cassée : on continue aujourd'hui à importer des panneaux chinois, mais sans espoir de développer une telle filière.
La part du panneau dans l'ensemble des ventes n'était pas dominante. De ce point de vue, les rectifications apportées me paraissent effectivement aller dans le bon sens.
Certes, il est regrettable que les propriétaires de l'usine dont vous parlez aient renoncé à l'installer.
C'est une conséquence…
Ils ont pris cette décision rapide parce qu'ils ont jugé que la France adoptait, comme d'autres pays, des mesures tendant à réduire rapidement le tarif de rachat, supprimant ainsi tout effet d'aubaine.
Pensez-vous qu'on ne crée des entreprises que lorsqu'il y a des effets d'aubaine ?
Pour certaines, oui.
Ne pensez-vous pas que les choix industriels soient fondés sur la prévisibilité d'un marché sur dix ans ?
La décision a été prise rapidement en raison de changements rapides et d'une imprévisibilité en matière de retour sur investissement. Je suis plus optimiste que vous sur l'augmentation du parc installé en France.
Au sujet du modèle allemand, l'articulation entre formation initiale et formation continue m'apparaît comme un enjeu important pour la compétitivité.
À cet égard, le fort clivage existant en France entre les grandes écoles dont sont issus nos cadres dirigeants, politiques ou industriels, et le reste du système de formation destiné à tous ceux qui n'ont pu y accéder, est extrêmement nuisible et peut expliquer le désamour des Français pour leurs entreprises.
On parle beaucoup aujourd'hui de la formation « tout au long de la vie », qui constitue un pilier de la flexicurité selon la Commission européenne, dans une communication consacrée à cette question. Mais cette formation n'existe quasiment plus en France, en dépit du droit individuel à la formation et des réformes portant sur la formation professionnelle.
Selon une enquête, les politiques de formation en France, lesquelles se situent à des niveaux supérieurs à celles des entreprises allemandes au regard notamment des cours suivis ou des taux de fréquentation, ont des effets moins importants qu'outre-Rhin.
Dans notre pays, les politiques de formation continue tendent essentiellement à adapter les compétences des salariés à leurs fonctions ou à leur poste, mais ouvrent peu de perspectives d'évolution ou de développement professionnel ou de carrière. En Allemagne, elles permettent de passer du grade d'ouvrier à celui de chef d'entreprise.
Les formations « sur le tas », liées à l'activité de travail, et les formations professionnalisantes obtiennent de bien meilleurs résultats en Allemagne.
Une réflexion doit être menée sur trois points : le système de production des qualifications, qui, en France, est très compliqué et relativement éloigné des réalités du marché du travail, l'optimisation du système de financement pour la formation continue, et le rôle du dialogue social dans celle-ci et le développement professionnel.

En ce qui concerne le secteur solaire, qui constitue un bon exemple en matière de compétitivité, la France disposait, dans les années 1970 et 1980, de spin-offs du Commissariat à l'énergie atomique travaillant en collaboration avec la Compagnie générale d'électricité sur des positions de leadership concernant l'optronique ou la photonique, qui déboucheraient plus tard sur le développement de la filière. Nous avions donc la possibilité de développer celle-ci, que toutes les études internationales, y compris le Commissariat général du plan, décrivaient comme une filière d'avenir. En témoigne l'exemple pionnier de Font-Romeu, où a été produit le premier four solaire au monde. Or, il a fallu attendre le Grenelle de l'environnement et que le prix du pétrole dépasse 100 dollars le baril pour que le solaire se développe en France, puis que nous soyons alertés au sein de la Commission des finances sur la nécessité de revoir la dépense fiscale correspondante.
Il est choquant que ce soit une décision fiscale de l'État qui ait été le facteur déclencheur d'une filière, dont les déterminants doivent être appréciés sur le long terme et dont les fondamentaux au départ étaient bons. Il est regrettable que nous ayons en quinze ou vingt ans laissé péricliter nos acquis dans ce domaine, puis que nous ayons brutalement développé ce secteur à l'aide d'un avantage fiscal, qu'il a fallu par la suite revoir.
Quel éclairage pouvez-vous nous apporter sur l'articulation entre les actions de court et de long terme ?
Le cas du solaire est important, dans la mesure où il est limpide.
L'Allemagne, qui n'a pas d'avantage climatique particulier, a réussi à développer une formidable industrie solaire et éolienne sur son territoire grâce à des politiques adaptées et à un engagement clair en faveur des énergies renouvelables. Elle se situe aujourd'hui au premier rang mondial de l'industrie solaire, dont le développement a été déclenché au départ par une incitation de l'État.
Vous avez eu raison de rappeler les débuts de l'industrie solaire française et les percées technologiques de notre pays à l'époque. Ensuite, du fait de l'évolution du prix du pétrole et de ce que l'énergie solaire coûte dix fois plus cher que l'énergie tirée du nucléaire amorti, la filière n'a pu se développer dans notre pays.
Mais avec le Grenelle de l'environnement et l'engagement en faveur des énergies renouvelables, il a été décidé de créer une filière solaire sur le territoire national à partir d'un système de prix incitatif permettant l'émergence d'un marché. Dès lors, des projets de développement sont nés, comme l'usine de Blanquefort. Comme un partenariat avec Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles garantissait l'achat de la production sur dix ans, il fallait aux industriels une visibilité, que les décisions prises ont supprimée.
Un partenariat existait avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, tendant à développer des filières technologiques sur notre territoire, lesquelles devaient prendre le relais de la technologie First Solar, qui avait déjà fait ses preuves : certaines, comme l'hétérojonction, devaient faire l'objet d'investissements dans le cadre de la commission sur le grand emprunt. Or tout cela est maintenant mis à bas.
Je vous rejoins sur l'historique de la filière et les freins qui l'ont empêchée de se développer, liés notamment à la baisse du prix du pétrole.
S'agissant des perspectives de reprise de secteur sur le plan national, les éléments de production – cellules, modules, panneaux, par exemple – avec tout l'outil associé et une politique d'intégration au bâti constituaient un ensemble cohérent.
Certes, il faut que les politiques publiques de l'énergie soient lisibles et se traduisent dans le développement de filières industrielles. Mais il faut aussi que l'ensemble du secteur solaire s'appuie sur une forte production nationale. L'Allemagne n'a pas hésité à importer, et encore récemment, du fait de ses incitations fiscales, des panneaux solaires chinois. Le reste de la filière allemande a fonctionné et les équipementiers ont continué à exporter. Il est nécessaire à cet effet de définir un seuil de marché qui soit suffisant, ce qui n'est probablement pas encore le cas aujourd'hui.
La séance est levée à dix-huit heures.