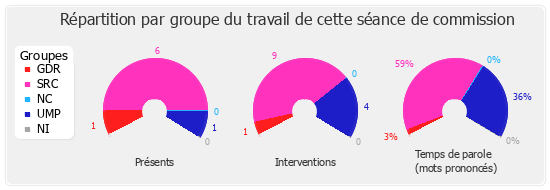Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
Séance du 10 mars 2009 à 16h00
La séance
La mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a auditionné les docteurs Annie Soussy, chef du service de consultations médico-judiciaires du centre inter-hospitalier de Créteil, Pierre Espinoza, chef du service des urgences de l'Hôtel-Dieu, membre du groupe d'experts du rapport Henrion, membre de la société française de médecine d'urgence, et Roland Coutanceau, médecin psychiatre, président de la Ligue française pour la santé mentale.

Mes chers collègues, nous avons souhaité entendre des médecins dans le cadre de nos travaux compte tenu de la place centrale qu'ils occupent dans la détection et dans le traitement des violences faites aux femmes.
Notre débat portera successivement sur l'accueil et la prise en charge médicale et psychologique des femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles en dehors de leur couple, sur le rôle d'expertise des médecins, notamment pour la rédaction des certificats médicaux, enfin, sur la prise en compte des auteurs de violences, notamment sur le plan psychologique.
Je suis aujourd'hui médecin au pôle urgences-réseaux de l'hôpital Georges Pompidou. J'ai exercé dix ans comme médecin à l'hôpital des prisons de Fresnes, après avoir travaillé dans le secteur de la médecine générale pendant mon internat puis mon clinicat, et j'ai dirigé dix ans le service des urgences de l'Hôtel-Dieu. Je travaille également à des projets de télémédecine, qui peuvent avoir un intérêt en termes d'interface avec les urgences médico-judiciaires (UMJ). J'ai enfin participé à la commission Henrion.
Que dire sur l'accueil et la prise en charge médicale et psychologique ou psychiatrique des femmes victimes de violences ? En France, les services d'urgence, premier lieu d'accueil, sont un véritable observatoire de santé publique : tout ce qui se passe dans la cité, est visible par l'intermédiaire des personnes qui y sont admises.
S'agissant plus particulièrement des femmes victimes de violences conjugales, leur prise en charge suppose un certain savoir-faire de la part des médecins urgentistes, déjà confrontés à une très grande diversité de pathologies. Ce qui pose le problème de la formation.
La France compte un peu plus de 600 services d'urgences, qui accueillent 14 millions de patients. Si l'on admet que 10 % des femmes sont victimes de violences conjugales, et que le sex-ratio est aux urgences d'environ une femme sur deux patients, sont donc admises aux urgences nombre de femmes victimes de violences conjugales, même si elles n'y sont pas forcément venues pour ce motif. Sait-on dépister ces violences ? Je suis très réservé sur ce point.
Tous les services d'urgences ne sont pas identiques. 150 environ, dans les CHU (centres hospitalo-universitaires), sont très importants. D'autres sont de tout petits services, tandis que plus de 300 sont de taille moyenne, situés dans des villes petites ou moyennes. Dans tous les cas, la lourde charge de travail des urgentistes explique que, dans le flux des arrivées aux urgences, une femme victime puisse ne pas être détectée.
D'autre part, il n'existe qu'une soixantaine de centres d'urgences médico-judiciaires. Des femmes victimes de violences peuvent donc être admises dans des services d'urgence qui, ne pouvant les adresser à un centre médico-judiciaire voisin, doivent se débrouiller, en fonction du savoir-faire des acteurs de terrain.
Qui sont justement ces acteurs ? Il faut savoir que l'accueil aux urgences n'est pas médical, mais avant tout infirmier. Ensuite, accueillir une femme victime de violences et dépister sa situation, c'est écouter, évaluer, conduire toute une série d'actions très bien déclinées dans le rapport Henrion. Or, qui peut mieux écouter une femme qu'une autre femme ? Il m'est ainsi arrivé dans ma pratique d'urgentiste de m'éclipser pour laisser une infirmière ou une femme médecin être le premier contact avec une femme victime de violences.
Ces remarques étant faites, je me permettrai de décliner plusieurs préconisations.
Sachant d'abord que la démographie médicale sera préoccupante dans les prochaines années, selon moi le meilleur référent au sein d'un hôpital ne doit pas être le médecin mais l'assistante sociale, pour peu qu'elle soit bien formée et sache exactement comment fonctionne le réseau local, c'est-à-dire les acteurs intervenant autour de l'hôpital. Pour autant, les services d'urgence ne comportent pas tous une assistante sociale. Ce peut donc être aussi l'infirmière, un cadre de santé, et, bien sûr, un médecin. Il est en tout cas important de savoir qui est le référent, parce que c'est celui qui connaît bien le réseau local.
Pour bien accueillir, il faut aussi savoir écouter. Or, aux urgences, la gestion du temps est un souci majeur. Peut-on réellement penser qu'une infirmière passera une heure, voire plus, à écouter une patiente pour débrouiller une situation de violence ? Des progrès sérieux seraient obtenus si l'on pouvait au moment de l'admission faire venir un référent de l'intérieur de l'hôpital, telle que l'assistante sociale du service de médecine ou des urgences, qui pourrait lui consacrer du temps.
Par ailleurs, le constat effectué aux urgences doit faire l'objet d'un certificat. Or les urgentistes sont loin d'être tous bien formés à leur rédaction. La société française de médecine d'urgence (SFMU) organise des formations et une conférence de consensus a bien été consacrée au dépistage et à la prise en charge de la maltraitance aux urgences, mais elle traite de toutes les maltraitances, celles envers les femmes étant comprises dans l'ensemble.
Agir aux urgences est donc compliqué. C'est pourtant un moment où l'on peut donner des conseils très précieux, tels de conserver ses papiers d'identité. Mais encore faut-il être bien formé, d'autant qu'il faut également prendre en compte le contexte : jusqu'à dix-sept heures, on peut faire appel à l'assistante sociale, mais à trois heures du matin ? Aux urgences, celui qui fait n'est pas nécessairement celui qui sait faire.
Des progrès seraient donc susceptibles d'être réalisés dans plusieurs domaines.
S'agissant d'abord du savoir-faire, la littérature actuelle suffit et les conseils sur ce qu'il faut faire existent. Pour m'intéresser à la télémédecine, le média audiovisuel m'apparaît à cet égard comme un très bon moyen pour faire passer des messages et pour bien former les acteurs du terrain.
Par ailleurs, aucun indicateur ne donne connaissance du pourcentage de femmes victimes de violences conjugales admises aux urgences. C'est à titre personnel que j'avais conduit les études qui figuraient à cet égard dans le rapport Henrion. Elles n'avaient rien d'une étude structurée, menée par exemple par une unité de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Or, pour définir une stratégie aux urgences, il faudrait déjà avoir une bonne connaissance du phénomène. On ne prend pourtant bien en charge que ce que l'on connaît. La porte d'entrée des victimes de violences conjugales peut aussi bien être la traumatologie – à la suite d'une « chute dans l'escalier » –, que la psychiatrie – pour une tentative de suicide –, que l'addictologie – pour alcoolisme – ou que la gynécologie-maternité.
Un autre point très important, est celui de la protection des enfants, qui sont également des victimes, ne serait-ce que parce qu'ils assistent aux violences. Le passage aux urgences permet de repérer que des enfants peuvent également être concernés. Or, bien souvent, on ne sait pas le faire.
Enfin, une très bonne interface avec les UMJ est nécessaire. Je reviens à cet égard aux certificats : en disposer constitue en effet un atout pour enclencher une procédure. Voilà pourquoi, encore une fois, l'ensemble du réseau de soins doit bien fonctionner.
Le service de consultations médico-judiciaires du centre hospitalier intercommunal de Créteil est compétent pour l'ensemble du Val-de-Marne. Mis en place le 1er octobre 1996, il fonctionne sur la base de deux conventions conclues par l'hôpital, avec le tribunal de grande instance de Créteil, et avec le service des douanes et le parquet de Créteil.
C'est un service non pas d'urgence mais de consultations et il présente une double particularité. D'une part, les examens dans le service sont effectués sur réquisition des services de police et de gendarmerie. Ce qui signifie que les victimes ont déjà dû faire la démarche de déposer plainte, quel que soit le type d'agression dont elles ont été victimes et sont adressées aux UMJ par les services de police et de gendarmerie. D'autre part, pour chaque acte réalisé dans le service – qu'il s'agisse de la consultation ou des examens complémentaires, par exemple en biologie en cas de viol –, un mémoire de frais est adressé au service de la régie du tribunal de grande instance de Créteil, qui est en charge des frais de justice : c'est là un financement très particulier d'actes médicaux par rapport à la gestion financière habituelle d'un hôpital.
Ce service de consultations médico-judiciaires est ouvert sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Son activité est triple : elle consiste, pour 50 %, en des examens de victimes d'agressions, notamment sexuelles, et de maltraitances – nous travaillons au quotidien, s'agissant des mineures, avec la brigade des mineurs du département ; elle a trait ensuite, pour 45 %, à des examens de personnes placées en garde à vue puisque nous assurons leur prise en charge médicale ; il s'agit enfin, pour 5 %, de levées de corps – et non d'autopsies –, en application de l'article 74 du code de procédure pénale, c'est-à-dire en cas de mort suspecte.
Les réquisitions nous concernant portent habituellement sur l'examen des personnes victimes d'agression, afin d'évaluer le retentissement psychologique et de déterminer l'ITT. Dans le cas de personnes qui ont porté plainte pour agression sexuelle ou viol, il nous est demandé de procéder à l'examen somatique et gynécologique et de réaliser les prélèvements biologiques nécessaires, ainsi, éventuellement, que des examens complémentaires.
Comme nous voyons ces personnes au début d'une procédure judiciaire, cela signifie qu'elles viennent la plupart du temps du commissariat où elles ont porté plainte. La qualité de l'accueil doit donc être particulièrement soignée. Elles sont en effet souvent désemparées et doivent pouvoir, en confiance et à leur rythme, exprimer ce qu'elles ont vécu. Hormis l'examen somatique qui nous est demandé, ce qui va occuper le plus notre attention c'est la prise en charge, laquelle demande beaucoup de temps, comme le soulignait le docteur Espinoza. Cela est valable pour toutes les agressions, mais encore plus pour les victimes d'agressions sexuelles, qu'elles aient eu lieu dans le milieu intrafamilial ou en dehors.
De plus, il est rare qu'une plainte soit portée dès les premiers faits de violence conjugale. Les victimes vont nous décrire les faits récents, qui ne sont pas forcément les plus graves, mais aussi des faits plus anciens, et qui vont servir à évaluer le retentissement psychologique des violences, qui peut être considérable. Si, aux urgences, les conditions de travail ne permettent pas forcément une bonne écoute, celle-ci fait partie du travail d'un service de consultations médico-judiciaires.
En 2008, nous avons effectué 22 000 examens. Cela signifie que, pour la moitié d'entre eux, nous y avons consacré une et trois heures, sachant que si l'examen gynécologique doit, à la suite d'une agression sexuelle, être effectué aussi minutieusement que possible, ce qui prendra le plus de temps sera d'entendre la personne et d'évaluer le retentissement psychologique de l'agression, de façon à mieux pouvoir la prendre en charge et l'orienter.
Concernant l'accueil lui-même, nous disposons d'un dispositif original puisque, depuis l'an 2000, a été mis en place, à l'initiative du procureur de la République, un « schéma départemental d'aide aux victimes ». C'est ainsi que quatre associations se sont organisées pour assurer une permanence au sein même du service, ce qui permet, une fois l'examen effectué par le médecin, d'orienter les personnes vers ces associations afin qu'elles leur fournissent les informations dont elles ont besoin.
Les victimes de violences conjugales, par exemple, ont souvent déjà déposé plusieurs mains courantes, mais ne connaissent guère la différence avec une plainte et ne savent pas vers qui s'orienter en matière notamment d'hébergement et de prise en charge. Il est donc important qu'elles puissent bénéficier de ces informations, et le rôle de ces associations est à cet égard très complémentaire de notre examen.
Pour ce qui est de ma pratique, je suis psychiatre des hôpitaux, chef d'un service où, depuis des années, sont développés deux pôles, l'un de victimologie, l'autre de prise en charge des auteurs de violence. Ce dernier pôle abrite la plus importante consultation de France de sujets en obligation de soins en dehors de la prison. Je suis aussi président de la Ligue française pour la santé mentale, dont le vice-président est Boris Cyrulnik, laquelle a ouvert une consultation spécialisée pour les violences conjugales.
Que peut-on faire de mieux en matière de prise en charge des victimes ?
Nombre d'équipes pratiquent la prise en charge de victimes, qu'elles relèvent de la santé publique ou du monde associatif. En revanche, ce secteur souffre d'un manque d'organisation. Pour développer une prise en charge « de masse » des victimes de violences conjugales et sexuelles, il faudrait pourtant un peu d'organisation et des consultations adaptées le flux qui leur est adressé.
Un autre élément clinique très fort en matière de victimologie, tient à la parole. L'une des meilleures techniques pour l'amélioration de l'état des victimes est celle du groupe de parole ; c'est un outil très efficace pour accompagner, après le temps de l'accueil, l'évolution d'une femme victime de violences sexuelles ou conjugales. Pour dépasser l'histoire traumatique, chacun use de sa propre créativité et travaille avec son propre thérapeute. Mais chacun a aussi intérêt à étayer son évolution sur le témoignage de celles et de ceux qui ont été victimes et qui ont trouvé des pistes de dégagement de l'histoire traumatique.
Boris Cyrulnik a théorisé le concept de résilience de façon positive. Mais il faut maintenant développer des techniques qui la favorisent. Par le groupe de parole, on s'enrichit de l'imaginaire des autres, de leur capacité à métaboliser et à dépasser le traumatisme. Aussi orientons-nous systématiquement vers le groupe les victimes qui ne progressent pas individuellement.
Que préconiser ? À mon avis, on peut faire mieux à moyens constants : les solutions ne tiennent pas à une question d'argent.
Ma première préconisation est, comme celle du rapport Henrion, l'amélioration de la formation des professionnels de santé. N'oublions pas cependant que la compétence de nombre de praticiens s'est forgée aussi à travers la pratique de terrain et le volume des cas dont ils se sont occupés. De nombreux efforts de formation ont en tout cas déjà été fournis, même s'il ne s'agit pas forcément de formations spécifiques. Le développement de la formation est en effet plutôt bien conduit en France.
Ma deuxième préconisation est le fléchage de l'ensemble du réseau de prise en charge, après le passage aux urgences. Organiser un tel fléchage nécessite beaucoup d'énergie, se heurte aux chapelles – en victimologie comme ailleurs –, et doit surmonter l'une des inhibitions du ministère qui craint, s'il faut flécher, de devoir trier, donc évaluer. À cet égard, ma solution est simple : il suffit de dire, de façon symbolique, à ceux qui, sur le terrain – qu'il s'agisse d'associations ou de services publics – accueillent les victimes dans le cadre d'une consultation spécialisée, qu'ils font partie du réseau.
Ma troisième préconisation, que j'ai faite également pour la prise en charge des auteurs, est de donner du symbole – je ne parle pas d'argent – aux équipes de psychiatrie publique qui consacrent une partie de leurs moyens à créer une consultation spécialisée de prise en charge des victimes. Pour cela il faudrait donner à ces consultations spécialisées un caractère intersectoriel, et, surtout, en leur signifier qu'elles sont bien chargées de prendre en charge les victimes.
Exactement. Il n'est pas utile de constituer une commission pour distinguer le bon grain de l'ivraie : le fléchage des bonnes volontés suffit.
On parle beaucoup, à l'heure actuelle, de la synergie entre secteurs public et privé. Mais, en matière de victimologie, une autre synergie me semble évidente, celle entre les secteurs public et associatif. Le secteur public a le mérite d'être pérenne, mais parfois « lent à la détente ». Le monde associatif est, quant à lui, réactif, mais fragile en raison de sa dépendance envers les subventions. En faisant, par exemple, héberger une association dynamique par un service public à l'activité similaire, on favorise des synergies, tout en limitant les coûts pour l'association.

À la suite de toutes ces remarques relatives à la prise en charge des retentissements psychologiques des faits subis, doit-on comprendre que vous n'avez affaire, dans les dispositifs d'urgence, qu'à des patients, des femmes en particulier, victimes de violence de type physique ? Ne vous arrive-t-il pas de recevoir des personnes en état de traumatisme psychologique ? Comment, alors, les traitez-vous ?
Ces violences sont probablement beaucoup plus nombreuses que les violences physiques, et à certains égards, quelle que puisse être la gravité dramatique de ces dernières, plus destructrices.
Aux urgences, nous rencontrons des patients manifestement sous contrainte psychologique importante. Il arrive même, après qu'une femme a été admise, que son conjoint survienne peu après et fasse alors preuve d'une présence forte. C'est une situation qui n'est pas facile à gérer pour les équipes.
Beaucoup plus fréquente est l'association entre violence physique et psychique. Dans des cas très aigus, il faut alors savoir protéger la femme, quitte à la transférer, sous X, à l'intérieur de l'hôpital, de façon à empêcher que son mari ne veuille la faire rentrer à la maison.
Par ailleurs, l'observation clinique d'une femme peut montrer qu'elle est déprimée, alcoolisée, sans qu'il y ait traumatisme apparent. Or l'alcoolisation est aussi une façon d'alléger sa douleur psychique forte. Il faut savoir dépister ces cas, ce qui nécessite une expérience clinique de la part des équipes sur le terrain. C'est alors souvent une infirmière expérimentée qui le signalera à l'interne. A ce stade encore, l'important est de protéger. Or, je ne suis pas sûr que tous sachent bien le faire.
Le cycle de la violence conjugale commence par la violence psychologique ; la violence physique ne vient qu'après. Au quotidien, la violence psychologique, avec son cortège de harcèlements et de menaces en tous genres, est beaucoup plus destructrice que la violence physique – même si, bien sûr, celle-ci fait mal, au propre et au figuré –.
Or, les femmes victimes réagissent rarement à ces premiers faits de violence, souvent de nature psychologique. Elles ne reconnaissent pas ou ne veulent pas reconnaître cette violence comme telle. Avec le temps se développent alors des traumatismes psychologiques, avec des conséquences considérables pour elles et leurs enfants.
Notre service, conduit, auprès des personnels des services d'urgence, de gynécologie obstétrique, de pédiatrie, des actions de formation au dépistage de ces femmes. Les motifs pour lesquels elles vont consulter sont en effet divers : chutes dans l'escalier, troubles de grossesse, etc.
Je comprends la motivation, notamment des associations, pour faire reconnaître la violence psychique. Les troubles qui en résultent auront d'ailleurs pu être notés par le médecin dans un certificat. Mais mon expérience d'expert me fait conclure que les violences psychiques au sein du couple sont aussi difficiles à objectiver que le harcèlement dans le milieu professionnel. Il n'y pas de témoins. C'est parole contre parole.
Si l'on flèche les lieux de soins, les êtres humains s'en saisiront. En organisant, comme dans d'autres pays, un fléchage des lieux où la société reçoit, évalue, accompagne les victimes de violences psychiques, on permet à ces dernières de pouvoir en parler et d'en faire état ensuite dans une plainte si la maltraitance psychologique est objectivable.

Qu'en est-il du retentissement psychologique des violences sexuelles commises hors du cadre familial ?
Le retentissement psychologique est toujours présent et la prise en charge psychologique indispensable.
Il nous revient, face à certains comportements – une personne prostrée ou, au contraire, très agitée – de prendre le temps de laisser la victime parler si elle le souhaite afin d'évaluer le retentissement psychologique des événements vécus.
L'enquête de l'INSERM sur les violences conjugales a permis de faire émerger dans la société la question des femmes victimes de violences. Pour autant, une étude menée dans les services d'urgence par des équipes extérieures qui montrerait la méconnaissance par ces services de la réalité des violences conjugales, serait un formidable outil pédagogique pour aider les acteurs du terrain à saisir ce qu'ils ont sous les yeux mais qu'ils ne voient pas, immergés qu'ils sont dans leur quotidien.

Peut-être faut-il réaliser un effort de formation, raccourcir le temps de prise en charge aux urgences, simplifier le parcours qui mène jusqu'aux urgences médico-judiciaires. Le problème est complexe car nous touchons là au plus profond de l'intime. La vraie difficulté est celle du repérage en amont, ce que j'appellerai le signalement. À cet égard, pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'il est possible de faire ?

Vous arrive-t-il de recevoir dans vos services des femmes qui ont été victimes, dans le cadre de leur activité professionnelle, de violences psychologiques ou d'agressions sexuelles n'allant pas jusqu'au viol ? Comment alors traitez-vous ces cas ?
Je pense effectivement que beaucoup est à faire en amont, surtout en matière de violence de masse. Si toutes les personnes battues de France, dont 10 % d'hommes, portaient plainte au même moment, les tribunaux seraient engorgés. Mais il y a aussi l'aval, car des couples continuent à vivre ensemble après la plainte.
Pourtant, nous rencontrons en France une difficulté, celle d'organiser le travail interdisciplinaire. Or il serait pertinent que chaque département dispose d'un espace dédié à la violence familiale, où interviendraient les services de santé et les services sociaux. Là aussi, un fléchage des compétences et l'apprentissage du travail en commun sont nécessaires. Ce sont des pratiques institutionnelles qui permettront à des corporations de travailler ensemble. Une autorité – la ville ou le département – pourrait ainsi prendre l'initiative de réunir les professionnels concernés, par exemple une fois par an.
Dans les pays où des consultations pour les auteurs de violences sont organisées et fléchées, les familles les utilisent en amont du temps judiciaire. Dans deux départements où je travaille – Paris et les Hauts-de-Seine – j'essaie pour ma part d'avoir des rapports de partenariat avec les services sociaux pour les aider à évaluer les situations familiales pour lesquelles ils ont des suspicions.

Si vous ne traitez que les femmes qui ont déposé plainte, cela signifie que toutes les autres ne peuvent avoir accès au système judiciaire et à une véritable prise en compte du problème qu'elles vivent. La formation des premiers intervenants est donc essentielle.
Nous intervenons dans un parcours fléché, qui ne reflète pas le nombre réel de personnes victimes de ce type de violences. Mais, en ce qui concerne en le département du Val-de-Marne, tous les intervenants peuvent nous contacter en cas de suspicion de maltraitance : les travailleurs sociaux comme les différents acteurs de l'éducation nationale – tels que les médecins scolaires et les infirmières – ou de l'hôpital. Lorsque, par exemple, des personnes viennent consulter dans des services d'obstétrique ou de gynécologie à la suite de violences conjugales dont elles ne parlent pas, nous sommes disponibles pour être à l'écoute des personnels, même si cela ne fait pas partie de notre travail stricto sensu.
La question de l'amont est d'autant plus essentielle qu'une dichotomie existe entre le social et le sanitaire. En Espagne, des associations, mais également la police, sont présentes dans les services d'urgence. Dans notre pays, on demande à la femme de se rendre – suivie parfois de son compagnon ! – dans un poste de police, car il est très difficile de faire venir des policiers pour enregistrer une plainte.
J'ai le sentiment que les choses peuvent se passer autrement dans les petites villes, mais il faudrait savoir ce qu'il en est exactement et cerner les endroits où il conviendrait d'agir.
Je ne me permettrai de ne pas vous répondre sur ce point.

Les urgentistes ont-ils reçu un minimum de formation pour être en éveil devant des cas de violences conjugales ?
Quant aux services médico-judiciaires en existe-t-il plusieurs par département et comment fonctionnent-ils ?
Enfin, qui pourrait prendre l'initiative d'un travail en réseau ?
Être en éveil ne dépend pas de la seule formation, mais également de sa culture: un infirmier macho le restera – en minimisant par exemple le cas d'une femme – même si la formation qu'il reçoit tend à l'aider à adopter un autre comportement.
S'agissant de la formation, la capacité de médecine d'urgence – la CAMU – comprend la question des violences conjugales, mais c'est un point parmi de multiples autres. La commission Henrion avait souligné la nécessité d'établir dans chaque hôpital des protocoles de repérage de la maltraitance qui fassent partie de l'accréditation de l'établissement. Je ne suis pas sûr que cette préconisation ait été reprise. Pourtant, l'existence d'une obligation est souvent le seul moyen de parvenir à ses fins.
En tout cas, la formation restera toujours insuffisante par rapport au savoir-faire d'une infirmière, par exemple, qui travaille depuis dix ans aux urgences. Je le répète, le référent est extrêmement important. C'est peut-être lui seul d'ailleurs qui peut animer le réseau.
Concernant la question des urgences médico-judiciaires, le premier service en la matière s'est ouvert à l'Hôtel-dieu en novembre 1985. Il couvre Paris intra muros. À l'heure actuelle, on dénombre un service par département de la petite et de la grande couronne, sachant qu'en Seine-et-Marne, qui compte trois tribunaux de grande instance, un seul service est ouvert : il se situe à Lagny-sur-Marne, qui dépend du tribunal de Meaux, et il ne couvre donc qu'une partie du département.
Pour ce qui est du Val-de-Marne, nous disposons de moyens de transport et les personnes concernées sont quelques fois accompagnées par les services de police pour faciliter leur déplacement.
Dans le reste de la France, on compte au moins un service de ce type par CHU.
Quand il n'y a pas d'UMJ, l'examen peut être effectué au sein des hôpitaux par les services de gynécologie, suivant un protocole bien précis. C'est pourquoi nous sommes régulièrement contactés par différents services qui veulent savoir à quels types d'examen procéder.
Contrairement à la cinquantaine d'urgences médico-judiciaires, les services d'urgence ne sont pas structurés, ce qui empêche d'avoir un état des lieux précis. Le chef du service, par exemple, a pu parfois recevoir une formation aux urgences médico-judiciaires par la société francophone de médecine d'urgence, mais ce ne sont que des cas isolés.
Un diplôme récent, la capacité de pratiques médico-judiciaires, délivré par certaines facultés, permet aux étudiants qui le souhaitent de se former au moyen de stages dans les urgences médico-judiciaires.
S'agissant du travail en réseau, il existe dans de nombreux départements une commission d'action contre les violences faites aux femmes qui regroupe déjà de façon structurée différents intervenants. Il conviendrait d'y adjoindre des représentants des services sociaux, qui sont en première ligne en matière de suspicion de maltraitance, et des médecins. Si les réseaux tiennent à la dynamique des hommes qui les composent, le triptyque État – services sociaux – santé permettrait à coup sûr d'entrer dans une logique de dépistage en amont.
Certaines victimes souhaitent toujours, même si c'est un leurre, pouvoir régler leur problème sans recours à la justice. En effet, porter plainte est une démarche qui reste difficile parce que l'on se trouve là au coeur de la famille. La judiciarisation n'est pas, hormis pour les cas graves, toujours l'alpha et l'oméga de la prévention de la violence familiale. Je le constate tous les jours en ma qualité de psychiatre criminologue, le fait de nommer, de dévoiler la violence familiale constitue aussi un fort élément de prévention contre tout dérapage : dès que la victime parle, souvent la violence s'arrête.
Dans mon propre service, une affaire de harcèlement s'est ainsi terminée du jour au lendemain après que l'infirmière ait osé nous parler et a ainsi permis de régler le problème. De même, j'ai rencontré des femmes qui en ont fini avec les violences après avoir simplement menacé de la révéler.
Parallèlement à la voie judiciaire, qui est aujourd'hui bien en place, même si l'application de la loi peut être améliorée, notre société doit maintenant effectuer un travail en amont afin d'empêcher, grâce au triptyque État – services sociaux – santé, que se répètent des actes de violence et de parvenir à les prévenir.
À cet égard, disposer d'un homme-orchestre serait utile en matière de prévention de la maltraitance pour faire le travail, d'une part, de dépistage des cas graves, d'autre part, de prévention lorsqu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à une action en justice, d'autant que celles-ci sont parfois décevantes pour la victime.
Un tel travail en amont me semble extrêmement intéressant à mener pour tout ce qui ressort de la violence familiale parce qu'une fois que celle-ci est nommée, elle peut être prévenue.
Quant aux cas de violence qui ressortent de la sphère professionnelle, il existe tellement de causes d'arrivée aux urgences que nous ne savons pas les repérer. À cet égard, le bon acteur serait peut-être le médecin du travail, voire le généraliste.
De plus en plus de personnes nous sont adressées à la suite d'un dépôt de plainte pour violence sur un lieu de travail, ce qui n'était quasiment jamais le cas voilà dix ans. À l'époque, ce type de violence existait bien évidemment, mais, comme pour les violences conjugales, les victimes de harcèlement dans le milieu professionnel ont été de plus en plus nombreuses à en parler grâce aux campagnes d'information.

Dans le milieu professionnel, cela peut-il également aller jusqu'aux violences physiques ?
Tout à fait. Le harcèlement sexuel peut aller jusqu'au viol.
Pour 600 services d'urgence, on compte une cinquantaine d'UMJ, une soixantaine de centres SOS-Mains, une centaine de services de neurologie, etc. C'est dire que l'on ne peut garantir à chaque Français l'intervention de ces services dans chaque hôpital de proximité. La télémédecine permet de faire de la consultation à distance dans des conditions sécurisées ; encore faut-il qu'au moyen de la tarification la loi reconnaisse la télémédecine à la fois comme activité de santé et comme une activité économique – ce qui renvoie à la T2A.

J'ai été d'autant plus surprise d'entendre dire ici que l'on manquait d'études épidémiologiques que la même constatation était faite, au cours d'une réunion que je viens de quitter, pour le sida en prison. Nous manquons en France de chiffres sur l'état de la santé. Ainsi, on ignore si le nombre des violences au travail explose ou si elles sont simplement plus connues.
Le rapport du professeur Henrion, qui date de 2001, préconisait dix actions prioritaires à mettre en oeuvre rapidement. L'urgence a-t-elle été suivie d'effet ?
Je précise par ailleurs que les commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes n'existent plus. Le problème est maintenant abordé par les conseils départementaux de prévention de la délinquance, ce qui est symptomatique comme l'est la disparition du ministère des droits de la femme… Une telle situation ne facilite ni la coordination des services ni une meilleure connaissance du sujet.
La première action prioritaire proposée en conclusion du rapport Henrion était de sensibiliser. Si l'action médiatique a permis de sensibiliser le public, la formation des médecins et des professionnels de santé au dépistage des violences conjugales s'est noyée dans la masse de toutes les autres informations. De plus, ces violences sont noyées dans l'ensemble des maltraitances. Il en va un peu de même pour les neuf autres actions. Je suis donc un peu déçu.
Il est vrai que les femmes victimes de violences conjugales se retrouvent tout aussi bien chez le généraliste, aux urgences, dans les maternités que chez le psychiatre voire chez le pharmacien, sans que personne ne mette en musique un plan structuré. L'identification des actions prioritaires et hiérarchisées à mener dans le cadre d'une politique à cinq ans n'est donc pas simple.
Trouver un hébergement d'urgence pour une femme qui veut s'en sortir n'est pas évident. Pourtant, assurer la mise à l'abri de la femme victime de violences était l'objet de l'action prioritaire n° 9.
Quant à l'action n° 8, qui a trait à la commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes, sa concrétisation a été, me semble-t-il, administrative. Elle ne s'est pas faite au coeur du terrain.
Le bilan que je dresse des actions proposées est donc mitigé, à l'image de l'action n° 2, « Évaluer des stratégies » : quelles stratégies avons-nous eues en effet à l'intérieur de l'hôpital ? Des cellules médico-psychologiques ont émergé ici et là dans des CHU, mais il manque toujours un plan clair dotant les hôpitaux d'un référent qui soit un aiguillon.
Pour prendre l'exemple des consultations spécialisées en réseau avec l'ensemble du dispositif de soins, il faut, si l'on veut mettre l'accent sur un sujet, encourager les professionnels que cela passionne à s'y investir. Je plaide pour la reconnaissance symbolique des espaces qui prennent en charge, les uns les victimes, les autres les auteurs, car les consultations spécialisées risquent d'être embouteillées.
Il ne faut pas oublier pour autant tout le travail en amont. Si l'on attend que les victimes de maltraitance portent plainte, c'est déjà trop tard. Il faut développer la prévention comme dans d'autres pays, et que des lieux bien fléchés, telles que les consultations spécialisées, puissent intervenir avant le temps judiciaire.
Certains départements ont listé les situations qui avaient abouti à l'homicide volontaire afin de savoir, en étudiant l'histoire sociale et judiciaire des hommes qui en étaient venus à cette extrémité, s'il n'aurait pas été possible d'intervenir plus tôt. Mon équipe et moi-même essayons, en travaillant sur les différentes catégories d'auteurs – les immatures, les égocentrés ou les personnalités pathologiques, dont certaines sont des paranoïaques qui harcèlent et tuent même après la séparation –, de dégager des items très simples de décodage afin de dépister des sujets à risque, sachant que tous les hommes violents ne tuent pas.

Le maintien de la femme victime et de ses enfants dans leur environnement, associé à un éloignement de l'auteur des violences, constitue-t-il une meilleure solution que, comme le suggère la proposition n° 9 du rapport Henrion, leur mise à l'abri ?

Lors de la préparation de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, il nous a très rapidement semblé qu'il fallait prévenir les risques liés à la situation de dépendance des jeunes filles. Nous avons donc pris des dispositions relatives à la pédophilie, au tourisme sexuel et aux mutilations, notamment les excisions. Dispose-t-on d'un état de la situation à ce dernier égard ?
Ces problèmes sont véritablement noyés dans la masse des pathologies auxquelles les urgences générales sont confrontées. Nous ne disposons pas, aux urgences, d'éléments objectifs cliniques ou épidémiologiques ni d'approche globale de ce sujet. Nous ne sommes pas les bons interlocuteurs.
Nous sommes conduits à recevoir des victimes de ce type, soit à la suite de signalements effectués par les services sociaux ou par un service hospitalier – si l'enfant hospitalisé en parle ou si des éléments font suspecter une mutilation –, soit lors d'enquêtes conduites sur des personnes suspectées d'effectuer des excisions sur de très jeunes enfants. Des examens destinés à rechercher l'existence de mutilations sexuelles peuvent alors nous être demandés.
Non. Les cas sont trop disparates.

Vous arrive-t-il de constater de telles mutilations chez des femmes qui viennent vous voir à la suite d'une agression ?
Quoique les cas soient rares, il nous est en effet arrivé de constater des mutilations anciennes lors de l'examen de femmes que nous recevons à la suite d'agressions sexuelles. Elles nous parlent alors de ce qu'elles ont subi dans leur petite enfance.

Pour en revenir à la question relative à la mise à l'abri, la meilleure solution est-elle que le conjoint violent quitte le domicile ou que la femme soit hébergée à l'extérieur ?
Le dispositif institué par la loi est extrêmement positif dans le cas d'hommes violents à la personnalité pas trop paranoïaque. La femme reste au domicile tandis que, après avoir été mis en garde à vue, l'homme auteur de violences physiques en est exclu. La société lui fait ainsi savoir que ses comportements sont interdits.
Il est des cas, en revanche, où, en sortant de garde à vue ou d'une petite peine, le sujet va enfreindre la règle posée par le juge, et venir harceler sa compagne, pouvant aller jusqu'à la tuer. Certaines femmes, envisageant une telle situation, demandent elles-mêmes à quitter le domicile pour un lieu anonyme.
Dans certains cas – il appartient aux magistrats d'en décider – l'éviction n'est pas nécessaire, dans beaucoup d'autres, elle est utile, enfin, dans une troisième catégorie de cas, l'installation de la femme dans un lieu inconnu du conjoint violent est extrêmement adaptée.
Même si la situation peut ensuite évoluer, il est important, pour une personne admise aux urgences dans une situation aiguë, de pouvoir être hébergée à distance du lieu où elle a été battue, en bénéficiant d'un accompagnement. Or, une femme qui entre aux urgences avec la volonté de quitter son domicile, peut être amenée à y retourner parce qu'on ne lui aura pas trouvé d'hébergement.

Comment abordez-vous, notamment sur le plan psychologique, le problème de la prise en compte des auteurs de violences ?
J'ai à cet égard deux pratiques, l'une, dans le service public, au sein de la plus importante consultation de sujets en obligation de soins, l'autre dans le cadre associatif de la Ligue française pour la santé mentale, où nous sommes partenaires du parquet.
Quel est l'état des lieux ? Mon équipe, qui a commencé voilà plus de dix ans, doit répondre à de plus en plus de demandes relevant de l'obligation de soins créée par le législateur et la plupart des sujets qui viennent nous voir le font dans ce cadre.
Nous pratiquons essentiellement des techniques de groupe en prenant en compte trois profils : d'une part, les sujets violents : marqués par l'immaturité, ils sont assez faciles à prendre en charge ; ils sont même presque demandeurs et sont motivés ; d'autre part – le groupe principal –, les sujets égocentrés qui, sensibles à l'action de la société et de la justice, acceptent de se laisser recadrer ; enfin, les sujets pathologiques à la personnalité plus problématique. Certains de mes collègues ont popularisé à leur égard le concept de pervers narcissique, qui suscite de ma part quelques réserves car il est trop général : tous les hommes violents ne sont pas pervers et narcissiques.
Ce qui m'intéresse en matière de violences conjugales c'est de tenter de distinguer, après un signalement, les signes qui indiqueraient que les auteurs de violences pourraient recommencer, voire aller jusqu'à tuer leur compagne. Il serait intéressant d'identifier de tels sujets capables de récidiver même après une plainte et leur présentation au procureur.
Pour autant, il s'agit d'une minorité. La majorité est sensible à l'interpellation et renoncent à la violence physique: ils se sentent sous l'oeil du procureur.
Sur ce sujet, les parquets ont été plus réactifs que les juges du siège. Ils sont plus interventionnistes ne serait-ce que par le classement sous conditions ou encore l'obligation de soins jusqu'au procès. À l'inverse, la pratique d'accompagner les peines par de telles obligations de soins ne se développe que lentement, car les juges savent que les structures d'accueil manquent.
Par ailleurs, le temps de l'obligation de soins que nous donne la justice est insuffisant eu égard à l'évolution nécessaire de l'homme violent, tout particulièrement dans les cas où le couple ne se sépare pas. En matière de violence conjugale, en effet, si dans plus de la moitié des cas de violences la séparation intervient après une plainte, certains couples reconstituent leurs liens après la plainte.
Un accompagnement de la famille est alors nécessaire. Aussi serait-il pertinent – je sais que je suis en l'occurrence atypique par rapport au discours associatif – que ceux qui s'occupent des uns et des autres se rencontrent afin que l'on n'en arrive pas à ce cas que j'ai connu récemment où un homme, exclu du domicile par le procureur, rentrait dormir chez lui, la porte lui étant ouverte par sa femme… Le couple reconstituait la vie conjugale dans le dos de la société ! La réalité n'est pas toujours simple.
Mon équipe dispose, en un même endroit, d'un lieu pour les auteurs, d'un autre pour les victimes et d'une consultation pour les enfants témoins, car nous pensons qu'un accompagnement systémique de la famille est nécessaire quand le couple se reconstitue. Voulant trop bien faire, certaines associations ont fait acter par le ministère que les services qui s'occupaient des auteurs ne seraient pas validés comme lieux de bonne pratique s'ils s'occupaient aussi des victimes. Il s'agit là selon moi d'une démarche idéologique dont je comprends l'esprit, mais qui ne correspond pas à la pratique de terrain d'autant que l'on s'aperçoit que les personnes qui traitaient les victimes sont aussi intellectuellement intéressées par le traitement des auteurs.
Dans ma pratique, j'ai également compris qu'il fallait s'appuyer sur la famille si l'on voulait que la pression sur l'auteur continue à s'exercer au-delà du temps strict de l'obligation judiciaire de soins. Rencontrer la famille permet à cet égard de demander ce qu'ils pensent à la mère de la femme battue et au père de l'homme violent. Tel est le type de prise en charge que mon équipe et moi essayons de développer.
Je comprends que des associations se soient opposées à la médiation pénale. En revanche, interdire un entretien de couple alors que celui-ci s'est reconstitué depuis des mois est proche de la posture idéologique. En tout cas, l'accompagnement d'un couple qui reconstitue la vie commune après que des violences sont survenues, présente une complexité spécifique qui nécessite, selon moi, des outils complémentaires.
Ma préconisation phare reste avant tout la consultation spécialisée fléchée de sujets sous main de justice. Il se peut d'ailleurs que nous l'obtenions de la part du ministère de la santé pour les agressions sexuelles car c'est un leurre de croire que le sujet agresseur sexuel va, dès sa sortie de prison, se diriger vers le centre médico-psychologique le plus proche.
Il serait même pertinent que les familles puissent, en amont, saisir ces lieux spécialisés, de façon, comme dans certains pays, à exercer une sorte de chantage affectif sur l'agresseur, en menaçant de le dénoncer s'il n'engage pas à son tour la démarche.
Si je suis favorable à la judiciarisation, puisque j'ai développé l'obligation de soins, je prône donc également le développement d'outils sociaux plus innovants et plus subtils pour traiter la masse de ces situations. Face à des femmes qui ne veulent pas porter plainte, il faut, à l'instar d'autres pays, des dispositifs en amont. Nous disposerons alors d'un échiquier satisfaisant pour le traitement de ce problème complexe.

Puisqu'on ne traitera pas le malheur des femmes victimes de violences uniquement par la judiciarisation et la pénalisation, et qu'il faut donc travailler à éduquer en amont, nous encouragez-vous à émettre des suggestions, pas obligatoirement de nature législative, relatives à la prise en « charge » des auteurs ?
Le fait que nous manquions terriblement sur le plan local de moyens pour venir en aide aux femmes victimes ne nous permettra pas de faire l'économie d'une réflexion sur la prise en charge des hommes, y compris dans des dispositifs d'hébergement, ne serait-ce que pour qu'ils sachent à leur tour ce que c'est que de devoir partir de chez soi, parfois dans des situations de très grande urgence et de très grande précarité.
Si, dans beaucoup de cas, il faut prendre en charge les victimes et pénaliser les hommes violents, ne pas accompagner la prise en charge de l'homme violent dans le cas des couples qui continuent à cohabiter après la plainte ne serait pas une bonne pratique. Il faut un accompagnement à la fois pour l'auteur et pour la victime.
Que les moyens soient d'abord donnés à la prise en charge des victimes est logique. Mais les victimes – je le dis comme je le pense – vont trop loin lorsqu'elles théorisent le monde tel qu'elles le voient. Des pays étrangers ont organisé la prise en charge d'hommes violents, ce qui se révèle sociétalement comme un très bon outil en amont. Les femmes qui continuent à vivre avec leur conjoint après avoir porté plainte tiennent-elles d'ailleurs vraiment le même discours que les associations ?
Nombre d'équipes ont d'ailleurs lancé une prise en charge des auteurs. Freiner cette démarche serait incompréhensible. Je plaide donc pour un accompagnement du système familial, comme au Canada, où les familles utilisent en amont ces consultations pour exercer un chantage affectif sur les auteurs en les menaçant de les dénoncer s'ils ne vont pas se soigner.
La judiciarisation ne peut pas tout. Il faut un dépistage précoce et un double axe de traitement concernant aussi bien les victimes que les auteurs.

Le véritable objectif d'une action de prévention de la violence, c'est de faire en sorte que celle-ci n'ait pas lieu. À cet égard, c'est très tôt que l'éducation au respect de l'autre doit être conduite, puisque l'origine culturelle des violences faites aux femmes tient à un sentiment de supériorité du garçon puis du jeune adulte, enfin de l'homme envers la personne de l'autre sexe avec laquelle il va travailler ou vivre. Cependant, les enseignants ne peuvent pas tout faire. Aussi ne conviendrait-il pas de permettre aux professionnels confrontés au phénomène – médecins, travailleurs sociaux, etc. – d'intervenir auprès des enfants – le plus tôt serait le mieux – avec toute la crédibilité que leur donne leur expertise?

Que des experts puissent intervenir, je le comprends, mais l'approche de la question des violences faites aux femmes n'est pas la même selon que l'on se place de notre côté – celui de la violence de genre –, ou de celui du docteur Coutanceau.
Pour moi, la logique culturelle n'est pas la seule cause de la violence de l'homme sur la femme. D'abord parce qu'en termes de violence physique, on compte, sur le plan sociologique, neuf hommes violents pour une femme violente. Ensuite, parce que l'on ne peut pas mettre entre parenthèses l'existence d'une psychopathologie de la personnalité. Les sujets violents sont des sujets caractériels, impulsifs, qui présentent des traits égocentriques, voire paranoïaques. À cet égard, il existe aussi des femmes violentes psychiquement : la violence psychique est en effet beaucoup plus partagée que la violence physique. Enfin, parce que le couple est une situation à risque pour les personnes immatures et égocentrées.
Sans nier la lecture de genre de la violence, ma vision en tant que criminologue de la violence est plus plurifactorielle, sans être contradictoire avec la vôtre.
Mon objectif est également plus modeste que le vôtre. Ce n'est pas la prévention que je vise dans l'absolu, même si j'y suis favorable : c'est le dépistage précoce pour arrêter le processus au moment où il commence, et favoriser le plus tôt possible la parole de la victime. Nombre de femmes battues m'ont ainsi assuré que si quelqu'un – professionnel, ami, membre de la famille – avait deviné leur situation, elles auraient parlé plus tôt.
Pourquoi des femmes invitées depuis des années, par des campagnes de presse, à dénoncer leur conjoint violent, ne le font pas. Une action de sensibilisation des professionnels et de l'entourage est indispensable. Une fois que les gens parlent, la violence conjugale ne peut plus se répéter. Un dispositif qui amène la victime à parler aussi tôt que possible est un élément de prévention de la répétition des violences.

D'où vient cette violence des hommes ? De l'éducation ? De la société ? Prévenir n'est-ce pas aussi faire apprendre par les parents, par l'école, par la société qu'une femme, cela se respecte et que l'homme n'est pas supérieur à elle ?
La violence des hommes, notamment dans le couple, n'est pas liée qu'à la culture. Les androgènes favorisent la violence, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas seulement violents avec les femmes. Ils le sont également entre eux. Ma conception de la violence conjugale est donc polyfactorielle. Elle ne repose pas sur la seule hypothèse culturelle. Si je la partage, j'en ai une vision plus complexe.
Prenons la violence psychique. Si j'osais, je dirais que les femmes ont aussi leur manière de peser durement sur la vie du couple.
Telle qu'elle m'apparaît dans ma pratique, la violence psychique est en effet beaucoup plus partagée entre les hommes et les femmes que la violence physique. Bien sûr, il existe une connotation machiste dans la violence psychique d'un homme sur une femme, car celui-là se croit supérieur. Mais il existe aussi une violence psychique des femmes sur les hommes, indépendamment de la violence physique. C'est ce que j'ai appelé le défi de l'intimité.
Ma thèse est que nombre d'êtres humains ont une difficulté à vivre en couple. La vie en commun n'est pas un long fleuve tranquille et les plus immatures et les plus égocentrés des hommes et des femmes traduisent certaines difficultés en violence psychique sur l'autre voire – pour les hommes plus que pour les femmes – en violence physique.

L'analyse culturelle de la violence est peut-être très répandue dans la société, mais elle est relativement récente. Auparavant, on expliquait par leurs caractères le fait qu'un homme et une femme ne s'entendaient pas.
L'enquête épidémiologique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale – INSERM – sur la violence, montre que celle-ci est largement répandue dans le monde, quel que soit le type de société.
J'ai été sollicité pour intervenir dans les lycées sur la toxicomanie et le sida. Ces interventions par quelqu'un qui a l'expérience sont très appréciées par les adolescents, d'autant que la forme de l'intervention, qui n'est pas celle d'un cours magistral, permet de faire émerger de nombreuses questions, voire certains mythes.
La santé publique en France est bien malade. S'il faut à cet égard que la prévention concernant les maltraitances en général et d'autres sujets comme la drogue et l'alcool, soit dirigée par des professionnels, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse uniquement de médecins. D'autres acteurs de la santé, telles les infirmières, savent très bien faire en termes d'éducation pour la santé.
La prévention en amont passe par la cité, c'est-à-dire notamment par le généraliste, voire par le pharmacien, mais également par la formation au cours des études médicales. Il faut une nouvelle approche éducative pour nos étudiants en médecine qui sont noyés sous l'apprentissage de maladies très pointues qu'ils n'auront jamais à connaître au cours de leur exercice.
Si je puis me permettre, monsieur Coutanceau, vous est-il arrivé d'être confronté à des situations de récidive, après qu'une connaissance des faits a entraîné une prise en charge, judiciaire ou non ?
Je ferai appel, pour vous répondre, au concept « d'être intimidable » au sens criminologique. Beaucoup d'êtres humains sont sensibles au fait d'être interpellés par la société. La garde à vue, à cet égard, est un choc. Sur cent hommes violents, un grand nombre arrête la violence physique – même si la violence psychique peut perdurer – simplement parce qu'ils sont repérés par la société. Statistiquement, la séquence interpellation sociale – garde à vue – sanction judiciaire est extrêmement efficace.
Certes, certains, à la personnalité complexe, continueront d'être violents. Un paranoïaque, par exemple, pense que sa femme est à lui éternellement, ce qui peut aller jusqu'à la tuer. C'est pourquoi j'essaie, avec mon équipe, de trouver les items de risque afin de prévenir. Ces hommes qui continuent constituent cependant une minorité.

Certains pervers ne passent jamais à la violence physique. Ils restent dans le domaine de l'humiliation. Comment prendre en compte cette violence psychique et psychologique ?
L'être humain, lorsqu'il n'est pas mature, lorsqu'il n'est pas épanoui, a plaisir à tourmenter l'autre. Dans tous les espaces humains – le couple, la famille, l'entreprise – des êtres humains en maltraitent d'autres psychiquement, prennent plaisir à déstabiliser l'autre. Quand quelqu'un d'angoissé, un peu jaloux, a peur que l'autre le quitte, il se venge.

Quand cette même personne ne se complaît plus dans les violences psychiques et psychologiques, passe-t-elle forcément à la violence physique ?
Qu'est-ce qui fait qu'un homme est violent ? C'est souvent parce qu'il n'est pas assez créatif dans sa manière de faire du mal à l'autre psychiquement. Nombre d'individus violents sont tout de même des impulsifs, des brutes, qui se contrôlent mal. Dès que les gens sont plus contrôlés parce qu'ils ont une structuration psychique plus intelligente, ils maltraitent les autres psychiquement. Ils savent que la violence physique s'objective et c'est pourquoi de très grands maltraitants psychiques ne présentent aucun risque de passer à la violence physique. Ils sont assez intelligents et fins stratèges pour faire du mal à l'autre en le maltraitant psychiquement.
Prenez le harcèlement dans l'entreprise. La violence physique est rare. On est plus dans le jeu, dans la stratégie psychique.

Nous connaissons tous des femmes qui ne se savent pas victimes de violence. À partir du moment où l'on aura réussi, d'une manière ou d'une autre, à caractériser ce qui fait violence au sein d'un couple, c'est-à-dire ce qui témoigne d'un ascendant qui n'est pas de l'ordre du normal et qui dénature le lien, on n'aura pas tout réglé, mais au moins aura-t-on permis la caractérisation de la violence qui, je le répète, continue, pour beaucoup, à ne pas en être une.
Il n'est pas facile pour la société d'objectiver la violence psychique. Le médecin peut acter que certains symptômes sont la conséquence d'une maltraitance psychique dont un patient a fait état. Pour autant, comment la justice humaine va-t-elle gérer un tel constat ? C'est un peu comme pour les séparations conjugales : devant un couple qui se déchire pour avoir la garde des enfants, l'expert et parfois le juge peuvent perdre leur latin devant les allégations des uns et des autres.
Le harcèlement dans le couple, comme ce fut le cas dans l'entreprise, n'est pas évident à objectiver. Ce n'est pas impossible, mais à tout le moins difficile.
La violence psychique n'est pas facile à objectiver et elle laisse plus de traces psychologiques que la violence physique.
En médecine, on sait pour le diabète, par exemple, qu'au-delà de tel niveau de glycémie on est diabétique. Le diagnostic, dans le champ de la psychiatrie, notamment au moyen des procédures de codage, est, lui, beaucoup plus complexe.
Les équipes sauront identifier les cas sévères, mais la définition de la frontière entre le normal et le pathologique constitue, dans le champ de la psychiatrie, un problème extrêmement difficile. Cela nécessite de la part des équipes de se constituer un savoir afin d'identifier des indicateurs et des traceurs cliniques fins. Il existe, pour des maladies organiques dont toute la physiopathologie a été identifiée, des centres de référence. Pourquoi n'en existerait-il pas dans le champ de la psychiatrie ou dans le champ psychosocial ? C'est à nous, mais aussi à vous d'innover en la matière car cela nécessite un travail de dix ou vingt ans avant qu'une équipe fasse émerger des profils, des indicateurs issus de l'expérience clinique.

Je vous remercie, madame, messieurs, pour vos interventions extrêmement intéressantes.
La séance est levée à dix-neuf heures quinze.