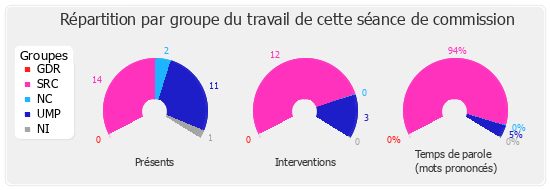Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Séance du 1er octobre 2008 à 9h45
La séance

Nous avons mis deux sujets à l'ordre du jour de cette audition : l'état des négociations sur le commerce, naturellement, ainsi que les travaux du comité commerce et environnement car la question des conditions dans lesquelles s'effectuent les échanges internationaux croise, plus que jamais, celle de la lutte contre le changement climatique et des politiques environnementales.
Le contexte économique et financier est actuellement marqué par une grande instabilité, et l'on ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre cette situation et celle du commerce international. Dans un monde entièrement globalisé, les échanges commerciaux doivent-ils, peuvent-ils être régulés ? Selon quels principes ? C'est à cette question que l'OMC doit répondre en s'efforçant de mettre en actes les solutions qu'elle préconise, en dépit des intérêts divergents – ou supposés tels – des différents États.
Le dernier round de négociations qui s'est tenu à Genève, en juillet dernier, n'a pas permis de déboucher sur un consensus, qu'il s'agisse des échanges de produits agricoles, de produits industriels ou de services mais il a certainement eu le mérite de faire apparaître les points d'achoppement essentiels qui devront être traités prioritairement dans de nouvelles discussions. Je suis persuadé, monsieur le directeur général, que vous allez nous en parler.
L'OMC est tout aussi concernée par les questions environnementales, à plusieurs titres. Premièrement, il existe un marché mondial des biens et services environnementaux, qui soulèvent les mêmes questions que les autres biens et services. Deuxièmement, de nouveaux problèmes de concurrence apparaissent, qui sont liés à la prise en compte très hétérogène des préoccupations environnementales dans les économies nationales. Deux risques existent à ce niveau : celui d'un détournement des normes environnementales pour des motifs protectionnistes, souvent évoqué, mais aussi celui d'une absence de régulation qui offrirait aux pays les moins respectueux du développement durable un avantage compétitif indu.
Comment l'OMC peut-elle concilier des objectifs d'accroissement des échanges et de développement durable ? Quelles sont les règles à élaborer dans un cadre multilatéral ?
Nous avons souhaité vous entendre, monsieur le directeur général, sur tous ces sujets.

Avant de répondre à vos questions, et compte tenu des développements tumultueux de ces derniers temps, je voudrais consacrer mon propos introductif à deux sujets : la place de l'OMC dans la régulation économique internationale, et l'état des lieux de la négociation du cycle de Doha.
Pour situer, en fond de tableau, la place de l'OMC dans la régulation économique internationale, comparons-la un moment à la régulation financière et à la régulation en matière d'environnement.
En matière financière, il est peu de dire que les événements, depuis plus d'un an, ont montré l'absence de régulation internationale efficace. J'entends par là un système de normes qui obligerait les pays qui les ont négociées et acceptées à respecter des règles multilatérales contraignant leur comportement national et international dans certaines limites. La crise actuelle trouve pour l'essentiel son origine dans un défaut de régulation du système financier américain dont les autorités n'ont pas su encadrer la créativité « bourgeonnante » des intervenants sur les marchés d'instruments de crédit. Il existe, certes, des lieux où traiter ces questions. Je ne parle pas du FMI dont le mandat est actuellement limité aux questions de balance de paiement ou de change. Je pense plutôt aux instances qui gravitent autour du pôle de la Banque des règlements internationaux de Bâle, y compris le Forum de stabilité financière créé il y a une dizaine d'années.
Mais les discussions, d'ailleurs fragmentées, qui se tiennent dans ces instances, n'ont débouché que sur des normes minimales, en l'absence d'accord de fond entre ceux qui plaidaient pour des normes réellement contraignantes et ceux qui préféraient faire confiance à l'autorégulation des opérateurs financiers. Les dispositifs en vigueur n'impliquent que de manière indirecte les États nations souverains, le plus souvent arc-boutés sur la défense de leurs intérêts particuliers.
Pour résumer, il n'y avait pas de consensus politique sur un objectif de régulation, a fortiori pas sur le périmètre ou les instruments de cette régulation, ni sur un lieu unique où des instruments juridiquement contraignants seraient négociés ni, encore, sur qui serait chargé de veiller à leur mise en oeuvre.
Dans un autre domaine, tout aussi essentiel pour la régulation globale, celui de l'environnement, la situation est très différente. Si l'on examine la question cruciale de l'émission des gaz à effet de serre, les lois de la physique – qui sont plus établies que celles de l'économie – ont provoqué une prise de conscience collective qui a donné naissance au protocole au Kyoto et aujourd'hui aux négociations post-Kyoto. Dans ce domaine, la discussion ne porte ni sur la nécessité d'une régulation internationale, qui est admise par tous, ni sur l'instance compétente, mais sur la répartition des efforts entre les États nations et sur les instruments contraignants à mettre en place pour assurer le respect des objectifs négociés. Resterait, si tel était le résultat obtenu, à articuler ces nouvelles obligations avec d'autres systèmes d'obligations internationales, en particulier celui de l'OMC. L'expérience des accords multilatéraux sur l'environnement actuellement en vigueur, qui peuvent comporter des mesures impactant le commerce international, montre que cette coexistence est possible.
Dans le domaine environnemental, on dispose donc d'une volonté, d'une énergie politique – absente jusqu'à présent en matière financière –, de lieux de négociations et de surveillance – les secrétariats des divers accords existants – et la négociation porte sur les engagements des uns et des autres à respecter un objectif commun, notamment entre pays développés et pays en développement dont la capacité « contributive » est évidemment différente.
Par rapport à ces deux exemples, l'OMC représente un système de régulation à la fois ancien, éprouvé et sophistiqué – si on le compare aux autres systèmes de régulation économique internationale.
Le système est ancien parce que cela fait plus de soixante ans que ses membres, instruits par les expériences protectionnistes désastreuses des années 1930, ont accepté, au sein du GATT de l'époque, de souscrire des disciplines en matière de commerce international.
Le système est éprouvé car les règles ont régulièrement été mises à jour au cours des huit cycles de négociation de 1974 à 1994, le neuvième cycle, dit de Doha, étant en cours depuis près de sept ans, et parce que l'intérêt du système a été validé par le nombre croissant de ses membres qui est passé de vingt-trois à l'origine à 153 aujourd'hui.
Le système est sophistiqué, enfin, puisqu'il comporte, premièrement, un accord sur le principe de base – qui est que l'ouverture négociée et graduelle des échanges marche mieux que la fermeture improvisée ou sournoise – ; deuxièmement, des règles qui prennent la forme de traités internationaux et portent sur de multiples aspects du commerce international des biens et des services ; troisièmement, des mécanismes de surveillance au sein des instances techniques regroupant les membres ; quatrièmement, un mécanisme contraignant de règlement des différends, sans précédent en droit international et, enfin, nombre de dispositions spécifiques destinées à compenser les handicaps des pays en développement.
Voilà donc un système beaucoup plus abouti que les autres, et c'est sans doute pour cette raison que l'OMC est souvent présentée comme l'ancre de la régulation économique internationale, à la fois par ses défenseurs et par ses critiques.
Ses défenseurs font valoir la valeur de bien public global que constitue un système qui soumet ses participants à des règles communes d'autant plus précieuses que la globalisation crée une interdépendance très vulnérable à des pulsions protectionnistes. Ces mêmes défenseurs prennent souvent pour exemple le contraste entre la crise de 1929 et les crises en Asie de la fin des années 1990 dont la solution a résidé, pour l'essentiel, dans le maintien des marchés internationaux ouverts qui ont permis aux pays touchés de sortir rapidement de la récession.
Les critiques du système voient dans le caractère abouti de celui-ci la domination du principe d'ouverture de l'échange commercial international sur d'autres champs nécessitant, à leurs yeux, des efforts de régulation tout aussi vigoureux au plan international, par exemple en matière de normes sociales. Même si bien des insuffisances subsistent dans le système OMC, force est de constater qu'il fournit à l'économie réelle, celle de tous les jours, notamment de nos fins de mois, une police d'assurance collective contre le désordre provoqué par des initiatives unilatérales, qu'elles soient ouvertes ou masquées, une garantie de sécurité des transactions en période de crise qui constitue désormais un facteur de résilience essentiel à la gestion d'un monde globalisé : en bref, une police d'assurance globale pour une économie réelle globale. D'où l'extrême importance de conduire à sa conclusion le cycle de Doha dans les turbulences qui secouent actuellement la finance et, peut-être, demain l'économie mondiale, de manière à ce que l'OMC continue à jouer, comme par le passé, son rôle d'« absorbeur de chocs ».
Dans la seconde partie de mon propos, je ferai l'état des lieux de la négociation du cycle de Doha.
Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers des arcanes et des acronymes de la négociation commerciale internationale, il faut imaginer ce cycle comme un long voyage, un itinéraire peuplé de donjons et de dragons, un hybride de l'Odyssée et de la Quête du Graal, dont le terme ne s'achève que lorsque tous les voyageurs sont passés par toutes les étapes.
Je ne vais pas énumérer la liste des vingt thèmes en négociation. Elle pourra figurer en annexe au compte rendu. Une seule certitude existe : il n'y a d'accord final sur aucun thème tant qu'il n'y a pas de consensus sur tous les thèmes mis dans le sac de la négociation en 2001. Cela n'empêche pas la négociation de progresser par à coups et par accumulation depuis bientôt sept ans. Cela fait un temps de gestation un peu éléphantesque mais c'est probablement à la mesure du mastodonte à accoucher.
Une étape décisive vers la conclusion a failli être bouclée en juillet dernier, comme l'a indiqué le président de la Commission. Mais les ministres présents se sont arrêtés avant la fin de l'étape, bien qu'ils aient réussi à franchir la plupart des obstacles en quelques jours. Ils ont buté sur la définition précise des paramètres d'une clause destinée à protéger les pays en développement de bouffées d'importation pouvant constituer une menace pour leur système de production agricole : cette clause opposait deux camps symbolisés par les Américains, d'un côté – au nom des exportateurs de matières premières agricoles – et par les Indiens, de l'autre – au nom de l'agriculture de subsistance.
Depuis, les ministres ont décidé de remettre leurs experts au travail de manière à tenter de trouver avant la fin de l'année un accord sur les sujets encore ouverts à l'intérieur du périmètre de la négociation de juillet : en matière agricole, la fameuse clause de sauvegarde spéciale et quelques autres sujets dont les subventions américaines et européennes à la culture de coton. En matière de marchandises industrielles, plusieurs points techniques restent aussi ouverts, notamment la liste des secteurs dans lesquels les réductions des droits de douane iraient au-delà de la formule générale retenue pour l'ensemble des produits.
En dépit de ce revers préoccupant, les contours du paquet final du cycle de Doha sont désormais suffisamment clairs pour en mesurer les proportions économiques, politiques et systémiques.
Sur le plan économique, les résultats se traduiraient par des réductions de moitié des droits de douane imposés aujourd'hui en matière industrielle ou agricole, dont les deux tiers dans les pays développés et un tiers dans les pays émergents, les pays les plus pauvres étant exonérés de ces réductions de droits de douane, le tout avec une mise en oeuvre de cinq ans pour les pays développés et de dix ans pour les pays en développement. L'impact sur les échanges serait d'autant plus fort que ces droits de douane sont élevés. L'impact des ouvertures supplémentaires en matière de services est plus complexe à estimer.
À l'horizon de cinq ou dix ans, cela représenterait pour l'Union européenne environ 20 milliards de dollars de moins de taxation de ses exportations, avec un gain de 5 milliards de dollars en matière agricole et agroalimentaire, qui est un point d'attention spécifique français.
En matière de subventions agricoles, les disciplines portant sur la partie des soutiens publics qui sont définis à l'OMC comme perturbant les échanges internationaux – représentant, dans le cas de l'Union européenne, environ un quart du soutien total – seraient sérieusement renforcées, comme le souhaitent les pays en développement, puisque les plafonds hérités du Round précédent seraient réduits de 70 à 80 %. Quant aux subventions à l'exportation, elles seraient définitivement interdites.
D'autres thèmes restent à finaliser, même si des progrès, encore inégaux selon les sujets, ont été faits en matière de régulation de l'antidumping, de subventions à la pêche, de procédures douanières ou de certains aspects touchant à la protection de la propriété intellectuelle ou aux biens et services environnementaux, pour ne prendre que quelques exemples.
Sur le plan politique, l'essentiel des résultats de la négociation réside dans le rééquilibrage des règles de l'OMC que réclament les pays en développement, qui estiment que l'héritage des huit cycles précédents porte la marque de rapports de force anciens qui handicapent leur insertion dans le commerce international, donc leur croissance, et donc la réduction de la pauvreté dans des domaines où ils ont acquis entre-temps des avantages comparatifs en matière de biens industriels, d'agriculture ou de services.
À leurs yeux, l'OMC constitue l'enceinte la plus appropriée en raison du poids qu'ils ont progressivement acquis autour de la table de négociation, pour négocier une redistribution des cartes du jeu géoéconomique et géopolitique, redistribution qu'ils peinent manifestement à obtenir dans d'autres organisations comme le Conseil de sécurité de l'ONU, ou les instances de Bretton Woods. Pour faire simple : le temps n'est plus où les États-Unis, l'Europe, le Canada et le Japon faisaient la loi au GATT ou à l'OMC, et le cycle de Doha doit être considéré comme le précurseur d'un système plus équitable où les pays émergents – Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Indonésie, etc. – doivent, en contrepartie, être prêts à assumer leur part de responsabilité.
Le troisième et dernier aspect de ce cycle, l'aspect systémique, me ramène à mon point de départ : conclure le cycle de Doha revient, certes, à encaisser les bénéfices économiques d'une nouvelle génération d'ouvertures de marchés équitablement répartis en fonction des capacités contributives des participants. C'est évidemment un élément très important pour la croissance, pour le développement et, notamment, pour la réduction de la pauvreté dans le tiers-monde. Mais aussi, et probablement surtout dans les circonstances actuelles, conclure consisterait à consolider l'un des rares systèmes de régulation effectifs au plan international. À l'inverse, ne pas conclure reviendrait à fragiliser un bien public construit avec patience et avec peine depuis plus d'un demi-siècle, et qui a apporté de la transparence, de la prévisibilité et de la stabilité, tous ingrédients dont notre planète globalisée a besoin dans beaucoup d'autres domaines, à commencer dans le domaine financier, pour devenir moins dangereuse.
Voilà ce que je souhaitais vous dire en prélude à nos échanges.

Je vous remercie, monsieur le directeur général. Je vais suspendre la séance pour permettre aux membres de la Commission de participer à un vote personnel dans l'hémicycle et nous passerons ensuite aux questions.

La progression du commerce mondial est revenue de 8 % en 2006 à 5,5 % en 2007 et on note un nouveau ralentissement en 2008. Ce ralentissement se confirme-t-il ? Est-il accentué par la crise financière actuelle ?
Y a-t-il vraiment une unité d'approche de l'Union européenne sur les différents enjeux des discussions de Doha ? Les propositions sur l'agriculture et les produits industriels rassemblaient une minorité d'États début juillet : le Royaume uni, la Suède, le Danemark, la République tchèque. Où en est-on aujourd'hui ? Quels sont les États les plus fermés sur la question des services ?
Peut-on penser que l'Inde et les États-Unis accepteront rapidement un compromis et que les négociations pourront reprendre ? La crise financière peut-elle avoir une incidence « positive » ? S'exprimant sur une radio ce matin, vous avez fait un parallèle avec la désorganisation et le manque de régulation du système financier. L'OMC est l'organisation qui a les règles les plus abouties. Nous n'en avons pas suffisamment conscience. Lorsque vous êtes venu devant la Commission il y a un an ou deux ans, vous aviez précisé les modalités de fonctionnement de l'OMC : celui-ci a lieu à partir de panels et aboutit à des décisions qui s'imposent. Il est régi par tout un ensemble de règles de bonne gouvernance qui n'existent absolument pas dans le domaine financier. L'intérêt de ces règles et la nécessité d'aboutir à un accord dans ce nouveau cycle de négociations commerciales ne vont-ils pas être encore plus mis en lumière par ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine financier ?
Plus généralement, quelle interaction y a-t-il entre la crise financière que nous traversons et l'organisation du commerce mondial ?

Le commerce mondial évolue, dans des proportions variables selon les moments, en fonction de trois paramètres. Le premier est la croissance des économies, à division internationale du travail donnée.
Le second est la diversification de cette division internationale du travail, notamment sous l'effet de la technologie et des flux d'investissement : si, à croissance donnée, il y a davantage de division internationale du travail, il y a plus de commerce.
Le troisième paramètre est l'ouverture des échanges, grâce au travail réalisé depuis soixante ans pour éliminer un certain nombre d'obstacles qui les freinaient, même si ces derniers présentent un aspect régulatoire. Ce facteur multiplicateur de la croissance, qui était de l'ordre de un à un et demi il y a trente ou quarante ans, est aujourd'hui de un à trois. Cela signifie que, pour deux points de croissance aujourd'hui, il y a en gros six ou sept points d'augmentation des échanges alors qu'avant, la proportion était de un à deux.
L'OMC n'a pas pour mission d'augmenter le commerce international. Ses membres se sont donnés pour tâche de faciliter l'ouverture des échanges, qui n'est qu'un des trois composants de l'évolution du commerce international.
L'impact de la crise financière actuelle dépendra de la transmission de celle-ci à l'économie réelle, c'est-à-dire à toutes les valeurs ajoutées générées dans un système économique : croissance, augmentation du PNB. Il est trop tôt pour se prononcer à ce sujet. Ce que j'ai dit ce matin sur une radio, c'est que cela m'étonnerait que la crise financière ait un effet positif. Cela étant, je ne sais pas quelle sera l'ampleur de l'impact négatif, d'autant que nous sommes aujourd'hui dans une économie internationale où, bien qu'il y ait un certain degré de couplage, les moteurs chinois, indien, brésilien, indonésien et sud-africain ont une dynamique propre, pour des raisons qui tiennent en partie à leur propre croissance domestique. Raison de plus, à mon avis, pour leur donner l'espace qu'ils réclament dans le commerce international. C'est l'intérêt bien compris des Européens, Américains et Japonais, surtout quand leurs propres moteurs commencent à crachoter un peu.
Votre question sur l'Union européenne n'est pas pour moi. C'est le négociateur européen qui peut dire qui est du côté de la majorité ou de la minorité au sein ce celle-ci. J'ai tout oublié de cette chimie fine en prenant mon « job » actuel. Il est clair qu'il existe des sensibilités différentes et que le prix du poids que l'Union européenne a à la table des négociations de l'OMC – elle est l'un des mastodontes, avec les Américains, même si ce ne sont plus ces deux mastodontes qui décident de tout – est de savoir trouver des compromis.
L'Union européenne peut-elle accepter le paquet tel qu'il s'esquissait en juillet et les compléments qu'il reste à boucler ? Je n'en sais rien. En tout cas, je le souhaite. Mon opinion, pour ce qu'elle vaut, est que c'est un bon deal pour l'Union, qui satisfait nombre de ses intérêts offensifs en matière industrielle, en matière de services et en matière agricole et agroalimentaire.
Je suis de ceux qui pensent que la position de l'Union ne doit pas être seulement défensive en matière agricole. Elle est, dans le monde d'aujourd'hui, le plus gros exportateur agroalimentaire – devant les Américains, compte tenu de son positionnement sur l'aval de la chaîne agroalimentaire et non sur l'amont. De ce point de vue, l'Union européenne et, à l'intérieur de celle-ci, la France, qui est le producteur agroalimentaire le plus efficace dans le système, ont des intérêts offensifs. Je comprends que les Européens mettent l'accent sur leurs intérêts défensifs – et de ce point de vue, notamment sur les produits agricoles sensibles –, les Européens, aidés par les Japonais, les Suisses, les Coréens, les Norvégiens et quelques autres, y ont assez bien réussi. Mais, encore une fois, ce n'est pas à moi d'en juger, mais aux négociateurs européens.
La négociation sur les services n'est pas couplée avec celle sur les questions industrielles et agricoles parce qu'il n'y a pas, dans ce secteur, de tarifs et que l'ouverture des marchés ne s'effectue pas de la même manière : pour les services, elle est en quelque sorte d'ordre réglementaire. Une conférence spécifique a eu lieu en juillet sur ce sujet et il y a actuellement sur la table l'esquisse d'un gros paquet « services ». Il y a à cela trois raisons.
La principale est que beaucoup de pays émergents ont maintenant des intérêts offensifs en matière de services. Dans l'Uruguay Round, il y a dix ou quinze ans, c'étaient les Américains, les Européens et les Japonais qui demandaient aux pays en développement d'ouvrir leurs marchés de services. Aujourd'hui, de nombreux pays émergents sont devenus offensifs dans les domaines de la technologie, de l'information, de la comptabilité, des questions juridiques, des travaux publics, du dragage, pour ne prendre que ces quelques exemples. Les Américains et les Européens ne sont plus seulement en position de demandeurs dans ces négociations. Il faut qu'eux-mêmes acceptent d'ouvrir leurs marchés de services à des pays en développement dans un certain nombre de domaines, ce qui n'est pas toujours simple.
La deuxième raison est que de nombreux pays en développement ont compris l'intérêt qu'ils avaient à ouvrir leurs marchés de services. Cela suppose évidemment une ouverture dans d'autres domaines car la négociation « services » ne se fait pas secteur contre secteur mais de manière très éparpillée. Mais beaucoup de pays sont conscients de l'intérêt d'importer par ce biais des technologies dans les domaines bancaire, financier et de l'assurance, ces technologies étant indispensables au développement et à la structuration de leur économie.
La troisième raison est que, alors qu'il y a dix ou quinze ans, les grands sujets de la négociation « services » étaient la banque, l'assurance et les télécoms, ce sont aujourd'hui les services environnementaux et énergétiques qui se trouvent « au-dessus de la pile » et exercent un attrait.
Le différend sur la clause de sauvegarde a bloqué la négociation en juillet, opposant le camp des Américains – regroupant les pays ayant des intérêts offensifs à l'exportation de matières premières agricoles – et le camp des Indiens – réunissant les pays défendant l'agriculture de subsistance. Les Européens n'avaient pas de cheval dans cette course, si je puis dire, car ils ne sont plus de gros exportateurs de matières premières. Le sujet est sensible. Les États-Unis et l'Inde sont actuellement en période électorale. Les premiers sont sans doute le plus globalisé de tous les pays de l'OMC et le second le pays le moins globalisé. Si les Indiens se « globalisent » en matière de services, ils le font beaucoup moins en matière industrielle, et encore moins en matière agricole. Ils importent cinq ou six dollars par an et par habitant d'agriculture alors que la moyenne mondiale doit être de l'ordre de cent et, pour un pays comme le Bangladesh, qui est extrêmement pauvre, entre vingt et vingt-cinq. Les Indiens ont une sensibilité particulière sur l'agriculture de subsistance. Je pense qu'un compromis est possible. Reste à savoir si les négociateurs commerciaux parviendront à le vendre à la maison.
Quant à la nécessité de règles, j'y ai consacré la majeure partie de mon propos introductif. Je pense effectivement qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait depuis soixante ans, à la suite du choc de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été en partie provoquée par une crise économique mal gérée dans les années 1930. Il est évidemment nécessaire d'avoir un système de sécurité financière, de même qu'existent un système de sécurité commerciale et des systèmes de sécurité sociale dans les pays eux-mêmes. Il faut, pour y parvenir, passer par les trois étapes classiques de la construction d'un espace réglementaire supranational.
D'abord, une volonté politique – et l'expérience prouve que les crises sont souvent productrices de cette énergie politique.
Ensuite, définir un concept commun de ce qu'on veut faire ensemble – ce qui est différent de la volonté politique. Ce concept commun se négocie. Il relève du compromis.
Il faut enfin une machinerie institutionnelle plus ou moins sophistiquée, de nature à assurer que les décisions sont prises et mises en oeuvre, et que leur non-mise en oeuvre fait éventuellement l'objet de sanctions.
En d'autres termes, il faut passer par une étape « pompier », qui est l'étape d'aujourd'hui, puis par une étape « architecte », qui nécessite une négociation entre architectes – il n'y a pas un grand architecte qui décide pour les autres –, et enfin par une étape « corps de métier » – l'étape à laquelle se trouve l'OMC – qui consiste à réviser régulièrement le bâtiment, ses fonctionnalités, ses tuyauteries, etc. En matière financière, nous n'en sommes pour l'instant qu'au stade du pompier.

Certains responsables politiques, que ce soit en France ou au niveau européen, évoquent la mise en place d'une taxe extérieure « carbone ». Deux voies sont avancées : la première s'appuie sur le régime des ajustements de taxe aux frontières ; la seconde sur l'article XX du GATT, qui constitue le régime d'exception de l'OMC. Sur quelle base mettre en place une taxe extérieure qui serait acceptée par les États membres, sans remettre en cause les principes fondateurs de l'OMC, tout en prenant davantage en compte la dimension environnementale ? Est-ce possible ?

Je crois que cela serait possible. Pour autant, je ne peux pas me prononcer dans l'absolu ; ce sont aux membres de l'OMC de se prononcer sur les décisions à prendre. Par ailleurs, il est très difficile de se déterminer en la matière tant qu'il n'y a pas de système précis sur la table.
La « Constitution » de l'OMC met le développement de l'échange international au service du développement durable. De nombreuses dispositions, dans le « code » de l'OMC, prennent en compte la nécessité de préserver l'environnement. La « jurisprudence » de l'organe d'appel de l'OMC a déterminé peu à peu les conditions dans lesquelles on pouvait mettre des obstacles au commerce, au nom de la protection de l'environnement. Une « doctrine » se met donc en place, en partie sur la base de la législation et en partie sur la base de l'interprétation des mécanismes de règlement des différends. Des connexions existent donc. Ce qui est valable en matière environnementale l'est aussi en matière de santé ou en matière sanitaire et phytosanitaire – mais pas, par exemple, en matière sociale.
Depuis Kyoto, la question n'est pas de savoir s'il est bon ou non d'instituer une taxe carbone à la frontière : d'abord, une telle taxe n'est pas le seul instrument disponible ; ensuite, la vraie question est de savoir comment répartir entre les différents États de la planète les efforts à faire en matière de réduction d'émission de CO2. Cela passe par une négociation politique, qui est menée sous l'égide du Panel des Nations unies sur le changement climatique. Elle est difficile, notamment parce que les pays en voie de développement vont devoir accepter des contraintes que les pays développés n'avaient pas acceptées auparavant.
Si l'on y arrive, le problème des instruments de politique environnementale à utiliser, et celui de leur compatibilité avec les principes fondateurs de l'OMC, se poseront. Mais il est encore trop tôt pour dire que tel instrument serait compatible et pas tel autre. L'essentiel est de faire l'effort en amont pour mener à bien cette répartition.

L'organisme que vous dirigez est l'un des seuls à tenter de mettre en place une régulation que la communauté internationale pourrait accepter. Mais jusqu'à présent, certains États ne l'ont acceptée qu'avec réticence. La période est-elle propice à pousser l'avantage de ceux, dont vous faites partie, qui estiment cette régulation nécessaire ? Les événements que nous sommes en train de vivre sont-ils susceptibles de vous aider à achever le cycle de Doha ?
Dans le secteur agro-alimentaire, il semble que des blocages soient apparus, notamment du fait de l'Europe et, en particulier, du fait de la France qui souhaite préserver les intérêts de ses producteurs. Mais il convient de préserver aussi les intérêts des producteurs des pays émergents, lesquels ont besoin d'une agriculture performante. Pensez-vous qu'il soit possible de parvenir à un accord qui, grâce à la régulation, permettrait à l'Europe et à la France de préserver leur puissance agro-alimentaire, tout en garantissant aux pays émergents l'avenir de leur agriculture ?

J'ai assisté récemment à un colloque sur le thème de l'Euro Méditerranée. Plusieurs personnes sont intervenues très violemment contre la décision qui avait été prise il y a trois ou quatre ans de lever des quotas sur les textiles et qui avait affecté, notamment, les économies du Maroc, de la Tunisie ou du Bangladesh. Peut-on, avec le recul, juger des dégâts entraînés par cette modification des règles commerciales avec la Chine ?

Quel est votre pronostic, en tant que directeur général de l'OMC, sur le danger potentiel que représentent les 62 000 milliards de CDS – Credit default swaps – en circulation ?

Comment faire appliquer et respecter par les États les sanctions de l'OMC ? Comment ces sanctions sont-elles vécues par le directeur général et le pays considéré, notamment lorsque s'engage, ensuite, un nouveau round de négociations ?

La corruption est l'une des formes majeures de distorsion de concurrence. L'OMC et l'OCDE articulent-elles leur action, dans le cadre de l'application de la convention de l'ONU contre la corruption ?

Je commencerai par répondre à la question de M. Cousin sur l'agriculture. Il y a eu longtemps au GATT puis à l'OMC, et il y aura encore longtemps, des débats sur le point de savoir si l'agriculture est une marchandise comme les autres.
Certains pensent qu'il n'y a pas de raison de distinguer les produits agricoles des pneus, des chaussettes et des voitures, la meilleure division internationale du travail étant celle qui permet de produire au moindre coût et pour le plus grand bénéfice des consommateurs dès lors qu'ils ont accès aux marchés ; il faut ouvrir ceux-ci et soumettre l'agriculture aux lois normales de la libéralisation des échanges. D'autres pensent que l'agriculture n'est pas un secteur comme les autres, pour des raisons de multifonctionnalité : les paysages, l'environnement, le rapport à l'alimentation, la culture ; et parce qu'une grande partie de l'agriculture de la planète n'est pas commercialisée, mais produite et consommée par certaines populations, uniquement pour survivre.
Les tenants de la première thèse sont plutôt parmi ceux qui ont des « avantages comparatifs » à la Ricardo : ceux qui produisent le mieux dans les meilleures conditions. Et ceux qui n'en ont pas sont plutôt favorables à la deuxième thèse.
Le compromis, tel qu'il s'esquisse à l'OMC, revient à éliminer des règles du commerce agricole ce qu'il y a de plus distorsif pour les échanges, à savoir : les pics tarifaires les plus élevés, les subventions les plus perturbatrices au profit de ceux qui ont des avantages comparatifs, de telle sorte que les uns et les autres y trouvent leur avantage ; à donner davantage d'accès aux marchés. Mais on le fait en tenant compte des sensibilités particulières de ceux qui, pour des raisons diverses, sont dans l'autre camp.
Si ce qui s'esquisse sur la table vient à aboutir, il restera, en matière agricole, des niveaux de protection douanière trois à quatre fois plus importants que ce qu'ils sont en matière industrielle, et des subventions d'un montant considérable qui n'ont pas leur équivalent en matière industrielle.
En matière de soutiens publics, les Américains et les Européens dépensent environ 80 milliards de dollars par an. Même si ces soutiens ne sont pas constitués uniquement de cash, ce montant ne va pas beaucoup diminuer. Ne diminuera que la partie des soutiens qui est perturbatrice des échanges – celle qui est liée au volume de la production, outre les subventions à l'exportation.
Ce n'est pas à moi de juger le cas français. Ce que nous pouvons tous constater, c'est que la France est un agro-exportateur puissant, dont le surplus est considérable : sur les États-Unis, ce surplus est de l'ordre de 2 milliards de dollars par an ; sur le Japon, il est de l'ordre de 1,5 milliard de dollars ; et sur la Chine, considérée comme une grande menace, il est de l'ordre de 400 millions de dollars. C'est notamment le cas pour tout ce qui ajoute de la valeur, c'est-à-dire pour tout ce qui coûte cher, indépendamment du fait que les matières premières de base sont ou non taxées. L'intérêt objectif français est que, sur tous ces produits-là, les droits de douane baissent ailleurs.
Il faut préciser que les deux tiers des exportations de l'économie française vont sur l'Europe, mais qu'en matière agricole, ce sont presque trois quarts qui y vont. Le premier enjeu de l'agriculture française est donc le marché européen. Et le producteur le plus efficace sur un marché n'a pas tellement intérêt à ce que les autres reçoivent trop de subventions.
Que la France exprime une position défensive en matière agricole s'explique par sa carte politique. Si c'est une position tactique pour obtenir davantage en disant que l'on a beaucoup à payer, je la comprends – de la même façon que je comprends la position de la négociatrice américaine ou du négociateur japonais.
Les quotas textiles ont constitué l'essentiel de la négociation du round précédent, de 1986 à 1994. Les pays en développement de l'après-guerre voulaient « avoir la peau » du système de protection spécifique en matière de textile–habillement, que les pays développés leur avaient imposé – notamment dans une perspective post-coloniale. Les pays en développement déclarèrent dans les années 80 que le textile et l'habillement seraient traités comme les voitures ou les puces électroniques des pays développés et qu'il fallait mettre fin à ce système de quotas, ce qui fut décidé en 1994. On décida également, pour les pays développés, d'une période de transition de dix ans – le double de ce qui se pratique habituellement.
Le fait est qu'un certain nombre de producteurs subirent l'impact de cette décision, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Mais certains pays surent s'adapter. La Suède s'adapta formidablement bien, sans doute de par l' « effet canoë » – la solidarité étant plus grande sur les petits esquifs que sur les grands ! La Chine profita beaucoup de cette ouverture. Mais aujourd'hui, elle est attaquée par des pays comme le Cambodge, le Vietnam, le Bangladesh, le Pakistan, voire par l'Inde ou le Sri-Lanka.
Le système a abouti à une division internationale du travail différente. Le consommateur en a retiré des bénéfices et la production globale en textile–habillement a énormément augmenté. La consommation est incomparablement plus forte dans le monde qu'il y a dix ou vingt ans.
M. Emmanuelli a évoqué les 62 000 milliards de CDS. Mais on n'est pas là dans le périmètre économique de l'OMC. Pour ma part, je suis dans l'économie réelle, que j'ai qualifiée d' « économie de la fin de mois ». Qu'il faille des marchés financiers qui fonctionnent pour accompagner le développement de ce système de transactions réelles, sans doute. Qu'il faille réguler ces marchés financiers, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Néanmoins, dès lors que l'absence ou l'insuffisance de régulation de l'économie financière impacte négativement l'économie réelle, l'idée de promouvoir un certain nombre de sécurités paraît assez logique. Après, il faut se mettre d'accord sur ce que l'on veut, ce qui n'est pas simple dans la mesure où cela suppose des abandons de souveraineté dans les espaces où l'on entend instituer cette régulation.
Prenez l'exemple du Cycle de Doha : ce n'est pas sur une question d'architecture ou de corps de métier, mais sur une question d'ajustement final que l'on bute. Pourtant, ce n'est pas très compliqué, comparé aux problèmes liés au changement climatique. Jean Pisani-Ferry écrivait l'autre jour dans la presse française que la négociation de l'OMC était à la négociation sur le changement climatique ce que le certificat d'études est au concours d'entrée à Polytechnique ! Il a raison. L'OMC intervient dans une zone relativement éprouvée, explorée et repérée.
Venons-en au rôle du directeur général. À l'OMC, il y a un gros législatif, un gros judiciaire et un tout petit exécutif.

Je comprends que des élus français, habitués à un système institutionnel spécifique, aient du mal à croire qu'il existe des exécutifs dont les marges de manoeuvre sont étroites.

Il y a donc un gros législatif, un Parlement qui siège en permanence. Simplement, au lieu de faire les lois une par une, comme vous, nous les faisons par « paquets ». Nous prenons le code et nous disons, par exemple, que c'est la neuvième fois que nous allons mettre à jour ou modifier les règles qu'il contient. Un peu comme si vous faisiez à la fois une législation sur l'énergie, sur les impôts, sur le sport, sur l'éducation, etc.
Il y a un gros judiciaire, qui a été créé en 1994, et qui constitue une exception du point de vue du droit international, dans la mesure où les décisions y sont contraignantes. Dans ce système, ce sont les membres qui prennent les décisions judiciaires et qui se mettent d'accord pour qu'il y ait des sanctions ; mais le membre qui perd ne peut pas s'opposer à la décision prise. Nous avons conservé les formes du consensus diplomatique : ce ne sont pas les juges qui décident. Ils font un rapport, que les membres adoptent.

Oui, il y a un système d'appel interne à l'OMC.
Les procès se font de membre à membre. Si un membre considère qu'un autre n'accepte pas telle ou telle règle, il entame les consultations. Un panel est désigné et se prononce. Cette décision de première instance peut être portée devant l'organe d'appel.
On ne peut pas dire que la notion de sanction ait été inventée en 1994. Mais il se trouve que, dans la philosophie générale du GATT et de l'OMC, le principe est celui de l'équilibre des concessions : j'ai fait des concessions ; vous avez fait des concessions ; nous nous sommes mis d'accord parce que nous avons jugé que ces concessions étaient équilibrées ; si vous n'appliquez pas les règles du système, vous rompez l'équilibre des concessions ; j'ai alors le droit de reprendre une concession que j'avais faite, c'est-à-dire d'exercer des sanctions contre vous, notamment en matière tarifaire. Voilà pourquoi le système de sanctions fonctionne.
De mon côté, je n'ai qu'un rôle de procédure. Ce n'est pas moi qui décide.

Une fois sur six ou sept.
Enfin, on peut concevoir qu'il y ait un lien conceptuel entre le commerce international et la corruption. Mais aujourd'hui, aucune discussion n'a été mandatée à l'OMC, par les membres de l'OMC, sur ce sujet. Il existe en effet une convention de l'ONU contre la corruption, ainsi que des travaux de l'OCDE. Mais pour l'instant, aucune règle « en dur » n'a été instituée, notamment pas à l'OMC.
Ce n'est pas forcément une mauvaise idée, dès lors que l'initiative en serait prise plutôt par les pays en développement que par les pays développés.

Si les pays développés prenaient une telle initiative, ils le feraient dans le cadre d'une vision politique que les pays en développement auraient beaucoup de mal à accepter. Voilà pourquoi je conseillerais, si l'on devait aller dans cette direction, que les pays en développement prennent l'initiative.