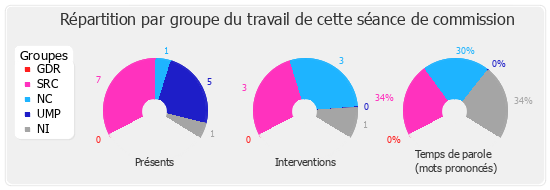Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
Séance du 3 septembre 2008 à 18h00
La séance
La commission des Finances, de l'économie générale et du Plan a procédé à l'audition de M. Jean-Pierre Aubert, ancien président du Consortium de réalisation – CDR –, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation – CDR – et le groupe Bernard Tapie.
Le Président Didier Migaud : Je remercie M. Jean-Pierre Aubert, ancien président du Consortium de réalisation – CDR –, d'avoir répondu à notre invitation. Je suppose, monsieur le président, que vous avez suivi en partie nos travaux.
Non. C'est contraire à mes principes.
Le Président Didier Migaud : Vous êtes donc vierge par rapport aux propos que l'on a pu tenir auparavant.
Je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet : où le dossier en était-il au moment où vous avez quitté la présidence du CDR ? Quelles observations avez-vous à formuler devant la représentation nationale sur les développements qui ont eu lieu depuis que vous avez quitté cette présidence ?
Le dossier Tapie, sur lequel vous avez souhaité m'entendre, est l'un des principaux contentieux dont le CDR a hérité lorsque le Crédit lyonnais lui a transféré, fin 1995, les actions de deux de ses filiales, la Société de banque occidentale – SBDO – et sa banque d'affaires Clinvest.
Peu de temps après la création du CDR à la fin de 1995, plusieurs procédures ont été engagées contre lui par les liquidateurs judiciaires du groupe Bernard Tapie : les sociétés du groupe Bernard Tapie et M. et Mme Tapie avaient en effet été déclarés en redressement judiciaire, puis, à l'exception de la société Bernard Tapie Finance, en liquidation judiciaire sous patrimoine commun, entre novembre 1994 et mars 1995.
La plus importante de ces procédures concernait le dossier Adidas. Les liquidateurs judiciaires du groupe Tapie reprochaient essentiellement au Crédit lyonnais :
– de s'être fait donner mandat par la société Bernard Tapie Finance, en décembre 1992, de vendre sa participation de 78 % dans Adidas au prix de 2,085 milliards de francs, sans lui révéler qu'il avait déjà trouvé un acheteur en la personne de Robert Louis-Dreyfus, à qui il a ensuite consenti une promesse de vente au prix de 4,4 milliards de francs ;
– d'avoir organisé le portage d'Adidas pour son compte par des structures qu'il contrôlait, de février 1993 date de sa vente par la société Bernard Tapie Finance, jusqu'à fin 1994, date de l'acquisition d'Adidas par Robert Louis-Dreyfus ;
– d'avoir été ainsi, à l'insu du groupe Bernard Tapie, la contrepartie de son mandant lorsqu'il a vendu Adidas en février 1993, et d'avoir capté à son seul profit, au détriment de son mandant, une plus-value de 2,3 milliards de francs.
Par ailleurs, les mêmes liquidateurs ont assigné le CDR, d'abord pour soutien abusif du groupe Bernard Tapie par le Crédit lyonnais et ses filiales, puis pour rupture abusive des concours bancaires consentis au groupe Bernard Tapie.
Voici, en quelques mots, le dossier que j'ai trouvé en arrivant à la présidence du CDR à la fin de 2001. Et je m'en suis saisi très vite en raison de son enjeu financier et de sa forte visibilité.
Dès le milieu de l'année 2002, je suis arrivé à la conclusion que, dans cette affaire d'une grande complexité, le CDR, comme successeur du Crédit lyonnais et de ses filiales concernées – SDBO, Clinvest –, n'était pas à l'abri d'une condamnation à payer des dommages et intérêts, d'un montant cependant très inférieur à la plus-value dont le groupe Bernard Tapie prétendait avoir été privé.
C'est en partant de cette analyse que j'ai proposé le 5 novembre 2002 au ministre de l'économie et des finances de rechercher, dans le cadre d'une médiation, une solution négociée sur la base d'une clôture pour extinction de passif de la liquidation judiciaire du groupe Bernard Tapie grâce à des abandons de créances du CDR. Cette solution avait l'avantage, pour M. et Mme Tapie, d'éviter la condamnation pour banqueroute dont ils étaient menacés devant le tribunal correctionnel et, pour le CDR, de clôturer rapidement de multiples procédures engagées six ans plus tôt et dont tout laissait à penser qu'elles se prolongeraient encore pendant plusieurs années.
M. Francis Mer m'a fait savoir fin 2002 qu'il préférait que la justice suive son cours.
En septembre 2004, le nouveau ministre de l'économie et des finances m'a demandé de mettre en oeuvre une médiation. À l'époque, le conseil d'administration du CDR et moi-même étions réservés sur ce processus qui avait pour inconvénient de dessaisir la cour d'appel quelques jours avant la date fixée pour les plaidoiries : je craignais que ce retrait de dernière minute ne soit perçu par la cour et par les adversaires du CDR comme un formidable aveu de faiblesse. En dépit de cette forte réticence, dont j'ai informé le ministre, le CDR s'est totalement impliqué dans la médiation conduite par M. Burgelin, ancien procureur général à la Cour de cassation, et il a accepté la proposition du médiateur, qui ne lui demandait que l'abandon de ses créances, tandis que les liquidateurs et M. Tapie l'ont rejetée.
Après l'échec de cette médiation, les parties se sont retrouvées devant la cour d'appel de Paris qui, par un arrêt du 30 septembre 2005, a condamné le CDR à verser 135 millions d'euros de dommages et intérêts aux liquidateurs judiciaires du groupe Bernard Tapie.
Après ce rappel, je voudrais indiquer pourquoi le CDR a tenu à se pourvoir en cassation et dans quelle situation il se trouvait après la cassation de la décision par un arrêt du 9 octobre 2006 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
La défense des finances publiques exigeait le pourvoi en cassation. En effet, il est très vite apparu aux avocats, au président et au conseil d'administration du CDR qu'une cassation totale de l'arrêt était très probable, notamment pour les raisons suivantes :
– la cour d'appel ne pouvait pas légalement retenir à la charge du Crédit lyonnais une obligation de financement du groupe Tapie pour lui permettre d'attendre une éventuelle levée de l'option accordée à Robert Louis-Dreyfus, alors que le banquier n'est jamais tenu de consentir un nouveau concours à l'un de ses clients ; au reste, un tel financement n'a jamais été demandé par la société Groupe Bernard Tapie Finance : au contraire, les liquidateurs du groupe Tapie reprochent au CDR un soutien abusif du groupe par le Crédit lyonnais ;
– selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait pas non plus indemniser la perte d'une chance de plus-value par des dommages et intérêts égaux à 100 % de cette plus-value.
La seule objection de la tutelle du CDR à sa décision de se pourvoir en cassation reposait sur la crainte qu'après cassation, la cour de renvoi ne condamne le CDR aussi lourdement, voire plus lourdement, que la cour d'appel de Paris ne l'avait fait par son arrêt du 30 septembre 2005.
Pour les raisons que je vais indiquer, cette objection ne me paraissait pas pertinente, et je l'ai expliqué au comité des sages que M. Thierry Breton avait réuni pour le conseiller sur un éventuel pourvoi.
Finalement, par un communiqué du 13 janvier 2006, le ministre de l'économie et des finances a fait savoir que les deux représentants de l'État au sein du conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration – EPFR –, actionnaire unique du CDR, ne formuleraient pas d'objection à la décision du CDR de se pourvoir en cassation.
L'arrêt de cassation du 9 octobre 2006 conférait au CDR une position solide. L'appréciation du CDR, après consultation de ses avocats, était que l'assemblée plénière de la Cour de cassation avait jugé définitivement que les liquidateurs du groupe Tapie n'étaient pas recevables à demander la remontée de la plus-value éventuellement perdue et qu'il ne leur était pas possible de demander plus que la réparation du préjudice personnel de la société Groupe Bernard Tapie du fait de l'éventuelle inexécution à son détriment, par la SBDO, du mémorandum du 10 décembre 1992.
Les juristes étaient unanimes à dire que, la Cour de cassation ayant statué en assemblée plénière, ce qu'elle avait jugé était définitif et s'imposait à la cour de renvoi. L'unique obligation de la SBDO, seule signataire du mémorandum de 1992 avec les sociétés du groupe Bernard Tapie, était la remontée vers le groupe d'une fraction du prix de vente d'Adidas, fixée à 185 millions de francs. Cette somme ayant été effectivement versée par la SBDO à la société Groupe Bernard Tapie, la SDBO s'était entièrement acquittée de son obligation contractuelle.
Indépendamment de cet aspect juridique, plusieurs considérations laissaient à penser que, quoi que décidât la cour de renvoi sur l'existence d'une faute de la SDBO, les préjudices personnels dont la société Groupe Bernard Tapie et M. et Mme. Tapie pouvaient éventuellement obtenir réparation seraient très inférieurs à la condamnation prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005.
Selon le CDR et ses conseils, la cour de renvoi devait tenir compte de trois facteurs essentiels.
Premièrement, le prix de 2,085 milliards de francs était le bon prix parce que :
– il correspondait au prix auquel le groupe Tapie avait conclu la vente d'Adidas à Pentland – c'est-à-dire Reebok – en juillet 1992 et il était validé par les différentes expertises et les autorités de marché ;
– il était le meilleur prix possible en raison de la perte de plus de 500 millions de francs réalisée par Adidas en 1992 et de la nécessité de recapitaliser la société pour un montant équivalent, conformément aux exigences des banquiers allemands ;
– il permettait au groupe Bernard Tapie, sans avoir mis un franc de fonds propres et sans prendre de risques, de gagner 230,8 millions de francs dans l'opération Adidas.
Deuxièmement, le redressement d'Adidas et la levée par Robert Louis-Dreyfus, fin 1994, de son option d'achat étaient aléatoires.
Troisièmement, la survie du groupe Tapie durant les années 1993 et 1994 était impossible sans l'encaissement du prix de vente de sa participation dans Adidas en février 1993.
Autant dire que la chance perdue d'obtenir un meilleur prix que celui obtenu lors de la vente de février 1993 était proche de zéro et que la société Groupe Bernard Tapie n'avait subi aucun préjudice. Voilà pourquoi j'avais indiqué au conseil d'administration du CDR le 13 décembre 2006, au cours de la dernière séance que j'ai présidée, que le CDR pouvait attendre avec confiance la décision de la cour de renvoi et n'avait rien à demander ou à obtenir de quiconque jusqu'à ce prochain rendez-vous.
Le Président Didier Migaud : Je vous remercie pour ce propos très clair.
L'arrêt de la Cour de cassation n'est pas, comme l'aurait souhaité le CDR, une cassation totale. Le consortium encourait-il un risque en laissant la justice suivre son cours, compte tenu de cet élément ? Ce risque est un des arguments que l'on avance aujourd'hui pour justifier le recours à l'arbitrage.
En novembre 2002, vous avez proposé d'engager une procédure de médiation. Le ministre de l'économie et des finances de l'époque ne l'a pas acceptée. En septembre 2004, le ministre en poste propose une nouvelle médiation que, pour votre part, vous ne souhaitez pas. Pourriez-vous préciser pourquoi ce que vous proposiez en 2002 ne vous paraissait plus souhaitable en 2004 ?
Qu'est-ce que l'annulation, par la Cour de cassation en assemblée plénière, de l'arrêt de la cour d'appel du 30 septembre 2005 sinon une cassation totale ? Après cette décision, le CDR ne doit pas un euro au liquidateur du groupe Bernard Tapie. J'ignore pourquoi l'on parle de cassation partielle alors qu'il y a eu annulation.
Sur le moyen que la cour d'appel a commis dans son arrêt un véritable vice de raisonnement – c'est du moins mon interprétation. Pour tenter de restituer au groupe Bernard Tapie une plus-value perdue, elle est passée par un détour en affirmant que le groupe aurait pu encaisser le prix d'achat payé par Robert Louis-Dreyfus s'il avait obtenu un financement lui permettant d'attendre ces deux ans. Elle a donc condamné le CDR – le Crédit lyonnais de l'époque – sur le fait que le Crédit lyonnais n'a pas consenti le concours de 2 milliards de francs qui aurait permis au groupe d'attendre le temps nécessaire.
Or il faut savoir qu'un actionnaire n'est pas recevable à demander réparation du préjudice de la société dont il détient des actions. En l'occurrence, le vendeur n'est pas le groupe Bernard Tapie mais Bernard Tapie Finance, dont le mandataire ad hoc a été déclaré irrecevable par la cour d'appel. Celle-ci a en revanche estimé recevable la plainte de la société Groupe Bernard Tapie au sujet d'une éventuelle inexécution du contrat passé au moment de la vente, c'est-à-dire du mémorandum.
Cela étant, l'inexécution du mémorandum représente au maximum 185 millions de francs, lesquels ont été versés. Pour pouvoir verser tout de même quelque chose au liquidateur, la cour d'appel invoque le défaut de financement ou le non-respect d'une obligation de financement. Ayant été président de banque pendant trente ans, je me souviens de l'émotion que ce sujet a soulevée dans le milieu bancaire : pour la première fois, une cour d'appel affirmait qu'il y avait un droit au crédit. Or, dans le même temps, le Crédit lyonnais était poursuivi pour soutien abusif. La cour d'appel aurait voulu qu'il consentît un financement supplémentaire d'environ 2 milliards de francs pendant deux ans, en attendant la levée, tout hypothétique, de l'option. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Robert Louis-Dreyfus n'était pas tenu d'acheter. Il détenait une simple option qu'il lui était loisible de lever ou non à la fin du mois de décembre 1994. Financer pendant deux ans le groupe Tapie – qui ne le demandait même pas – en attendant cette éventualité n'était à l'évidence pas raisonnable.
Voilà pourquoi je ne crois pas que l'on puisse parler de cassation partielle. Le vrai sujet, c'était le risque que présentait la cour de renvoi. C'est ce qui a fait beaucoup hésiter au moins trois ministres de l'économie et des finances, dont Thierry Breton qui, avant de donner son feu vert au recours en cassation, se demandait si la cour de renvoi n'allait pas sanctionner le CDR encore plus durement que la cour d'appel. C'était une vraie question. Après y avoir beaucoup travaillé, nous sommes arrivés à la conviction qu'il n'y avait pas de risque : comme l'indique clairement la Cour de cassation, on ne peut indemniser à 100 % un préjudice résultant d'une perte de plus-value.
On a avancé beaucoup de chiffres au sujet de cette perte. La part de Bernard Tapie Finance dans Adidas était de 78 %, de 95 % du capital, soit 2,085 milliards de francs, ce qui correspond à une valorisation de 100 % d'Adidas, en février 1993, de 2,9 milliards de francs. Par ailleurs, les investisseurs dans Adidas ont dû procéder à une augmentation de capital de 517 millions de francs pour compenser les pertes de 1992 – les banques allemandes avaient en effet menacé de suspendre leur concours si l'on ne procédait pas à cette recapitalisation. En conséquence, le prix payé par les investisseurs, incluant le montant de la recapitalisation est de 3,4 milliards de francs. C'est ce montant qu'il convient de comparer au prix d'achat en décembre 1994, soit 4,4 milliards qu'a payé Robert Louis-Dreyfus. La vraie différence ne s'élève donc pas à 2,3 milliards, comme on l'a soutenu, mais à un peu plus d'un milliard de francs. C'était là le préjudice maximum. De plus, tant la cour d'appel que la Cour de cassation affirmaient que la demande du groupe Bernard Tapie relative à la perte de plus-value de sa propre filiale n'était pas recevable. Vraiment, je ne vois pas à quel montant la cour de renvoi aurait pu condamner le CDR : à notre avis, pas grand-chose ! Au demeurant, ce sont les liquidateurs qui ont demandé l'arbitrage.
J'en viens à votre seconde question, monsieur le président. En 2002, peu de dossiers de l'ancien Crédit lyonnais étaient vraiment « blanc-bleu ». On ne pouvait estimer que le dossier Adidas ne présentait pas de risques : la preuve en est que la cour d'appel a condamné le CDR à 135 millions d'euros – on me l'avait reproché à l'époque –. Mon idée était que l'on pouvait s'épargner plusieurs années de procédure sur la base d'un principe que j'avais appelé « ni riche ni failli ». En d'autres termes, le CDR était prêt à abandonner les créances qu'il savait ne devoir jamais recouvrer et qui étaient provisionnées à 100 %, tandis que M. et Mme Tapie évitaient une comparution devant le tribunal correctionnel pour banqueroute.
C'était un compromis équilibré, celui-là même que l'avocat de M. et Mme Tapie avait demandé, autant qu'il m'en souvienne, quelques années auparavant et que le CDR avait alors refusé. Mais M. Francis Mer a souhaité que la justice suive son cours.
Si, en 2004, j'ai marqué beaucoup de réticence à l'idée d'une médiation, c'est que, comme je l'ai dit au ministre, dessaisir la cour d'appel de Paris à huit jours des plaidoiries constituait un très mauvais signal sur la solidité du dossier. Ce qui était possible à froid me paraissait dangereux à chaud.

Le président Aubert peut en témoigner, nous avons pratiquement toujours été d'accord pour soutenir une position dure dans cette affaire : la justice jusqu'au bout ! Je ne partage cependant pas tout à fait sa lecture de l'arrêt de la Cour de cassation. Certes, l'arrêt de la cour d'appel est cassé dans son élément essentiel, à savoir la condamnation à 135 millions d'euros portés à 145 millions à la suite d'une erreur – et il est vrai que cet arrêt était, en droit, un scandale : tous les articles de doctrine le disent et soulignent cette création d'un droit au crédit qui consacrait, à moins que l'on n'établisse un régime communiste, la disparition des banques en France ! Hélas, la Cour de cassation a maintenu ouvertes certaines portes, notamment en matière de responsabilité délictuelle.
Quoi qu'il en soit, je partage le sentiment du président Aubert : il n'existait aucun risque d'être condamné à un montant supérieur à 135 millions d'euros.
Le ministre Francis Mer a soutenu lui aussi une position dure. M. Sarkozy, qui lui a succédé, a d'abord hésité mais a autorisé la médiation puisque la possibilité restait ouverte de s'opposer aux conclusions qui en résulteraient. C'est finalement la partie adverse qui les a refusées. Elles étaient, si je puis dire, dans la « ligne Aubert » puisque M. Burgelin proposait 140 millions d'euros, soit aucun bonus pour les époux Tapie. Pour ma part, j'étais contre un tel versement, estimant que M. Tapie voulait un boni de liquidation pour se refaire et que ce n'est pas à cela qu'il fallait employer l'argent du contribuable.
Quant au ministre Thierry Breton, il m'avait indiqué, en réponse à une question orale à l'Assemblée, qu'il était ouvert à un accord. Cependant, après discussion et arbitrage, on a décidé d'aller en cassation. Je ne nie pas avoir eu quelque rôle dans cette affaire, ayant averti le Premier ministre et son entourage qu'il ne fallait surtout pas suivre la position initiale de M. Breton.

L'arrêt de la Cour de cassation nous a donné raison et nous a mis dans une situation juridique beaucoup plus forte que si l'on s'en était tenu à l'arrêt de la cour d'appel.

Votre exposé, monsieur le président Aubert, était plus concis mais aussi beaucoup plus synthétique et éclairant que ceux que nous avons entendus jusqu'à présent. De façon documentée et clinique, vous faites un sort à la théorie selon laquelle les opérations menées entre 1992 et 1994 auraient spolié Bernard Tapie. Je regrette que mes collègues Gilles Carrez et Jérôme Chartier, qui semblaient vouloir insister sur ce point, n'aient pas été là pour vous entendre car ils auraient bénéficié de toutes les réponses aux questions qu'ils se posaient.
Permettez-moi de revenir sur le rôle des ministres successifs. M. Mer refuse votre proposition de médiation ; M. Sarkozy accepte la médiation que mènera M. Burgelin ; M. Breton n'a pas à se prononcer sur les résultats de cette médiation puisque le refus vient des liquidateurs ; il décide en revanche d'aller en cassation après l'arrêt de la cour d'appel.
Sur ces sujets, et dès lors que de l'argent public est engagé, le président du CDR, société privée, ne prend pas de décision majeure sans l'accord du ministre de l'économie et des finances. Selon vous, le président actuel du CDR a-t-il pu recourir à la procédure arbitrale et renoncer à tout appel une fois la sentence du tribunal arbitral rendue sans l'accord clair et explicite de la ministre de l'économie et des finances ?
Je ne saurais répondre pour mon successeur et ne voudrais surtout pas compliquer les choses. Le CDR, je le répète, est une société de droit privé ayant pour actionnaire unique un établissement public administratif, l'EPFR. Certains dossiers clairement identifiés sont à la charge financière directe de l'EPFR, et non du CDR en première ligne. Le dossier Adidas, tout comme le dossier Executive Life, est de ceux-là. Il était donc normal que le président du CDR, avant de prendre une décision importante sur ces sujets, demandât au président de l'EPFR s'il avait une objection. En 2002, une objection à la médiation a été formulée. En 2004, lorsque l'on a évoqué une nouvelle médiation, les choses ont été un peu plus directes : le CDR pouvait difficilement s'y opposer, mais il a été capable d'imposer ses conditions, dont deux étaient essentielles :
– que la médiation soit conduite par une personnalité incontestable, ce qu'était à l'évidence Jean-François Burgelin, homme d'une formidable trempe et d'une intégrité absolue ;
– que la médiation ne puisse aboutir au versement d'une somme dont une partie aurait pu s'ajouter au patrimoine de M. ou Mme Tapie – c'était une exigence du conseil d'administration du CDR et j'avais dit moi-même au ministre que je ne ferais jamais un chèque, ne serait-ce que d'un euro, si elle n'était pas remplie : il m'avait répondu que personne ne me le demandait.
Certes, la médiation ne me paraissait pas une bonne solution dans la mesure où l'on était à quelques jours des plaidoiries en appel. Je pense que cela a eu un rôle dans la décision ultérieure, mais on peut soutenir le contraire.
Permettez-moi de citer le relevé de décisions du conseil d'administration du 23 septembre 2004 : « Enfin, le conseil demande au président de veiller à ce qu'aucun accord transactionnel ne puisse entraîner, pour le CDR, un paiement en numéraire au bénéfice direct ou indirect des époux Tapie, c'est-à-dire allant au-delà de ce qui pourrait être nécessaire pour solder la liquidation judiciaire compte tenu des actifs dont elle dispose. »

Quand cette affaire est remontée à l'EPFR – qui a accepté ces conditions –, j'ai voté contre le principe de la médiation de M. Burgelin, étant certain que celle-ci échouerait : dès lors qu'il était certain qu'ils n'auraient pas un sou, les époux Tapie refuseraient. C'est bien ce qui s'est passé. Les plus pervers nous ont même accusés de n'avoir engagé la médiation que pour la faire échouer.

Vous ne sauriez, bien entendu, vous exprimer à la place de votre successeur, monsieur le président Aubert. Vous confirmez toutefois que, dans votre pratique, rien d'important ne s'est fait sans l'accord ou le refus explicite du ministre et vous imaginez difficilement qu'il ait pu en être autrement par la suite…
Le Président Didier Migaud : M. Rocchi l'a affirmé lui aussi clairement, mon cher collègue. L'EPFR dispose d'une faculté d'empêcher. Le ministre donne des instructions aux représentants de l'État et le président de l'établissement, pour en revenir au débat sémantique que nous avons eu ce matin avec M. Schneiter, « peut » en tenir compte. Tout le monde reconnaît que cela fonctionne ainsi.

Je veux souligner à mon tour combien concise, claire, explicite et démonstrative a été l'introduction de M. le président Aubert et combien elle nous sera utile pour la suite du débat.
Parmi les nombreuses incohérences de cette affaire, il en est une qui est particulièrement frappante et qui aurait dû inciter le Gouvernement à changer sa position au sujet du recours : la thèse centrale, défendue par les liquidateurs du groupe Bernard Tapie devant la cour d'appel, est que l'on a causé du tort au groupe en ne lui offrant pas la chance de réaliser un profit par le biais d'un prêt qui aurait été consenti aux mêmes conditions que ceux accordés aux autres repreneurs.
Il se trouve que Le Point avait consacré un dossier à Bernard Tapie et m'avait interviewé à ce sujet. Il suffisait de lire, dans le numéro suivant, la réponse de M. Lantourne, avocat de Bernard Tapie, à cette interview. Il y exposait sa ligne juridique : on prétend que c'est en raison de difficultés financières que le groupe a choisi de vendre Adidas mais il n'en est rien ; en réalité, c'est une décision personnelle de Bernard Tapie qui, considérant que la gestion d'une affaire industrielle était incompatible avec l'exercice d'une fonction ministérielle – apparemment, c'était pressé –, a choisi de vendre et a été trahi par son mandataire.
Telle est la version alléguée. Je pense pour ma part que le choix n'existait pas car mon analyse du mandat passé en 1992 avec la SDBO est très différente de ce que l'on peut lire ici ou là : il ne s'agit pas d'un mandat de vente mais de la signature d'une obligation de vendre à tout acheteur désigné par la SDBO et au premier appel, sans que Bernard Tapie et son groupe puissent émettre la moindre réserve. En effet, il existait sur les actions Adidas détenues par Bernard Tapie un nantissement. M. Tapie étant incapable de faire face à son échéance à deux ans, la banque aurait pu, sans dépenser un euro, exercer son gage et se retrouver à la tête d'Adidas. Selon moi, c'est pour permettre à Bernard Tapie, qui allait entrer au Gouvernement, de sauver la face que l'on a organisé une vente au lieu d'exercer le nantissement. Bernard Tapie a lui-même affirmé que cette vente s'était faite à un « bon prix », avec une plus-value de 240 millions de francs.
Il y avait en effet quelque exagération à affirmer que l'arrêt de la cour d'appel et celui de la Cour de cassation faisaient peser des menaces sur le CDR. Ce n'était pas le cas. J'estime donc que l'on a pris une décision à l'encontre des intérêts de l'État et du contribuable.

Je vous remercie moi aussi, monsieur le président Aubert, pour la concision et la clarté de votre introduction.
Au moment où vous quittez vos fonctions, la Cour de cassation vient de rendre son arrêt. Vous estimez qu'un passage par la cour de renvoi ne peut aboutir à une issue plus défavorable que l'arrêt de la cour appel. Au moment du passage de témoin, avez-vous fait part de votre sentiment à vos autorités de tutelle et à votre successeur ?
Quel jugement, au regard de ce que vous connaissez du dossier, portez-vous sur les montants figurant dans la sentence du tribunal arbitral ?
Enfin, j'aimerais savoir – car je crois à l'honnêteté de votre approche – comment vous jugez l'idée d'une indemnisation de M. Tapie pour préjudice moral.
Ayant eu à présider, au cours de ma carrière, quelques établissements, je me suis fixé pour principe de ne jamais dire un mot sur mes prédécesseurs et sur mes successeurs. Vous pourrez vous reporter aux procès-verbaux des conseils d'administration, notamment celui dont je vous ai lu un extrait : c'était ma dernière intervention devant le CDR.
S'agissant de la sentence du tribunal arbitral, ce n'est pas l'ancien président du CDR mais le citoyen qui s'exprimera. En tant que citoyen, je ne comprends pas cette décision. Il me semble que le protocole d'arbitrage – que je n'ai pu consulter mais dont j'ai beaucoup entendu parler – imposait de respecter la chose jugée. Or la question de la recevabilité était jugée de façon définitive. Je le dis et redis : le groupe Bernard Tapie n'était pas recevable, en tant qu'actionnaire du vendeur d'Adidas – à savoir Bernard Tapie Finance – à réclamer une indemnité compensatoire d'une éventuelle perte de plus-value pour BTF. La cour d'appel l'a affirmé et la Cour de cassation l'a confirmé, conformément à une jurisprudence constante : un actionnaire ne peut intenter une action au nom de la société qu'il détient ; il ne peut le faire que s'il a subi un préjudice propre et personnel. Ce préjudice, pour le groupe Bernard Tapie, c'était l'éventuelle inexécution du mémorandum du 10 décembre 1992, lequel prévoyait que, sur le prix de vente d'Adidas à hauteur de 2,085 milliards de francs, 185 millions devaient remonter dans les caisses du groupe. La SBDO a versé cette somme. Il y a donc bien eu exécution de l'obligation contractuelle. Dès lors, je ne vois pas sur quel fondement la société Bernard Tapie peut invoquer un préjudice résultant de la perte de plus-value par sa filiale.
À la limite, le seul point sur lequel le tribunal arbitral disposait d'une liberté totale de décision était la détermination du préjudice moral. Il aurait pu aussi bien l'estimer à 285 millions d'euros : sur le plan strictement juridique, cela aurait été moins choquant ; sur d'autres plans, chacun est libre de son appréciation.
Le Président Didier Migaud : Merci beaucoup, monsieur le président Aubert.