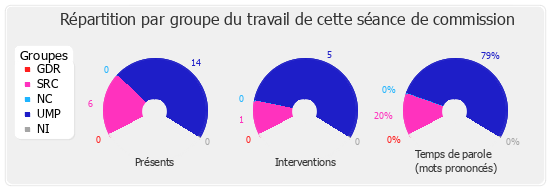Commission des affaires étrangères
Séance du 11 mars 2009 à 10h30
La séance
Table ronde sur les perspectives de règlement du conflit israélo-palestinien après les élections israéliennes, avec M. Yves Aubin de la Messuzière, ancien directeur Afrique du Nord-Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes, chercheur associé à la Chaire Moyen-Orient-Méditerranée de Sciences-po, et M. Alain Dieckhoff, directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études et de recherches internationales (CERI, Sciences Po Paris).
La séance est ouverte à dix heures trente.

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à M. Yves Aubin de la Messuzière, ancien directeur Afrique du Nord-Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes et chercheur associé à la Chaire Moyen-Orient-Méditerranée de Sciences-Po. Nombre d'entre nous, Monsieur l'ambassadeur, ont eu l'occasion de vous rencontrer lorsque vous représentiez notre pays au Tchad, en Tunisie ou, jusqu'en août 2007, en Italie. Je précise également que vous avez présidé le conseil des affaires étrangères et que, bien que vous soyez à la retraite depuis un an, vous continuez à suivre de près la situation au Moyen-Orient dans le cadre de votre enseignement. J'ajoute, enfin, qu'à l'instar d'un certain nombre de vos collègues diplomates occidentaux, vous plaidez depuis plusieurs mois pour que le Hamas soit associé au processus de paix dans cette région.
Soyez également le bienvenu, Monsieur Alain Dieckhoff. Directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études et de recherches internationales, spécialiste de la politique et de la société contemporaine israélienne, vous avez publié en 2008 un ouvrage très complet consacré à L'État d'Israël ; j'ajoute que vous travaillez également sur la question du processus de paix israélo-palestinien.
J'ai souhaité vous réunir car vos points de vue sur les perspectives de règlement de ce conflit me semblent complémentaires. Bien que le parti Kadima de Mme Tzipi Livni ait obtenu un siège de plus que le Likoud de M. Netanyahou lors des élections à la Knesset du 10 février dernier, c'est ce dernier que le président Perez a chargé de former un nouveau gouvernement dont tout laisse à penser qu'il s'appuiera sur une coalition regroupant les partis de droite.
Alors que l'arrivée de M. Obama à la Maison blanche et le choix de ses collaborateurs pour le Proche-Orient tendent à montrer que les États -Unis sont déterminés à mener une politique plus équilibrée dans la région et à peser en faveur d'un règlement du conflit, il est à craindre que le gouvernement israélien, loin de faire des concessions aux Palestiniens, revienne sur l'acceptation du principe de deux États.
Quelques semaines après la fin des opérations militaires contre le Hamas, qui ont infligé à la Bande de Gaza des dommages considérables – comme plusieurs de mes collègues et moi-même avons pu le constater sur place il y a un mois –, peut-on encore croire à la possibilité de voir la raison l'emporter et, donc, d'assister un jour à la création de deux États qui vivraient en paix ?
Notre table ronde a lieu après trois événements majeurs.
Le premier : l'élection de M. Obama, qui devrait avoir des incidences sur le règlement du conflit israélo-palestinien mais également sur les relations avec l'Iran, l'Irak et l'Afghanistan.
Le deuxième : la guerre à Gaza, de la fin du mois de décembre 2008 aux 17-18 janvier 2009, qui, si elle a changé beaucoup de choses sur le terrain en raison de son intensité, n'a en revanche rien modifié sur un plan politico-stratégique, puisque le Hamas demeure un acteur essentiel de cette région qu'il faudra bien intégrer d'une manière ou d'une autre dans les politiques à venir.
Le troisième, enfin : les résultats des élections israéliennes, qui avec 65 députés sur 120, ont donné une franche majorité aux partis de droite et d'extrême droite mais également aux religieux. Selon toute probabilité, la prochaine coalition gouvernementale sera dirigée par M. Netanyahou.
Depuis une décennie, la situation se caractérise par une contradiction croissante entre le processus diplomatique et la réalité du terrain. Ce processus a donné des résultats mais, hélas, très largement théoriques – que l'on songe aux « paramètres Clinton », ou à la feuille de route de 2003 – car obérés par les faits, même si ces avancées ont par ailleurs permis de dessiner les contours de ce que pourrait être un accord de paix final juste et réaliste. Quoi qu'il en soit, ces résultats ont été minés par les évolutions locales : les Israéliens ont pratiqué dans les années 2000 l'unilatéralisme – même si, en 2007, ils ont « réanimé », avec l'administration Bush finissante, un processus de négociations – tandis que les Palestiniens sont prisonniers d'une bipolarisation géographique et politique entre Hamas dans la Bande de Gaza et Fatah en Cisjordanie. Pour toutes ces raisons, il n'est pas possible de poursuivre le processus de paix sur les brisées des années quatre-vingt dix. J'ajoute que la volonté américaine de s'impliquer à nouveau dans ce processus – la nomination du sénateur George Mitchell comme émissaire au Moyen-Orient en témoigne – doit être saluée ; si elle constitue un élément positif, cela ne sera néanmoins pas suffisant pour surmonter les difficultés qui se font jour, et la perspective d'un règlement final du conflit ne me semble pas à portée de main.
Dès lors, que peut-on faire ?
Première possibilité : la « gestion du conflit » – telle sera, me semble-t-il, la perspective du prochain gouvernement israélien – car il n'est pas envisageable pour le Likoud de régler la situation définitivement compte tenu de ce qui n'est pas négociable, c'est-à-dire des « lignes rouges » que sont, pour lui, l'indivision de Jérusalem et le maintien du Jourdain comme « frontière » de sécurité.
Cette gestion se fera selon deux modalités : d'une part, la promotion, auprès de l'Autorité palestinienne, de ce que M. Netanyahou a appelé « la paix économique » – amélioration de la situation économique des Palestiniens, renforcement des institutions de Ramallah – et, d'autre part, l'isolement du Hamas par la pression militaire.
Cela dit, M. Netanyahou est réaliste et sait fort bien qu'il ne pourra s'opposer frontalement à la nouvelle politique américaine. Il essaiera donc de proposer une sorte de « service minimum » en négociant s'il le faut, mais sans véritable volonté d'engagement, à l'instar de ce qu'il avait fait lorsqu'il était Premier ministre dans les années 1990. Par ailleurs, il ne faut pas exclure à moyen terme une ouverture vers Kadima si la pression de l'extrême droite devient trop forte sur le Likoud.
Dans la situation actuelle, une dose de gestion du conflit est certainement inévitable. Il ne faut pas se bercer d'illusions : on ne parviendra pas à un accord définitif entre Israéliens et Palestiniens dans les six prochains mois – on n'y est pas parvenu à la fin des années 90 dans un contexte plus favorable.
Seconde possibilité à mes yeux préférable : préparer les conditions pour un règlement futur. Cela suppose d'abord de travailler avec l'Egypte, à un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas, lequel ne peut que reposer sur une logique de contreparties : d'une part, contrôle du Djihad islamique par le Hamas, arrêt total des tirs de roquettes sur le sud d'Israël et fin de la contrebande d'armes à Rafah ; d'autre part, ouverture des points de passages autour de la Bande de Gaza.
A partir de là, il faudrait s'efforcer de réellement mettre en oeuvre deux principes présents dans la feuille de route de 2003, dont la logique interne demeure valable. Le premier : l'amélioration de la transparence financière de l'Autorité palestinienne et de la sécurité interne ; des progrès indéniables ont été réalisés dans ces domaines en Cisjordanie, sous l'autorité de M. Salam Fayyad. Le second : le gel du développement des implantations israéliennes, qui n'a en revanche pas connu de début de mise en oeuvre. C'est sur ce point-là que devrait porter l'action internationale si la volonté d'aboutir à la création de deux États est bien réelle. Entre 2003 et 2008, sans compter Jérusalem-Est, la population juive israélienne en Cisjordanie est en effet passée de 226 000 à 276 000 personnes. La mise en place d'un véritable système de monitoring international s'impose. Sans le respect de ces deux préalables, la perspective de deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité, restera chimérique.

La question des colonies est en effet décisive ; or, non seulement les implantations ne sont pas gelées mais il est également prévu qu'elles se poursuivent, ce qui n'en est que plus préoccupant.
Je partage l'analyse de M. Dieckhoff quant aux perspectives qui semblent se dessiner après le conflit de Gaza et les élections israéliennes. La forte mobilisation de la communauté internationale pour reconstruire Gaza ne peut, selon moi, atténuer ce pessimisme.
En effet, la situation à Gaza est loin d'être stabilisée et les négociations qui se poursuivent sous les auspices de l'Egypte semblent dans l'impasse en ce qui concerne le contrôle de la frontière avec ce dernier pays, l'ouverture des points de passages et l'échange de prisonniers. J'ajoute que le blocus israélien ne s'est pas desserré depuis la fin du conflit, ce qui rend impossible la reconstruction de Gaza.
La « fracture » palestinienne, par ailleurs, risque de perdurer même si la mise en place d'un gouvernement d'union nationale est espérée pour gérer la situation à Gaza et organiser les élections générales palestiniennes, qui devraient avoir lieu en janvier 2010.
Il est en outre frappant de constater combien l'OLP, considérée depuis les années 70 comme l'unique organisation représentative et légitime des Palestiniens, a été, pour la première fois de son histoire, hors du jeu. La récente démission de Salam Fayyad, de ce point de vue, ne fait que renforcer le Hamas, dont c'était l'une des revendications. Ce dernier se sent d'ailleurs conforté dans le monde arabe et en Cisjordanie, même si, à Gaza, il est aujourd'hui moins populaire que naguère, faute d'avoir pu gérer la situation. Du reste, il ne manque pas de faire valoir ce qu'il considère comme sa triple légitimité, acquise dans la résistance, dans les urnes et dans la confrontation avec Israël.
Je constate également que les dirigeants du Hamas veillent à maintenir un consensus entre l'aile politique de Damas et celle de Gaza – notamment à travers des conseils consultatifs, qui existent aussi parmi les prisonniers – depuis que le mouvement a failli éclater après le coup de force de juin 2007 à Gaza, les pragmatiques considérant alors qu'il était préférable de s'intégrer au sein l'OLP plutôt que de prendre directement le contrôle de Gaza. Cela n'a pas empêché l'expression d'assez fortes divergences après que Khaled Mechaal, chef du bureau politique à Damas, a déclaré à l'issue du conflit que la perspective de créer une nouvelle OLP était envisageable.
J'ajoute, enfin, que le Hamas contrôle difficilement le Djihad islamique, lequel est semble-t-il à l'origine des tirs de roquettes kassam – alors que ce mouvement s'était associé à la première trève.
Autre raison d'être pessimiste : l'élection de M. Netanyahou – même s'il est pragmatique et que sa politique ne sera pas nécessairement la même que celle qu'il avait engagée lors de son premier mandat. Il n'en demeure pas moins que la coalition droite- extrême droite risque de geler durablement le processus de paix, d'autant que le futur Premier ministre s'en tiendra certainement à son projet de paix économique. Toute perspective politique est donc renvoyée sur le moyen et le long termes.
Par ailleurs, si l'on excepte le versant sécuritaire, il ne me semble pas qu'Israël ait jamais eu une vision d'avenir structurée, élaborée sur la question palestienne. Comme l'a dit M. Dieckhoff, il s'agit avant tout de gérer la situation. Tout se passe comme si Israël, toutes tendances confondues, avait pour seule stratégie politique de consacrer la séparation de deux entités palestiniennes et à constater l'absence d'interlocuteur capable de mener des négociations.
Enfin, si Israël n'a, selon moi, jamais cherché à éradiquer le Hamas, il a en revanche promu une politique de containment ou d'endiguement en empêchant son intégration au sein de l'OLP et, si nécessaire, en le frappant par les armes.
En outre, le conflit de Gaza a été l'occasion de constater une exacerbation des rivalités inter-arabes, un front hétéroclite de soutien au Hamas autour du Qatar et de la Syrie s'étant formé lors du sommet extraordinaire de Doha, l'Egypte étant quant à elle moins considérée comme un médiateur que comme une partie prenante voulant contenir le mouvement islamiste. Une telle fracture rend le maintien de l'initiative arabe de paix de 2002 bien incertaine. Le prochain sommet tentera de rétablir un consensus mais ce dernier sera largement artificiel.
Par ailleurs, je ne pense pas que l'Iran ait une responsabilité directe dans le déclenchement du conflit de Gaza, même si ce pays s'est depuis introduit subtilement dans le jeu régional en participant au sommet de Doha et en invitant à Téhéran le chef du bureau politique du mouvement islamiste. Je ne doute pas que le dossier du Proche-Orient sera évoqué dans le cadre des entretiens annoncés entre les États-Unis et l'Iran, ce dernier pays pouvant alors jouer un rôle d'apaisement ou d'exacerbation des tensions.
Je retiens d'entretiens récents à Washington que la nouvelle administration américaine, quant à elle, abordera ce dossier avec une méthode bien différente de celle de l'équipe Bush. Avant d'imaginer l'organisation d'une conférence internationale, je gage qu'elle s'efforcera de créer les conditions d'une relance du processus de paix, ce qui suppose de stabiliser la situation à Gaza à travers notamment le contrôle des frontières, la fin du blocus, et, enfin, de ne pas faire obstacle à la réconciliation palestinienne à la différence de ce qui s'est passé en mars 2008 quand les États-Unis – notamment Condoleezza Rice – sont intervenus directement auprès de M. Abou Mazen afin d'empêcher un accord entre le Fatah et le Hamas.
Il semble, enfin, que la pression de la nouvelle administration américaine sur Israël commence à se faire sentir s'agissant des colonies : je rappelle qu'en 2001, M. Mitchell avait été chargé de la rédaction d'un rapport sur la deuxième Intifada dans lequel il accordait une grande place aux problèmes posés par les colonies.
M. Nicolas Sarkozy a annoncé à Charm El-Cheikh la possible réunion, au printemps, d'un sommet global sur le Proche-Orient. Etant donné que la situation ne sera pas stabilisée, je considère qu'il ne faut rien précipiter – il me semble que c'est aussi l'avis de la nouvelle administration américaine. L'urgence est d'abord de créer les conditions d'un règlement du conflit. À cette fin, le ferme engagement du nouveau gouvernement israélien à arrêter la colonisation et la mise en place d'un nouveau gouvernement palestinien sont sans doute nécessaires. Il faut aussi se garder de l'illusion selon laquelle le volet syrien de cette crise serait plus facile à régler : Bachar El-Assad ne s'engagera pas sérieusement en l'absence de perspectives sérieuses pour les Palestiniens.
Enfin, le pire des scénarios consisterait à considérer que la question israélo-palestinienne peut-être gérée comme un conflit de basse intensité qui subirait des soubresauts sans conséquence sur la stabilité régionale et que la priorité serait accordée au seul développement économique. On rejoindrait ainsi la stratégie de Netanyahou.

Ne pensez-vous pas, Monsieur Dieckhoff, que les Israéliens considèrent l'Iran comme la première menace directe et indirecte qui pèse sur eux ? Tant que cette question ne sera pas réglée, chercheront-ils vraiment à négocier avec les Palestiniens ?
Par ailleurs, Monsieur Aubin de la Messuzière, vous ai-je bien compris lorsque vous avez affirmé que les tirs de roquettes dont est victime Israël ne sont pas le fait du Hamas ? N'est-ce pas un peu difficile à envisager dès lors que cette organisation contrôle entièrement la Bande de Gaza ?
Enfin, la communauté internationale devrait-elle selon vous discuter avec le Hamas ou s'en tenir à sa position actuelle selon laquelle on ne peut discuter qu'avec le Fatah ?
Le gouvernement israélien privilégie « la gestion du conflit » à son règlement pour deux raisons : la division des Palestiniens ; les « lignes rouges » du Likoud (statut de Jérusalem, frontière de sécurité le long du Jourdain …) que j'ai déjà évoquées. L'écart est trop grand entre le maximum que pourrait accorder le Likoud et le minimum que pourrait accepter l'Autorité palestinienne.
Par ailleurs, le problème iranien comptera sans aucun doute parmi les priorités du prochain gouvernement israélien – Netanyahou l'a dit et répété –, la question palestinienne passant au second plan.
Je pense également que la dramatisation de la question iranienne peut être une manière d'évacuer plus facilement le dossier israélo-palestinien.
S'agissant des tirs de roquette, devenus quasi-quotidiens, la plupart d'entre eux ont été revendiqués par le Djihad islamique. Le Hamas a même procédé à des arrestations si l'on en croit un site palestinien. Ce qui est certain, c'est que ce mouvement est confronté à des difficultés depuis le conflit de Gaza : il exerce certes un contrôle serré sur la population, mais pas sur la faction du Djihad islamique.
On pourrait imaginer que la situation actuelle n'est qu'un jeu, le Hamas laissant au Djihad islamique le soin de maintenir la pression, mais je ne pense pas que ce soit la réalité. En tout cas, sans aller nécessairement jusqu'à un clash, le Hamas a la capacité de contrôler la situation s'il le souhaite, car le Djihad islamique est extrêmement minoritaire à Gaza, où ses moyens sont très inférieurs à ceux du Hamas. On peut donc imaginer qu'il existe aujourd'hui des discussions. Ajoutons à cela que le Hamas est beaucoup plus autonome que le Djihad islamique vis-à-vis de l'Iran, car il peut s'appuyer sur d'autres pays, comme la Syrie ou le Qatar.
Il me semble qu'il est nécessaire de mener le dialogue avec le Hamas, car il est, avec Israël, l'un des deux acteurs du conflit à Gaza, l'OLP étant restée à l'écart. On constate au demeurant un plus grand réalisme dans le langage utilisé, en particulier du côté français : le Hamas a ainsi été qualifié d' « interlocuteur » par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, par le ministre lui-même, mais aussi par le Président de la République, dans son discours de Charm El-Cheikh.
On commence donc à s'écarter du dogme – dépourvu de sens – qui avait été posé par le Quartette : renonciation à la violence ; reconnaissance de l'État d'Israël – alors que les différents pays arabes ne reconnaissent pas Israël, à l'exception de l'Egypte et de la Jordanie ; et enfin reconnaissance des accords des paix comme conditions du dialogue.
Du côté européen, il y a encore beaucoup de réserves et de réticences, mais la France tend à reprendre le rôle précurseur qui lui revient traditionnellement dans le dossier israélo-palestinien depuis des décennies, et qui peut avoir un effet d'entraînement, notamment si un dialogue avec les Américains s'instaure.

Ne pensez-vous pas que la situation risque de se cristalliser si le Hamas est maintenu dans l'isolement ?
Vous avez recommandé d'éviter toute précipitation dans l'organisation d'un nouveau sommet. Or, il me semble que le conflit israélo-palestinien dure depuis si longtemps qu'on ne saurait parler de précipitation.
Au cours de certains déplacements dans la région, j'ai en outre constaté qu'il existait un risque d'internationalisation de la crise. Partagez-vous cette analyse ?

Je me suis récemment rendu en Iran, en compagnie de Jean Glavany, dans le cadre d'une mission sur la situation en Afghanistan et au Pakistan. Pensez-vous, comme beaucoup d'analystes, que l'État Israël ne laissera jamais l'Iran acquérir la bombe atomique, et qu'il est prêt à intervenir militairement, dans un délai d'un ou deux ans, s'il le faut ?
D'autre part, que se passera-t-il en cas d'échec de la nouvelle politique de dialogue promue par l'administration américaine, qui allie une accentuation des pressions avec la possibilité d'une reconnaissance de l'Iran ? Si le nouveau président iranien et le guide suprême refusent de renoncer à la bombe, Israël peut-il intervenir ? Et le fera-t-il ?
Si le futur gouvernement israélien adopte une politique de gestion du conflit et d'isolement du Hamas, cela contribuera naturellement à figer la situation. Il en résultera un statu quo, avec sans doute quelques évolutions, mais sans grand changement par rapport à ce que nous connaissons depuis 2007. Or, le statu quo peut être à l'origine de la violence, comme l'a montré la guerre de janvier dernier. D'où la nécessité d'une action diplomatique.
Il reste qu'il faut également tenir compte du contexte : un sommet prématuré peut causer plus de torts sur le long terme qu'un sommet certes plus tardif, mais mieux préparé. Je pense notamment au sommet de Camp David en 2000 : cette conférence était sans doute utile du point de vue américain, mais elle est intervenue trop tôt, et son échec a certainement précipité le retour de la violence. Il est vrai qu'on peut toujours organiser une réunion ne durant qu'une seule journée, à l'image de la conférence d'Annapolis, mais cela ne présente guère d'intérêt.
Mieux vaudrait travailler à la mise en oeuvre des principes de la feuille de route. Je rappelle en effet que nous n'avons effectué que la moitié du chemin : nous avons demandé à l'Autorité palestinienne – laquelle a fait ce qu'elle pouvait – de reconstruire ses institutions et d'adopter une plus grande transparence budgétaire et financière, mais rien n'a été entrepris en ce qui concerne le gel des colonies, hormis le démantèlement de quelques implantations sauvages, généralement reconstruites au bout de quelques mois.
J'en viens à la question de l'Iran, qui fait l'objet d'un large consensus au sein de la classe politique israélienne : il existe une opposition claire et nette à la détention de l'arme nucléaire par cet État. Cela dit, que peut faire Israël ? Son futur gouvernement va sans doute privilégier le renforcement des sanctions autant qu'il est possible, les Israéliens considérant que cette politique a produit des effets positifs. Mais il faudra également qu'Israël laisse une chance à l'administration américaine de faire aboutir le dialogue qu'elle envisage aujourd'hui. Dans ces conditions, j'imagine mal qu'une opération militaire ait lieu dans les mois à venir.
J'ajoute qu'une telle intervention ne serait pas facile à réaliser compte tenu de la dissémination des sites en Iran. Israël pourrait certes se contenter de frapper un nombre limité de cibles, mais il faut tenir compte de la riposte iranienne. Et je le répète : une action militaire ne me semble envisageable qu'après un éventuel échec de la politique d'ouverture des États-Unis.
Il est effectivement nécessaire de préparer le terrain avant tout nouveau sommet, afin que celui-ci soit utile. Il faut éviter de susciter des illusions en cédant à la précipitation, comme ce fut le cas lors du sommet de Camp David. Pour avoir été en contact avec Yasser Arafat en tant qu'émissaire du Président de la République, je peux témoigner qu'il y avait des réticences du côté palestinien ; de son côté, le président Clinton songeait surtout à la photo qui serait prise sur le perron de la Maison blanche, car il était à la fin de son second mandat. Il en a été de même lors de la conférence d'Annapolis, à la fin de la présidence de M. Bush.
Ce qui importe aujourd'hui, c'est que les parties prenantes adoptent des mesures permettant de renforcer la confiance mutuelle. Cela vaut en particulier pour Israël, qui a plus de chemin à parcourir que l'Autorité palestinienne, si l'on veut bien mettre de côté la question de Gaza.
Le « point dur » concerne actuellement la colonisation, sujet qui pourrait susciter une nouvelle crise entre Israël et les États-Unis, si j'en crois certaines sources américaines. Devant le refus du Premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, de participer à la conférence de paix de Madrid, les États -Unis avaient en effet menacé, en 1991, de suspendre les garanties qu'ils apportaient à des emprunts israéliens dont le montant était considérable. Cet exemple démontre qu'Israël ne peut que céder lorsque les États-Unis exercent de véritables pressions.
Or, on peut se demander si la détermination du nouveau président américain ne risque pas de faiblir, compte tenu de l'ampleur des difficultés. Chacun connaît l'action des lobbies israéliens, mais il y aussi l'attitude du Congrès américain : le Sénat est en particulier très réticent à tout changement en la matière.
Au risque de passer pour un prophète de malheur – vous vous souviendrez peut-être que j'avais prédit la tragédie de Gaza –, il me semble que l'on s'achemine vers une 3e Intifada si de nouvelles perspectives ne s'ouvrent pas. C'est en effet une question de générations : les images qui sont aujourd'hui diffusées par Al Jazeera ne peuvent que susciter une grande frustration et une intériorisation de la violence, laquelle ressortira au cours de la prochaine décennie. Cela me semble inéluctable.

J'ai le sentiment que nous faisons du surplace depuis des années, et je me demande si le système électoral israélien ne favorise pas cette situation : les acteurs les plus modérés et les plus ouverts sont toujours pris en otage par les plus radicaux. La communauté internationale ne pourrait-elle pas aider les bonnes volontés à changer le système électoral ? Il faudrait dégager des majorités claires, susceptibles d'accorder de vrais mandats à l'exécutif. Faute de quoi, on risque de ne pas avancer pendant longtemps encore.

Vous avez laissé entendre, Monsieur Aubin de la Messuzière, que les Israéliens avaient intérêt à ce que les Palestiniens demeurent divisés, du moins à court terme. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Vous avez également insisté sur le changement d'attitude de la nouvelle administration américaine à propos d'une éventuelle réconciliation entre les Palestiniens, dont la réalisation faciliterait sans doute les discussions avec Israël. Cet objectif n'est-il pas contradictoire avec la distinction, que tout le monde pratique désormais, entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza ?
Je vais plus loin : n'y a-t-il pas aujourd'hui deux États palestiniens ? Dans ces conditions, que devient l'idée qu'il devrait exister à terme deux États, l'un palestinien, l'autre israélien ? Que peut faire la communauté internationale pour que l'on conserve cet objectif ?
Ma dernière question, que j'ose à peine formuler, concerne le statut de Jérusalem, ville revendiquée à la fois par les Palestiniens et par les Israéliens. Peut-on imaginer qu'elle devienne à terme une ville sous statut international ?

Certains affirment que le Hamas a été « fabriqué » par les services secrets israéliens afin de lutter contre Yasser Arafat. Que pensez-vous de cette thèse ?
Chacun sait que l'Iran a toujours essayé d'utiliser le Hamas et le Hezbollah, et que ce pays a dépensé des sommes importantes à cet effet, en dépit des difficultés résultant de la distance géographique – les armes doivent notamment circuler par d'autres États. Il reste qu'un règlement de la situation en Irak pourrait conduire l'Iran à se concentrer sur d'autres intérêts. Ajoutons à cela que les relations entre Israël, d'une part, et le Hezbollah et le Hamas, d'autre part, dépendent étroitement de l'état des relations américano-iraniennes. Quelle appréciation portez-vous sur ce jeu à multiples bandes ?
Il me semble que des actes fondateurs et forts sont parfois nécessaires sur la scène internationale. C'est pourquoi j'ai toujours estimé que la France devait dès maintenant reconnaître l'Autorité palestinienne en tant gouvernement d'un État. Malgré l'existence de colonies israéliennes, l'Autorité palestinienne exerce en effet un contrôle territorial. Une reconnaissance internationale ne pourrait-elle pas jouer un rôle de déclencheur, comme le fit autrefois le discours de Phnom Penh?
Autre sujet d'interrogation : les Israéliens ont-ils un jour admis qu'ils détenaient l'arme nucléaire ? On pense qu'ils disposent d'une centaine de bombes, et je rappelle que les Iraniens attachent une grande importance à cette question.
En dernier lieu, ne peut-on pas penser que les Israéliens se satisfont de l'existence d'un conflit permanent de basse intensité avec le Hamas, voire avec le Hezbollah, car cela favorise leur unité nationale ? Que pensez-vous de cette idée que certains défendent ?

Vous avez indiqué, l'un et l'autre, mais en des termes un peu différents, qu'Israël n'avait pas de vision de long terme, hormis un impératif de sécurité nationale. Dans quelles directions l'État d'Israël pourrait-il s'engager à l'avenir ?
Vous avez évoqué, Monsieur Aubin de la Messuzière, l'évolution de la position française. Quel rôle l'Union pour la Méditerranée, créée à l'instigation du Président de la République, pourrait-elle jouer dans le conflit israélo-palestinien ? Je pense notamment à la Turquie, qui se tourne vers l'Union européenne, mais qui demeure à la recherche d'un positionnement international.
Il est exact que le système électoral israélien complique singulièrement la situation. Depuis 1996, aucune législature n'est allée jusqu'à son terme. Le système électoral a fonctionné tant qu'il existait un parti dominant – d'abord le parti travailliste, pendant une trentaine d'années, puis le Likoud, qui a pris le relais à la fin des années 70. Depuis 1990, les deux grands partis se sont affaiblis, tandis que les petits partis se sont renforcés, ce qui a déséquilibré la situation.
Les députés israéliens ayant bien conscience du problème, de nombreuses réformes ont été proposées, mais aucune d'entre elles n'a abouti. Les petits partis n'ont en effet aucun intérêt à ce que la situation change, et je ne vois malheureusement aucune perspective de réforme interne pour le moment.
Dans ces conditions, la communauté internationale pourrait-elle agir ? Je rappelle qu'elle n'intervient jamais dans le mode de désignation des instances politiques, à l'exception des États dits « faillis ». Les Palestiniens eux-mêmes ont pu choisir le type de scrutin qu'ils souhaitaient – ils l'ont d'ailleurs modifié, au préjudice du Fatah, en combinant représentation proportionnelle et représentation par circonscription. Comme l'a montré l'exemple italien, il faudra attendre que le système soit complètement à bout de souffle pour qu'un changement interne se dessine. Mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là en Israël.
Sur la question de Jérusalem, il y a eu des progrès sur le papier depuis 2000, car certains responsables israéliens, notamment M. Ehud Barak, ont accepté le principe d'une division de la souveraineté. Il reste à discuter de ses modalités, ce qui est une question plus complexe. Cela étant, le principe d'une division a été accepté par la gauche israélienne, et même par une partie de la droite modérée.
L'hypothèse d'une internationalisation de Jérusalem est en revanche rejetée par les deux parties, bien que cette solution présente un certain intérêt. Pour avoir beaucoup travaillé sur la question de Jérusalem, je crois qu'il faut s'interroger sur ce que l'on désigne par ce nom : fait-on référence à la Jérusalem administrative telle que les Israéliens la conçoivent, ou bien seulement à la vieille ville ? Cette dernière pourrait être internationalisée, et le reste divisé, sur le plan de la souveraineté, entre quartiers juifs et arabes.
Quant au Hamas, il me semble difficile d'y voir une créature d'Israël. Il est vrai que le gouvernement militaire israélien qui administrait la Cisjordanie et Gaza a encouragé le développement du mouvement des Frères musulmans à la fin des années 70, en vue de réduire l'influence de l'OLP. Toutefois, il faut se souvenir que les Frères musulmans ne formaient alors qu'un simple mouvement quiétiste, prônant un retour à des pratiques plus rigoureuses de l'islam. L'État d'Israël n'avait pas perçu que ce mouvement pourrait se politiser, ce qui a fini par se produire à partir de la première Intifada, en 1987. En effet, les Frères musulmans pouvaient difficilement rester en dehors du mouvement populaire. Le Hamas a ensuite fait son apparition, puis il est devenu un ennemi irréductible d'Israël, contrairement à l'OLP, qui a suivi le chemin inverse.
Je ne pense pas que le maintien d'un conflit de basse intensité soit une nécessité existentielle pour Israël. Mais c'est une option « gérable », qui présente l'avantage de repousser les choix, notamment en ce qui concerne le tracé de la frontière avec le futur État palestinien. Or, c'est précisément ce qui explique l'absence de vision de long terme en Israël. Avec la Syrie, comme avec l'Egypte dans les années 70, le contentieux est certes complexe, mais la frontière est à peu près claire, à quelques centaines de mètres près. En revanche, ce n'est pas du tout le cas avec le futur État palestinien. Si certains acceptent l'idée que deux États coexistent – c'est le cas au sein du Parti travailliste et de Kadima, mais pas du Likoud –, il n'existe à l'heure actuelle aucun accord sur les détails pratiques.
La logique actuelle donne donc une prime à l'immobilisme. Si l'on reste au statu quo, c'est pour éviter de prendre des décisions. Les considérations de court terme prévalent.
Je rappelle que Yasser Arafat avait l'intention de proclamer unilatéralement l'existence d'un État palestinien dans les années 2000, mais qu'il en a été découragé. Le Fatah était lui-même divisé sur cette question, certains considérant qu'une telle proclamation ne pouvait que consacrer la situation existante, tout en conduisant à une rupture des négociations avec Israël. D'autre part, j'observe que cette question n'est plus à l'ordre du jour pour le moment.
La séparation entre la Cisjordanie et le Hamas, qui pourrait être l' « agenda caché » des Israéliens, fait effectivement courir un risque au futur État palestinien. Si le Hamas suit aujourd'hui une logique beaucoup plus nationaliste et politique que religieuse, la donne pourrait changer. Certaines personnalités indépendantes que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Gaza s'inquiètent de l'emprise croissante du Hamas.
S'agissant du statut de Jérusalem, il y a eu des avancées lors du sommet de Camp David en 2000, puis avec le Pacte de Genève, mais la conférence d'Annapolis a marqué une véritable régression, puisqu'il n'y a pas eu de véritable discussion sur la question de Jérusalem. Les « paramètres Clinton » ont pourtant ouvert des perspectives. La même observation vaut pour la question des réfugiés, elle aussi laissée de côté.
J'en viens à l'Union pour la Méditerranée : à cause du récent conflit à Gaza, le processus a été mis en veilleuse. Les groupes de travail ne se réunissent plus, les pays arabes ne voulant pas rencontrer les Israéliens. Il faut également préciser que l'UPM, telle qu'elle a été conçue par le Président de la République, n'a pas pour objet d'aborder la question israélo-palestinienne. Compte tenu du nombre des participants, ce serait en effet une tâche singulièrement complexe.
D'autre part, il est exact la Turquie joue un rôle émergent, qui est souhaité par les Palestiniens et qui semble plus facilement acceptable par l'Egypte que celui d'autres pays arabes, notamment le Qatar ou la Syrie, sur des sujets tels que la négociation et l'application de la trêve, les échanges de prisonniers, ou l'ouverture de points de passage.
Elles n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration officielle. En réponse à une question posée par un journaliste du Spiegel, M. Ehud Olmert n'a certes pas été loin d'admettre que son pays détenait l'arme nucléaire, mais les autorités israéliennes ne sont jamais allées au-delà. Il y a toujours eu une ambiguïté, qui fait d'ailleurs partie de la doctrine israélienne.

Il me reste, Messieurs, à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, et d'avoir alimenté notre réflexion en venant exposer vos vues.
La séance est levée à onze heures quarante-cinq.