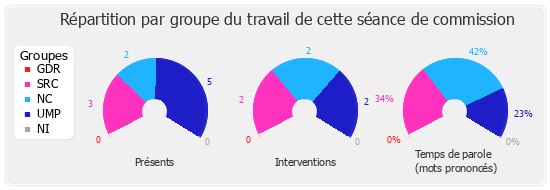Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale
Séance du 18 mai 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
Mercredi 18 mai 2011
La séance est ouverte à seize heures quinze.
(Présidence de M. Bernard Accoyer, président de la Mission d'information, puis de M. Marc Laffineur, vice-président, puis de M. Christian Blanc, vice président)
La Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale entend, en audition ouverte à la presse, M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor, Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale, et M. Luc Rousseau, directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Mes chers collègues, l'intérêt de cette mission d'information tient à la fois à l'importance des défis auxquels nous confronte l'évolution de l'économie mondiale et à la nécessité de préserver un pacte social dont nous ne pouvons pour autant négliger les implications financières. Je remercie donc la directrice et les directeurs de trois des plus prestigieux services des ministères financiers pour l'éclairage qu'ils vont nous apporter sur ces questions conjointes de la compétitivité de notre économie et du financement de notre protection sociale.
La France constitue-t-elle une exception en Europe, pour ce qui est de la compétitivité ? Objectivement non : l'exception serait plutôt allemande. Reste que nous sommes à cet égard sur la pente descendante, cependant que nos dépenses sociales restent plus élevées que celles de nos voisins.
Au cours de la dernière décennie, notre pays a perdu des parts de marché à un rythme proche de celui qu'on observe dans le reste de la zone euro – notre performance à l'exportation a baissé en moyenne de 2,4 % par an entre 2000 et 2008, et celle des pays du coeur de la zone euro, hors Allemagne, de 1,9 % –, mais, dans le même temps, l'Allemagne améliorait, elle, ses résultats de 1,2 % par an, si bien que l'écart avec notre voisin s'est creusé.
Ce décrochage, abondamment documenté, s'explique par une divergence des coûts salariaux, liée à un problème de compétitivité-coût. Aujourd'hui, notre coût salarial horaire dans l'industrie manufacturière, qui est de 33 euros, est à un niveau très proche de celui de l'Allemagne, laquelle a fait un effort gigantesque afin de compenser le coût de la réunification. En revanche, le coût des services reste à un niveau significativement supérieur en France. Or l'industrie manufacturière repose aussi sur les services.
Le problème de compétitivité-prix se pose de façon moins criante, notamment parce que nos entreprises ont comblé, en baissant leurs marges, cet écart de compétitivité lié aux coûts. Ainsi, au cours de la même période 2000-2008, notre compétitivité par rapport à l'Allemagne, qui s'est dégradée de 15 % sur les coûts, n'a diminué que de 5 % sur les prix. Mais l'effort consenti sur les marges se traduit par une diminution de l'effort de recherche et développement (R & D) et de l'investissement, ce qui peut expliquer une partie de notre handicap sur les autres déterminants de la compétitivité, la compétitivité hors-coût et hors-prix, où nous avons également perdu du terrain.
En matière de protection sociale, la situation de la France est un peu particulière.
Premièrement, nos dépenses sont notablement plus élevées que chez nos quinze principaux partenaires européens : en 2008, nous y consacrions 31 % de notre PIB, contre 27 % pour eux, en moyenne. Signalons accessoirement que, malgré un mouvement général plutôt orienté à la hausse, quelques pays – dont le Royaume-Uni, les pays nordiques et l'Allemagne – ont stabilisé, voire réduit le poids de ces dépenses de protection sociale au cours des dernières années.
Deuxièmement, notre protection sociale est financée à 65 % par des cotisations, alors que la moyenne chez nos principaux partenaires est de 58 %. Même si cette moyenne masque des différences importantes en fonction de l'histoire de chaque pays et des modèles d'organisation, il reste que notre mode de financement fait peser davantage que les leurs l'effort sur le travail, c'est-à-dire sur l'emploi. Remarquons cependant qu'entre 1997 et 2008, le poids relatif des cotisations a diminué de six points en France, ce qui se traduit par un timide début de convergence avec nos partenaires européens.
Quel lien établir entre notre compétitivité et le financement de notre protection sociale ? D'innombrables rapports ont été produits sur le sujet, notamment en 2007, à la suite de débats qui avaient défrayé la chronique, mais sans apporter de réponse. Où en est-on aujourd'hui ? Faut-il modifier les modalités de financement de notre protection sociale ?
En premier lieu, il convient de maîtriser les dépenses : le poids des prélèvements obligatoires dans notre pays – environ 43 % – est supérieur à la moyenne de nos principaux compétiteurs, qui se situe autour de 39 %. Au reste, la nécessité où nous nous trouvons d'assainir nos finances publiques ne nous laisse guère le choix !
Doit-on, pour parvenir à cette maîtrise, changer les assiettes, ou du moins les faire évoluer ? On peut se demander, par exemple, pourquoi la politique de la famille est financée par des cotisations assises sur le travail. Mais, pour s'en tenir à des considérations strictement économiques, il faut bien voir qu'une réduction des charges pesant sur le travail favoriserait l'emploi et améliorerait la compétitivité des entreprises, dans la mesure, évidemment, où les taxes appelées à compenser ces baisses de cotisation ne viendraient pas en annuler les effets positifs – il ne faut donc pas se tromper dans le choix d'une recette de substitution.
Les pays voisins nous offrent des exemples intéressants. L'Italie a compensé en 1998 la suppression des cotisations santé des employeurs, assises sur le travail, par un nouvel impôt régional sur les activités productives. La Suède s'est engagée sur une autre voie, entre 2001 et 2006, en verdissant sa fiscalité par la hausse des taxes environnementales. L'Allemagne, en 2007, a relevé sa taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de trois points, ce qui lui a rapporté 24 milliards d'euros ; en même temps, elle a baissé de 1,6 point, et de 11,5 milliards, les cotisations sociales. Cette « TVA sociale » a donc servi à la fois à restaurer la compétitivité et à redresser les comptes publics. De la même façon, en fiscalisant une partie des cotisations de sécurité sociale avec la contribution sociale généralisée (CSG), la France a fait évoluer, quoique à un moindre degré, la structure de ses prélèvements.
Quelles seraient les conditions à remplir pour poursuivre dans cette voie ?
D'abord, il faut déterminer si ce sont les cotisations salariales ou les cotisations patronales que l'on souhaite baisser. Les effets ne sont évidemment pas les mêmes dans les deux cas. À court terme, la baisse des cotisations sociales des employeurs, de loin les plus importantes, permettrait de stimuler à la fois l'emploi et la compétitivité. La baisse des cotisations salariales améliorerait, quant à elle, le pouvoir d'achat.
Ensuite, il convient de déterminer quels régimes sociaux seraient concernés. On sait par exemple que, s'agissant des cotisations salariales, les taux appliqués dans les branches Maladie et Famille sont déjà presque nuls. J'éviterai d'entrer trop dans les détails à cet égard, mais il faut au moins distinguer entre les différents étages de notre protection sociale. S'agissant de la sécurité sociale au sens strict, compte tenu des allégements de charges déjà consentis, une nouvelle baisse des cotisations ne pourrait jouer que sur des rémunérations nettement supérieures au salaire minimum de croissance (SMIC) – au-delà de 1,6 SMIC. L'effet sur l'emploi serait, de ce fait, limité. Dès lors, faut-il plutôt agir sur le deuxième étage qui rassemble régimes obligatoires, complémentaire vieillesse, assurance chômage et une myriade de contributions, qui, additionnés, finissent par peser assez lourd comme l'a remarqué récemment la Cour des comptes dans son rapport où elle comparait la France et l'Allemagne ?
L'option couramment avancée consiste à faire baisser les taux de droit commun de sécurité sociale. C'est bon pour la compétitivité, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour l'emploi, je le répète, en raison des allégements de charges existants sur les bas salaires.
Une autre option consisterait à alléger les charges des employeurs qui financent les grands régimes paritaires. Concevable en théorie, une telle mesure risquerait d'avoir de très lourdes conséquences en termes de gouvernance.
Mais il reste de la place pour des actions plus techniques. Par exemple, on pourrait bouger les curseurs des allégements de charges dans toutes sortes de directions, pour essayer d'avoir un impact plus marqué sur l'emploi.
Pour compenser ces baisses de charges, quelles taxes ou contributions relever ? Chaque solution présente des avantages et des inconvénients. Relever la taxe sur la valeur ajoutée pénaliserait le pouvoir d'achat des actifs dans la mesure où cela aurait nécessairement un impact sur les prix, variable en fonction du contexte plus ou moins inflationniste et du degré de concurrence dans l'économie. Augmenter la contribution sociale généralisée serait s'inscrire dans le prolongement des réformes des années quatre-vingt-dix mais, comme il n'y a pratiquement plus de cotisations salariales pour les prestations de nature universelle, toute hausse de la contribution sociale généralisée réduirait le salaire net et donc le pouvoir d'achat. Enfin, on pourrait agir sur les taxes « carbone » et les taxes comportementales, celles dont on dit qu'elles apportent un double dividende, parce qu'elles procurent des recettes tout en contribuant à faire évoluer les comportements.
En conclusion, il faut d'abord agir sur la dépense, comme l'ont dit ici ceux qui sont en charge des différents régimes ; ensuite, si l'on décide de faire évoluer les recettes, définir clairement les objectifs que l'on poursuit, en les hiérarchisant ou en arbitrant entre eux – par exemple entre pouvoir d'achat, emploi et compétitivité ; enfin, dégager la meilleure des options.
Je laisserai à M. Luc Rousseau le soin de parler de ce que l'on fait, ou de ce que l'on doit encore faire, pour améliorer notre compétitivité économique. Je me bornerai ici à citer quelques outils susceptibles d'y contribuer : la loi de modernisation de l'économie, en particulier son volet « concurrence » ; les incitations à développer la recherche-développement (R&D) – crédit d'impôt recherche, réforme des universités… –, la réforme de la taxe professionnelle et l'accompagnement de nos entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, à l'exportation grâce aux plans Export, à la Coface et à UbiFrance.
Je partage l'analyse présentée par mon collègue Ramon Fernandez mais, pour ma part, j'insisterai sur la dégradation de notre balance commerciale qui, entre 2000 et 2010, est passée du quasi-équilibre à un déficit de plus de 50 milliards d'euros par an, et peut-être plus encore sur la dégradation de la balance des paiements courants qui, il y a dix ans, était excédentaire d'une vingtaine de milliards et est aujourd'hui déficitaire d'environ 40 milliards. Une telle évolution, insoutenable pour notre pays, traduit une perte de compétitivité de notre appareil économique, notamment de notre appareil productif et, plus spécifiquement, de son secteur industriel. Il ne s'agit pas d'une fatalité, liée par exemple à la montée des pays émergents, puisque l'Allemagne a su améliorer sa balance commerciale au cours de la même période. Je précise qu'en ce domaine, la France se trouve dans une situation sensiblement moins grave que celles de l'Espagne et de l'Italie, comparable à celle du Royaume-Uni.
Quelles sont nos faiblesses ?
Depuis dix ou quinze ans, nos gains de productivité sont relativement modestes, surtout dans les services, puisque la productivité moyenne a augmenté de 0,7 % mais de 3 % dans l'industrie. C'est en tout cas un élément à prendre en considération.
Par ailleurs, la France présente certainement un handicap sectoriel. Au regard de la mondialisation, on peut distinguer quatre catégories : des secteurs très exposés à la concurrence internationale – textile, habillement, électronique grand public, génériques en pharmacie, acier, aluminium –, le coût de la main-d'oeuvre y étant majeur ; des secteurs en équilibre instable comme la chimie et la construction automobile ; des secteurs continentaux peu délocalisables – raffinage, production et distribution d'énergie, télécommunications – et, enfin, des secteurs que nous qualifions de « moteurs d'innovation » – industrie aéronautique et spatiale, défense, filière nucléaire, pharmacie, biotechnologie, logiciels. À mesure qu'on passe d'une catégorie à l'autre, la valeur ajoutée par emploi augmente, partant de 55 000 euros pour aller jusqu'à 90 000 euros, comme augmente en principe la participation de ces secteurs à la croissance, dans les pays occidentaux. La France est sans doute un peu faible dans la dernière catégorie, celle des « moteurs d'innovation ». Il conviendrait de renforcer notre structure d'entreprises, notamment notre structure industrielle, dans ces secteurs à forte croissance et à forte valeur ajoutée, soutenues par un fort niveau de recherche et développement. Or, comme l'a remarqué mon collègue, la dégradation des marges des entreprises françaises a freiné l'investissement, notamment en recherche et développement. Celui-ci représentait 7 % de la valeur ajoutée industrielle il y a dix ans, comme en Allemagne. Le taux est resté à 7 %, alors qu'il est passé à 10 % chez notre voisin.
Enfin, l'évolution différenciée des coûts du travail a creusé entre la France et l'Allemagne un écart de dix ou quinze points en une dizaine d'années. Comme il ne nous est plus possible de compenser ce handicap par la monnaie – par des dévaluations –, il a été envisagé de procéder à un recalage par un ajustement des prélèvements obligatoires – mission confiée par deux ministres à M. Jean-François Dehecq, vice-président de la Conférence nationale de l'industrie.
Sachant que les prélèvements obligatoires sur les entreprises sont de 16 % du PIB en France contre 8 % en Allemagne, l'idée est de regarder comment transférer des prélèvements pesant sur le travail et l'investissement vers d'autres assiettes, plus neutres vis-à-vis des importations notamment, voire plus vertueuses du point de vue environnemental – mais en prenant garde alors à de possibles distorsions aux frontières. Il ne faut pas oublier non plus les allocations familiales, issues d'un prélèvement assis sur les salaires, ce qui est une particularité quasi exclusivement française. Dans le même temps, comme l'a conseillé mon collègue, il convient bien sûr de contenir les dépenses et les prélèvements obligatoires, qui pèsent sur la compétitivité nationale.
Cette mesure de recalage est une mesure de court terme. Bien d'autres, plus structurelles, peuvent être envisagées :
– tout d'abord, encourager la montée en gamme pour se différencier d'un certain nombre de pays concurrents. Beaucoup a été fait en ce sens ces dernières années : triplement du crédit d'impôt recherche, développement des pôles de compétitivité et, plus récemment, lancement du programme « investissements d'avenir ». Mais pour qu'elle fasse sentir ses effets sur les investissements des entreprises, une telle politique devrait gagner en lisibilité. En outre, il conviendrait de ne pas s'en tenir à la recherche « amont », mais de développer aussi l'innovation de façon à favoriser l'implantation d'activités manufacturières en France. On pourrait également envisager des mesures complémentaires en faveur de secteurs émergents dynamiques tels que les biotechnologies, les technologies vertes et certaines technologies de l'information ;
– accompagner les entreprises locales, comme savent le faire nos pays concurrents, dans trois domaines : pour l'exportation, en incitant davantage les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à se lancer ; pour l'excellence opérationnelle, ou Lean Management ; pour « l'image qualité » des produits et des services car la qualité, qui se traduit dans le prix qu'accepte de payer le client, est un facteur de différenciation de notre pays par rapport à l'Allemagne ;
– accélérer la diffusion des technologies de l'information, notamment dans les services. La France investit plutôt moins que les autres pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) dans ces technologies, ce qui se traduit par des gains de compétitivité moindres. Plus généralement, il convient d'accélérer la diffusion de l'innovation dans notre appareil productif, car c'est un facteur de compétitivité et de productivité ;
– renforcer la concurrence, en particulier dans les services, en s'appuyant sur la directive « Services » et sur la loi de modernisation de l'économie ;
– faciliter les financements sur fonds propres. À cet effet, les entreprises peuvent déjà recourir au Fonds stratégique d'investissement et à son volet France Investissement destiné notamment à développer le capital risque et le capital développement, mais aussi sur des mesures fiscales comme la mesure dite « Madelin » et la mesure « ISFPME ». Ce sont des outils d'autant plus utiles que l'une de nos grandes différences avec l'Allemagne, s'agissant de la structure des échanges commerciaux, tient à la faible place des entreprises de taille moyenne ou intermédiaire ;
– favoriser le travail en filière – car les Français sont par nature individualistes – en encourageant les coopérations de moyen et long termes et en évitant de se focaliser sur le seul facteur prix. Travailler en filière permet de structurer des offres qui ne peuvent être le fait d'acteurs isolés, et pour lesquelles il convient d'additionner les capacités de donneur d'ordre et de fournisseur ;
– enfin, améliorer la formation et son adéquation aux besoins de l'économie en développant l'alternance, en multipliant les interactions entre les entreprises et l'éducation nationale et en veillant à la qualité de l'orientation. Dans un certain nombre de métiers, le décalage entre les besoins et l'offre constitue encore un frein à la croissance et à l'activité économique.
Pour la direction de la législation fiscale, des réformes de la structure de nos prélèvements obligatoires peuvent en effet changer la donne sur le terrain économique. Mais si des marges de manoeuvre subsistent pour les prochains mois et les prochaines années, elles sont cependant limitées.
Je partirai d'un travail que nous avons préparé avec le prédécesseur de M. Ramon Fernandez à partir de la fin de 2007 et qui a donné lieu à une publication à la mi-2008 : la revue générale des prélèvements obligatoires. Il s'agissait pour nous d'établir, à la demande des autorités publiques, un diagnostic sur la situation de nos prélèvements fiscaux et sociaux afin d'essayer de déterminer les meilleurs choix possibles pour les mois suivants. Une grande partie de ce diagnostic a été reprise dans le rapport de la Cour des comptes comparant la situation de la France et celle de l'Allemagne à cet égard.
Nous avions tenté de caractériser certaines failles de notre système, mais aussi et surtout de cerner les stratégies envisageables pour l'organisation des prélèvements obligatoires, en comparant leurs mérites. Très synthétique, le document ne rendait que partiellement compte de notre travail mais il faisait apparaître clairement que l'on n'aboutissait pas aux mêmes choix suivant que l'on privilégiait une certaine neutralité des prélèvements entre capital et travail, ou la recherche d'une croissance à fort contenu en emplois – ce qui impliquait d'alléger les prélèvements pesant sur le travail –, ou encore des modèles de concurrence fiscale, ce qui amenait à rechercher des assiettes non délocalisables et donc à s'appuyer davantage sur la taxe sur la valeur ajoutée – ou sur les impôts indirects en général – et sur les impôts environnementaux que sur les impôts pesant sur le capital. Nous nous sommes rendu compte, en particulier, que selon l'importance donnée au taux de croissance ou au taux de chômage, on parvenait à des équilibres de prélèvements très différents.
Cela m'amène à appuyer ce que disait tout à l'heure M. Ramon Fernandez, à savoir qu'avant de s'engager dans des réallocations de prélèvements obligatoires, forcément compliquées et difficiles, il importe de clairement identifier les objectifs que l'on poursuit… et de bien vérifier qu'ils restent d'actualité, car les circonstances économiques, politiques ou extérieures peuvent avoir changé la donne entre-temps.
Les choix que proposait le Gouvernement dans le document précité conduisaient à privilégier trois grands objectifs : la justice fiscale ; le développement durable à travers les impôts environnementaux ; et la compétitivité, à travers la réforme de la taxe professionnelle, considérée alors comme devant avoir la priorité dans toute réorganisation de nos prélèvements obligatoires.
Concrètement, dans la période qui s'est écoulée et pour s'en tenir aux mesures phares, vous avez voté cette réforme de la taxe professionnelle, une importante augmentation du crédit d'impôt recherche destinée à favoriser les investissements de croissance et des mesures visant à faciliter le financement de nos entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, qui en avaient bien besoin.
Quatre ou cinq ans plus tard, j'observe que nous avons corrigé quelques-uns de nos défauts, mais que certains pays parviennent à vivre assez bien avec des défauts assez voisins des nôtres ! C'est ainsi que l'Allemagne, qui a peu fiscalisé son financement de la protection sociale, ne paraît pas éprouver, de ce fait, un handicap de compétitivité particulier. La Cour des comptes a noté qu'elle avait su, mieux que nous, mettre sa stratégie fiscale au service de sa compétitivité, sans doute parce qu'elle avait été plus vigilante sur le long terme, ou simplement plus consciente des conséquences que pouvaient avoir sur l'organisation de ses prélèvements obligatoires les contraintes liées à une économie ouverte. Et de manière assez surprenante, alors que nous attendions que la cour nous invite à gérer nos finances publiques avec davantage de prudence, elle a insisté sur l'importance de se tenir à cet objectif de compétitivité et sur la différence notable qui existe, en ce domaine, entre la France et l'Allemagne.
La réflexion que vous menez invite à réfléchir à ce que pourraient être les prochaines étapes. Ces dernières années, pour ce qui est des assiettes, nous avons plutôt axé l'effort sur l'investissement en consolidant les options prises en faveur de l'emploi. Aujourd'hui, la question des choix à faire se pose.
M. Ramon Fernandez s'est interrogé sur la manière dont on pourrait faire évoluer les financements existants de la protection sociale. Pour ma part, je poserai la question suivante : si une réallocation était jugée souhaitable pour des raisons de compétitivité, quelles seraient nos marges de manoeuvre et nos contraintes, sachant que notre niveau de prélèvements est déjà assez élevé et que nous sommes soumis à une forte compétition internationale ?
Malgré ce niveau élevé de prélèvements obligatoires et cette compétition féroce, nous avons des marges de manoeuvre – les travaux de la Cour des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires l'ont démontré. Il suffit d'ouvrir le tome II de l'Évaluation des voies et moyens pour comprendre qu'une réflexion est en cours sur les dépenses fiscales. Et, qu'il s'agisse des impôts sur la consommation ou des impôts sur les « externalités négatives », le niveau plutôt modeste de nos impôts indirects ouvre la possibilité d'évolutions.
Même s'il ne faut pas généraliser, j'insisterai aussi sur la très grande capacité des contribuables, ménages ou entreprises, à adapter leur comportement en fonction des choix faits en matière de prélèvements obligatoires et en fonction de la gouvernance fiscale. Certaines assiettes sont ainsi très sensibles : pour s'en convaincre, il suffit de consulter les rapports de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, qui ne concernent d'ailleurs pas que la France. Force est de constater, par exemple, qu'aujourd'hui, dans notre pays, le taux de l'impôt sur les sociétés est à un niveau élevé, ce qui constitue un sujet de préoccupation pour le moyen terme. S'ajoutant aux prélèvements sur la détention de capital, les prélèvements de droit commun sur l'épargne atteignent également – surtout en comparaison de ce qui se fait à l'étranger – des niveaux importants qui doivent tout au moins nous inciter à la prudence.
Prudence qui s'impose d'autant plus que la compétitivité et la réorganisation du système des prélèvements obligatoires ne sont pas des problèmes purement économiques ou fiscaux. Au-delà de la description technique des phénomènes mathématiques et économiques à l'oeuvre dans ces matières, la dimension psychologique n'est pas à négliger : l'impôt doit être accepté par les citoyens et cela peut constituer une autre limite à l'exercice de réallocation.

Quelle évaluation êtes-vous en mesure de faire du crédit d'impôt recherche ? Contribue-t-il à combler notre retard en matière de recherche et d'innovation ?
Notre compétitivité s'est-elle améliorée au cours des trois ou quatre dernières années, par rapport à l'Allemagne et à nos autres partenaires européens ?
Nos entreprises ne dégagent pas suffisamment de marges, contrairement à ce que croit l'opinion publique, aveuglée par celles que réalisent un petit nombre d'entre elles. Comment améliorer la situation ?

S'agissant de la maîtrise des dépenses, notre corapporteur Pierre Méhaignerie, qui a dû nous quitter, aurait aimé avoir votre avis sur la baisse dégressive des indemnités de chômage des cadres.
De façon plus générale, quelle hiérarchie établir en vue de cette maîtrise des dépenses, afin d'améliorer notre compétitivité internationale tout en assurant le financement de la protection sociale, conformément à l'objet de la présente mission d'information ?
Comment caractérisez-vous la fiscalité pesant sur nos entreprises, notamment l'impôt sur les sociétés, par comparaison avec celle de nos partenaires européens ?

Le problème de compétitivité de l'économie française aurait-il pour origine le poids de la dette, comme d'aucuns le suggèrent ?
Comment se situe la France au sein de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques pour ce qui est des investissements internationaux ? On dit qu'ils seraient moins importants qu'on ne l'a annoncé, dans la mesure où il s'agirait souvent de rapatriements de fonds placés à l'étranger par des entreprises multinationales.
La multiplicité des acteurs intervenant dans le soutien aux entreprises françaises est-elle un gage d'efficacité ou constitue-t-elle au contraire un handicap ?
Selon les chiffres en notre possession, les capacités de nos entreprises seraient utilisées entre 70 % à 75 % : si tel est le cas, ne doit-on pas craindre une atonie des investissements au cours des prochaines années ?
Que pensez-vous enfin des projections gouvernementales selon lesquelles la part des prélèvements obligatoires repasserait à 43,9 % du PIB en 2013, alors qu'elle est déjà supérieure à celle que connaît notamment l'Allemagne ?
L'année dernière, plusieurs rapports, émanant notamment de votre assemblée et de l'inspection des finances, ont conclu qu'il était un peu tôt pour évaluer de manière étayée l'efficacité du crédit d'impôt recherche, compte tenu des modifications importantes intervenues en 2008, dont le passage à un dispositif fondé sur le volume des dépenses de recherche et la suppression du plafonnement.
Ces travaux ont toutefois constaté des progrès notables : une croissance des dépenses de recherche plus importante que ne le permettait le seul contexte économique, ce qui paraît indiquer que le dispositif est efficace mais reste à confirmer sur le moyen terme ; une plus grande diffusion de l'effort de recherche au sein de l'économie, au bénéfice de secteurs jusqu'alors peu touchés ; un regain rapide d'attrait du dispositif auprès des petites et moyennes entreprises, qui ont, elles aussi, besoin de recherche et développement pour pénétrer des marchés très concurrentiels.
Les rapports notaient également, de la part des acteurs économiques, le souhait de voir ce dispositif stabilisé pour leur permettre d'inscrire dans la durée leurs stratégies d'investissement. Cette stabilisation est également souhaitable vis-à-vis des investisseurs internationaux, qui ont renoué avec l'investissement à long terme depuis le relèvement du crédit d'impôt recherche.
Même si un complément d'évaluation circonstancié s'impose d'ici deux ou trois ans, Bercy fait donc une évaluation positive de ce dispositif et souhaite le voir s'installer durablement dans le paysage fiscal français, sous un format important. Il fait en effet « coup double » : il favorise une stratégie de croissance à forte valeur ajoutée, liée à un investissement dynamique, tout en tempérant le taux très élevé de l'impôt français sur les sociétés – un des plus élevés des pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques. En ce sens, ce dispositif pertinent et puissant permet d'estomper les critiques adressées à l'impôt sur les sociétés.
Il y a quelques semaines, la Commission européenne a présenté un projet de directive visant à harmoniser l'assiette de l'impôt sur les sociétés et à consolider sa répartition au sein des États membres. Certes, cette directive sera difficile à appliquer car elle pose des problèmes politiques importants aux pays anglo-saxons, mais elle permettra à la France et à l'Allemagne, en particulier, de se poser la question des assiettes économiques les plus pertinentes, voire d'améliorer la convergence de leurs systèmes. En la matière, avoir une plus grande transparence et une plus forte pertinence en partage est un gage d'efficacité et de compétitivité externe, du fait de l'amélioration de la lisibilité pour les investisseurs internationaux. Le chantier est donc ouvert…
Pour un fiscaliste, le niveau de prélèvements obligatoires n'est pas un indicateur véritablement significatif. Un système de prélèvements qui, tout en remplissant les caisses de l'État, n'obère pas la compétitivité économique internationale, ne doit pas nécessairement être décrié. Il faut évidemment tenir compte des équations économiques, notamment de la croissance. Un niveau de prélèvements obligatoires élevé n'est pas a priori inquiétant pour la santé d'un pays : tout dépend de leur structure et de la pertinence des dépenses ainsi financées.
S'agissant des dépenses fiscales, qui pèsent elles aussi sur nos déficits publics, nous avons entamé une étude approfondie pour déterminer celles qui sont les plus dynamiques, ou les plus datées, ou les moins pertinentes, ou les plus « exotiques ». Le Gouvernement vous rendra sur le sujet un rapport d'évaluation à la fin de ce premier semestre, conformément à la loi de programmation des finances publiques, en vue d'un réexamen éventuel de ces dépenses.
Des entreprises internationalement mobiles sont venues investir ou réinvestir en France grâce au crédit d'impôt recherche. Lors de presque toutes les réunions qu'ils ont avec l'État, les industriels se préoccupent de la lisibilité et de la pérennisation du dispositif, qui est l'un de ceux qu'ils apprécient le plus.
Nous attendons évidemment du crédit d'impôt recherche des retombées en matière de recherche, de développement et d'emploi. Même si l'effet était modeste sur le niveau de la recherche – ce qui ne sera pas le cas, à mon avis –, la réduction d'impôt sur les sociétés ainsi assurée aux entreprises qui conduisent des travaux de recherche profite de toute façon à celles qui sont fortement exposées à la concurrence internationale : ce sont à peu près les mêmes. C'est donc une excellente mesure.
L'investissement des entreprises ne se fait pas forcément en France. Nombre d'entre elles, appartenant notamment à de grands groupes industriels, préfèrent investir dans les pays à forte croissance et certaines entreprises françaises de renom dégagent leurs marges à l'étranger : celles-ci n'ont dès lors aucun impact ni sur l'investissement ni sur l'emploi dans notre pays. Garder un investissement productif en France pour maintenir l'emploi est donc notre souci constant.
Il est techniquement difficile d'établir des statistiques permettant de distinguer entre les investissements selon leur nature – par exemple entre rachats et investissements physiques. Dans les séries qui sont retraitées au niveau national et rapportées aux données d'Eurostat, on observe que le taux d'investissement, rapporté à la même valeur ajoutée industrielle, est légèrement supérieur en France à ce qu'il est en Allemagne mais nettement inférieur à ce qu'on observe en Espagne ou en Italie. Nous nous efforçons de documenter ce point. Par ailleurs, notre investissement dans les technologies de l'information – je parle ici de logiciels d'entreprise, non d'infrastructures – est un des plus bas de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, alors que c'est un facteur de compétitivité. En dépit d'une légère amélioration, nous restons en queue de peloton.
S'agissant du taux d'utilisation de l'outil manufacturier, il s'élevait à 86 % avant la crise de 2008. Il est tombé à 72 % au début de l'année 2009 pour remonter aujourd'hui à 79 %. Nous avons assisté corrélativement à une remontée de la formation brute de capital fixe – l'investissement physique – dans ces mêmes secteurs : alors qu'il s'élevait, avant la crise, à 28 milliards d'euros par an hors secteur énergie, il est tombé durant la crise à 24 milliards pour revenir aujourd'hui à quelque 27 milliards. La décomposition de l'augmentation du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre de cette année révèle que l'investissement y a fortement contribué. À ce rythme, celui-ci devrait avoir retrouvé à la fin de 2011 son niveau d'avant la crise financière.
(M. Marc Laffineur, vice-président, remplace M. le président Bernard Accoyer à la présidence de la séance)
Les très bons chiffres du premier trimestre sont notamment dus au bon niveau de l'investissement des entreprises.
Le faible taux d'utilisation des capacités de production a-t-il pour effet de retarder la reprise des investissements ? À ce stade, la réponse serait plutôt négative, mais la question demeure légitime. Ce faible taux peut avoir des explications diverses : stockage-déstockage, désinvestissement des entreprises… Cela étant, les chiffres les plus récents constituent plutôt de bonnes nouvelles.
Le crédit d'impôt recherche fait également l'unanimité à la direction générale du Trésor. Il est plébiscité pour ses effets sur les comportements des entreprises – sur leur politique d'implantation sur le territoire national ou sur leur effort de recherche. Il ne se résume pas du reste à l'incitation fiscale : il est également une incitation à une meilleure coopération entre les différents acteurs de la recherche et développement. Il entre dans tout un ensemble de mesures de même sens : autonomie des universités, investissements d'avenir…
Non seulement le taux d'effort de recherche privée par rapport au produit intérieur brut est inférieur en France à ce qu'il est en Allemagne – 1,4 % contre 1,9 % –, mais la productivité de notre recherche est également moindre que celle de nos voisins : un euro de recherche et développement en Allemagne génère 60 % de plus de brevets déposés à la fois dans l'Union européenne, aux États-Unis et au Japon, et 30 % de plus de chiffre d'affaires en produits nouveaux. Notre effort est donc inférieur non seulement en valeur absolue mais également pour la manière dont il s'intègre dans l'« écosystème » et en termes de résultats. En rapprochant les différents acteurs, publics et privés, le crédit d'impôt recherche devrait contribuer à améliorer cette situation.
Les acteurs publics venant en soutien aux entreprises ne sont pas nécessairement plus nombreux en France que chez nos partenaires ; nous avons toutefois un effort à faire en vue de les coordonner pour améliorer leur complémentarité, et de les faire travailler en réseau, notamment au niveau local. Ce serait plus efficace que de réduire cette multiplicité pour disposer d'une institution unique. L'élaboration de chartes régionales de l'export va dans ce sens : organiser la coopération entre les chambres de commerce et d'industrie, les structures publiques représentées au niveau local et, plus généralement, tous ceux qui concourent à l'export.
Vous avez auditionné, je crois, Mme Agnès Bénassy-Quéré, directrice du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), qui a produit un rapport sur les investissements internationaux de la France. Notre pays reste une terre d'accueil comme une terre d'origine des investissements. On peut toutefois faire des lectures diverses des données disponibles sur le sujet.
S'agissant de l'évolution du taux des prélèvements obligatoires, les perspectives pour les prochaines années sont inscrites dans le programme de stabilité transmis à Bruxelles après la consultation du Parlement. Après avoir commencé de baisser au début du quinquennat, ce taux remonte légèrement, en raison de la politique de redressement des finances publiques et par l'effet mécanique des mesures que vous avez votées, en particulier de celles qui visent à réduire les niches fiscales. Comme Mme Marie-Christine Lepetit l'a souligné, à taux de prélèvements obligatoires égal, les effets sur la croissance, sur la compétitivité et sur l'emploi peuvent être différents.
Quant à savoir si notre compétitivité s'est améliorée depuis trois ou quatre ans, il est difficile de l'affirmer en raison de la situation extraordinaire que nous avons vécue durant cette période. Nous y verrons un peu plus clair lorsque l'environnement se sera stabilisé. Cela dit, toutes les réformes évoquées par M. Luc Rousseau, par Mme Marie-Christine Lepetit ou par moi-même, notamment celles qui ont porté sur la compétitivité-coût – je pense aux mesures relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance prises depuis 2007 – ou sur la concurrence dans le secteur de la grande distribution, visant à favoriser un comportement de prix plus favorable, doivent se traduire par un redressement de cette compétitivité. Il convient toutefois de poursuivre les efforts. Si le coût de l'accès à l'énergie est plus favorable en France que chez nos voisins, tel n'est pas le cas de l'accès aux transports. Certains des intrants qui concourent à la compétitivité de nos entreprises représentent des atouts, d'autres non. Nous ne pourrons juger des résultats qu'une fois que nous aurons le recul suffisant.
Quelles priorités arrêter en matière de maîtrise des dépenses ? Il faut être attentif à tous les postes, qu'il s'agisse notamment de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie (ONDAM) ou des dépenses de retraite à la suite de la réforme, et ce pour tous les acteurs publics : État, sphère sociale, collectivités territoriales. Nos directions se montrent ainsi vigilantes en ce qui concerne leurs crédits de fonctionnement. Nous n'avons pas le choix. Un effort tous azimuts est requis.

Monsieur Luc Rousseau, vous avez introduit des éléments de stratégie qu'il serait intéressant de développer, s'agissant notamment de la compétitivité-coût.
Un des points importants du rapport de la Cour des comptes est celui qui concerne le pilotage et la cohérence : on y note que les Allemands se tiennent aux décisions stratégiques qu'ils ont prises…
Vous avez également insisté sur la recherche et l'innovation : peut-être pourriez-vous nous fournir quelques compléments d'information sur le sujet.
J'ai été moins convaincu par votre propos sur les filières : n'est-ce pas une notion très française ? Ne conviendrait-il pas de privilégier au contraire la notion de territoire, plus féconde en ce qu'elle favorise les fertilisations croisées ? En effet, si plusieurs de nos voisins, notamment l'Allemagne, ont pris ce parti, c'est qu'elle permet de faire jouer ensemble différents facteurs, d'ordre économique, technique, culturel, au bénéfice d'une dynamique collective que, me semble-t-il, la France n'a pas suffisamment intégrée dans ses systèmes de production de montée en gamme.
Monsieur Ramon Fernandez, vous avez parlé à l'instant d'« écosystème » : n'est-ce pas précisément dans ce cadre que peuvent se développer les nouveaux modes de production ?
Par ailleurs, pensez-vous que les petites et moyennes entreprises profitent du crédit d'impôt recherche autant que les grandes entreprises ?

S'agissant des prélèvements obligatoires, ne conviendrait-il pas d'établir une péréquation entre les entreprises, en fixant un plafond et un plancher de cotisations en fonction du chiffre d'affaires, ce qui permettrait de rééquilibrer leur participation au financement de la protection sociale, entre celles qui créent de l'emploi et celles qui importent ou ont moins de charges ? Il s'agit à mes yeux de propositions de bon sens qui ne sont, pourtant, jamais reprises parce qu'on préfère s'orienter vers des systèmes d'exonération de charges, qui sont trop compliqués pour les petites entreprises, ou vers la « TVA sociale », laquelle n'est pas sans inconvénients comme vous l'avez vous-même souligné.
(M. Christian Blanc remplace M. Marc Laffineur à la présidence de la séance)

Je n'ai pas assisté au début de la réunion mais vous avez été critiques, m'a-t-on dit, sur la « TVA sociale ». Or une précédente audition avait permis de souligner la tendance lourde au recul, dans le financement de la protection sociale, de la part des cotisations reposant sur le travail – 72 % en France à l'heure actuelle – par rapport à celle qui provient de l'impôt – 28 %. Sans pour autant inviter à copier l'expérience limite du Danemark, ne convient-il pas de s'inquiéter du retard pris par la France par rapport à ce mouvement ?
À l'ère de la mondialisation, continuer de financer la protection sociale par le travail ne constitue-t-il pas un grave anachronisme ? Pourquoi la France continue-t-elle de s'accrocher à cette assiette, contrairement à nombre de ses partenaires ?
Il est vrai que le territoire est une priorité : en témoignent les moyens qu'il mobilise, au travers notamment des pôles de compétitivité ou d'autres formes de clusters ou grappes d'entreprises.
La coopération entre entreprises au niveau local permet d'additionner les idées, les compétences et les talents. Elle facilite également la coopération de ces entreprises avec les institutions publiques – je pense notamment aux établissements d'enseignement et de recherche. Pôles de compétitivité et investissements d'avenir, au travers notamment des Instituts de recherche technologique, participent de cette démarche.
Cette interaction concerne l'ensemble de l'écosystème : fournisseurs, compétences humaines – il faut anticiper les besoins en qualifications à échéance de cinq ou dix ans –, financements locaux, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises. Du reste, les pôles de compétitivité ont été pensés à l'intention et autour des petites et moyennes entreprises, même si les grandes en sont des acteurs importants.
Toutefois, certains secteurs, tels que le nucléaire ou la fabrication de matériels de transport, se prêtent plus particulièrement à une logique de filière. Il s'agit de secteurs où le nombre de donneurs d'ordre est très limité et celui des fournisseurs de rang 1, 2 ou 3 très important. Les Allemands nous ont montré le chemin avec leur fédération unique de l'industrie automobile, la VDA (Verband der Automobilindustrie), alors qu'en France, le même secteur se partage entre deux ou trois fédérations. Il existe du reste des projets de réunir constructeurs et équipementiers en vue de définir des stratégies communes, comme dans l'aéronautique. Cela permettrait de concevoir l'automobile de l'avenir comme de réfléchir aux consolidations souhaitables ou à la répartition des tâches entre constructeurs et équipementiers de rang 1 ou 2.
Une meilleure coopération est également nécessaire pour exporter et se développer à l'international. Que ce soit dans l'automobile ou dans le nucléaire, le constructeur doit aller en Inde ou en Chine accompagné de ses fournisseurs pour prospecter efficacement le marché. Les actions de filière doivent donc être renforcées. Les Japonais et les Allemands nous ont malheureusement précédés dans cette démarche.
Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont la première priorité non seulement des pôles de compétitivité mais également des politiques de recherche et développement, même s'il ne faut pas les opposer aux grands groupes car, dans les secteurs que j'ai cités, l'existence de petits fournisseurs dépend de constructeurs implantés sur le territoire national. Toutefois, la politique d'innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ne se limite pas au crédit d'impôt recherche. Contrairement aux grands groupes, elles peuvent bénéficier de nombreux autres outils : Oséo est le meilleur exemple, ces dernières années, d'un regroupement de structures opéré en vue de diminuer le nombre des acteurs. C'est une agence dédiée aux petites et moyennes entreprises dont les moyens sont importants, notamment au service de l'innovation : dispositif « jeunes entreprises innovantes », dispositif « ISF-PME ». La comparaison entre ce qui est fait pour les petites et moyennes entreprises et ce qui est fait pour les grands groupes ne doit donc pas se limiter au seul crédit d'impôt recherche.
S'agissant du soutien à l'export, il est clair pour l'État que le redressement de notre commerce extérieur passe d'abord par un renforcement de nos petites et moyennes entreprises. La création d'UbiFrance a exigé de notre administration qu'elle se scinde en deux puisque nous avons détaché quelque 1 000 agents auprès de cette agence complètement dédiée aux petites et moyennes entreprises. Si les résultats sont encourageants pour ce qui est de l'organisation de salons et de déplacements, la réforme est encore trop récente pour se traduire plus concrètement : nous achevons à l'heure actuelle la dévolution aux agences d'UbiFrance de l'ancien réseau à l'exportation de la direction générale du Trésor. Il faut savoir que nos agents devaient se disperser auparavant entre une multitude de missions que la création d'UbiFrance a permis de séparerrépartir plus équitablement.
D'autres mesures spécifiques aux petites et moyennes entreprises ont été prises dans le cadre de la Coface : suppression des frais de dossier, avances sur indemnité pour les très petites entreprises (TPE). Le Parlement a même créé la catégorie des entreprises de taille intermédiaires en 2007 et 2008, afin de valoriser le rôle très important que jouent les entreprises de taille intermédiaire entre les TPE-PME et les grands groupes.
Il est vrai que les charges pesant sur le travail sont plus lourdes en France que chez nos voisins et nous ne nous en satisfaisons pas. Toutefois, les solutions pour y remédier présentent toutes des inconvénients et leurs objectifs peuvent être divers : il faut alors faire des choix, par exemple entre compétitivité, emploi et pouvoir d'achat. La question de la « TVA sociale » entre dans ce débat : comme l'a montré le rapport de 2007 de Mme Christine Lagarde et de M. Éric Besson, son instauration ne serait pas sans conséquences et son succès dépend de conditions bien précises.
Je ne me prononce pas sur les mesures prises en la matière par les Allemands, en 2007 : les conditions étaient très particulières, ce qu'on dit rarement. En effet, ils ne se sont pas contentés d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée pour baisser les cotisations : ils ont augmenté leur taxe sur la valeur ajoutée qui était plus basse que la nôtre, partiellement baissé les cotisations et redressé les comptes publics.

Je vous remercie, madame, messieurs. Surtout, n'hésitez pas à être iconoclastes chaque fois que vous le pourrez. Nous avons besoin d'innover.
S'agissant des coûts de production, nous avons reçu des chefs d'entreprise qui disaient y être indifférents parce qu'ils fabriquent des produits à haute valeur ajoutée. Pour d'autres au contraire, la question est vitale. Or nous adoptons des législations et des réglementations qui valent pour tous !
Je voudrais donc soulever une double question – iconoclaste, précisément : afin d'être plus efficaces, ne faudrait-il pas adopter des stratégies complexes, adaptées à la diversité des situations, avec des sous-stratégies en défense et en attaque, comme le pratiquent les entreprises ? Ou devons-nous continuer d'adopter des législations uniformes et indifférenciées, autorisant tout au plus des ajustements ? Nous n'y répondrons toutefois pas aujourd'hui !
La séance est levée à dix-sept heures cinquante.