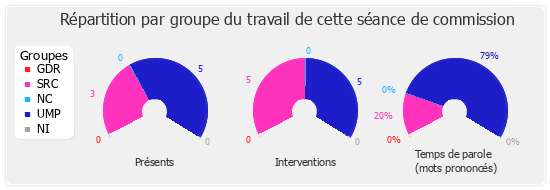Mission d'information assemblée nationale-sénat sur les toxicomanies
Séance du 2 février 2011 à 16h00
La séance
Mission d'information SUR LES TOXICOMANIES
Mercredi 2 février 2011
La séance est ouverte à seize heures quinze.
(Présidence de M. Serge Blisko, député, coprésident et de M. François Pillet, sénateur, coprésident)
La Mission d'information sur les toxicomanies organise une table ronde, en audition ouverte à la presse, réunissant des représentants d'associations : M. Jean-Pierre Couteron, président de Fédération addiction, M. Pierre Chappard, président d'Act-up Paris, M. Fabrice Olivet, directeur général d'Auto-support des usagers de drogues, M. Jean-Paul Bruneau, président d'Espoir du Val d'Oise, Mme Lia Cavalcanti, directrice générale d'Espoir Goutte d'Or, M. Richard Maillet, président de la Fédération nationale des associations de prévention de la toxicomanie, Mme Nadine Poinsot et M. Philippe Poinsot, coprésidents de l'association Marilou, M. Olivier Maguet, consultant en action sociale et santé, membre du conseil d'administration de Médecins du monde et M. Jean-François Corty, directeur des missions France de Médecins du monde, M. Jean Canneva, président de l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques, et M. Pierre Leyrit, directeur général de Coordination toxicomanies 18.
L'association Marilou - Pour les routes de la vie, que nous avons créée avec ma femme en 2002, se préoccupe de sécurité routière et a notamment inspiré, avec M. Richard Dell'Agnola, député, qui avait déposé une proposition de loi en ce sens, la loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. C'est par le biais de nos interventions dans les collèges et les lycées sur le thème de la sécurité routière que nous sommes amenés à faire de la prévention en matière de toxicomanie.
Nous voudrions parler ici surtout du cannabis, drogue très consommée chez les jeunes, qui en ont une image valorisante et la perçoivent comme un moyen d'identification à un groupe. Nous pensons que des campagnes de communication faisant passer ses consommateurs pour des « blaireaux » pourraient casser cette image et faire diminuer notablement la consommation car beaucoup de jeunes consomment pour « faire les malins ». Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui a été fait, avec un certain succès, en matière de sécurité routière – un jeune en scooter roulant à toute allure et sans casque était traité de « gros blaireau » par ses copains ? Nous sommes bien entendu convaincus que la dépénalisation ou la légalisation de l'usage de stupéfiants en ferait exploser la consommation, comme cela a été observé dans d'autres pays.
Nous avons créé cette association après que notre fille eut été tuée par un délinquant de la route qui conduisait sans permis et sous l'emprise de cannabis – et de cannabis seulement, je le précise. Toute dépénalisation ou légalisation de l'usage de ce produit, comme l'ouverture de « salles de shoot » pour d'autres drogues, serait profondément néfaste. Elle accentuerait le laxisme général dont notre fille, et hélas tant d'autres, ont été des victimes et qui, depuis 1968, prévaut dans notre société tout entière, des autorités publiques jusque dans les familles où les parents ont souvent démissionné. Que de mal a fait le fameux slogan « Il est interdit d'interdire », que nous ne pouvons que réprouver en tant qu'éducateurs et parents de cinq enfants !
Pour tous les stupéfiants, y compris l'alcool que, même s'il est autorisé, nous considérons comme la première drogue en France, il faut poser des interdits fermes. Dès la première transgression, une sanction doit être prononcée de façon à bien marquer les limites, lesquelles ne peuvent qu'être floues quand des hommes politiques, dont M. Lionel Jospin à l'époque, ont pu dire qu'il était moins grave de fumer un « pétard » que de boire un verre de vin avant de prendre le volant. Comment les jeunes pourraient-ils s'y retrouver ? Si le cannabis, considéré à tort comme une drogue douce, venait à être dépénalisé ou les « salles de shoot » autorisées, le brouillage du message qui en résulterait conduirait à une catastrophe en matière de délinquance, routière et générale. Tout notre travail, comme celui de beaucoup d'autres associations, serait réduit à néant. Il n'y a pas d'autre solution selon nous que de délivrer un message ferme d'interdiction. Une grande campagne en ce sens serait nécessaire en direction des jeunes, avec des mots clairs et directs.
Je représente, avec M. Jean-François Corty, l'association Médecins du monde, que vous connaissez tous. Les utilisateurs de drogues constituent, au même titre que d'autres personnes éloignées du système de soins, des populations cibles de certains de nos programmes. Nos missions dites de réduction des risques représentent 6 à 8 % de notre activité en France et dans le monde.
Médecins du monde n'a pas vocation à prendre en charge les toxicomanes sur le plan thérapeutique. Nous cherchons plutôt à anticiper et prévenir les conséquences sanitaires de l'usage de drogues, par quoi nous entendons des substances psychoactives dont la cession, la détention et la consommation sont illicites au regard des lois nationales ou des conventions internationales. Nous ne prodiguons de soins aux toxicomanes ni en France ni à l'étranger et ne préjugeons d'aucune option thérapeutique – traitement de substitution, sevrage ou séjour dans une communauté thérapeutique –, dont le choix relève des professionnels. Toutes sont possibles pourvu qu'elles respectent les standards des bonnes pratiques professionnelles validées notamment par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec le programme des Nations Unies de lutte contre le sida, ONUSIDA, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. Ces trois instances ont édité des guides de bonnes pratiques pour les traitements de substitution aux opiacés et les dynamiques de sevrage.
Se voulant d'abord pragmatique, Médecins du monde intervient en amont pour établir un lien avec les usagers de drogues, dont la pratique est toujours criminalisée, les informer et les conseiller afin de réduire les risques, à la fois individuels et collectifs. Dans cette logique, nous mettons à leur disposition information, conseils, services et outils – parmi lesquels des traitements de substitution aux opiacés qui présentent l'avantage de faire passer d'une consommation illégale de rue – avec tous les risques associés – à une consommation plus propre. Nous ne portons jamais de jugement sur ceux que nous recevons : c'est d'ailleurs volontairement que nous parlons de manière neutre de « personnes utilisant des drogues ». En tant qu'organisation humanitaire médicale généraliste, nous cherchons sur le strict plan de la santé publique à réduire les risques infectieux et partant, les coûts, directs et indirects, socio-économiques et sanitaires résultant des pratiques de ces personnes. Nous intervenons également, de la même façon et avec le même objectif, à l'étranger. Je suis ainsi responsable de notre mission « Réduction des risques » en Afghanistan.
Médecins du monde a toujours innové. Dès 1987, nous ouvrions le premier centre de dépistage anonyme et gratuit du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) à Paris, initiative reprise par les pouvoirs publics deux ans plus tard avec la généralisation de tels centres partout en France. En 1989, nous engagions le premier programme d'échange de seringues, alors que l'accès à un matériel stérile d'injection n'allait être autorisé par la loi que six ans plus tard. Enfin, c'est la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui a fait de la réduction des risques un objectif sanitaire relevant, entre autres, de l'État.
Dans cette logique, nous continuons à agir au plus près du terrain en adaptant en permanence nos dispositifs. Nous développons actuellement un programme d'éducation aux risques liés à l'injection de drogues, en particulier pour prévenir la contamination par le virus de l'hépatite C, dont la prévalence est toujours assez forte. Diverses études épidémiologiques, notamment de l'Institut de veille sanitaire, montrent que les stratégies de réduction des risques ont permis de limiter la transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), un peu moins celle du virus de l'hépatite C, qui se transmet plus facilement. Nous cherchons donc, nous gardant de toute approche morale ou idéologique, à limiter les risques sanitaires encourus par les usagers de drogues, ce qui ne signifie pas que nous niions les autres risques de la prise de drogues. Et nous continuons d'innover, sachant que nos innovations ont souvent été reprises par les pouvoirs publics.
Je souhaite insister sur deux points. Tout d'abord, alors que la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, rattachant les services de soins en prison au ministère de la santé, a posé le principe d'égalité et de continuité des soins pour tous nos concitoyens, y compris les détenus, force est de constater que ce principe n'est pas respecté. L'échange de seringues n'est toujours pas autorisé en prison, ce qui est contraire à la volonté exprimée par le législateur en 1994.
Ensuite, on ne peut faire abstraction du contexte plus général dans lequel nous travaillons aujourd'hui et que caractérise un certain paradoxe sanitaire. Il existe une contradiction croissante entre d'un côté, les progrès considérables réalisés en matière de santé publique, grâce à des dispositions législatives et des moyens financiers pour la prise en charge de populations assez éloignées du système de soins et, de l'autre, les blocages créés par l'application de dispositions pénales dont le poids et l'étendue se renforcent, notamment depuis quelques années, entravant – nous en avons des exemples quotidiens dans nos centres – l'accès aux soins de ces populations. Je ne reviens ni sur les récentes mesures relatives à l'accès à l'aide médicale d'État, ni sur celles de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui rendent plus difficile d'intervenir auprès des personnes se prostituant. Je porte simplement à votre connaissance qu'hier, à Mayotte, une maman sans papiers a été arrêtée avec son bébé de six mois à la sortie de l'un de nos centres. Ce paradoxe, nous nous y heurtons quotidiennement dans la prise en charge des utilisateurs de drogues.
L'association Coordination toxicomanies 18 a été créée il y a une dizaine d'années dans le contexte des crises récurrentes que provoquait une concentration de polytoxicomanes usagers de crack dans le nord-est parisien. Elle a un triple objectif. Tout d'abord, fédérer l'ensemble des intervenants médico-sociaux sur le territoire concerné pour mieux prendre en charge ce public marginal, en grande errance. Ensuite, répondre à une attente des habitants qui, face aux difficultés rencontrées, remettaient en cause les dispositifs de réduction des risques : tout un travail d'information, de sensibilisation et d'éducation est nécessaire pour modifier la représentation qu'ils ont de ces usagers de drogues. Enfin, mieux connaître les actions menées par l'ensemble des institutions afin de mieux les coordonner car il arrive aujourd'hui qu'elles soient contradictoires.
Depuis dix ans, les évolutions législatives, avec l'inscription dans la loi de l'objectif sanitaire de réduction des risques, et les évolutions institutionnelles, avec la mise en place des agences régionales de santé, ont creusé le fossé entre les approches médicale et sociale, alors même que les personnes concernées vivent dans une très grande précarité. Il faut réfléchir aux conséquences de la révision générale des politiques publiques et de l'approche que les agences régionales de santé auront de la toxicomanie. Il y a là un problème concret d'articulation des politiques publiques.
La population du quartier éprouve de nouveau un très fort sentiment d'impuissance car elle ne perçoit pas d'améliorations. Elle doute de l'efficacité de l'approche pénale et judiciaire. Elle est en revanche pleinement consciente de l'insuffisance des actions médico-sociales, qu'elle considère pourtant comme l'un des éléments à même de ramener la tranquillité dans le quartier. Elle ressent, comme nous, la contradiction croissante entre approche pénale et approche médico-sociale. Cela explique d'ailleurs que sa représentation des drogues et de leurs usagers soit devenue plus ambivalente.
Brésilienne d'origine mais Française d'adoption, je dirige l'association Espoir Goutte d'Or qui travaille depuis vingt-quatre ans dans le quartier populaire de la Goutte d'Or, situé au nord de Paris, où je vis moi-même depuis trente ans. L'originalité de l'association est d'être née de la volonté des habitants de ce quartier particulièrement défavorisé, investi par les consommateurs et les trafiquants de drogues. Au début des années 1980, alors que débutait l'épidémie de SIDA, toutes les familles de la Goutte d'Or étaient, de près ou de loin, touchées, et se sentaient impuissantes.
L'un de nos objectifs était précisément de lutter contre ce sentiment d'impuissance en apportant des réponses originales. Espoir Goutte d'Or a ainsi été la première association accueillant des usagers de drogues à s'implanter au coeur du lieu des trafics. Je suis en effet convaincue que l'offre de soins doit être proposée là même où l'est la drogue. C'est corps à corps, pour ainsi dire, qu'il faut contrer les trafiquants en offrant une alternative à la consommation – sans jamais juger ceux que nous recevons.
L'association se compose aujourd'hui de deux établissements, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. En 2009, le premier a reçu 5 032 personnes et le second 397, en majorité des consommateurs de crack. Je n'insiste pas sur l'extrême difficulté de recevoir plus de 5 000 personnes par an dans des locaux exigus, où les salles de consultation ne font pas plus de trois à quatre mètres carrés. Les conditions de travail sont éprouvantes pour les personnels – médecins généralistes, psychiatres, assistantes sociales… –, mais ceux-ci sont extrêmement motivés.
Parmi le public accueilli, on compte 84 % d'hommes et 16 % de femmes. Leur moyenne d'âge, qui va augmentant, s'est établie en 2010 à 39 ans. C'est là une conséquence, heureuse, de la politique de réduction des risques : dans les premières années, elle n'était que de 26 ans !
Parmi les usagers de drogues reçus au centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, 89 % sont sans travail, et ce taux a augmenté ces dernières années. En 2009, 68 % d'entre eux avaient déjà été en prison, contre 60 % l'année précédente. En outre, 27 % n'ont aucun logement, 30 % vivent dans un logement précaire et 8 % vivent dans des « squats », dont le nombre se multiplie.
La problématique est quelque peu différente au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie où les personnes accueillies s'inscrivent dans une démarche de soins et acceptent les contraintes des protocoles thérapeutiques, qui exigent par exemple de passer tous les jours à l'association. Nous nous battons contre l'hépatite C, mais comment faire quand le protocole de soins des hépatites exige que le patient dispose d'un hébergement ? 46,7 % de ceux que nous recevons n'ont pas de domicile fixe. Vous imaginez sans mal l'extrême difficulté de soigner des personnes dont seulement 28,3 % ont un logement stable. Seules 9,1 % disposent de revenus du travail. Sans ressources, beaucoup n'ont pas la moindre couverture sociale, ce qui complique encore la situation. En effet, il nous est impossible, car il est alors déclaré irrecevable, d'ouvrir un dossier aux personnes sans revenus d'aucune sorte. Elles sont pourtant 40,9 % dans ce cas au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie – contre 31 % au centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
La situation dramatique de cette population totalement démunie invite, je le crois, à une réflexion politique plus large. Ces personnes sans travail n'ont jamais travaillé, n'ont aucune formation et, pour beaucoup, présentent de graves pathologies, somatiques et psychiques. Comment permettre qu'elles cohabitent harmonieusement avec les familles du quartier dont nous défendons aussi la qualité de vie et le droit à vivre dans la tranquillité ? D'où la question qui se pose aux pouvoirs publics d'autoriser ou non des salles de consommation de drogues. Ce sont ces personnes qui n'ont pas de domicile pour consommer qui les fréquenteraient. Nous avons une lourde responsabilité à prendre en la matière, vous, politiques, et nous, acteurs de terrain.
La fédération que je préside regroupe plusieurs associations ayant pour principal objet la prévention de la toxicomanie en milieu scolaire.
La population qui nous importe et nous tient à coeur, dont on ne parle jamais, est celle qui ne consomme pas de drogue ou encore peu. Si certains jeunes se droguent parce qu'ils ont des problèmes, d'autres y viennent par simple curiosité, pour faire comme les autres, pour « frimer » ou rechercher des sensations nouvelles. Trois grandes raisons nous paraissent expliquer les évolutions observées.
Tout d'abord, les jeunes n'ont plus peur des stupéfiants. Pourquoi ? C'est un fait que depuis 1998, on a plus ou moins délaissé la prévention au profit d'une politique de maîtrise de la consommation, qui s'est traduite sur le terrain par une incitation à consommer. L'ouvrage Drogues : savoir plus, risquer moins, édité et réédité par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, la MILDT, a été vu par les jeunes comme un moyen d'en savoir plus pour consommer plus, tout en pensant risquer moins. Y est opérée une distinction entre « drogues douces » et « drogues dures », ainsi qu'entre usage simple et usage nocif, qui laisse croire qu'il est sans danger de consommer occasionnellement certaines drogues, notamment du cannabis. L'ouvrage contient également un mode d'emploi de toutes les substances et vante les effets thérapeutiques du cannabis, à l'époque pourtant rejetés aussi bien par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et l'Académie nationale de médecine en France que par la Cour suprême aux États-Unis. Il avance enfin que la drogue constituerait une fatalité dans notre société. Ce discours a conforté l'attitude des consommateurs réguliers, encouragé la récidive des expérimentateurs et placé les non-consommateurs dans une situation intenable. Certains d'entre eux ont commencé à se droguer par peur de passer pour des arriérés ou des poltrons. Les « flyers », tracts dits préventifs édités par diverses associations et distribués dans les centres de jeunesse ont eux aussi contribué à l'explosion à la fois du nombre de consommateurs et de la consommation, en même temps qu'ils facilitaient le passage d'une drogue à une autre, conduisant à la polyconsommation aujourd'hui observée. En tolérant la consommation occasionnelle, non seulement on ne dissuade pas les jeunes de se droguer mais on incite même certains à croire qu'ils pourront « gérer » leur consommation de cannabis ou de cocaïne, comme ils pensent le faire de l'alcool et du tabac. D'ailleurs, leur phrase fétiche n'est-elle pas « T'inquiète, je gère » ?
En 1996, les chefs d'établissement nous demandaient d'intervenir en seconde et en troisième ; en 1999, en quatrième et en cinquième, et en 2002, en CM2 ! Non seulement la consommation a explosé mais l'âge des premières consommations s'est abaissé à 9 ou 10 ans.
Une autre raison pour laquelle les jeunes prennent de la drogue est que c'est « branché ». Sur ce point, j'appelle votre attention sur l'influence néfaste des médias. Combien de fois n'ai-je entendu le soir, rentrant de réunions de prévention avec des parents et des professeurs, des vedettes du spectacle, du monde musical ou des présentateurs de télévision tenir des propos banalisant, voire valorisant l'usage des drogues ? Où est la cohérence ?
Les jeunes se droguent aussi parce qu'aucune sanction n'est jamais prononcée à l'encontre ni des simples usagers ni des petits « dealers ». À Lille, le proviseur d'un lycée où nous avions mené des actions de prévention nous a demandé si nous pouvions agir pour que cessent les petits trafics à la sortie de son établissement. Nous avons saisi la brigade des stupéfiants qui, en dépit de ses promesses, n'est jamais intervenue. Et le préfet lui-même, auquel nous nous sommes finalement adressés, nous a avoué n'être pas certain de pouvoir faire quelque chose. Le petit trafic de stupéfiants continue donc, alors même que la loi le réprime plus sévèrement, et c'est heureux, à la sortie des établissements scolaires.
La circulaire dite « Guigou » du 17 juin 1999 relative aux réponses judiciaires aux toxicomanies, toujours en vigueur, qui enjoint aux parquets de ne plus poursuivre les usagers, rend impossible toute application de la loi du 31 décembre 1970. Certaines stations de radio – vous savez comme moi lesquelles – n'hésitent pas à diffuser des messages banalisant l'usage des drogues. Certains groupes français de rap ou de reggae leur emboîtent le pas, incitant dans leurs chansons à la consommation. Certaines émissions de télévision et certains films vont dans le même sens. Je pense à Lol, film dans lequel les policiers eux-mêmes consomment du cannabis. Pis : dans Le petit lieutenant, une affiche en demandant la légalisation trône dans le bureau d'un policier qui en fume ! Il y a enfin les supports écrits, comme les ouvrages des Éditions du Lézard, de L'Esprit Frappeur ou encore des Éditions Georg qui, liés au lobby des drogues, incitent à la consommation et n'en sont pas moins vendus en toute impunité. Si on ne peut guère contrer internet pour l'instant, peut-être pourrait-on empêcher la circulation de ces ouvrages en librairie.
Que proposons-nous ? Tout d'abord, de revoir la circulaire dite « Guigou » de 1999. Ensuite, de renforcer les dispositions de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique qui répriment toute incitation, directe ou indirecte, à la prise de drogues – et qu'on ne nous dise pas que cela porterait atteinte à la liberté d'expression ! Enfin, ne surtout pas autoriser l'ouverture de centres de consommation supervisés. Cela adresserait un signal désastreux, fatal à la prévention, déjà très difficile pour les raisons que j'ai indiquées. On nous dit que de telles salles se justifieraient dans un souci de réduction des risques. Mais le premier des risques, c'est le développement de la toxicomanie par la banalisation de l'usage des drogues qui en résulterait. Les jeunes ont encore peur de l'héroïne, drogue chère, qui n'est pas à la mode et demeure assez difficile à se procurer. Les « salles de shoot », banalisant sa consommation, modifieraient cette représentation, amenant certains à se dire « si c'est permis par l'État, pourquoi pas nous ? ». Nos arguments, qui ont pourtant fait leurs preuves, seraient balayés par l'État qui, organisant lui-même une consommation encadrée de substances interdites, signifierait qu'il renonce à la lutte contre la drogue. L'Académie nationale de médecine vient de se prononcer contre l'ouverture de telles salles et, dans son rapport de 2009, l'Organe international de contrôle des stupéfiants recommandait aux États qui en avaient ouvert de les fermer.
C'est de ceux qui ne consomment pas ou encore peu que j'ai voulu ici prendre la défense. Autant dire que si des « salles de shoot » devaient ouvrir dans notre pays, nous n'aurions plus qu'à arrêter tout travail de prévention.

Notre mission d'information, même si elle sera amenée à en traiter puisque la question a été versée dans le débat public, a un objet beaucoup plus large que les seuls centres de consommation supervisés.
L'union que je préside regroupe quelque 15 000 familles et 45 000 aidants de proximité de malades souffrant de graves troubles psychiques, essentiellement des psychoses. Notre plate-forme téléphonique reçoit plus de 10 000 appels par an.
C'est un fait que 95 % des schizophrènes ont fumé du cannabis. S'il est impossible de dire ce qui a déterminé quoi, on ne peut pas soutenir qu'il n'existe pas de lien entre les deux. Des jeunes sans problèmes psychiques « disjonctent » soudain, simplement après avoir fumé du cannabis. Cette consommation n'est peut-être pas la seule cause de leur problème comportemental mais pour des personnalités fragiles, elle est sans doute un facteur déclenchant.
Une fois la maladie déclarée, nous veillons à ce qu'elle n'accentue pas l'isolement social des malades et, surtout, ne les conduise pas à la rue. Mais ils ont tendance à se cacher, leurs familles aussi d'ailleurs – cela explique sans doute que si peu soit fait pour les malades mentaux qui pourtant vivent aujourd'hui à 95 % au milieu de nous, plus de 100 000 lits de psychiatrie ayant été supprimés au fil des ans. Le deuxième point auquel nous portons une attention particulière est l'observance du traitement, dont l'arrêt présente un risque majeur. Enfin, nous surveillons la consommation de substances addictives, y compris l'alcool, qui aggrave considérablement les symptômes et peut notamment rendre violentes des personnes qui ne l'ont jamais été. Il est probable que les drogues et la maladie agissent sur les mêmes parties du cerveau puisqu'elles provoquent des dysfonctionnements semblables, notamment des délires. On n'est pas encore en mesure de l'expliquer sur le plan scientifique, mais nous le constatons quotidiennement. Les spécialistes des maladies mentales ont d'ailleurs une compétence particulière en matière de drogues et d'addictions.
Nous vous supplions donc d'expliquer aux jeunes quels risques considérables ils prennent en se droguant. Leur faire rencontrer des malades psychotiques les ferait peut-être réfléchir à deux fois avant de commencer, surtout si on les informait qu'on ne guérit pas d'une psychose.
Dans l'espoir de lever le tabou entourant la maladie mentale, je n'ai cessé de demander au Président de la République que soit adopté un plan de prévention et d'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques, ce qui a finalement été le cas en Conseil des ministres du 26 janvier dernier.
Espoir du Val d'Oise est une association que j'ai créée il y a vingt-trois ans quand j'étais encore à la brigade des stupéfiants et que je menais déjà des actions de prévention en milieu scolaire. L'association héberge gratuitement, pour une certaine durée, vingt-six usagers de drogues dépendants, désireux d'arrêter la prise de toute substance et de se réinsérer socialement sans recourir aux produits de substitution. Je vous invite à venir les rencontrer. Ils seraient heureux d'échanger avec vous sur ce qu'il faudrait faire, notamment pour éviter certains dérapages. Ils m'accompagnent dans les établissements scolaires où nous faisons de la prévention auprès de dix mille élèves environ chaque année.
Dans le cadre des lois du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il conviendrait de donner plus de sens aux sanctions prévues pour le simple usage de drogues en distinguant entre ceux qui ne sont pas encore dépendants, ceux qui commencent à le devenir et ceux qui le sont totalement.
Pour les usagers qui ne se droguent encore que pour braver l'interdit ou fuir leur mal-être, il faudrait prononcer une sanction immédiate à visée éducative. Aujourd'hui, cette sanction, souvent différée, se limite la plupart du temps à un avertissement ou une injonction thérapeutique peu contrôlable et qui, dans plus de 90 % des cas, demeurent sans suite. Il serait plus pertinent de leur infliger une amende de composition pénale d'un montant modique, évolutive en cas de récidive, équivalente à celle infligée pour un défaut de port de ceinture de sécurité mais accompagnée d'un enregistrement au fichier des infractions à la législation sur les stupéfiants afin de repérer les récidives et imposer, en ce cas, des mesures complémentaires comme un stage de sensibilisation ou un travail d'intérêt général dans des structures accueillant des malades dépendants en rétablissement.
Les usagers dépendants avérés, identifiables par le biais du fichier des infractions à la législation sur les stupéfiants et suivis dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ne devraient pas faire l'objet de poursuites pénales mais d'une obligation de soins contrôlée. En contrepartie de l'absence de sanction, ils ne pourraient demeurer anonymes. L'injonction thérapeutique contrôlée a un sens si elle s'accompagne d'une obligation de résultat à moyen terme, pour l'usager comme pour la structure chargée du suivi.
Pour ce qui est des malades dépendants chroniques, dont l'état physique et psychique est si dégradé qu'ils ne peuvent d'emblée s'engager dans une démarche de soins, il importe, à tout le moins, de ne pas leur faciliter la consommation de substances illicites. Dans leur intérêt et celui de la collectivité, il faudrait leur proposer un accompagnement en centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie – certainement pas en centre de consommation supervisé – avec des produits adaptés à leur addiction. Pourquoi pas de la méthadone injectable pour remplacer l'héroïne chez ceux qui sont si dépendants de l'injection qu'ils s'injectent de tout, y compris des substituts, ou de nouveaux produits de substitution ayant des effets proches des produits illicites mais classés comme médicaments ? On propose bien aux malades dépendants au jeu, à l'alcool ou au tabac des produits psychoactifs contrôlés pour les aider à se sevrer. Pourquoi ne pas faire de même avec les usagers de drogues ? Mais l'héroïne, la cocaïne et autres stupéfiants doivent impérativement demeurer interdits pour ne pas créer de confusion. Il serait nécessaire aussi, pour ce public très marginalisé, de renforcer l'accueil de nuit dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ce qui supposerait de réduire parallèlement le temps d'accueil en journée.
J'ajoute qu'en menant toutes ces actions, il faudrait veiller à ce que les victimes d'autres addictions n'aient pas le sentiment que les usagers de drogues bénéficient d'un traitement privilégié.
L'ouverture de centres de consommation supervisés, quant à elle, soulèverait de multiples problèmes. Qu'en serait-il par exemple des poursuites pénales en cas de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits illicites consommés légalement dans un de ces centres ? Comment distinguerait-on ceux qui, habiles manipulateurs, ne viendraient consommer dans un centre que pour y être à l'abri des poursuites ? Enfin, la dépense supplémentaire qui résulterait pour le budget de l'État de la création de ces centres serait-elle prioritaire par rapport à celle nécessaire à la mise en place des communautés thérapeutiques prévues dans le plan de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui se font attendre ? Depuis cinq ans, on manque cruellement de places pour ceux qui veulent en finir avec toute addiction.
Pour plus de détails sur l'ensemble nos propositions, je vous invite à vous reporter au document remis au secrétariat de votre mission.
Après les déclarations de mon voisin, je crains de me faire arrêter à la fin de cette séance !
L'association que je représente est une association d'usagers de drogues, consommateurs, ex-consommateurs et usagers du système de soins lié à la toxicomanie. Elle était initialement consacrée à la lutte contre le SIDA. C'est du reste dans le contexte de cette épidémie que la politique de réduction des risques a été introduite, dans les années 1990, alors que le seul horizon était jusqu'alors le paradigme du sevrage et de l'abstinence – horizon auquel il semble du reste qu'on veuille aujourd'hui nous ramener. La réduction des risques suppose de ne pas porter de jugement moral sur la consommation, mais de trouver des solutions pragmatiques pour remédier aux conséquences somatiques de l'usage de drogues, comme la fourniture de seringues stériles, l'éducation à l'injection et l'auto-support.
L'approche classique de la toxicomanie identifie un fléau – la drogue – considéré comme un agent autonome véhiculé par des trafiquants à la sortie des écoles et détruisant des vies. Cette approche privilégie la logique de l'offre.
La réduction des risques, quant à elle, ne porte aucun jugement moral sur l'usage de drogues et ne considère pas les substances comme des agents pathogènes, mais privilégie plutôt la logique de la demande, en insistant sur les différents niveaux de consommation validés par la science : usage, abus et dépendance. Cette approche insiste sur la responsabilité des usagers qui choisissent de consommer tel produit selon les circonstances de leur vie – ce qui peut certes être dramatique, notamment quand la consommation est une manière d'échapper à la folie ou au suicide, mais ce n'est pas toujours le cas.
L'Auto-support des usagers de drogues, qui existe depuis 1993, a construit un partenariat avec les professionnels du soin et les pouvoirs publics en vue d'un double but : l'information des usagers de drogue, notamment au moyen de « flyers » – qui, je le précise, ne sont pas distribués dans les écoles – et la lutte contre la discrimination sociale dont souffrent les usagers de substances illicites.
La réduction des risques est une approche qui considère les usagers de drogues comme des personnes responsables et capables de gérer les risques liés à leur consommation. L'exemple historique à cet égard est le décret dit « Barzach » du 13 mai 1987 qui a autorisé la commercialisation des seringues et été suivi, en six mois, par une très forte baisse de consommation. La droite est à l'origine des principales mesures de réduction des risques, mais cette approche suscite néanmoins des critiques de part et d'autre. À gauche prévalent plutôt la victimisation et les explications sociales, l'usage de drogues étant souvent présenté comme une excuse à des comportements délinquants, ce qui est antinomique avec la responsabilité et invalide la question des devoirs qui s'imposent aux usagers comme à tous les citoyens. À droite prime une vision morale de l'usage des drogues, souvent assimilé à une déchéance et à une perversion et considéré comme un acte condamnable, ce qui invalide la question des droits que défend notre association. Dans les deux cas, il y a peu de place pour la responsabilité d'usagers susceptibles d'assumer un statut de citoyen.
Bien qu'elle soit largement passée sous silence, la catastrophe sanitaire provoquée par le décret du 13 mars 1972 qui interdisait la vente de seringues en pharmacie – dont les signataires sont en partie les promoteurs de la loi du 31 décembre 1970, parmi lesquels le ministre de l'intérieur de l'époque, Raymond Marcellin – est un exemple caricatural de l'impact de l'idéologie dominante et des bonnes intentions. Cette politique a fait des milliers de victimes, contaminées par le VIH et le virus de l'hépatite – notamment des membres de notre association, y compris moi-même. En matière de drogues, les options rationnelles et scientifiques passent souvent après les options morales.
Le mot « toxicomanie », incompréhensible dans les conférences internationales, où l'on utilise les termes anglo-saxons de « drug use » et « drug abuse », a été forgé au XIXe siècle. La catastrophe que je viens d'évoquer a illustré l'échec historique de ce concept-roi des années marquées par l'héroïne, l'injection et l'épidémie de SIDA. Au début du XXIe siècle, qui a vu l'avènement de la science hospitalo-universitaire des addictions, ce terme devrait être banni et remplacé celui d'« usage de drogues » ou d'« addictions ». Il faut rompre avec l'idéologie qui a fait naître ce concept et passer à une autre étape, mais il semble que l'on veuille forger un nouveau paradigme pour revenir aux années 1970.
Je formulerai encore deux réflexions politiquement incorrectes. Tout d'abord, l'idée que l'équilibre résiderait dans l'abstinence de toute drogue est erronée. Pour la grande majorité des usagers, notamment les jeunes et les usagers récréatifs, l'idéal recherché est précisément cette récréativité – même si elle est à risque et fait parfois basculer dans la dépendance. Il en va de même, au demeurant, pour l'alcool. Chaque drogue possède son propre potentiel addictogène, variable selon l'individu et que chacun fait varier selon ses propres objectifs de consommation.
Par ailleurs, lorsqu'il est question de l'usage de substances, il est difficile de sortir du débat sur les valeurs. L'usage de drogues relève autant de la culture que de la science et moins les usagers possèdent d'outils culturels pour gérer cet usage, plus celui-ci est brutal pour eux-mêmes et pour les autres. Il faut donc sortir des solutions proposées par la technocratie médicale, qui a validé des décisions criminelles comme celle qui a conduit au décret du 13 mars 1972, dont la philosophie a été confirmée en 1985, en pleine épidémie de SIDA. La question centrale est bien celle de la liberté, de la fraternité et de la sécurité : est-il juste d'autoriser certains types de consommation et défendable de protéger la liberté générale et le droit de disposer de son propre corps ?
Psychologue clinicien et président de Fédération addiction, qui rassemble depuis peu une association consacrée à l'alcool et une autre consacrée à la toxicomanie, je consulte depuis vingt-cinq ans dans le quartier du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. J'y recevais ce matin encore de jeunes consommateurs de cannabis – j'ai d'ailleurs été parmi les premiers à en recevoir en 1999, alors qu'ils ne relevaient pas encore des missions des centres de consultation.
Le risque psychiatrique n'est que l'un des enjeux liés à la consommation de cannabis. Les risques de cette consommation sont réels sur la route ; mais on constate que les benzodiazépines sont de plus en plus souvent en cause dans les accidents. Alors qu'en 1999, les problèmes que l'on me soumettait durant les repas de famille concernaient essentiellement l'usage de cannabis, il y est aujourd'hui beaucoup plus souvent question de poker – qui mobilise des sommes considérables. Il est regrettable que nous ne puissions aujourd'hui que survoler les problèmes et j'espère que vous donnerez un jour les moyens d'une expertise plus apaisée et plus construite.
L'association que je représente regroupe cinq cents structures réparties sur l'ensemble du territoire national. Il importe de ne pas appréhender de manière uniforme des questions qui se révèlent très différentes selon les personnes et les situations. Les usagers que je reçois à Saint-Germain n'ont pas la même vie que ceux que je reçois dans le quartier du Val-Fourré et ne doivent donc pas être pris en charge de la même façon, même si c'est là une chose terrible à dire pour un républicain. Ainsi, la plupart des usagers que je rencontre à Mantes-la-Jolie n'ayant ni permis de conduire, ni assurance – et n'en ayant souvent que faire –, certaines des sanctions proposées semblent d'une naïveté déconcertante. Il nous faut déployer des réponses diverses, selon un axe transversal répondant à la diversité des publics et un axe temporel répondant à leurs évolutions.
Le « standard unique », fondé sur le sevrage et l'abstinence, a eu des effets négatifs car il ne tenait pas compte de ces évolutions, mais il n'est pas question d'y renoncer pour autant : on peut fort bien continuer à recourir au sevrage et à l'abstinence tout en proposant aussi une politique de réduction des risques. Je vous engage à consulter à ce propos les travaux de MM. Sobell et Klingemann sur la sortie des addictions en population générale et ceux de MM. Prochaska et De Leon, fondateurs de communautés thérapeutiques, sur l'importance de la motivation.
L'association que je représente développe des programmes d'éducation préventive, car il n'y a aucune honte pour des parents à souhaiter que leurs enfants ne deviennent pas usagers. Il n'en est pas moins indispensable d'intervenir en milieu festif, sous peine de ne plus jamais avoir accès aux enfants qui fréquentent ce milieu. Sans la réduction des risques, la jeune fille de quinze ans que je recevais ce matin, qui a fréquenté des rave parties et a connu des moments difficiles, n'aurait pu arriver jusqu'à mon bureau et travailler sur l'abstinence comme elle le fait aujourd'hui.
Notre association a bataillé avec M. Xavier Bertrand, dans ses précédentes fonctions de ministre chargé de la santé, pour imposer les communautés thérapeutiques qui se voyaient alors reprocher d'être trop coûteuses, de venir de l'étranger et de n'être pas scientifiquement validées.
Les salles de consommation à moindres risques ne sont pas pour nous l'outil essentiel mais nous en avons besoin pour un public particulier dans des endroits précis. Nous recevons aussi des personnes ayant fait l'objet d'une injonction thérapeutique – de fait, quand on conduit sous l'emprise de substances, il est normal d'être sanctionné. Il convient, je le répète, de mettre en oeuvre l'ensemble des réponses nécessaires.
Enfin, l'un des savoir-faire des professionnels consiste à proposer le bon outil aux personnes qu'ils prennent en charge, afin de leur faire faire un pas en avant. Aucun professionnel ne s'impose et n'est confronté à tant de difficultés d'exercice dans le but de faciliter l'usage de drogues, et c'est nous faire un mauvais procès d'intention que de nous soupçonner de créer certains outils de réduction des risques en vue de banaliser l'usage de ces substances. La notion d'« éthique du moindre mal » proposée par l'Espace éthique de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris exprime bien l'idée qu'il faut mettre la marche à la hauteur que la personne concernée peut atteindre. Celles pour lesquelles nous souhaitons la création de salles de consommation sont déjà allées plusieurs fois à l'hôpital, ont subi plusieurs sevrages et encombrent les services d'urgence, ce qui coûte très cher et ne sert à rien. Un outil adapté est donc nécessaire.
Ainsi, nous avons conclu à la nécessité des salles de consommation après avoir examiné diverses solutions et expérimenté les maraudes, qui n'ont pas donné de grands résultats – je ne me réjouis pas moins d'apprendre que des maraudes renforcées sont organisées avec des psychiatres, car nous avons du mal à obtenir la présence de ces derniers dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et autres structures de soins. La création de ces salles devrait s'accompagner de celle d'autres outils, dans les domaines notamment du logement et de la socialisation.
Les parlementaires ont la responsabilité d'adapter les réponses à un univers qui n'est plus celui des années 1970 – et encore moins celui de mai 1968, qui ne signifie plus rien pour les jeunes du Val-Fourré ; ils n'ont en effet aucun idéal de solidarité et sont pris dans une course frénétique à l'argent et à la surconsommation, dans une société d'hyperviolence. Nous vous demandons des outils permettant de répondre à ces jeunes et non pas à une jeunesse idéale dont nous rêverions et que nous nous donnons de moins en moins les moyens de construire.
Je n'ai, pour conclure, aucun doute sur les conclusions de cette mission, que je sais tranchées d'avance, mais j'aurai au moins eu le plaisir de dire ce que je pense, au nom des professionnels que je représente.
Act-up Paris est une association de malades et d'activistes qui lutte contre les discriminations et pour les droits des populations particulièrement touchées par le SIDA, parmi lesquelles les prisonniers, les migrants, les femmes, les homosexuels et les usagers de drogues. Dans les années 1990, nous avons fait partie du mouvement en faveur de la réduction des risques, laquelle doit être développée et se voir dotée d'outils innovants. Vingt-six départements qui ne disposent d'aucune structure de réduction des risques devraient être dotés de centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Les données sur la consommation de drogues par les femmes sont insuffisantes et les programmes qui leur sont spécifiquement destinés sont trop peu nombreux. Il faudrait également diversifier l'offre de traitements de substitution aux opiacés. En effet, les deux produits de substitution actuellement disponibles, le Subutex et la méthadone, ne conviennent pas à tous les usagers ; il importe donc de développer des produits inhalables et injectables, ainsi que l'héroïne médicalisée.
Deux actions d'urgence s'imposent pour deux populations vulnérables. La première concerne les détenus. La consommation de drogues, y compris par injection, est en effet très importante en prison. Un rapport indique que plus de la moitié des usagers de centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ont été au moins une fois en prison et une enquête récente montre que le partage de matériel est courant entre usagères de drogues incarcérées. La réduction des risques ne s'applique pas en prison, où les usagers de drogues manquent d'informations et ne disposent que d'eau de Javel, en outre souvent sous-titrée et donc inefficace face au VIH et au virus de l'hépatite C. Quant aux programmes de substitution, de nombreuses prisons ne les mettent pas en oeuvre ou le font mal, distribuant par exemple les produits sous une forme inadaptée en les pilant et en les diluant dans de l'eau, ce qui en annule l'efficacité.
La deuxième urgence concerne les gens qui vivent dans la rue et se « shootent » dans les caves, les parkings ou les toilettes publiques – situation indigne pour notre société. Pour ce public très précarisé, un collectif dont nous faisons partie a proposé la création de salles de consommation supervisées. L'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale montre que de telles salles ne créent pas de nouveaux consommateurs et n'encouragent pas non plus les usagers de drogues à en consommer plus. Si ces salles ne sont pas une panacée, elles sont du moins un outil de santé publique et d'ordre public, réservé à un public très restreint et très précaire.
Contrairement à ce qui avait été annoncé, le recours à la méthadone et les échanges de seringues n'ont pas banalisé l'usage de la drogue. Il en va de même pour les salles de consommation : les usagers ont des styles de vie et d'usage si différents qu'il faut leur ouvrir une nouvelle porte d'accès aux soins et leur permettre de rencontrer des soignants. Il ne s'agit ni de banalisation ni d'un premier pas vers la dépénalisation de l'usage, comme le montre l'expérience de nombreux pays en la matière. En 2001, l'ouverture de la salle de consommation de Vancouver s'est traduite par une augmentation de plus de 30 % des demandes de sevrage et de substitution dans cette ville. Les salles de consommation n'ont rien à voir avec des « squats », mais permettent aux usagers de rencontrer des professionnels qui les conseillent et les orientent. Une étude parue en septembre dans la revue Drug and alcohol dependence montre que les salles de consommation peuvent aider les usagers à quitter durablement la drogue. Je rappelle que ces salles ont le soutien de villes et collectivités territoriales telles que Paris, Marseille, Nancy ou la région d'Île-de-France. Elles pourraient représenter une solution au problème du crack. À Rotterdam, en effet, les crackers ont disparu des rues, où ils étaient plus de 2 500 – et ont pu se réinsérer grâce à ce dispositif. Nous en sommes encore bien loin à Paris.
La politique de réduction des risques a donc été efficace contre le VIH et les surdoses – même si le nombre de celles-ci a récemment augmenté de 30 %. Pour qu'elle reste efficace, il faut créer des outils innovants et développer ceux qui existent déjà.
Notre mission, composée de quinze sénateurs et quinze députés de sensibilités et de professions différentes, n'a pas vocation à produire un rapport prescriptif, et encore moins un rapport centré sur les « salles de shoot ». Ne nous faites pas, monsieur Jean-Pierre Couteron, un procès surréaliste : notre mission d'information synthétisera avec la plus grande objectivité les éléments issus des auditions auxquelles elle procède – et durant lesquelles les scientifiques expriment, eux aussi, des opinions très différentes. Notre objet, je le répète, n'est pas de produire un texte de loi, mais de permettre à tous les parlementaires et à tous les lecteurs du rapport d'avoir une vision globale des toxicomanies – ou, si vous préférez ce terme, des addictions.
Enfin, la limitation du temps de parole lors de nos auditions ne signifie pas que votre expression soit limitée : nous ne manquerons pas de lire les communications écrites que vous voudrez bien nous remettre.

Monsieur le coprésident François Pillet, les mots ont un sens. Parler de « salles de shoot » exprime déjà bien des choses ; mieux vaudrait employer l'expression de « salles de consommation à moindres risques ».

Nous prenons acte des clivages qui s'expriment. Il importe en effet que nous entendions la diversité des opinions, afin que notre rapport évite les solutions préconçues. Il ne s'agit pas d'opposer option morale et permissivité morbide mais plutôt de définir des solutions pour la prise en charge des personnes confrontées à l'addiction et des mesures propres à assurer une prévention efficace, en examinant certains « codes » qui provoquent un désastre chez les jeunes. Quel sera leur avenir et quelle société pourrons-nous leur offrir ? Une fraternité dans la consommation ou un avenir sans addiction ?
En matière de prévention, les parents, qui souhaitent légitimement le meilleur pour leurs enfants, constatent les dégâts. Lorsque les jeunes sont tombés dans la consommation, il faut saluer le travail d'accompagnement réalisé sur le terrain par les associations mais, malgré les outils variés dont nous disposons aujourd'hui, l'objectif n'est pas tant d'accompagner et de gérer à l'infini la consommation que de diminuer le nombre de personnes ayant à fréquenter les centres de soins. Les politiques de prévention peuvent, en réduisant la demande, réduire également l'offre et, partant, les trafics. L'importance de ces derniers justifierait du reste la création d'une mission d'information spécifique.
Les salles d'injection ne sont pas unanimement considérées comme des outils pertinents. Le sujet a en effet suscité des études contradictoires et la politique de réduction des risques, au sein de laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale place ces dispositifs, n'est que l'un des éléments, presque marginal, de la lutte contre la toxicomanie et la prise en charge des toxicomanes. Nous irons certes visiter des salles d'injection mais, je le répète, elles ne sont pas l'unique objet de notre mission. Nous devrons également prendre en compte les différentes études sur ces salles, comme celles qui ont été réalisées en Suisse par l'Office fédéral de la santé publique et dont les conclusions ne privilégient nullement cette solution.
Comment rendre plus efficaces les campagnes de prévention menées auprès des jeunes ? Faut-il une information collective ou personnalisée ? À quel âge faut-il commencer la prévention ? Pour ce qui est de la prise en charge de la schizophrénie, faut-il envisager une loi ? Par ailleurs, la logique judiciaire et la logique médico-sociale sont-elles antinomiques ou complémentaires ? Enfin, madame Lia Cavalcanti, adoptez-vous une approche différente pour accompagner les usagers de drogues selon qu'ils sont simples consommateurs ou « dealers » ?

Bien que notre mission soit en effet une mission d'information, nous sommes aussi ici pour faire la loi.
Une société sans drogues n'existe pas – et cela d'autant moins qu'on autorise désormais la publicité pour l'alcool et les jeux de hasard sur internet.
Monsieur et madame Philippe et Nadine Poinsot, monsieur Richard Maillet, pouvez-vous préciser vos propos, qui laissent penser que la loi française serait trop laxiste, alors qu'elle a plutôt la réputation, en Europe, d'être répressive ? Il me semble par ailleurs légitime de distinguer, comme c'est le cas depuis la circulaire dite « Guigou » du 17 juin 1999, les usagers de drogues de ceux qui en détiennent ou en vendent. Enfin, monsieur Richard Maillet, vous avez déclaré que l'ouverture de salles d'injection supervisées contredirait les arguments pertinents qui ont fait leurs preuves auprès des jeunes publics qui ne sont pas encore dépendants. Or, les usagers de drogues par injection ne sont pas du tout le même public que les enfants, parfois très jeunes, auxquels vous faites allusion.
J'évoquais pour ma part les délits routiers. La France fait certes partie des pays où les lois sont les plus répressives, mais ces lois ne sont pas appliquées. Je vous invite à consulter la rubrique de notre site internet présentant un tableau comparatif des peines encourues, des peines requises et des peines prononcées : la pratique est bien loin du code pénal.
Il est frustrant que le débat ne soit pas plus large. Aucun des dix-sept pays du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale dans lesquels je travaille au titre d'experte de la Commission européenne n'a réduit son taux de consommation de drogues dans la population générale. En Égypte, où les autorités niaient la consommation de drogues, la presse annonçait pourtant chaque jour de nouvelles saisies de substances…
Nous vivons dans une société individualiste qui offre, pour chaque problème, une solution par la consommation. La société de consommation sait faire consommer, mais elle ne sait pas comment faire abandonner les habitudes de consommation. Il faudra bien pourtant que nous l'apprenions, notamment dans le domaine écologique. Cet individualisme croissant tient au mode de vie contemporain. Mon public est constitué des exclus du processus de mondialisation, qui seront de plus en plus présents dans tous les centres urbains du monde. Le crack est en train de dévorer le Brésil, mon pays d'origine. Au lieu d'essayer d'imputer le laxisme ambiant aux politiques de nos opposants, cherchons à voir comment inciter les individus à réduire leur consommation, et cela pour toutes les addictions. Aucun pays n'a tenu ce pari.
La seule issue est, comme le propose M. Jean-Pierre Couteron, de travailler d'une manière transversale et adaptée à des populations très diverses. Nous respectons le travail des représentants du peuple ; évitons cependant les écueils simplistes : la volonté des pères et mères de famille et celle du législateur ne suffiront pas à réduire la consommation. Ce qui est en jeu, ce sont les modes de vie. Je rencontre ainsi, dans le cadre de mon association, un ambulancier victime d'une addiction à l'alcool – une drogue légale –, ou des éducateurs présentant des addictions au sexe ou au jeu. Ces addictions prolifèrent dans notre culture et le « laxisme » des gouvernements précédents n'en est pas responsable.
Le principe même de l'universalité des soins exige qu'un soignant ne juge pas la personne qu'il reçoit. Parmi les 40 % de personnes sans ressources que je reçois, un grand nombre sont de petits « dealers », mais ils vivent dans la plus grande exclusion et le plus grand dénuement : ce ne sont pas eux qui sont responsables du grand trafic international. Je suis dans l'incapacité de faire une distinction entre consommateurs et « dealers », et cela ne me concerne pas.
La question de fond est celle de la capacité à faire valoir ses droits. L'addiction fait basculer du droit commun, où la liberté peut s'exercer, à une zone où la présomption de capacité est mise en cause. Ce phénomène est particulièrement préoccupant lorsqu'il s'agit d'un jeune : celui-ci sait-il que son comportement va lui faire perdre sa capacité à l'autonomie ? Le législateur est à cet égard plus éclairé que la science médicale même. Ces questions sont en effet régies par la législation sur la capacité juridique, celle sur les soins sans consentement et l'article 122-1 du code pénal, qui prennent en compte l'altération ou l'abolition du discernement. Le législateur a fort justement prévu que, lorsqu'on sort du droit commun, on entre dans une zone qui n'est pas de condamnation, mais de protection : celle du droit des incapacités.
Nos stratégies de prévention ne sont pas bonnes et nous devons y réfléchir. Il faut communiquer sur les dangers que représentent certains comportements et certaines substances. Des études montrent qu'il faut avancer progressivement, en commençant par les dangers qui concernent le plus grand nombre de personnes. Ainsi, il est parlant d'évoquer les troubles de la concentration ou de la mémoire qu'induit la consommation de cannabis. Par exemple, un boucher qui consomme du cannabis m'a dit qu'il était conscient d'oublier parfois quelles pièces de viande il était venu chercher dans son réfrigérateur… À la différence de la maladie mentale, l'addiction ne se traduit cependant pas systématiquement par une perte de responsabilité.
Nous parlons de personnes « à demi capables ».
Vous avez raison, de nombreux consommateurs de substances sont désormais dans une banalisation de l'usage qui va au-delà de la psychopathologie. L'atteinte de certaines fonctions est un des arguments les plus efficaces de la prévention.
Par ailleurs, peut-être par découragement face à notre incapacité à éduquer, nous avons aujourd'hui tendance à privilégier la répression. Mais, là où je travaille, les policiers ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 pour interpeller les usagers et une telle approche, si elle était possible, aggraverait le problème. Il nous faut donc disposer d'outils complémentaires permettant de rencontrer des jeunes avant l'interpellation – c'est une exigence pour tout éducateur et un objectif d'éducation publique qui dépasse les clivages politiques. La peur de la sanction a certes un rôle à jouer, mais il faut aller au-delà.
Le docteur Claude Olievenstein décrivait comme facteur d'addiction la recherche d'instantanéité et d'intensité. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études supérieures pour comprendre que notre société d'hyperconsommation banalise ces deux éléments : on voit ainsi certains enfants, scolarisés dans les meilleurs lycées, se transformer en « psychopathes » à l'instant même où une panne d'ordinateur les empêche de recevoir leurs courriels. De fait, des consultations de plus en plus nombreuses sont motivées par des comportements liés à l'ordinateur.
Quant aux communautés thérapeutiques – pour lesquelles nous allons développer des formations avec M. Georges Van der Straten, qui dirige des communautés belges –, elles sont certes utiles, mais seulement pour les personnes qui peuvent y entrer. En effet, elles n'accueillent pas tout le monde et la loi doit permettre aux équipes qui travaillent sur le terrain d'avoir des portes d'entrée aussi nombreuses que possible pour donner accès au système de soins. Nous avons signalé quelques dysfonctionnements et nous réjouissons qu'ils soient relayés d'une manière moins médiatique et moins polémique qu'à certains moments.
En écoutant, comme aujourd'hui, les associations qui travaillent sur le terrain, le législateur cherche à déterminer quelles politiques mettre en oeuvre pour prendre en charge les toxicomanies et quelles logiques doivent les sous-tendre. Les modes de vie contemporains sont hétérogènes et nous devons toujours veiller à préserver la liberté de nos concitoyens. Il incombera donc un jour au législateur de s'assurer que le droit est adapté à la situation qu'il est supposé régler. Aussi tenons-nous à vous questionner sur les outils qui vous paraissent les plus pertinents et que certains d'entre vous mettent en oeuvre, comme les communautés thérapeutiques. Nos conclusions sont loin d'être déjà écrites : nous sommes réunis pour comprendre afin d'apporter une meilleure réponse à des problèmes douloureux.

Ma question s'adresse aux représentants de Médecins du monde, qui ont évoqué deux populations particulières, les sans-abri et les prisonniers. Comment, d'une part, améliorer le travail accompli auprès des sans-domicile fixe ? Quelles actions mener dans les établissements pénitentiaires, à la fois pour améliorer la prise en charge des consommateurs de drogues et pour éviter que des détenus non consommateurs au moment de leur incarcération ne sortent de prison usagers ou trafiquants ?
Compte tenu de la criminalisation croissante des personnes en marge de la société, ces deux populations tendent précisément à se rapprocher. L'application des lois sur la récidive fait que la France suit malheureusement le chemin des États-Unis en pénalisant l'usage simple de manière grandissante. Il en résulte que l'on trouve de plus en plus de fous en prison parce que notre système public de santé psychiatrique est en déshérence, et que de plus en plus de personnes sont incarcérées en raison d'une infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il conviendrait de rééquilibrer l'approche répressive et les approches de santé publique, celles-ci étant malheureusement considérées comme secondaires. Dire cela ne signifie pas qu'il faudrait permettre de se fournir en héroïne au supermarché local.
J'ajoute que les débats qui ont lieu en France à ce sujet ne peuvent être déconnectés de l'environnement international, à la fois parce que Médecins du monde, présent dans plusieurs pays, a pu constater que les efforts faits pour réduire la consommation n'ont pas permis de juguler l'offre – c'est le cas notamment en Afghanistan où sont pourtant stationnées les troupes de la coalition – et parce que nous devons tenir compte des conventions qui nous lient, en particulier la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes conclue à Vienne le 20 décembre 1988.
M. Claude Olievenstein l'avait souligné : « La toxicomanie, c'est la rencontre entre un individu, un contexte social et un produit ». Or l'environnement économique et social mondial pousse malheureusement de plus en plus de personnes à se tourner vers des consommations destinées à réparer une souffrance, qu'il s'agisse des réfugiés ou des personnes incarcérées alors que leur place n'est pas en prison. Le législateur devra veiller à rééquilibrer l'approche pénale et l'approche de santé publique, cette dernière étant manifestement au second plan en ce qui concerne les usagers de drogues emprisonnés.
Entre 30 et 40 % des sans-domicile fixe connaissent des troubles mentaux ou des problèmes d'addiction, mais l'accès aux soins et l'accès au logement vont de pair. Pour pouvoir les soigner, il faudrait d'abord appliquer la loi. Or, sur les cinq cents permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, prévues par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, trois cent quatre-vingt-dix seulement sont ouvertes, et la plupart ne sont pas opérationnelles ; quant aux permanences d'accès aux soins de santé mobiles psychiatriques, elles n'existent que dans certaines villes, comme Marseille et Paris. Ces structures sont trop peu nombreuses, et de loin, pour répondre aux besoins.
Par ailleurs, la prise en charge médicale doit se faire dans des conditions d'hébergement décentes. Or les structures d'accueil sont à la fois en nombre insuffisant et inadaptées à la diversité des profils des personnes vivant dans la rue, si bien que la continuité des soins n'est pas assurée. Des structures nouvelles permettant à la fois l'hébergement et une prise en charge spécifique sont nécessaires.
Nous pourrions débattre indéfiniment des bienfaits d'une société sans addictions, madame la corapporteure Françoise Branget, mais le principe de réalité nous commande de vous rappeler les enjeux de santé publique et les urgences sanitaires – effets collatéraux de la drogue – auxquels nous devons faire face puisqu'usage il y a : ainsi en est-il de l'explosion de l'épidémie d'hépatite C, maladie qui touche désormais près de 60 % des usagers de drogues par voie intraveineuse.

La problématique ne se résume pas à la toxicomanie ou à l'addiction. Elle concerne le logement, l'emploi et la santé publique. La prise en charge de l'individu doit donc être globale, sous peine de ne rien régler. Dans cette optique, travaillez-vous avec l'ensemble des acteurs sociaux, socio-éducatifs et socio-économiques ? Dans la mesure où la dispersion de l'argent public nuit à l'efficacité, les efforts ne devraient-ils pas être regroupés ? L'Éducation nationale consacre-t-elle des programmes à l'addiction et ce thème est-il abordé en cours de sciences de la vie et de la terre ? Je pense aussi que le message des pouvoirs publics, pour être efficace, doit être compris de tous. Il pourrait s'inspirer de la campagne « Tu t'es vu quand t'as bu ? », qui renvoyait au comportement individuel et à la responsabilité de chacun.

Il est évident que nous ne pourrons malheureusement pas agir contre toutes les addictions, mais nous pouvons espérer les minimiser. Je vous accorde qu'il s'agit d'un problème de santé publique ; je considère que la prévention doit passer avant toute chose car les effets collatéraux des drogues m'inquiètent. Je parle du décrochage scolaire menaçant les collégiens de cinquième qui ont pris l'habitude de fumer un « joint » le matin avant les cours, sinon davantage, ce qui les inscrit dans un parcours de désociabilisation ; je parle aussi des accidents de la route dus à des conducteurs sous l'emprise de cannabis, contre lesquels lutte l'association Marilou, et de leur cortège de drames.
Il est de la responsabilité de tous, acteurs de terrain et législateurs, de réduire le nombre de personnes toxicodépendantes. Bien sûr, nous ne changerons pas le monde ; mais concentrons nos efforts et agissons dans la même direction plutôt que de creuser des clivages politiques.
Face à cette détresse, la question de M. le corapporteur Gilbert Barbier est juste. Non, les campagnes de prévention ne sont pas bonnes, car informer n'est pas éduquer. La responsabilité de cette situation n'incombe pas aux associations qui tentent d'agir, mais à ceux qui ont pour tâche de mettre en oeuvre les politiques publiques. Il ne s'agit pas simplement de poser des interdits pour poser des interdits. Faute de l'avoir compris, les pouvoirs publics conduisent des campagnes de prévention inefficaces. De plus, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a « détricoté » tout ce qui permettait d'appréhender l'addiction dans ses multiples dimensions – pénale, judiciaire, médico-sociale et sociale –, coupant court à l'interministérialité des politiques. De même, il faut dire les dégâts causés par la révision générale des politiques publiques et par la création des établissements publics autonomes que sont les agences régionales de santé, qui ne prennent aucunement en compte la nécessaire transversalité des politiques publiques. Les parlementaires doivent réfléchir à cette question.
Nos actions de prévention en milieu scolaire sont très bien accueillies, en premier lieu par les élèves. Notre priorité est, pour éviter le risque, de prévenir la consommation en développant l'esprit critique des jeunes gens, en leur apprenant à dire « non », en leur montrant par les témoignages d'anciens toxicomanes ou les résultats d'expériences scientifiques réalisées sur des animaux ce que sont les conséquences de la consommation. Distribuer des tracts d'information sans distinguer entre non-consommateurs, expérimentateurs et consommateurs avérés est délétère.
Les arguments sanitaires ne portant pas auprès d'eux, nous n'avons trouvé que deux leviers pour agir avec efficacité auprès des jeunes : ils n'aiment guère « se faire avoir » et détestent perdre leur liberté. Il convient aussi d'impliquer les parents, souvent démunis face au phénomène, et de leur donner des clés pour communiquer.
La table ronde s'achève à dix-huit heures quinze.
L'audition débute à dix-huit heures quinze.
La Mission d'information sur les toxicomanies entend, en audition conjointe, MM. le professeur Paul Lafargue, président de la commission « Substances vénéneuses et dopantes » de l'Académie nationale de pharmacie, le professeur Pierre Joly, président de l'Académie nationale de médecine et le professeur Jean Costentin, membre de la commission sur les addictions de l'Académie nationale de médecine.
J'ai dirigé pendant vingt-quatre ans une équipe de neuro-psycho-pharmacologie expérimentale du Centre national de la recherche scientifique, dont les principaux objets d'étude étaient la cocaïne et le cannabis. Je suis membre de la commission sur les addictions de l'Académie nationale de médecine et de la commission « Substances vénéneuses et dopantes » de l'Académie nationale de pharmacie.
Président du Centre national de prévention, d'études et de recherches sur les toxicomanies, je dirige aussi une consultation destinée aux usagers de cannabis à l'hôpital. Je donne régulièrement des conférences sur les méfaits du cannabis à des publics scolaires, des universitaires, des psychiatres et des équipes éducatives. Je fais partie du conseil scientifique de l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques. J'ai publié l'ouvrage « Halte au cannabis », participé à la rédaction du rapport « Désamorcer le cannabis dès l'école » de l'Académie nationale de médecine et écrit, avec M. Henri Chabrol et Mme Marie Choquet, « Le cannabis et ses risques à l'adolescence ».
Les statistiques de la consommation de drogues dans notre pays sont calamiteuses : 15 millions de Français sont en délicatesse avec le tabac, 4 millions avec l'alcool, et 1,7 million d'entre eux fument au moins un « joint » de cannabis tous les trois jours, ce qui les classe dans la catégorie des « usagers réguliers ».
L'exceptionnelle lipophilie du tétrahydrocannabinol (THC) en fait la drogue qui est stockée le plus durablement dans le cerveau, si bien qu'un « joint » tous les trois jours suffit à stimuler en permanence les récepteurs CB1. Mais la désensibilisation de ces récepteurs et la tolérance de plus en plus grande qui en résulte conduisent certains à accroître les doses pour continuer de ressentir les effets du cannabis : c'est le cas des 600 000 usagers quotidiens et multi-quotidiens. Le nombre total des consommateurs de cannabis place la France en tête des vingt-sept États membres de l'Union européenne.
On a longtemps contesté l'escalade dans l'usage de drogues alors qu'elle est évidente et, dans l'échelle qui mène de la consommation de méthylxanthines – présentes dans le café – à l'héroïne, en passant par le tabac, l'alcool et le cannabis, la cocaïne est de plus en plus prisée, comme le montre l'ampleur croissante des saisies. Ensuite, viennent les produits de substitution, Subutex et méthadone, qui font l'objet d'un trafic scandaleux. C'est particulièrement vrai pour le Subutex, dont un tiers des cachets, remboursés une fortune par la Sécurité sociale, sont absorbés par des jeunes gens qui n'étaient pas jusque-là usagers d'opiacés mais qui, quand ils ne se satisferont plus du Subutex, passeront à l'héroïne. Or, on dénombre déjà 250 000 héroïnomanes en France.
Pourquoi ces nombres terrifiants ? Les présidents de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie qui se sont succédés ont commis de graves manquements en ne prenant pas la mesure du drame ou en ne faisant rien pour l'empêcher. Mme Nicole Maestracci et, dans une moindre mesure, M. Didier Jayle ont joué un rôle délétère ; les responsabilités devront être recherchées. La campagne d'information que j'ai conduite était battue en brèche par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales au point que j'ai eu le sentiment de me trouver face à une « Mission interministérielle de lutte contre les détracteurs de la toxicomanie » ! Je rends hommage au président actuel de la mission interministérielle, qui tient enfin un discours adapté aux enjeux sociétaux posés par la drogue. Non, la drogue n'est pas une fatalité, même si le combat que nous menons contre les toxicomanies peut évoquer le mythe de Sisyphe. Il faut exercer une pression pédagogique constante et contenir notre attirance toxicophile. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, mais s'il y a négligence ou, pire, complaisance, on aboutit aux statistiques que je vous ai communiquées.
Dans les années 1970, la Suède connaissait une situation semblable à celle qui est la nôtre maintenant. Puis le psychiatre Sven Andreasson a effectué, à partir d'une cohorte de 50 000 conscrits, une étude sur la relation entre leur consommation de cannabis avant l'âge de la conscription et l'évolution de leur santé mentale pendant les dix années suivantes. Les conclusions de l'étude, publiée en 1987 dans The Lancet, établissent que le fait d'avoir fumé plus de cinquante « joints » avant l'âge de la conscription multiplie par six le risque de développer une schizophrénie. Mais, en France, ce qui dérange est occulté ou minoré – on l'a vu pour le tabac : à quelle époque a-t-on su que le tabac tuait chaque année 66 000 personnes, soit la moitié de la population de Rouen ? J'en veux terriblement aux décideurs irresponsables qui ont autorisé la vente des fameuses « P4 », cigarettes vendues par paquets de quatre, faisant du collégien que j'étais un fumeur régulier.
Je suis celui qui méconnaît le moins le cannabis en France. Vouloir légiférer sur cette drogue sans en connaître tous les tenants pharmacologiques, pharmacocinétiques, épidémiologiques et cliniques tient du parfait surréalisme ; je me tiens à votre disposition pour un cours en la matière…
Est-il exact que l'on est parvenu par sélection génétique à augmenter le taux du principe actif contenu dans les plants de cannabis ?
C'est vrai. Les croisements ont permis d'obtenir un taux de principe actif multiplié par 8 – et celui des fleurs femelles sinsemilia est encore plus élevé. Les fumeurs de « joints » sont ainsi passés de la consommation conviviale et du rire bête à la « défonce ». Or, ces produits sont désormais en vente sur internet, et les « grow shops », qui ont scandaleusement pignon sur rue, vendent le matériel nécessaire pour une culture en chambre, hydroponique, sous éclairage artificiel, conçue pour la production de plants au taux de THC décuplé – avec les effets associés.
Peut-on parler de toxicomanie s'agissant de la consommation de cannabis ? En d'autres termes, cette drogue rend-elle dépendant ? Par ailleurs, qui doit mener les actions de prévention ? Quelles sont les populations prioritaires ? La médecine scolaire joue-t-elle son rôle ? Quel est celui de l'Académie nationale de médecine ?
50 % des filles et 70 % des garçons ont expérimenté le cannabis à l'âge de 18 ans. Le fait que 1,7 million d'entre eux deviendront des usagers réguliers traduit un pouvoir d'« accrochage » – de pharmacodépendance – très fort.
Pour caractériser la toxicomanie, on s'attache toujours aux manifestations de l'abstinence. Or la période de stockage du THC dans le cerveau est si longue qu'un fumeur peut attendre plusieurs jours avant d'avoir besoin d'un autre « joint » ; il peut donc ignorer être dépendant. Lorsque l'usager régulier est contraint de cesser sa consommation, par exemple s'il est incarcéré – encore que dans les prisons françaises, le cannabis se trouve plus facilement qu'en d'autres lieux – les manifestations physiques de l'abstinence ne se perçoivent que quinze ou vingt jours plus tard. Une étude australienne sur des usagers réguliers incarcérés – sachant que dans les prisons australiennes la drogue ne circule pas – a même montré que l'élimination urinaire des produits persistait huit semaines après l'arrêt de toute consommation.
En raison de cette longue rémanence, à aucun moment le consommateur ne ressent l'abstinence de façon abrupte. Toutefois, la dépendance physique a été avérée par l'administration d'un antagoniste des récepteurs CB1, le rimonabant : en se substituant brutalement au THC, il déclenche des syndromes d'abstinence semblables à ceux observés chez les héroïnomanes. La pharmacodépendance au cannabis est donc très forte, mais elle est masquée par la lente disparition du THC dans l'organisme.
Comme l'Académie nationale de médecine l'a expliqué dans son rapport « Désamorcer le cannabis dès l'école », la pédagogie commence bien trop tard en France. En Suède, on inculque aux enfants la peur de la drogue dès la maternelle, et cette aversion est entretenue par 40 heures de cours sur les méfaits des drogues dispensées jusqu'à l'enseignement supérieur.
En France, cet enseignement manque cruellement. Je suis parvenu à faire introduire deux heures consacrées aux drogues dans le programme de la première année commune aux études de santé. C'est encore très insuffisant et cela ne concerne que bien trop peu d'étudiants, mais au moins l'auditoire reçoit ainsi des messages qui ne lui ont jamais été transmis auparavant.
La rencontre avec le cannabis a lieu à l'adolescence, période de grande vulnérabilité où le système nerveux central n'est pas encore fini. En interférant dans les processus de « prolifération » et d'« élagage » en cours, le cannabis perturbe gravement son achèvement. Plus personne ne nie sérieusement la relation entre cannabis et schizophrénie ; plus le cannabis est consommé tôt et à des doses élevées, plus les conséquences sur le développement psychique, la mémoire, les processus éducatifs, l'anxiété et la dépression sont graves. Le discours sur le cannabis ne peut plus être celui qui nous était servi il y a trente ans. Quant aux arguments qui consistent à présenter le cannabis comme un médicament, ils procèdent d'une misérable manipulation.

Je n'affirmerais pas, comme vous le faites, que la drogue est absente des prisons australiennes.
Cependant, vous avez raison de souligner que le Subutex, souvent consommé dans un cadre festif, est un mode d'entrée dans la dépendance aux opiacés. Mais tout coûteux qu'il soit pour la collectivité, ce produit est aussi utile. Pensez-vous que le rapport bénéfices-risques du Subutex soit négatif ?
Le bénéfice du Subutex est avéré lorsque le produit est prescrit et délivré par des professionnels bien formés. S'il est pris dans une perspective de réduction progressive des doses menant à l'abstinence, il est irremplaçable et a toute sa place dans l'arsenal de lutte contre la toxicomanie. Le prix du Subutex augmente actuellement sur le marché noir, ce qui laisse penser que l'offre se raréfie. Mais pourquoi n'a-t-on pas combattu ce trafic pendant les quinze dernières années, notamment grâce à la carte Vitale ? Ce qui est insupportable, c'est que la collectivité se ruine à financer la part de ces médicaments qui sert à de nouveaux « recrutements » d'usagers et permet aux trafiquants de s'offrir leur « chère » héroïne.
Des pharmacologues, des toxicologues, des sociologues et des psychiatres siègent à la sixième des vingt commissions de l'Académie nationale de médecine, celle qui traite des addictions. La commission procède à des auditions, avant de voter, en général à l'unanimité, un rapport. Celui-ci est ensuite présenté à l'académie réunie en séance plénière et soumis à débat. Le rapport final, qui peut intégrer les éléments de cette discussion, est voté huit jours plus tard.
Sont ainsi parues au bulletin de l'Académie nationale de médecine des communications sur « Quels futurs traitements pour la dépendance au tabac et au cannabis ? » en janvier 2008, « Addiction à la cocaïne et au crack, un problème de santé qui s'aggrave », en avril 2009 et « Le cannabis, médicament ou drogue ? », en février 2010. Les actes du colloque « Désamorcer le cannabis dès l'école » ont été publiés en 2006. Enfin, le communiqué à propos du projet de création de salles d'injection pour toxicomanes a été adopté le 11 janvier dernier. À chaque fois, nos prises de position ont été très nettes.
Le professeur Jean Costentin a dit tout ce qu'il y avait à dire. On demande souvent aux professionnels de santé de résoudre les problèmes de la société ; ils préféreraient que de judicieuses politiques de prévention soient mises en oeuvre. Pour les médecins que nous sommes, les toxicomanes sont des malades comme d'autres, mais nous aimerions ne pas en recevoir autant dans nos consultations. L'académie a pris parti et sa position est ferme et constante : la prévention avant tout. Il faut parvenir à endiguer un phénomène qui ne bénéficie à personne. Les pharmacologues et les psychiatres, qui sont en première ligne, sont agacés par un climat de tolérance qui confine au laxisme ; la lucidité s'impose et je comprends la tonalité explosive de leurs propos.
L'hypothèse de la création de salles d'injection a fait l'objet d'un grand débat en notre sein. Les malades sont des malades, mais il est consternant de demander à des médecins d'assister à l'injection intraveineuse d'un produit dont ils ne connaissent pas l'origine et qui peut causer une mort. Mieux vaut prévenir.
Pourtant, des psychiatres se sont exprimés en faveur de ce dispositif.
Il peut y avoir des exceptions, mais ceux qui siègent à l'Académie nationale de médecine sont assez unanimes.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le débat qui a précédé le communiqué publié par l'Académie nationale de médecine le 11 janvier dernier ?
Le débat a été très long. Il a notamment porté sur l'argument, à mon avis assez utopique, selon lequel l'ouverture de salles d'injection supervisées permettrait de connaître les toxicomanes et ainsi de pouvoir les soigner. Le résultat du vote sur les termes du communiqué a été sans équivoque : 83 % de voix favorables, quelque 15 % contre, 2 ou 3 % d'abstentions.
Avant d'occuper ma fonction actuelle, je fus sept ans « expert national drogue ». À ce titre, je représentais notre pays au sein du groupe horizontal « Drogues » de la Commission européenne et il me revenait de mener en France les débats interministériels sur cette question pour parvenir à ce que tous parlent d'une même voix – une gageure !
Sur le sujet qui nous occupe, l'Académie nationale de pharmacie tient des séances thématiques ouvertes au public. À l'une, qui concernait les conduites addictives, nous avions d'ailleurs invité M. Pierre Chappard, président d'Act-up Paris ; une autre a été consacrée au thème « Cannabis et sécurité routière ». Nous avons aussi publié un rapport dressant le bilan des politiques publiques en matière de substitution aux opiacés. Nous organiserons le 19 octobre 2011 une séance thématique sur le thème « Drogues illicites, médicaments psychotropes et monde du travail » ; on constate en effet l'augmentation des accidents du travail dus à la consommation de substances psychotropes.
Comme l'a souligné le professeur Jean Costentin, les cannabinoïdes se concentrent dans les graisses ; or le cerveau est – à quelque chose près… – une « motte de beurre ». J'ai personnellement décelé des dérivés cannabinoïdes dans les urines soixante et onze jours après la dernière prise de l'individu considéré. Or le stress, en augmentant le taux de catécholamines dans le sang, induit la résurgence tardive du cannabis « stocké », si bien que le cerveau d'un sujet ayant cessé toute consommation depuis huit ou neuf jours peut se trouver subitement en état d'ivresse cannabique. Ce phénomène explique que depuis 1989 les dispositions réglementaires applicables en matière d'aéronautique militaire imposent la recherche systématique des conduites addictives. Depuis lors, des entreprises en nombre croissant ont inscrit dans leur règlement intérieur l'obligation de cesser toute absorption de substances psychotropes pendant l'activité professionnelle ; mais, sous l'effet du stress, une ivresse cannabique risque de se produire dont le sujet pouvait légitimement penser être à l'abri.
Le professeur Jean Costentin, outre qu'il est membre de la commission sur les addictions de l'Académie nationale de médecine, est aussi membre de la commission « Substances vénéneuses et dopantes » de l'Académie nationale de pharmacie. Tout ce qu'il a dit reflète une approche scientifique qu'il est difficile de réfuter, et je partage son point de vue. Les conclusions des travaux en commission sont fondées sur des débats au cours desquels nous auditionnons des personnalités qualifiées, dont des psychiatres. Nos propositions de recommandation sont ensuite soumises à l'approbation de nos collègues réunis en séances plénières – dites restreintes en ce qu'elles ne sont pas ouvertes au public – et les prises de position exprimées sont toujours celle de l'Académie nationale de pharmacie dans son ensemble.
Comme mes confrères l'ont souligné, il convient avant toute chose de renforcer la prévention. Cela étant, ne soyons pas naïfs : l'appétence pour les produits psychotropes ne disparaîtra pas et la consommation ne cessera pas. C'est bien sûr une absurdité d'incarcérer un consommateur de substance psychotrope – on n'a jamais mis un malade en prison. Le consommateur devenu dépendant doit être pris en charge comme tout autre malade mais la finalité du traitement doit être le sevrage et, quels que soient les aléas – rechutes et insuccès –, ne pas viser la cessation de la consommation serait une forme de non-assistance à personne en danger.
Il faut impérativement expliquer aux jeunes gens qu'ils doivent éviter de consommer ces molécules. La déscolarisation est, dans 95 % des cas, due à la consommation de cannabis, qui conduit rapidement à un besoin, lequel va entraîner un début de délinquance car il faut de l'argent pour se procurer le produit. De ce fait, le jeune consommateur déscolarisé se trouve progressivement désocialisé. Le problème n'est pas moral mais social. Je le redis, un consommateur de produit psychotrope est un malade qui doit être pris en charge, mais l'essentiel est de faire qu'il ne tombe pas malade ; de la même manière, on fera tout pour éviter qu'un patient souffrant de diabète de type 1 ne se trouve affligé d'un diabète de type 2 induit par des habitudes alimentaires nocives, qu'il faut corriger.

On se rappelle l'« aller-retour législatif » de l'Espagne à propos de la dépénalisation de l'usage du cannabis. Les risques induits par la consommation de cette substance ne laissent pas d'inquiéter si l'on pense par exemple que, lors des sorties scolaires, des classes entières sont confiées à des chauffeurs d'autocars… Peut-on efficacement détecter la présence de cannabis dans l'organisme comme on détecte la présence d'alcool en fonction du taux de gamma-GT ? Quel devrait être le rôle de la médecine du travail et de la médecine scolaire ? Quelles actions entreprendre pour sensibiliser les adolescents à des dangers qu'ils ignorent ?
M. le professeur Paul Lafargue. Le taux de gamma-GT ne servant qu'à signaler une induction enzymatique, le mesurer est selon moi sans intérêt. Nous disposons de tests immunologiques parfaitement efficaces de dépistage de la présence de cannabis dans l'organisme, mais leur fiabilité est mise en cause pour de bien mauvaises raisons. Le coût d'un tel test est d'environ 13 euros ; s'il faut, comme le soutiennent certains, en passer à chaque fois par la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, le coût unitaire du dépistage est compris entre 250 et 300 euros. Autrement dit, en niant la fiabilité des tests immunologiques, certains analystes défendent leur intérêt – et ce n'est pas la première fois. En 1992 déjà, M. Jean-Claude Gayssot, alors ministre chargé des transports, avait constitué une commission interministérielle chargée de définir les moyens propres à renforcer la sécurité routière. Mais le chiffrage de l'étude épidémiologique, fondée sur des tests réalisés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, était apparu budgétairement insupportable. Il ne s'agissait pourtant que de se faire une idée du nombre de sujets consommant des substances psychotropes et conduisant ; dans cette optique, une imprécision de 3 % était de peu d'importance. Il en est résulté que l'étude entreprise a été limitée aux conducteurs responsables d'accidents mortels, soit une cohorte très faible – et les tests de dépistage du cannabis au volant ont mis très longtemps à entrer dans les moeurs.
Le dirigeant d'une société de transport conscient de ses responsabilités s'attachera à mettre en oeuvre la recherche de conduites toxicophiles chez les chauffeurs qu'il emploie : addiction à l'alcool et aux drogues mais aussi aux médicaments, puisque la France occupe la première place mondiale du douteux palmarès de la consommation de benzodiazépines. Bien entendu, le secret médical demeure : de même que le médecin du travail peut déclarer inapte à un certain poste un salarié frappé d'hypertension artérielle, il peut déclarer inapte un chauffeur consommateur de substance psychotrope, sans davantage donner le motif de cette inaptitude.
Je ne m'attarderai pas sur la médecine scolaire, qui est l'ombre d'elle-même.
Je considère qu'il serait très mal venu de mettre à disposition des parents des tests leur permettant de déterminer eux-mêmes si leur enfant consomme du cannabis, car cela aurait pour effet de rompre la confiance entre enfants et parents. Cela étant, certains signes cliniques doivent alerter : vasodilatation entraînant le rougissement des yeux, comportement agressif, démotivation scolaire … Parler de ces symptômes au médecin de famille permet d'apprécier une consommation possible et d'engager un traitement.
M. le professeur Pierre Joly. La difficulté tient à ce que nous sommes confrontés d'une part à des consommateurs qui souhaitent reconnaissance et sécurité et, d'autre part, à des familles très angoissées ; on ne peut à la fois faciliter la consommation de drogue et rassurer les familles. Les individus dépendants ne se trouvent pas toujours dans cette situation volontairement – nous sommes nombreux à avoir fumé une première cigarette pour faire « comme papa » tout en la trouvant écoeurante. Il est difficile de dire qui a raison et qui a tort. Mais si nos confrères ont des réactions aussi vives, c'est que notre pays n'a pas de ligne politique claire : un jour on en tient pour les salles d'injection supervisées, un autre pour le dépistage… Il serait bon de prendre le temps de réfléchir sereinement à une prévention efficace et à une organisation satisfaisante. Il existe actuellement de remarquables centres de sevrage en France, mais ils sont pratiquement dénués de moyens. Plutôt que de lancer de nouvelles structures, pourquoi ne pas favoriser les structures existantes lorsqu'elles sont efficaces ? Aussi longtemps que les pouvoirs publics n'auront pas de position ferme et que les moyens manqueront, nous serons en permanence confrontés à des groupes de pression. Pourtant, moins l'on consomme de drogues, mieux l'on se porte.
La séance est levée à dix-neuf heures quarante.